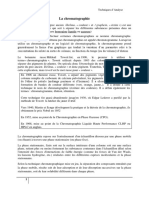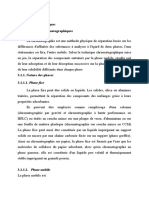Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Ta 1
Transféré par
همس المطرTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Ta 1
Transféré par
همس المطرDroits d'auteur :
Formats disponibles
La chromatographie
La chromatographie (du grec ancien khrôma, « couleur » et / graphein, « écrire ») est une
méthode physico-chimique qui sert à séparer les différentes substances présentes dans un
mélange (échantillon en phase homogène liquide ou gazeuse)
L'appareil utilisé pour effectuer certaines chromatographies se nomme chromatographe.
L'image ou le diagramme obtenu par chromatographie est appelé chromatogramme.
Lorsqu'on utilise un chromatographe et un logiciel de chromatographie, le chromatogramme
prend généralement la forme d'un graphique qui traduit la variation d’un paramètre relié à la
concentration du soluté en sortie de colonne, en fonction du temps (ou du volume) d’élution
Le botaniste russe Mikhail Tswett fut, en 1906, le premier à utiliser le
terme« chromatographie ». Tswett utilisait depuis 1903 des colonnes d'adsorption pour
séparer des pigments de plantes. On spécula donc l'étymologie du mot « chromatographie » à
partir du grec ancien khrôma, « couleur » et donc pigment. Toutefois, Tswett ne donna jamais
cette explication, mais tswett est le mot russe pour « couleur ».
En 1906 un chimiste russe, Tswett, a séparé des pigments végétaux colorés sur une colonne
remplie de carbonate de calcium pulvérulent, les pigments étaient entraînés avec de l'éther de
pétrole (mélange pentanes et d’hexanes). Il a observé sur la colonne la formation de bandes
de couleur différente (vert, orange, jaune..). Il a donné à cette technique le nom de
chromatographie (écriture des couleurs). Il a défini également les termes : chromatogramme,
élution, rétention.
Cette technique fut quasi-abandonnée jusqu'en 1930, où Edgar Lederer a purifié par la
méthode de Tswett la lutéine du jaune d’œuf.
Vers 1940, Martin et Synge développent la pratique et la théorie de la chromatographie, ils
obtiennent le prix Nobel en 1952
En 1952, mise au point de la Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG).
En 1968, mise au point de la Chromatographie Liquide Haute Performance CLHP ou HPLC
en anglais.
La chromatographie repose sur l'entraînement d'un échantillon dissous par une phase mobile
(ou éluant) à travers une phase stationnaire (ou phase fixe).
La phase stationnaire, fixée soit sur la surface intérieure d'une colonne soit sur une surface
plane, retient plus ou moins fortement les substances contenues dans l'échantillon dilué selon
l'intensité des forces d'interactions de faible énergie (comme les forces de Van der Waals,
les liaisons hydrogène, etc.) réalisées entre les différentes espèces moléculaires et la phase
stationnaire.
Selon la technique chromatographique mise en jeu, la séparation des composants entraînés par
la phase mobile, résulte soit de leur adsorption et de leur désorption successives sur la phase
stationnaire, soit de leur solubilité différente dans chaque phase.
Les différents types de chromatographie
• chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC en anglais) ;
• chromatographie enphase gazeuse (CPG ou GC en anglais) également appelée CPV
(chromatographie en phase vapeur) ;
• chromatographie en phase liquide (CPL ou LC en anglais) ;
• chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP ou HPLC en anglais) ;
La chromatographie en phase gazeuse
Technique de séparation applicable aux composés gazeux ou susceptibles d’être volatilisés
par élévation de T°. Elle est limitée aux composés thermostables et suffisamment volatils
(MM<300)
➢ Les gels de silice :
C’est la phase stationnaire la plus utilisée en chromatographie et notamment en C.L.H.P
Le gel de silice est constitué de micro sphères de diamètre sensiblement constant pouvant
varier de 2 à 5 µm.
Les gels de silice sont stables dans une grande gamme de pH mais ils ne supportent pas des
pH trop extrêmes. Il y a des risques de dissolution pour des pH trop acides ou trop basiques,
on se limite donc a la gamme 2 < pH < 12. Des gels spéciaux existent pour une utilisation à
pH extrêmes. La qualité d’un gel dépend de plusieurs paramètres : taille des grains, porosité
ouverte (dimensions et répartition des pores), résistance à l’écrasement, surface spécifique…
Les gels courants pour C.L.H.P ont les caractéristiques suivantes :
2
diamètre de 2 à 5 µm, résistance à l’écrasement sous 1000 bars, surface spécifique 350 m /g,
porosité 0,7 mL / g , taille des pores 10 nm.
CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE
PERFORMANCE: H.P.L.C
La chromatographie liquide haute performance est très utilisée dans tous les domaines de la
chimie analytique. Son succès est du au fait qu’il est possible de modifier la résolution en
jouant sur la composition de la phase mobile. Elle utilise des colonnes remplies d’une phase
stationnaire constituée de particules sphériques de très petites dimensions de diamètre
couramment compris entre 2 et 5 µm ce qui conduit à de grandes efficacité et résolution.
L’inconvénient est que plus les particules sont petites et plus il est difficile de faire s’écouler
le solvant, on doit donc utiliser des pompes spéciales qui poussent le solvant sous des
pressions très élevées. A l’origine le P de H.P.L.C correspondait donc au mot Pression. La
grande efficacité de la technique fait que le P désigne actuellement le mot Performance.
Comparaison CPG – HPLC
CPG HPLC
- Séparation en phase gazeuse - Séparation en phase liquide
- Composés volatils et non - Indifférent
thermolabiles - Séparation à température ambiante
- Séparation à température élevée - Grande latitude d’ajustement des
- Sélectivité limitée sélectivités
Ces deux Techniques analytiques sont de routine, Travail sur des quantités infimes de
produits. Domaines d’applications variés. Possibilité de coupler la technique avec d’autres
méthodes analytiques (AA, SM, IRTF…)
Les pompes doivent répondre aux exigences suivantes : fournir des pressions élevées jusqu'à
400 bars. Débit stable, et réglable de 0,1 à 10 mL/min. résistance à la corrosion quelque soit le
solvant utilisé
La pression à imposer dépend des facteurs suivants :
- débit de la phase mobile
- viscosité de l’éluant
- taille des grains de la phase stationnaire
- géométrie de la colonne
La phase normale:
La phase normale est constituée de gel de silice. Ce matériau est très polaire. Il faut donc
utiliser un éluant apolaire. Ainsi lors de l'injection d'une solution, les produits polaires sont
retenus dans la colonne, contrairement aux produits apolaire qui sortent en tête.
L'inconvénient d'une telle phase, c'est une détérioration rapide au cours du temps du gel de
silice, ce qui entraîne un manque de reproductibilité des séparations.
La phase inverse :
La phase inverse est majoritairement composée de silice greffée par des chaînes linéaires de 8
ou 18 atomes de carbones (C8 et C18). Cette phase est apolaire et nécessite donc un éluant
polaire. Dans ce cas, ce sont les composés polaires qui seront élués en premier. Contrairement
à une phase normale, il n'y a pas d'évolution de la phase stationnaire au cours du temps, et la
qualité de la séparation est donc maintenue constante.
Si la phase stationnaire est polaire, on utilisera une phase mobile peu polaire la
chromatographie est dite en phase normale ;
Si la phase stationnaire est très peu polaire, on choisira une phase mobile polaire ( le plus
souvent des mélanges de méthanol ou d'acétonitrile avec de l'eau), c'est la chromatographie en
phase inverse. En modifiant la polarité de la phase mobile, on agit sur les facteurs de rétention
des composés.
Chromatographie sur couche mince (CCM)
➢ Définition et appareillage:
La chromatographie sur couche mince (CCM) repose principalement sur des phénomènes d'adsorption
: la phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants, qui progresse le long d'une phase
stationnaire fixée sur une plaque de verre ou sur une feuille semi-rigide de matière plastique ou
d'aluminium. Après que l'échantillon ait été déposé sur la phase stationnaire, les substances migrent à
une vitesse qui dépend de leur nature et de celle du solvant.
Les principaux éléments d'une séparation chromatographique sur couche mince sont:
• la cuve chromatographique : un récipient habituellement en verre, de forme variable, fermé par un
couvercle étanche.
• la phase stationnaire : une couche d'environ 0,25 mm de gel de silice ou d'un autre adsorbant est fixée
sur une plaque de verre à l'aide d'un liant comme le sulfate de calcium hydraté plâtre, l'amidon ou un
polymère organique.
l'échantillon : environ un microlitre (µl) de solution diluée ( 2 à 5 %) du mélange à analyser, déposé en
un point repère situé au-dessus de la surface de l'éluant. l'éluant : un solvant pur ou un mélange : il
migre lentement le long de la plaque en entraînant les composants de l'échantillon.
➢ Principe de la technique.
Lorsque la plaque sur laquelle on a déposé l'échantillon est placée dans la cuve fermée, l'éluant monte
à travers la phase stationnaire, essentiellement par capillarité. En outre, chaque composant de
l'échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette vitesse dépend d'une part,
des forces électrostatiques retenant le composant sur la phase stationnaire et, d'autre part, de sa
solubilité dans la phase mobile. Les composés se déplacent donc alternativement de la phase
stationnaire à la phase mobile, l'action de rétention de la phase stationnaire étant principalement
contrôlée par des phénomènes d'adsorption.
Les paramètres de rétention en CPG (voir tirage)
Vous aimerez peut-être aussi
- Télédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauD'EverandTélédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauPas encore d'évaluation
- Chromatographie: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandChromatographie: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Cours Ta 1 2021Document17 pagesCours Ta 1 2021allali hanaaPas encore d'évaluation
- Technique Danalyse KouidriDocument33 pagesTechnique Danalyse Kouidriichrak abdelazizPas encore d'évaluation
- Chromatographie LiquideDocument7 pagesChromatographie LiquideAPas encore d'évaluation
- Chromato1 5Document27 pagesChromato1 5hind bioPas encore d'évaluation
- Cours CompletDocument192 pagesCours CompletSarra Bessadok100% (2)
- 8.techniques ChromatographiquesDocument4 pages8.techniques ChromatographiquesMebtouche ZianePas encore d'évaluation
- Cours 4. HPLC1Document26 pagesCours 4. HPLC1AminePas encore d'évaluation
- Les ChromatographiesDocument60 pagesLes ChromatographiesMariem YahyaPas encore d'évaluation
- cours-chromatographieHPLC CCMDocument18 pagescours-chromatographieHPLC CCMBilal BekhtaouiPas encore d'évaluation
- Chromatographie Liquide À Haute Performance YbDocument3 pagesChromatographie Liquide À Haute Performance YbYasmine BendarkawiPas encore d'évaluation
- Cours Chromatographie TAII 2 MoustaidDocument119 pagesCours Chromatographie TAII 2 MoustaidSalma MounirPas encore d'évaluation
- Kerazi KaoutarDocument10 pagesKerazi KaoutarAli BoutaharPas encore d'évaluation
- Cours - 1Document72 pagesCours - 1JudicaëlPas encore d'évaluation
- Chromatograph I 1Document29 pagesChromatograph I 1Chim RemPas encore d'évaluation
- Cours ChromatographieDocument82 pagesCours ChromatographieFàtiiTà EmitàfPas encore d'évaluation
- HPLCDocument10 pagesHPLCadribispo100% (1)
- ChromatographieDocument7 pagesChromatographiecélia fer100% (2)
- Cour s1 CCMDocument5 pagesCour s1 CCMhadilPas encore d'évaluation
- Theme 3Document15 pagesTheme 3nouroulouedraogoPas encore d'évaluation
- TP Chromatographie Sur Couche MinceDocument9 pagesTP Chromatographie Sur Couche Minceamirachaouch498Pas encore d'évaluation
- COURS1Document41 pagesCOURS1Li NaPas encore d'évaluation
- Généralités Sur La Chromatographie Et CPGDocument7 pagesGénéralités Sur La Chromatographie Et CPGAPas encore d'évaluation
- coursMPA 1Document36 pagescoursMPA 1MecheriPas encore d'évaluation
- Chromatographie Sur Couche Mince DR F.BELAIDIDocument14 pagesChromatographie Sur Couche Mince DR F.BELAIDIzineb fellaPas encore d'évaluation
- CHROMatographie Sur Couche MinceDocument11 pagesCHROMatographie Sur Couche Mincecélia fer100% (6)
- Protocoles de TP 2012 M2VRV Phytochimie 2Document6 pagesProtocoles de TP 2012 M2VRV Phytochimie 2YounesPas encore d'évaluation
- Cour HPLCDocument36 pagesCour HPLCSanaPas encore d'évaluation
- Cours MPCADocument36 pagesCours MPCAحمزة ابو الجودPas encore d'évaluation
- ChromatographieDocument83 pagesChromatographieSalah Ine100% (1)
- Chapitre IDocument24 pagesChapitre IKenz L'AïdPas encore d'évaluation
- 6 Ème Cours (Chromatographie)Document34 pages6 Ème Cours (Chromatographie)Mariem YahyaPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument7 pagesIntroductionilyesPas encore d'évaluation
- CPG RamdaneDocument17 pagesCPG Ramdanelamis ramdanePas encore d'évaluation
- HPLCDocument45 pagesHPLCMohamed Taieb Bakouche100% (2)
- TP Chromatographie Abdelouahed RhaouiDocument9 pagesTP Chromatographie Abdelouahed RhaouiAli BoutaharPas encore d'évaluation
- HPLCDocument13 pagesHPLCnassima ghallabiPas encore d'évaluation
- HPLCDocument13 pagesHPLCnassima ghallabiPas encore d'évaluation
- Chapitre IIIDocument7 pagesChapitre IIISafa Sghaier100% (1)
- III - CHAPITRE II ChromatographieDocument12 pagesIII - CHAPITRE II ChromatographieRêz NãdäPas encore d'évaluation
- Chromatographie Sur Couche MinceDocument25 pagesChromatographie Sur Couche MinceWinnie AhouhaPas encore d'évaluation
- A-6 HPLC-1Document27 pagesA-6 HPLC-1ABDESSAMAD HAMOUMIPas encore d'évaluation
- Techniques D'analyse - Cours (Chap 1) Chomatographie L3 GPDocument28 pagesTechniques D'analyse - Cours (Chap 1) Chomatographie L3 GPamina ennoualPas encore d'évaluation
- MéthodologieDocument10 pagesMéthodologieHalima ElaieidaPas encore d'évaluation
- ChromatoDocument52 pagesChromatototoafif100% (1)
- Chromato Sur Couche MinceDocument4 pagesChromato Sur Couche Minceazeddine najimPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document7 pagesChapitre 1ichrak abdelazizPas encore d'évaluation
- Chap A Aspets GénérauxDocument93 pagesChap A Aspets GénérauxAhmed ELBOUZIDIPas encore d'évaluation
- Introduction Générale Sur La Chromatographie - CopieDocument29 pagesIntroduction Générale Sur La Chromatographie - CopieFatima Irjdaln100% (1)
- Chromato 4Document24 pagesChromato 4ainaneayoubPas encore d'évaluation
- Méthodes D'analyse ChromatographiqueDocument43 pagesMéthodes D'analyse ChromatographiquedesiréPas encore d'évaluation
- Chap C HPLC Msai 2021 2022Document32 pagesChap C HPLC Msai 2021 2022Ahmed ELBOUZIDIPas encore d'évaluation
- HPLCDocument49 pagesHPLCsalim100% (1)
- Biophy PresDocument26 pagesBiophy Presange soniaPas encore d'évaluation
- Applications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesD'EverandApplications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesPas encore d'évaluation
- Nouveau moyen de préparer la couche sensible des plaques destinées à recevoir les images photographiques Lettre à M. AragoD'EverandNouveau moyen de préparer la couche sensible des plaques destinées à recevoir les images photographiques Lettre à M. AragoPas encore d'évaluation
- LC 21-080Document4 pagesLC 21-080Simon HoudePas encore d'évaluation
- Math Brevet 2019 2Document11 pagesMath Brevet 2019 2ddd75% (4)
- MQS Science XIthDocument127 pagesMQS Science XIthKrishna KumarPas encore d'évaluation
- Td2 Trans StatiqueDocument5 pagesTd2 Trans Statiquesara100% (1)
- 2 - Épreuve 02 - Le SéismeDocument3 pages2 - Épreuve 02 - Le SéismeLįllÿ LįllÿPas encore d'évaluation
- Catalogue Reles ADocument44 pagesCatalogue Reles AMohammedPas encore d'évaluation
- Preuve Ponctuelle Obligatoire Eps - Bac GT - Livret Candidat - Tennis de Table - 2024 15860Document6 pagesPreuve Ponctuelle Obligatoire Eps - Bac GT - Livret Candidat - Tennis de Table - 2024 15860moussaidiabdouPas encore d'évaluation
- RapportDocument25 pagesRapportMolka Ayechi100% (1)
- Le Figaro PDFDocument3 pagesLe Figaro PDFemilie dos santosPas encore d'évaluation
- Eurocode 5 BASE DE DONNEESDocument10 pagesEurocode 5 BASE DE DONNEEScabreraPas encore d'évaluation
- BAROKA Mémoire Tourisme 2016Document127 pagesBAROKA Mémoire Tourisme 2016Josué BAROKA100% (1)
- Arduino Pour Bien Commencer en Electronique Et en ProgrammationDocument302 pagesArduino Pour Bien Commencer en Electronique Et en ProgrammationHichem HamdiPas encore d'évaluation
- Minhaj SalafiDocument18 pagesMinhaj SalafisososopiPas encore d'évaluation
- Axtem Mag PRINTEMPS 2012Document16 pagesAxtem Mag PRINTEMPS 2012MTS_47Pas encore d'évaluation
- Avoir Des Loisirs Dans Un Espace UrbainDocument2 pagesAvoir Des Loisirs Dans Un Espace UrbainonerPas encore d'évaluation
- La DouleurDocument14 pagesLa DouleurSamantha Francisco RossettiPas encore d'évaluation
- TD 03 CorrigéDocument5 pagesTD 03 CorrigéTaimocha FatiPas encore d'évaluation
- Perception Et IllusionDocument3 pagesPerception Et IllusionSelma AddaPas encore d'évaluation
- Sikadur® Injection LP: Fiche ProduitDocument3 pagesSikadur® Injection LP: Fiche Produitabdelali baaddouchPas encore d'évaluation
- Pancreatite ÉemDocument8 pagesPancreatite ÉemInfirmier Santé PubliquePas encore d'évaluation
- Le ZahirDocument3 pagesLe Zahirmounirnet100% (1)
- Chapitre 3 - Présentation - Loi 13-83Document53 pagesChapitre 3 - Présentation - Loi 13-83BENHIBA WAFAEPas encore d'évaluation
- RB SCCDDocument36 pagesRB SCCDsirovic90Pas encore d'évaluation
- Gestion Des Déchets 22223 1 PDFDocument101 pagesGestion Des Déchets 22223 1 PDFbehdenna riyanaPas encore d'évaluation
- Charles Lancelin - Comment On Meurt-Coment On Nait (Les Deux Pôles de La Vie) (FR) PDFDocument101 pagesCharles Lancelin - Comment On Meurt-Coment On Nait (Les Deux Pôles de La Vie) (FR) PDFViviane Tjiovas100% (1)
- Investir Dans Le Secteur Fruits Et Legumes Du MaliDocument23 pagesInvestir Dans Le Secteur Fruits Et Legumes Du MaliGregory MaigaPas encore d'évaluation
- 3 - CCTP Ouvrage Oued GabesDocument14 pages3 - CCTP Ouvrage Oued GabesqsegaqgPas encore d'évaluation
- Essai SPT Arvor 2010Document1 pageEssai SPT Arvor 2010Seif EddinePas encore d'évaluation
- Rapport2 G2Document8 pagesRapport2 G2ahmedPas encore d'évaluation
- Mat2777 Examen Final H2020Document9 pagesMat2777 Examen Final H2020fahfaPas encore d'évaluation