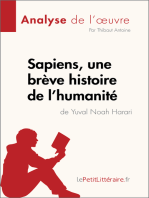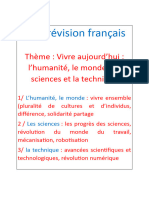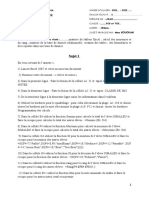Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Seance 2. Histoire Inegalite-1
Seance 2. Histoire Inegalite-1
Transféré par
H. DaneelTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Seance 2. Histoire Inegalite-1
Seance 2. Histoire Inegalite-1
Transféré par
H. DaneelDroits d'auteur :
Formats disponibles
Éléments sur l’histoire de l’inégalité
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
• La préhistoire
• L’inégalité selon Gerhart Lenski
• Inégalités et domination dans les sociétés préindustrielles
• La révolution industrielle et la montée des inégalités
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
La préhistoire
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Évolution de l’espéce humaine
2,5 millions d’années avant JC. Homo Abilis, première espèce du genre
Homo. Culture oldowayenne
CHASSEURS- . Outils de pierre dont la forme semble
impliquer des activités conscientes de taille des silex par frappe les uns
contre les autres.
CUEILLEURS
1,5 millions d’années avant JC. Nouvelles espèces du genre Homo. Homo
Erectus. Culture acheuléenne. Outils de pierre taillés mais procédures de
taille beaucoup plus élaborées, permettant de fabriquer différentes formes
d’outils - haches, grattoirs – disposant de cotés tranchants. Des outils d’os
et de bois sont aussi disponibles. Divers indices montrent que les Homo
Erectus chassaient, s’organisant pour tuer des animaux sans se contenter de
récupérer des carcasses d’animaux morts.
250 000 ans avant notre ère. Homo Sapiens. Cultures moustérienne,
aurignacienne, magdalennienne, … témoignant de la capacité à fabriquer
des objets en pierre de plus en plus élaborés jusqu’aux microlithes du
mésolithique. Vestiges archéologiques disponibles.
Paris 10 000 avant
IV\ Séminaire JC. l’invention
Sociologie de l’agriculture
des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les « chasseurs-cueilleurs », groupes de foyers égaux
Le pair-bond pièce essentielle de l’organisation sociale des humains
La sexualité dans notre espèce aurait évolué de manière à ce que tant les
mâles que les femelles auraient intérêt à collaborer dans l’ élevage des
enfants, pour assurer leur descendance.
« L’organisation sociale humaine se caractérise par la combinaison (1)
de liens entre les hommes, (2) de liens entre les femmes, (3) de familles
nucléaires. Nous avons en commun les premiers traits avec le
chimpanzés, les deuxièmes avec les bonobos, les troisièmes sont notre
apanage». De Waals (1996)
Les « chasseurs-cueilleurs ».
Fondamentalement, la notion renvoie à la manière dont les groupes se
procurent l’essentiel de leur nourriture : par la chasse, la pêche, la
cueillette des fruits et racines disponibles dans leur environnement.
Le « foyer » est l’élément essentiel d’un groupe de « chasseur-
cueilleur ».
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
A quel moment la rupture ?
2,5 millions d’années avant JC. Homo Abilis, première espèce du genre
Homo. Culture oldowayenne
CHASSEURS- . Outils de pierre dont la forme semble
impliquer des activités conscientes de taille des silex par frappe les uns
contre les autres.
CUEILLEURS
1,5 millions d’années avant JC. Nouvelles espèces du genre Homo. Homo
Erectus. Culture acheuléenne. Outils de pierre taillés mais procédures de
taille beaucoup plus élaborées, permettant de fabriquer différentes formes
d’outils - haches, grattoirs – disposant de cotés tranchants. Des outils d’os
et de bois sont aussi disponibles. Divers indices montrent que les Homo
Erectus chassaient, s’organisant pour tuer des animaux sans se contenter de
récupérer des carcasses d’animaux morts.
OBJETS DE PRESTIGE
250 000 ans avant notre ère. Homo Sapiens. Cultures moustérienne,
aurignacienne, magdalennienne, … témoignant de la capacité à fabriquer
des objets en pierre de plus en plus élaborés jusqu’aux microlithes du
mésolithique. Vestiges archéologiques disponibles.
Paris 10 000 avant
IV\ Séminaire JC. l’invention
Sociologie de l’agriculture
des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Explications de l’apparition de l’inégalité
Catégorie de modèles Variante Auteurs
correspondants
Modèles « fonctionalistes » Gestion de l’information
L’existence des inégalités permet Gestion des pénuries et
de mieux gérer des problèmes fluctuations
fondamentaux Minimise les stress internes
Modèles cognitifs et culturels
Les valeurs culturelles ou Cauvin, 1994
personnelles mènent aux
inégalités
Modèles démographiques environnements ne permettant
L’accroissement de population pas l’immigration Rosenberg,
entraîne dans certaines Pression démographique 1998
circonstances l’inégalités entre engendrant territorialité et donc
groupes lutte entre groupes Carneiro, 1970
Modèles « politiques » Contrôle Testart, 1982
Certains réussissent à acquérir sur le produit stocké
le contrôle de ressources sur les réseaux d’échange Hayden, 1995
importantes et à en priver les sur les moyens de production
autres du travail des autres
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Modèles politiques. Le rôle des « aggrandizers »,
Les modèles « politiques » reposent sur l’idée de l’action volontaire de certains
pour s’accaparer les choses.
L’apparition des inégalités pourrait alors s’expliquer par les phénomènes
suivants.
Il faut qu’un surplus de nourriture soit possible.
Il faut admettre la présence d’individus désireux d’accroitre leurs avantages :
les « aggrandizer ». « la recherche de la considération sociale paraît avoir
été en tout temps et en toute région une motivation importante de la vie en
société. (Testard, 2005)
Les sociétés de chasseur-cueilleurs « simples ne semblent pas accepter
les individus trop accapareurs.
Dans les sociétés de chasseur-cueilleurs « complexes » disposant de
surplus, on peut imaginer absence de réactions vives, aucun foyer n’ayant
de réels problèmes pour assurer sa subsistance.
Il faut expliquer comment le surplus est détourné vers la production de biens
autres que la nourriture, vers des « objet de prestige » par exemple.
Obtenir cette transformation implique de convaincre d’autres de travailler à
des fins non immédiatement productives pour eux.
C’est ici que la notion de politique intervient à plein, ce sont les
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
L’inégalité suivant Gerahrt Lenski
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les types de sociétés de Gerahrt Lenski
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Évolution du degré d’ « inégalité » suivant Lenski
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les facteurs du degré d’inégalité. Le modèle de Turner (1)
Exemple des inégalités de richesse matérielle.
Elle dépend du volume des biens produits (P), du nombre des
différents types de hiérarchies sociales (NH), du nombre d’
« échelons » (organizational units) que l’on peut y distinguer (NO) .
La formule (heuristique) est la suivante : IN = w1ep *w2e-NH*w3e-NO
l’inégalité croit de manière exponentielle avec la productivité ,
décroit, de manière exponentielle, avec le nombre de hiérarchies
et le nombre de groupements.
Pourquoi?
Les lignes hiérarchiques sont plus ou moins en compétition
entre elles. Plus elles sont nombreuses; moins les effets de
monopole pourront se produire.
Plus le nombre des échelons est grand, moins la pression du
sommet pourra se faire sentir.
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les facteurs du degré d’inégalité. Le modèle de Turner (2)
Type de société P NO NG Inégalité
Chasseur-cueilleur Très bas Très peu Aucune Quasi-égalité
Horticulteur Bas Un peu Quelques- Un peu concentré
simple unes
Horticulteur Moyenn Moyen Quelques- Concentré
avancé e unes
Agraire Elevé Nombreuse Beaucoup Très fortement
concentré
Industrielle Très Très Très Très concentré
Paris IV\ Séminaire Sociologieélevé nombreuses
des inégalités\2014-2015\ nombreuses
O. Galland & Y. Lemel
Inégalités et domination dans les
sociétés préindustrielles
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Trois types de société préindustrielles
• Sociétés de chasseurs-cueilleurs sans Etat, étudiées par
les ethnologues
• Sociétés sans Etat avec présence de l’agriculture et/ou
de l’élevage (étudiées par les ethnologues)
• Les sociétés agraires avec Etat
– Civilisations antiques étudiées par les historiens
– Sociétés agraires précoloniales des empires et royaumes
africains
– Sociétés d’ordre du Moyen-Age étudiées par les historiens
– Les sociétés rurales contemporaines
• Un cas spécifique : la société de castes
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs
• Matériel empirique rare et affecté de biais
• En général, sociétés économiquement égalitaires (pas
de différenciation entre riches et pauvres)
– Mais rôle des surplus alimentaires éventuels et de la capacité de
les stocker
sédentarité et apparition de différenciations sociales
• Hiérarchie sociale organisée autour de l’âge
(systématique) et du sexe (variable)
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les sociétés horticoles ou d’éleveurs sans Etat
• Pas de propriétaires fonciers au sens des sociétés antiques ou
de l’Occident médiéval pas de « paysans sans terre »
exploités
• Sociétés d’abord structurées par l’importance de la parenté,
les interdits du mariage, les stratégies d’alliance
• La « richesse » peut avoir deux usages :
Une visée ostentatoire et de prestige (Malinowski)
Payer le « prix de la fiancée » (le gendre fournit au beau-père des
biens, condition du mariage)
• Domination d’âge et de sexe : les jeunes mâles nubiles
n’accèdent à la plénitude sociale qu’avec la possibilité d’être
un géniteur légal en raison du mariage
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les sociétés agraires avec Etat
• Les sociétés des civilisations antiques (Rome, civilisation
égyptienne, Chine impériale…) : sociétés divisées entre une
classe de grands propriétaires terriens, disposant du pouvoir
politique, et une classe d’esclaves ou de paysans misérables
exploités économiquement
• Les royaumes d’Afrique précoloniale : sociétés étatiques
(≠ chefferies) dont les principes de stratification ne reposent
pas sur le sexe, l’âge ou la parenté, mais sur une distance
irréductible, définie à l’échelle de la société globale, entre
gouvernants et gouvernés
• Les sociétés d’ordre du Moyen-Age européen : à partir du
IXème siècle : 3 ordres ou états bien distincts, et hiérarchisés
en dignité, ceux qui prient, les clercs (oratores), ceux qui font
la guerre, les barons (bellatores), ceux qui produisent la
subsistance de tous, les paysans (laboratores)
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les sociétés agraires avec Etat
• Les sociétés rurales contemporaines : sociétés paysannes
étudiées par Henri Mendras = paysans de l’Europe occidentale
de l’an 1000 à l’an 2000 ; une société très autonome, quasi-
autarcique où le travail s’effectue au sein du groupe
domestique (≠ économie industrielle) et au sein d’un société
d’interconnaissance aux rôles peu différenciés ; société qui
coexiste avec la société globale : des notables (hobereaux,
châtelains, hommes de loi, notaires, fonctionnaires..) font le
lien entre les deux et assurent le contrôle politique et
idéologique de la société paysanne et la perception du
prélèvement en hommes (exode rural) et en argent
• À l’intérieur de ces sociétés l’inégalité se fonde sur la
possession de la terre et sur les règles de succession : système
« à maison » de la France du Midi fondamentalement
inégalitaire (aîné, garçons) ; système « à parenté » de la France
du nord, plus égalitaire (partage du patrimoine)
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Les sociétés de caste
• Groupes de la société indienne strictement délimités par des
principes hiérarchiques de division du travail et de règles
endogamiques.
• Une hiérarchie de prestige fondée sur un principe religieux :
l’opposition du pur et de l’impur (deux catégories extrêmes,
les brahmanes et les intouchables)
• L’impureté : une notion religieuse dont la source est le contact
avec la vie organique, opposition de l’homme religieux et
social à la nature
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
La révolution industrielle et la montée
des inégalités
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
La révolution industrielle 1. La structure sociale
• Les changements dans la structure sociale au XIXème siècle
(Yaouanq, sur la situation française)
– Avant la révolution française, une structure sociale extrêmement
inégalitaire (coefficient de Gini > de 50 à 100% à ceux actuels) :
nobles et clergé (<5% de la population) accaparent une grande partie
des revenus agricoles (entre le quart et un tiers)
– De la révolution au Second Empire : les inégalités économiques se sont
plutôt atténuées (redistribution des terres, abolition des droits féodaux)
mais la redistribution a surtout profité aux groupes intermédiaires
(petite bourgeoisie et paysans aisés)
– La deuxième moitié du siècle : l’industrialisation s’accélère, et à la fin
du Second Empire la croissance de demande de main d’œuvre en ville
contribue à la hausse des salaires et à la baisse de l’inégalité
– Recomposition de la stratification sociale : développement d’une
grande bourgeoisie (banquiers, industriels) et d’une bourgeoisie
intermédiaire, d’une nouvelle couche d’employés qui gagnent bien leur
vie ; déclin de la domesticité, croissance d’un groupe ouvrier assez
hétérogène ; les ouvriers de la grande industrie ne se développeront
qu’àSociologie
Paris IV\ Séminaire la fin dudessiècle
inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
La révolution industrielle 2. Le grand U-Turn
• Le grand « U-turn » : une manière imagée de décrire
l’évolution des inégalités au cours de l’industrialisation,
d’abord croissantes, puis décroissantes, une courbe en U
inversée (Kuznets)
• Une évolution validée pour nombre de pays occidentaux
durant le XIXème siècle et jusqu’aux années 1970 (USA,
Grande-Bretagne, France..)
• La thèse de Kuznets : la théorie des deux secteurs, agricole-
rural (inégalité plus faibles) et industriel-urbain (inégalités
initialement élevées, puis déclinantes : effet de la concurrence
engendrée par l’industrialisation)
• Une thèse contestée (Piketty) : différencier les revenus du
travail et les revenus du capital ; ce sont les revenus du capital
qui ont contribué principalement à la baisse des inégalités
durant la première moitié du XXème siècle (chocs subis
durant les deux guerres mondiales)
Paris IV\ Séminaire Sociologie des inégalités\2014-2015\ O. Galland & Y. Lemel
Vous aimerez peut-être aussi
- Rituel Des 72 AngesDocument65 pagesRituel Des 72 AngesOSSINGA ANDY FREDERIC80% (5)
- Repenser La Pauvreté (French Edition) - NodrmDocument421 pagesRepenser La Pauvreté (French Edition) - NodrmEco Tv Abdel100% (2)
- Léon Denis - Dans L'invisible Spiritisme Et MédiumnitéDocument616 pagesLéon Denis - Dans L'invisible Spiritisme Et MédiumnitéSophie100% (3)
- MANAGEMENT Interculturel FinalDocument26 pagesMANAGEMENT Interculturel FinalShaimaeAboulmajd100% (2)
- Chapitre 4Document187 pagesChapitre 4Eric ClémentPas encore d'évaluation
- Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari (Analyse de l'œuvre): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandSapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari (Analyse de l'œuvre): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Baudrillard JeanDocument13 pagesBaudrillard JeanNicusor Ioan100% (1)
- La Geometrie de L'energie Comme - Ethan Indigo SmithDocument160 pagesLa Geometrie de L'energie Comme - Ethan Indigo SmithFrank Marcel MingoasPas encore d'évaluation
- TD1+Solution Théorie Des GraphesDocument5 pagesTD1+Solution Théorie Des GraphesLoukman BelmahnoufPas encore d'évaluation
- Henri Lefebvre - Critique de La Vie Quotidienne - 3. de La Modernité Au Modernisme-Arche (1981)Document172 pagesHenri Lefebvre - Critique de La Vie Quotidienne - 3. de La Modernité Au Modernisme-Arche (1981)Guilherme Salvini100% (1)
- SOWELL, Thomas. Race, Politique Et Économie - Une Approche InternationaleDocument318 pagesSOWELL, Thomas. Race, Politique Et Économie - Une Approche InternationaleYo_CaraPas encore d'évaluation
- Djaballah Abdelhamid Et Madi Fares ING 2020Document108 pagesDjaballah Abdelhamid Et Madi Fares ING 2020TjrKoffiPas encore d'évaluation
- Jacob Lorber - Le Soleil Spirituel V1Document335 pagesJacob Lorber - Le Soleil Spirituel V1BORIS57% (7)
- Modalites D'obtention D'une Licence de Creation Et D'exploitation D'un Laboratoire D'analyse Et de Biologie MedDocument4 pagesModalites D'obtention D'une Licence de Creation Et D'exploitation D'un Laboratoire D'analyse Et de Biologie MedKlinnanTourePas encore d'évaluation
- Cours D'economie - 10e Ses - Corrige1Document49 pagesCours D'economie - 10e Ses - Corrige1Ayouba Traoré100% (2)
- CHAP 1 (pt1), CHAP 2 ET 3Document29 pagesCHAP 1 (pt1), CHAP 2 ET 3qqqqqqPas encore d'évaluation
- Marketing Approfondissement Introduction)Document113 pagesMarketing Approfondissement Introduction)Loubna SmiresPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Sciences ÉconomiquesDocument91 pagesIntroduction Aux Sciences ÉconomiquesOussama RabahPas encore d'évaluation
- Chanel Sophie CreolisationDocument9 pagesChanel Sophie CreolisationfabiolaPas encore d'évaluation
- EBOOK Abhijit V. Banerjee-Esther Duflo - Economie Utile Pour Des Temps DifficilesDocument187 pagesEBOOK Abhijit V. Banerjee-Esther Duflo - Economie Utile Pour Des Temps DifficilesRamiaramanana ANDERSEN JOHAN ERILALAPas encore d'évaluation
- Problèmes Économiques ActuelsDocument31 pagesProblèmes Économiques ActuelsMartìalPas encore d'évaluation
- Vivre Aujourd'hui L'humanité Le Monde Les Sciences Et La TechniqueDocument21 pagesVivre Aujourd'hui L'humanité Le Monde Les Sciences Et La Techniquemademoisellelilou1971Pas encore d'évaluation
- S1.1 Les Analyses de La Structure Sociale - Elève PDFDocument112 pagesS1.1 Les Analyses de La Structure Sociale - Elève PDFjayseseckPas encore d'évaluation
- La Societe de Consommation Et La FamilleDocument15 pagesLa Societe de Consommation Et La FamilleJetGokuSSBPas encore d'évaluation
- Repenser La Question Migratoire, Migrations, Inégalités Et IndividuationDocument12 pagesRepenser La Question Migratoire, Migrations, Inégalités Et IndividuationAngela MancipePas encore d'évaluation
- Des Cultures, Au PlurielDocument12 pagesDes Cultures, Au PlurielMohamed LemsefferPas encore d'évaluation
- DEVROEY - Les Élites Et La Richesse Au Haut Moyen Âge (2010, Brepols Publishers)Document544 pagesDEVROEY - Les Élites Et La Richesse Au Haut Moyen Âge (2010, Brepols Publishers)Samuel S. de OliveiraPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu Méthodologie Cultures Monde - Sabrina CarneiroDocument11 pagesCompte-Rendu Méthodologie Cultures Monde - Sabrina CarneiroSabrina CarneiroPas encore d'évaluation
- Anthropo Culturelle - NotesDocument62 pagesAnthropo Culturelle - Notessidrita AbdiuPas encore d'évaluation
- AnthropologieDocument26 pagesAnthropologiePriscilla BengaPas encore d'évaluation
- Fiche D'investigation Terrain Pour Portrait Sociologique Sierra NevadaDocument10 pagesFiche D'investigation Terrain Pour Portrait Sociologique Sierra NevadaJuan Sebastián OsorioPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Géographie Des Inégalités en FranceDocument6 pagesChapitre 2 - Géographie Des Inégalités en Francecla dubsPas encore d'évaluation
- Document 1 - Qui Sont Les MillenialsDocument1 pageDocument 1 - Qui Sont Les MillenialsTANAYA KETKARPas encore d'évaluation
- Penser La FamilleDocument16 pagesPenser La FamilleAmina KannanPas encore d'évaluation
- PPT-Semaine - 2 2Document37 pagesPPT-Semaine - 2 2naimasowx3Pas encore d'évaluation
- Industries, vestiges archéologiques et préhistoriques - Action aléatoire de la nature & Action intentionnelle de l’Homme - Volume VID'EverandIndustries, vestiges archéologiques et préhistoriques - Action aléatoire de la nature & Action intentionnelle de l’Homme - Volume VIPas encore d'évaluation
- Lenoir Social ExlusionDocument3 pagesLenoir Social Exlusionjan carlo kayananPas encore d'évaluation
- L - Entraide. L - Autre Loi de La J Pablo ServigneDocument148 pagesL - Entraide. L - Autre Loi de La J Pablo ServigneaomaraitslimaniPas encore d'évaluation
- 2.trace Écrite de La Préhistoire À L'histoireDocument5 pages2.trace Écrite de La Préhistoire À L'histoireqvachonPas encore d'évaluation
- Chapitre2 Comment Crée-T-On Des Richesses Et Comment Les Produit-On ?Document12 pagesChapitre2 Comment Crée-T-On Des Richesses Et Comment Les Produit-On ?LyliPas encore d'évaluation
- Adolescence et affiliation: Les risques de devenir soiD'EverandAdolescence et affiliation: Les risques de devenir soiPas encore d'évaluation
- Cultures Et Organisations Sociales - TDDocument4 pagesCultures Et Organisations Sociales - TDDjidioufPas encore d'évaluation
- VIDAL de LA BLACHE, Paul. Les Conditions Géographiques Des Faits Sociaux. in Annales de Géographie, T. 11, N 55, 1902Document12 pagesVIDAL de LA BLACHE, Paul. Les Conditions Géographiques Des Faits Sociaux. in Annales de Géographie, T. 11, N 55, 1902afonsomalechaPas encore d'évaluation
- La Notion de CultureDocument4 pagesLa Notion de CultureNolberto RomeroPas encore d'évaluation
- Cours D'histoire Des Faits Economiques Et SociauxDocument49 pagesCours D'histoire Des Faits Economiques Et SociauxChris SegaPas encore d'évaluation
- Sociologie de La CultureDocument7 pagesSociologie de La CultureLisa ViallePas encore d'évaluation
- La Culture Entre Civilisation Et BarbarieDocument13 pagesLa Culture Entre Civilisation Et BarbarieCryvalonPas encore d'évaluation
- Colette Guillaumin Sexe Race Et PratiqueDocument4 pagesColette Guillaumin Sexe Race Et PratiquekarolannevlogtvPas encore d'évaluation
- 340 RevueDocument30 pages340 RevueMathieu TMPas encore d'évaluation
- Alain Cottereau & Mokhtar Mohatar Marzok - Une Famille Andalouse. Ethnocompatibilité D'une Économie InvisibleDocument19 pagesAlain Cottereau & Mokhtar Mohatar Marzok - Une Famille Andalouse. Ethnocompatibilité D'une Économie InvisibleFelipe Berocan VeigaPas encore d'évaluation
- Textes Atelier Philo 14 Décembre 2023 (Version Revue)Document2 pagesTextes Atelier Philo 14 Décembre 2023 (Version Revue)OrdreEtProgres U235Pas encore d'évaluation
- La Societe de Consommationkk 1Document231 pagesLa Societe de Consommationkk 1Rahal RahalPas encore d'évaluation
- 9782742789672Document16 pages9782742789672CherizaPas encore d'évaluation
- Cours PPT DLFDocument117 pagesCours PPT DLFqv2jnd7vfpPas encore d'évaluation
- Anthropologie CM2Document4 pagesAnthropologie CM2max.corsuPas encore d'évaluation
- v4n2 Jean Karina p233-262Document30 pagesv4n2 Jean Karina p233-262WHENEVERPas encore d'évaluation
- Sciences Économiques PDFDocument90 pagesSciences Économiques PDFNadaPas encore d'évaluation
- HG 2ndeDocument60 pagesHG 2ndeFerdinan Randrianasolo100% (2)
- Du LaureDocument466 pagesDu LaureNTMPas encore d'évaluation
- Pour une conscience terriste: Nature, Cultures, AgriculturesD'EverandPour une conscience terriste: Nature, Cultures, AgriculturesPas encore d'évaluation
- Synthèse Des Générations Tableau de ConfrontationDocument2 pagesSynthèse Des Générations Tableau de ConfrontationTheo BrissonPas encore d'évaluation
- Communication InterculturelleDocument11 pagesCommunication InterculturelleSahanePas encore d'évaluation
- Formes de Vie Alternatives. Une Société Par Maillage en Pays Du Bord de TarseDocument8 pagesFormes de Vie Alternatives. Une Société Par Maillage en Pays Du Bord de TarseFondationEcoloPas encore d'évaluation
- Histoire Exam.2 ? 7Document4 pagesHistoire Exam.2 ? 7quickdraw199628Pas encore d'évaluation
- Memoire 1Document93 pagesMemoire 1Willy JasminPas encore d'évaluation
- Écologie Sociale Economies de CommunautéDocument21 pagesÉcologie Sociale Economies de CommunautéMVUHPas encore d'évaluation
- Catalogue Reperes 2023Document126 pagesCatalogue Reperes 2023Charcoal GreyPas encore d'évaluation
- Seance 5. 2.Pbs MesureeDocument7 pagesSeance 5. 2.Pbs MesureeH. DaneelPas encore d'évaluation
- Seance 8 Transmission InegalitesDocument26 pagesSeance 8 Transmission InegalitesH. DaneelPas encore d'évaluation
- Presentation Du CoursDocument4 pagesPresentation Du CoursH. DaneelPas encore d'évaluation
- Seance 5. 1.individus Et Structure.Document13 pagesSeance 5. 1.individus Et Structure.H. DaneelPas encore d'évaluation
- Bennasrallah 1991Document7 pagesBennasrallah 1991nadir adelPas encore d'évaluation
- CRT Partie ADocument11 pagesCRT Partie ASamar NejiPas encore d'évaluation
- ContrôleDocument10 pagesContrôleHassan Guenzaouz0% (1)
- Bibang 2021 CV CdiDocument1 pageBibang 2021 CV CdiBIBANG DERLYPas encore d'évaluation
- TD1 - Introduction À La Physiologie, La Cellule, Les Protéines 2023 SVDocument23 pagesTD1 - Introduction À La Physiologie, La Cellule, Les Protéines 2023 SVJoas ÕsčãrbõltPas encore d'évaluation
- EVALUATION N°4 CGAO PCG Et TCGDocument4 pagesEVALUATION N°4 CGAO PCG Et TCGCyrille KonoPas encore d'évaluation
- Le Développement RuralDocument13 pagesLe Développement RuralKenza Rhimi100% (1)
- JT 2018 - Expertise Vibratoire Et Moyens Mis en Œuvre Pour La Préservation Des AvoisinantsDocument18 pagesJT 2018 - Expertise Vibratoire Et Moyens Mis en Œuvre Pour La Préservation Des Avoisinantsdr4g69200Pas encore d'évaluation
- Orca Share Media1479681839123Document2 pagesOrca Share Media1479681839123bbwPas encore d'évaluation
- (Etude D'un Batiment A Usage D'habitation en Beton Arme (R+1) ) Part 2Document17 pages(Etude D'un Batiment A Usage D'habitation en Beton Arme (R+1) ) Part 2Abrar NOuARPas encore d'évaluation
- AKOFENA N°008 Vol.1 Mai 2023 - SOMMAIREDocument11 pagesAKOFENA N°008 Vol.1 Mai 2023 - SOMMAIREAmidou TourePas encore d'évaluation
- Rancic 2Document346 pagesRancic 2Julien GilPas encore d'évaluation
- Crochet de LieDocument1 pageCrochet de LieTalal BenPas encore d'évaluation
- R.C TS en GDS 22016Document32 pagesR.C TS en GDS 22016mohamed starPas encore d'évaluation
- Bilan ThermiqueDocument9 pagesBilan ThermiqueHamza SafiPas encore d'évaluation
- CV Cci CampusDocument1 pageCV Cci Campusspam bidonPas encore d'évaluation
- BAT - PETRO - MAGMA TFBDocument8 pagesBAT - PETRO - MAGMA TFBastuceramazanilulonga64Pas encore d'évaluation
- Rapport Audit Afaq Nas 2015 PDFDocument23 pagesRapport Audit Afaq Nas 2015 PDFsalvadorPas encore d'évaluation
- Nawel BOUDECHICHEDocument10 pagesNawel BOUDECHICHEAbdennour AhmadiPas encore d'évaluation
- Schtroumpfs ProfsDocument7 pagesSchtroumpfs ProfsCreamPas encore d'évaluation
- Corriger 2019 Normal MatinDocument5 pagesCorriger 2019 Normal MatinAbdelhadi AZPas encore d'évaluation
- ENIB MP2IM EmbeddedSystems3 2023Document16 pagesENIB MP2IM EmbeddedSystems3 2023Mariem ArbiPas encore d'évaluation
- RMChap8 (Flambement)Document36 pagesRMChap8 (Flambement)Adrian VlfPas encore d'évaluation