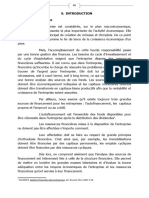Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Financement Hierarchise
Financement Hierarchise
Transféré par
Hyacinthe Jules Junior DJOSSA0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues5 pagesTitre original
FINANCEMENT HIERARCHISE
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
5 vues5 pagesFinancement Hierarchise
Financement Hierarchise
Transféré par
Hyacinthe Jules Junior DJOSSADroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 5
RÉPUBLIQUE DU BENIN
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D’ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DE
MANAGEMENT
Année Académique : 3ème Filière : GFC
Module : FINANCE DES MARCHES
EXPOSÉ
Thème :
FINANCEMENT HIéRARCHISé
Présenté par :
Hyacinthe DJOSSA
Chistiano ALOWANOU
Emmanuel AKPLOGAN
Séphora KPEDJO
Maxime AKABASSI Sous la supervision de:
Jorence EWASSADJE Dr Crescent MEBOUNOU
Année Académique : 2021-2022
PLAN
INTRODUCTION
La théorie du financement hiérarchique ou Pecking Order
Theory (POT)
CONCLUSION
INTRODUCTION
Le financement des petites et moyennes entreprises au cours de la période récente
est au centre d'un débat concernant leur fragilité face à une conjoncture marquée
par une montée des taux d'intérêt réels atteignant des niveaux sans précédent et
par une récession de l'activité économique. Cependant, la structure financière des
entreprises s'est sensiblement améliorée depuis le milieu des années quatre-vingt
avec une diminution de la part relative de l'endettement au profit des fonds
propres, alimentés par l'autofinancement des entreprises. Ses différentes
observations font ressortir le phénomène du financement hiérarchisé. Qu’est-ce
que réellement le financement hiérarchisé ?
La théorie du financement hiérarchique ou Pecking Order
Theory (POT)
L’existence d’une structure financière optimale a été remise en question,
notamment par le développement de la théorie du financement hiérarchique ou
Pecking Order Theory (POT). Contrairement à TOT, POT est fondée sur
l’asymétrie d’information qui existe entre les acteurs internes (propriétaires,
dirigeants) et les acteurs externes (bailleurs de fonds) à l’entreprise. D’après
Myers and Majluf (1984), les dirigeants d’entreprises ne doivent pas essayer de
maintenir un niveau particulier d’endettement (ratio cible optimal). Les choix de
financement étant principalement déterminés par le niveau d’asymétrie
d’information, les dirigeants adoptent une politique financière qui vise à
minimiser les coûts associés à cette asymétrie et ils préfèrent le financement
interne au financement externe. Ainsi, le dirigeant hiérarchise ses préférences
selon la séquence suivante : l’autofinancement, la dette non risquée, la dette
risquée, l’augmentation du capital (Myers, 1984). Le respect de cette hiérarchie a
pour avantage d’éviter la réduction des prix des actions de l’entreprise, de limiter
la distribution des dividendes pour augmenter l’autofinancement, de réduire le
coût du capital en limitant le recours aux emprunts. Les entreprises rentables
disposent donc ainsi d’un financement interne plus abondant. Les PME, qui
souhaitent emprunter quand leurs besoins de financement dépassent leurs flux
internes de trésorerie, sont souvent confrontées dans leur relation de crédit à la
sélection adverse et à des coûts d’information. Ces coûts peuvent être nuls pour
l’autofinancement mais sont élevés dans le cas de l’émission de nouvelles actions,
tandis que les coûts de la dette occupent une position intermédiaire. Les dirigeants
de PME visent à maximiser leur propre richesse tout en conservant leur
indépendance vis-à-vis des acteurs externes, c’est pourquoi les fonds internes font
l’objet de leur choix de financement prioritaire ; si les fonds internes sont
insuffisants, ils préfèrent recourir à la dette plutôt qu’à l’augmentation du capital
car la dette permet de réduire le degré de dépendance de l’entreprise à l’égard des
autres apporteurs de capitaux, et ainsi de garder le contrôle et le pouvoir de
décision. POT a été argumentée au regard d’hypothèses relatives à l’âge et à la
profitabilité des entreprises : Berger and Udell (1998) font valoir que les PME
recourent moins à l’endettement au fur et à mesure que leur cycle de vie les
conduit de la jeunesse à la maturité
CONCLUSION
La théorie financière moderne de l'entreprise suggère l'existence d'une hiérarchie de financement de
l'investissement à cause de coûts de faillite, de taxation différentielle, d'asymétrie d'information ou de
relation entre l'entreprise et ses créanciers. On remarque que l'autofinancement reste la source
préférée de financement, suivie par l'endettement et enfin les apports externes. On peut noter que
plus l'entreprise investit, plus elle a recours à du financement externe après avoir épuisé les sources
internes. Nous présentons également les résultats d'estimations économétriques des déterminants
des sources de financement des entreprises qui confirment l'existence d'une structure de financement
particulière des petites et moyennes entreprises.
Vous aimerez peut-être aussi
- Business Plan - BiscuiterieDocument33 pagesBusiness Plan - BiscuiterieJospin WambaPas encore d'évaluation
- Business Plan - Immobilier - Modelesdebusinessplan - Com 2Document39 pagesBusiness Plan - Immobilier - Modelesdebusinessplan - Com 2Our Events100% (2)
- Cours de Trésorerie Au Sein D'un Groupe (2022 - B)Document65 pagesCours de Trésorerie Au Sein D'un Groupe (2022 - B)Fyfty PlataPas encore d'évaluation
- Justifier Le Choix D'une Structure Par Les Considérations PatrimonialesDocument4 pagesJustifier Le Choix D'une Structure Par Les Considérations PatrimonialesQaz ZephPas encore d'évaluation
- Que vaut ma start-up ?: Bien estimer la valeur de son entrepriseD'EverandQue vaut ma start-up ?: Bien estimer la valeur de son entreprisePas encore d'évaluation
- Détermination de La Strucure Du CapitalDocument8 pagesDétermination de La Strucure Du CapitalMarouane MaestroPas encore d'évaluation
- L'entreprise Familiale TunisienneDocument33 pagesL'entreprise Familiale Tunisiennemohammedali_tounsi986067% (3)
- Article Pme Et InnovationDocument26 pagesArticle Pme Et InnovationMohamed BayazidPas encore d'évaluation
- Endettement Des Entreprises FamilialesDocument42 pagesEndettement Des Entreprises FamilialeskakaromalldoPas encore d'évaluation
- 71-Texte de L'article-514-1-10-20180210Document15 pages71-Texte de L'article-514-1-10-20180210Dougoukolo KonaréPas encore d'évaluation
- Cours de Trésorerie Au Sein D'un Groupe (2022 - A)Document29 pagesCours de Trésorerie Au Sein D'un Groupe (2022 - A)Aime AmoakonPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument22 pages1 PBMohamed BousacourPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document4 pagesChapitre 1elhoussaine nineflassPas encore d'évaluation
- Structure FiDocument47 pagesStructure FinabilPas encore d'évaluation
- Exposé M2PB FINANCEDocument10 pagesExposé M2PB FINANCEMira TiamelaPas encore d'évaluation
- Un Test de La ThA Orie Du Financement HiA RarchisA Sur DonnA Es de Panel FranA Aises MOLAY 2006Document25 pagesUn Test de La ThA Orie Du Financement HiA RarchisA Sur DonnA Es de Panel FranA Aises MOLAY 2006atktaouPas encore d'évaluation
- Les Différents Modes de Financement Et La Sturtuce Financière OptimaleDocument23 pagesLes Différents Modes de Financement Et La Sturtuce Financière OptimalekakaromalldoPas encore d'évaluation
- Modigliani Miller Cost of CapitalDocument23 pagesModigliani Miller Cost of CapitalnajmproPas encore d'évaluation
- Mohamed Abdesslam Et Benjamin Le Pendeven PME Nouveaux Modes de FinancementDocument46 pagesMohamed Abdesslam Et Benjamin Le Pendeven PME Nouveaux Modes de FinancementAbdoulaye NdongPas encore d'évaluation
- Fin Interne Final 1Document14 pagesFin Interne Final 1Riam Êam100% (1)
- Capsule 5 CHAP 4 Financement de Léconomie Principes de BaseDocument6 pagesCapsule 5 CHAP 4 Financement de Léconomie Principes de BaseGhita banaPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument26 pages1 PBMaab OuPas encore d'évaluation
- Thème 6 - Structure Financière Et Cout de CapitalDocument56 pagesThème 6 - Structure Financière Et Cout de Capitalikram ezzari67% (3)
- Projet de Recherche Scientique PME (Enregistré Automatiquement)Document14 pagesProjet de Recherche Scientique PME (Enregistré Automatiquement)Kethia MasengoPas encore d'évaluation
- Structure Financière Et Performance Des Entreprises Dans UnDocument16 pagesStructure Financière Et Performance Des Entreprises Dans UnB.I50% (2)
- DissertationDocument19 pagesDissertationEl Mouden BrahimPas encore d'évaluation
- Habib BENBAYERDocument16 pagesHabib BENBAYERDiamanta Mayar0% (1)
- RésuméDocument8 pagesRésuméAhlam ChennaPas encore d'évaluation
- Recherche Pfe &Document50 pagesRecherche Pfe &Kadiatou KantéPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument21 pages1 PBChristelle TiemeniPas encore d'évaluation
- Ingenieurie FinDocument63 pagesIngenieurie FinndtPas encore d'évaluation
- Matiere Finance D Entreprise PDFDocument43 pagesMatiere Finance D Entreprise PDFHamey CISSEPas encore d'évaluation
- COURS DE CORPORATE FINANCE 2020 (Enregistrï¿ Automatiquement)Document48 pagesCOURS DE CORPORATE FINANCE 2020 (Enregistrï¿ Automatiquement)Prince DongmoPas encore d'évaluation
- Capital Investment Cas Pme MarocDocument23 pagesCapital Investment Cas Pme MarocKhalid AbidPas encore d'évaluation
- HelouazzaniDocument16 pagesHelouazzaniyassPas encore d'évaluation
- Le Capital Investissement Moyen Alternatif de Financement Pour Les PME EtDocument15 pagesLe Capital Investissement Moyen Alternatif de Financement Pour Les PME EtDjaber BEZTOUHPas encore d'évaluation
- Structure Financière Et Performance Économique Des PMEDocument37 pagesStructure Financière Et Performance Économique Des PMEB.IPas encore d'évaluation
- Economie Bord Partie14Document8 pagesEconomie Bord Partie14Stephane Claude AMOUGOUPas encore d'évaluation
- Gestion Financiere DébutDocument23 pagesGestion Financiere Débutelazhari moritPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument16 pages1 PBayoub elazhariPas encore d'évaluation
- Décisions de Financement Et Structure de Capital (Approche Classique)Document16 pagesDécisions de Financement Et Structure de Capital (Approche Classique)elhoussni redouanePas encore d'évaluation
- La Structure Financière Dans Un Environnement InflationisteDocument38 pagesLa Structure Financière Dans Un Environnement InflationisteB.IPas encore d'évaluation
- Structure Du Capital Et Choix Managériaux: Ramzi BenkraiemDocument19 pagesStructure Du Capital Et Choix Managériaux: Ramzi Benkraiemyamina soudaniPas encore d'évaluation
- PFE Le Financement Bancaire Des Projets de Creation Et de Reprise Des PMEDocument45 pagesPFE Le Financement Bancaire Des Projets de Creation Et de Reprise Des PMEyazid Gaming100% (1)
- Analyse de La Performance Des Institutions de Microfinance. Cas de La CAMECDocument74 pagesAnalyse de La Performance Des Institutions de Microfinance. Cas de La CAMECBloody Molosse100% (2)
- Structure Financière de L'entreprise Elyas SaadDocument2 pagesStructure Financière de L'entreprise Elyas SaadElyas SaadPas encore d'évaluation
- Introduction À La Politique FinancièreDocument4 pagesIntroduction À La Politique FinancièreWilfried NABIPas encore d'évaluation
- Atelier Yoyo FANDJADocument19 pagesAtelier Yoyo FANDJApatrickamtoPas encore d'évaluation
- Kapita Memoire Cpte OkDocument71 pagesKapita Memoire Cpte OkmbmkapitaPas encore d'évaluation
- 344-Article Text-1348-1-10-20211129Document11 pages344-Article Text-1348-1-10-20211129Omar AgoujimPas encore d'évaluation
- Pfe Financement Des Pme 2017Document28 pagesPfe Financement Des Pme 2017marhfor67% (3)
- Exposé Gestion de Projet Et Montage FinancierDocument21 pagesExposé Gestion de Projet Et Montage Financiermbark abalouchPas encore d'évaluation
- 7608 18218 1 PBDocument14 pages7608 18218 1 PBSlimani El Alaoui MohamedPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document5 pagesChapitre 1masnaouiyouness2Pas encore d'évaluation
- Le Cadre Conceptuel Des Petites Et Moyennes Entreprises - Diversité Et SpécificitéDocument19 pagesLe Cadre Conceptuel Des Petites Et Moyennes Entreprises - Diversité Et SpécificitéYousouf EsttPas encore d'évaluation
- MemFE03 07 - LBO Financement Acquisition Des Entreprises - PHAM GARCIADocument178 pagesMemFE03 07 - LBO Financement Acquisition Des Entreprises - PHAM GARCIARajita EconomistePas encore d'évaluation
- Les Determinants de La Structure Financiere Des inDocument22 pagesLes Determinants de La Structure Financiere Des inahamadouibt4Pas encore d'évaluation
- Cours de Decision D'invest Et de Financement DR Kuipou m1 FinanceDocument54 pagesCours de Decision D'invest Et de Financement DR Kuipou m1 FinanceIsrael YetmenPas encore d'évaluation
- Le Financement Des Pme Et Les Mecanismes de Garantie en AlgerieDocument13 pagesLe Financement Des Pme Et Les Mecanismes de Garantie en AlgerieDark MonsterPas encore d'évaluation
- HamzaDocument3 pagesHamzasofyan ait malekPas encore d'évaluation
- Impact de L'endettement Sur La Performance Dans Les PME Du District de Bamako Cas BTPDocument14 pagesImpact de L'endettement Sur La Performance Dans Les PME Du District de Bamako Cas BTPEco Tv AbdelPas encore d'évaluation
- Yahamani 5Document64 pagesYahamani 5Hicham FadiliPas encore d'évaluation
- Gouvernance ActionnarialeDocument5 pagesGouvernance Actionnarialeelliot.dumas00Pas encore d'évaluation
- Appel A Candidature - Relance: ContexteDocument23 pagesAppel A Candidature - Relance: Contexteroldes josthenPas encore d'évaluation
- Droit BancaireDocument14 pagesDroit BancaireMonir AmariPas encore d'évaluation
- Les Concepts Économiques de Base ExcelentDocument20 pagesLes Concepts Économiques de Base Excelentafrica2014Pas encore d'évaluation
- RAPPORTDocument59 pagesRAPPORTBilal ABDOULKARIMPas encore d'évaluation
- TrésorerieDocument2 pagesTrésorerieAbel SachetPas encore d'évaluation
- La Politique Budgétaire Comme Instrument de Stabilité Et de Sortie Des Crises Financières Et ÉconomiquesDocument18 pagesLa Politique Budgétaire Comme Instrument de Stabilité Et de Sortie Des Crises Financières Et ÉconomiquesSam Lee100% (1)
- Prise de NoteDocument9 pagesPrise de NoteChama RadiPas encore d'évaluation
- Etude Fao Ada - 1Document35 pagesEtude Fao Ada - 1zakariaPas encore d'évaluation
- Cours Du Marché Financier Et Techniques Financiã©res PR ZANATI 22-23 VDEDocument95 pagesCours Du Marché Financier Et Techniques Financiã©res PR ZANATI 22-23 VDELaila RahPas encore d'évaluation
- Chap 3Document11 pagesChap 3Janice YAVOPas encore d'évaluation
- Cour EMF. Mme LajfariDocument85 pagesCour EMF. Mme LajfariYasser AitelhihiPas encore d'évaluation
- Colivim - PlaquetteDocument8 pagesColivim - PlaquettebiyahofPas encore d'évaluation
- Le Plan de FinancementDocument19 pagesLe Plan de FinancementHamza Afif100% (3)
- Syntheses 1ere EcoDocument26 pagesSyntheses 1ere Ecobeatrice.lin2000Pas encore d'évaluation
- Rap de Minata FinalDocument60 pagesRap de Minata FinalSorePas encore d'évaluation
- Gestion D'entreprisesDocument107 pagesGestion D'entrepriseshossam.chakraPas encore d'évaluation
- MonnaieDocument40 pagesMonnaieBlegnoua Alexandre David100% (1)
- Legislation Cours Ok OkDocument44 pagesLegislation Cours Ok OkJoel MumberePas encore d'évaluation
- Les Principaux OutilsDocument2 pagesLes Principaux OutilsyounusPas encore d'évaluation
- Wepik Les Produits Des Banques Participatives Au Maroc Une Approche Professionnelle 20231112110543fsexDocument13 pagesWepik Les Produits Des Banques Participatives Au Maroc Une Approche Professionnelle 20231112110543fsexadobe5957Pas encore d'évaluation
- Rôle Du Gouvernement Dans La Microfinance FRDocument6 pagesRôle Du Gouvernement Dans La Microfinance FRMamadou NdiayePas encore d'évaluation
- Nouveau Document Microsoft WordDocument8 pagesNouveau Document Microsoft WordKarim FarjallahPas encore d'évaluation
- IPC Rapport Étude KFW Fonsis Rapport FinalDocument78 pagesIPC Rapport Étude KFW Fonsis Rapport FinalOTPas encore d'évaluation
- 8-Groupe BPCE - Facteurs de RisqueDocument16 pages8-Groupe BPCE - Facteurs de Risqueleila abdelwahedPas encore d'évaluation
- Le Rationnement de Crédit BancaireDocument118 pagesLe Rationnement de Crédit BancairetsivoasanajordyPas encore d'évaluation
- Finance HistoireDocument17 pagesFinance HistoireEnongene Armand EbullePas encore d'évaluation
- 519-Article Text-1901-1-10-20210216Document21 pages519-Article Text-1901-1-10-20210216KhalidPas encore d'évaluation