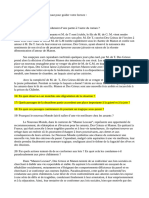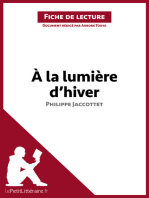Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Parcours 2024 Emancipations Créatrices
Parcours 2024 Emancipations Créatrices
Transféré par
mosbahi30090 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
89 vues4 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
89 vues4 pagesParcours 2024 Emancipations Créatrices
Parcours 2024 Emancipations Créatrices
Transféré par
mosbahi3009Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
ment son organisation canonique, fondée sur l’équi-
Sujet de dissertation : Peut-on dire que dans Cahiers
de Douai Rimbaud a su s’émanciper artistiquement ? libre entre les deux hémistiches, en déplaçant la cé-
Votre réflexion prendra appui sur Cahiers de Douai, sure et en recourant souvent au rejet, comme nous le
les textes étudiés dans le cadre du parcours « Émanci- remarquons dans ce distique de « Rages de Césars » :
pations créatrices », ainsi que sur votre culture per- « Il s’était dit : “Je vais souffler la Liberté / Bien délica-
sonnelle. tement, ainsi qu’une bougie !” ». Mais il ne s’agit ja-
En dépit de la modeste connotation scolaire mais, pour autant, de poèmes en prose, auxquels il
contenue dans son appellation (Cahiers de Douai), le s’adonnera par la suite, dans la lignée de Baudelaire.
premier recueil de Rimbaud marque une date impor- On s’en convaincra en relisant le début du « Dormeur
tante dans l’histoire de la poésie française. Il rompt en du val », marqué par la sensualité et le lyrisme et qui
effet avec une tradition poétique et ouvrent la voie à s’apparente à bien des égards au romantisme par la
la poésie moderne. forme d’un sonnet qui respecte le schéma des rimes
Si les poèmes de Cahiers de Douai, compte te- remontant à Marot, donc au XVI e siècle : abab. abab.
nu des conditions de sa composition, traduisent a ccd. eed. Rappelons que, sur le plan formel, douze
priori une émancipation, un affranchissement des poèmes, sur les vingt-deux du recueil, sont des son-
formes d’autorité lié à l’accès à la maturité, peut-on nets, et que cette structure poétique fait partie, en
cependant parler d’une libération totale, opérée aux 1870, des formes académiques de la poésie patrimo-
plans physique, intellectuel et artistique ? niale française. Dans « Le dormeur du val », le dernier
Après avoir envisagé l’oeuvre comme l’expres- vers apporte même la pointe (le concetto), une chute
sion d’un art de vivre, nous nous poserons la question qui invite le lecteur à relire l’ensemble du texte pour y
de savoir dans quelle mesure Cahiers de Douai renou- trouver a posteriori les indices autorisant une nou-
velle la création artistique, voire est conçu par Rim- velle interprétation (« Il a deux trous rouges au côté
baud comme un moyen d’action lui permettant de re- droit »). Du point de vue du genre de la rime, Rim-
penser le monde. baud respecte là encore la tradition, faisant alterner
fréquemment rimes masculines et féminines, et
Plan détaillé non rédigé : veillant à leur valeur ; ce que nous pouvons constater
I. Un art de vivre plus qu’une œuvre d’émancipation dans « Première soirée ». Enfin, sans relever complè-
a) Une versification somme toute assez classique tement d’une forme fixe, certains poèmes en rap-
b) Vivre l’innocence de la sensualité et communier pellent une, comme « Bal des pendus » dont le titre,
avec la nature le thème traité, l’univers médiéval, la forme et le re-
c) Une culture classique et scolaire tour exact de toute une strophe pour clore le poème
nous rappellent largement « La ballade des pendus »,
II. Une manière de renouveler la création artistique
a) Des rythmes poétiques renouvelés illustre poème de François Villon.
b) Des audaces lexicales et thématiques en vue de I. b)
s’émanciper En outre, écrit par un adolescent du XIX e
siècle, le recueil fait la part belle aux émois amoureux.
III. La poésie conçue comme un moyen d’action, de De nombreuses figures féminines séduisantes
repenser le monde
peuplent Cahiers de Douai et servent de supports à la
a) Le goût de l’indépendance et de la liberté
peinture des différentes étapes de la relation amou-
b) Dénoncer les injustices d’une pensée dominante
c) S’attaquer aux puissants reuse. Cela peut être la jeune femme « fort désha-
billée » de « Première soirée », le « blanc peignoir »
de Nina (« Les reparties de Nina »), les « alertes […]
I. a) fillettes » de « À la musique », ou les jeunes filles ano-
Dans Cahiers de Douai, Rimbaud utilise encore nymes de « Roman » et de « Rêvé pour l’hiver »…
l’alexandrin dans le respect d’un certain classicisme, Mais l’éveil des sens n’est pas associé qu’aux femmes,
dont relève d’ailleurs en 1870, le choix du mètre de car la nature peut aussi susciter un plaisir sensuel in-
douze syllabes. Certes le jeune poète bouscule légère- tense. Or la poésie devient avec Rimbaud un art de
vivre, une manière d’être au monde, de vivre en har- Par exemple, la poésie des Cahiers, héritière
monie avec un univers revisité avec des yeux de poète en cela des recueils Baudelaire et de Hugo, rompt
(« Ma Bohème » : « Mon auberge était à la Grande- chez Rimbaud encore davantage avec la versification.
Ourse »). De même les deux quatrains du poème S’il conserve l’alexandrin, c’est pour mieux en briser le
« Sensation » expriment le plaisir qu’éprouve le « je » rythme : coupes non classiques, enjambements, rejets
poétique à marcher, durant les « soirs bleus d’été », et contre-rejets sont légion. Aussi Rimbaud joue-t-il
dans la nature. D’une manière plus éloquente, une avec l’alexandrin pour casser les groupes rythmiques
nature personnifiée semble, dans « Soleil et chair », habituels en y intégrant d’audacieuses répartitions
érotisée et gorgée de vie comme un corps de femme : syllabiques. Par exemple, dans « Le dormeur du val »,
« la terre est nubile et déborde de sang » et « son im- le vers suivant présente des écarts évidents avec la
mense sein […] est de chair comme la femme ». Nous tradition : « Un soldat jeune, | bouche ouverte, | tête
pouvons par conséquent conclure à la prédominance nue, », soit un rythme en 5-4-3 qui suit la ponctuation
somme toute traditionnelle en période post-roman- dans un vers qui contourne la césure attendue. Enfin,
tique d’un « je » réceptif aux expériences sensorielles. bien que l’usage de techniques relatives à une forme
I. c) fixe puisse, on l’a vu, relever d’une forme de respect
Dans le même poème, Rimbaud fait référence d’une certaine tradition poétique, le lecteur peut éga-
à Vénus ou Cybèle pour désigner la déesse Nature. Or lement y voir le reflet d’une volonté de faire évoluer
sa culture classique est palpable tout au long de Ca- le genre poétique. On voit en effet dans le dernier
hiers de Douai : l’influence de Virgile (Bucoliques, tiers du XIXe siècle que se développe le goût pour l’ar-
Géorgiques) et de Lucrèce (De Natura rerum : La Na- chaïsme en poésie et le genre populaire de la chan-
ture) transparaît dans la peinture que jeune poète fait son, deux tendances repérables sous la plume de
de la nature pleine de vie et de sensualité. Il révèle Jules Laforgue (Complaintes, 1885), en germe chez
dans certaines images sa fine connaissance de la my- Rimbaud dans « Roman » et « Bal des pendus ».
thologie (« L’eau du fleuve, le sang rose des arbres II. b)
verts / Dans les veines de Pan mettaient un uni- Ensuite la langue poétique se marie avec tous
vers ! », « Soleil et chair »), évoquant tour à tour une les sujets, toutes les tonalités (lyrique, satirique,
galerie de divinités de diverse importance, telles épique, pathétique, réunies parfois au sein d’un
qu’Europe, Prométhée ou Éros. Dans un registre même poème), tous les champs du vocabulaire (on
proche de la plaisanterie potache versifiée, Rimbaud pense aux termes « pommadés », « ravaudés »,
revisite aussi la naissance de Vénus dans « Vénus ana- « échine » et « anus » dans « Vénus anadyomène »).
dyomène ». Cela étant le poète ne se contente pas L’audace rimbaldienne se trouve de fait principale-
des références gréco-latines ; les littérature française ment dans le lexique choisi et valorisé par sa position
et européenne sont également présentes dans le re- à la rime. Ce procédé lui permet de bousculer la tradi-
cueil. Par exemple, « Ophélie » propose une réécri- tion du blason poétique de manière encore plus radi-
ture de la pièce Hamlet (Shakespeare, 1603) et, dans cale que ne le fit Baudelaire dans « Une charogne ».
un tout autre style, « Le châtiment de Tartufe » prend On trouve par ailleurs le nom « merde » dans « Le for-
appui sur le célèbre personnage de Molière afin de li- geron », tandis que Rimbaud manifeste une éton-
vrer une critique acerbe de l’hypocrisie reli- nante insistance à placer des termes du langage oral
gieuse (« bavant la foi de sa bouche édentée »). dans ses poèmes, tels les interjections (« Peuh ! »
dans « Le châtiment de Tartufe »), les pointillés ou les
II. a) tirets qui interrompent le cours de nombreux vers.
À cette célébration d’un art de vivre Rimbaud Enfin, la dominante lyrique du recueil ne doit nous
ajoute cependant une revendication aussi singulière tromper : Rimbaud a conscience de son âge et garde
que novatrice : celle de pouvoir explorer de nouveaux parfois une distance ironique qui lui permet de sou-
espaces poétiques. Il bouleverse en effet la concep- rire des élans émotionnels décrits. Il en va ainsi dans
tion que l’on se faisait de la poésie et des pratiques « Roman », qui s’ouvre et se clôt sur le vers « On n’est
d’écriture. pas sérieux quand on a dix-sept ans », et « Les repar-
ties de Nina », Rimbaud rit des émois soudains et des dats comme des êtres insouciants ou de pathétiques
projets déraisonnables de l’amoureux transi (« lui ») victimes).
qu’il est parfois. III. c)
Cette double audace, lexicale et tonale, rend Nous pouvons enfin affirmer que le recueil ose
complexe la personnalité d’un « je » épris d’indépen- s’attaquer aux figures puissantes du clergé et de Na-
dance, soucieux de se peindre en mouvement et sen- poléon III. L’hypocrisie des faux dévots est ainsi dé-
sible à certains thèmes politiques et moraux. noncée dans « Le mal ». De même, une dimension
polémique digne des Châtiments est perceptible dans
III. a) les poèmes « Rages de Césars » et « L’Éclatante vic-
En effet, pendant l’année de composition, toire de Sarrebrück » : l’empereur y apparaît comme
Rimbaud fuit le climat familial et se rend à Paris et en un être méprisable et ridicule (« Car l’empereur est
Belgique. Le recueil met en scène un « je » souvent en soûl de ses vingt ans d’orgie ! » ; « Au milieu, l’Empe-
mouvement, soucieux d’exercer sa liberté d’aller et reur, dans une apothéose / Bleue et jaune, s’en va,
venir à sa guise. Le poème « Sensation » ouvre le re- raide, sur son dada / Flamboyant »). C’est que l’actua-
cueil sur une promenade dans la nature (« J’irai dans lité est bien connue de l’adolescent, qui n’est pas sans
les sentiers »), tandis que « Ma Bohème » le clôt sur savoir qu’au moment où il compose, l’armée prus-
l’évocation d’une fugue (« Je m’en allais »). Les déam- sienne menace de renverser en quelques semaines
bulations dans Charleville sont également mention- les troupes françaises. De plus, Rimbaud défend
nées : en effet, dans « Roman », il « va sous les tilleuls l’idéal républicain dans « Le Forgeron », où Louis XVI
verts de la promenade » et dans « Les reparties de Ni- apparaît comme un avatar de Napoléon III, et dans
na », il accompagne « Nina » à travers la campagne. « Morts de Quatre-vingt-douze », poème dans lequel
Mais le besoin d’ailleurs pousse le « je » à fuguer à Rimbaud vilipende la propagande qui empoisonne la
plusieurs reprises. Ainsi le motif bien connu de « Ma presse et le régime du Second Empire. Il fustige ainsi
Bohème » est repérable dans « Rêvé pour l’hiver » et les journalistes du Pays (journal favorable à la poli-
« Au Cabaret-Vert » (« Depuis huit jours, j’avais déchi- tique impériale), dénonçant leur usage opportuniste
ré mes bottines / Aux cailloux des chemins. [...] »). de la Révolution française pour appeler à la mobilisa-
Chaque fois, l’errance est vécue avec bonheur : dans tion contre la Prusse.
« Sensation », le « je » se dit « heureux, comme avec
une femme », tandis que dans « Les reparties de Ni-
na », le plaisir de l’errance imaginée est comparé à Conclusion
une sorte d’ivresse de tous les sens. Le premier recueil de Rimbaud bouleverse les
III. b) pratiques dominantes à l’époque de leur composition.
Cahiers de Douai témoigne en outre d’ume vo- Âgé d’à peine dix-sept ans, Rimbaud n’en est qu’au
lonté de s’émanciper de la pensée dominante aux début de son itinéraire, mais en dépit d’influences en-
plans social, politique et religieux. En effet, s’oppo- core décelables, ces vers de jeunesse ouvrent un che-
sant souvent aux conceptions qu’il considère comme min jusqu’alors inexploré.
bourgeoises, Rimbaud dénonce le matérialisme et la Cahiers de Douai dépasse la peinture d’un art
petitesse d’esprit qui caractérisent les Carolopolitains de vivre et illustre bien la quête d’une « liberté libre »
assis sur les bancs de la place de la Gare dans « À la (expression de Rimbaud dans une lettre à G. Izam-
musique ». Rimbaud opte pour une vie libérée de bard), absolue : à la fois celle d’aller et venir, mais
leurs préjugés moraux (« Roman ») ou des idées belli- aussi la possibilité de penser différemment, dans une
cistes. D’une manière générale s’impose d’ailleurs nouvelle langue poétique, voire de remettre en cause
l’idée d’un « je » antimilitariste, qui dénonce avec une la légitimité des autorités.
certaine finesse la barbarie et les mensonges qui envi- Rimbaud n’en reste pas moins un artiste inspi-
ronnent toute guerre (« Le mal », « Le dormeur du ré par la poésie parnassienne et marqué par Hugo,
val », « À la musique », qui présentent les simples sol- Baudelaire, ou même Verlaine, dont il a lu Poèmes sa-
turniens (1866) et Fêtes galantes (1869) Présente dès
ce premier recueil, cette émancipation s’épanouira
dans les œuvres ultérieures, notamment Illumina-
tions (1886), où le langage fait advenir une vision in-
édite du monde.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Trame Se Soigner Par Lénergie Du Monde (French Edition) (Patrick Burensteinas) (Z-Library)Document96 pagesLa Trame Se Soigner Par Lénergie Du Monde (French Edition) (Patrick Burensteinas) (Z-Library)Rahman100% (1)
- La Bénédiction Du Sel Et de L'eauDocument2 pagesLa Bénédiction Du Sel Et de L'eauThamai100% (1)
- Manuel Du Conducteur de Culte 2015-2016Document12 pagesManuel Du Conducteur de Culte 2015-2016Cécé Charles Kolié82% (17)
- Parcours IIIDocument5 pagesParcours III667 X lzPas encore d'évaluation
- Méthodes de Recherche en Management by ImihiDocument618 pagesMéthodes de Recherche en Management by ImihiSalma Nouni100% (3)
- Questionnaire Manon LescautDocument3 pagesQuestionnaire Manon LescautClara Cheron100% (1)
- Les Fleurs du mal, « Correspondances », Charles Baudelaire: Commentaire de texteD'EverandLes Fleurs du mal, « Correspondances », Charles Baudelaire: Commentaire de texteÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Analyse Lettre 161Document4 pagesAnalyse Lettre 161edemmagh2000Pas encore d'évaluation
- Bac Français Les Fleurs Du Mal - v2Document4 pagesBac Français Les Fleurs Du Mal - v2thomasPas encore d'évaluation
- Commentaire Linéaire L'albatros Baudelaire 1857Document4 pagesCommentaire Linéaire L'albatros Baudelaire 1857Nas AirrPas encore d'évaluation
- Approche de La Notion de PoesieDocument8 pagesApproche de La Notion de PoesieantoPas encore d'évaluation
- Rimbaud Émancipations Créatrices CoursDocument9 pagesRimbaud Émancipations Créatrices Coursninjax2000proPas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud - Les Effarés - CommentaireDocument3 pagesArthur Rimbaud - Les Effarés - CommentaireAlavi AurélienPas encore d'évaluation
- Evaluation N 3 DissertationDocument2 pagesEvaluation N 3 Dissertationjigglepeeker02Pas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud, Sensation - Commentaire ComposéDocument2 pagesArthur Rimbaud, Sensation - Commentaire ComposéAlavi AurélienPas encore d'évaluation
- TEXTE BAC N°2 Extrait Acte II Scène 8 Le M.I (Molière)Document6 pagesTEXTE BAC N°2 Extrait Acte II Scène 8 Le M.I (Molière)Raiii.78Pas encore d'évaluation
- Le Crapaud, Corbière LL RédigéeDocument4 pagesLe Crapaud, Corbière LL RédigéeLaurence Silva100% (2)
- Explication Linéaire Du Texte 11 - Portrait de L'antiquaireDocument3 pagesExplication Linéaire Du Texte 11 - Portrait de L'antiquaireClo05Pas encore d'évaluation
- Colette Préparation Au Bac PDFDocument2 pagesColette Préparation Au Bac PDFMister SPas encore d'évaluation
- 2queneau LA-GZ SAD11Document5 pages2queneau LA-GZ SAD11Ane KatePas encore d'évaluation
- La PoesieDocument3 pagesLa PoesielesliePas encore d'évaluation
- Sido Texte 5Document2 pagesSido Texte 5wennamanyPas encore d'évaluation
- Abbé Prévost, Manon LescautDocument2 pagesAbbé Prévost, Manon Lescauttroallic100% (2)
- Ma BohèmeDocument5 pagesMa BohèmecolasadlerlilianPas encore d'évaluation
- Le Malade Imaginaire-2Document4 pagesLe Malade Imaginaire-2riezjrif fsdjkfipsdjPas encore d'évaluation
- Fiche A QUI DONC SOMMES NOUSDocument6 pagesFiche A QUI DONC SOMMES NOUSAmina Belarouci100% (1)
- Arthur Rimbaud, À La Musique - Plan Détaillé Pour Un Commentaire ComposéDocument2 pagesArthur Rimbaud, À La Musique - Plan Détaillé Pour Un Commentaire ComposéAlavi AurélienPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde p2 Scene 3Document5 pagesJuste La Fin Du Monde p2 Scene 3siyeon9242Pas encore d'évaluation
- Programme Bac 2023 2024 2Document13 pagesProgramme Bac 2023 2024 27k2xwytvq6100% (1)
- Axe de Dissertation Sur GargantuaDocument7 pagesAxe de Dissertation Sur Gargantuanour.elamrani24Pas encore d'évaluation
- Cours Droit Des Stes CommercialesDocument82 pagesCours Droit Des Stes CommercialesMohamed Moudine100% (1)
- Fiche-Bilan Le Parti Pris Des ChosesDocument12 pagesFiche-Bilan Le Parti Pris Des Chosesfrancis100% (1)
- DISSERTATION - Eléments de CorrigéDocument3 pagesDISSERTATION - Eléments de CorrigéanasserekifPas encore d'évaluation
- ETUDE LINEAIRE N°7 La Mort de ManonDocument3 pagesETUDE LINEAIRE N°7 La Mort de Manoncmmcpbbw7n100% (1)
- nrpl99 Juin22 Seq1 La BruyereDocument10 pagesnrpl99 Juin22 Seq1 La BruyereGaltier JulienPas encore d'évaluation
- Sémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFDocument28 pagesSémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFvelhobiano67% (3)
- À la lumière d'hiver de Philippe Jaccottet (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandÀ la lumière d'hiver de Philippe Jaccottet (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Personnages en Marge Exemple SuiteDocument3 pagesPersonnages en Marge Exemple Suitemaelle.carpaye.runPas encore d'évaluation
- Bodies York Rite Structure GlufmmmoscDocument6 pagesBodies York Rite Structure GlufmmmoscMatthieu LUBOYAPas encore d'évaluation
- Fleurs Du Mal Notamment. Rêvé Pour L'hiver, Et Ma BohêmeDocument6 pagesFleurs Du Mal Notamment. Rêvé Pour L'hiver, Et Ma BohêmeMatheo MariaPas encore d'évaluation
- Gargentua 2Document4 pagesGargentua 2riezjrif fsdjkfipsdjPas encore d'évaluation
- Parcours Spectacle Et ComédieDocument4 pagesParcours Spectacle Et ComédieYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- Texte 1 - Acte I Scène 2 LFCDocument2 pagesTexte 1 - Acte I Scène 2 LFCAsiganPas encore d'évaluation
- 2 Piste de Correction (Sujet: Centre Étranger) Le Malade ImaginaireDocument4 pages2 Piste de Correction (Sujet: Centre Étranger) Le Malade Imaginairedroniouarthur100% (1)
- Les Effarés Rimbaud Analyse LinéaireDocument12 pagesLes Effarés Rimbaud Analyse Linéaireapolline.charrondierePas encore d'évaluation
- Travail Francais (Arthur Rimbaud + 4poemes)Document1 pageTravail Francais (Arthur Rimbaud + 4poemes)vuillemin.margPas encore d'évaluation
- 2022 Metropole CorrigeDocument7 pages2022 Metropole CorrigeAnisha RegularasaPas encore d'évaluation
- Fiche Dissertation Juste La Fin Du MondeDocument2 pagesFiche Dissertation Juste La Fin Du MondeAnthony DufourPas encore d'évaluation
- ANDRÉE CHEDID. RythmesDocument20 pagesANDRÉE CHEDID. RythmesÉlésiorPas encore d'évaluation
- 5 Explication Linéaire LhuitreDocument2 pages5 Explication Linéaire LhuitreMaxence DuboisPas encore d'évaluation
- (Aristote) de La G?n?ration Des AnimauxDocument461 pages(Aristote) de La G?n?ration Des AnimauxFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- 2 EAF2 Ma Boheme Questions CorrectionDocument3 pages2 EAF2 Ma Boheme Questions Correctionelsagril02Pas encore d'évaluation
- EL 3 Il Fait Un Temps d' Insectes AffairésDocument3 pagesEL 3 Il Fait Un Temps d' Insectes Affairésanabelle.allard43100% (1)
- Dissertation Les Fleurs Du Mal Mareschal RomaneDocument2 pagesDissertation Les Fleurs Du Mal Mareschal Romanenaboussy inass100% (1)
- EXPLICATION LINÉAIRE CharogneDocument3 pagesEXPLICATION LINÉAIRE CharogneLaurence CROSPas encore d'évaluation
- Analyse Manon LescautDocument5 pagesAnalyse Manon LescautInès NicolasPas encore d'évaluation
- Au Cabaret-Vert Arthur Rimbaud AnalyseDocument7 pagesAu Cabaret-Vert Arthur Rimbaud Analysemjegham2019Pas encore d'évaluation
- LL3Les Violettes Dans Le Dernier FeuDocument7 pagesLL3Les Violettes Dans Le Dernier FeumathildaehretPas encore d'évaluation
- NRP - LYCEE - SEPT - 2021 Voix de FemmesDocument48 pagesNRP - LYCEE - SEPT - 2021 Voix de FemmesAudreyPas encore d'évaluation
- M.I. Lecture Linéaire I, 1Document2 pagesM.I. Lecture Linéaire I, 1spidermanflash8Pas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 15-4Document4 pagesLecture Linéaire 15-4SandraPas encore d'évaluation
- Manon Lescaut L'enterrementDocument3 pagesManon Lescaut L'enterrementbenoldikillianPas encore d'évaluation
- 1re Francais Victor Hugo Les Contemplations I IV Dissertation Sujet 2021Document2 pages1re Francais Victor Hugo Les Contemplations I IV Dissertation Sujet 2021Elyas BenghanemPas encore d'évaluation
- MOLIERE Acte IV Scene 5-6 Elements AnalyseDocument2 pagesMOLIERE Acte IV Scene 5-6 Elements AnalyseFatima LAHSSINIPas encore d'évaluation
- 2 Analyse - Dormeur - Du - ValDocument2 pages2 Analyse - Dormeur - Du - Valeliott.mdc27Pas encore d'évaluation
- Correction Lecture Linéaire Zone Rédigée 4Document3 pagesCorrection Lecture Linéaire Zone Rédigée 4syadPas encore d'évaluation
- DissertationDocument7 pagesDissertationXenos TV100% (1)
- Ce Coeur Qui Haïssait La GuerreDocument3 pagesCe Coeur Qui Haïssait La GuerreDavid WalterPas encore d'évaluation
- JNGG 2012 519 PDFDocument8 pagesJNGG 2012 519 PDFFaci AliPas encore d'évaluation
- Plaquette Des EnseignementsDocument17 pagesPlaquette Des Enseignementsabdul.rahmanprivate.box2022Pas encore d'évaluation
- Enon SuitesDocument26 pagesEnon SuitesLOUNDOU orthegaPas encore d'évaluation
- Reflexion Sur Le Style Néo Mauresque en AlgérieDocument53 pagesReflexion Sur Le Style Néo Mauresque en AlgérieMARWA BOUPas encore d'évaluation
- M2 - Mémoire - SR ModifDocument121 pagesM2 - Mémoire - SR ModifSandra RebolledoPas encore d'évaluation
- Management HospitalierDocument4 pagesManagement HospitalierAli Lemrabet0% (1)
- 3 - DéglutitionDocument17 pages3 - DéglutitionouazzanyPas encore d'évaluation
- 1 Rapport de SSTDocument3 pages1 Rapport de SSTAbdellahPas encore d'évaluation
- Sujet Certification Octobre 2015 Validé 2Document5 pagesSujet Certification Octobre 2015 Validé 2fatoutraore2345Pas encore d'évaluation
- DS Elec n1Document4 pagesDS Elec n1Zac RajayiPas encore d'évaluation
- Programmation Linéaire en Nombres Entiers Pour L'ordonnancement Modulo Sous Contraintes de Ressources.Document75 pagesProgrammation Linéaire en Nombres Entiers Pour L'ordonnancement Modulo Sous Contraintes de Ressources.Med GasPas encore d'évaluation
- 2021 03 Metro Sujet1 ExoB BoissonHydratation 5pts CorrectionDocument6 pages2021 03 Metro Sujet1 ExoB BoissonHydratation 5pts CorrectionYoram JdlPas encore d'évaluation
- Fiche MethodeDocument3 pagesFiche MethodeLoundou ortegaPas encore d'évaluation
- Le Colonel Si Sadek Est Mort Le Matin DZDocument3 pagesLe Colonel Si Sadek Est Mort Le Matin DZxeres007Pas encore d'évaluation
- Macadabre OdtDocument2 pagesMacadabre Odtjean reuhPas encore d'évaluation
- Les Yowlè - Recherche GoogleDocument1 pageLes Yowlè - Recherche Googlekouameulysse0Pas encore d'évaluation
- Correction SERIE EXERCICES TP3Document5 pagesCorrection SERIE EXERCICES TP3Khlifi AyoubPas encore d'évaluation
- Rendu Approche Documentaire BRUN Tom CARNIAUX FabienDocument8 pagesRendu Approche Documentaire BRUN Tom CARNIAUX FabienFafabi ibafaFPas encore d'évaluation
- Emeka Et Le Vieil Homme - Nwanne Felix-EmeribeDocument14 pagesEmeka Et Le Vieil Homme - Nwanne Felix-EmeribeSara CANO CARRATALÁPas encore d'évaluation
- TD Dualité 2021Document2 pagesTD Dualité 2021AYMANE JAMAL100% (1)
- BIOLOGIE1TD3groupes3 4 5et6L1Geo21Document4 pagesBIOLOGIE1TD3groupes3 4 5et6L1Geo21aqua FishPas encore d'évaluation
- Spasmocalm 80mgDocument4 pagesSpasmocalm 80mgSmile ForeverPas encore d'évaluation