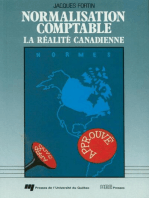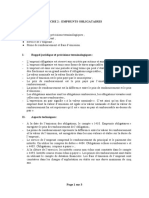Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ifrs
Ifrs
Transféré par
Aicha OdTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ifrs
Ifrs
Transféré par
Aicha OdDroits d'auteur :
Formats disponibles
Universit Moulay Ismal Mekns
Ecole Suprieure de Technologie Dpartement : Techniques de Management
INFORMATIQUE ET COMPABILITE DES ENTREPRISES
PROJET DE FIN DETUDES
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Encadrement : Mr. B. NEJJAR Mr. N. MARCHOUD
Ralis par : ERRMA HASSANA
Anne Universitaire 2006 2007
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Nous tenons remercier tous ceux qui ont particip de prs o de loin llaboration de ce projet de fin d'tude. Tous ont fait preuve dun dvouement et dune patience toute preuve et surtout Mme
ACHAHBOUN Zoubida.
Nous Tenons aussi remercier Mr B. NEJJAR et Mr. N. MARCHOUD pour leurs conseils sur le plan technique et mthodologique ainsi que pour leur grande disponibilit.
Enfin nous remercions lensemble des membres du corps enseignant et de la direction de LEST travers son directeur M. fouad Ainsi que les professeurs de lEcole
Supriere de Technologie de Mekns pour leur encadrement et
2
leur
sens
de
la
pdagogie.
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
REMERCIEMENTS INTRODUCTION CHAPITRE I : CONTEXE DE LA NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE I : CADRE GENERAL DES NOUVELLES NORMES I-2- LE CADRE CONCETUEL I-3 LA COMMUNICATION AUTOUR DE PASSAGE AUX NORMES IFRS9 II- ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES NORMES IFRS / NORMES MAROCAINE CHAPITRE II : LIMPACT DU PASSAGE AUX IFRS SUR LA QUALITE DE LINFORMATION FINANCIERE : OPPORTUNIETE ET COMPLEXITE I- LES INCIDENCES DU CHANGEMENT DU REFERENTIEL 25 25 17 7 7 4
I-1- L'HARMONISATION COMPTABLE INTERNATIONALE ...7
I-1 COMMENT LE PASSAGE AUX IFRS EST IL RESSENTI ?.......25 I-2 REPERCUSSIONS ORGANISATIONNELLES.28 II- LES IFRS VERS LA DEMOCRATISATION OU LAUTARCIE DE LINFORMATION FINANCIERE
II-1 CREATIVITE COMPTABLE, DISTORSIONS ET MANIPULATION II-3-LA REGULATION FINANCIERE A LA CROISEE DES CHEMINS
32
32 36
II-2- LES IFRS : LE NOUVEAU LANGAGE DU CAPITALISME COMPTABLE 35
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
III- UNE VISION GLOBALE SUR LA REALITE ECONOMIQUE DE LENTREPRISE LORS DE LA REFORME COMPTABLE : RISQUES ET OPPORTUNITES .37 CHAPITRE III : MODLES DE LIMPACT SUR LA QUALITE DE LINFORMATION FINANCIERE I. CAS DE MAROC TELECOM I.1. CHANGEMENT DE REFERENTIEL COMPTABLE I.2. LA TRANSITION IFRS : DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET I.3. MODIFICATION APPORTEES A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS LORS DE LADOPTION DU NOUVEAU REFERENTIEL REFERENTIEL IAS/IFRS II. CAS SCANIA MAROC II-1 BREVE PRESENTATION DE SCANIA MAROC II-2 LA DEMARCHE DU TRAITEMENT DES NORMES 16 et 36 II-3 DEFINITION DES UNITES GENERATRICES DE TRESORERIE CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE ANNEXES 44 44 46 46 47 49 55 56 57 I.4. PRESENTATION DES IMPACTS APPORTEES PAR LAPPLICATION DU 41 41 41 41
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Lintroduction des normes IAS/IFRS a souvent t dcrite comme entranant une rvolution de linformation financire. Tout de moins, elle reprsente un changement profond pour les entreprises. Le changement est clair sur le plan conceptuel : comme en tmoigne le choix de linvestisseur comme destinataire privilgi de linformation financire. Les marchs financiers internationaux revtent de plus en plus dimportance pour les entreprises cherchant accder des sources de financement lchelle international. Le nombre des transactions menes sur les marchs montaires et financiers internationaux enregistrent une croissance sans prcdent. La transparence devient alors un facteur-cl de lefficacit des marchs de capitaux. Cest prcisment pour cette raison quil est indispensable de pouvoir comparer les tats et rsultats financiers des diffrentes entreprises du monde entier do lide de luniformisation des normes IAS/IFRS. Dans le contexte actuel de mondialisation, l'harmonisation internationale, ou encore la rduction des diffrences entre rglementations comptables nationales, est donc devenue un enjeu pour les entreprises, cette harmonisation leur permettra notamment d'accder tous les marchs financiers sans avoir tablir un jeu de comptes particuliers pour chaque place financire. Paralllement, les investisseurs pourront plus facilement valuer la performance de toute entreprise sans avoir connatre les spcificits de chaque comptabilit locale. Ladoption donc des normes IAS/IFRS aux socits europenne ou marocaines ncessite une anticipation et une rflexion qui nen demeure pas mineur. En effet, la production et la communication de linformation financire, aussi bien interne quexterne vont ainsi tre modifies en profondeur. Ainsi, lensemble des changements imposs ncessite une vritable gestion de projet et une attention des dirigeants des entreprises. Cet attention, prend alors forme en assimilant en un premier lieu les enjeux rels de ladoption de ces normes, ce qui signifie une parfaite familiarisation avec les rgles techniques de passage dune comptabilit nationale une comptabilit internationale. En second lieu, cette attention doit tenir compte des spcificits propres aux organes veillant sur ces normes ainsi que des enjeux politiques et conomiques qui se cachent derrire la volont dune harmonisation comptable internationale. Dans ce contexte de normalisation internationale quels sont donc les enjeux rels de ladoption des normes IAS/IFRS et quels sont les organismes qui ditent, rgulent et contrlent ces normes ? A ce niveau, trois enjeux caractrisent ce rfrentiel international. Dabord satisfaire les investisseurs, ensuite fournir une information financire fidle la ralit conomique, enfin avoir une base unique permettant une meilleure comparabilit des indices et ratios financiers utiliss par les diffrentes parties prenantes du monde des affaires ? De ce fait, ces normes sont labores par le comit des normes internationales (IASB) qui a pour objectif de les prsenter comme tant des normes financires caractre volutif et dconnectes des contraintes fiscales et des environnements juridiques de chaque pays. 5
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Toutefois ce que lon peut dire concernant le fonctionnement de cet organisme sapplique sur les normes quil propose et qui restent complexes et assez ambigus de par leur contenu ce qui laisse planer certaines zones dombres quand leur efficacit. Ces zones dombres, entachent la justesse de leur application et ce qui cre des bouleversements et des distorsions au sein des diffrents acteurs de la communaut financire, rendant alors la communication de linformation financire difficile et envisageant ainsi lutilisation dun grand nombre dinformations tout en limitant les choix comptables dont disposaient les diffrentes parties prenantes. Quelles sont les convergences et divergences de limpact du passage au IFRS sur linformation financire par les parties prenantes ? Ds leur application en janvier 2005 par les socits cotes en bourse, les diffrentes parties prenantes de linformation financire ont remarqu que ces normes ne sont pas neutres et ont un impact rel, bien que difficile mesurer, sur le fonctionnement de lconomie. En effet, lEurope qui est passe directement dun modle traditionnel de dcision nationale une dlgation de souverainet au bnfice dun organisme priv vocation mondiale, dans lequel linfluence europenne nest pas prpondrante a montr que la question de la gouvernance des normes comptables porte rellement sur la responsabilit ultime du politique mais aussi sur la manire la plus efficace dexercer travers ces normes compte tenu de la complexit technique et du caractre volutif de cette matire. De ce fait, une bonne qualit de linformation financire, ncessite un projet de conversion aux normes IFRS quitable pour toutes les parties prenantes et impliquant une transformation radicale de la philosophie et du langage financier vers une harmonisation comptable et financire plus juste. Autant dire que la russite d'un tel projet ne pourra aboutir que grce aux efforts conjugus de l'ensemble des parties concernes. Afin de rpondre notre problmatique sur limpact du passage aux normes IFRS sur la qualit de linformation financire par les parties prenantes ainsi quaux diffrentes questions cites auparavant , nous axerons notre prsentation en deux parties. Dans la premire partie nous dfinirons le contexte de la normalisation comptable international, en prsentant le cadre conceptuel pour comprendre lorigine de ces normes et comment la communication autour de ces dernires est faite. Dans une seconde partie, nous traiterons des consquences du passage aux normes IAS/IFRS sur linformation financire par les futurs utilisateurs ainsi que des enjeux politiques quelles prsentent. Finalement notre rapport prsentera notre vision de ce nouvel ordre conomique travers deux cas pratiques mettant en vidence dune part lexprience de certaines entreprises en la matire et dautre part nous montreront les opportunits et les complexits de la mise en place et de lapplication de ces normes IAS/IFRS.
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
CONTEXE DE LA NORMALISTION COMPTABLE INTERNATIONAL
I . CADRE GENERAL DES NOUVELLES NORMES
II- ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES NORMES IFRS / NORMES MAROCAINES
CHAPITRE I:CONTEXE DE LA NORMALISTION COMPTABLE INTERNATIONAL
7
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
I : CADRE GENERAL DES NOUVELLES NORMES
L'arrive des IFRS (International Financial Reporting Standards) annonait une re nouvelle de normes internationales de haute qualit et un instrument permettant aux investisseurs de mieux apprcier leurs choix d'investissements. Quelque temps aprs leur adoption, le dbat intense au sujet de l'introduction des IFRS se poursuit. Que peut-on dire des expriences initiales dans la mise en uvre des IFRS? La ralit a-t-elle t la hauteur des attentes? Quel a t l'effet de leur introduction et pourquoi certains ont-ils trouv difficile de l'accepter? Que pouvons-nous esprer pour l'avenir? Peut-on s'attendre ce que les IFRS soient adoptes l'chelle mondiale dans un dlai prvisible?
I-1- L'HARMONISATION COMPTABLE INTERNATIONALE
1.1.1 LES MOTIFS DE L'HARMONISATION COMPTABLE 1.1.1.1 Motivation de l'harmonisation comptable La coexistence de diffrents rfrentiels comptables internationaux, alors que les changes sont de plus en plus mondialiss, et les conomies de plus en en plus intgres, pose des problmes de lisibilit des informations comptables, en fonction des normes selon lesquelles elles ont t tablies (normes anglo-saxonnes: USGAAP - UniTed States Generally Accepted Accounting Principles; europennes: 7eme directive ; internationales : IASB International Accounting Standard Board). Un processus d'harmonisation, puis de normalisation internationale est donc en cours, qui terme devrait aboutir une convergence des principaux standards (USGAAP et IASB). Par ailleurs, l'union europenne a adopt le 29 septembre 2003 les normes internationales lAS (devenues depuis juin 2003 IFRS - International Financial Reporting Standards). Les normes comptables marocaines sont particulirement concernes par cette mise en conformit, en raison de leur caractre singulier. 1.1.1.2 Le dveloppement des marchs financiers Le dveloppement des marchs financiers a montr les limites de l'individualisation des rfrentiels comptables nationaux : pas d'existence formelle d'un systme de norme unifi pour les entreprises qui lvent des capitaux sur les marchs internationaux; absence d'homognit de l'information financire fournie aux investisseurs; investissement en temps important pour les directeurs financiers de socits afin de prsenter l'information financire selon les diffrents rfrentiels.
Exemple: une entreprise cote Casablanca (publiant des comptes en normes marocaines) souhaite s'introduire sur une place boursire de New York, pour accrotre son dveloppement et sa notorit. Elle doit fournir la SEC un tableau de rconciliation entre tats financiers en normes marocaines et tats financiers en US GAAP. (Voir schma 1) 1.1.1.3 Une crise de linformation financire
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Au cours de la dernire dcennie , lacclration de linternationalisation des conomies puis leur mondialisation et donc la globalisation des marchs des capitaux qui en a rsult, ainsi que le poids croissant de lpargne institutionnelle , ont plac la comptabilit au cur du fonctionnement des marchs financiers. Hors, la comptabilit est devenue un dopant des performances des entreprises par des techniques de gestion du bilan au dtriment de toutes rationalits et ralits. En effet, la comptabilit a perdu sa confiance, surtout par des mthodes comptables pas toujours en phase avec la ralit des oprations, et par cette raison que la crise de confiance de linformation financire fournies par les entreprises est apparut. Hormis les grands investisseurs institutionnels en bout de chane, tous les acteurs des marchs financiers se retrouvent dans les tourmentes comptables. En premire ligne les directeurs financiers et gnraux des grands groupes et les auditeurs. Jusqu encore trs rcemment, ils taient peu contrls ; seule la rvlation a posteriori dune erreur comptable pouvait les dfaire. En fait, cette situation est aggrave par tout ce qui est arriv des entreprises Europen comme celle de groupe de Metallgesellschaft, le fond LTCM et le scandale dEnron. 1.1.1.4 Norme locales: absence de cadre conceptuel Ainsi, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe ; la comptabilit est largement perfectible. Elle ne donne pas une image de la situation de trsorerie. En outre la diversit des rfrentiels rend les entreprises dun secteur incomparables. A la mondialisation des conomies et la globalisation financire rpond logiquement lhomognisation des informations financires et comptables fournies aux investisseurs. Lune des lacunes de la doctrine comptable marocaine ; comme de nombreux rfrentiels locaux,provient,du fait que le Maroc ne sest jamais dote dun cadre conceptuel ce qui oblige la recherche de la solution comme le dit Yves Bernheim dans son ouvrage lessentiel des US GAAP: labsence de dfinition des concepts essentiels,lomission dobjectif fixes pour des tats financires dont on ne sait pas aux besoins de quels utilisateurs ils devraient rpondre,linexistante ou le caractre non explicite dhypothses fondamentales sur la base desquelles les tats financiers devraient tre prpars,et labsence de caractristiques qualitatives sous la forme desquelles ces tats devraient tre prsents, aboutissent un systme de normalisation recherchant les solutions au cas par cas. 1.1.2 LES ENJEUX DE LADOPTION DES NORMES IAS/IFRS1
Les normes IAS/IFRS, quest ce que cest ?
Il est important de bien comprendre quen comptabilit, on a deux notions diffrentes : dune part les comptes sociaux, lgaux, qui doivent correspondre la lgislation fiscale du pays dont relve une socit, et dautre part les comptes au sens de la consolidation dun groupe, qui sont publis pour linformation des investisseurs.
Autant la comptabilit marocaine ne change pas, autant pour les groupes, depuis longtemps dj, il existe des normes pour la consolidation. Les plus connues sont LUSGAAP et LIAS/IFRS, les premires qui sont dorigine amricaines alors que les secondes
1
Grgory Heem ; Lire les tats financiers en IFRS ; ditions dorganisation ; 2004
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
sont dorigine europenne. La prsentation des rsultats des socits cotes aux USA se fait obligatoirement selon ces normes. Les IAS/IFRS sont un ensemble de normes comptables europennes, qui ont t faite dans le mme but que les US-GAAP. Elles sont encore en cours dvaluation, et elles tendent converger vers les normes amricaines. Les rsultats financiers de lentreprise en normes IAS peuvent tre trs diffrentes des rsultats fiscaux. Pour la prsentation de ces rsultats, on parle de normes IFRS. Les IAS se prsentent sous la forme dune srie de normes numrotes (IAS1. IAS2, IAS3..IAS41) qui ont pour but duniformiser les principes comptables utiliss, afin de fournir aux investisseurs des informations plus claires et plus comparables.
Qui est concern par ces normes ?
Les entreprises cotes en Europe et leurs filiales dans tous les pays devront prsenter leurs comptes consolids pour les exercices couverts partir du 1er janvier 2005 (avec un retraitement des donnes de 2004 pour permettre la comparaison). Mais il est probable qu plus long terme toutes les entreprises seront concernes, ce dautant plus que les normes comptables nationales de chaque pays europen ou non europen ayant de fortes relations conomiques ou financires avec lEurope vont finir par converger vers le rfrentiel IAS.
Ce qui va changer lors de lapplication des ces normes
Dans le cadre de ces normes, on comptabilise diffremment, un certain nombre doprations (sans pour autant modifier la comptabilisation lgale et fiscale du pays). Ce sont donc surtout les pratiques comptables qui vont changer (comptabilisation des oprations de fusion acquisition, du traitement des immobilisations, des risques de change, des provisions), soit par des imputations, soit par des jeux dcritures diffrents. La gestion des immobilisations est par ailleurs trs touche : elle ncessite un ddoublement de toutes les rgles damortissement.
I-2- LE CADRE CONCPETUEL2
I-2-1 LIASC LIASC labore les normes comptables internationales grce un processus tabli qui implique la profession comptable mondiale, les prparateurs et les utilisateurs des tats financiers, et les organismes nationaux de normalisation. LIASC est dsormais reconnu comme le seul processus tabli dlaboration de normes comptables internationales. Les objectifs de lIASC sont de formuler et de publier les normes comptables observer pour prsenter les tats financiers, de promouvoir leur acceptation et leur application dans le monde et de travailler de faon gnrale lamlioration et lharmonisation des tats financiers. Les membres de l IASC sont les organismes professionnels comptables membres de la Fdration Internationale des Comptables (IFAC) (International Federation of accountant). LIASC est finance par les organismes comptables et dautres membres appartenant son conseil, par lIFAC, par les contributions de socits multinationales, dinstitutions financires, de firmes comptables et dautres organisations(voir annexe1).
I-2-1-1 Structure
2
Cours de la MSTCF- comptabilit anglo-saxonne et IFRS Mr Fraiha
10
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
a. Le conseil
Lactivit de lIASC est exerce par un Conseil qui comprend les reprsentants dorganismes comptables de treize pays nomms par le Conseil de lIFAC et de quatre organismes, au plus, ayant un intrt pour les rapports financiers. Chaque membre peut dsigner deux reprsentants au plus et un conseiller technique pour participer aux runions du Conseil. Le Conseil dfinit le programme de lIASC, constitue les groupes de travail chargs de llaboration des textes, suit lavancement des travaux, commente les projets qui lui sont soumis et se prononce sur ladoption des normes.(Il se runie trois fois par an) b. Le groupe consultatif Il a t mis en place par le Conseil de lIASC en 1981 et comprend des reprsentants de divers organismes concerns par llaboration ou lutilisation des tats financiers (Bource des Valeurs, Organismes Nationaux de Normalisation Comptable). Il se runit priodiquement pour discuter avec le Conseil des questions techniques sur le projet de lIASC, de son programme de travail, de sa stratgie. Ce groupe joue un rle important dans le processus dlaboration des Normes Comptables Internationales et pour lacceptation des normes tablies.
c. Le Conseil Consultatif :
Il a t mis en place en 1995. Ce conseil est compos de personnes de qualits exceptionnelles occupant de hautes responsabilits dans la profession comptables. Son rle est de promouvoir lacceptation en gnral des Normes Comptables Internationales et daccrotre la crdibilit du travail de lIASC par les moyens suivants entre autres : Examen et observation sur la stratgie et les plans de lASC, de tele sorte avoir lassurance que les besoins des membres sont satisfaits ; Recherche et obtention de financements pour le travail de lIASC en veillant ce que son indpendance nen soit pas atteinte ; Examen du budget et des tats financiers de lIASC ; Prparation dun rapport sur lefficacit du Conseil de lIASC dans la ralisation de ses objectifs et dans laccomplissement du processus dlaboration des normes.
Il sassure notamment de lindpendance et lobjectivit du Conseil lorsque ce dernier prend des dcisions techniques sur les propositions de Normes Comptables Internationales. Le Conseil Consultatif ne participe pas et ne cherche pas influencer ces dcisions.
I-2-1-2 Llaboration des normes Les reprsentants au conseil, les organisations membres, les membres du groupe consultatif, les autres organisations et personnes physiques sont encourags prsenter de nouveaux sujets pouvant tre traits dans les normes comptables internationales. 11
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Une fois que le conseil a ajout un sujet son programme, il tablit un groupe de travail pour laborer une dclaration de principe, un expos sondage, et en dernier lieu une norme comptable internationale : IAS. Le conseil a publi un cadre de prparation et de prsentation des tats financiers dont les objectifs sont daider le conseil laborer les futures normes comptables internationales et rviser les normes comptables existantes, de promouvoir lharmonisation des normes travers la rduction du nombre des retraitements comptables. (Voir annexe1) I-2-2 LIASB Dans la structure de lIASC, lInternational Accounting Standards Board (IASB) a toutes les comptences en matire technique ce qui inclue la prparation et llaboration des standards comptables et dun trait dexposition. Pour accomplir sa mission, lInternational Accounting Standards Board (IASB) procde : D es tests (aussi bien dans les pays dvelopps que dans les marchs mergeants) pour sassurer que les standards sont praticables dans tous les environnements ; D es consultations de lopinion public pour discuter et proposer des standards, mme si il ny a pas de demande pour tous les projets.
Ainsi, LIASB a les pleins pouvoirs concernant lagenda de lIASC, ses projets, et lorganisation de son travail. Le board peut sous-traiter des recherches ou des travaux auprs des dcideurs des standards nationaux ou auprs dautres organisations. Parmi les responsabilits attribues lIASB : La publication dun trait dexposition sur chaque projet et doit normalement publier un trait de principe ou un autre document permettant des commentaires publics sur les principaux projets; La rvision des commentaires effectus dans une priode raisonnable suivant leur publication ; La consultation du Standards Advisory Council sur les projets principaux, lagenda des dcisions et les priorits de travail ; La publication des conclusions des standards comptables internationaux et dun trait dexposition ; Le dveloppement de la coordination avec les normalisateurs nationaux.
12
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
I-3 LA COMMUNICATION AUTOUR DE PASSAGE AUX NORMES IFRS3
I-3-2 CONTRAINTES RESPECTER POUR QUE LINFORMATION SOIT PERTINENTE ET FIABLE Les caractristiques qualitatives sont les attributs qui rendent utile pour les utilisateurs linformation fournie dans les tats financiers. Les quatre principales caractristiques qualitatives sont lintelligibilit, la pertinence, la fiabilit et la comparabilit.
INTELLIGIBILITE : Une qualit essentielle de linformation fournie dans les tats
financiers est dtre comprhensible immdiatement par les utilisateurs. A cette fin, les utilisateurs sont supposs avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activits conomiques et de la comptabilit et une volont dtudier linformation dune faon raisonnablement diligente. Cependant, linformation relative des sujets complexes, qui doit tre incluse dans les tats financiers du fait de sa pertinence par rapport aux besoins de prises de dcisions conomiques des utilisateurs, ne doit pas tre exclue au seul motif quelle serait trop difficile comprendre pour certains utilisateurs.
PERTINENCE : Pour tre utile, linformation doit tre pertinente pour les besoins de
prises de dcisions des utilisateurs. Linformation possde la qualit de pertinence lorsquelle influence les dcisions conomiques des utilisateurs en les aidant valuer des vnements passs, prsents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs valuations passes. Les rles de prvision et de confirmation de linformation sont interdpendants. Par exemple, linformation sur la structure et le niveau actuels des actifs dtenus a une valeur pour les utilisateurs lorsquils cherchent prvoir la capacit de lentreprise profiter des opportunits et sa capacit ragir des situations dfavorables. La mme information joue un rle de confirmation des prvisions passes, par exemple sur la structure de lentreprise ou sur le rsultat dactivits prvues. Linformation sur la situation financire et la performance passe est frquemment utilise comme base de prvision de la situation financire et de la performance futures, ainsi que dans dautres domaines dun intrt direct pour les utilisateurs, tels que les paiements de salaires et de dividendes, les variations des prix des titres et la capacit de lentreprise faire face ses engagements leur chance. Pour avoir une valeur prdictive, linformation na pas besoin de prendre la forme dune prvision explicite. La capacit prvoir partir des tats financiers est cependant amliore par la faon dont linformation sur les transactions et les vnements passs est prsents. Par exemple, la valeur prdictive du compte de rsultat est amliore si les lments inhabituels, anormaux et peu frquents, tant en matire de produits que de charges, sont fournis sparment. Importance relative La pertinence de linformation est influence par sa nature et son importance relative. Dans certains cas, la nature de linformation est suffisante elle seule pour la rendre pertinente. Par exemple, le fait de prsenter un nouveau secteur peut affecter lapprciation des risques et des opportunits auxquels est confronte lentreprise, quelle que soit limportance relative des rsultats raliss par le nouveau secteur au cours de lexercice. Dans dautres cas, cest la fois la nature et limportance relative qui sont importante, par exemple,
Enqute sur le passage des norms IFRS Mazars
13
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
le montant des stocks dtenus dans chacune des principales catgories qui sont appropries lactivit. Linformation est significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les dcisions conomiques que les utilisateurs prennent sur la base des tats financiers. Limportance relative dpend de la taille de llment ou de lerreur, juge dans les circonstances particulires de son omission ou de son inexactitude. En consquence, limportance relative fournit un seuil ou un critre de sparation plus quune caractristique qualitative principale que linformation doit possder pour tre utile.
FIABILITE : Pour tre utile, linformation doit galement tre fiable. Linformation
possde la qualit de fiabilit quant elle est exempte derreur et de biais significatifs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour prsenter une image fidle de ce quelle est cense prsenter ou ce quon pourrait sattendre raisonnablement la voir prsenter. Linformation peut tre pertinente, mais si peu fiable par nature ou dans sa reprsentation que sa comptabilisation pourrait tre potentiellement trompeuse. Par exemple, si la validit et le montant dune demande dindemnits en vertu dune action en justice sont contests, il nest pas appropri pour lentreprise de comptabiliser le montant total de cette demande au bilan, bien quil puisse tre appropri dindiquer le montant et les circonstances de la demande. Image fidle Pour tre fiable, linformation doit prsenter une image fidle des transactions et autres vnements quelle vise prsenter ou dont on sentend raisonnablement ce quelle les prsente. Ainsi, par exemple, un bilan doit prsenter une image fidle des transactions et autres vnements qui gnrent des actifs, des passifs et des capitaux propres pour lentreprise la date de clture et qui satisfont aux critres de comptabilisation. Dans la plupart des cas, lessentiel de linformation financire prsente un certain risque dtre une prsentation moins fidle que ce quelle vise prsenter. Ceci nest pas d un parti pris mais plutt aux difficults inhrentes soit lidentification des transactions et autres vnements valuer, soit la conception et lapplication des techniques dvaluation et de prsentation qui peuvent traduire ces transactions et ces vnements. Dans certains cas, lvaluation des effets financiers des lments pourrait tre si incertaine que les entreprises, de faon gnrale, ne les comptabilisent pas dans les tats financiers. Par exemple, bien que la plupart des entreprises gnrent, de faon interne, un goodwill au cours du temps, il est habituellement difficile didentifier ou dvaluer de faon fiable ce goodwill. Dans dautres cas, cependant, il peut tre pertinent de comptabiliser des lments et dindiquer le risque derreur relatif leur comptabilisation et leur valuation. Prminence de la substance sur la forme Si linformation doit prsenter une image fidle des transactions et autres vnements quelle vise prsenter, il est ncessaire quils soient comptabiliss et prsents conformment leur substance et leur ralit conomique et non pas seulement selon leur forme juridique. La substance des transactions et autres vnements nest pas toujours cohrente avec ce qui ressort du montage juridique apparent. Par exemple, une entreprise peut cder un actif un tiers, de telle faon que les actes visent confrer la proprit juridique ce tiers. Nanmoins, des accords peuvent exister, qui font en sorte que lentreprise continue bnficier des avantages conomiques futurs reprsentatifs de cet actif. Dans de telles circonstances, la comptabilisation dune vente ne donnerait pas une image fidle de la transaction qui a t conclue (si tant est quil y ait eu, en fait, une transaction). Neutralit 14
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Pour tre fiable, linformation contenue dans les tats financiers doit tre neutre, cest dire sans parti pris. Les tats financiers ne sont pas neutres si, par la slection ou la prsentation de linformation, ils influencent les prises de dcisions ou le jugement afin dobtenir un rsultat ou une issue prdtermin. Prudence Les prparateurs dtats financiers, cependant, sont confronts avec les incertitudes qui, de faon invitable, entourent un grand nombre dvnements et de circonstances, tels que la recouvrabilit des crances douteuses, la dure dutilit probable des immobilisations corporelles et le nombre de demandes en garantie qui peuvent survenir. De telles incertitudes sont reconnues travers une information sur leur nature et tendue et par lexercice de la prudence dans la prparation des tats financiers. La prudence est la prise en compte dun certain degr de prcaution dans lexercice des jugements ncessaires pour prparer les estimations dans des conditions dincertitude. Pour faire en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas survalus et que les passifs ou les charges ne soient pas sous-valus. Cependant lexercice de la prudence ne permet pas, par exemple, le cration de rserves occultes ou de provisions excessives, la sous-valuation dlibre des actifs ou des produits, ou la survaluation dlibre des passifs ou charges, parce que les tats financiers ne seraient pas neutres, et, en consquence, ne possderaient pas la qualit de fiabilit. Exhaustivit Pour tre fiable, linformation contenue dans les tats financiers doit tre exhaustive, autant que le permettent le souci de limportance relative et celui du cot. Une omission peut rendre linformation fausse ou trompeuse et, en consquence, non fiable et insuffisamment pertinente.
COMPARABILITE : Les utilisateurs doivent tre en mesure de comparer les tats
financiers dune entreprise dans le temps afin didentifier les tendances de sa situation financire et de sa performance. Les utilisateurs doivent galement tre en mesure de comparer les tats financiers dentreprises diffrentes afin dvaluer, de faon relative, leurs situations financires, leurs performances et les variations de leurs situations financires. En consquence, lvaluation et la prsentation de leffet financier de transactions et dvnements semblables doivent tre effectues de faon cohrente et permanente pour une mme entreprise et de faon cohrente pour diffrentes entreprises. Une des implications importantes de la caractristique qualitative de comparabilit est que les utilisateurs soient informs des mthodes comptables utilises dans la prparation des tats financiers et de tout changement apport ces mthodes ainsi que des effets de ces changements. Les utilisateurs doivent tre en mesure didentifier les diffrences entre les mthodes comptables pour des transactions et autres vnements semblables, utilises par la mme entreprise dun exercice lautre et utilises par diffrentes entreprises. La conformit avec les normes comptables internationales, y compris lindication des mthodes comptables utilises par lentreprise, aide atteindre cette comparabilit. Le besoin de comparabilit ne doit pas tre confondu avec luniformit pure et ne doit pas constituer un obstacle lintroduction de dispositions normatives comptables amliores. Il nest pas appropri pour une entreprise de continuer comptabiliser de la mme faon une transaction ou un autre vnement si la mthode adopte ne permet pas de respecter les caractristiques qualitatives de pertinence et de fiabilit. De mme, il est inappropri pour une entreprise de maintenir inchanges ses mthodes comptables lorsquil existe dautres mthodes plus pertinentes et plus fiables. 15
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Parce que les utilisateurs souhaitent comparer la situation financire, la performance et la variation de la situation financire dune entreprise au cours du temps, il est important que les tats financiers donnent linformation correspondante des exercices prcdents. CONTRAINTES RESPECTER POUR QUE LINFORMATION SOIT PERTINENTE ET FIABLE
CELERITE : Linformation peut perdre sa pertinence si elle est fournie avec un retard
indu. La direction peut avoir trouver un quilibre entre les mrites relatifs dune information prompte et ceux dune information fiable. Pour fournir une information bonne date, il peut souvent tre ncessaire de la prsenter avant que ne soient connus tous les aspects dune transaction, ce qui nuit la fiabilit. Inversement, si lon retarde la prsentation de linformation jusqu ce que tous les aspects soient connus, linformation peut tre fiable, mais de peu dutilit pour les utilisateurs qui ont eu des dcisions prendre entre temps. Pour atteindre lquilibre entre pertinence et fiabilit, la considration dominante doit tre de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs en matire de prise dcisions conomiques.
RAPPORT COT/ AVANTAGE : Le rapport cot / avantage est une contrainte
gnrale plutt quune caractristique qualitative. Les avantages obtenus de linformation doivent tre suprieurs au cot quil fallu consentir pour la produire. Lvaluation des avantages et des cots est cependant un processus qui est affaire de jugement. En outre, les cots ne psent pas ncessairement sur les utilisateurs qui profitent des avantages. Les avantages peuvent galement profiter des utilisateurs autres que ceux pour qui linformation est prpare ; par exemple, la fourniture dune information supplmentaire aux prteurs peut rduire les cots des emprunts dune entreprise. Pour ces raisons, il est difficile dappliquer un test cot/ avantage dans un cas particulier. Nanmoins, les normalisateurs, en particulier, ainsi que les prparateurs et les utilisateurs dtats financiers, doivent garder lesprit cette contrainte.
EQUILIBRE ENTRE LES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES
En pratique, la recherche dun quilibre ou un arbitrage entre les caractristiques qualitatives est souvent ncessaire. Gnralement le but poursuivi est datteindre un quilibre appropri entre les caractristiques afin de satisfaire aux objectifs des tats financiers. Limportance relative des caractristiques dans les divers cas est une affaire de jugement professionnel. IMAGE FIDELE/ PRESENTATION FIDELE Les tats financiers sont frquemment dcrits comme donnant une image fidle ou une prsentation fidle de la situation financire, de la performance et des variations de la situation financire dune entreprise. Bien que le prsent cadre ne traite pas directement de ces concepts, lapplication des principales caractristiques qualitatives et des dispositions normatives comptables appropries a normalement pour effet que les tats financiers donnent ce qui gnralement sentend par image fidle ou prsentation fidle de cette information. I-3-3 LECTURE DE LINFORMATION FINANCIERE PAR LES PARTIE PRENETES
I-3-3-1 Les parties prenantes de linformation financire
Lentreprise interfre avec de nombreux acteurs, partie prenante de la manire dont elle gre la difficile quation entre lhomme et son environnement socital et cologique. 16
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
On distingue les parties prenantes internes dites primaires c'est--dire celles qui ont une relation contractuelle avec lentreprise. Les parties prenantes internes comprennent des acteurs traditionnellement reconnus appartenant au primtre direct de lentreprise (les actionnaires, les clients, le personnel) et peuvent galement englober des acteurs appartenant au primtre priphrique de lentreprise (associations professionnelles, corps professionnels) Dautres conceptions se font jour officiellement et largissent le primtre aux parties prenantes externes dites secondaires , celles qui nont pas de relations contractuelles formalises avec lentreprise, mais qui subissent (ou sont susceptibles de subir) ses activits ou dinfluer sensiblement le cours de ses activits. Cette partie prenante, trs htrogne, aux acteurs multiples, et moins familire pour lentreprise, fait irruption sur la scne internationale et sur le march : la socit civile .
Parties prenantes traditionnelles Actionnaires Clients Administrateurs Fournisseurs Employs Sous-traitants Partenaires daffaires et alliances Concurrents etc. Parties prenantes priphriques Associations industrielles Corps professionnels Associations de consommateurs Gouvernements etc. Nouvelle partie prenante : la socit civile Opinion publique ONG Riverains Socits locales Groupes de pression et dinfluence Fonds commun de pension, fonds de retraite, fonds dpargne Communauts locales et internationales.
Le primtre de lentreprise volue et varie, bien sr selon les produits, les marchs, les pays, les contextes gopolitiques ou culturels, les vnements locaux ou mondiaux, mais surtout en fonction des intrts patrimoniaux des parties prenantes. En fait, lon peut considrer que les parties prenantes sont actionnaires de la responsabilit de lentreprise, cest dire de son engagement dans un dveloppement durable. Cette analogie se retrouve dans lhomonymie anglo-saxonne, apparue aux Etats-Unis au dbut des annes soixante : stakeholders, porteurs denjeux , par opposition shareholders, porteurs de parts ou actionnaires financiers . La consquence pour lentreprise est quil existe une interdpendance troite entre elle et lensemble de ses parties prenantes. Cette interdpendance largit celle concernant les shareholders, qui portent les enjeux de proprit financire, et vis--vis desquels lentreprise porte la responsabilit de dvelopper le profit financier.
17
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
II. ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LES NORMES IFRS / NORMES MAROCAINES
II.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les normes IAS/IFRS - Amortissement de certaines immobilisations ; - Rvaluation possible ; - Mode damortissement liniaire. Les normes marocaines - Amortissement obligatoire des immobilisations incorporelles ; - Rvaluation possible ; - Mode damortissement liniaire. - Comptabilis en tant quactif ; - Mode damortissement liniaire ; - Dure maximum 20 ans (dure dutilit de limmobilisation concerne) A noter : le PCG prvoit que lcart dacquisition soit amorti, sans exception, selon un plan damortissement dont la dure doit reflter les hypothses retenues et les objectifs fixs lors de lacquisition. - Les frais taler ou les frais dtablissement sont comptabiliss lactif et amortis sur une dure maximum de 5 ans. - Les frais de recherches fondamentales doivent tre comptabilises en charge ; -Les frais de recherche applique peuvent tre comptabilise en immobilisation ; -Les frais de dveloppement peuvent tre immobilises sous certaines conditions ; - Amortissement sur maximum de 5 ans. A noter : la rgle gnrale est la constatation en charge. Cependant, pour les frais de recherche applique et dveloppement, lactivation est possible si : - Les projets sont individualiss - Dimportantes chances de russites techniques ; - La rentabilit commerciale est dmontre.
a- le goodwill ou cart dacquisition.
- Comptabilis en tant quactif ; - Amortissement non autoris suite la rvision de IAS 38. A noter : le goodwill nest plus amortissable depuis la rvision de IAS 38.
b- les frais dtablissement et frais taler. c- les frais de recherches et de dveloppement.
- IAS 38 interdit la comptabilisation parmi lactif des frais taler ou des frais dtablissement. - Les frais de recherches fondamentales doivent tre comptabilises en charge ; -Les frais de recherches appliques doivent tre comptabilise en charge ; -Les frais de dveloppement peuvent tre immobilises sous certaines conditions ; - Amortissement sur la dure prvisionnelle dutilisation. A noter : IAS 38 prvoit lactivation des frais de dveloppement lorsque les critres suivants sont vrifis : - Probabilit de gnrer des bnfices ; - Produit clairement identifi ; - Possibilit de fabrication dmontre ; - Intention de vendre le produit ; -Existence dun march potentiel ; - Ressources suffisantes.
18
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
II.2 LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les normes IAS/IFRS LES - La rvaluation des IMMOBILISATIONS immobilisations corporelles est CORPORELLES permise non taxe et pratique. - Les normes internationales recommandent deffectuer rgulirement les rvaluations de manire ce que la valeur comptable nette de limmobilisation soit proche de sa juste valeur. a.les amortissements - la dure damortissement est la des immobilisations dure de vie conomique prvue ; corporelles. - mode damortissement non prcis ; - dure fiscale non applicable. A noter : IFRS16 (immobilisations corporelles)prcise que lentreprise doit identifier et slectionner la mthode damortissement qui reflte le rythme selon lequel les avantages conomiques lis lactif sont consomms par lentreprise. Les normes marocaines - La rvaluation des immobilisations corporelles est permise, taxe et pratique rarement. - Les rgles fiscales jouent un rle pnalisant puisque les rvaluations sont soumises limpt. - La rvaluation est rarement pratique au Maroc. - la dure damortissement est la dure de vie conomique prvue ; - mode liniaire ou dgressif ; - dure fiscale frquemment choisie comme dure damortissement. A noter : Au Maroc, les mthodes comptables damortissement des immobilisations sont dpendantes de la rglementation fiscale en terme du dure retenue et de rythme damortissement ; .la dure de vie sur le plan fiscal et comptable est en gnral plus courte que la dure de vie relle des immobilisations.
II.3 APPROCHE PAR COMPOSANTES
APPROCHE PAR COMPOSANTES Les normes IAS/IFRS - Selon IAS 16, les composantes dune immobilisation complexe, ayant des dures de vie diffrentes que limmobilisation principale, doivent tre immobilises sparment et amorties selon leurs propres dures. Les normes marocaines - Au Maroc, lapproche dimmobilisation par composante nest pas aussi systmatique que dans les normes internationales.
19
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
II.4 LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Les normes IAS/IFRS LES - la classification retenue est la IMMOBILISATIONS suivante : FINANCIERES . les actifs financiers dtenus des (les points de fins de transaction, dont le but de divergence) la dtention est de dgager un bnfice des fluctuations du prix court terme ; . les placements dtenus jusqu leur chance, son gnralement les obligations ; . les prts et crances mis par lentreprise ; . les actifs disponibles la vente sont ceux qui ne rentrent en aucune des catgories prcdentes. Les normes marocaines - Le CGNC distingue au sein des immobilisations financires, les titres de participation et les autres titres immobiliss ; et dautres parts, les titres et valeurs de placement figurant lactif circulant ; - Cette classification en immobilisations et actifs circulant traduit la distinction qu opre le CGNC entre le long et le court terme, en se fondant sur une dure de dtention ou de recouvrement de plus ou moins 12mois.
II.5 LES STOCKS
Les normes IAS/IFRS LES STOCKS (les points de divergence) - lenregistrement des stocks se fait la date de transfert de lessentiel des risques et avantages et du contrle des avantages conomiques futurs; -Inclus tout le matriel utile la production et au stockage mme les cots de transport ; - En cas dactualisation des paiements diffrs, lcart est pris en rsultat financier. Les normes marocaines - lenregistrement des stocks en normes marocaines se fait la date de transfert de proprit; -La liste des cots incorporables aux cots fixes de production est plus restreinte ; - La prsentation des subventions en diminution des postes de lactif immobilis nest pas prvue.
Il ny a pas de divergence majeure entre le traitement des stocks selon les normes internationales et marocaines. Les principes comptables sont comparables, toutefois linformation fournir est plus complte en normes IAS/IFRS quen rgles marocaines. La norme IAS2 impose de fournir en annexe une information sur la valeur des stocks dprcies et comptabilises la valeur nette de ralisation. Les mthodes dvaluations des stocks admises sont les mmes selon les deux normes.
20
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
II.6 CONTRAT DE LOCATION
Les normes IAS/IFRS CONTRAT DE LOCATION (les points de divergence) Les normes marocaines - dans les comptes individuels, la comptabilisation ne distingue pas la nature des contrats de location ; - location financement - dans les comptes consolids, enregistrer en tant quactif ; il peut tre procd au - location exploitation enregistrer retraitement des contrats de en tant que charge location financement ; - les loyers dus raison du contrat constituent des charges dexploitations.
-Au Maroc, le crdit bail (leasing) est constat en charge, contrairement aux normes internationales, traitant celui-ci comme un lment dactif (immobilisation gnralement). - Dfinition et critres prcis pour un contrat de location financement selon les normes IAS/IFRS (IAS17).
II.7 LES SUBVENTIONS
Les normes IAS/IFRS LES SUBVENTIONS - La prsentation des subventions en diminution des postes de lactif immobilis est prvue ; - les subventions doivent tre comptabilises en produits, sur une base systmatique sur les exercices ncessaires pour les racheter aux cots lis quelles sont censes compenser. Les normes marocaines - La prsentation des subventions en diminution des postes de lactif immobilis est prvue ; - les subventions dinvestissement est constate systmatiquement dans un compte spcifique des capitaux propres pour le montant peru est amorti au mme rythme que limmobilisation correspondante par le crdit du compte de rsultat.
21
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
II.8 LE TRAITEMENT DES CREANCES
Les normes IAS/IFRS - la comptabilisation du CA est en fonction de la ralit de la transaction ; - la mthode du pourcentage davancement est obligatoire pour les prestations de service. En normes IAS/IFRS, le montant des produits des activits ordinaires doit tre valu la juste valeur de la contrepartie reue ou recevoir en tenant compte du montant de toute remise commerciale ou rabais pour quantit consenti par lentreprise. Toutefois, lorsque lentre de trsorerie ou quivalent de trsorerie est diffre,la juste valeur de la contrepartie peut tre infrieure au montant nominal de la trsorerie reue ou recevoir, dans ce cas le montant enregistr en vente actualise de la crance sur lacheteur. Les normes marocaines
- la comptabilisation du CA est en fonction de la forme juridique du contrat ; - la mthode du pourcentage davancement est une option. Selon les normes marocaines, les crances circulantes sont inscrites leur valeur nominale en principal, telle que celle-ci rsulte des conventions lgales ou contractuelles liant lentreprise ses dbiteurs. Les intrts financiers nettement identifiables en application des conventions tablies ne rentrent pas dans cette valeur nominale.
LE TRAITEMENT DES CREANCES
II.9 LES ECARTS DE CONVERSION
Les normes IAS/IFRS LES ECARTS DE CONVERSION (les points de divergence) - Conversion au taux de clture ; - Impact sur rsultat comptabilis. Selon les normes IAS/IFRS, les gains et pertes latents due aux variations des cours de monnaies trangres, sont comptabilises comme suit : . Evaluation en utilisant le cours de change la date de transaction ; . Evaluation en utilisant le cours de clture la date de clture pour les lments montaires et celui du jour de transaction pour les lments non montaires ; . Ecarts de change sont comptabilises dans le compte de rsultat. 22 Les normes marocaines - Conversion au taux de clture ; - Impact sur rsultat comptabilis uniquement pour des pertes de change latent. Au Maroc, les gains et les pertes de change latents sont comptabiliss au bilan dans les comptes dcart de conversion. Une provision pour risque de change est constate, en cas de perte latente. Le gain de latent nest pas intgr dans le rsultat comptable, mais il est pris en compte de la dtermination du rsultat fiscal.
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
II.10 LES PROVISIONS
LES PROVISIONS Les normes IAS/IFRS - Lactualisation des provisions est obligatoire ; - Il y a une prcision pour lestimation des flux futurs, lactualisation et les informations fournir ; - Les provisions pour grosses rparations ne sont pas permises par les normes internationales ; Selon la norme 37, une provision ne doit pas tre comptabilise que si les conditions ci-dessous sont respectes : - Un passif rsultant dvnements passs ; - Une obligation actuelle qui aboutira une sortie de ressources ; - La probabilit dvaluer de faon fiable le montant de lobligation. Ces conditions ne sont pas les mmes quau Maroc. En effet, les provisions pour grosses rparations, qui ne respectant pas la condition premire de IAS37, sont autorises par la rglementation comptable marocaine. Les normes marocaines
- Lactualisation des provisions nest pas obligatoire ; - Absence de disposition expresse concernant lvaluation des provisions. Elle est gnralement faite avec approximation ; - Les provisions pour grosses rparations est obligatoirement constitue si elle est destine couvrir des charges importantes qui ne prsentent pas un caractre annuel et ne peuvent tre assimiles des frais courants dentretien et de rparation. Au Maroc, cest surtout le principe de prudence, qui est la base de dotation de provision.
. Au Maroc, cest surtout le principe de prudence, qui est la base de dotation de provision. Les provisions pour rparations ne sont pas permises par les normes internationales. Lapproche par composante au niveau de la gestion des immobilisations permet de combler les impacts de cette non autorisation.
II.11 LES IMPOTS DIFFERES
LES IMPOTS DIFFERES Les normes IAS/IFRS - Comptabilisation dans les comptes sociaux ; - Comptabilisation dans les comptes consolids. Les normes IAS/IFRS - Non applicable dans les comptes sociaux ; - Comptabilisation dans les comptes consolids.
Au niveau des comptes consolids, il nexiste pas de diffrences majeures entre les rgles marocaines et les normes internationales en matire dimpts diffrs. 23
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Les impts diffrs ne sont comptabiliss au Maroc que dans les comptes consolids. Dans les comptes sociaux, seul est comptabilis limpt courant payer au titre de lexercice concern. Les normes IAS12 (impt sur le rsultat), prconise la comptabilisation des impts diffrs dans les comptes sociaux et dans les comptes consolids. Elle impose la comptabilisation de passif et actif dimpts diffrs bass sur des consquences fiscales futures des diffrences temporelles taxables.
II.12. LES AVANTAGES DU PERSONNEL
La comptabilisation de lensemble des avantages du personnel, obligatoire dans les normes IAS/IFRS ne fait pas lobjet dune normalisation comptable marocaine directe et prcise. Des provisions pour risques et charges peuvent tre comptabilises (engagement de retraite par exemple). Aussi, dans les normes internationales, les informations complmentaires relatives aux avantages du personnel et exiges sont trs dtailles par rapport ce qui est exig pour les provisions pour risques et charges au Maroc.
II.113. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE Les normes IAS/IFRS Selon les normes IAS/IFRS, les corrections derreurs fondamentales postrieures la date de clture et les changements de principes comptables sont comptabilises en ajustant les capitaux propres du bilan douverture. Les principes comptables dintangibilit du bilan douverture ne sont pas respects. Elles autorisent aussi la comptabilisation des ajustements en rsultat de lexercice avec une prsentation pro forma des exercices antrieures retraits en annexe. Les normes IAS/IFRS Au Maroc, les corrections derreurs, postrieurs la date de clture, sont comptabiliser en compte de rsultat.
24
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
LIMPACT DU PASSAGE AUX IFRS SUR LA QUALITE DE LINFORMATION FINANCIERE : OPPORTUNIETE ET COMPLEXITE
I- LES INCIDENCES DU CHANGEMENT DU REFERENTIEL II- LES IFRSVERS LA DEMOCRATISATION OU LAUTARCIE DE LINFORMATION FINANCIERE III- UNE VISION GLOBALE SUR LA REALITE ECONOMIQUE DE LENTREPRISE LORS DE LA REFORME COMPTABLE : RISQUES ET OPPORTUNITES
25
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
CHAPITRE II : LIMPACT DU PASSAGE AUX IFRS SUR LA
QUALITE DE LINFORMATION FINANCIERE : OPPORTUNIETE ET COMPLEXITE I- LES INCIDENCES DU CHANGEMENT DU REFERENTIEL
I-1 COMMENT LE PASSAGE AUX IFRS EST IL RESSENTI ?
1.1.1
Un changement coteux mais salvateur4
Parmi les avantages, il faut citer lobjectif originel de la norme qui est de favoriser la comparabilit des comptes au niveau europen. Aux yeux des investisseurs, ce point est fondamental. Les normes nouvelles vont entraner terme des rgles de calcul et de prsentation standardises. De la mme manire, elles vont homogniser le calcul dlments parfois complexes comme le contenu du chiffre daffaires ou le traitement du goodwill. Ladoption des normes IFRS permettra galement de sortir dun systme comptable ancien essentiellement marqu par lenregistrement des oprations au cot historique, et de mieux rendre compte de la ralit conomique. Si lapproche bilancielle semble lemporter, elle a des incidences en termes de lecture mais aussi en termes dlaboration des comptes. En thorie, les nouvelles normes doivent mettre fin aux pratiques de pilotage du rsultat par le biais des provisions. Cela ne sera pas sans influence sur lutilisation de certains ratios dans les secteurs de lassurance et de la banque. Au-del du contenu des normes et de leur aspect technique, il y a tout lieu de penser que les entreprises vont devoir sadapter, rflchir lvaluation de leurs actifs et trouver des solutions pour grer efficacement lapplication des nouvelles rgles. Il est dailleurs frquent que ce type de rflexion, de remise plat, conduise une amlioration des modes opratoires et des contrles. La mise en oeuvre des nouvelles rgles peut alors prsenter des opportunits de dpasser le strict cadre rglementaire et doptimiser le fonctionnement des entreprises. Ces travaux de remise plat, dvaluation et plus globalement de rflexion peuvent conduire les entreprises mettre en vidence une meilleure apprhension des risques, ce qui participera lamlioration de la perception de lentreprise par les investisseurs. Les entreprises concernes par le passage aux nouvelles normes IFRS ont dores et dj rflchi aux solutions qui soffrent elles pour appliquer les nouvelles normes. En thorie, tout est fait pour que la qualit et la lisibilit des comptes soient meilleures. Cependant, tout dpend de ltat desprit des entreprises concernes et des moyens quelles dgagent dans le domaine informatique, en formation et surtout en communication. Elles devront faire un effort de pdagogie marqu, principalement au moment du bilan douverture. Le premier point concerne le champ dapplication de la notion de juste valeur. Compte tenu du choix laiss aux entreprises quant la mthode de dtermination de la juste valeur, on peut craindre une plus grande difficult dans la comparaison des comptes dune entreprise
4
Crouzet P.et N. Vron (2002) : La mondialisation en partie double : la bataille des normes comptables.
26
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
lautre. Il est quasi-certain que lon voit merger des experts en valuation, sur lesquels il faudra sappuyer, sans avoir la possibilit pour les analystes de critiquer leurs mthodes ou leurs modles internes. Le recours des modles internes, sil est une source de divergences entre socits, va aussi favoriser lmergence dune zone de certification dans laquelle vont sengouffrer les cabinets de consultants. Ce point peut soulager les analystes qui nauront vraisemblablement pas le temps de fouiller lanalyse et auraient du, sinon, se contenter de contrles de cohrences sur les taux retenus par les modles. Cette remarque sera valable aussi pour les goodwills, dont lvaluation passera par la notion d impairment test pour laquelle les socits auront sans doute recours des experts internes. Cette nouvelle mthode dvaluation se substituera aux amortissements sur de trs longues priodes antrieurement pratiqus. En ce qui concerne la recherche/dveloppement, les nouvelles normes imposent que la recherche reste en charge et ne soit pas inscrite lactif. Le dveloppement tant, pour ce qui le concerne, intgr lactif du bilan. A ce sujet, deux difficults peuvent se faire jour : la classification des dpenses de recherche et dveloppement en charges ou en actifs risque de se heurter lincomprhension des oprationnels qui devront tre sensibiliss ce sujet. Dautre part il va tre difficile dvaluer ces nouveaux postes dactif. Comment dterminer la valeur actuelle des flux futurs ? Quelle sera la bonne mthode ? Tout repose aussi sur la manire dont les socits vont communiquer, dire quelles sont les normes qui vont les impacter. Il est fort probable que les marchs ragiront ngativement si des socits qui sont soumises au passage aux normes IFRS ne se dotent pas des moyens ncessaires la communication. Les socits vont devoir communiquer plus largement et rpondre aux questions des analystes sur les impacts, sur les cots. Alors que la place sera confronte un phnomne de rupture dans les bases disponibles, les analystes vont peut-tre, dans un premier temps, revenir des considrations moins financires que par le pass en examinant la qualit du management, la qualit de la stratgie, la mise en oeuvre du gouvernement dentreprise. Sur tous ces points, il est clair que lmetteur qui communiquera trs tt sur les impacts que ces nouvelles normes ont sur ses comptes aura un avantage. 1.1.2
Les dangers de la juste valeur 5
Le principe de juste valeur propose de dterminer la valeur des actifs par lestimation des flux de trsorerie anticips actualiss (valeur instantane). Dans le monde des marchs parfaits et complets, cette valeur est gale au prix de march des actifs. En effet, si la concurrence est pure et parfaite, la valeur de lactif est exactement gale ce quil cote (hypothse de profits nuls) et tous les actifs ont la mme rentabilit. En cas d'absence d'un march de rfrence, une modlisation doit permettre de construire la valeur actualise des flux engendrs par cet actif. LIASB propose, dans cette optique, de prendre la plus grande de ces deux valeurs comme talon pour la dprciation de la valeur d'un actif enregistr au cot amorti (IFRS 36). Or la mise en oeuvre des actifs fait apparatre des complmentarits ou synergies avec les comptences propres de lentreprise dans son ensemble. Ainsi, la rentabilit conomique des actifs diffre suivant la nature de lacqureur, ce qui est impossible dans la thorie des marchs parfaits. Un actif est dit spcifique pour une entreprise lorsque lutilisation de cet actif par cette entreprise engendre un rendement suprieur par rapport son utilisation par toute autre entit (Caballero et Hammour [1998] par exemple). Le prix de march de cet actif,
5
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/archive/2003/l_26120031013fr.html
27
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
cest--dire lestimation collective de sa valeur par les autres agents, sera diffrent de la valeur de cet actif pour lentreprise. La spcificit et l'asymtrie dinformation sont essentielles et invitables pour tout projet entrepreneurial. Elles sont en effet au fondement de l'avantage comptitif e des survaleurs (goodwill) qui sont la diffrence entre la valorisation d'ensemble des actifs dans lentreprise par rapport leur valeur de liquidation individuelle. On sait que les survaleurs estimes par le march boursier donnent souvent lieu des valorisations qui savrent fantaisistes, comme celles issues des transactions lors de la bulle internet. La gnralisation de la juste valeur rendra structurels les problmes que lon peroit dans la mesure de la survaleur : alors que le problme comptable de la survaleur ne se pose que lors de lachat de participations ou du contrle d'une socit, la logique de la juste valeur ltend l'valuation de tous les actifs chaque tablissement des comptes. Il sagit donc bien dune extension de la logique de valorisation financire. Les succs patents de cette dernire au moment de la bulle internet ou dans lanalyse de quelques socits dont la faillite nourrit lactualit financire, amnent questionner trs srieusement lintrt de ltendre dans les bilans mmes des entreprises sous peine de voir les bulles boursires se transformer en bulles comptables. La comptabilit cot historique possde une logique conomique, fonde sur une vision dynamique de lentreprise en tant quentit productive durable et indivisible. Elle interroge le processus qui amne les capitaux investis dans les ressources d'entreprise jusqu' la cration de valeur et les reprsente notamment sous forme d'actifs (matriels et immatriels). Elle vise ainsi valuer et reprsenter le revenu d'entreprise au fur et mesure qu'il est gnr par cette entit, spcialement grce aux rsultats de ses ventes. La valorisation des actifs faits rfrence donc ce processus conomique spcifique de l'entreprise, plutt qu'aux cours boursiers. l'vidence, pourquoi investir sans retour ? Toute dpense active devrait alors impliquer des rsultats. Cependant, est-ce effectivement le cas ? C'est prcisment pour cela que l'on rend priodiquement les comptes. Dans cet esprit, une mise en alerte s'impose pour les utilisateurs et les rdacteurs futurs, en particulier en matire de cohrence inter-temporelle et inter-entreprises, des frontires de l'entit prise en compte, et enfin de la valorisation prophtique des actifs, notamment financiers. Les futurs utilisateurs des bilans selon les IFRS devront d'abord faire attention la cohrence intertemporelle et de comparaison inter-entreprises, en raison des nombreuses options laisses par l'IASB, par exemple, en matire de valorisation des actifs, entre la notation au cot historique corrig pour la perte de dprciation (IFRS 36), et celle au prix courant de march (trs souvent substitue par l'estimation d'experts agrs).
28
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
I-2 REPERCUSSIONS ORGANISATIONNELLES
Lapplication des IFRS dans le monde
Carte mise disposition par FinHarmony, formation et conseil en IAS/IFRS
1-2-1 Rpercussions sur les socits cotes en bourse
Les impacts sur lorganisation interne des entreprises6 Prs de 57% des entreprises cotes estiment que le passage aux normes IAS/IFRS constitue une relle opportunit permettant damliorer leur organisation interne. Mais ce chiffre est relativiser suivant les secteurs dactivit, o la difficult de mise en uvre sera prdominante sur les instruments financiers pour les entreprises du secteur des Banques, Services Financiers, Energie et Assurance. Ceci est moins le cas pour dautres secteurs pour lesquels les diffrences entre leurs propres normes et les normes IAS/IFRS sont plus mineures et affecteront les tats financiers dans leur forme plus que dans lapprciation de leurs actifs. Ainsi, une organisation spcifique est mise en place dans la plupart des cas, en centralisant le projet de mise en place de ces normes au sige de lentreprise, et pour 2/3 des entreprises cotes europennes, la mise en place dune organisation spcifique sera gre par des experts extrieurs.
6
Etude baromtrique KPMG Cartesis normes IFRS 2005
29
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Ces experts extrieurs sont des spcialistes dans les domaines financier et comptable, et dans le dans les domaines de la formation ou dans le diagnostic des systmes dinformation. Cependant, de nombreux domaines tels que les procdures dorganisation interne, les conseils en communication et la mise en place dun programme spcifique de formation pour le personnel concern restent ngligs. Mais les entreprises nabordent pas les problmes dorganisation interne de la mme faon que les aspects purement financiers. En effet, mme si la plupart des directeurs financiers europens peroivent ce changement de rfrentiel comme une opportunit long terme, en France ou au RoyaumeUni, les normes IFRS sont perues comme gnratrices de charges supplmentaires. De plus, lIASB a fourni ses dernires normes IFRS rgissant lensemble des principes comptables finaliss le 31 mars 2004, ce qui a laiss peu de temps pour les entreprises de se prparer pour le 1er janvier 2005, do le retard annonc et inquitant de certaines entreprises cotes europennes 2 mois de lchance.
Des impacts anticips en raison de la volatibilit des rsultats
Cest au niveau des marchs financiers que les nouvelles normes auront le plus dimpacts : sur les instruments financiers, sur les fusions acquisitions, et sur la valorisation des actifs. En effet, lune des particularits des normes IAS/IFRS rside dans la comptabilisation la juste valeur, celle du march, et non plus un cot historique jug dconnect de la ralit. Mais, lintroduction de la juste valeur risque aussi dentraner une plus grande volatibilit de lvaluation des actifs, et la question est de savoir quel sera limpact sur un plan macroconomique des normes IFRS sur la comptitivit des entreprises et de leur croissance.
Un lobbying traduisant dune frilosit de certaines entreprises europennes
20% des entreprises mnent des oprations de lobbying auprs de lIASB, soit de manire directe soit par lintermdiaire dassociations professionnelles, en vue de modifier certaines normes qui ne semblent pas adaptes leur activit (surtout sur les secteurs des Banques et dAssurance). Ce lobbying se manifeste souvent en raison dune frilosit des entreprises concernant le caractre obligatoire de cette application, du retard que certaines dentre elles ont mettre en place ce nouveau rfrentiel, et des opportunits et habitudes locales. En effet, ce nouveau systme va initier de nouveaux rflexes financiers, comptables et stratgiques pour les entreprises. Les impacts dans la prise de dcision stratgique
Une lecture des comptes plus fiable et transparente
Les normes IAS/IFRS ont pour objectif prioritaire dapporter une meilleure perception de la sant financire des entreprises (transparence des comptes) et une meilleure comparabilit des comptes long terme. Ainsi, linformation financire sera plus fiable sur les marchs financiers. En effet, les normes font apparatre certains engagements hors bilan qui ne figurent pas habituellement pas dans les comptes sociaux et consolids : - elles prvoient de nouvelles rgles de provision et dapprciation dactifs, - elles permettront de connatre les performances des entreprises par zone gographique et par secteur dactivit pour la consolidation des rsultats par filiale. 30
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Cependant, les risques inhrent cette application rsident dans une augmentation de la manipulation des tats financiers, la complexit des normes et une trop grande diversit de profils dentreprises face une application de normes uniques.
Les normes IFRS, un pas vers un march financier europen unifi
Cette harmonisation va pouvoir crer une unit de langage comptable, et ainsi favoriser lmergence et la construction dun march financier europen. De plus, les normes IFRS convergent avec les normes amricaines US GAAP, dj utilises par des socits europennes, ce qui permet dintensifier le principe dharmonisation des marchs financiers sur la scne mondiale.
1-2-2 Rpercussions sur les socits non cotes en bourse
Les impacts sur lorganisation interne des entreprises Malgr les inquitudes, la mise en place dun langage comptable europen unique sduit plus de la moiti des entreprises non cotes, et pour la plupart dentre elles, ladoption du nouveau rfrentiel est du leur appartenance un groupe cot ou leur implantation ltranger, par soucis dharmoniser les comptes. Pour elles, lapplication des normes IFRS nest pas encore obligatoire, et cela leur laisse le temps de pouvoir bien la prparer, en ayant lexemple des entreprises cotes qui devront tre aux normes pour le 1er janvier 2005. Cependant, cette prparation de rorganisation est trs coteuse pour ces entreprises aux moyens limits et donc le poids financier savre significatif. Contrairement aux socits cotes, les socits non cotes mettent davantage laccent sur leur rorganisation interne quant la modification des systmes dinformation et les formations internes et tout comme les socits cotes, elles font appel des spcialistes pour les entourer (techniques financires et comptables, diagnostics dinformation et formation des salaris). Les impacts financiers et stratgiques Face aux entreprises cotes, les entreprises non cotes se montrent moins positives quant aux amliorations que le nouveau rfrentiel est susceptible dapporter en matire dinformation financire, par une meilleure transparence et comparabilit des comptes. Cest pourquoi, la majorit des entreprises europennes non cotes se prparent dj en amont adopter ce nouveau rfrentiel malgr leurs proccupations concernant le cot et le temps dadaptation.
I-3 REPERCUSSION SUR LE SYSTEME FINANCIER
Dans le cadre de ces normes, on comptabilise diffremment un certain nombre doprations, sans pour autant modifier la comptabilisation lgale et fiscale du pays. Ce sont donc surtout les pratiques comptables qui vont changer (comptabilisation des oprations de fusion/acquisition, des subventions, des locations, des risques de change, des provisions), soit par des imputations sur dautres comptes, soit par des jeux dcritures diffrents. Il est aussi ncessaire de disposer, dans le systme informatique de lentreprise, dinformations complmentaires utiles (notamment pour ce qui concerne la sectorisation, mais aussi la comptabilisation des stocks).
31
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
La gestion des immobilisations est par ailleurs trs touche : elle ncessite un ddoublement de toutes les rgles damortissement (par exemple, biens amortissables en comptabilit fiscale et non amortissable en IAS, et vice versa). La comptabilit franaise est conue pour souligner laspect fiscal des tats financiers, permettant notamment dtablir limpt payer. Les IAS sadressent en priorit aux investisseurs et aux cranciers de lentreprise. Les changements induits dans la prsentation des comptes : Lintgration en bilan dune partie du Hors Bilan actuel, comme lintgration des produits drivs, La rduction des dlais de diffusion (trimestriels), Le niveau de dtail accru dans les annexes, avec, notamment, une ventilation par secteurs conomiques et gographiques.
Les changements induits dans lintroduction de la notion de la juste valeur (fair value) qui modifie la valorisation de lentreprise un instant donn : Evaluation la valeur du march Comptabilisation des gains et des pertes latents Nouvelle classification Comptabilisation spcifique des produits drivs optionnels, Nouvelles notions de couverture. Calcul de provisions Calcul de dprciation dactifs Le bilan Le compte de rsultat Le tableau de flux de trsorerie (facultatif) Lannexe tout autre document utile la comprhension des comptes .
Les changements induits dans les modes de comptabilisation des instruments financiers :
Les changements induits dans lintroduction de nouvelles rgles :
Dsormais, lensemble des tats financiers est constitu des lments suivants :
32
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
II- LES IFRS VERS LA DEMOCRATISATION OU LAUTARCIE DE LINFORMATION FINANCIERE
II-1 CREATIVITE COMPTABLE, DISTORSIONS ET MANIPULATION7
Avec le nouveau rfrentiel, le problme de linformation financire reste finalement le mme : sur quoi les entreprises vont-elles choisir de communiquer ? Elles auront probablement encore le droit dutiliser les indicateurs de leur choix, mme si elles doivent alors les dfinir avec prcision, garder les mmes dune anne sur lautre et publier de toute faon des donnes de base. Dautant que les normes internationales ne sont pas des rgles dtailles mais posent plutt des principes gnraux : il se peut alors que deux socits dun mme pays ou dun mme secteur choisissent des applications diffrentes. Nanmoins, remarquons que cette flexibilit ou souplesse dans les normes nest pas neutre : elle est entre autres destine faire passer plus en douceur les entreprises aux normes internationales. De plus, les options permettent dexprimenter plusieurs mthodes comptables et donc, en effectuant des comparaisons entre les diffrentes applications et leurs incidences, den retirer la meilleure ou la plus juste . Enfin, il est clairement prvu et prcis que les normes sont amenes voluer, notamment en diminuant petit petit toutes ces options. La flexibilit des normes nest alors peut-tre pas long terme un problme en matire de transparence. Serait-ce mme un atout comme ont tendance le croire les Anglo-saxons ?
2-2-1 Problmes engendrs par certaines normes
Tout dabord, avec les normes internationales, les entreprises vont ncessairement vers une plus grande volatilit des comptes lie par exemple lvaluation des instruments financiers et des immobilisations (corporelles comme incorporelles) leur juste valeur (IAS16 et IAS39). Comptabiliser les lments au prix instantan du march (au lieu du cot historique et des amortissements annuels) soumet les comptes la volatilit des marchs. Les variations de valeur de chaque poste rendront les bnfices plus volatiles, donc les capitaux propres galement, ce qui pourrait poser un problme aux actionnaires. Prenons un autre exemple de difficult : la juste valeur dune socit (ou de son actif immobilis) peut-elle toujours tre assimile sa valeur de march ? Il semble que non, tant que la marque nest pas comptabilise et ne figure pas dans les comptes de lentreprise. Il nest pas tonnant, dans ces conditions, que la question de la juste valeur provoque actuellement des ractions trs virulentes, notamment de la part des banques europennes qui vont ainsi voir leur risque normment augmenter. Ces ractions font ressortir une tendance naturelle des diffrents acteurs vers la scurit : les entreprises sont en effet peu disposes accepter la position incertaine dans laquelle les place la valorisation la juste valeur. Un deuxime cueil est que les normes internationales introduisent lide de futur dans la prsentation des comptes, notamment par lactualisation des flux et la prvision des volutions venir ; or, partir du moment o il sagit dlments prvisionnels, les chiffres ne
7
http://www.ecif.info/OptionFinance_Goodwills.pdf
33
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
sont plus lis des choses tangibles ou relles : chacun peut en quelque sorte prvoir ce qui larrange pour embellir ses comptes et l, on sloigne manifestement de lexigence de transparence ! Comment ds lors viter que cette valuation soit subjective ? Beaucoup dinstruments financiers ntant pas ngocis sur des marchs actifs ou liquides, il faut recourir des modles pour dterminer leur juste valeur ; mais ces modles prvisionnels sont source derreurs involontaires et volontaires, ce qui fait que la fiabilit et la validit de la mesure dpendront de la pertinence des paramtres choisis et de la sincrit des entreprises (puisque les modles pourront toujours tre manipuls leur avantage). Lvaluation redevient alors dnue de neutralit et plus le modle utilis sera complexe, plus la manipulation crative sera difficile dtecter. Enfin, lvaluation la juste valeur fait que les rsultats comptables seront plus affects par les lments externes (taux de change et dintrt) que par les dcisions de lquipe dirigeante. La traduction de la performance quelle donne sera donc trs loigne de la ralit de gestion de lentreprise. Faudrait-il, dans ce cas, tenir une double comptabilit base sur deux mthodes dvaluation diffrentes ? Mais est-il vraiment rigoureux davoir un reporting interne qui diffre du reporting externe ? Dautre part, certaines normes peuvent poser des problmes oprationnels : les groupes vont par exemple rencontrer des difficults importantes en matire de regroupement dentreprises. En effet, les nouvelles rgles supprimeront lamortissement systmatique des carts dacquisition et introduiront des tests de perte de valeur (selon lIAS 36, un actif a perdu de la valeur quand sa valeur comptable est suprieure sa valeur recouvrable, la valeur recouvrable tant dfinie comme la valeur la plus leve entre la valeur dutilit et le prix de vente net). Concrtement, les entreprises devront chaque anne recalculer la valeur de march des cibles quelles ont acquises pour sassurer que ces dernires ne se sont pas dprcies. Ce rapprochement la juste valeur impliquera pour les comptes la mise en place de mthodes de calcul et de suivi de la valeur : il devra tre intgr la possibilit dune volatilit plus grande de la valeur de certains actifs. Les circonstances dans lesquelles les entreprises seront conduites comptabiliser des pertes de valeur seront en outre beaucoup plus nombreuses quauparavant. En effet, aujourdhui, des pertes de valeur sont souvent dclenches et comptabilises dans le cadre de restructuration et/ou abandon dactivit ; demain, les analyses devront tre menes ds quun certain nombre dindicateurs (changements dans lenvironnement technologique, conomique ou juridique, variation des taux dintrt) laisseront penser que les actifs ont perdu de la valeur. Par ailleurs, les analyses ne pourront plus tre effectues au niveau global de lentreprise mais elles devront ltre au niveau des units gnratrices de trsorerie auxquelles tous les actifs, corporels et incorporels, devront tre rattachs. Lunit gnratrice de trsorerie (ou UGT) est le plus petit groupe identifiable dactifs dont lutilisation continue gnre des entres de trsorerie qui sont largement indpendantes des entres de trsorerie gnres par dautres actifs ou groupes dactifs. La mise en place de ces UGT permettant de suivre les valeurs des actifs implique la participation des oprationnels en plus de celle des services comptables et de la direction financire. Il sagit en particulier didentifier les UGT (le rle des hommes du plan et de la stratgie devrait tre ici primordial), de dterminer leur composition (par les contrleurs de gestion aids des oprationnels) et dvaluer les valeurs recouvrables par la mise en place du calcul des valeurs dutilit.
34
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
2-2-2 Quest ce quil est en est de linformation envers les autres parties prenantes ?
Pour finir cette section, il nous parat intressant et ncessaire de se poser une question sous-jacente au passage aux normes IFRS : quels sont les besoins des autres parties prenantes linformation financire ? Il va de soi quune pluralit dagents conomiques et sociaux est directement concerne par lentreprise, des actionnaires au personnel, en passant par lEtat, les banques, les clients et les fournisseurs ; sans parler de ceux qui le sont indirectement Ainsi, il existe une pluralit de parties prenantes (stakeholders) de linformation comptable qui nont pas toutes la mme vision ni la mme conception de la valeur dune entreprise. Dans ce contexte, la comptabilit donne voir lconomie dune certaine manire ; en effet, comme nous lavons vu un peu plus haut, les normes internationales offrent une vision dans laquelle les lecteurs privilgis sont les actionnaires. Ils ont essentiellement pour but de communiquer vers les marchs financiers; dautant que les scandales aux Etats-Unis comme ailleurs ont pour effet de renforcer cette information destine aux actionnaires, mais que faiton des autres parties prenantes tels que les salaris, les clients, les fournisseurs et les pouvoirs publics ? Les entreprises nont-elles pas aussi le devoir dadresser leur communication ces derniers ? Comment concilier linformation ncessaire aux actionnaires et aux investisseurs avec celle due aux autres acteurs ? Ces derniers vont-ils sy retrouver avec le nouveau rfrentiel comptable ? Va-t-on les y aider ? Ecartons ici le cas des banques car elles se prparent dj en amont au changement et tendraient mme plutt inciter les entreprises satteler aux nouvelles normes, notamment pour favoriser leurs services dingnierie financire proposs aux entreprises). Somme toute, lentreprise doit rendre des comptes toutes ces parties prenantes qui, parce quelles sont affectes par ses activits, ont un droit linformation sur celles-ci. Sur ce point, lvaluation la juste valeur rpond nettement aux attentes des investisseurs mais beaucoup moins bien celles des autres parties : en effet, lEtat, les clients ou les salaris ont un besoin dinformation stable, non remise en cause tout le temps, pour forger leur opinion. De plus, la juste valeur fait de la maximisation de la valeur actionnariale lun des objectifs uniques de lentreprise. Or, un pilotage de lentreprise fond uniquement sur la maximisation de la cration de valeur pour lactionnaire ne risque-t-il pas de freiner la croissance et de favoriser le court-terme au dtriment dune vision stratgique long terme, de linnovation et de nouveaux marchs ou produits ? Natteint-on pas les limites dune marchisation de la comptabilit ? Il convient sans doute dintgrer aux informations la juste valeur des donnes venant dune comptabilit de gestion et des ressources humaines par exemple (relatives une valeur ajoute sociale ). Mais la transparence passe peut-tre aussi par une amlioration notable du contenu des rapports, prcisant par exemple les engagements sociaux et environnementaux (cf. dveloppement durable). Car la cration de valeur socitale des firmes semble sintgrer compltement leur analyse en tant que facteur de solidit et de durabilit.
II-2- LES IFRS : LE NOUVEAU LANGAGE DU CAPITALISME
35
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
COMPTABLE8
Laffaire Enron commence le 16 octobre 2001 lorsque la firme de Houston annonce une perte de 618 millions de $ pour le 3 trimestre 2001 aprs constatation dune charge exceptionnelle de 1 Mds de $. Les marchs sont pris au dpourvu et le doute sinstalle : en 5 jours laction chute de 40%. La principale ruse pratique par Enron a consist exclure abusivement de son primtre de consolidation de nombreuses filiales cres de toute pice et dans lesquelles sont loges des dettes et des engagements quelles souhaitent occulter afin damliorer limage de sant financire donne par son bilan consolid. Enron a galement manipul la comptabilisation des contrats long terme de fourniture dnergie. Par ailleurs en utilisant les marges de manuvre offertes par les rgles de comptabilisation des oprations de ngoce (reconnaissance comme chiffre d affaires soit de lensemble des montants ngocis soit de la seule marge de ngoce) elle a artificiellement grossi son chiffre daffaires. Ce nest quun an aprs le dclenchement du scandale Enron que les normes comptables amricaines ont supprim cette marge dinterprtation. Il sagit en ralit dun dsastre collectif : lauditeur dEnron Arthur Andersen, les banques daffaires, les socits de conseil stratgique ont t mls de prs ou de loin aux manipulations dEnron...De nombreux comptables, analystes, juristes, rgulateurs et lgislateurs nont pas jou leur rle un degr ou un autre, pour assurer lexactitude des informations financires et le bon acheminement des donnes honntes et non manipules sur les marchs. Cette affaire, nest que la preuve que Lvolution de linformation financire nest en fait quun nouvel aspect de la transformation du capitalisme. En effet, Les auteurs estiment que la distinction classique entre capitalisme rhnan (avec ses banques omniprsentes) et capitalisme anglo-saxon (avec ses marchs financiers et son obsession du profit court terme) nest plus pertinente. La distinction propose par Raghuram Rajan et Luigi Zingales leur semble davantage convenir lpoque actuelle. Dun ct le Capitalisme relationnel dans lequel les relations entre individus, forges par exemple au gr dtudes communes ou de proximit sociales ou politiques, jouent un rle prpondrant dans lallocation des financements externes de lentreprise. De lautre ct le Capitalisme contractuel dans lequel les relations personnelles ne sont pas dterminantes et o les dcisions se prennent de manire anonyme . Selon cette grille danalyse les marchs des capitaux relvent du capitalisme contractuel alors que les financements par les banques commerciales, les fonds de lEtat sont plutt caractristiques du capitalisme relationnel . Dans un contexte denvironnement instable, cr par lapparition de nouvelles technologies, le capitalisme relationnel consacre beaucoup de ressources la sauvegarde dentreprises condamnes alors que le capitalisme contractuel favorise lapparition de nouvelles entreprises et de nouvelles fortunes. Lcosystme financier franais hrit des Trente glorieuses accorde une large place aux relations personnelles pour llaboration et la diffusion de linformation financire. Ainsi les normes comptables nationales sont en France teintes de considrations fiscales, statistiques et prudentielles exprimant la prminence de lEtat et des grandes banques par
8
Nicolas Veron ; L'Information financire en crise : Comptabilit et capitalisme; Editions Odile Jacob ; 2004
36
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
rapport aux autres utilisateurs et notamment aux actionnaires. Linformation financire accessible publiquement revt une importance relativement mineure, en comparaison avec un modle de capitalisme contractuel appuy principalement sur les marchs des capitaux. Ce systme semble toutefois en France tre appel un remise en cause car la priode actuelle se caractrise par des volutions profondes du paysage financier. En effet lacclration des changements de primtre des groupes due aux fusions et acquisitions (qui rend la lisibilit des comptes et lapprciation des performances plus difficiles), limpact du dveloppement des nouvelles technologies de la communication sur linformation financire et les innovations financires tous azimuts sont quelques uns de ces chocs dont leffet est une profonde mutation de lcosystme financier et qui appellent des mesures urgentes pour viter une drive du systme. Le systme financier( insistent les auteurs qui restent malgr tout optimistes) doit dvelopper des mcanismes de dfense par rapport aux principaux risques de drives et de fraudes ; en partie de nouvelles rglementations et en partie un contrle collectif plus contraignant sur les agissements des dirigeants
II-3-LA REGULATION FINANCIERE A LA CROISEE DES CHEMINS
La prsence dune autorit collective est indispensable au bon fonctionnement des marchs des capitaux. Cette rgulation est constitue par les institutions publiques, semipubliques ou prives. Des institutions pour les marchs... Les institutions de rgulations des marchs des capitaux sont nes des crises boursires lorsque les mcanismes spontans du march ou de lautorgulation par les acteurs eux mmes se sont rvls insuffisants pour empcher les drives des comportements et la dstabilisation du systme financier. Sans rgulation publique les entreprises pourraient publier des informations donnant une vision fausse de leur situation et de leur activit et les intermdiaires pourraient ne pas agir dans lintrt de leurs clients, comme cela a pu tre le cas pour les analystes par exemple. Un certain degr de rgulation publique est souvent ncessaire pour assurer la confiance des marchs. A linverse trop de rgulation peut freiner lesprit dentreprise, dcourager la prise de risque et brider lefficacit des mcanismes de march. Un quilibre dlicat est rechercher au cas par cas, selon les types de march considrs, selon les pays et les poques. Aux Etats-Unis, la SEC, organisme public, est loin dtre le seul acteur de la rgulation. Elle a dlgu une partie de ses pouvoirs des organismes de droit priv, comme le PCAOB pour le contrle des auditeurs ou le FASB pour les normes comptables USGAAP. Certains marchs de produits financiers drivs ne dpendent pas de la SEC mais dune autre agence fdrale, le Commodity Futures Trading Commission. Par ailleurs la surveillance prudentielle des entreprises de banques et dassurances est assure par un rseau complexe dautorits dont La Rserve Fdrale. En dehors de Etats-Unis, tous les pays dvelopps se sont progressivement dots dautorits de rgulation boursire avec dans chaque cas la mme double fonction que pour la SEC : une fonction de contrle de linformation dune part et de police de march dautre part. Toutefois le champ exact de ces missions varie dune situation lautre. Aux Etats-Unis la normalisation comptable est apparue comme un sous ensemble de la mission de la SEC. Ceci est li la priorit dont bnficient les investisseurs sur les autres utilisateurs de linformation financire dans le systme amricain. En France, la normalisation comptable est reste pour 37
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
lessentiel, jusqu ladoption des IAS, entre les mains du ministre des finances. Dans tous les pays, les tribunaux jouent aussi un rle de premier plan dans la rgulation des marchs. Enfin les gouvernements eux-mmes et les parlements ont des influences trs varies selon le contexte national. Aux multiples acteurs tatiques il faut aussi ajouter la commission europenne... Cette multiplicit des acteurs nest pas le seul lment qui donne sa spcificit la rgulation des marchs. Plus fondamentalement, celle-ci se situe la charnire entre le public et le priv. La participation active dintervenants issus du secteur priv demeure une caractristique gnrale de la rgulation des marchs de capitaux. Seuls les individus qui ont lexprience des marchs peuvent en dmonter les mcanismes et y identifier le cas chant les fraudes et les irrgularits.
III- UNE VISION GLOBALE SUR LA REALITE ECONOMIQUE DE LENTREPRISE LORS DE LA REFORME COMPTABLE : RISQUES ET OPPORTUNITES
Un changement de normes comptables ne peut pas tre vu comme un simple changement doutil, dont les effets conomiques seraient neutres sous prtexte que la ralit conomique retranscrite dans les chiffres est la mme. La comptabilit a un impact rel, bien que difficile mesurer, sur le fonctionnement de lconomie. Il en est ainsi parce quelle dtermine ncessairement la vision que se font de lentreprise les diffrents utilisateurs des comptes : dirigeants, actionnaires, Etat, cranciers, salaris, fournisseurs, clients..., et qu son tour, cette vision influence les comportements de ces acteurs vis--vis de lentreprise. Ceci explique la vigueur de certains dbats rcents, par exemple sur la comptabilisation des actifs financiers (IAS 32 et 39) ou sur lamortissement des carts dacquisition (goodwill). A cet gard, les entreprises ne peuvent que saluer lobjectif des IAS/IFRS de mieux reflter dans les comptes la ralit de la situation conomique sous-jacente. Sur le plan des principes, la notion de fair value , qui constitue le coeur du projet IAS, ne peut donc qutre approuve, puisquen soi, il parat conomiquement justifi de comptabiliser les actifs et les passifs leur juste valeur plutt qu leur cot historique. Lapplication de ce principe nest toutefois pas exempte de risque ds lors quon scarte dun monde conforme aux manuels de microconomie, dot de marchs complets et efficients. En effet, dans la ralit conomique, il nexiste pas de marchs doccasion pour lensemble des actifs dune entreprise. Ds lors, il devient ncessaire de procder des valuations fondes sur des modlisations, dans lesquelles une part darbitraire et dincertitude peut sintroduire puisque des hypothses de base lgrement diffrentes peuvent induire des carts importants. En outre, mme quand une valeur de march existe, par exemple sur les marchs financiers, elle peut conduire des donnes extrmement volatiles, susceptibles dexercer des effets de procyclicit dangereux pour lconomie. En pratique, limpact des normes IAS sur le rsultat comptable des entreprises parat aujourdhui trs difficile valuer, aucune tude dimpact scientifique na t ralise et rendue publique. Aujourdhui encore, alors que les entreprises cotes europennes sapprtent tablir leurs comptes consolids en IAS/IFRS, on ne dispose daucune vritable valuation chiffre des consquences du changement de rfrentiel. Plusieurs normes IAS/IFRS laissent toutefois anticiper une plus forte volatilit des bilans et des rsultats en IAS/IFRS quen normes marocains (outre la valorisation des actifs financiers et parfois des immobilisations leur juste valeur , on notera les conditions plus 38
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
svres pour la passation des provisions (IAS 37) ou la dfinition stricte de la notion dlment extraordinaire (IAS 8)). A cet gard, au-del des effets des IAS/IFRS sur les entreprises en gnral, une rflexion Certains chiffres publis dans la presse donne dailleurs une ide de la volatilit qui pourrait tre introduite par les IAS/IFRS. Si tel devait tre le cas, les nouvelles normes comptables nauraient-elles pas des consquences sur lhorizon de gestion des entreprises ? Les dirigeants pourraient tre incits tenir exagrment compte de limpact de court terme de leurs dcisions, au dtriment de la mobilisation sur les choix stratgiques de moyen ou long terme, seuls mme dtre durablement crateurs de valeur. De mme, la mesure comptable de la performance va probablement voluer avec lintroduction des nouvelles rgles. Or il nest pas dmontr que les IAS/IFRS constituent un outil de pilotage efficace pour les entreprises. Cette question ne se pose dailleurs avec dautant plus dacuit pour les PME, qui ne disposent pas ncessairement des moyens financiers ou humains doprer des retraitements pour laborer des outils de gestion financire internes. Approfondie mriterait galement dtre mene sur les diffrences dimpact selon la taille des entreprises. Dans cette perspective, deux premires remarques peuvent ici tre notes : a) Les entreprises cotes ont d engager des cots importants pour grer la complexit du passage aux IAS/IFRS, notamment sous la forme dinvestissements informatiques et de formations dispenses de nombreux niveaux (directions gnrale et financire, ressources humaines, services juridiques, services commerciaux, services du parc immobilier...). De mme, certaines procdures nouvelles ont d tre introduites (ou certaines procdures anciennes modifies) afin dalimenter le travail des services comptables par des informations oprationnelles (informations sur la dprciation des stocks, sur la valeur de revente dun actif sur le march, sur la dure dutilisation des composants dun investissement...). Or, structurellement plus petites, les entreprises non cotes ne disposent pas de la mme surface financire ni des mmes ressources internes pour piloter dans les meilleures conditions la gestion de cette complexit. En outre, contrairement aux investisseurs impliqus dans le capital des grandes entreprises, les diffrentes parties prenantes des PME ne semblent aujourdhui pas exprimer dattente forte lgard dune comptabilit en IAS. Autrement dit, au premier abord, le diffrentiel entre les avantages et les cots dun passage en IAS/IFRS parat particulirement plus faible pour les PME que pour les grandes entreprises. Il nest dailleurs pas interdit de penser quil est ngatif pour certaines. b) Lapplication du rfrentiel IAS aux socits cotes fait craindre certains analystes une volatilit des marchs financiers en raison de la volatilit potentielle des comptes valus en juste valeur. Si les entreprises non cotes chappent naturellement ce risque, elles pourraient nanmoins ntre pas exemptes de perturbations avec leur partenaire financier privilgi. La notation que les banques effectuent de chacun de leur client , notation dont limpact sur le financement va tre dautant plus important quelle devient un lment-cl de la rglementation prudentielle , dpend largement de certains ratios comptables (taux dendettement, ratio de fonds propres...), qui peuvent devenir plus volatiles en raison du passage aux IAS/IFRS.
39
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
MODELES CONCRET DE LIMPACT SUR LA QUALITE DE LINFORMATION FINANCIERE
I. CAS DE MAROC TELECOM II. CAS SCANIA MAROC
CHAPITRE III : MODELES CONCRET DE LIMPACT SUR LA QUALITE DE LI
40
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
I. CAS DE MAROC TELECOM9
I.1. CHANGEMENT DE REFERENTIEL COMPTABLE
LUnion europenne (UE) a choisi dadopter le rfrentiel comptable IFRS (International Financial Reporting Standards) mis par IASB (International Accounting Standard Board) ; en application du rglement europen n1606/2002 applicable aux socits cotes sur les Bourses de valeurs de lUnion europenne (UE) et conformment la norme IFRS 1 Premire adoption des normes IFRS en tant que rfrentiel comptable . Ainsi, ses entreprises doivent prsents ses comptes consolids, compter du 1er janvier 2005, tablis selon les normes comptables internationales (IFRS) en vigueur au 31 dcembre 2005. Cependant, au Maroc, le calendrier dapplication de ces nouvelles normes nest pas encore fix dune manire dtaille, mais la premire publication des comptes IFRS est fixe 2008. Lanne en cours(2007) sera donc une anne de transition et suppose louverture de plusieurs chantiers aussi bien au niveau comptable, organisationnel, ou en systme dinformation, pour les entreprises, notamment les tablissements de crdits et les entreprises financires, pour se conformer ces nouvelles normes internationales. En effet, les comptes consolids de Maroc Telecom ont t, compter du 1er janvier 2005, tablis selon les normes comptables internationales (IFRS) en vigueur au 31 dcembre 2005.Ainsi, suite lobligation de changement du rfrentiel comptable, Maroc Telecom a mis en uvre une mthodologie projet pour assurer le succ de ce changement du rfrentiel au cours du quatrime trimestre 2003.
I.2. LA TRANSITION IFRS : DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET
I.2.1 : Calendrier de transition aux normes IAS/IFRS
Sur la base des seules obligations figurant dans les normes IFRS et dans les textes lapplication par les socits europennes, ce nest en principe quen 2006 que les socits concernes doivent publier leurs comptes consolids de lanne 2005 conformes aux normes IFRS. Or, Les premiers comptes publis selon les normes IAS/IFRS sont ceux de lexercice 2005 prsents avec un comparatif au titre de lexercice 2004 tabli selon le mme rfrentiel, lexception des normes IAS 32/IAS 39 appliques compter du 1er janvier 2005. Les premiers comptes complets en rfrentiel IAS/IFRS de Maroc Telecom, conformes la norme IFRS 1 Premire adoption des IFRS , sont ceux publis au titre de lexercice 2005. Par ailleurs, les comptes semestriels 2005 sont prsents conformment la Recommandation CNC 99-01 mais avec application des rgles dvaluation IAS/IFRS. Aucune donne en normes comptables IFRS nest fournie pour lexercice 2003. La transition tant dfinitive, aucun compte pro forma en normes franaises ne sera tabli pour lexercice 2005 ni pour les suivants.
I.2.2. Planification du projet IAS/IFRS
9
Maroc Telecom est loprateur historique de tlcommunications au Maroc, leader sur lensemble de ses segments dactivits, Fixe, Mobile et Internet. Maroc Telecom est cot simultanment Casablanca et Paris depuis dcembre 2004 et ses actionnaires de rfrence sont le groupe Vivendi Universal (51%) et le Royaume du Maroc (34,1%).
41
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Afin de publier cette information comparative, Maroc Telecom a prpar un bilan douverture au 1er janvier 2004, date de transition aux normes IFRS, point de dpart pour appliquer ces normes et date laquelle les incidences lies la transition sont enregistres, principalement en capitaux propres. I.2.2.1 Organisation du projet de conversion Maroc Telecom a anticip lapplication des normes IFRS par des diagnostics et des analyses ralises en amont par la Direction de la consolidation Groupe. Ces travaux ont permis : De mettre en vidence les principales divergences entre les normes IFRS et les pratiques du groupe ; De procder lanalyse des options comptables ; Dapprcier les implications organisationnelles, fonctionnelles et informatiques lies la mise en place de ces nouvelles normes. Les rgles dvaluation et de consolidation ont-elles t adaptes? Les divergences principales ont-elles t identifies?
1) Le projet de conversion aux normes IFRS initi au cours du quatrime trimestre 2003 comprend principalement les phases suivantes : Une premire phase de lancement a permis de modliser la conduite du projet, dy affecter des ressources, et de sensibiliser et former les principaux acteurs ; Une seconde phase de diagnostic a permis didentifier les principales diffrences entre les mthodes comptables appliques par Maroc Telecom (normes comptables franaises) et les normes comptables internationales (IFRS) ; La troisime phase dvaluation des impacts de la conversion aux normes IFRS La dernire phase de mise en oeuvre des modifications induites par le changement de rfrentiel porte notamment sur la production dun bilan douverture au 1er janvier 2004 et la mise en place dune procdure pour la production rgulire de comptes IFRS en 2005, avec comparatifs 2004 . Suppression de lamortissement des carts dacquisition et mise en place de tests de dprciation selon les dispositions des IFRS 3, IAS 36 et 38; Diffrences des modalits de reconnaissance du chiffre daffaires et des cots dacquisition des clients notamment selon les dispositions des IAS 2 et 18; en particulier comptabilisation des subventions abonns en moins du chiffre daffaires ventes dquipements hauteur de la marge brute quelles dgagent, en charge de priode pour le solde; Rgles de prsentation et dvaluation des immobilisations corporelles et incorporelles et des stocks selon les dispositions des IAS 2, 16, 36 et 38; Reventilation du rsultat exceptionnel en rsultat oprationnel et financier; Classement bilanciel des actifs et passifs financiers, et leur valuation la juste valeur ou selon la mthode du cot amorti selon les cas.
2) Les principales divergences identifies ce jour peuvent se rsumer comme suit :
I.2.3. Retraitements lis la premire application du rfrentiel IAS/IFRS
42
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Conformment aux options offertes par la norme IFRS1 Premire application des normes dinformation financire internationales, le groupe a choisi pour son bilan douverture : De maintenir les cots historiques pour ses immobilisations corporelles et na donc procd aucune rvaluation ; De ne pas retraiter les oprations de regroupement antrieures au 1er janvier 2004 ; De procder la remise zro au 1er janvier 2004 des carts de conversion. Cependant, en date de transition aux normes IFRS, Maroc Telecom devrait faire le choix de ne pas faire dvaluation la juste valeur de ses immobilisations.
I.2.4. Impact du passage aux normes IAS/IFRS
Limpact du passage aux normes IAS/IFRS est relativement limit dans la mesure o Maroc Telecom applique dj des mthodes prfrentielles recommandes par le Conseil National de la Comptabilit et conformes aux normes IAS. Les principaux impacts lis lapplication du nouveau rfrentiel, indpendamment des nouveaux formats de prsentation des tats financiers, concernent donc : Les modalits de reconnaissance du chiffre daffaires ; Le non-amortissement des carts dacquisition compter du 1er janvier 2004 ; Lanalyse de la norme IAS 16 relative aux immobilisations corporelles.
I.2.5. Aspects problmatiques lis la conversion IAS/IFRS
Certaines normes et interprtations importantes, qui ont en vigueur au 31 dcembre 2005, ont t publies dans leur version dfinitive par lIASB plus tardivement quinitialement prvu (lIASB stait initialement engag publier les derniers textes applicables en 2005 au plus tard le 31 mars 2004), voire ne sont pas publies lors de la conversion. Compte tenu de lmission rcente de certaines normes et interprtations IFRS, de leur faible mise en pratique et dun nombre limit dinterprtations, certaines transactions sont en cours danalyse lors de transition. Les impacts dus au passage aux normes IFRS ne sont donc pas exhaustifs et dautres impacts, en cours danalyse, pourront tre probablement induits par le nouveau rfrentiel.
I.2.6. Cot de la conversion IAS/IFRS
Le passage aux normes IFRS a un impact limit sur les comptes du groupe Maroc Telecom au 31 dcembre 2004 : -514 millions de dirhams sur le chiffre daffaires, li essentiellement la prise en compte des subventions des terminaux en rduction du chiffre daffaires, sans impact sur le rsultat dexploitation ; -71 millions de dirhams sur le rsultat dexploitation essentiellement li lapplication de la norme IAS 16 sur les immobilisations corporelles ; +72 millions de dirhams sur les capitaux propres principalement li au retraitement des primes de fidlisation.
I.3. MODIFICATION APPORTEES A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS LORS DE LADOPTION DU NOUVEAU REFERENTIEL
43
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
I.3.1. Description des retraitements IFRS
I.3.1.1. Prsentation des tats financiers Compte de rsultat : Compte tenu de la pratique et de la nature de lactivit, la prsentation du compte de rsultat par nature de produits et de charges a t maintenue. La principale modification affectant le compte de rsultat est lidentification du Cot de lendettement financier net. Bilan : Les principales modifications concernent : La ventilation des actifs et des passifs en courants et non courants ; La prise en compte des intrt minoritaires dans les capitaux propres ; Le reclassement des impts diffrs. Tableau des flux de trsorerie : Aucune modification due au changement de rfrentiel ntant apporte la trsorerie nette, les seules diffrences par rapport la prsentation antrieure consistent en des reclassements et indications plus dtailles tel que le classement du cot de lendettement dans le flux de trsorerie li aux oprations de financement.
I.4. PRESENTATION DES IMPACTS APPORTEES LAPPLICATION DU REFERENTIEL IAS/IFRS
I.4.1. Actifs incorporels
PAR
Les normes applicables sont IAS 38 Immobilisations incorporelles, IFRS 3 Regroupements dentreprises et IAS 36 Dprciations dactifs. carts dacquisition : Aucun retraitement des oprations de regroupement antrieures au 1er janvier 2004 na t pratiqu. IAS 36 rvise supprime lamortissement des carts dacquisition mais impose dsormais de pratiquer un test de dprciation annuel (et lors de toute ventuelle perte de valeur) pour les actifs incorporels ayant une dure de vie indtermine et pour les goodwills issus dun regroupement dentreprises. Limpact sur le rsultat 2004 li au retraitement de la dotation aux amortissements des carts dacquisition est de 7 Millions de dirhams. En application de lIAS 28, les carts dacquisition relatifs des socits mises en quivalence sont comptabiliss en titres mis en quivalence et non plus dans le poste cart dacquisition. Ce reclassement a une incidence sur le bilan douverture de 6 millions de dirhams. Cartes SIM : Les cartes SIM sont inscrites en immobilisations incorporelles en cours lors de leur acquisition et sont reclasses en immobilisations dfinitives amortissables sur 2 ans lors de leur activation. Les cartes SIM remplissent les conditions de lIAS 38 rvise pour tre considres comme des immobilisations incorporelles : Les cartes SIM sont ncessaires la mise en place dun abonnement qui gnre des avantages conomiques futurs; Le cot des cartes SIM peut tre mesur de manire fiable ; Les cartes SIM sont sparables, dans la mesure o les abonnements peuvent tre cds, concds et changs conjointement avec le contrat dabonnement ; 44
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Les cartes SIM sont la proprit de loprateur durant la priode minimum contractuelle ou labonn est li au rseau auquel il a souscrit. Loprateur dtient donc le contrle des avantages conomiques sur la priode contractuelle de labonnement ; La carte SIM est ncessaire pour activer labonnement, dont des avantages conomiques futurs sont attendus.
I.4.2. Immobilisations corporelles
Elles continuent de figurer au bilan pour leur cot historique dacquisition. Elles ne font lobjet daucune rvaluation. Dures damortissement : Lapplication de la norme IAS 16 Immobilisations corporelles a conduit aux changements de certaines dures damortissement en utilisant la mthode prospective et lapplication de lapproche par composants en raison de la nature des actifs corporels des tlcommunications. Lamortissement est calcul de manire linaire sur la dure dutilit de lactif. Pices de rechange Les pices de rechange sont juges utilisables sur plus dun exercice et ddies aux matriels les concernant. Par consquent, elles doivent, selon lIAS 16, tre comptabilises avec leurs quipements respectifs ; Les pices de rechange acquises dans le cadre dun march dacquisition dquipement suivent les mmes rgles de mise en service et damortissement que les quipements auxquels elles sont lies; Les pices de rechange acquises dans le cadre dun march spcifique sont mises en service immdiatement et amorties sur la dure de vie rsiduelle des quipements lis ou sur leur dure damortissement initiale si cette information nest pas disponible.
I.4.3 Passifs financiers (dette taux zro)
Maroc Telecom na pas jug utile de procder lactualisation des dettes taux 0 dans la mesure o des ngociations relatives au remboursement de cette dette qui est intervenu dbut aot 2005, avaient t inities de longue date.
I.4.4. Reconnaissance du chiffre daffaires
Chiffre daffaires des postes Le produit sur vente des postes doit tre enregistr au moment de lactivation des abonns sur le rseau. Retraitement des subventions Comptabilisation du chiffre daffaires net des subventions. Ce retraitement na pas dimpact sur le rsultat dexploitation, ces subventions tant initialement inscrites en produits et en charges. Retraitement des services vocaux Les ventes de services aux abonns par le groupe Maroc Telecom pour le compte de fournisseurs de contenu impactent le chiffre daffaires qui est prsent net du montant revers ces fournisseurs. Programme de fidlisation Dans lattente dune interprtation de lIFRIC, Maroc Telecom ne provisionne les primes de fidlisation accordes ses clients pour le renouvellement de terminaux qu hauteur de la 45
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
sortie complmentaire de ressource par rapport lavantage accord aux nouveaux clients lors de la souscription initiale. Les points de fidlisation convertibles en services gratuits sont eux provisionns.
I.4.5. Information sectorielle
Linformation sectorielle est organise par secteur dactivit fixe & mobile et par zone gographique.
II. CAS SCANIA MAROC
II-1 BREVE PRESENTATION DE SCANIA MAROC
Scania Maroc, filiale de Scania Sude 99 %, a t cr en 1994. Son activit se rsume limportation et la commercialisation des vhicules et pices de rechanges de marque Scania. Depuis 1998, la socit est devenue lun des leaders du march avec 25% de part de march. La politique de pntration sest traduite par des pertes trs importantes dues aux prix pratiqus et linvestissement dans lexpansion du rseau de distribution. Historiquement, le march des camions a t essentiellement marqu par la domination de Volvo suivie de Berliet et de Mitsubishi pour le petit tonnage, dont les produits ont t limits une seule gamme (4x2). Scania a initi de grands changements au niveau de ce march. Scania a innov au niveau de la varit de sa gamme et a prsent pour la premire fois le modle 8x4. Le manque des infrastructures au Maroc a t aggrav par les mesures draconiennes imposes par la banque mondiale et le Fonds montaire international dans le dbut des annes 80 qui visaient rduire les dpenses publiques. Il tait ncessaire d'attendre que le Maroc dcide d'ouvrir entirement son conomie avec les accords du GATT, l'accord de libre change avec l'Union europen et avec les Etats-Unis. Le Maroc a dcid alors de commencer la restructuration de son conomie avec comme objectif l'attraction des investissements trangers. Ce qui a rendu la modernisation de ses infrastructures une priorit. La candidature manque du Maroc pour lorganisation du championnat du monde de football de 2010 na pas dcourag les autorits marocaines de continuer le plan ambitieux de construction dautoroute, port et stades de football.. La situation du march de camion a t alors marque par un dveloppement trs important du segment de C (Chantier) et le prochain dveloppement prvisible du national et du segment de TIR. Le march des camions atteindra un pic historique en 2005 (plus 1000 units), puis un ralentissement en 2006, principalement en raison de la saturation du segment de construction. A partir de 2007, le march commencera accrotre lentement jusqu' atteindre son niveau de 2005 en 2009. Le service aprs vente profite de lanciennet du parc roulant de Scania Maroc. Les perspectives de croissance sont prsentes pour la seule succursale de Tanger qui servira dans le test de dprciation car cest la seule succursale que Scania Maroc possde. Dans le cas prsent nous allons procder une rpartition des immobilisations pour les deux activits pices de rechanges et magasin. Ensuite, nous allons revoir les plans damortissement du groupe des diffrentes immobilisations pour les aligner sur les normes IFRS. En particulier, lapplication de lamortissement par composant. (Unit gnratrice de trsorerie).
II-2 LA DEMARCHE DU TRAITEMENT DES NORMES 16 et 36
46
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Selon la norme IAS 36, nous avons procd la rpartition par composant bas sur la dure de la vie. Ceci, principalement pour le poste construction. Ensuite, nous les avons rparti par des U.G.T dont la dfinition sera dtaille dans le deuxime point qui suit. Le problme qui se pose au niveau des immobilisations corporelles est la liaison entre ces lments par exemple, la construction est compos de plusieurs composants, quil faut les dfinir avec leurs valeurs, fin de trouver une valuation selon leurs dure de vie (mures, portes, fentres), et de trouver les cls de rpartitions par unit gnratrice de trsorerie de ces lments, daprs les normes, IAS 16 et IAS 36. Enfin, le rsultat des diffrents retraitements est prsent dans le tableau ci-dessous :
Construction
Plan amortissement "normes groupe" Rpartition Atelier Magasi n
Date Composants acquisi tion
Montant
Dprciatio n priode
Age
Valeur nette comptable Fin 2005
Construction Total
2001 3 551000 3 551000
25
2 982 840 2 982 840
90%
10%
47
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Dprciation d'actif selon la norme IFRS 36 Valeur nette Age comptable Fin 2005 Rpartition
Composants
Date acquisition
Montant
Dprciation priode
Atelier
Magasin
Construction Installation lectrique Portes/Fentres Total
2001 2001 2001
3 274 636 218 997 57 367 3 551 000
50 25 25
4 3 012 665 4 4 183 957 48 188 3 244 811
90% 90% 90%
10% 10% 10%
Revue des amortissements pratiqus Autres postes d'immobilisations corporelles Plan amortissement "normes groupe" Rpartition Postes Agencement amnagement Matriel Outillage Matriel de bureau Matriel informatique Mobilier de bureau Total Valeur nette Date Dure Montant Age comptable Fin acquisition amortissement 2005 2001 495 000 2001 530 000 2001 156 000 2001 2001 2001 35 000 24 500 71 000 1 311 500 10 5 5 5 5 10 4 4 4 4 4 4 297 000 106 000 31 200 7 000 4 900 42 600 488 700 Atelier Magasin
70% 70% 100% 100% 90% 50% 50%
5% 5% 0% 0% 10% 50% 50%
48
Projet de fin d'tudes Dprciation d'actif selon la norme IFRS 36
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Rpartition Composants Valeur nette Date Dure Montant Age comptable Fin acquisition amortissement 2005 2001 73 000 15 4 53 533 Atelier Magasin
Agencement et amnagement "Portes Ateliers" Autres Agencement amnagement Matriel Outillage Climatiseurs Matriel informatique Mobilier de bureau Total
100%
0%
2001 422 000 2001 156 000 2001 530 000 2001 35 000 2001 2001 24 500 71 000 1 311 500
15 5 2 5 2 10
4 4 4 4 4 4
309 467 31 200 0 7 000 0 42 600 443 800
70% 100% 100% 90% 50% 50%
5% 0% 0% 10% 50% 50%
II-3 DEFINITION DES UNITES GENERATRICES DE TRESORERIE
La succursale objet de notre cas pratique, a deux activits : Ventes pices et main duvres sur rparation. La contribution de latelier dans les ventes des pices travers le montage de ces dernires lors des divers natures de rparations effectues, pose la problmatique de la rpartition de la marge total des pices. En effet, sur la base de la quotepart du chiffres daffaire de ces derniers, par vente au comptoir et vente par le biais de latelier, un prix de cession a t fix. Ce prix, concerne les pices qui vont du magasin latelier pour tre mont sur les camions en rparation. Do une affectation plus quitable de la marge dgage sur les pices de rechange entre latelier qui occupe plus de 90% de la surface de la succursale et le magasin.
Dfinition du taux dactualisation
Pour la dtermination du taux dactualisation nous allons tous dabord tudier la structure de financement de lentreprise. Cette dernire se compose de : Capital : 15 000.000 MAD Dcouvert structurel : 200 031 MAD Le cot de ces diffrentes sources de financement est prsent ci-dessous :
49
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Cas pratique
Calcul du cot moyen pondr du capital Structure de fiancement Dcouvert bancaire structurel Emprunt groupe Retraitement du crdit bail Capital/ Total
Rentabilit exig Rentabilit pondre avant impt Rentabilit pondre aprs impt
Moyenne
153 396 45 000 1 635 15 000 215 031
7% 4% 9% 13%
4,82% 0,90% 0,07% 0,91%
3,13% 0,58% 0,04% 0,91% 4,67%
Le choix du calcul du cot de lactualisation est important dans la mesure ou il faut se rfrer plusieurs critres, fin daboutir la ralit du secteur de transport, donc nous avons pris la mthode du CMPC, puisque les donnes proposes refltent la ralit de lentreprise et du march financier.
Lactualisation des flux nets de trsorerie prvisionnels et le test de dprciation
Tout dabord, nous avons calcul les flux nets de trsorerie partir du rsultat net dexploitation auquel nous avons ajout les dotations damortissements pour avoir les cash flows, Les diffrents retraitements sont prsents dans le tableau ci-dessous
50
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Prvisions/ 5 ans
2006
Magasin Labor sales
2007
Magasin Labor sales
2008
Magasin Labor sales
2009
Magasin Labor sales
2010
Magasin Labor sales
I- Ventes I-1 Ventes externes 2
Pices Main d'ouvres
3 900 0 50 860
2 290 1 647 3
4 55 146
3 719 7 011 4
4 60 461
3 719 8 011 4
4 66 807
3 710 5 853 4
5 73
600
I-2 Ventes internes
Pices Main d'ouvres
315
Total ventes II-Cot
Cot externes Cot /Cession internes
915 111
5 5
400 5 315
4 32 3 3
507 622
6 5
841 8 647
4 35 3 4
157 184
7 6
326 5 011
5 39 4 4
472 430
7 6
387 4 011
5 43 4 4
660 483
8 7
445 8 853
6 47 4 5
5 Total cot Marges % Charges de structure Rsultat d'exploitation Dotations aux amortissements Cash flow 111 80 4 14% 167 63 8 1 6 65 4 0 640
5 622 76 4 14% 175 71 0 1 6 72 6 88 6 005
6 184 83 3 14% 184 78 9 1 6 80 5 97 0 406
6 430 92 1 042 14% 193 84 9 1 6 86 5 445 2
7 483 94 1 177 14% 202 97 5 1 6 99 1 331
17% 1 499 739 13 8 601
17% 1 573 737 10 0 637
17% 1 652 732 10 0 632
17% 1 735 793 10 0 693
1 114 17% 1 821 708 10 0 608
Ensuite, nous avons repris les donnes de notre tableau prvisionnel pour procder lactualisation des flux. Ceci pour chacune des units gnratrices de trsorerie. U.G.T : Magasin Cashs flow, prvisionnels Anne 1 Rsultat d'exploitation Dotations aux amortissements = Cash flow sur activit atelier Valeur rsiduelle la fin de la priode =Total cashs flows actualiss U.G.T : Atelier Cashs flow, prvisionnels Anne 1 Rsultat d'exploitation Dotations aux amortissements = Cashs flow sur activit atelier Valeur rsiduelle la fin de la priode =Total cashs flows actualiss -739 138 Anne 2 -737 100 Anne 3 -732 100 Anne 4 -793 100 Anne 5 -708 100 654 16 670 Anne 2 726 16 742 Anne 3 805 16 821 Anne 4 865 16 881 Anne 5 991 16 1 007
0 3 569
-601
-637
-632
-693
-608
0 -2 768
Enfin, le test de dprciation, pour tester la valeur nette comptable avec celle du march, et la valeur recouvrable, pour la constatation de la perte de valeur
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Test dprciation
UGT : Magasin Immobilisations Goodwill Construction Matriel et outillage Autres immobilisations Valeur nette comptable 0 324 0 37 500 0 0 Valeur de march
Valeur recouvrable 3 569 Perte de valeur 0
Dfinition de l'U.G.T
Reprsente les ventes des pices de rechanges au comptoir; Ainsi que les ventes par le biais de l'atelier pour lequel une marge de 5% est concde.
II
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Test dprciation
UGT : Atelier Immobilisations Goodwill Construction Matriel et outillage Autres immobilisations Valeur nette comptable 0 2 920 31 298 4 500 0 30 Valeur de march
Valeur recouvrable -2 768 Perte de valeur 0
Dfinition de l'UGT
L'atelier occupe 90% de l'espace de la succursale et contribue Scania Maroc par l'intermdiaire des camions rpars dans ses locaux. Pour cela, compte tenu des donnes statistiques sur la part des pices de rechanges montes par le biais de l'atelier; Une marge de 5% sur 60% des ventes de P.R sera raffecter l'atelier.
La comparaison entre valeur recouvrable, valeur de march et valeur nette comptable nous a amen ne pas constater aucune perte de valeur. Ceci, en raison de la flambe des prix des locaux de la zone industrielle. En outre, les diffrences entre les cash-flows des deux U.G.T (ngatif pour latelier et positif pour le magasin), nous pose la problmatique de la dfinition des U.G.T. Ceci qui nous a pouss dfinir toute la succursale de Tanger comme une seule U.G.T. Linvestissement Tanger, a t surdimensionn par rapport aux potentialits de la rgion du moins sur le moyen terme. Ce qui ne veut pas dire que ce projet va tre abandonn en raison de limportance davoir un rseau de succursale et de concessionnaire dans tout le territoire marocain pour les entreprises du secteur.
III
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
En conclusion, comparabilit, transparence et fiabilit des informations financires constituent les principes et des objectifs viss par le passage aux normes IFRS; ne pourront tre atteints que si les trois grandes questions que sont la mise en uvre, linterprtation et lapplication sont traites de faon identique dans tous les pays. Or, rien ne le garantit. Chacun deux a ses traditions comptables et ses spcificits en matire de structures de rgulation des marchs.
Globalement, si les entreprises, en grande majorit, pensent que cette uniformisation de la comptabilit devrait apporter une plus grande transparence et une meilleure comparabilit des comptes et quelle va favoriser la construction dun vrai marcher financier unique, les rticences et le scepticisme sont encore perceptibles.
De fait, il est peu probable que lobjectif de comparabilit soit atteint ds 2005. Le passage aux normes IFRS nest pas un long fleuve tranquille. Il soulve un certain nombre de problmes de principe et de grandes difficults dapplication pratique.
En fait,comme nous l'avons vu dans le cas de Maroc Telecom , le passage aux normes IFRS necessite la mise en uvre d'un projet de conversion bien tudier et traite avec prudence accompagnant d'une action de suivi et de contrle car le passage aux normes IFRS constitue une tape utile et acte ultime et la plus difficile tape de transition. Par contre dans Scania Maroc nous avons vu la dmarche de l'application des normes IAS16 et 36 ainsi que sa rpartition par des units gnratrices de trsorerie"UGT" qui constitue une tape important dans le calcul de l'immobilisation.
IV
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES : Grgory Heem ; Lire les tats financiers en IFRS ; ditions dorganisation ; 2004 Normes IAS/IFRS Que faute il faire ? Comment sy prendre ? ; DFCG collection Laurent Bailly ; Comprendre les IFRS ; Maxima Laurent du Mesnil diteur De Muriel Nahmias ; L'essentiel des normes IAS/IFRS ; ditions dorganisation Cours dMSTCF- comptabilit anglo-saxonne et IFRS Mr Fraiha Casta J-F, B. Colasse ; Juste valeur : enjeux techniques et politiques ; Economic; 2001 Nicolas Veron ; L'Information financire en crise: Comptabilit et capitalisme; Editions Odile Jacob ; 2004
ARTICLES ET ENQUETES : Etude baromtrique KPMG Cartesis normes IFRS 2005 Enqute sur le passage des norms IFRS Mazars Formation aux IFRS Altadis -Maroc Similarities and Differences IFRS USGAAP - PWC
SITE WEB: http://www.focusifrs.com/edito/plan.asp http://www.cegid.fr/lyon-finance.org/normes/ http://www.kpmg.fr http://archives.lesechos.fr/ http://mazars.com/ http://www.deloitte.fr http://www.club-comptable.com http://www.revuefiduciaire.com http://www.ccomptes.fr http://www.finances.gouv.fr/CNCompta http://www.agecompta-gestion.com http://www.europa.eu.int http://www.iasplus.com http://www.efrag.org http://www.iasb.org.uk http://www.ecif.info/OptionFinance_Goodwills.pdf
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
VI
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Bilan consolid et notes explicatives au 31 dcembre 2004 en normes IAS/IFRS
Bilan consolid au 31 dcembre 2004 en normes IAS/IFRS
VII
Projet de fin d'tudes
L'impact des nouvelles normes IFRS sur la qualit de l'information financire
Notes annexes au bilan
VIII
Compte de rsultat de lexercice clos le 31 dcembre 2004 en normes IAS/IFRS
Notes annexes au compte rsultat
Tableau des flux de trsorerie de lexercice clos le 31 dcembre 2004 en normes IAS/IFRS
Tableau de variation des capitaux propres au 31 dcembre 2004 en normes IAS/IFRS
Etat de rapprochement des capitaux propres au 31 dcembre 2004
Annexe 1 : la structure de lIASB: (Source : www.iasb.org)
Annexe 2 : Elaboration des normes
INDEX DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ASB : Accounting Standards Board (normalisateur comptable, Royaume-Uni et Irlande) CESR : Committee of European Securities Regulators (structure de coordination des autorits de rgulation des marchs financiers, Union Europenne) CNC : Conseil National de la Comptabilit (comit consultatif, France) COB : Commission des Oprations de Bourse (autorit de rgulation des marchs financiers, France) CRC : Comit de la Rglementation Comptable (France) EFRAG : European Financial Reporting Advisory Group (comit consultatif, Union Europenne) FAF : Financial Accounting Foundation (maison-mre du FASB, Etats-Unis) FASB : Federal Accounting Standards Board (normalisateur comptable, Etats-Unis) FRC : Financial Reporting Council (maison-mre de lASB, Royaume-Uni) IAS : International Accounting Standards (ancien nom des IFRS) IASB : International Accounting Standards Board (normalisateur comptable international, socit prive base Londres) IASC : International Accounting Standards Committee (fondation prive base au Delaware, maison-mre de lIASB) IFRS : International Financial Reporting Standards (normes produites par lIASB, anciennement appeles IAS) IOSCO : International Organisation of Securities COmissions (structure de coordination internationale des autorits de rgulation des marchs financiers) SEC : Securities & Exchange Commission (autorit de rgulation des marchs financiers, Etats-Unis) US GAAP : Generally Accepted Accounting Principles (normes produites par le FASB, Etats-Unis)
PANORAMA DES NORMES
IAS 1 Prsentation des tats financiers IAS 2 Stocks IAS 7 Tableau des flux de trsorerie IAS 8 Rsultat net de lexercice, erreurs fondamentales et changements de mthodes comptables IAS 10 Evnements postrieurs la date de clture IAS 11 Contrats de construction IAS 12 Impts sur le rsultat IAS 14 Information sectorielle IAS 15 Information refltant les effets de variations de prix IAS 16 Immobilisations corporelles IAS 17 Contrats de location IAS 18 Produits des activits ordinaires IAS 19 Avantages du personnel IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations fournir sur laide Publiques IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies trangres IAS 22 Regroupements dentreprises IAS 23 Cots demprunts IAS 24 Information relative aux parties lies IAS 26 Comptabilit et rapports financiers des rgimes de retraite IAS 27 Etats financiers consolids et comptabilisation des participations dans les Filiales IAS 28 Comptabilisation des participations dans des entreprises associes IAS 29 Information financire des les conomies hyper inflationnistes IAS 30 Informations fournir dans les tats financiers des banques et des institutions financires assimiles IAS 31 Information financire relative aux participations dans des coentreprises IAS 32 Instruments financiers : informations fournir et prsentation IAS 33 Rsultat par action IAS 34 Information financire intermdiaire IAS 35 Abandon dactivits IAS 36 Dprciation dactifs IAS 37 Provisions, passifs ventuels et actifs ventuels IAS 38 Immobilisations incorporelles IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et valuation IAS 40 Immeubles de placement IAS 41 Agriculture
IFRS IFRS 1 IFRS 2 IFRS 3 IFRS 4 IFRS 5 IFRS 6 IFRS 7 Premire application des normes d'information financire internationales Paiement fond sur des actions Regroupements d'entreprises Contrats d'assurance Actifs non courants dtenus en vue de la vente et activits abandonnes Prospection et valuation de ressources minrales Instruments financiers : informations fournir Interprtations SIC SIC 7 SIC 10 SIC 12 SIC 13 SIC 15 SIC 21 SIC 25 SIC 27 SIC 29 SIC 31 SIC 32 IFRIC 1 IFRIC 2 IFRIC 4 IFRIC 5 IFRIC 6 IFRIC 7 Introduction de l'euro Aide publique - Absence de relation spcifique avec des activits oprationnelles Consolidation - Entits ad hoc Entits contrles conjointement - Apports non montaires par des coentrepreneurs Avantages dans les contrats de location simple Impt sur le rsultat - Recouvrement des actifs non amortissables rvalus Impt sur le rsultat - Changements de statut fiscal d'une entreprise ou de ses actionnaires valuation de la substance des transactions prenant la forme juridique d'un contrat de location Informations fournir - Accords de concession de services Produits des activits ordinaires - Oprations de troc portant sur des services de publicit Immobilisations incorporelles - Cots lis aux sites web IFRIC Variation des passifs existants relatifs au dmantlement, la remise en tat et similaires Parts sociales des entits coopratives et instruments similaires Dterminer si un accord contient un contrat de location Droits aux intrts manant de fonds de gestion ddis au dmantlement, la remise en tat et la rhabilitation de l'environnement Passifs dcoulant de la participation un march dtermin - Dchets d'quipements lectriques et lectroniques Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29
Encadre 1: les dates cl: 1973: Cration de lIASC Londres, l'initiative de Sir Henry BENSON, premier Prsident lu de l'IASC. 1975: Publication des deux premires normes intitules IAS 1 "Publication des mthodes comptables" et IAS 2 "Valorisation et prsentation des stocks selon la mthode du cot historique" 1982: la suite de la cration de l'IFAC, les activits de l'IASC et de l'IFAC sont rorganises, le rle de normalisateur comptable international tant dvolu officiellement l'IASC. 1987: L'IASC engage un processus d'amlioration de ses normes afin de rduire le nombre d'alternatives proposes et ainsi d'assurer une meilleure comparabilit entre les entreprises utilisant les IAS. 1989: L'IASC publie son cadre conceptuel pour la prparation et la prsentation des tats financiers. Il permit de donner l'esprit des nouvelles normes qui furent publies aprs sa parution, et notamment, la dfinition et l'objectif des tats financiers, ses composantes et leur comptabilisation. 1990: La Commission europenne occupe un sige d'observateur au sein du conseil de l'IASC. 1995: L'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs mobilires (OICV-IOSCO), en accord avec l'IASC, s'engage, sous certaines conditions, recommander aux rgulateurs nationaux daccepter des tats financiers prsents selon les normes comptables internationales pour toutes les missions et cotations effectues sur les marchs financiers internationaux, sans ncessit de rconciliation avec les normes locales. La Commission europenne encourage la signature de cet accord. 1999: Une tude mene par la Commission europenne dmontre que les IAS sont compatibles avec les directives europennes, de rares exceptions prs. La Commission europenne dcide d'engager un plan d'action pour les services financiers qui prvoit notamment l'application des IAS comme rfrentiel comptable europen, l'horizon 2005. 2000: Une nouvelle constitution de l'IASC est approuve. L'OICV, conformment son engagement, recommande ses membres daccepter des tats financiers prsents selon les normes comptables internationales pour toutes les missions et cotations effectues sur les marchs financiers internationaux, sans ncessit de rconciliation avec les normes locales. La Commission europenne prsente un plan selon lequel toutes les entreprises europennes cotes devront commencer utiliser les IAS au plus tard partir de 2005. 2001: Rforme de lInternational Accounting Standards Committee (IASC) qui devient lInternational Accounting Standards Board (IASB). Ce dernier se voit doter dun organe de direction : lInternational Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) qui est galement charg dassurer son financement. Les normes publies jusquau 1er avril conservent la dnomination "IAS" : International Accounting Standards. Les normes mises partir de cette date seront intitules "IFRS" : International Financial Reporting Standards.Prsentation par la Commission europenne, le 13 fvrier 2001, dune proposition de rglement visant rendre obligatoires les normes internationales pour les comptes consolids des socits europennes cotes, pour les exercices ouverts compter du 1er janvier 2005. 2002: Publication au JOCE du 11 septembre 2002 du rglement CE n 1606/2002 dit IFRS 2005 : celui-ci impose aux socits europennes cotes qui publient des comptes consolids lapplication des IAS/IFRS pour les exercices dbutant partir du 1er janvier 2005. 2003: L'IASB publie la version rvise de 13 normes. Sur la recommandation de l'Accounting Regulatory Committee (ARC), la Commission europenne publie le rglement CE n 1725/2003 qui adopte la quasi-totalit des normes publies par lIASB (IAS 1 IAS 41), lexception de l'IAS 32 et l'IAS 39, soit le rfrentiel de l'IASB en vigueur au 14 septembre 2002. 2004 - 2005 : L'adoption de normes de l'IASB s'est poursuivie par la publication ultrieure de rglements europens. Pour plus de dtails, vous rfrer au thme "Normes et Interprtations" - rubrique "Rglements". En juin 2005, les Trustees de l'IASCF ont adopt des amendements la Constitution ; la version rvise de celle-ci
est entre en vigueur le 1er juillet 2005. Pour en savoir plus sur la Constitution et les diffrents projets de rvision qui l'ont concerne, consulter la rubrique Constitution et projets de rvision. 2006: L'IASB et le FASB raffirment leur engagement visant amliorer la cohrence, la comparabilit et l'efficacit des marchs mondiaux, en dveloppant des normes comptables communes de haute qualit. Par ailleurs, en dbut d'anne, l'IASB a prpar un expos sondage prliminaire portant sur une norme internationale d'information financire pour les PME.
Vous aimerez peut-être aussi
- DCG Ue10 Sujet0 Corrige 769Document15 pagesDCG Ue10 Sujet0 Corrige 769Hugo Da TorrePas encore d'évaluation
- Les Normes IAS IFRS Et Les Normes Marocaines - Etudes Et RetraitementsDocument92 pagesLes Normes IAS IFRS Et Les Normes Marocaines - Etudes Et RetraitementsSouad Baya89% (72)
- (Taha D+ Kamal D) PFE (Impact Des Normes IFRS Sur Les États FinancièresDocument51 pages(Taha D+ Kamal D) PFE (Impact Des Normes IFRS Sur Les États FinancièresTaha Can90% (10)
- Impact IFRS Sur Analyse Fin 2Document51 pagesImpact IFRS Sur Analyse Fin 2Latifa El Hassnaoui80% (5)
- Rapport Stage IfrsDocument93 pagesRapport Stage IfrsFatiha Arsmouk100% (1)
- Comparaison Ifrs CGNCDocument68 pagesComparaison Ifrs CGNCAhmed Char100% (2)
- Presentation Projet de Déglobalisation Des Investissements - Volet TechniqueDocument27 pagesPresentation Projet de Déglobalisation Des Investissements - Volet TechniqueAli Dp-inas100% (2)
- Memoire Sur Les Normes Comptables InternationnalesDocument63 pagesMemoire Sur Les Normes Comptables InternationnalesAmine Belcadi100% (3)
- PFEDocument79 pagesPFEyoussrita100% (2)
- MEMOIRE Birane VdéfDocument70 pagesMEMOIRE Birane Vdéfbirane83100% (7)
- Difficultés de Passage Du CGNC Aux Normes IFRSDocument24 pagesDifficultés de Passage Du CGNC Aux Normes IFRSNihad Benali100% (1)
- Audit Comptes ConsolidésDocument84 pagesAudit Comptes ConsolidésAmal Amal100% (2)
- Cours IFRS-Master CCAF-1er Envoi PDFDocument95 pagesCours IFRS-Master CCAF-1er Envoi PDFZineb TahirPas encore d'évaluation
- Mémoire IfrsDocument77 pagesMémoire Ifrsmendoza6967% (6)
- Rapport de Stage de Fin D'étudeDocument101 pagesRapport de Stage de Fin D'étudeIslam El OusroutiPas encore d'évaluation
- Support Cours Normes Ifrs 4 IfDocument78 pagesSupport Cours Normes Ifrs 4 IfKhalid Assaka100% (1)
- Rapport IFRS s10 PDFDocument73 pagesRapport IFRS s10 PDFEnseignant Universiataire0% (1)
- Ias IfrsDocument5 pagesIas IfrsSimo EL KhomssiPas encore d'évaluation
- Passage Aux Normes IAS IFRS Au MarocDocument18 pagesPassage Aux Normes IAS IFRS Au MarocMoad Ennajy100% (1)
- Les Normes IFRSDocument13 pagesLes Normes IFRSHoussamPas encore d'évaluation
- IFRSDocument11 pagesIFRSHassanAmenou100% (2)
- L Impact Des Nouvelles Normes IFRS Sur La Qualite de L Information FinanciereDocument87 pagesL Impact Des Nouvelles Normes IFRS Sur La Qualite de L Information FinanciereJocelyn Kabran100% (1)
- Ias, IfrsDocument253 pagesIas, IfrsAli Lemrabet100% (3)
- PFE DéfinitifDocument134 pagesPFE DéfinitifsimoPas encore d'évaluation
- Adoption Des Normes Comptables Internationales Ifrs Au Maroc Essai D'analyse Des Enjeux Et Des Contraintes de Mise en Oeuvre Pour Le Secteur Immobilie PDFDocument21 pagesAdoption Des Normes Comptables Internationales Ifrs Au Maroc Essai D'analyse Des Enjeux Et Des Contraintes de Mise en Oeuvre Pour Le Secteur Immobilie PDFnetflix tigmi100% (1)
- Passage Aux Normes IFRS Maroc With Cover Page v2Document14 pagesPassage Aux Normes IFRS Maroc With Cover Page v2Aicha Ben TaherPas encore d'évaluation
- Maroc-Le Passage Aux Normes Ias-Ifrs Et Leur ImpactDocument70 pagesMaroc-Le Passage Aux Normes Ias-Ifrs Et Leur ImpactKingo ZizoPas encore d'évaluation
- Rapport Comparaison IFRS Et CGNCDocument14 pagesRapport Comparaison IFRS Et CGNCFATIMA EL OMARIPas encore d'évaluation
- La Comptabilite InternationaleDocument47 pagesLa Comptabilite InternationaleAbdessalamBoulaajoulPas encore d'évaluation
- Impact Des IFRS Sur Les États FinanciersDocument8 pagesImpact Des IFRS Sur Les États FinanciersSarah Hope TraorePas encore d'évaluation
- Le Passage Aux Normes IAS - IFRS Dans Le Cadre D - OffshoringDocument71 pagesLe Passage Aux Normes IAS - IFRS Dans Le Cadre D - OffshoringOThman JounsePas encore d'évaluation
- Application Des Normes Ifrs en TunisieDocument4 pagesApplication Des Normes Ifrs en TunisieHaythem TrabelsiPas encore d'évaluation
- L'Impact Des Normes IAS-IFRS Sur La Consolidation Et L'analyse Financière Des États Consolidés Du Groupe CLDocument84 pagesL'Impact Des Normes IAS-IFRS Sur La Consolidation Et L'analyse Financière Des États Consolidés Du Groupe CLFatima-zahra AbdourafiqPas encore d'évaluation
- Memoire 2Document91 pagesMemoire 2Sanae Mahraz0% (2)
- L'Apport Des Normes IFRS IAS Au Nouveau Plan Comptable Des Caisses de RetraiteDocument55 pagesL'Apport Des Normes IFRS IAS Au Nouveau Plan Comptable Des Caisses de RetraiteMohammed EzzouakPas encore d'évaluation
- Ias/ifrsDocument28 pagesIas/ifrsToufik ZeroukPas encore d'évaluation
- Impact Des Normes IFRSDocument82 pagesImpact Des Normes IFRSJocelyn Kabran100% (2)
- L'impact Des Normes IFRS Dans Le Bilan PDFDocument56 pagesL'impact Des Normes IFRS Dans Le Bilan PDFKhadir En-najiPas encore d'évaluation
- Le Ire Aux Comptes Face A La Premiere Application Des Normes IFRSDocument162 pagesLe Ire Aux Comptes Face A La Premiere Application Des Normes IFRSnahid02Pas encore d'évaluation
- Ifrs 9Document25 pagesIfrs 9Wafi ChikhaouiPas encore d'évaluation
- Lepassageauxnormesias Ifrs 121220150024 Phpapp02Document70 pagesLepassageauxnormesias Ifrs 121220150024 Phpapp02Imane Zouhouredine100% (1)
- Mémoire SurDocument88 pagesMémoire SurHanan Mrfc100% (1)
- Ifrs 9Document20 pagesIfrs 9AminaAlouani100% (1)
- Normes Comptables InternationalesDocument53 pagesNormes Comptables InternationalesSarah Nassiri100% (3)
- Memoire IFRSDocument85 pagesMemoire IFRSSaray El KhatibPas encore d'évaluation
- Pfe RésuméDocument25 pagesPfe Résuméhamza belfqihPas encore d'évaluation
- IFRS Fayçal DerbelDocument28 pagesIFRS Fayçal DerbelRafik Belkahla100% (1)
- IfrsDocument10 pagesIfrsanon-442325100% (2)
- Les Normes IFRS - Quelles Opportunités Pour Les Entreprises SénégalaisesDocument66 pagesLes Normes IFRS - Quelles Opportunités Pour Les Entreprises Sénégalaisesnetflix tigmi100% (4)
- Le Mini-Projet-Processus Et Cadre Conceptuel Des Normes IAS IFRSDocument26 pagesLe Mini-Projet-Processus Et Cadre Conceptuel Des Normes IAS IFRSŽahra Ňah Id100% (1)
- Pfe IfrsDocument45 pagesPfe IfrsHalichou wijdanePas encore d'évaluation
- Enjeux Et Impacts de La Bascule Aux IFRSDocument18 pagesEnjeux Et Impacts de La Bascule Aux IFRSJocelyn KabranPas encore d'évaluation
- 1466-Article Text-5150-1-10-20231105Document22 pages1466-Article Text-5150-1-10-20231105Ilham RidPas encore d'évaluation
- NormeDocument17 pagesNormeIlyass MatraouiPas encore d'évaluation
- Le Passage Aux IFRSDocument25 pagesLe Passage Aux IFRSAbdel Khalek BelhajPas encore d'évaluation
- Sujets Ias IfrsDocument6 pagesSujets Ias IfrsYoussefPas encore d'évaluation
- Les Normes IFRSDocument53 pagesLes Normes IFRSHiba IngePas encore d'évaluation
- NORMES IFRS Et Normes MarocainesDocument64 pagesNORMES IFRS Et Normes MarocainesHicham AHPas encore d'évaluation
- Ifrs BancaireDocument34 pagesIfrs BancaireSmail TaziPas encore d'évaluation
- 2017-483-Article Text-1815-1-10-20200827Document17 pages2017-483-Article Text-1815-1-10-20200827BAAMOUDIPas encore d'évaluation
- Cour FusionDocument8 pagesCour FusionNourAllah AouiniPas encore d'évaluation
- Ex 1201Document4 pagesEx 1201Moumin Hassan waberiPas encore d'évaluation
- Fiche 232Document3 pagesFiche 232BluePas encore d'évaluation
- Consolidation Des Comptes 2ème PartieDocument3 pagesConsolidation Des Comptes 2ème PartieINDIPas encore d'évaluation
- Cours de Comptabilite Des Societes l2 UipaDocument20 pagesCours de Comptabilite Des Societes l2 UipaLidwine MarwaPas encore d'évaluation
- B PRЕSЕNTATION DЕS ЕTAT FINANCIЕRSDocument22 pagesB PRЕSЕNTATION DЕS ЕTAT FINANCIЕRSkarimpeter97Pas encore d'évaluation
- EXAM 4ème AnnéeDocument3 pagesEXAM 4ème AnnéeHassan OuchenPas encore d'évaluation
- Politiques de DividendesDocument21 pagesPolitiques de Dividendeslaflouf100% (1)
- Cours Consolidation 2023 2024 - Chap 2Document24 pagesCours Consolidation 2023 2024 - Chap 2rahmaPas encore d'évaluation
- Comptabilité GénéraleDocument4 pagesComptabilité GénéraleHamza BPas encore d'évaluation
- La Renaissance LochoiseDocument2 pagesLa Renaissance LochoisepfePas encore d'évaluation
- Thème 6 - Structure Financière Et Cout de CapitalDocument56 pagesThème 6 - Structure Financière Et Cout de Capitalikram ezzari67% (3)
- Guide Pour Une SASDocument28 pagesGuide Pour Une SASmineralsursoiPas encore d'évaluation
- Evaluation D'entrepriseDocument5 pagesEvaluation D'entreprisechakiri sihamPas encore d'évaluation
- Tableau de FinancementDocument13 pagesTableau de FinancementEnseignant UniversiatairePas encore d'évaluation
- FACTUREDocument6 pagesFACTUREPFEPas encore d'évaluation
- Comptes Annuels 2021: Période Du 02/01/2021 Au 31/12/2021Document24 pagesComptes Annuels 2021: Période Du 02/01/2021 Au 31/12/2021Carmen AncutaPas encore d'évaluation
- Atelier2 CorrectionDocument2 pagesAtelier2 CorrectionWalid TliliPas encore d'évaluation
- Le Passage Aux IFRSDocument25 pagesLe Passage Aux IFRSAbdel Khalek BelhajPas encore d'évaluation
- Corrigé TD 4 AdfDocument1 pageCorrigé TD 4 AdfMr Moctar DEMIPas encore d'évaluation
- Audit LegalDocument5 pagesAudit LegalsanaePas encore d'évaluation
- Simpl Is Cahier Des Charges Edi v1 9 4+Document49 pagesSimpl Is Cahier Des Charges Edi v1 9 4+soufianePas encore d'évaluation
- Bdef Def 2013 Prov 2014Document379 pagesBdef Def 2013 Prov 2014ndongPas encore d'évaluation
- Copie de Cas BASMA LP SESEGDocument3 pagesCopie de Cas BASMA LP SESEGMoualdi AyaPas encore d'évaluation
- Les Travaux de Fin D'exerciceDocument14 pagesLes Travaux de Fin D'exercice3ONSORY FFPas encore d'évaluation
- Analyse de CPC Esg Caf 4Document11 pagesAnalyse de CPC Esg Caf 4Asmaa LahouaouiPas encore d'évaluation
- EXPLORATION FINANCIERE DU BILAN COMPTABLE (Série 2)Document3 pagesEXPLORATION FINANCIERE DU BILAN COMPTABLE (Série 2)mostafaaPas encore d'évaluation
- Examen BIF EE2Document3 pagesExamen BIF EE2Hdhiri NawresPas encore d'évaluation