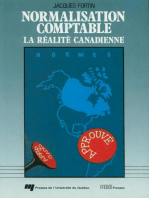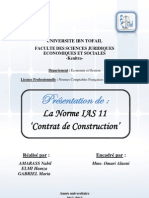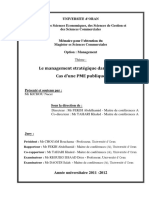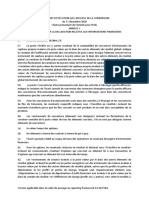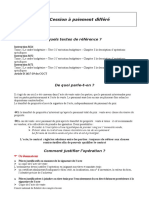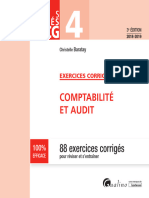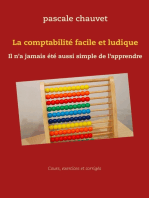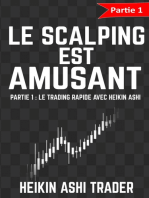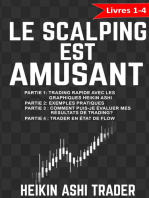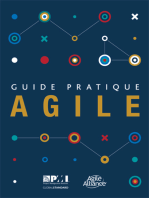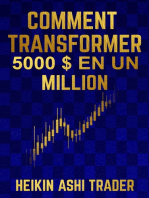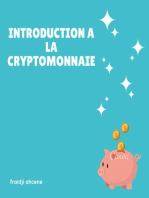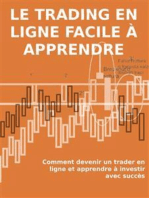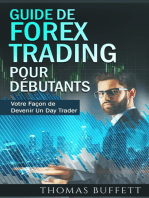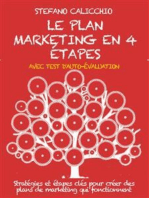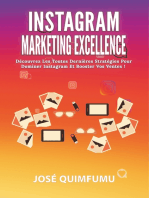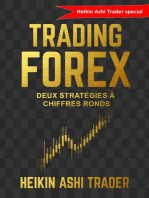Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Passage Aux Normes IAS IFRS Au Maroc
Transféré par
Moad EnnajyCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Passage Aux Normes IAS IFRS Au Maroc
Transféré par
Moad EnnajyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Passage aux normes IAS/IFRS au Maroc : quels effets sur
l’évaluation et le pilotage de la performance financière des
groupes cotés ? Une exploration théorique
Transition to IAS / IFRS standards in Morocco: what effects on
the assessment and management of the financial performance of
listed groups? A theoretical exploration
Mbarek BENDDIH
Doctorant en sciences de gestion
Groupe de Recherche En Management et Ingénierie de Développement, FSJES, Université
CADI AYYAD, Marrakech
benddih@gmail.com
Date de soumission : 29/08/2019
Date d’acceptation : 24/10/2019
Pour citer cet article :
BENDDIH M. (2019) « Passage aux normes IAS/IFRS au Maroc : quels effets sur l’évaluation et le pilotage de
la performance financière des groupes cotés ? Une exploration théorique » Revue Internationale des Sciences de
Gestion « Numéro 5 : Octobre 2019 / Volume 2 : numéro 4 » p : 471 - 488
Digital Object Identifier : https://doi.org/10.5281/zenodo.3522718
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 471
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Résumé :
Le processus de mesure, évaluation et pilotage de la performance financière est sans doute
affecté par l’introduction du référentiel IAS/IFRS. La performance de l’entreprise, mesurée
par des agrégats comptables, se trouve modifiée même si les opérations qui sont traduites dans
les documents comptables n’auront pas changé. Au niveau du bilan, le référentiel IFRS
accorde une primauté à la vision économique à la place de la vision juridique. Le référentiel
consacre aussi la notion de « juste valeur » dans l’évaluation du patrimoine de l’entreprise.
S’agissant du compte résultat, il est relégué au second ordre et l’élément nouveau concerne
l’introduction de la notion de « produits des activités courantes ». Il fait également ressortir
certaines informations nouvelles : le résultat opérationnel, le coût de l’endettement financier
net, etc. Le travail d’évaluation et de pilotage de la performance financière se trouve
complètement modifié par l’harmonisation comptable, le rendant à la fois plus riche et plus
complexe.
Mots clé : normes IAS/IFRS ; performance ; évaluation de la performance ; pilotage de la
performance ; harmonisation comptable.
Abstract:
The process of measuring, evaluating and managing financial performance is undoubtedly
affected by the introduction of IAS/IFRS standards. The performance of the enterprise, as
measured by accounting aggregates, is modified even if the transactions that are translated in
the accounting documents have not changed. At the level of the balance sheet, the IFRS
framework gives priority to the economic vision in place of the legal vision. The reference
framework also includes the notion of "fair value" in the valuation of the company's assets. As
regards the profit and loss account, it is relegated to the second order and the new element
concerns the introduction of the concept of "products of current activities". It also highlights
some new information: operating income, cost of net financial debt, etc.
The work of evaluating and controlling financial performance is completely modified by
accounting harmonization, making it both richer and more complex.
Keywords: IAS / IFRS standards; performance; performance evaluation; performance
management; accounting harmonization.
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 472
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Introduction
Les transactions menées sur les marchés monétaires et financiers internationaux enregistrent
une croissance sans précédent. La transparence devient alors un facteur-clé de l’efficacité des
marchés de capitaux. Dans ce contexte de mondialisation, l'harmonisation internationale, ou
encore la réduction des différences entre réglementations comptables nationales, est devenue
un enjeu pour les entreprises, cette harmonisation leur permettra notamment d'accéder à tous
les marchés financiers sans avoir à établir un jeu de comptes particulier pour chaque place
financière. Pour faire face à cette conjoncture économique, l'Union européenne a décidé qu'il
était crucial d'améliorer la compétitivité de l'Europe notamment grâce à l'adoption d’un
nouveau référentiel comptable commun pour la production des informations comptables des
sociétés cotées.
Pour ne pas être en marge des évolutions internationales qui, aujourd’hui, sont irréversibles
d’une part, et attirés par les nombreux avantages de ce nouveau référentiel d’autre part,
plusieurs pays hors Union européenne à l’instar du Maroc ont décidé d'accepter la publication
en IFRS sur leurs marchés boursiers nationaux ou d'accélérer la convergence de leur
référentiel local vers celui de l'IASB. Les normes IAS/IFRS sont ainsi devenues, en quelques
années seulement, le langage comptable le plus reconnu au niveau mondial.
Selon une étude1 réalisé par M'hammed EL HAMZA (2018) ayant pour objet d’expliquer les
déterminants de l’adoption des normes IFRS par les sociétés cotées à la bourse de Casablanca,
la taille de l’entreprise, l’internationalité de la propriété, la réputation de l’auditeur, son
influence et L'activité internationale présente des impacts significatifs sur le choix des
entreprises cotées marocaines.
Le processus d’adoption des normes comptables internationales répond aux besoins
d’intelligibilité et de comparabilité exigés par les investisseurs dans le but d’évaluer
correctement l’activité et la performance d’une entreprise. Cependant, malgré la simplicité
affichée de tels objectifs, la normalisation se heurte à des problèmes conceptuels, notamment
la définition de la performance. Les normes sont établies dans l’objectif de répondre au critère
qualitatif du reporting de la performance sans toutefois faire état d’une définition claire. Dès
lors, l’adoption d’un tel référentiel anime les débats entre professionnels de la comptabilité, si
bien que les parties prenantes ne semblent pas s’accorder sur le bien-fondé d’une telle
harmonisation.
1 http://www.revuecca.com/2018/12/numero-5-juin-2018_1.html
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 473
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Notre contribution portera sur l’étude des effets de ce passage aux normes comptables
internationales sur les l’évaluation et le pilotage de la performance financière des groupes
marocain côtés. Nous allons donc essayer de répondre à la question suivante :
quels sont les effets du passage aux normes IFRS sur l’évaluation et le pilotage de la
performance financière des groupes marocains côtés ?
Le présent travail a pour objectif de présenter une revue de littérature des effets attendus de
l’adoption des normes IFRS au Maroc, les impacts sur l’évaluation de la performance
financière et le pilotage de ladite performance.
1. Adoption des normes IFRS au Maroc : éléments contextuels et revue de la littérature
1.1 Du système comptable marocain à la décision d’ouverture sur les normes IFRS
Avant 1992, on ne pouvait pas parler d’un droit comptable propre à l’entreprise marocaine et
au commerçant, mais seulement de réglementations comptables éparpillées dans des textes de
droit privé et de droit fiscal.
Enracinées dans une vision éminemment juridique de l’entreprise et de ses obligations
d’information, les premières dispositions comptables marocaines avaient privilégié davantage
le point de vue des créanciers et notamment la connaissance des soldes des comptes à chaque
date d’inventaire plus que l’analyse des flux de l’entreprise et l’information financière sur ses
performances.
C’est ainsi que les obligations comptables contenues dans le Dahir des Obligations et Contrats
(Articles 10 à 18, 1913) évoquent principalement le devoir des commerçants de tenir une
comptabilité en tant que moyen de preuve susceptible de servir au juge afin d’établir les droits
et obligations des parties lors des litiges portés devant les tribunaux.
Les sanctions pénales ayant trait à la comptabilité, prévue aux articles 556 à 562 du Code
pénal (1913), traitent uniquement des cas de violation des intérêts des créanciers et punissent
l’absence de tenue régulière dans les seuls cas de cessation de paiement.
Par la suite, la réglementation comptable contenue dans les textes régissant les droits des
sociétés (notamment les dahirs du 11/08/1922 et du 01/09/1926) a eu également pour objet
principal de prémunir les créanciers contre les distributions de dividendes fictifs.
Il faudrait attendre le début des années 1970 pour voir introduites un ensemble de dispositions
en faveur des actionnaires, mais uniquement des grandes sociétés anonymes et précisément
les sociétés cotées. Plus particulièrement, le Dahir du 25/07/1970 instaure le principe de droit
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 474
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
de communication au profit de tout actionnaire de société anonyme dont l’actif dépasse cinq
millions de dirhams ou qui détient un portefeuille dont la valeur à l’inventaire excède un
million de dirhams. Ce texte instaurait par ailleurs l’obligation de la publication des comptes
annuels des sociétés cotées en Bourse, 45 jours après la tenue de leur Assemblée Générale
Ordinaire.
Si sur le plan réglementaire, ce sont les textes juridiques qui définissaient la nature et
l’étendue des obligations comptables des entreprises marocaines, la pratique comptable dans
cette période était principalement régie par un ensemble de dispositions fiscales visant à
sécuriser le processus de collecte de l’impôt sur les bénéfices à travers la standardisation des
données comptables.
C’est ainsi qu’en 1965, le pouvoir fiscal a institué un système comptable (nomenclature des
comptes, règles d’enregistrement, d’évaluation et de présentation) qui est fortement inspiré du
plan comptable français de 1957.
L’emprise de la fiscalité sur la comptabilité s’est poursuivie jusqu’aux années 1980 avec
l’entrée en vigueur de textes de loi relatifs à la TVA, à l’IS et à l’IGR respectivement au
01/04/1986, 21/01/1987 et 01/01/1990.
Ces dispositions couvraient tous les volets qui caractérisent un système comptable (définition
d’une nomenclature des rubriques comptables, mode d’évaluation des transactions, schéma
des états financiers, caractéristiques d’une comptabilité irrégulière....).
Pour ce qui est de la profession comptable, la pratique du commissariat aux comptes des
sociétés anonymes était empreinte d’un grand libéralisme depuis les premiers textes régissant
le droit des sociétés traitant de la profession (Articles 32 à 34 du Dahir du 11/08/1922).
Cette loi insère également l’obligation d’un contrôle des sociétés par actions par un
commissaire aux comptes. Une disposition qui sera quasiment non appliquée jusqu’au milieu
des années 1990.
Un dahir du 8 décembre 1954 précisera les conditions d’exercice de la profession d’expert-
comptable au Maroc. Elaboré en période de protectorat et en l’absence d’un diplôme
marocain d’expertise comptable, c’est le diplôme français qui est privilégié comme voie
d’accès à l’inscription sur la liste des personnes autorisées.
Ce n’est qu’à partir du 4 août 1992 qu’une réforme de la comptabilité a été engagée avec pour
objectifs de consacrer une autonomie du droit comptable et de structurer la profession
comptable.
Cette réforme s’est traduite notamment par la promulgation de deux lois structurantes. La
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 475
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
première loi promulguée est la loi comptable n° 9-88 (datant du 25 décembre 1992) relative
aux obligations comptables des commerçants complétées par le Code Général de la
Normalisation Comptable (CGNC) élaboré par la Commission Nationale de la Normalisation
Comptable en 1987. Ce code représente depuis le référentiel théorique et pratique de
référence de la normalisation comptable marocaine.
Ce référentiel comptable, qui s’inspire fortement du plan comptable français de 1982,
matérialise une recherche d’une vision plus économique de l’entreprise à travers la
normalisation des soldes de gestion et l’instauration de l’obligation de publication d’un
tableau de financement et un état des informations comptables. L’institution des
amortissements dérogatoires qui permettent de s’écarter des règles fiscales en matière
d’amortissement participe également de la même vision.
D’un point de vue conceptuel, l’image fidèle fait également son apparition en tant qu’objectif
recherché des états financiers.
La deuxième loi promulguée est la loi n° 15-89 (Dahir n° 1-92-139 du 8 janvier 1993) qui
réglemente la profession d’expert-comptable en définissant les critères d’appartenance à ce
corps de métier et les obligations en matière de contrôle des publications comptables des
entreprises. Cette même loi institue également le Conseil National de la Comptabilité (CNC)
en tant qu’organisme de référence en matière d’élaboration des normes comptables privées et
publiques au Maroc.
La loi n° 15-89 prévoit également la création de l’Ordre des Experts Comptables (OEC) en
tant qu’organisme en charge de coordonner et d’organiser les professionnels de contrôle des
comptes. Ce texte réaffirme la centralité de l’objectif de recherche d’image fidèle puisqu’il
donne à l’expert-comptable la mission de certifier que « les comptes et autres états
comptables et financiers de l’entreprise donnent une image fidèle de ses actifs et passifs ainsi
que de sa situation financière et de ses résultats ».
Si cette loi attribue le monopole de la certification des comptes sans aucune distinction de ses
formes à l’expert-comptable, c’est la loi de 1995 sur les sociétés anonymes qui traitera par la
suite de la responsabilité professionnelle des commissaires aux comptes et donnera quelques
indications sur leur indépendance.
Depuis la dernière réforme comptable et ses déclinaisons en termes de plans comptables
sectoriels et de dispositions spécifiques aux petites entreprises, l’activité de normalisation
comptable au Maroc est rentrée relativement dans une phase de stagnation alors que
l’environnement économique et financier des entreprises a connu une complexité importante
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 476
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
dans le début du siècle non sans conséquence sur la matière comptable.
Cette stagnation est particulièrement inquiétante s’agissant de la normalisation des comptes
consolidés au Maroc puisqu’en dépit d’une disposition de la Bourse des Valeurs datant de
1993 rendant en théorie la publication des comptes consolidés obligatoire pour les groupes
côtés, aucune norme ne détaillait en pratique les principes et règles à appliquer.
Il fallait attendre le milieu des années 2000, sous la double pression de la Banque Mondiale
publiant un rapport d’évaluation critique sur le système comptable marocain, mais aussi de la
transition des groupes européens aux IFRS, pour voir foisonner au Maroc un ensemble de
dispositions visant à réglementer la publication des comptes consolidés au Maroc.
C’est ainsi qu’en 2005, le CNC publie l’avis n° 5 définit une méthodologie relative à
l’élaboration des comptes consolidés tout en laissant aux groupes côtés le choix de son
application ou de l’adoption des normes IFRS.
La même année, la Bourse des Valeurs publie une nouvelle loi (loi n° 52- 01) réaffirmant
l’obligation de consolidation des entreprises ayant des filiales soit selon les normes
marocaines ou IFRS.
Ces textes seront précisés par la circulaire n° 06/05 du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières (CDVM) publiée la même année qui énonce qu'à partir de l'année 2007, les
groupes cotés au premier compartiment de la Bourse de Casablanca peuvent publier leurs
comptes consolidés soit selon la législation marocaine soit selon les normes IFRS.
Pour les établissements de crédit et assimilés, la Banque Centrale, dans le cadre de ses efforts
de transposition des dispositions de Bâle II, publie en 2007 une note circulaire 56/G/2007 qui
oblige ces derniers à appliquer les normes IFRS à compter de 2008. Pour les établissements
publics, l’application des IAS/IFRS est sur option à partir de 2008, en se référant à la loi 38-
05 du 14 février 2006 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises
publics.
A noter qu’à date d’aujourd’hui, aucune disposition législative n’oblige les entreprises non
cotées au Maroc a publié des comptes consolidés encore moins selon le référentiel comptable
international.
Aussi, l’application des normes IFRS au Maroc est principalement cantonnée pour le moment
aux établissements de crédit, aux entreprises publiques et aux groupes non financiers côtés.
Ces derniers, face à leur importante ouverture à l’international, ont fait majoritairement le
choix du référentiel IFRS comme langage de base de consolidation en lieu et place du
référentiel comptable marocain publié par le CNC.
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 477
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
1.2 Les effets attendus de l’adoption des normes IFRS au Maroc : Une revue de la
littérature
La littérature sur les effets de l’adoption des normes IFRS est très vaste. Les recherches
menées semblent toutefois pouvoir être classées au regard de la variété des effets des normes
IFRS (effets micro-économiques ou macro-économiques) et leur contingence (effets
d’intensité variable selon le type de système comptable ou économique).
Le présent travail de recherche tente de cerner la problématique des effets micro-économiques
de l’application des normes IFRS dans le contexte marocain. Aussi, en l’absence d’une
littérature précédente traitant de cette question, l’étude de K Ahsina (2012) s’étant attardé sur
les motivations de la transition aux IFRS des entreprises marocaines, nous allons rapprocher
ces effets en observant les conséquences des normes IFRS dans des systèmes comptables et
économiques apparentés.
Pays colonisé par la France jusqu’en 1956, le Maroc a mis en place un système comptable
fortement inspiré du système comptable français.
C’est ainsi que le Code Général de Normalisation Comptable mis en place lors de la réforme
de 1999 s’inspire fortement du PCG français de 1982 et adopte la même approche juridico-
fiscale.
Plus récemment, le référentiel de base en matière de consolidation, élaboré par le CNC en
2005, est quasiment une reprise du référentiel français applicable aux comptes consolidés
(CRC 99-02).
D’essence plus économique que juridique, le référentiel de base en matière de consolidation
continue toutefois de réserver une place centrale à la convention d’évaluation au coût
historique et au principe de prudence.
Dans ces conditions, les effets du passage des groupes marocains aux IFRS peuvent être
rapprochés des effets du passage des groupes français aux IFRS et plus fondamentalement des
pays à système comptable européen continental (Nobes, 1992).
Plusieurs travaux sur l’impact financier des normes IFRS et au-delà sa pertinence ont été
réalisées s’agissant des pays développés à système comptable européen continental.
D’un point de vue méthodologique, ces recherches sont basées sur une approche quantitative ;
L’échantillon étudié varie de 26 à 483 entreprises avec une période d’étude allant d’un an à
dix ans.
Ces travaux convergent vers le constat de l’importance des impacts micro-économiques avec
comme causes principales des impacts relevés la substitution du système d’évaluation au coût
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 478
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
historique par le nouveau système d’évaluation à la juste valeur et l’usage rendu plus
systématique d’une définition économique des actifs et passifs en lieu et place d’une
définition juridique.
Aussi, une conclusion commune de ces travaux est que l’adoption des IFRS a apporté plus de
pertinence à l’information financière que les normes nationales.
2. L’impact des normes IAS / IFRS sur l’évaluation de la performance financière.
2.1 Impact des normes IAS/IFRS sur les états financiers
Le référentiel IFRS met en exergue les points suivants d’une grande importance pour le
travail de l’analyste financier :
• C’est un référentiel établi à l’intention des marchés financiers et donc des investisseurs. En
effet, l’enjeu principal des normes IAS/IFRS est de faciliter le fonctionnement des marchés de
capitaux, cela passe par la protection des investisseurs en préservant leur confiance envers les
marchés financiers. L’idée est de pouvoir obtenir une meilleure évaluation de l’entreprise
grâce à une information financière plus transparente et plus comparable ;
• Il est fondé sur une approche reflétant la réalité de l’activité économique de l’entreprise par
rapport au marché. Le bilan de l’entreprise doit désormais refléter la valeur actuelle de ses
actifs et de ses passifs, il ne correspond plus à une évaluation historique de son patrimoine
Il est déconnecté des contraintes fiscales et des environnements juridiques de chaque pays.
De plus, trois éléments importants doivent être mis en évidence à la lecture des normes
IAS/IFRS ;
• La primauté du bilan sur le compte de résultat : L’un des objectifs majeurs des normes est de
fournir une vision plus claire de la valeur du patrimoine à partir de la simple analyse du bilan.
Le bilan est donc prédominant sur le compte résultat. Les actifs et les passifs, y compris ceux
figurant dans les normes nationales hors bilan, devront figurer à leur juste valeur ;
• La mesure de la perte de valeur et de dépréciation des actifs : les actifs doivent apparaître
pour une valeur n’excédant pas la valeur recouvrable soit la valeur la plus élevée entre le prix
de vente net d’un actif et sa valeur d’utilité. Le prix de vente net est celui que pourrait réaliser
l’entreprise en cas de vente de l’actif dans des conditions de concurrence normales.
La valeur d’utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus durant la
période d’exploitation de l’actif ainsi que des flux liés à sa sortie en fin de durée d’utilité.
• La prééminence du fond sur la forme : Il est impératif, au nom du réalisme économique, que
les transactions et autres événements soient comptabilisés en fonction de leur substance et leur
réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 479
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Dans cette perspective le référentiel IFRS consacre le point de vue économique et juridique en
permettant l’inscription dans le bilan des biens financés par crédit bail.
Notre première hypothèse s’énonce donc comme suit :
Hypothèse 1 : le passage au référentiel IFRS améliorerait la lisibilité des états financiers.
2.2- L’impact des normes IAS/IFRS sur l’analyse financière du bilan
Une distinction dans le bilan doit être obligatoirement faite entre les éléments courants et non
courants au niveau du passif et de l’actif. Néanmoins, une présentation des rubriques du bilan
par ordre de liquidité des actifs et d’exigibilité des passifs est autorisée dans le cas où cette
présentation fournit une information plus fiable et plus pertinente que la première.
Les actifs et passifs courants correspondent au cycle normal d’exploitation (un an maximum à
priori).
Un actif est qualifié de courant si :
• l’entreprise envisage de le réaliser, le vendre ou le consommer dans le cadre du cycle
d’exploitation ;
• il est détenu à des fins de transaction ou pour une courte période ;
• il représente de la trésorerie ou un équivalent de trésorerie.
Un passif est qualifié de courant si :
• il est soldé dans le cadre de l’exploitation ;
• il est réglé dans les douze mois après la date de clôture de l’exercice
Aucun format de bilan n’est imposé, la norme IAS 1 précise les postes devant apparaître au
minimum au bilan. On retrouve ci après une présentation qui permet de découvrir les normes
qui modifient la présentation des documents financiers et par suite leur analyse :
Tableau 1 : présentation du bilan comptable conformément aux normes IRFS
Actifs Montant Passifs et capitaux propres Montant
Actifs non courants Capitaux propres
Immobilisations incorporelles Capital
Immobilisations corporelles Réserves
Immeubles de placement Réserve de réévaluation
Actifs biologiques Résultats accumulés non
Autres actifs corporels distribués
Participation dans les entreprises Intérêts minoritaires
associées
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 480
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Actifs financiers non courants
Actifs d’impôts différés Passifs non courants
Actifs courants Emprunts moyen long terme
Stocks Emprunts obligataires
Actifs financiers courants Passifs financiers non courants
Clients Passifs d’impôts différés
Autres actifs courants Provisions à long terme
Trésorerie et équivalents de Obligations en matière de
trésorerie retraites
Passifs courants
Fournisseurs et autres
créditeurs
Découverts et emprunt court
terme
Passifs d’impôts courants
Provisions à court terme
Total des actifs Total des passifs et capitaux
propres
Source : Auteur
2.2.1 Les indicateurs d’analyse du bilan IFRS
Le fonds de roulement :
Il se détermine par différence entre les capitaux permanents et les actifs non courants.
Fonds de roulement = Capitaux permanents – Actif non courant
Avec :
Capitaux permanents = capitaux propres + passifs non courants
La règle de l’équilibre financier suppose l’existence d’un fonds de roulement positif. Il
représente une marge de sécurité pour l’entreprise et permet de couvrir, le cas échéant, la part
des actifs courants (hors trésorerie) non couverte par les passifs courants (hors trésorerie).
Le besoin en fonds de roulement (BFR)
Le besoin en fonds de roulement est égal aux actifs courants (hors trésorerie) diminués des
dettes courantes (hors trésorerie).
BFR = (Actifs courant – trésorerie) – Dettes courantes (hors trésorerie)
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 481
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
La trésorerie nette :
Elle se définit de deux façons :
• Elle se détermine par différence entre le FR et le BFR. Elle constitue une « résultante »
assurant l’égalité entre le total des emplois et ressources.
FR – BFR = Trésorerie nette
Elle constitue également la différence entre la trésorerie active (trésorerie et équivalents de
trésorerie) et la trésorerie passive (concours bancaires courants et découverts).
Trésorerie nette = Trésorerie active - Trésorerie passive
2.2.2 L’analyse du bilan par les ratios
Ratio de liquidité réduite :
(Actifs courants – stocks et encours) / Passifs courants
Exprimant l’aptitude de l’entreprise à honorer ses engagements à court terme au moyen de ses
actifs disponibles et réalisables à court terme. Ce ratio doit être au minimum de 70%.
Ratio d’endettement global :
Capitaux propres / (Capitaux propres + Passifs courants ou non)
Qui mesure la capacité d’endettement total de l’entreprise. Ce ratio doit dépasser 1/3.
Ratio d’endettement à terme :
Capitaux propres / (Capitaux propres + Passifs non courants)
Ce ratio mesure la capacité d’endettement à plus d’un an de l’entreprise. Il doit être supérieur
à 1/2.
Délai de remboursement des passifs non courants :
Passifs non courant / CAF annuelle
Il doit être inférieur à 3 ans pour être acceptable selon les établissements financiers.
Cette modification de présentation du bilan ainsi que de ces indicateurs d’analyse nous
conduit à la formulation de l’hypothèse suivante :
Hypothèse 2 : le passage aux IFRS permettrait une meilleure évaluation de la situation
financière des entreprises.
2.3 L’impact des normes IAS/IFRS sur l’analyse financière du compte de résultat
Le compte de résultat est un état qui récapitule les charges et les produits réalisés par
l’entreprise au cours de l’exercice. Il permet d’obtenir, par différence, le résultat net de
l’exercice.
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 482
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Dans la philosophie des normes IAS/IFRS, le compte de résultat est secondaire par rapport au
bilan, car il ne fournit pas une évaluation complète de la performance de l’entreprise.
Plusieurs éléments sont inscrits directement dans les capitaux propres (réévaluation, écart de
conversion, …). Une étude globale de la performance nécessite le recours à l’état de variation
des capitaux propres.
2.3.1Une évolution majeure : l’introduction de la notion de produits des activités
courantes
Selon les normes IAS/IFRS, le compte de résultat peut être présenté par nature ou par
fonction. L’élément nouveau concerne l’abandon de la notion de « chiffre d’affaires »
remplacée par la notion de « produits des activités ordinaires ».
Les produits des activités courantes sont définis par la norme IAS 18, ils comprennent les
ventes de biens, les prestations de services, les intérêts, les redevances et les dividendes. C’est
donc une conception plus large que les produits d’exploitation du CPC du plan comptable
marocain, car ils regroupent notamment les produits financiers.
Le concept des activités ordinaires remplace donc la distinction traditionnelle
exploitation/financier/non courant. En matière d’analyse financière, l’analyste devra ainsi
étudier attentivement les notes annexes pour analyser les différentes composantes du revenu
global.
Le résultat non courant ou exceptionnel disparaît, c’est le même cas pour le résultat financier.
En effet, seules les charges financières apparaissent mais séparément dans le compte de
résultat afin de faciliter le calcul du coût de l’endettement.
Le résultat opérationnel (résultat des activités ordinaires) occupe une place importante dans le
compte résultat IFRS.
Il est à préciser que les produits des activités ordinaires sont retenus pour leur juste valeur.
En effet en cas d’encaissement différé, il est nécessaire de procéder à l’actualisation des flux
de trésorerie futurs.
2.3.2 L’analyse financière de l’activité et de la rentabilité
L’analyse financière du compte de résultat IFRS est moins facile que ne l’est celle du CPC
normes marocaines. L’analyste financier est obligé d’utiliser des informations
complémentaires fournies par les notes annexes pour effectuer une analyse plus détaillée.
Rentabilité économique :
Résultat opérationnel /
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 483
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Actifs non courants + BFR + trésorerie et équivalents de trésorerie
On peut retenir au dénominateur les capitaux propres + passifs non courants + découverts
bancaires
Rentabilité financière
Résultat net consolidé / Capitaux propres part groupe et intérêt minoritaires de début
d’année
Exprime la rentabilité des actionnaires du groupe. Elle doit en moyenne dépasser 15%.
Le poids des charges financières
Coût de l’endettement financier / produits des activités ordinaires
Ne doit pas dépasser en moyenne 3%.
Le taux d’intérêt moyen supporté par l’entreprise :
Coût de l’endettement financier / Passifs non courants rémunérés (y compris découverts
bancaires)
2.4 Les autres tableaux normalisés par le référentiel IFRS
Il s’agit du tableau de variation des capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie très
utiles pour l’analyse financière.
2.4.1 Le tableau de variation des capitaux propres
C’est un tableau qui explique le passage des capitaux propres d’ouverture de l'exercice
comptable aux capitaux propres de clôture de l'exercice comptable. En d'autres termes, le
tableau de variation des capitaux propres doit retranscrire les mouvements de capitaux qui ont
eu lieu au cours de l'exercice comptable concerné.
Il permet de voir quels sont les profits et les pertes (ex : les réévaluations des immobilisations)
non comptabilisés dans le compte de résultat.
Ce tableau recense essentiellement :
Les montants de transactions sur le capital avec les actionnaires et les distributions ;
Les mouvements sur les résultats non distribués (accumulés en réserves) ;
Les variations spécifiques aux capital social, prime d’émission, réserves, expliquant la
valeur comptable au début et à la fin de l’exercice.
2.4.2 Le tableau des flux de trésorerie
Ce document retrace les flux de trésorerie générés et employés au cours de chaque exercice et
explique ainsi la variation de trésorerie constatée au bilan. Il procure une information nouvelle
par rapport au bilan et au compte de résultat.
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 484
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
Le tableau des flux de trésorerie explique la variation de trésorerie en présentant les flux de
trésorerie intervenus sur la période selon la nature des activités :
opérationnelles ;
d’investissement ;
et de financement.
Cette nouvelle présentation du bilan nous conduit à la formulation de l’hypothèse suivante :
Hypothèse 3 : le passage aux IFRS permettrait une meilleure évaluation de la performance
financière des entreprises.
3. L’impact des normes IAS / IFRS sur le pilotage de la performance financière.
Théorie positive de la comptabilité comme cadre d’analyse:
La théorie positive de la comptabilité représente le courant dominant pour expliquer les choix
comptables des firmes, elle est un passage nécessaire pour la compréhension des décisions
comptables prises lors de la transition au référentiel comptable IFRS pour les grands groupes
marocain.
La Théorie Politico Contractuelle (TPC, qualifiée par extension : théorie positive de la
comptabilité) est le cadre de réflexion le plus utilisé dans les recherches sur les choix
comptables. Pour DUMONTIER et RAFFOURNIER (1999) ce courant a pour but
d’expliquer les décisions comptables à partir des relations d’agence et des coûts politiques
auxquels les entreprises sont soumises. CASTA (2000) estime que « la théorie positive de la
comptabilité tend à expliquer et à prédire le comportement des producteurs et des utilisateurs
de l’information comptable, dans le but ultime d’éclairer la genèse des états financiers ».
Ainsi la TPC ne vise pas à montrer ce qu’il faut faire mais à comprendre et expliquer les
pratiques observées afin d’élaborer des lois de comportement. La méthodologie de la théorie
positive consiste à développer des hypothèses sur les facteurs qui influencent les pratiques
comptables et à tester empiriquement leur validité (BELKAOUI (1992)). Selon WATTS et
ZIMMERMAN (1990) la recherche positive en comptabilité est guidée par la recherche de
régularités empiriques et apporte des explications à celles-ci. Les études relevant de ce
courant « étudient statistiquement les relations entre tel « choix comptable » fait par les
entreprises et telle caractéristique de la firme » (CHIAPELLO (2005)). La théorie politico
contractuelle veut par son ancrage dans les données empiriques éviter les jugements de
valeurs et les spéculations théoriques (HOARAU (2001)). La TPC est fondée sur le postulat
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 485
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
que les dirigeants, les actionnaires, les régulateurs et les hommes politiques sont rationnels et
par conséquent tentent de maximiser leur utilité, celle-ci étant directement liée à leur
rémunération et donc à leur richesse (BELKAOUI (1992)). Pour synthétiser, nous pouvons
dire qu’en pratique la théorie politico contractuelle est caractérisée par deux éléments :
L’identification du comportement des acteurs qui jouent un rôle en matière
comptable, il s’agit des dirigeants, mais aussi des investisseurs, ou des créanciers
La formulation des hypothèses de comportement des acteurs qui reposent sur une
conception contractualiste de l’entreprise :
L’entreprise est un nœud de contrats conclus entres différentes parties
prenantes afin de réduire leurs divergences d’intérêts
Ces différentes parties (actionnaires, créanciers, managers) cherchent à
maximiser les revenus qu’ils tirent de l’entreprise
Il existe une opposition latente entre les managers (qui disposent de la
maîtrise de la comptabilité) et les autres parties prenantes (qui n’ont pas
la maîtrise de la comptabilité).
COLASSE (2000) met en évidence deux niveaux d’études : d’une part les instances de
normalisation, et d’autre part les entreprises lorsque le normalisateur laisse à celle-ci la
possibilité de choisir entre plusieurs possibilités. L’observation, de l’application des normes à
options, s’inscrit dans cette seconde voie de recherche.
La théorie positive de la comptabilité représente ainsi, le courant dominant pour expliquer les
choix comptables des firmes, elle est un passage nécessaire pour la compréhension des
décisions comptables prises lors de la transition au référentiel comptable IFRS pour les
grandes entreprises. Conscient de son pouvoir explicatif fort mais aussi de ses limites, nous
souhaitons mesurer les capacités explicatives de la théorie positive de la comptabilité face au
cas particulier de l’adoption de la norme IFRS au sein des grandes entreprises marocaines et
notamment, l’incident de ce passage sur le pilotage de la performance financière au sein des
groupes marocains cotés. Nous formulons ainsi l’hypothèse suivante :
Hypothèse 4 : le passage aux normes IFRS contribuerait à des décisions plus pertinentes
qu’avec les normes comptables marocaines
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 486
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
CONCLUSION :
Les états financiers en normes IFRS visent à fournir une meilleure représentation du
patrimoine de l’entreprise. Le référentiel IFRS accorde une primauté à la vision économique
du bilan. Il consacre la notion de « juste valeur », il pourra donc y avoir réévaluation de
certains actifs, mais également dépréciation. L’objectif étant de procéder annuellement à un
test de dépréciation des actifs pour approcher au maximum la valeur de marché.
S’agissant du compte résultat, il est relégué au second ordre et l’élément nouveau concerne
l’introduction de la notion de « produits des activités courantes ». Il fait également ressortir
certaines informations nouvelles : le résultat opérationnel, le coût de l’endettement financier
net, etc.
Le référentiel IFRS a aussi normalisé certains états financiers très utiles pour l’analyse
financière, il s’agit de l’état de variation des capitaux propres et du tableau des flux de
trésorerie.
Le travail d’évaluation et de pilotage de la performance financière se trouve donc
complètement modifié, le rendant à la fois plus riche et plus complexe.
Plus riche par la diversité et la profondeur des informations à exploiter.
Plus complexe par la multitude des choix offerts pour la comptabilisation de certaines
opérations. A cet égard, les états financiers en normes IFRS ne dispensent pas les analystes
financiers de faire des retraitements pour dégager l’information dont ils ont besoin. Pire, ils
sont obligés d’opérer, peut-être, plus de retraitements en raison de la diversité des choix
comptables (option pour la juste valeur ou option pour le coût par exemple).
Bibliographie
- AHSINA K. & al (2014). L’impact de l’adoption des IFRS sur les sociétés cotées à la
bourse de Casablanca : une étude exploratoire.
- AHSINA K. TAOUAB O. (2017) Y’a-t-il vraiment un besoin pour changer de référentiel
comptable au Maroc? la prétendue value relevance des normes comptables IFRS
- BOUKARI, M., RICHARD, J. (2007). Les incidences comptables du passage des
groupes français cotés aux IFRS. Comptabilité contrôle audit, Thématique, 155-170.
- BACHY B., SION M. (2012). 2ème édition « Analyse financière des comptes consolidés
Normes IFRS ».
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 487
Revue Internationale des Sciences de Gestion
ISSN: 2665-7473
Numéro 5 : Octobre 2019
- EL HAMZA M. (2008). Les déterminants de l’adoption des normes IFRS par les sociétés
cotées à la bourse de Casablanca
- Lenormand G. et al. , (2012). “ LES IAS/IFRS, Bilan et perspective, ” Revue française de
gestion, n° 222, p. 55-66.
- ELATIFE H., (2012) “Passage aux normes comptables internationales IAS/IFRS : Essai
d’observation et de compréhension des choix effectués par les sociétés cotées à la Bourse
des Valeurs de Casablanca, ” Thèse de doctorat.
- HAOUDI K. (2015). Passage aux normes IFRS au Maroc : fondements théoriques, intérêt
et enjeux
- ISSIAGA T. (2011), étude des liens entre l’appropriation des normes IAS/IFRS et les
dimensions organisationnelles et managériales des services comptables, Thèse de
doctorat
- TRABELSI R. (2014). Vers un dispositif d’appréciation de la pertinence des IFRS dans
un contexte pré- Implémentation International.
Hosting by Copernicus International Index www.revue-isg.com Page 488
Vous aimerez peut-être aussi
- Adoption Des Normes Comptables Internationales Ifrs Au Maroc Essai D'analyse Des Enjeux Et Des Contraintes de Mise en Oeuvre Pour Le Secteur Immobilie PDFDocument21 pagesAdoption Des Normes Comptables Internationales Ifrs Au Maroc Essai D'analyse Des Enjeux Et Des Contraintes de Mise en Oeuvre Pour Le Secteur Immobilie PDFnetflix tigmi100% (1)
- IfrsDocument10 pagesIfrsanon-442325100% (2)
- Traité de gestion de portefeuille, 5e édition actualisée: Titres à revenu fixe et produits structurés - Avec applications Excel (Visual Basic)D'EverandTraité de gestion de portefeuille, 5e édition actualisée: Titres à revenu fixe et produits structurés - Avec applications Excel (Visual Basic)Pas encore d'évaluation
- Impact IFRS Sur Analyse Fin 2Document51 pagesImpact IFRS Sur Analyse Fin 2Latifa El Hassnaoui80% (5)
- Acquisition, financement et cessions d'entreprises: Instruments financiers, structures d'acquisition et mécanismes de contrôle sous l'angle fiscal, comptable et financierD'EverandAcquisition, financement et cessions d'entreprises: Instruments financiers, structures d'acquisition et mécanismes de contrôle sous l'angle fiscal, comptable et financierPas encore d'évaluation
- Le Passage Aux IFRSDocument25 pagesLe Passage Aux IFRSAbdel Khalek BelhajPas encore d'évaluation
- Les Normes IFRSDocument13 pagesLes Normes IFRSHoussamPas encore d'évaluation
- Ias IfrsDocument5 pagesIas IfrsSimo EL KhomssiPas encore d'évaluation
- Ias/ifrsDocument28 pagesIas/ifrsToufik ZeroukPas encore d'évaluation
- Cours IfrsDocument57 pagesCours IfrsHamza100% (1)
- IFRSDocument11 pagesIFRSHassanAmenou100% (2)
- IfrsDocument69 pagesIfrs25845100% (2)
- PFEDocument79 pagesPFEyoussrita100% (2)
- Passage Aux Normes IFRS Maroc With Cover Page v2Document14 pagesPassage Aux Normes IFRS Maroc With Cover Page v2Aicha Ben TaherPas encore d'évaluation
- Mémoire IfrsDocument77 pagesMémoire Ifrsmendoza6967% (6)
- Difficultés de Passage Du CGNC Aux Normes IFRSDocument24 pagesDifficultés de Passage Du CGNC Aux Normes IFRSNihad Benali100% (1)
- Rapport Comparaison IFRS Et CGNCDocument14 pagesRapport Comparaison IFRS Et CGNCFATIMA EL OMARIPas encore d'évaluation
- Pfe IfrsDocument45 pagesPfe IfrsHalichou wijdanePas encore d'évaluation
- PFE DéfinitifDocument134 pagesPFE DéfinitifsimoPas encore d'évaluation
- Memoire Sur Les Normes Comptables InternationnalesDocument63 pagesMemoire Sur Les Normes Comptables InternationnalesAmine Belcadi100% (3)
- Pfe RésuméDocument25 pagesPfe Résuméhamza belfqihPas encore d'évaluation
- Les Différences Et Les Similitudes Entre Les Référentiels Comptables Normes Marocaines, IAS, UDocument86 pagesLes Différences Et Les Similitudes Entre Les Référentiels Comptables Normes Marocaines, IAS, USouhair Bouallala89% (9)
- L'Apport Des Normes IFRS IAS Au Nouveau Plan Comptable Des Caisses de RetraiteDocument55 pagesL'Apport Des Normes IFRS IAS Au Nouveau Plan Comptable Des Caisses de RetraiteMohammed EzzouakPas encore d'évaluation
- Maroc-Le Passage Aux Normes Ias-Ifrs Et Leur ImpactDocument70 pagesMaroc-Le Passage Aux Normes Ias-Ifrs Et Leur ImpactKingo ZizoPas encore d'évaluation
- Le Mini-Projet-Processus Et Cadre Conceptuel Des Normes IAS IFRSDocument26 pagesLe Mini-Projet-Processus Et Cadre Conceptuel Des Normes IAS IFRSŽahra Ňah Id100% (1)
- La Comptabilite Des Produits Financiers Islamiques 1Document12 pagesLa Comptabilite Des Produits Financiers Islamiques 1Hatim BenchakrounPas encore d'évaluation
- L Impact Des Nouvelles Normes IFRS Sur La Qualite de L Information FinanciereDocument87 pagesL Impact Des Nouvelles Normes IFRS Sur La Qualite de L Information FinanciereJocelyn Kabran100% (1)
- Ifrs 9Document20 pagesIfrs 9AminaAlouani100% (1)
- Synthèse Sur La Normalisation Comptable Au MAROCDocument5 pagesSynthèse Sur La Normalisation Comptable Au MAROCyoussrita75% (4)
- (Taha D+ Kamal D) PFE (Impact Des Normes IFRS Sur Les États FinancièresDocument51 pages(Taha D+ Kamal D) PFE (Impact Des Normes IFRS Sur Les États FinancièresTaha Can90% (10)
- Memoire 2Document91 pagesMemoire 2Sanae Mahraz0% (2)
- Mémoire SurDocument88 pagesMémoire SurHanan Mrfc100% (1)
- Les Normes IAS IFRS Et Les Normes Marocaines - Etudes Et RetraitementsDocument92 pagesLes Normes IAS IFRS Et Les Normes Marocaines - Etudes Et RetraitementsSouad Baya89% (72)
- Lepassageauxnormesias Ifrs 121220150024 Phpapp02Document70 pagesLepassageauxnormesias Ifrs 121220150024 Phpapp02Imane Zouhouredine100% (1)
- Application Des Normes Ifrs en TunisieDocument4 pagesApplication Des Normes Ifrs en TunisieHaythem TrabelsiPas encore d'évaluation
- Rapport Stage IfrsDocument93 pagesRapport Stage IfrsFatiha Arsmouk100% (1)
- Normes Comptables InternationalesDocument53 pagesNormes Comptables InternationalesSarah Nassiri100% (3)
- La Consolidation Au Sein de BMCE BankDocument44 pagesLa Consolidation Au Sein de BMCE Banka_abdou10100% (2)
- 1 - Introduction Aux Normes IAS - IFRSDocument59 pages1 - Introduction Aux Normes IAS - IFRSGlennJeffreyPas encore d'évaluation
- Normes Ifrs & Comptabilite TunisienneDocument36 pagesNormes Ifrs & Comptabilite TunisienneAMBINONNOSS100% (1)
- La Com Fin Banque PopulaireDocument27 pagesLa Com Fin Banque Populaireencgland0% (1)
- Rapport La Norme Ifrs 12Document23 pagesRapport La Norme Ifrs 12Jouh123Pas encore d'évaluation
- Power Point La Finance IslamiqueDocument37 pagesPower Point La Finance Islamiquekata brh100% (1)
- Memoire IFRSDocument85 pagesMemoire IFRSSaray El KhatibPas encore d'évaluation
- Impact Des IFRS Sur Les États FinanciersDocument8 pagesImpact Des IFRS Sur Les États FinanciersSarah Hope TraorePas encore d'évaluation
- Rapport IFRS s10 PDFDocument73 pagesRapport IFRS s10 PDFEnseignant Universiataire0% (1)
- Resume de La Norme Ias 1Document4 pagesResume de La Norme Ias 1Arou N'a100% (2)
- Cours IFRS-Master CCAF-1er Envoi PDFDocument95 pagesCours IFRS-Master CCAF-1er Envoi PDFZineb TahirPas encore d'évaluation
- La Comptabilite InternationaleDocument47 pagesLa Comptabilite InternationaleAbdessalamBoulaajoulPas encore d'évaluation
- Les Incidences Fiscales Du Passage Aux Normes IASIFRS Sur Les Entreprises MarocainesDocument64 pagesLes Incidences Fiscales Du Passage Aux Normes IASIFRS Sur Les Entreprises MarocainesSimo EL KhomssiPas encore d'évaluation
- Ias 11Document15 pagesIas 11Nabil Amarass100% (1)
- Theme 8 La Consolidation Et L IFRS 12Document64 pagesTheme 8 La Consolidation Et L IFRS 12Maroua BourhimPas encore d'évaluation
- Comparaison Ifrs CGNCDocument68 pagesComparaison Ifrs CGNCAhmed Char100% (2)
- NormeDocument17 pagesNormeIlyass MatraouiPas encore d'évaluation
- 2017-483-Article Text-1815-1-10-20200827Document17 pages2017-483-Article Text-1815-1-10-20200827BAAMOUDIPas encore d'évaluation
- Normes IFRSDocument4 pagesNormes IFRSKamalPas encore d'évaluation
- Synthèse Des ThèmesDocument170 pagesSynthèse Des ThèmesYasser LotfyPas encore d'évaluation
- CGNC IfrsDocument4 pagesCGNC IfrsIlyass MatraouiPas encore d'évaluation
- Le Modele TrinomialDocument55 pagesLe Modele TrinomialMoad Ennajy100% (1)
- TH3871Document333 pagesTH3871Moad EnnajyPas encore d'évaluation
- TH4384Document411 pagesTH4384Moad EnnajyPas encore d'évaluation
- CHAPITREIII StateoftheartofBlockchainDocument45 pagesCHAPITREIII StateoftheartofBlockchainMoad EnnajyPas encore d'évaluation
- F03.00 NG PresentationDocument2 pagesF03.00 NG PresentationNawfel FroujaPas encore d'évaluation
- IAS 36 - FicheDocument8 pagesIAS 36 - Fichefouad cherkaouiPas encore d'évaluation
- Comptabilite GeneraleDocument106 pagesComptabilite GeneraleBryce WilliamsPas encore d'évaluation
- Lancer Un Nouveau ProduitDocument41 pagesLancer Un Nouveau Produitkanded medjPas encore d'évaluation
- Fonction:: Chef Produit MarketingDocument375 pagesFonction:: Chef Produit MarketingtheashesladyPas encore d'évaluation
- 2016 - partieCONSOCorrigé ISCAEDocument56 pages2016 - partieCONSOCorrigé ISCAENabil KarouitePas encore d'évaluation
- Mega Rep PDFDocument31 pagesMega Rep PDFKONAN EDOUARD YAOPas encore d'évaluation
- Comptes Annuels Et Autres Documents À Déposer en Vertu Du Code Des SociétésDocument14 pagesComptes Annuels Et Autres Documents À Déposer en Vertu Du Code Des SociétéstotPas encore d'évaluation
- Boukhari HachemDocument7 pagesBoukhari HachemHouda LaroussiPas encore d'évaluation
- TP Fidelisation STDocument3 pagesTP Fidelisation STAlami FatiPas encore d'évaluation
- 4 Exposé Sur La GIRH-1Document29 pages4 Exposé Sur La GIRH-1Meryem KrimiPas encore d'évaluation
- Résumé de Technique de VentDocument4 pagesRésumé de Technique de VentYounes Phone100% (3)
- Cadre Conceptuel PR DjeghabaDocument83 pagesCadre Conceptuel PR DjeghabaSaidi AssiaPas encore d'évaluation
- Auditeur JuniorDocument10 pagesAuditeur JuniorIvan Ivan Ngomo Nang100% (1)
- TD2 CPCdocxDocument6 pagesTD2 CPCdocxparkmelii78Pas encore d'évaluation
- 2021 Intro Au DR Et À La Fisca - Exercices IS - Corrections V2Document25 pages2021 Intro Au DR Et À La Fisca - Exercices IS - Corrections V2Jason GautheroPas encore d'évaluation
- Guide Ope Pat Tome 2 Fiche13Document4 pagesGuide Ope Pat Tome 2 Fiche13Pascal MariePas encore d'évaluation
- CHAPITRE III Marché de L'entrepriseDocument15 pagesCHAPITRE III Marché de L'entrepriseAsma HelaliPas encore d'évaluation
- PFE Leader FoodDocument101 pagesPFE Leader FoodChaimae LhdiriPas encore d'évaluation
- Résumé Partie 1 Kotler Comprendre Le Marketing ManagementDocument5 pagesRésumé Partie 1 Kotler Comprendre Le Marketing ManagementMohamed Achraf NAHIDPas encore d'évaluation
- Ex2 Exercices Comptabilité Et AuditDocument31 pagesEx2 Exercices Comptabilité Et AuditAhmed CHARIF100% (1)
- SNC Batillat-2021-2022-Rapport (PF)Document25 pagesSNC Batillat-2021-2022-Rapport (PF)Démarches Visa d'étudePas encore d'évaluation
- Déterminer Le Taux D'amortissement: Frais de ConstitutionDocument4 pagesDéterminer Le Taux D'amortissement: Frais de ConstitutionMoaad El BoghabiPas encore d'évaluation
- Market SensoDocument10 pagesMarket SensoDaouda MagassoubaPas encore d'évaluation
- Exercice 1Document4 pagesExercice 1Gharbi RaedPas encore d'évaluation
- Le Diagnostic Export Le Diagnostic ExportDocument9 pagesLe Diagnostic Export Le Diagnostic ExportovkukikPas encore d'évaluation
- Rapport Final Evaluation Des EntreprisesDocument66 pagesRapport Final Evaluation Des EntreprisesHamiYoussef100% (1)
- 1.2. Les Apports Du Capital Pendant La Création. 1.2.1. Règles JuridiquesDocument19 pages1.2. Les Apports Du Capital Pendant La Création. 1.2.1. Règles JuridiquesAyoub officielPas encore d'évaluation
- BP Mis À JourDocument52 pagesBP Mis À JourMarco CarosiniPas encore d'évaluation
- Calcul Économiquefinancier FACEJ VPDocument24 pagesCalcul Économiquefinancier FACEJ VPDabo Nandy BarryPas encore d'évaluation
- L'analyse technique facile à apprendre: Comment construire et interpréter des graphiques d'analyse technique pour améliorer votre activité de trading en ligne.D'EverandL'analyse technique facile à apprendre: Comment construire et interpréter des graphiques d'analyse technique pour améliorer votre activité de trading en ligne.Évaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (6)
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Le Scalping est Amusant!: Partie 1: Le trading rapide avec Heikin AshiD'EverandLe Scalping est Amusant!: Partie 1: Le trading rapide avec Heikin AshiÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Investir pour les débutants - Démarrer en 10 étapes facilesD'EverandInvestir pour les débutants - Démarrer en 10 étapes facilesÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (2)
- 7 Techniques Pour Augmenter Vos Revenus: Rentabilisez vos passions, Testez vos idées et Lancez votre business sans risqueD'Everand7 Techniques Pour Augmenter Vos Revenus: Rentabilisez vos passions, Testez vos idées et Lancez votre business sans risqueÉvaluation : 2.5 sur 5 étoiles2.5/5 (3)
- Agile Practice Guide (French)D'EverandAgile Practice Guide (French)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Comment transformer 5000€ en un millionD'EverandComment transformer 5000€ en un millionÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Maîtriser l'Art de la Lettre de Motivation: ...et décrocher plus d'entretiens d'embaucheD'EverandMaîtriser l'Art de la Lettre de Motivation: ...et décrocher plus d'entretiens d'embaucheÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- Le trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsD'EverandLe trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (19)
- Comment Développer Votre Entreprise de Marketing de Réseau en 15 Minutes Par Jour : Rapide ! Efficace ! Fantastique !D'EverandComment Développer Votre Entreprise de Marketing de Réseau en 15 Minutes Par Jour : Rapide ! Efficace ! Fantastique !Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (8)
- Guide de FOREX Trading pour Débutants: Votre Façon de Devenir Un Day TraderD'EverandGuide de FOREX Trading pour Débutants: Votre Façon de Devenir Un Day TraderÉvaluation : 2.5 sur 5 étoiles2.5/5 (3)
- Le Scalping Est Amusant! 4: Partie 4 : Trader en état de flowD'EverandLe Scalping Est Amusant! 4: Partie 4 : Trader en état de flowÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Le money management facile à apprendre: Comment tirer profit des techniques et stratégies de gestion de l'argent pour améliorer l'activité de trading en ligneD'EverandLe money management facile à apprendre: Comment tirer profit des techniques et stratégies de gestion de l'argent pour améliorer l'activité de trading en ligneÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (3)
- Le plan marketing en 4 étapes: Stratégies et étapes clés pour créer des plans de marketing qui fonctionnentD'EverandLe plan marketing en 4 étapes: Stratégies et étapes clés pour créer des plans de marketing qui fonctionnentPas encore d'évaluation
- Comment trader dans un range: Négociez sur le marché le plus intéressant du mondeD'EverandComment trader dans un range: Négociez sur le marché le plus intéressant du mondeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Instagram Marketing Excellence: Découvrez Les Toutes Dernières Stratégies Pour Dominer Instagram Et Booster Vos Ventes!D'EverandInstagram Marketing Excellence: Découvrez Les Toutes Dernières Stratégies Pour Dominer Instagram Et Booster Vos Ventes!Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)
- Le dropshipping pour les débutants: Comment vivre de sa boutique E-commerce sans stock, sans investissement et sans expérience.D'EverandLe dropshipping pour les débutants: Comment vivre de sa boutique E-commerce sans stock, sans investissement et sans expérience.Évaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (5)
- Le marketing d'affiliation en 4 étapes: Comment gagner de l'argent avec des affiliés en créant des systèmes commerciaux qui fonctionnentD'EverandLe marketing d'affiliation en 4 étapes: Comment gagner de l'argent avec des affiliés en créant des systèmes commerciaux qui fonctionnentPas encore d'évaluation
- La communication professionnelle facile à apprendre: Le guide pratique de la communication professionnelle et des meilleures stratégies de communication d'entrepriseD'EverandLa communication professionnelle facile à apprendre: Le guide pratique de la communication professionnelle et des meilleures stratégies de communication d'entrepriseÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Stratégie d'Investissement en Crypto-monnaie: Comment Devenir Riche Avec les Crypto-monnaiesD'EverandStratégie d'Investissement en Crypto-monnaie: Comment Devenir Riche Avec les Crypto-monnaiesÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (11)