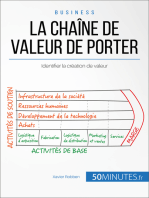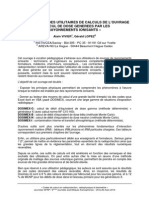Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Theorie Des Organisations
Theorie Des Organisations
Transféré par
KhalilLatrachTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Theorie Des Organisations
Theorie Des Organisations
Transféré par
KhalilLatrachDroits d'auteur :
Formats disponibles
UE 5.
309
Thorie des organisations
Diaporama1
Thories des Organisations
Ou
comment ne pas se contenter de
limmdiatement visible
Contrat des exposs en TP
Expos de 12 minutes (+/- 1).
Si possible mdiatis mais toujours la recherche dune coute
optimale. Donner lessentiel du contenu et surtout pas le superflu
Sance de cadrage : le 16/09/05
1re sance exposs : 04/11/05
18/11/05
25/11/05
02/12/05
09/12/05
3heures /2 groupes = 1h30 pour 20 tudiants chaque sance.
20 exposs raison de 4 par sance soit 30 minutes de complments
de cours.
Liste des thmes dexposs possibles
1. Le principe de Peter (pourquoi tout va toujours mal).
2. Le compagnonnage.
3. Taylorisme et fordisme (OST).
4. Mac Donald ou le taylorisme moderne.
5. Le fayolisme (OAT) ou l administration telle que rve par Max Wber.
6. Leffet Hawthorn, le virage des relations humaines au travail.
7. La dimension humaine de lentreprise Mac Grgor
8. La satisfaction au travail (Herzberg, 1971, le travail et la nature de l homme).
9. La pyramide des besoins de Maslow.
10. La Thorie (moderne) de la Contingence de Lorch et Laurence.
11. Le toyotisme.
12. Les cercles de qualit..
13. Lapproche sociotechnique. [O. Orsterman, quel travail pour demain ? 1994]
14. La participation ou le management participatif.
15. Michael PORTER
16. Lacteur et le systme => lanalyse stratgique Michel Crozier.
17. Le pouvoir et la rgle de Erhard Friedberg (1994).
18. Le rseau
19. Lapproche des structures de H.Mintzberg [un travail pour deux exposs => 2 fois 2]
20. Le chmage.
21.la thorie des conventions de laurent Thvenot et Luc Botanlski [Mondes et accords].Les conomies de la grandeur
22. Le syndicalisme
23. La flexibilit.
24. Les concepts clefs de lconomie/organisations
Premire sance de TP : thorie des organisations.
Le 04/11/05
1. Le compagnonnage..
2. Taylorisme et Fordisme.
3. Mac Donald.
4. Le Fayolisme.
Deuxime Sance de TP : Thorie des
organisation
Le 18/11/05
5. Leffet Hawthorne.
6. Mac Grgor :
7. La satisfaction au travail (Herzberg) :
8. Le toyotisme :
Exposs de la sance du 25/11/05
9. Cercles de qualit :
10. Management participatif
11. La flexibilit.
12. M. Porter :
Sance de Travaux Pratiques du 02/12/05
13. Le pouvoir et la rgle (Friedberg)
14. Le syndicalisme
15. Le chmage
16. Le principe de Peter.
Sance de travaux pratiques du 09/12/05
17. Maslow (Minsberg 1).
18. Thorie de la contingence (Minsberg 2).
19. Lorganisation comme un rseau.
Lorganisation sociale
Une ralisation ancre dans le concret qui articule entre eux
des moyens humains et matriels ou symboliques pour
atteindre des buts communs.
Ces buts sont des productions au sens le plus large
possible. Cela peut aller de la production de services la
production de biens de consommation.
Lorganisation est une unit en elle-mme (un hpital,une
cole,un rectorat, une UFR, une entreprise, une mairie, un
rgiment,un club sportif).
Elle peut faire partie dune chane dorganisations.
Lorganisation sociale (suite)
Il existe en son sein des rapports
dinterdpendance entre les diffrents lments
qui la constituent. Il sagit donc dune unit
complexe qui met en systme des phnomnes:
- dordre opratoire (ou fonctionnel comme
par exemple la division et le partage des tches)
et des phnomnes :
- dordre social (comme la division sociale du
travail).
7 sept impratifs sont communs aux
organisations sociales (Y.F. Livian, 1998).
1) Espace dune division du travail articulant missions, buts, fonctions de chaque
membre ou groupe de membres.
2) Lieu de coordination collective des fonctions selon un ordre tabli.
3) La coordination des actions de chacun est finalise sur des buts clairs et partags.
4) Laction collective est volontaire sur la base de dcisions plus ou moins ngocies
5) Lorganisation possde des rgles et un systme (+ ou-) de contrle de celles-ci.
6) La stabilit organisationnelle doit permettre un changement pour tre prenne.
7) Organisation lieu daction et d innovation mais aussi de cration de
reprsentations individuelles et sociales.
Lorganisation sociale un lieu social
mdiationnel entre lindividuel et le social
Linstitution. L ETAT
Lorganisation Groupe social plus ou
(lentreprise, la firme) moins important.
Le groupe. Souvent un groupe
restreint
Lindividu/acteur
Lorganisation, la firme, lentreprise
Lentreprise cest le modle organisationnel le plus
tudi. Aujourdhui cest lentreprise capitaliste : la
firme (mise en valeur des capitaux dans un
environnement caractris par la concurrence sur le
march des produits et le march du travail).
1. Un centre de comptabilit.
2. Une activit fixe et continue.
3. Lieu de travail individuel et collectif.
4. Centre de dcision autonome.
5. Fonde sur la prise de risque.
Confusion organisation et
institution
Linstitution peut avoir deux sens possibles.
1) Cadre global dans lequel se droule une
activit conomique et sociale.
2) Ce qui fonde une socit et lui permet de
perdurer. Ensemble de repres aux fonctions
dorientation et de rgulation sociale. Ici cest
un niveau politique.
Traiter des organisations cest aussi se prononcer sur leur efficacit.
Lvaluation de lefficacit est rendue difficile par la diversit des buts poursuivis par l orga-
nisation. Difficult dautant augmente quelle peut tre le fait des diffrentes parties prenantes
lorganisation.
1) les buts de production : fournir des produits et des services adapts ses
clients ou marchs.
2) Les buts de socit : rpondre un besoin public, un intrt gnral.
3) Les buts systmiques : faire fonctionner lorganisation de manire
ce quelle puisse atteindre ses buts principaux (recherche de stabilit, de contrle).
4) Les buts drivs : viser dautres buts que latteinte des objectifs de
production permet dobtenir de surcrot des buts culturels, politiques ou sociaux
Diffrents buts sont gnralement co-prsents. Pour comprendre une organisation il convient
de ne pas sarrter aux seuls buts officiellement dclars. Les buts officiels sont de temps en
temps considrer plutt comme des rationalisations de buts plus opratoires non mis en avant.
La pluralit des parties prenantes est aussi prendre en considration quand
il va sagir dvaluer de lefficacit dune organisation.
Lactionnaire, le client, le salari
En fait ils peuvent tre nombreux et se regrouper en deux catgories .
Les parties prenantes externes et les parties prenantes internes.
Clients/usagers Actionnaire
Actionnaires fournisseurs
Fournisseurs dirigeants
Public encadrants
Etat personnel
Syndicats syndicats
Milieu local
Lorganisation doit donc tenir compte de ces diffrents acteurs sociaux et tenter de prserver
un quilibre dans la satisfaction des intrts de chacun. Car en effet les rsultats que ces
acteurs de lorganisation attendent de celle-ci sont parfois divergents quand ils ne sont pas
incompatibles.
Par ailleurs lefficacit organisationnelle peut tre value partir de critres.
Cest ce que propose Morin E.M. Quatre critres pouvent servir valuer lefficacit
organisationnelle.
Tableau 1.2 Dimensions et critres de lefficacit organisationnelle
Valeur des ressources humaines Efficience conomique
Mobilisation du personnel Degr dintrt que les employs
manifestent
pour leur travail et pour lorganisation ainsi que leffort
fourni pour atteindre les objectifs.
Moral du personnel
Degr auquel lexprience clu travail est value
positivement par lemploy,
Rendement du personnel Qualit ou quantit de production
par employ ou par groupe.
D velc%~pemen t du personnel Degr auquel les
comptences saccroissent chez les membres de
lorganisation.
conomie des ressources
Degr auquel lorganisation rduit a quantit des ressources
utilises tout en assurant le bon fonctionnement du systme.
Productivit
Quantit ou qualit de biens et services produits par
lorganisation par rapport la quantit de ressources
utilises pour leur production durant une priode donne.
Lgitimit de lorganisation
auprs des groupes externes
Prennit
de lorganisation
Satisfaction des bailleurs de fonds Degr auquel les
bailleurs estiment que leurs fonds sont utiliss de faon
optimale. Satisfaction de la clientle Jugement que porte le
client sur la faon dont lorganisation a su rpondre ses
besoins.
Satisfaction des organismes rgulateurs Degr auquel
lorganisation respecte les lois et les rglements qui
rgissent ses activits. Satisfaction de la communaut
Apprciation que fait la communaut largie des activits et
des effets de lorganisation.
Qualit du produit
Degr auquel le produit rpond aux besoins de la clientle.
Rentabilit financire
Degr auquel certains indicateurs financiers (par exemple,
la rentabilit> de lorganisation augmentent ou diminuent
par rapport aux exercices prcdents, ou par rapport un
objectif fix.
Comptitivit
Degr auquel certains indicateurs ecoriomi ques se
comparent favorablement Ou dfa vorablement avec ceux de
lindustrie ou des concurrents.
Les diffrents regards scientifiques ports sur
l organisation.
L organisation sociale est peut devenir lobjet dtude de
champs scientifiques (en sciences humaines et sociales) divers
et parfois concurrents.
Lhistoire peut apporter un clairage sur lvolution de
lorganisation en lien avec le contexte socital et culture.l
ambiant.
La sociologie.
Lanthropologie.
La psycho-sociologie.
La psychologie.
Lconomie.
Utiliser des images pour mieux comprendre les
organisations
1. Les organisations sont complexes et peuvent tre
reprsentes de multiples faons, sous diffrents angles.
Mobiliser des images, des mtaphores revient les utiliser
comme des outils pour mieux cerner la ralit organisa-
tionnelle lieu de dcision et daction.
2. Une autre faon de procder, faire lanalyse des structures
organisationnelles prvues par le formel.
Les 9 images de lorganisation
Apports la vision de lorganisation. Notions lgues.
La famille. Formation accompagne. Comptence.
Suivi qualit. Responsabilit
La machine. Unit et efficacit Rendement. Contrle.
Prvisibilit Pilotage
Lorganisme vivant. Ouverture sur lenvironnement Systme - rtroaction
Adaptation Rgulation -connexion -cycle
Le cerveau. Traitement de linformation. Anticipation.
Une culture. Importance des normes, rgles Culture, identit, lien social
et valeurs Mythes, rites.
Politique. Gouvernement de lorganisation Pouvoir, acteur, stratgies
Exercice du pouvoir. Influence, coalition.
Psychique. Lieu de plaisir et de souffrance Stress, motivation, imaginaire
Domination. Pouvoir et sphres sociales Emprise, contrle, domination
Distribution du pouvoir
Le Rseau. Dcentralisation, relations inter- Cration rseau, maintien, activation
firmes, inter-individuelles des nuds slectionns
Lorganisation comme une famille.
Certaines organisations fonctionnent sur des relations
interpersonnelles qui relvent davantage du domaine de la filiation, de
la fraternit voire du maternage ou encore du parrainage.
Ce type de phnomnes sociaux sont trs imprgns du modle
familial traditionnel.
Un modle ternaire = pre-mre-enfant. On retrouve une trinit aussi
au fondement certaines religions.
Nous retrouvons les prmisses de cette forme organisationnelle dans
les mtiers qui conservent une forme artisanale. Orfvrerie certains
mtiers du btiment, des professions indpendantes comme notaire,
architecteLes jeunes pousses doivent aussi tre dans ce cas.
Rappelons que lartisanat est la plus grande entreprise de France.
Le compagnonnage
Cest au 11me sicle quest apparue de faon formalise la pratique
du compagnonnage. Epoque o une demande en hommes de mtier
devient importante notamment sur les chantiers de construction des
cathdrales en Europe.
Les artisans se regroupent pour organiser la formation, la dfense et la
solidarit artisanale par spcialit = les corporations et les corps.
Le comportement paternaliste du matre lgard de son aspirant, fait
partie du contrat dapprentissage. Le suivi dans la formation est une
garantie quant la qualit des comptences transmises.
Ici le principe de comptence et de sa transmission est central.
Le principe de qualit en est dduit. Grce au contrat de formation qui
lie le matre et laspirant devant la corporation.
Les effets collatraux sont lis au traitement quasi familial de la
prise en charge.
Lorganisation comme une machine
Lentreprise est vue comme un ensemble mcanique de rouages, assembls afin de
rpondre chacun un objectif particulier. Chaque geste et chaque attitude est
codifi. Chaque tche accomplir est dote dun cahier des charges, des
responsabilits et un degr dautonomie dfini lavance.
[Frdric le Grand, roi de Prusse du 18me propose dautomatiser les
comportements et spcialiser les tches des soldats. Adams Smith (1776) conoit
les employs de lorganisation au service des machines, cela a pour effet de rduire
leurs initiatives en fonction des besoins de lorganisation].
Puis viennent les auteurs de la priode classique des organisations au dbut du
20me sicle. Max Weber qui conoit la bureaucratie comme une organisation
mcanique de ladministration. Lieu de recherche defficacit, de fiabilit grce un
partage quitable des tches un contrle et des rgles dfinies.
Les thoriciens classiques de la gestion au nombre desquels Henri Fayol.
Lorganisation scientifique du travail avec Frdrick W. Taylor puis Henri Ford.
Tableau comparatif des thories classiques
LOST (Taylor) LOAT(Fayol) Le modle weberien
1. Conception mcaniste 1. Conception mcaniste 1. Conception mcaniste
de lh. et de lorganis. de l homme. de l homme.
2. Rationalit quasi- 2. Rationalit quasi- 2. Rationalit quasi-
illimite. Illimite. Illimite.
3. Objectif de 3. Objectif de 3. Objectif de
productivit productivit. Rationalisation.
4. Prise en compte de 4. Prise en compte de 4. Prise en compte de
lindividu, non du lindividu, non lindividu, non
groupe. du groupe. du groupe.
5. Division du 5. Division du 5. Division du travail.
travail. Travail.
6. Le One best way 6. Le One best way. 6. Caractristiques
bureaucratiques.
7. Aucune relation de 7. Aucune relation de 7. Analyse des relations
de pouvoir pouvoir pouvoir et dingalit
Lorganisation comme un organisme
Les cueils de la conception mcanique ont permis une volution vers
un modle biologique. Tel des organismes vivants il va falloir tudier
lenvironnement, la composition, les mutations et les cycles de vie des
organisations.
Les terminologies biologiques organisationnelles deviennent celles de
positionnement, de cohrence et defficacit dans leur environnement.
Les travaux de E. Mayo ont mis en vidence les relations et
interactions implicites au sein des organisations.
Les travaux sur la motivation de Mac Grgor, Herzberg et Maslow ont
dmontr que le dveloppement individuel est important pour le bon
fonctionnement organisationnel.
Les apports de lapproche systmique ont remis en tte les ensembles
articuls entre eux de paramtres techniques, conomiques, politiques
et humains.
Lorganisation comme un systme
Les organisations sociales notamment lentreprise sont modlises
dans leur forme et leur gestion par les environnements interne et
externe. Burns et Stalker dfinissent trois types denvironnement qui
induisent des modlisations particulires.
Un environnement stable caractris par des techniques de production
matrise et des besoins de consommateurs connus et canaliss.
Modle mcaniste o lindividu reste un instrument de production.
Un environnement moins stable o les techniques de production
voluent de mme que les besoins des clients. Ici un modle
organique adaptatif avec des individus sinformant et coordonnant
leurs activits.
Un environnement instable o linnovation est un principe de survie.
Modle organique trs ouvert. Lindividu y est positionn par ses
comptences son savoir-faire et son implication dans le systme.
Lorganisation comme un cerveau
Lorganisation serait assimilable dans son fonctionnement ce qui se
passe au temps de laction lorsque les deux hmisphres crbraux
travaillent de faon coordonne, complmentaire et rciproque
notamment quant au fait traiter de linformation (interne/externe).
Lorganisation est un centre de prise de dcision, elle doit traiter,
fragmenter, grer les informations qui vont permettre aux dcideurs
de les exploiter.
Mais cette prise de dcision ne peut tre totalement rationnelle car les
dcideurs nont pas toutes les informations ncessaires.
Nanmoins la ncessit actuelle pour lorganisation est dvoluer en
apprenant, mais aussi en apprenant apprendre.Traitement des
informations et apprentissage sont deux phnomnes dont le cerveau
est le sige.
Lorganisation comme un systme politique
Ici la dialectique de lemploy et du citoyen les oppositions entre les
droits civiques et les droits du salari.
Le jeu des pouvoir au sein de lorganisation a laspect dun systme
politique. Entre les choix personnels et les dcisions collectives fruits
de ngociations et de consultations.
Les diffrents types de gouvernements des organisations :
- lautocratie : les pouvoirs entre les mains de peu de personnes.
- la bureaucratie : Gestion par le biais de lcriture, lgalit, rationalit
- la technocratie : o prsident comptences et savoir-faire
- la cogestion : coalition/cohabitation
- la dmocratie : le pouvoir revient aux employs ou leurs
reprsentants.
Lorganisation comme une prison psychique
Des phnomnes conscients et inconscients crent et maintiennent les
organisations en tat. Pour les individus ces mcanismes peuvent tre
ressentis comme de vritables prisons. Leurs interprtations des
phnomnes organisationnels peuvent leur tre en propres ou tre
suggrs par les organisations elles-mmes.
Mais il en est de mme au niveau organisationnel. Les organisations
modlent le monde et peuvent senfermer dans leur propre vision les
empchant dinnover. Cest dire de rpondre aux transformations de
leur environnement.
Il faut donc analyser les phnomnes organisationnels en tenant
compte de la structure cache et de la dynamique du psychisme
humain (quand le pre fondateur est toujours prsent).
Lorganisation est le produit de la somme des individus et de leur
histoire personnelle et de lhistoire commun et collective de
lentreprise.
Lorganisation comme culture
Lorganisation conue comme culture veut dire que les
hommes et femmes qui se retrouvent en inter-relation au
sein des organisations dveloppent entre eux des relations
multiples. Sy cre du lien social, des rites, des normes de
comportement, des idaux, des traditions.
Cest lapproche anthropologique qui tente de cerner
lorganisation comme un peuple une ethnie, une tribus. On
pourrait dire que cette faon de concevoir la dimension
culturelle de lorganisation cest faire ressortir ce qui est
proprement humain la diffrence des approches
prcdentes
Lorganisation comme systme de domination
En prolongement des images politique et culturelle celle-ci montre le
lien des organisations avec les phnomnes de domination sociale, du
pouvoir dun petit nombre sur la majorit.
1) Qui dirige les organisations?
2) Etudes des relations entre fonctionnement organisationnel et
dtenteurs du pouvoir conomique et politique.
3) Etablissement de liens entre images psychiques et politiques.
Lorganisation au service des intrts de ses dirigeants. Assurance de
lobissance des subalternes par des outils visant le processus
psychiques.
Pouvoir de groupes dominants sur la socit
Pouvoir de lorganisation sur l individu
Processus Processus
conscients inconscients
Individu
LOrganisation comme rseau
Classiquement lorganisation est conue comme un objet social bien
dlimit. Cest une structure matrielle et humaine que lon peut
modeler sa guise. Or ce phnomne social nest-il pas plutt un
construit du cerveau-esprit de celui qui lobserve ou en parle. Au
mme titre que tous ces outils intellectuels que nous mobilisons pour
changer propos de phnomnes sociaux et qui nont pas de ralit
naturelle directe. Il sagit de significations inventes par nous pour
communiquer autour dobjets sociaux dans nos propres cadres socio-
culturels.
Implicitement il est fait rfrence des thories comme lnaction qui
nous mais en garde contre les risques de confondre les constructions
rhtoriques qui nous servent parler des choses et de la ralit des
choses propos desquelles on parle.
Lorganisation serait alors un construct permanent articulant en
continu des faits et des significations.
Lorganisation en tant quaction
organise
L'action sociale est alors structure sous des formes plus ou moins
diffuses, stables. L'organisation est alors une de ces formes
daction sociale.
Cette conception rpond en partie au moins un des problmes
soulev par la tradition : l'opposition entre l'organisation et le
march. Entre cette forme stable et formelle et cette autre forme
souple et mouvante. Paradoxe pour qui est d'accord considrer
l'organisation en particulier l'entreprise comme un des chanons
gntiquement reli au march.
Perue comme une action organise l'organisation contient alors des
marges de manuvre et d'incertitude, de souplesse au mme titre que
le march contient des ingrdients d'ordre et de structuration.
Organisation March
Action organise
Formes Formes
structures diffuses
Grille des 4 dimensions danalyse de laction organise.
Degr de formalisation
Faible Fort
Degr de finalisation
Faible Fort
Degr d intriorisation de la rgulation par ceux qui y participent.
Faible Fort
Degr de dcentralisation.
Faible Fort
Selon le sociologue E. Friedberg (le pouvoir et la rgle,
1993).
March et organisation ne diffrent pas dans leur nature
mais dans leur degr de structuration. Dans les deux cas
il sagit de considrer les deux entits comme des
systmes daction concrets
Il sagit dun concept thorique sociologique quivalent
des ensembles dinteractions et de jeux entre des acteurs
stabiliss au moment de lobservation porte.
Ces systmes daction concrets peuvent traverser les fron
tires officielles de lorganisation. la formalisation de ces
systmes peut tre diffremment tablie. Ils sont plus ou
moins finaliss, dcentraliss et tolreront diffremment
les liberts que saccorderont les acteurs en leur sein.
Un tel outil thorique devient de plus en plus indispensable.
Les configurations organisationnelles se complexifient, les modles
se croisent et/ou se juxtaposent.
Lhybridation des formes organisa-
tionnelles obirait selon P. Louart (1996) 4 rgles de construction.
-1) coapparition de formes dj observes historiquement ,
-mlange des formes correspondant des contextes diffrents
- ( entreprises la fois high tec et taylorienne),
-2) accent mis sur une dimension (technologique par exple) et
-ngligeant dautres,
-3) association de parties stables et de paries mobiles (un
-noyau dur central et des lments priphriques souples).
Cette explosion des formes explique le succs de la notion de rseau
utilise bien souvent de faon extensive.
Le rseau serait un ensemble dlments en interaction, relis de
manire stable, durable dans le temps et lespace. Ce concept est
un carrefour disciplinaire.
En sociologie ds les annes cinquante les relations interindividuelles
sont tudies (qui connat qui ? et qui apprcie qui ? ).
Ce sont les rseaux de socialit ou rseaux sociaux.
En conomie industrielle et marketing depuis les annes soixante
sont observes les relations de coopration et de concurrence entre
entreprises dun mme secteur ou dune mme rgion.
Pour la thorie des organisations on peut situer la notion de rseau
comme une coordination entre organisation classique et march.
Organisation -----------------------rseau----------------------------march
Il sagirait dun systme daction concret parmi dautres.quand il sagit
de caractriser lorganisation en rseau ou lorganisation-rseau.
Dont la structure moins formalise, moins spcialise, aux frontires
moins nettes que dans les structures classiques (synonymes dans ce cas
de bureaucratique). Nous serions alors face un nouvel idal-type adapt
aux conditions modernes de comptitivit grce sa souplesse et sa
ractivit. Le concept de rseau et aussi associ au dveloppement des
technologies modernes de communication, avec une plus-value sman-
tique de modernit.Les entreprise utilisant ces technologies seraient alors
des entreprises en rseau.
Au bilan de quoi parle-t-on quand on parle de rseau ?
Organisation en rseau
Rseau interfirmes
Rseaux sociaux---------------------------------------------------Rseaux de tlcommunication ou
rseaux informatique
On peut alors essayer de connecter ces diffrentes dimensions.
-les relations interfirmes,
-la dcentralisation ou lclatement des structures classiques
- en units autonomes tissant entre elles des relations plus
-souples,
-des relations inter-individuelles qui contribuent aux deux
- types de relations ci-dessus,
-les outils de communication qui peuvent influer sur ces trois
- phnomnes prcdents.
Il convient alors de bien cerner le type de ralit que lon dsigne
sous le vocable de rseau selon les cas.
Lanalyse des structures des organisations
Quand on travaille sur les diffrentes images quune organisation peut prsenter, on se
centre surtout sur la dimension humaine de lorganisation. Il semble quen STAPS ce soit
la facette naturelle de lapproche organisationnelle. Nanmoins lapproche peut aussi
se faire par dautres entres. Si lon considre en accord avec Y. Livian (1998) quune organisation
est concevable comme un systme qui articule entre elles quatre composantes.
Humaine, structurelle, gestionnaire et physique.
Humaine
Structure systme de gestion
Physique
La composante humaine rfre au domaine des comptences du
groupe humain, des attitudes au travail, des appartenances revendiques
.Ce que nous avons largement voqu auparavant.
La composante physique renvoie la distribution de :
1) lespace organisationnel : la localisation, le flux des matires
et de lnergie.
2) du matriel comme les quipements techniques et les locaux.
Localisation flux
Equipements Btiments et installations
La localisation peut favoriser laccs aux ressources et voies de
communication mais aussi se trouver dans une culture (urbaine,
rurale, montagne, bord de mer [Sophia Antipolis = Antibes].
La rationalisation des flux qui traversent lorganisation est un enjeu
permanent de celle-ci.
Les quipements sont autant ceux lis aux oprations de production
que ceux lis aux communications et traitement des informations
internes et externes.
Btiments et installations contribuent aussi lidentit de lorga-
nisation.
La composante systme de gestion rfre quatre groupes doutils
organisationnels.
Le systme dobjectifs que se fixe lorganisation dans son ensemble
et les diffrents sous-groupes qui la composent.
Le systme de contrle des objectifs et de leur qualit.
Le systme dvaluation des personnels avec les sanctions et
rcompenses associes.
Le systme dinformation et de communication (stockage, dif-
fusion, traitement).
Systmes dobjectifs systmes de contrle
Systmes dinformation systmes dvaluation et
Et de communication de sanctions/rcompenses
La structure de lorganisation :
Nous reprenons la dfinition quen donne H. Mintzberg en 1982 la somme totale des moyens
utiliss pour diviser le travail entre tches distinctes et pour assurer la coordination ncessaire
entre ces tches . Dans cette dfinition sont explicitement distingus les temps de la division
du travail et de coordination. Double mouvement typiquement organisationnel que les struc-
tures formelles ou informelles visent raliser avec ou sans lengagement intentionnel des
acteurs invits y participer.
Division du travail Coordination
- Dfinition des postes/fonctions Procdures
Formel - Organigrammes Circuits de communications
-Procdures Runions, comits, hirarchie
-Interactions quotidiennes Interactions quotidiennes
Informel - Comptence Comptence
- Appartenance culturelle Appartenance culturelle
- Affinits Affinits
Avant de se focaliser sur ces deux dimensions sus-nommes
reprenons la dmarche dans son ensemble. H. Mintzberg
partir dun bon nombre de recherches empiriques propose un
modle danalyse et de dfinition des organisations partir
dun certain nombre de critres.
la place des lments de base,
-
les mcanismes de coordination,
-
les paramtres de conception,
-
les facteurs de contingence.
A) Les lments de base lorganisation :
Ce sont les composantes des organisations relativement
leur taille. Ces lments sont des parties distinctes entre
lesquelles se rpartissent les tches accomplir.
Elles sont au nombre de cinq.
1) Le centre oprationnel : il sagit de tous les excutants ou opra-
teurs (ouvriers, vendeurs, expditeurs) dont le travail est directem-
ent li la production des biens ou services (achat, fabrication,
distribution, support direct ou maintenance).
2) Le sommet stratgique : les personnes dont les responsabilits
sont les plus larges (PDG, quipe dirigeante). Lexistence du centre
oprationnel justifie la prsence dun responsable investi des mis-
sions de direction, de stratgie, dallocation des ressources, de rela-
tion avec lextrieur, de contrle.
3)La ligne hirarchique : les personnels dencadrement(du cadre suprieur
lagent de matrise) entre le sommet qui dfinit les orientations et le centre
oprationnel qui produit. Il sagit de collecter les informations, de les trans-
mettre au niveau hirarchique suprieur, dlaborer les rgles et de mettre
en uvre les projets, dallouer les ressources et enfin de formuler les stratgies
pour leur propre unit.
4) La technostructure : (experts, ingnieurs, cadres des fonctions comptabilit,
mthodes, formation). Se sont les analystes qui ne font pas partie de lencadrement
et qui ont pour rle de planifier, standardiser, contrler).
5) La ou les fonction(s) de support logistique : units qui ne jouent pasun rle direct
sur la production, mais fournissent un support indirect la mission de base. (conseil
juridique, relations humaines, recherche, dveloppement, rception, restauration,
dentreprise). Elles procurent aux membres de lorganisation les services ncessaire
leur activit. Ainsi il y a un contrle des affaires intrieures et une rduction de
leurs incertitudes.
H. Mintzberg souligne galement le rle de lidologie (culture) de lorganisation.
Les mcanismes de coordination :
Au nombre de cinq ce mcanismes permettent lorganisation de
coordonner lensemble des tches.
1. Lajustement mutuel : Le travail est coordonn par simple
communication informelle. Le contrle reste la tche de lop-
rateur.
2.La supervision directe : la responsabilit du travail des autres
et leur contrle sont assurs par une seule personne. Les trois mca-
nismes suivants relvent de la standardisation. Celle-ci donne des
rgles et de normes aux salaris avant la ralisation mme de leur coor-
dination. Nanmoins elle peut prendre trois formes :
3) La standardisation des procds de travail : les rgles portent sur
les contenus du travail et sont relatives lexcution des tches.
4) La standardisation des rsultats : les rgles concernent les
rsultats atteindre, la performance.
5) La standardisation des qualifications : les rgles relatives la
qualification dune personne permettent aux autres de connatre son
travail et donc de lier les tches entre elles.
Standardisation
des procds
Ajustement Supervision Standardisation Ajustement
mutuel directe des rsultats mutuel
Standardisation
des qualifications
C) H. Mintzberg suggre des paramtres de conception
de toute structure.
Ce sont les grandes dimensions autour desquelles les dcideurs ont
conu la structure un moment donn :
a) la conception des postes de travail,
b) la conception de la superstructure,
c) la conception des liens latraux entre
individus et units et
d) la conception du systme de prise de
dcision.
Groupe Paramtre de conception Concepts associs
Conception des postes - spcialisation du travail - division de base du travail
- formalisation du - standardisation du contenu du travail
comportement - systme de flux rguls
- formalisation et socialisation - formalisation des qualifications
Conception de la - Regroupement en units - supervision directe
superstructure - division administrative du travail
- systme dautorit formelle, de flux rguls, de
communication informelle et de constellations
de travaux.
- organigramme
- taille des units - systme de communication informelle
- supervision directe
- surface de contrle
Conception des - systmes de planification - standardisation des productions
liens latraux et de contrle - systme de flux rguls
- mcanismes de liaison - ajustement mutuel
- systme de communication informelle de constel-
lations de travaux et de processus de dcision
Conception du - dcentralisation verticale - division administrative du travail
systme de prise - systme d autorit formelle, de flux rguls, de
de dcision de travaux et de processus de dcision ad hoc
- dcentralisation horizontale - division administrative du travail
- systme de communication informelle, de constel-
lations de travaux et de processus de dcision
Ce qui modle le comportement
Division du travail et coordination
Circuits de communication et dinformations
Rpartition des tches, des rles
Rpartition du pouvoir
Division du travail
Hirarchie et contrle
Les lments contenus dans les dfinitions des structures
Lorganisation comme flux et transformation
La mtaphore du cours deau qui prsente un ordre impliqu (le
mouvement du fleuve et de leau qui coule) et un ordre expliqu (le
remous ponctuel cre par le pied dans le courant de leau) peut offrir
une nouvelle possibilit de comprendre et de grer le changement
organisationnel, limage dun dun flux de transformations.
On distingue quatre mcanismes logiques de changement emprunts
des thories ou des principes scientifiques qui vont dans ce sens du
flux de transformations.
La thorie de lautopoese,
Logique de la complexit et du chaos,
Principe cyberntique,
Logique du changement dialectique.
La thorie de lautopoese
Lautopoese dsigne la capacit dauto-production par lentremise
dun systme de relations clos.Ce concept sous-entend que le systme
sauto-produit. Une capacit gnre par le besoin de garder une
identit propre. On obtient des systmes qui au contact de leur
environnement, entrent en interaction et finissent par se gnrer eux-
mmes.
Cerner un tel systme est difficile car sa nature est dtre construit en
boucles dinteractions et quil est paradoxal de vouloir lui donner un
dbut et une fin. Cest un tout possdant sa propre logique.
Les organisations tentent sans cesse dintgrer leur environnement
dans un systme dinteractions et cherchent faire face leur
environnement tout en gardant leur identit propre. Environnement et
organisation sont alors prendre dans leur sens le large possible.
Le dfi de cette thorie est de cerner et comprendre comment
lorganisation change et volue et dans quelle mesure elle agit et
interagit sur environnement.
Logique du chaos et de la complexit
Un vnement survenant au hasard peut provoquer des situations
imprvisibles mais quen fin de compte un ordre cohrent nat
toujours de ce type de situation.
Tout systme complexe gnre en son sein des systmes auto-
rgulateurs ou dauto-organisation spontans. Cest lart de se servir
des petits changements pour provoquer de grands effets et de rester
lcoute des nouvelles mtaphores enclenchant des mcanismes
dauto-organisation.
Principes cyberntiques
Le rle de la rtroaction positive et de la rtroaction ngative dans la
dynamique des systmes. Une action peut donc engendrer une srie
dautres actions mais pas toujours dans le sens attendu.
Action et rsultat ne sont pas forcment des lments linaires. Il peut
se produire des changements de niveau voire de nature. Les petits
changements peuvent augurer des ralisations importantes au plan
organisationnel.
Logique de changement dialectique
Inspir du taosme et repris par des occidentaux cette thse montre
tout phnomne engendre son contraire. Le gestionnaire doit pouvoir
avec cette analyse, reconnatre les contradictions qui existent au sein
du systme et mettre en vidence les solutions aux problmes
rencontrs
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Grands Courants de La Pensée de La Théorie Des OrganisationsDocument6 pagesLes Grands Courants de La Pensée de La Théorie Des Organisationsعبداللهبنزنو75% (4)
- Changement organisationnel : Théorie et pratiqueD'EverandChangement organisationnel : Théorie et pratiqueÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4)
- La chaîne de valeur de Porter: Identifier la création de valeurD'EverandLa chaîne de valeur de Porter: Identifier la création de valeurÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Réussir le changement: Mobiliser et soutenir le personnelD'EverandRéussir le changement: Mobiliser et soutenir le personnelPas encore d'évaluation
- Ecoles Des Relations HumainesDocument49 pagesEcoles Des Relations Humainesابو الياس الزفاطي67% (3)
- Cours de Sociologie Organisations Et TravailDocument73 pagesCours de Sociologie Organisations Et TravailPhreedom DvdPas encore d'évaluation
- Exposé Théories Des OrganisationsDocument56 pagesExposé Théories Des Organisationshajar1988100% (2)
- Rapport Neoclassique pdf2Document17 pagesRapport Neoclassique pdf2Yassine MadaniPas encore d'évaluation
- Synthèse de MINTZBERG FinaleDocument20 pagesSynthèse de MINTZBERG Finaleherrera90100% (2)
- Théorie Des Organisations PDFDocument126 pagesThéorie Des Organisations PDFMèd Rm100% (3)
- Les Theories Des OrganisatIonsDocument34 pagesLes Theories Des OrganisatIonsouazene ahmed100% (15)
- Théories Des OrganisationsDocument24 pagesThéories Des OrganisationsMedjiah_Bouale_2466Pas encore d'évaluation
- La Théorie de Droit de Propriété Et La Théorie de L'agenceDocument18 pagesLa Théorie de Droit de Propriété Et La Théorie de L'agenceHanane Aya100% (1)
- Fiche de Lecture3 MintzbergDocument8 pagesFiche de Lecture3 MintzbergSandra DuvergerPas encore d'évaluation
- Cours Sociologie Des OrganisationsDocument24 pagesCours Sociologie Des OrganisationsBZDR67% (3)
- La psychologie du travail facile à apprendre: Le guide d'introduction à l'utilisation des connaissances psychologiques dans le domaine du travail et des organisationsD'EverandLa psychologie du travail facile à apprendre: Le guide d'introduction à l'utilisation des connaissances psychologiques dans le domaine du travail et des organisationsPas encore d'évaluation
- S'organiser pour la complexité. Revitalisez le travail et remettez l'humain au cœur de la performanceD'EverandS'organiser pour la complexité. Revitalisez le travail et remettez l'humain au cœur de la performancePas encore d'évaluation
- Théorie Des OrganisationsDocument7 pagesThéorie Des Organisationsfirst25100% (2)
- Théorie Des OrganisationsDocument32 pagesThéorie Des OrganisationsMohamedAnsari100% (2)
- Les Ecoles de La Theorie Des OrganisationsDocument37 pagesLes Ecoles de La Theorie Des OrganisationsBayn Bnto100% (2)
- Théorie Des OrganisationsDocument17 pagesThéorie Des OrganisationsAna DeduPas encore d'évaluation
- Les Théories Des OrganisationsDocument16 pagesLes Théories Des OrganisationsAminePas encore d'évaluation
- Théories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardeD'EverandThéories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardePas encore d'évaluation
- Cours Complet - Theorie Des OrganisationDocument15 pagesCours Complet - Theorie Des OrganisationanasPas encore d'évaluation
- La ContingenceDocument34 pagesLa ContingenceMohcine Liraki57% (7)
- Ecole ClassiqueDocument18 pagesEcole ClassiqueShada Laamri100% (2)
- Théorie Des Organisations 2Document10 pagesThéorie Des Organisations 2Cecile SpykilinePas encore d'évaluation
- L'approche Bureaucratique Et Cycle Vicieux de La BureaucratieDocument4 pagesL'approche Bureaucratique Et Cycle Vicieux de La BureaucratieAnonymous ETwFaG100% (2)
- Synthése Théorie Des OrganisationsDocument7 pagesSynthése Théorie Des OrganisationsMahassinMidi100% (5)
- Chap 3 Les Théories Managériales Des OrganisationsDocument46 pagesChap 3 Les Théories Managériales Des OrganisationsClovis Tshituka100% (2)
- OriginalDocument20 pagesOriginalRubs PastorePas encore d'évaluation
- Théorie Des Organisations Mr. ZAKARIA OULAHCENDocument123 pagesThéorie Des Organisations Mr. ZAKARIA OULAHCENSaid JB67% (3)
- Théorie Des Organisations CoursDocument121 pagesThéorie Des Organisations CoursEl Arbi Abdellaoui Alaoui100% (2)
- Cours de Théories Des OrganisationsDocument25 pagesCours de Théories Des OrganisationsChaimaa Kharraf100% (1)
- Taylor, Fayol, WeberDocument9 pagesTaylor, Fayol, WeberIliasBenryane100% (2)
- Le Changement OrganisationnelDocument137 pagesLe Changement Organisationneltahus100% (5)
- Theorie Des OrganisationsDocument28 pagesTheorie Des OrganisationsYassine Tawfik100% (1)
- Fiche de Lecture Theorie Des Relations HumainesDocument4 pagesFiche de Lecture Theorie Des Relations HumainesYassine MadaniPas encore d'évaluation
- L'ecole de La DécisionDocument26 pagesL'ecole de La DécisionYassine Madani100% (5)
- Cours Des Thèories Des Organisations-CompletDocument14 pagesCours Des Thèories Des Organisations-CompletJihaneScribdPas encore d'évaluation
- Approche SystémiqueDocument4 pagesApproche SystémiqueAyoub DemkalPas encore d'évaluation
- Teorie Des Organisations :LE MOUVEMENT DES RELATIONS HUMAINESDocument13 pagesTeorie Des Organisations :LE MOUVEMENT DES RELATIONS HUMAINESIkram El Ghazouani90% (10)
- Rapport Structure OrganisationnelleDocument31 pagesRapport Structure OrganisationnelleMokhless Et100% (1)
- TCB FgoDocument26 pagesTCB FgoYassine Madani100% (1)
- Cours de Management GénéralDocument259 pagesCours de Management GénéralRajita EconomistePas encore d'évaluation
- Ecole de Relation HumaineDocument3 pagesEcole de Relation HumaineAkimedes Walker100% (2)
- Theorie X Et YDocument22 pagesTheorie X Et YAbdel Motaleb AL-Saady100% (1)
- Théorie Des OrganisationsDocument36 pagesThéorie Des OrganisationsjoeyyPas encore d'évaluation
- D Cercles VicieuxDocument45 pagesD Cercles Vicieuxlmaroua50% (2)
- Les Théories de La ContingenceDocument9 pagesLes Théories de La Contingencecipher A100% (1)
- Les Différents Modèles de Prise de DécisionDocument4 pagesLes Différents Modèles de Prise de Décisionpadja_rp100% (1)
- Ethique Des AffairesDocument24 pagesEthique Des AffairesAbbad Nabil50% (2)
- 80480905le Changement Organisationnel Karim Ben Kahla PDFDocument30 pages80480905le Changement Organisationnel Karim Ben Kahla PDFnangaayissiPas encore d'évaluation
- Théorie Des OrganisationsDocument89 pagesThéorie Des Organisationsnada100% (1)
- Ecole ClassiqueDocument13 pagesEcole ClassiquekhadijaPas encore d'évaluation
- Les Structures OrganisationnellesDocument11 pagesLes Structures OrganisationnellesMoussaoui Mohamed100% (1)
- Chap. 2 Ecole Des Relations HumainesDocument11 pagesChap. 2 Ecole Des Relations HumainesLiliane Kouadio100% (1)
- Résumé Des Theorie Des Organisation s1Document3 pagesRésumé Des Theorie Des Organisation s1Walid Farid100% (5)
- Ecole Des Relations HumainesDocument24 pagesEcole Des Relations Humainespsepse100% (1)
- 1) Les Théories Des OrganisationsDocument18 pages1) Les Théories Des OrganisationsJojoPas encore d'évaluation
- NA CPI 1 5 Rev 11 PR Sentation de CEP Industrie 186 125 4Document10 pagesNA CPI 1 5 Rev 11 PR Sentation de CEP Industrie 186 125 4chatxxnoirPas encore d'évaluation
- NA CPI 1 5 Rev 11 PR Sentation de CEP Industrie 186 125 2Document11 pagesNA CPI 1 5 Rev 11 PR Sentation de CEP Industrie 186 125 2chatxxnoirPas encore d'évaluation
- NA CPI 1 5 Rev 11 PR Sentation de CEP Industrie 186 125 1Document12 pagesNA CPI 1 5 Rev 11 PR Sentation de CEP Industrie 186 125 1chatxxnoirPas encore d'évaluation
- Exercice Gestion Budgetaire PDFDocument2 pagesExercice Gestion Budgetaire PDFAbdèlàzizPas encore d'évaluation
- S3a Alain VivierDocument1 pageS3a Alain VivierchatxxnoirPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire, Oscar Et MathildeDocument2 pagesAnalyse Linéaire, Oscar Et MathildeOsCaRPas encore d'évaluation
- Documents Tara SVT-HGDocument7 pagesDocuments Tara SVT-HGMon Beau PhénixPas encore d'évaluation
- D Lais de Paiement Loi6921 SFM Conseil 1689180706Document14 pagesD Lais de Paiement Loi6921 SFM Conseil 1689180706AyOub AbdaNiPas encore d'évaluation
- Tourisme Responsable Dernic3a8re VersionDocument48 pagesTourisme Responsable Dernic3a8re VersionOlivePas encore d'évaluation
- PPP S2 Dossier Final Connaissance de Soi 20132014Document7 pagesPPP S2 Dossier Final Connaissance de Soi 20132014IulianPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 FinDocument22 pagesChapitre 1 FinMôlkà TrabelsiPas encore d'évaluation
- Les ModalisateursDocument1 pageLes ModalisateursnouriPas encore d'évaluation
- Exercice TCE - NotesDocument3 pagesExercice TCE - NotesTifania MiranaPas encore d'évaluation
- Blog de Naruto-CitationsDocument4 pagesBlog de Naruto-CitationsYANPas encore d'évaluation
- Assemblages SoudureDocument12 pagesAssemblages SoudureMISSOUM RachidPas encore d'évaluation
- 1STIChap14Les Matéraux-19Document9 pages1STIChap14Les Matéraux-19Rick SanchezPas encore d'évaluation
- Annonces S - 44 - 30.10 Au 05.11.23Document14 pagesAnnonces S - 44 - 30.10 Au 05.11.23mticiccPas encore d'évaluation
- Système NerveuxDocument11 pagesSystème Nerveuxhajar sektiouiPas encore d'évaluation
- Tables I1 RDocument5 pagesTables I1 RAdil AboulkasPas encore d'évaluation
- Corrige S Asie Juin 2002Document7 pagesCorrige S Asie Juin 2002akcmerteyah1Pas encore d'évaluation
- Conception Si UmlDocument177 pagesConception Si UmlYao KevinPas encore d'évaluation
- Evaluation 1 Courant Alternatif Bac Pro IndustrielDocument2 pagesEvaluation 1 Courant Alternatif Bac Pro IndustrielFélix Kouassi100% (3)
- Démarrage Par Variateur Et Autotransformateur MMTS353Document12 pagesDémarrage Par Variateur Et Autotransformateur MMTS353samisamata4Pas encore d'évaluation
- VMC Dans Les Igh A Usage D - HabitationDocument8 pagesVMC Dans Les Igh A Usage D - HabitationhichamPas encore d'évaluation
- chapitreII Sys Num VF 2023Document59 pageschapitreII Sys Num VF 2023safe selmiPas encore d'évaluation
- Jde38 2011Document32 pagesJde38 2011Sylvain GoulardPas encore d'évaluation
- Canevas Stage de Fin de Formation - 2022 - Final-1Document4 pagesCanevas Stage de Fin de Formation - 2022 - Final-1gnibenamounkoroPas encore d'évaluation
- Marketing Strategy Chapter 1 P2 TradDocument14 pagesMarketing Strategy Chapter 1 P2 TradFouad guennouniPas encore d'évaluation
- Notre Projet ProfessionnelDocument16 pagesNotre Projet ProfessionnelVladimir SavuPas encore d'évaluation
- Tipaza 23Document1 pageTipaza 23Mehdi PlcPas encore d'évaluation
- Les Parades Au Sol PL2012Document11 pagesLes Parades Au Sol PL2012David DuvielPas encore d'évaluation
- Chap 3 KaizenDocument43 pagesChap 3 Kaizenhouarbi samehPas encore d'évaluation
- 5 Prise Connaissance Générale PDFDocument20 pages5 Prise Connaissance Générale PDFkonate ichiaka86% (7)
- Didactique 3Document6 pagesDidactique 3Rudina PrevalPas encore d'évaluation
- CFM 2019Document8 pagesCFM 2019Edelin Cabral Jean-PierrePas encore d'évaluation