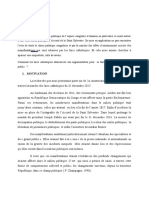Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Refonder La Cohesion Sociale Art Jacques
Refonder La Cohesion Sociale Art Jacques
Transféré par
sasori89Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Refonder La Cohesion Sociale Art Jacques
Refonder La Cohesion Sociale Art Jacques
Transféré par
sasori89Droits d'auteur :
Formats disponibles
1
Refonder la cohsion sociale
JACQUES DONZELOT
Repenser la solidarit ? Repenser lEtat-providence ? Nest-ce pas prcisment ce qui se fait depuis une quinzaine dannes travers la prolifration de rflexions et de publications autour de lexpression de cohsion sociale, laquelle semble bien focaliser la rflexion dun nombre croissant dorganismes de recherche plus ou moins directement associs des
gouvernements nationaux ou des organismes internationaux ? Sans prtendre lexhaustivit, commenons par indiquer quelques-uns des textes parmi les plus souvent remarqus sur ce nouveau front de la rflexion sociale. En France, le Commissariat Gnral du Plan, rcemment rebaptis Conseil dAnalyse Stratgique, sest distingu en premier, par la publication, dun rapport intitul Cohsion sociale et prvention de lexclusion (Fragonard, 1993), puis un second, tout aussi notoire, avec pour titre Cohsion sociale et territoires (Delevoye, 1997). Lun et lautre des titres de ces deux rapports fournissent, du mme coup, une indication des thmes qui focalisent lusage de cette expression de cohsion sociale : la marginalisation sociale, le dcrochage conomique croissant de certaines rgions par rapport dautres. A ces deux rapports du Plan, il faut ajouter les dbats parlementaires relatifs aux diffrentes lois prsentes dans le cadre du Plan national de cohsion sociale tabli, en 2005, par le Ministre Jean-Louis Borloo, luimme intitul ministre du Travail du Logement et de la Cohsion Sociale. Nombre dautres nations occidentales ont contribu, et souvent plus amplement que la France, au lancement de cette expression. Pour ne prendre quun exemple, le Canada a mis en place, depuis 1996, une commission le rseau canadien de recherche sur les politiques publiques , essentiellement axe autour de cette question : comment, lheure de la mondialisation, repenser lunit de la socit canadienne, la nature de son projet politique ? Comment surtout engager les citoyens dans cette rflexion alors quun certain malaise se fait sentir, compte tenu de lvolution quelque peu ngative de lemploi, de la sant et de la famille ? Ce rseau fut destin rflchir sur les effets horizontaux des politiques de la sant, de la main duvre et de la famille, en matire de participation des citoyens et de construction dun projet politique ax sur les valeurs auxquelles la population issue des multiples origines
2 qui composent ce pays pouvait adhrer et, du coup, rtablir une cohsion sociale qui semblait bien menace 1 . Lune des ralisations les plus significatives de ce rseau fut, dailleurs, la cration, en 2000, dun nexus de la cohsion sociale 2, charg de recueillir toute la rflexion existante sur ce sujet et de la dvelopper. On ne peut mieux dire quel point cette expression se trouve leste de toute la matire qui fait langoisse dune socit quant sa solidit matrielle et morale. Sagissant des organismes internationaux, la Commission Europenne et le Conseil de lEurope se trouvent en pointe en la matire. Lune et lautre ont cr, depuis plusieurs annes, des commissions ad hoc, voues la dfinition des attendus thoriques et des applications pratiques de lexpression de cohsion sociale. En 1997, Le Conseil de lEurope dcida, en effet, de renforcer son action dans les domaines des droits de lhomme, de la scurit des citoyens, des valeurs dmocratiques, de la diversit culturelle et, bien sr, de la cohsion sociale 3. De la lecture de ce dernier texte, il ressort dailleurs clairement que les quatre premiers sujets sinscrivent dans le dernier qui apparat comme le seul liant susceptible de leur donner une cohrence. Pour sa part, qui nest pas moindre, la Commission Europenne a fait de la cohsion sociale, lors du fameux sommet de Lisbonne de lan 2000, le troisime de ses objectifs principaux (donc aprs le premier qui consiste amener lEurope constituer lconomie de lintelligence la plus performante du monde et le second qui vise produire, au sein des pays membres, une croissance durable )4. A chelle mondiale, on entend encore parler de la cohsion sociale, dans la littrature produite par des organismes comme lOCDE ou la Banque Mondiale. LOCDE a multipli, depuis 1995, les rencontres et les publications sur le thme de la mondialisation et de ses effets sur la cohsion sociale. Quant la Banque Mondiale, elle en a fait le leitmotiv de son discours en direction des pays en voie de dveloppement5. Le thme de la cohsion sociale a ainsi connu, depuis une quinzaine dannes, une fortune rapide. La promotion soudaine dune formule si peu dfinie peut paratre affaire de mode et sans grande consquence, la vouant une fortune aussi phmre que soudaine. Mais
Cf Jane Jenson Les contours de la cohsion sociale : ltat de la recherche au canada . Etude des
RCRPP (Rseaux canadiens de recherche en politiques publiques) 1998. N F/03
2
Dirig par Denis Saint-Martin, Rseau de la famille, Rseaux canadiens de recherche en politiques
publiques.
3 4 5
Cf le Comit europen pour la cohsion sociale (CDCS) Runion du 13 juillet 2000. Conclusion du Conseil europen de Lisbonne : http//ue.eu.int CF le site de la Banque Mondiale. www1.worldbank.org.
3 elle peut aussi bien se rvler le symptme de la mutation discrte dun systme de pense un autre . La concidence de cette promotion avec lapparition des consquences sociales de la mondialisation, avec le constat des difficults des Etats Providence de tous genres faire face celle-ci, donnerait penser quelle nest ni fortuite, ni superficielle, mais quelle traduit la recherche dune nouvelle manire dapprhender les questions de solidarit toutes les chelles, locales, nationales, internationales. Cest, en tout cas, le parti pris que nous avons adopt pour lire et interprter les textes usant de cette expression depuis une quinzaine dannes avec une telle insistance. Quelle mthode adopter pour comprendre la fortune croissante de cette thmatique de la cohsion sociale ? Une recherche de type gnalogique simpose lvidence dans un tel exercice puisquil sagit de ressaisir les conditions dmergence de ce qui fait problme travers la mise en avant dun nouvel nonc. Elle consiste, en loccurrence, identifier une expression qui aurait prcdemment occup une place plus ou moins similaire de celle dont on veut comprendre la fortune, une expression qui perdrait donc du terrain du fait de la monte de celle-ci et rflchir ainsi aux motifs qui ont pu entrer en ligne de compte dans la substitution de lune lautre. Dans ce rle, on ne voit gure que lexpression de progrs social qui ait pu connatre, durant la priode prcdente, une fortune gale. Par poque prcdente, entendons celle qui va de la fin de la seconde guerre mondiale ce dbut des annes quatre-vingts, lorsque commence, justement, la fortune de cette expression de cohsion sociale, proportion de lusage dclinant de celle de progrs social. Pourquoi parle-t-on maintenant de cohsion sociale plutt que de progrs social ? Quand on se plonge dans les textes relatifs au progrs social produits durant les trente glorieuses , lorsque rgnaient une production dominante fordiste et un mode keynsien de rgulation de lconomie, on prend vite la mesure dune certitude ambiante concernant le lien entre la solidarit et le progrs. La croyance en un enchanement rgulier de lun lautre prenait la forme dune spirale. Le premier terme - la solidarit - apparaissait clairement comme la condition du second - le progrs conomique. En retour, celui-ci permettait daccrotre la solidarit entendue comme le sentiment dappartenance une commune socit. Requise pour le progrs conomique, la solidarit justifiait que lavance de celui-ci soit mis au service du progrs social, c'est--dire la rduction des ingalits sociales, lmancipation de chacun et la protection de tous. Quand on considre les textes de la priode qui suit immdiatement les trente glorieuses , nous voyons disparatre ce cercle vertueux unissant la solidarit sociale et le progrs conomique. Il nest plus question que de cohsion sociale, de la menace qui pse sur
4 celle-ci du fait de la mondialisation, de la ncessit toutefois de la maintenir pour prserver la comptitivit de lconomie locale ou nationale. De sorte que la fameuse cohsion sociale succde bien au progrs social mais sur fond dune perte dvidence de la solidarit objective de tous chelle de la nation. Le progrs social ne va plus de soi comme lorsque le progrs de la productivit obtenu au prix dune spcialisation croissante des tches industrielles suffisait accrotre linterdpendance de tous dans la socit. (Partie I : Dun systme de pense lautre). La nouveaut ou le renouveau de cette expression de cohsion sociale va-t-elle de pair avec de nouveaux contenus capables de produire une nouvelle pense de la solidarit dans ce systme de pense qui sinstalle depuis le dbut des annes quatre-vingt? Dsigne-t-elle une simple manire de reconnatre le dsarroi des politiques comme des experts face la dislocation de la socit industrielle de type fordiste avec la rduction rgulire des emplois industriels, la monte du chmage et de lexclusion, la ncessit accrue donc de faire du social pour enrayer ces drives autant que faire se peut? Ou bien voit-on venir avec elle une rflexion qui dpasse la pense antrieure organise autour des conflits et de linterdpendance des classes sociales dans la dfunte socit industrielle, qui prend en compte la ncessit dintgrer les catgories sociales et ethniques en prsence, si diffrentes soient-elles dans leurs ralits respectives et leurs aspirations, de les amener faire socit autrement quen misant sur une interdpendance objective devenue bien incertaine ? Cest cette dernire hypothse que nous privilgierons. Non quelle paraisse vidente. La cohsion sociale semble, bien des gards, un concept mou aux contours flous6. Il dsigne tantt des politiques sociales plus ou moins novatrices, tantt le civisme et la participation dmocratique la vie de la socit locale ou nationale. Bref, on le met un peu toutes les sauces. Mais cette extensibilit mme de lexpression peut aussi bien nous donner la cl de la tentative dont elle constitue le support et qui, selon nous, consiste modifier les lignes sur lesquelles reposait la solidarit dans sa version antrieure. La solidarit objective reposait dabord sur lidentit de classe, lappartenance, de gr ou de force, de chacun une profession qui valait destine et ensuite, surtout, sur la capacit de lEtat rduire les ingalits entre ces classes pour amortir la conflictualit entre elles, et tout cela, en faisant du social . Or, lobservation des contenus que recouvre prsent ladite cohsion sociale, va nous montrer luvre une rorientation subjective des bases de la solidarit. De deux manires, la premire faisant jouer
Cf Paul Bernard La cohsion sociale : critique dialectique dun quasi concept . CPDS Universit de
Montral. Lien social et politique-RIAC 41 : mars 1999. Prsentation de Judith Maxwell.
5 la confiance au plan horizontal par la valorisation des rseaux, de la connectivit, du capital social tandis que la seconde vise restaurer le consentement lautorit de lEtat, non plus par la rduction des ingalits sociales, mais par laugmentation des chances des individus. (partie II : Entre confiance et consentement).
DUN SYSTEME DE PENSEE LAUTRE
A quoi correspond donc, au plan des enjeux thoriques, cette rcente et soudaine excitation autour dune expression comme celle de cohsion sociale ? Bien sr, cette expression ne constitue pas, en elle-mme, une nouveaut et ceux qui la promeuvent tiennent dailleurs le souligner. Son origine, disent-ils avec une certaine insistance et le souci vident den lgitimer lusage, remonterait la sociologie naissante, Emile Durkheim en loccurrence. Cela lui vaut forcment certificat de qualit, en terre franaise du moins. Cette remarque ne rpond pas vraiment la question que nous posons mais permet de la mieux prciser. Pourquoi, donc, cette expression dj ancienne, connat-elle, prsent, un tel regain de faveur dans les milieux politiques, administratifs et intellectuels alors quelle ne sortait gure des milieux universitaires lorsquelle apparut en cette fin du XIX sicle ? De la sociologie durkheimienne, on avait justement surtout retenu le concept de solidarit, lequel avait aliment une doctrine politique longtemps dominante sous la Troisime Rpublique, celle du solidarisme cre par Lon Bourgeois en appui sur Durkheim, et qui avait servi de prlude lEtat providence comme aux trente glorieuses . Lexpression de cohsion sociale, elle, bien que promue en mme temps par Emile Durkheim ne fit pas spcialement recette jusqu la fin du XX sicle. Sociologue minent de lpoque de lindustrialisation naissante, thoricien dune conception de la solidarit associe la croyance en un progrs linaire de la socit, Durkheim pourrait-il servir aussi de rfrence pour lpoque actuelle, celle de la dsindustrialisation travers le concept de cohsion sociale ? Comment interprter au demeurant cette rfrence sa pense lors de deux moments aussi antithtiques ?
Pour rpondre cette question, il convient de se rapporter au livre fondateur de la rflexion durkheimienne, savoir sa thse intitule De la division du travail social soutenue en 1878. Car. il sagit bien de louvrage dans lequel se mettent durablement en place pour la suite de son uvre les significations respectives des trois concepts essentiels de sa
6 rflexion sur le sujet : 1) celui de division du travail social 2) celui de solidarit, avec ses deux variantes, celle dite de similitude et celle dite organique 3) celui, enfin et surtout, de cohsion sociale. Dans cet ouvrage, Durkheim vise dplacer le registre danalyse de ladite division du travail social, du plan conomique qui constituait sa seule grille de lecture depuis Adam Smith, vers un plan sociologique afin de lever les obstacles sa comprhension que constitue cette lecture conomique qui sest rvle simpliste et rductrice. Depuis son lancement par Adam Smith, cette analyse de la division du travail social, naurait fait, selon Durkheim, que bien peu de progrs . A tel point que les socialistes purent, tout loisir, fournir des exemples opposs ceux avancs par lconomiste pour invalider la lecture positive que ce dernier en avait fournie avec sa thorie du march, comme main invisible distribuant harmonieusement les places et les fonctions dans la socit proportion des talents et des aptitudes de chacun fournir les meilleures produits souhaits et au meilleur prix. Linjustice qui sest installe dans les rapports sociaux la faveur de cette confiance nave des gouvernants envers les vertus du march aurait vite conduit lmergence dune doctrine socialiste dont les tenants rivalisaient dans lart de dnoncer lirrationalit de celui-ci, et de faire litire de cette vision naturaliste dun agencement spontanment harmonieux des individus en socit par le seul jeu de loffre et de la demande. De sorte que les socits modernes staient mises osciller entre laffirmation toujours plus discutable des seules vertus du libralisme et la tentation de sa totale remise en question. Soit au nom de la tradition et du ncessaire retour ses vertus. Soit au nom du socialisme, utopique ou dEtat, comme on disait alors, mais tous deux galement hostiles au principe de lchange marchand comme mode dorganisation de la socit. Cest donc sur fond de ce sombre tableau des socits dveloppes dchires par des tendances doctrinales contraires sous leffet de la dception associe au march sur les rapports sociaux que Durkheim reprend la question de la division croissante des tches entre les individus. Quelle peut tre la fonction, demande-t-il, de cette division sociale des tches si ses effets apparents correspondent si peu ce que nous en dit lconomie librale ? Cette question est traverse par lvidente proccupation politique dun homme qui aspire occuper la fonction de pre fondateur dune Rpublique durable, en fournissant des arguments permettant de rcuser les contempteurs de cette dernire qui ne songent qu la remplacer par des formules condamnes par lhistoire comme le traditionalisme ou dautres qui condamnent lhistoire pour lui imposer un
cours rvolutionnaire ? Bref comment penser la fonction de la division du travail social si lon veut, comme lui, Durkheim, que vive la Rpublique ?! (Donzelot, 1994). Il importe de bien
7 ressaisir le ressort de sa dmarche si lon veut prendre la mesure du problme vis actuellement travers lexpression de cohsion sociale. La lecture smithienne de la division du travail social parait trompeuse aux yeux de Durkheim pour cette raison essentielle quelle fait reposer la solidarit de la socit sur lchange entre les individus, sur la dtermination par ceux-ci, en face face, selon le principe de loffre et de la demande, de la valeur de ce que chacun produit. En fonction de cette loi du march, chaque individu se spcialiserait dans la tche o il excelle le plus pour fournir une offre qui trouverait avantageusement preneur. De sorte, dit-il, que linterdpendance entre les producteurs spcialiss qui rsulte de cette logique du march ne serait, en bonne logique librale, que le produit de lindpendance foncire des individus et du bref contact qui stablit entre eux loccasion des changes marchands. Cette ide dune socit qui serait faite par des individus, partir des seuls libres changes quils effectueraient entre eux, parait aux yeux de Durkheim la principale erreur des conomistes. Elle autorise, en effet, la dnonciation de la socit par les socialistes au nom des injustices quelle produirait du fait de la rduction de son activit des changes entre individus obissant leurs seules motivations, quelles soient altruistes ou gostes. Cette lecture de la division sociale du travail conduit, explique Durkheim, se mprendre sur les vritables mcanismes fondateurs de la socit, prendre les mfaits occasionnels du march dans la socit pour la manifestation de ltre de celle-ci, alors que cet tre emprunte des lois autrement plus complexes et caches que lchange marchand. Dune manire gnrale, lconomie conduit prendre lapparence de la socit pour sa ralit profonde. Elle parait comme produite par un ensemble dindividus alors que cest linverse qui se passe, la socit qui produit un ensemble dindividus de plus en plus distincts raison de la division du travail social, la socit qui se trouve, elle-mme, la base du processus dindividuation et non comme son rsultat ! Pour dpasser cette fragilit du raisonnement smithien sagissant de la division sociale du travail et de la vision nave de son engendrement positif par les seules lois du march, Durkheim propose dinterroger la division du travail au titre de sa fonction sociale : en a-t-elle une, laquelle, et si tel parait bien tre le cas, pourquoi se trouve-t-elle si faiblement ressentie par les membres de la socit ? Ainsi pose, la question de la fonction sociale de la division du travail va lamener dmontrer, sinon la supriorit absolue de la sociologie sur lconomie politique, du moins son antriorit logique. Il procde en formulant deux thses, chacune lui fournissant loccasion dexpliquer, et le sens du concept de solidarit, et celui de la cohsion sociale. Car nous navons pas seulement chercher si, dans nos sortes de socits, il existe une solidarit qui vient de la division du travail... il faut surtout dterminer
8 dans quelle mesure la solidarit quelle produit contribue lintgration gnrale de la socit 7. Soit dabord le lien entre division du travail social et solidarit. Comment sopre lengendrement de la seconde par la premire ? Pour le comprendre, il faut, dit Durkheim, se rapporter non pas aux liens marchands circonstanciels entre les individus mais aux rgles juridiques profondes et intrinsquement sociales qui rgissent les comportements entre individus. Lire le droit, celui du commerce, des hritages, des socits de production, cest comprendre quel point la socit prcde lindividu l o il se croit roi, cest sortir du dilemme entre lgosme et laltruisme dans lexplication des conduites. Cest comprendre que la conscience que les individus acquirent de leurs valeurs respectives se trouve dtermine par la ralit de leur interdpendance dans la socit considre comme un organisme complexe o la division du travail social produit une solidarit qui nest pas le fruit dune morale variable selon les individus, extrinsque donc la socit, mais dune moralit intrinsque . Cest parce que la division du travail devient la source minente de la solidarit sociale quelle devient du mme coup la base de lordre social 8. Vient ensuite la question du rapport entre cette solidarit objective de la socit et sa cohsion effective, plus ou moins ressentie par tous ses membres. Pour apprcier ce second niveau de la fonction de la division du travail social, il convient, toujours selon Durkheim, de prendre en compte, non seulement le droit stricto sensu, mais le progrs de la justice dans le cadre de cette moralit intrinsque de la socit quil lui incombe de faire valoir. Car le processus de la division du travail dfait les anciennes croyances collectives qui produisaient jusqualors la cohsion sociale, affranchissant les individus sans que la vie nouvelle de la socit ne soit organise de faon satisfaire le besoin de justice qui surgit alors dans les curs. Cette situation anomique ne peut donc cesser par un retour en arrire, vers les croyances traditionnelles, qui ne peut que prendre contre-pied linterdpendance objective croissante entre les hommes. Elle ncessite justement lintroduction dans les rapports sociaux dune justice et dune moralit la mesure de linterdpendance nouvellement cre. La cohsion sociale apparat lorsque lon tire toutes les consquences de la solidarit objective qui unit les hommes en socit. La fonction de cette division du travail social consiste donc, in fine, induire la morale collective ncessaire la cohsion sociale, dans une socit o les individus sont de plus en plus libres et de plus en plus lis par une solidarit objective.
7 8
Durkheim, opus cit, pp 27-28 Durkheim, opus cit, pp 396.
Le raisonnement de Durkheim propos de la cohsion sociale revient donc dire : il y a plus important que le march, il y a la division sociale du travail, laquelle produit une solidarit objective qui appelle une moralit collective intrinsque cet tat de la socit. Cest parce que lon rduit la socit la logique du march que lon passe ct de son fonctionnement, de ses rgles juridiques, de la dpendance mutuelle o celles-ci placent les individus. Parce que le march leur fait croire quils sont autant datomes libres dchanger et ainsi de dterminer leur place dans la socit comme de former celle-ci. Par contre, lorsquon se situe dans un raisonnement sociologique, il est ais de voir lexistence dun enchanement progressif et progressiste entre division sociale du travail, solidarit et cohsion sociale. Tout est affaire de prsance dans la comprhension de la socit entre la sociologie et lconomie. Seule la premire place dans le bon ordre ces trois concepts. Seule la sociologie peut donc sauver la Rpublique des tentations traditionalistes ou rvolutionnaires en remettant lconomie sa place : celle dune science des apparences dont il faut matriser les effets ngatifs si lon veut comprendre comment le march ne prcde pas la socit mais en procde !
Cette conception durkheimienne de la cohsion sociale peut elle tre encore de mise prsent que lexpression connat une nouvelle fortune ? On voit bien que tous les lments du raisonnement durkheimien ont perdu leur crdibilit. On ne parle plus maintenant de la fonction de la division sociale du travail en tant quelle produirait une solidarit objective entre les membres de la socit et induirait ainsi sa cohsion sociale. On nen parle plus de peur de paratre ridicule lre de la dlocalisation, du capitalisme actionnarial, de limmigration plantaire des pauvres vers les pays riches, de la migration des membres aiss des pays riches vers les nations o elles profitent dune moindre redistribution fiscale et sociale. Mais cest pour reconnatre que, ds lors, la cohsion sociale ntant plus adosse cette solidarit objective, devient un problme majeur pour toutes les socits, riches et pauvres , tant par ses causes que pour ses consquences. On parle ainsi de la concurrence en tant quelle dfait la cohsion sociale mais tout autant la ncessite pour que chaque individu se sente suffisamment adoss la socit, et ainsi que chaque socit soit assez forte pour se montrer la hauteur de la comptition mondiale. De mme, ny a-t-il plus une lecture du progrs qui transcenderait le devenir des socits modernes ce que certains prfrent appeler modernit tardive ou modernit rflexive . Cen est fini galement du dbat entre
10 lconomie et la sociologie. Lconomie et la sociologie ont dplac le registre de leurs analyses respectives dune manire qui rend leur confrontation ncessaire mais jamais suffisante. Au plan de lconomie, tout a chang avec la substitution du no-libralisme au libralisme smithien. Le no-libralisme dpasse les critiques dont le libralisme pouvait faire lobjet parce quil sest prcisment construit sur un refus explicite de la lecture navement naturaliste du march, substituant celui-ci une thorie de la concurrence conue non comme un fait de nature mais comme une ide quil convient de raliser, de produire et non de laisser se faire. La diffrence est en effet de taille puisque la concurrence relve dune construction volontaire ncessitant une politique de socit propre entretenir sa vitalit. Ce dplacement du march vers la concurrence, Michel Foucault la analys comme le produit dune condamnation par les nolibraux du mode de gouvernement qui nous avait conduit de Smith Keynes au fur et mesure que les aberrations lies cette vision nave du march remettaient en cause le libralisme (Foucault, 2004). Bref, cest le libralisme classique qui aurait conduit ltatisation de lconomie, ltatisme correcteur de la socit dans toutes ses formes, monstrueuses comme le fascisme ou le stalinisme, insidieuses comme le keynsianisme. Car, lEtat correcteur du march nexiste et ne se dveloppe quautant que lon croit paradoxalement en la seule efficacit du march, que lon veut la prserver, contre ceux qui la critiquent, contre ses consquences erratiques pour lconomie et nocives pour la socit. En substituant le concept de concurrence celui de march, les no-libraux valident bien aussi lintervention de lEtat mais dune toute autre manire que les libraux. Son intervention devient ncessaire tant les obstacles existent face elle puisquelle nest pas un fait de nature librer, mais une ide mettre en uvre. Toute ide, pour marcher, doit tre dfendue, soutenue. La concurrence appelle la capacit sy livrer, donc une politique adquate dans tous les domaines. La politique no-librale ncessite une action de lEtat soucieuse de mettre la socit en capacit de concurrence, y compris entre ses membres par la lutte non plus contre les ingalits au nom de la justice sociale, mais contre lexclusion dans la mesure o celle-ci diminue la capacit concurrentielle des membres de la socit en permettant que certains se trouvent hors jeu de ladite concurrence. Quant au raisonnement sociologique, il scarte, prsent, aussi sensiblement de celui tenu par Durkheim que les no-libraux de la pense dAdam Smith. Il dnonce la croyance linaire dans un progrs technique, conomique et social qui paraissait le rsultat gnral de la sociologie classique . Cest visiblement le cas des auteurs phares de la sociologie dans le nouveau systme de pense que sont, Ulrich Beck (2001), Anthony Giddens (1994), Richard
11 Sennett (2000, 2006). Au lieu du bel ordonnancement fonctionnaliste et progressif de la division du travail social, de la solidarit et de la cohsion sociale, cest lincertitude des effets sociaux et environnementaux de cette division sociale du travail, la disparition mme de la solidarit objective au niveau national au moins, la menace de la perte de la cohsion sociale, quils mettent en avant. Pour eux, la fonction providentielle classique de lEtat, la croyance dans le progrs ne sont plus que manire de tourner le dos la nouvelle ralit. Bref, cest la remise en question de tout le systme de pense antrieur qui constitue la cible de leurs analyses. Il ny a plus de solidarit objective, il ny a plus une dpendance mutuelle dductible de la division sociale du travail qui rconcilierait et harmoniserait miraculeusement la libert individuelle croissante et la morale commune. Cen est fini de lre fordiste et keynsienne, fini de ces trente glorieuses annes pendant lesquelles laugmentation de la richesse globale est alle de pair avec une rduction des ingalits, une protection sociale croissante et une mancipation sereine des individus. La mondialisation rend inutile, inexploitable, une partie de la population, fait prvaloir le capitalisme actionnarial sur la rationalit industrielle, la diversit des cultures et des ethnies sur la socit homogne. La cohsion sociale nest plus le rsultat escomptable de la rationalit luvre travers une solidarit objective. Elle devient le fait dune mobilisation politique de la socit civile face lensemble des risques quelle encourt, en appui sur des individus libres et responsabiliss en tant que tels et non pas au nom dune interdpendance positive et unificatrice. Le rle du politique ne peut plus tre de sappuyer sur la solidarit objective pour dvelopper la conscience et les pratiques de justice quelle appelle. Il nest plus le garant ou le gestionnaire du progrs mais celui qui incite la socit civile produire la cohsion sociale par rapport une situation de comptition qui, tout la fois, la menace et la fait valoir comme un atout pour la russite conomique. Il est devenu animateur (Donzelot, 1994), superviseur (Innerarity, 2006), selon les nouvelles formules avances son propos, cest--dire un Etat qui rend capable chacun dagir, dentrer dans le jeu, et tous, de former un ensemble uni par des buts externes (la comptitivit), et internes (un idal de vie commune).
ENTRE CONFIANCE ET CONSENTEMENT
12 Si la solidarit objective ne permet plus de fonder la cohsion sociale, comment tablir ou rtablir celle-ci de manire ce que la comptition conomique internationale ne dpasse pas par trop lexistant et, mieux encore, que la comptitivit de chaque socit se trouve amliore par la force des liens unissant les membres de celle-ci ? Tels sont bien, de fait, les termes du problme pos dans toutes les enceintes o lon se mobilise avec une fbrilit croissante sur ce fameux objectif de production de la cohsion sociale. La rponse parat, dune certaine manire, aller de soi. Puisque la dite cohsion ne peut plus, ou plus autant, prendre appui sur linterdpendance objective existant entre les membres dune socit plus ou moins dfaite et refaire, il convient donc de miser sur la dimension subjective des liens sociaux, sur cette part volontaire, intersubjective qui entre en ligne de compte dans la production du lien social. Quest-ce qui unit les membres dune socit hormis la complmentarit produite par la division du travail social ? La confiance, la certitude que les autres membres de la socit seront disposs vous aider dans vos taches, dans la rsolution de vos difficults, la croyance de chacun quil pourra laborer et raliser avec les autres des projets. La confiance aussi dans les institutions, dans lEtat et le gouvernement, dans la volont et la capacit des dirigeants de conduire pour le mieux ce frle esquif quest devenu une socit lheure de la mondialisation, de veiller au sort de chacun en mme temps qu lefficacit de lensemble, de ne pas sacrifier lun lautre. Sans doute ne sagit-il pas du mme type de confiance que celle existant entre les gens et celle manifeste envers lautorit des dirigeants. Autant la premire se dploie sur un plan horizontal, tramant des liens entre gaux, autant la seconde se situe sur un plan vertical, tablissant des liens dobissance entre dirigs et dirigeants sur le mode de lacceptation de la prminence des uns sur les autres. Aussi vaut-il mieux parler de consentement en ce second cas que de confiance si lon veut prendre en compte cette diffrence de registre. Encore faut-il prciser, que la confiance entre les gens et le consentement envers les dirigeants sont difficilement dissociables. Car nest-ce pas la confiance envers lEtat qui permet celle entre les gens dans la mesure o son autorit assure chacun que lautre se comportera vis--vis de lui de la manire quil prvoit ? Et cette dernire ne parat-elle pas ncessaire la manifestation de la premire, car que serait lautorit de lEtat dans une socit en conflit permanent ? (Donzelot, 2003) De la confiance entre les gens ou du consentement envers les autorits, quest-ce qui doit tre considr comme le plus dterminant ? Cette question spare en deux courants, sinon trois, les textes contemporains relatifs la cohsion sociale. On a dabord ceux qui mettent en avant avec le plus dinsistance la ncessit de dvelopper la confiance entre les gens pour
13 compenser les effets de la perte de solidarit objective. Ils se regroupent autour du concept de capital social, similaire leurs yeux de celui de cohsion sociale. Et puis il y a ceux qui font prvaloir la ncessit de restaurer le consentement envers les autorits. Encore faut-il considrer que la plupart des textes rcents consacrs la cohsion sociale font rfrence au capital social, considrant les deux expressions tantt comme synonymes, tantt comme distinctes, tantt comme complmentaires. Synonymes par dfaut de dfinition claire et consensuelle de la notion de cohsion sociale, alors que le capital social fait lobjet dune laboration thorique croissante, depuis le dbut des annes quatre-vingt dix, dans la mouvance amricaine. Distinctes par ncessit, pourrait-on dire, dans certains pays comme la France, o la juxtaposition de ces deux termes de capital et de social donne limpression dun oxymore ! Complmentaires au sens o le capital social serait une composante de la cohsion sociale, ncessaire mais non suffisante, dans un certain nombre de pays comme pour la plupart des organismes internationaux ports par la nature oprer des syncrtismes entre des penses issues de contextes diffrents. Y a-t-il dbat entre ces deux options ? Il serait plus juste de parler de polarisation de la rflexion que daffrontement thorique. Chaque tendance semploie dmontrer quantitativement lintrt de loption quelle adopte plutt qu dnoncer lerreur en quoi consisterait le parti pris adverse. Au demeurant, il ne manque pas de tentatives cherchant combiner les avantages des deux options pour ouvrir une troisime voie .
Pour comprendre limpact du concept de capital social, sa place dans lensemble des partitions relatives la cohsion sociale, il faut commencer par ltude de sa gense et du contexte de celle-ci. Au dpart de la thorisation, aux Etats-Unis, du capital social, on trouve une rflexion sur lutilit des rseaux dans la lutte contre le chmage dans les zones urbaines dfavorises. Cette rflexion prend appui sur un article canonique de Mark Granovetter publi en 1973 et intitul La force des liens faibles . Lauteur sinterroge non pas sur les guichets quil conviendrait de mettre la disposition des demandeurs demploi, mais sur lutilit que peut reprsenter lentourage de celui-ci dans sa dmarche. Au sein de cet entourage relationnel, il distingue deux registres. Tout dabord, les liens forts, ceux de la famille, du voisinage immdiat, de la communaut dappartenance. Ils servent dappui matriel et moral pour celui qui recherche un emploi mais lui sont rarement dune utilit particulire pour identifier les ressources demploi. Ils se situent du ct de la dbrouillardise, pas de la solution durable. Celle-ci provient plutt des liens faibles, ceux que lon tablit loccasion
14 de circonstances particulires, lors des sorties en dehors de son milieu. Ils ne sont pas entretenus avec la mme rgularit, mais peuvent bien mieux dispenser une information sur des opportunits demploi que la communaut dappartenance en raison du caractre relativement ferm et limit de celle-ci (Granovetter, 1973). Lutilit de cette dernire apparat en fait surtout, et mme se montre indispensable, pour soutenir la dmarche de celui qui veut saisir sa chance telle quelle apparat travers les liens faibles et quelle ncessite une aide pour sa ralisation. Car la force des liens faibles repose in fine sur celle des liens forts. Cette rflexion sur limportance des rseaux dans la construction de la capacit collective et individuelle se trouve au principe de lmergence du concept de capital social tel que pens, tout particulirement, par Robert Putnam. Elle a dabord nourri lhypothse dune grande enqute quil a conduite sur la dmocratie en Italie avec Robert Leonardi et Raphalle Nanetti publie en 1993. Comment se faisait-il quil existt dans ce pays des rgions - au Nord - o la vie dmocratique, comme la vie conomique, connaisse un grand panouissement et dautres, au Sud, o elle ne rsiste pas aux comportements mafieux et dprissent ? Aprs avoir limin tous les paramtres susceptibles dentrer en relation avec ce phnomne, un seul rsista aux yeux des chercheurs : la densit des associations et tout particulirement les chorales et les clubs de football ! Quest-ce qui pouvait bien expliquer cette corrlation ? Ceci que de telles associations comportent une dimension civique latente ou explicite qui diffuse une confiance entre les gens. Cette confiance facilite linvestissement dans la vie publique parce que chacun se trouve dispos agir sans attendre un retour immdiat de son effort ds lors quil sait pouvoir compter globalement sur la collectivit. Cela galement que lexistence de cette confiance gnralise, donc non restreinte un cercle interpersonnel bien dfini, cre un climat propice aux transactions commerciales et donc la vie conomique. La confiance a priori raccourcit le temps requis pour les transactions dans la mesure o les parties en prsence nexigent pas de garanties qui freineraient le processus dchange. Lconomique comme la dmocratie prosprent donc sur fond dune confiance que produisent les associations de caractre civique. (Putnam, Leonardi, Nanetti, 1993) Cette analyse du rle des rseaux et de la confiance quils instaurent entre leurs membres, comme dans la socit dune manire gnrale, servent de plus en plus, aux EtatsUnis, de cadre thorique pour rationaliser la stratgie adopte pour rgler aussi bien les problmes sociaux, comme le chmage, le crime, la relgation socio-urbaine, que pour combler le dficit de la volont de vivre ensemble qui est devenue manifeste avec, par exemple, le dveloppement des communauts fermes et toutes les formules de scession qui
15 affectent la socit amricaine. La formule des Corporations de Dveloppement Communautaire (CDC) na pas attendu la thorie du capital social pour se propager et servir de remde principal aux zones urbaines dfavorises. Mais elle vient apporter une explication leur russite en identifiant la raison de celle-ci, cette manire civique de construire une communaut, par lapprentissage de la tolrance entre ethnies, par la confiance mutuelle quelle requiert de tous pour llaboration dun projet commun de dveloppement, par lesprit de disponibilit mutuelle, de dmocratisation des prises de dcision, par louverture surtout de la communaut sur son dehors, via les alliances quelles oprent avec les milieux du business ou des universits, brefs les fameux liens faibles qui donnent tant de force. Il ne manque pas non plus danalyses dmontrant, avec toute la rigueur quantitative requise comme on sait jusqu lextrme aux Etats-Unis, que le crime diminue lorsque le capital social augmente et inversement. La lutte contre la dpendance envers laide sociale, loccasion de la welfare reform de 1996, prend largement appui sur cette analyse qui valorise le rle des rseaux proches et lointains dans la recherche demploi. Sagissant de la volont du vivre ensemble, Robert Putnam souligne limportance de la dynamique des Corporations de Dveloppement Communautaire pour contrer la tentation de lisolement que reprsentent les gated communities, la perte de confiance en soi et en les autres quelle symbolise (Putnam, 2001). Lide de la confiance horizontale entre les gens, thorise ou non, travers le concept de capital social connat galement une indniable fortune dans les plupart des pays europens. Elle prend moins appui sur la notion de communaut sauf en Grande-Bretagne que sur la promotion du local, du quartier, du territoire dune agglomration, comme espaces o peut et doit se manifester cette confiance. Les partenariats stratgiques locaux (Local Strategy Partneship) ont t institus en Angleterre dans les quartiers les plus dfavoriss avec lide bien affirme de rtablir la confiance entre les diffrentes catgories dhabitants, mais aussi les prestataires de services, les hommes daffaires tents dy investir, afin de lutter par cette force contre celle, ngative, de la sparation qui apparat entre ceux-ci mais surtout entre ces quartiers et le reste de la ville, voire la socit en gnrale (Rob Atkinson, 2000). Les Hollandais, les Scandinaves, les Allemands, orientent leurs politiques dans ce sens. Et la France na-t-elle pas fait de mme, en lanant le Dveloppement Social des Quartiers pour inaugurer sa politique de la ville ? On pourrait mme estimer que la fortune toute aussi rcente du concept de gouvernance, pour dsigner les nouvelles formules de gouvernement des villes, doit son explication cette promotion de la confiance horizontale. Ne sagit-il pas, en effet, avec la gouvernance, de rapprocher toutes les forces qui paraissent parties prenantes (stakeholder) un titre ou un autre au devenir de la ville, dassocier ainsi, certes, les
16 prsidents dUniversit et les businessmen, mais aussi bien les associations dhabitants dans le processus de prise de dcision ? Au niveau international, la thorie du capital social a trouv un cho important auprs dun organisme comme la Banque Mondiale en charge daider les pays en dveloppement. Pourquoi tel pays, qui dispose de ressources naturelles et qui reoit, pour les dvelopper, laide de la Banque Mondiale, ny parvient-il pas ? Voil la question par excellence que se posaient les responsables de cet organisme. Et voici que leur arrive, avec la thorie du capital social, la rponse. Si chec il y a, celui-ci nimplique ni le rgime conomique ni le rgime dmocratique ni la Banque Mondiale, mais la faiblesse du capital social et corollairement, la mauvaise qualit de la gouvernance dans ce pays. La solution simpose alors delle-mme. Pour que la Banque Mondiale russisse dans son entreprise, il convient quelle naccorde pas mcaniquement son aide financire mais lassortisse dun investissement pralable dans la constitution ou la reconstitution du capital social et lapprentissage dune bonne gouvernance. Ainsi peut-on entrevoir, dans cette recherche dune confiance entre les gens, au niveau dune communaut, dune entreprise, dun quartier, dune ville, la volont de trouver un substitut la solidarit de classe. La disparition de celle-ci va de pair avec celle de la conflictualit sociale rgle mais aussi avec lapparition dun autre danger, la sparation spatiale, sociale et ethnique, prjudiciable la dynamique de la socit. La promotion de la confiance dans tous les registres des regroupements existants entre les gens offrirait une alternative avantageuse la dfunte solidarit de classe, puisque oriente vers le bon fonctionnement de chacune de ces entits et non plus le conflit, en mme temps quelle permettrait denrayer la logique de sparation qui porte socit se dsagrger. La communaut comme alternative la solidarit de classe ? Nest-ce pas aussi illusoire que dangereux ? demandent certains. Car la communaut peut enfermer chacun de ses membres dans son unit et susciter plus la surveillance mutuelle que la confiance. Emport par son lan critique, un philosophe anglais dinspiration foucaldienne, Nikolas Rose, est all jusqu comparer ces communauts de quartier au clbre panopticon de Bentham qui permettait une grande conomie dans la police des conduites des individus (Rose, 1996). A une diffrence prs mais qui pourrait paratre comme un raffinement supplmentaire dans lart du contrle. Car lil du gardien dans le panopticon permettait de voir sans tre vu par ceux quil surveille, donc de produire des effets mme en labsence de toute surveillance effective. A prsent, le gouvernement trouverait le moyen de se rendre invisible chacun en se cachant dans le regard de son voisin ! Et le tout, cette fois, au nom de la confiance au lieu de la crainte ! Quiconque connat les difficults de ces communauts de
17 quartier trouver un minimum de consistance naccordera pas grand crdit cette hantise dun nouveau big brother. Linquitude en question justifie nanmoins que lon sinterroge sur ce qui fait ou non que lesdites communauts souvrent sur leur dehors et procurent une force leurs membres, ou bien permet seulement une gestion moindre cot et pour le seul bnfice de lordre public travers le confinement ou les membres de ces communauts se retrouvent du fait de lactuelle logique de sparation qui mine la socit et qui porte chaque catgorie sloigner de la zones dhabitation de la catgorie immdiatement en dessous delle, isolant ainsi au maximum les plus pauvres au nom de leur dangerosit suppose ou relle mais surtout du prjudice quelle reprsente dans la comptition ouverte au plan de la scolarit.
La stratgie de la solidarit par la confiance prsente une limite, ce risque quelle contient de ne servir surtout qu lamlioration de lordre public, sans bnfice particulier pour ceux, les plus pauvres, auprs desquels on sefforce particulirement de la promouvoir. Quadvient-il donc, prcisment, dans la nouvelle socit librale, du second volet de la confiance, celle envers les institutions et que nous prfrons dsigner par le terme du consentement ? Jusqu lavnement du nolibralisme, lautorit des gouvernants, le respect envers les institutions et les services publics, prenaient appui sur la volont manifeste de lEtat de rduire les ingalits de revenus entre les classes, la part du travail par rapport celle du temps libre, bref duvrer au progrs social. Et celui-ci se ralisait dautant plus aisment que le rapport de force stablissait en faveur des catgories les plus nombreuses, les moins qualifies, du fait de leur rle dcisif dans la production industrielle de masse. Mais depuis que celle-ci parait de moins en moins de mise, depuis que les conflits sociaux menacent moins le rythme de production quils ne visent de manire dsespre retenir la fermeture dune entreprise ou sa dlocalisation, depuis que la richesse repose sur une conomie de lintelligence dont le personnel qualifi peut et menace de sexporter en raison des meilleurs salaires quon lui offre dans dautres nations, comment obtenir lassentiment de tous et surtout des moins favoriss envers les institutions et les gouvernants ? On ne peut plus, en faisant du social , prtendre rduire les ingalits sans prendre le risque de faire fuir les comptences et les entrepreneurs. Tout au plus, peut-on colmater les brches les plus videntes qui apparaissent avec le chmage de longue dure et lexclusion. Encore faut-il procder avec une extrme prudence tant le risque parait grand de dcourager les investisseurs et dattirer les migrants des pays pauvres par la manne tatique. Au lieu du cercle vertueux reliant la croissance conomique et le progrs social, les gouvernants
18 daujourdhui se trouvent confronts au choix entre maintenir la comptitivit ou le niveau de la redistribution. Et comme une option claire dans un sens ou dans un autre parait impossible, les politiques produisent des mcontents de tous cts. Ils nont plus de conflits rgler mais des dsordres rparer, ceux des cits de relgation o senlisent les minorits ethniques, ceux des jeunes confronts un march du travail qui ne fait pas grand cas de la valeur de diplmes conus durant lre du progrs social. Voici pourquoi lon est pass du cercle vertueux de la productivit et du progrs social la difficult denchaner comptitivit et cohsion sociale. Pour obtenir le consentement leur action, les gouvernants disposent pourtant dune solution. Sil est devenu difficile, de faire de la lutte contre les ingalits sociales la vise dclare de leur action, ils peuvent avantageusement lutter pour la rduction de lingalit des chances. Ils ne risquent pas ainsi de heurter la classe mergente de la mondialisation qui se targue de ses mrites, des efforts dploys par leurs membres pour acqurir leur comptence et qui refusent, ce titre, de contribuer aux revenus de ceux qui ne font pas le mme effort dadaptation queux-mmes. Ds lors que leur contribution serait explicitement destine lutter pour laugmentation des chances de tous, comment pourrait-il la refuser ? De plus, une telle action rencontre le fameux impratif de comptitivit auquel les dirigeants se trouvent confronts sils ne veulent pas apparatre comme des fossoyeurs de la nation. Il ne sagit plus tant de redistribuer passivement que dinvestir. Lide de restaurer le consentement envers lautorit des institutions par la lutte pour lgalit des chances, alimente de plus en plus laction des gouvernements. Quand, en France, on parle de cohsion sociale, cest surtout cette ide dgalit des chances que lon pense et, travers elle, la reconqute du consentement envers lautorit des institutions que lon songe restaurer, tant lautre volet de la confiance, celui qui dsigne celle entre les gens y parait grosse du danger de faire, dans les cits dhabitat social peuples de migrants du moins , le lit de lennemi par excellence de la Rpublique, le fameux communautarisme. Pour rtablir ce consentement le Ministre de la Cohsion Sociale semploie explicitement lutter pour lgalit des chances, par le biais dune rnovation urbaine, elle-mme place sous le signe de la mixit sociale. Il y a, en effet, dans la mixit sociale urbaine, une ide qui entre en rsonance avec celle de lgalit des chances. Faire cohabiter les classes dites populaires et dites moyennes, cela revient tablir entre les individus un principe dingalit dynamique, une gale ingalit propice lentranement des plus faibles par les plus forts. La dimension scolaire de cette mixit sociale constitue le principal champ dapplication ou, du moins, dillustration thorique des bienfaits potentiels de cette politique dgalit des chances.
19 Nul doute en effet que lmulation, lexemple, lenvie chez les enfants pauvres dgaler les rsultats de la classe plus leve, ne puissent constituer pour eux un puissant ressort, capable de compenser leur handicap culturel de dpart. Voil pourquoi le gouvernement sest lanc, en France, officiellement du moins, dans un ambitieux programme de dmolition et de reconstruction de cette part des cits dhabitat social o se trouve concentre la population la plus marginalise, celle des minorits visibles, de faon ce que les nouvelles habitations puissent accueillir, pour moiti au moins, des classes moyennes. Do vient alors que cette politique de cohsion sociale par lgalit des chances travers la mixit sociale de lurbain nait pas suscit le consentement escompt ? Car cest le moins que lon puisse dire sagissant des destinataires directs de la rnovation urbaine, le peuple color des cits , si lon songe aux meutes de novembre 2005, lesquelles se sont tout particulirement droules dans des cits o des dmolitions taient programmes ! (Donzelot, 2006) Pourquoi tant de fureur envers une politique qui leur voulait tant de bien ? Sans doute parce que ces oprations diminuaient, leurs yeux, le peu de pouvoir quils avaient sur leur vie, du fait de la matrise relative de leur cadre de vie. Mais, plus gnralement, cest tout le discours de la lutte pour lgalit des chances qui rencontre dans la socit un certain scepticisme. Au point que seule une partie de la droite politique se risque le tenir en France. Il y a crainte, en effet, que cette politique ne soit que la justification dun abandon de la redistribution sociale de la richesse nationale, quelle ne consiste quen une lutte contre lexclusion par souci de lordre public, mais sans bnfice pour la plus grande part de la population soumise une vulnrabilit croissante de lemploi. La critique donne voir le remde. Pour quil y ait adhsion une action publique conduite au nom de lgalit des chances, il faudrait dabord quelle vise, chez les plus faibles, le renforcement de la confiance en eux et entre eux, afin que les leviers quelle propose soient saisis sans apprhension. Il faudrait ensuite et surtout que la lutte pour lgalit des chances prolonge de manire vidente la lutte contre lexclusion au lieu de sy borner. Cela suppose non pas de rduire la redistribution mais de la redployer sur la base dun nouvel argumentaire. Lequel consisterait se demander systmatiquement quelles politiques de sant, dducation, de formation, de logement, daccs lemploi, permettent le mieux aux diffrentes composantes de la socit de voir les chances de leurs membres se rapprocher ? Cela suppose de rapporter chaque politique chaque groupe social ou ethnique, chaque rgion, partout o de telles mesures sont possibles. Un tel travail de suivi, de monitoring, permettait de dmontrer le souci des gouvernants de prendre en compte galement chaque groupe, chaque ethnie, chaque rgion, de veiller une galit, non pas abstraite mais concrte.
20
Cette rapide exploration des bnfices mais aussi des risques associs la promotion de la cohsion sociale par lune et lautre des deux branches selon lesquelles sorientent les actions conduites au titre de la confiance et du consentement pour remdier aux dfaillances de la solidarit objective permet dentrevoir les conditions dune reconfiguration de lEtat qui protge en un Etat qui rend capable . Confiance entre les gens et consentement envers les institutions contribuent de manire ingale, selon les nations et les organismes, la dfinition de la proccupation apparue avec lexpression de cohsion sociale. Mais quelque soit le dosage existant entre ces deux ingrdients, rien ne parait plus vident que la ncessit de penser leur complmentarit. Car il apparat clairement quil nest pas de politique
damlioration des chances de chacun qui puisse devenir effective si elle ne prend pas appui sur son milieu dappartenance, si elle ne rend pas celui-ci capable de sapproprier les nouvelles opportunits et daider les individus les saisir. De mme, il nest pas dinvitation dvelopper le civisme, tant au niveau local de la communaut quau niveau national , qui ne soit crdible auprs de gens qui ne percevraient pas clairement la volont de la puissance publique doffrir chacun, autant que possible, les mmes chances. Les motifs de limpasse o se trouve lEtat-providence sont bien connus. Ils tiennent ceci quil dispose de moyens ncessairement finis face une demande potentiellement infinie. Et cette potentialit alimente largumentaire de ceux qui rclament une responsabilisation individuelle des prestations comme seul moyen de rduire linflation des demandes, quitte consentir une aide minimale pour la part la plus ncessiteuse de la population, au nom de la lutte contre lexclusion qui trouve son premier fondement dans le nolibralisme lui-mme et ne risque gure ainsi de perturber lexigence de comptitivit. Entre cette orientation minimaliste et la dfense de lEtat-providence hrit de lre du progrs, il existe bien une troisime voie. Celle dune rorientation de cet Etat-providence dans le sens non plus dune confrontation entre moyens finis et demande infinie mais de la vise simultane de lgalisation aussi grande que possible de lgalit des chances de chacun et du civisme de tous. Dmontrer que laction de solidarit est soucieuse de rapprocher les chances de tous ne peut quenrayer linflation dune demande qui sautorise du droit en soi et non des moyens relatifs lgalit. Faciliter ainsi le civisme ne peut quorienter chacun dans le souci de lavenir de la socit laquelle il appartient au lieu quil attende de celle-ci la seule protection de son existence spare.
21
22
BIBLIOGRAPHIE
Atkinson R., Combatting social exclusion in Europe, the new urban policy challenge . 2000. Urban Studies, n 37 pp.1037-1055. Beck U., 2001 [1992], La socit du risque, Paris, Aubier. Delevoye J.-P., 1997, Cohsion sociale et territoires . La Documentation Franaise Donzelot J., 1994, Linvention du social, Paris, Seuil, rdition. Donzelot J., 2003, Faire socit. La politique de la ville aux Etats-Unis et en France, Paris, Seuil, coll. La couleur des ides . Donzelot J., 2006, Quand la ville se dfait, Paris, Seuil, coll. La couleur des ides . Durkheim E., 1978 [1893], De la division du travail social, Paris, PUF, coll. Quadrige . Fragonard M., 1993, Cohsion sociale et prvention de lexclusion. La Documentation Franaise. Foucault M., 2004, Naissance de la biopolitique. Gallimard /Seuil, coll. Hautes tudes . Granotter M., The strongs for weak ties hypothetis , American journal of sociology, 1973 in Le march autrement . Descle de Brouwer. 2000. Giddens A., 1994 [1991], Les consquences de la modernit. Lharmattan. Innerarity Daniel. La dmocratie sans lEtat. Essai sur le gouvernement des socits complexes. Climats 2006. Putnam R., 2001, Bowling alone. Simon & Schuster. Putnam R., 1993, Making democracy works. Princeton Universty Press. Rose Nikolas. Foucault and the political reason. Routledge. 1996 Sennett R., 2000, Le travail sans qualit, Paris, Albin Michel.. Sennett R., Respect. Albin Michel. 2003. Sennett R., 2006, La culture du nouveau capitalisme, Paris, Albin Michel. .
Vous aimerez peut-être aussi
- FR USHARE Piano Compensi 7 5Document49 pagesFR USHARE Piano Compensi 7 5Royer Hyacinthe100% (1)
- Économie Sociale Et Secteur InformelDocument6 pagesÉconomie Sociale Et Secteur InformelHicham AlaouiPas encore d'évaluation
- Démocratie Bruno BernardiDocument14 pagesDémocratie Bruno BernardiveraPas encore d'évaluation
- Pour en finir avec ce vieux monde: Les chemins de la transitionD'EverandPour en finir avec ce vieux monde: Les chemins de la transitionÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (1)
- Faire Collectif de La Constitution A LaDocument29 pagesFaire Collectif de La Constitution A LaetiemblePas encore d'évaluation
- Philosophie de La Libération Et Tournant Décolonial, Cahiers Des Amériques Latines #62 - 2009,3Document160 pagesPhilosophie de La Libération Et Tournant Décolonial, Cahiers Des Amériques Latines #62 - 2009,3Kenny THELUSMAPas encore d'évaluation
- La Social-Écologie en DébatDocument160 pagesLa Social-Écologie en DébatTopetePas encore d'évaluation
- Économie Solidaire Et Autres Concepts Poirier Juillet 2014Document27 pagesÉconomie Solidaire Et Autres Concepts Poirier Juillet 2014Othmane ADPas encore d'évaluation
- Capital Social Et Theories Sociologiques 2006Document14 pagesCapital Social Et Theories Sociologiques 2006Gbale Pregnon ThierryPas encore d'évaluation
- Ethique L1 - Chap 2Document15 pagesEthique L1 - Chap 2PharellePas encore d'évaluation
- Afrique Et Monde Arabe (Samir Amin, Hakim Ben Hammouda Etc.) (Z-Library)Document183 pagesAfrique Et Monde Arabe (Samir Amin, Hakim Ben Hammouda Etc.) (Z-Library)Ala BahriPas encore d'évaluation
- Les Cons Quences Du Capitalisme Du M Contentement La R Sistance Chomsky Noam Waterstone MarvDocument502 pagesLes Cons Quences Du Capitalisme Du M Contentement La R Sistance Chomsky Noam Waterstone MarvOUATTARA MOUSSAPas encore d'évaluation
- Le Multiculturalisme - Patrick SavidanDocument102 pagesLe Multiculturalisme - Patrick SavidanMaurício Tombini100% (1)
- 1 - Preface La CSC Syndicat 45 Ans de Progrès SocialDocument4 pages1 - Preface La CSC Syndicat 45 Ans de Progrès Socialfilgoud67Pas encore d'évaluation
- 1987 6938 1 PBDocument9 pages1987 6938 1 PBYussuf ElPas encore d'évaluation
- Aides Sociales Representations de La JusDocument37 pagesAides Sociales Representations de La Jusزقعار مصطفىPas encore d'évaluation
- Travail Recherche - Pol 1600Document11 pagesTravail Recherche - Pol 1600OlympePas encore d'évaluation
- Perspectivas Da Subjetivação Da Racionalidade Neoliberal Rafael Xavier TolentinoDocument18 pagesPerspectivas Da Subjetivação Da Racionalidade Neoliberal Rafael Xavier TolentinoMaestro FutebollPas encore d'évaluation
- L'Édification Nationale Dans Diverses Régions, UNESCO, 1971Document184 pagesL'Édification Nationale Dans Diverses Régions, UNESCO, 1971BouhahahaPas encore d'évaluation
- Cours SociologieDocument49 pagesCours SociologieYassine BenjaziaPas encore d'évaluation
- M - Rioux - Les OI Cahier MINDc 1-5-12Document43 pagesM - Rioux - Les OI Cahier MINDc 1-5-12soltani mohamedPas encore d'évaluation
- DM de EmcDocument5 pagesDM de Emcaugustin.bqtPas encore d'évaluation
- Thierry Rambaud - Gouverner Le Religieux Dans Un État LaïcDocument56 pagesThierry Rambaud - Gouverner Le Religieux Dans Un État LaïcFondapol100% (1)
- Commun(s) : discours de la méthode: Vers le « pari de la confiance » !D'EverandCommun(s) : discours de la méthode: Vers le « pari de la confiance » !Pas encore d'évaluation
- L Institution de La Communaute - Une LecDocument14 pagesL Institution de La Communaute - Une LecMarc JacquinetPas encore d'évaluation
- Le Terme de Classe Sociale Est LDocument2 pagesLe Terme de Classe Sociale Est Lhiro djokouehiPas encore d'évaluation
- CE - Questions SocialesDocument24 pagesCE - Questions SocialesvtiflettePas encore d'évaluation
- Interventionseconomiques 945Document114 pagesInterventionseconomiques 945Gwladys BettoPas encore d'évaluation
- L'État Inscrit Dans La Société Régulation Et Architecture InstitutionnelleDocument6 pagesL'État Inscrit Dans La Société Régulation Et Architecture InstitutionnellespéculairePas encore d'évaluation
- 10 Lecons 2012Document217 pages10 Lecons 2012pilgrimofsaintmichaePas encore d'évaluation
- RFP 4494Document42 pagesRFP 4494Désir DjomekaPas encore d'évaluation
- Mondialisation DefinitionsDocument6 pagesMondialisation Definitionssarita-mansouriPas encore d'évaluation
- Ess Au MarocDocument41 pagesEss Au MarocabdelrhPas encore d'évaluation
- Au-Dela Du Developpement Quand La Cooperation InternationaleDocument36 pagesAu-Dela Du Developpement Quand La Cooperation Internationaleibrahima diengPas encore d'évaluation
- RFSP 0035-2950 1961 Num 11 1 392615 t1 0195 0000 001Document4 pagesRFSP 0035-2950 1961 Num 11 1 392615 t1 0195 0000 001Juani TroveroPas encore d'évaluation
- Economia N17 WebDocument34 pagesEconomia N17 Webabdel__amalPas encore d'évaluation
- Dorronsoro (2019) - Le Reniement Démocratique. Néolibéralisme Et Injustice SocialeDocument120 pagesDorronsoro (2019) - Le Reniement Démocratique. Néolibéralisme Et Injustice SocialealbirezPas encore d'évaluation
- Olson Logique de L'action Collective Book ReviewDocument5 pagesOlson Logique de L'action Collective Book Reviewnesrine.ayadiPas encore d'évaluation
- Origines Et ContoursDocument35 pagesOrigines Et ContoursoissafebrahimePas encore d'évaluation
- Des Associations Citoyennes Pour DemainDocument141 pagesDes Associations Citoyennes Pour Demainfuga48Pas encore d'évaluation
- Economie Solidaire Socialisme Libertaire-1Document15 pagesEconomie Solidaire Socialisme Libertaire-1PLX SteelFaktoryPas encore d'évaluation
- F0181 PrefaceDocument6 pagesF0181 PrefacesosaiddPas encore d'évaluation
- ENM Annales CG 2009Document7 pagesENM Annales CG 2009yaopierre jeanPas encore d'évaluation
- Questionsdecommunication 7170Document3 pagesQuestionsdecommunication 7170Micky MousePas encore d'évaluation
- Le Concept de Developpement PDFDocument6 pagesLe Concept de Developpement PDFSaad HakawiPas encore d'évaluation
- Questionsdecommunication 31514Document25 pagesQuestionsdecommunication 31514Sidoine hakim LanzaréPas encore d'évaluation
- Développement Durable Et Territoire - Chapitre 1. Les Antécédents Conceptuels Du Développement Soutenable - Presses Universitaires Du SeptentrionDocument12 pagesDéveloppement Durable Et Territoire - Chapitre 1. Les Antécédents Conceptuels Du Développement Soutenable - Presses Universitaires Du SeptentrionEcologiedz MouladPas encore d'évaluation
- Memoire Patrick MukokaDocument75 pagesMemoire Patrick MukokaPatrick Dilomene MukokaPas encore d'évaluation
- Citoyenneté Et Civilité Aujourd'Hui Quelques ÉclaircissementsDocument1 pageCitoyenneté Et Civilité Aujourd'Hui Quelques ÉclaircissementsZineb FikriPas encore d'évaluation
- 10638-Article Text-30495-1-10-20180329Document13 pages10638-Article Text-30495-1-10-20180329DidierKondoPas encore d'évaluation
- LCRX 20130418Document28 pagesLCRX 20130418quimdafaia59100% (1)
- La Revue Socialiste N°57 - Mars 2015Document166 pagesLa Revue Socialiste N°57 - Mars 2015Parti socialistePas encore d'évaluation
- Document Sans Titre-3Document8 pagesDocument Sans Titre-35grg8fq6nkPas encore d'évaluation
- Vivre Ensemble Dans Un Monde Incertain (Serge Paugam (Paugam, Serge) )Document51 pagesVivre Ensemble Dans Un Monde Incertain (Serge Paugam (Paugam, Serge) )taoufiq nasriPas encore d'évaluation
- Solidarisme - Revue Du MAUSSDocument8 pagesSolidarisme - Revue Du MAUSSstephane.sauzeauPas encore d'évaluation
- La Tripartition SocialeDocument11 pagesLa Tripartition SocialepictosonicPas encore d'évaluation
- Support 01Document10 pagesSupport 01DohPas encore d'évaluation
- Nicolas Duvoux - Les Inégalités SocialesDocument132 pagesNicolas Duvoux - Les Inégalités SocialesJephte KenfackPas encore d'évaluation
- Gérard Lemaine. Latour Bruno, Politiques de La Nature. Comment Faire Entrer Les Sciences en Démocratie., Revue Française de Sociologie, 2000Document5 pagesGérard Lemaine. Latour Bruno, Politiques de La Nature. Comment Faire Entrer Les Sciences en Démocratie., Revue Française de Sociologie, 2000Cadenasi Atorrante del PunkPas encore d'évaluation
- Foucault, Réponse À Une QuestionDocument13 pagesFoucault, Réponse À Une QuestionCadenasi Atorrante del PunkPas encore d'évaluation
- Zittoun, DispositifDocument4 pagesZittoun, DispositifCadenasi Atorrante del PunkPas encore d'évaluation
- DOUAILLER, Le Philosophe Et Le Grand Nombre. Politiques Du Texte en FuiteDocument112 pagesDOUAILLER, Le Philosophe Et Le Grand Nombre. Politiques Du Texte en FuiteCadenasi Atorrante del PunkPas encore d'évaluation
- Audit GRHDocument96 pagesAudit GRHSidAli KouPas encore d'évaluation
- Propo Epreuve Bts 2007Document65 pagesPropo Epreuve Bts 2007Tresor Comptable NgouanaPas encore d'évaluation
- 0 Cours MGMT Stratégique MissoumDocument229 pages0 Cours MGMT Stratégique MissoumMina NinaPas encore d'évaluation
- G11 IRG BIC fr2023Document2 pagesG11 IRG BIC fr2023SEGHIR YACINE89% (9)
- PCI - TD - Centres Resp Et Profit - Correction CASDocument28 pagesPCI - TD - Centres Resp Et Profit - Correction CASDevin Ramos100% (1)
- GOL720 20222 PlanDocument7 pagesGOL720 20222 PlanAlex AlexPas encore d'évaluation
- Documents de PISCICULTUREDocument2 pagesDocuments de PISCICULTURESuze KilondaPas encore d'évaluation
- Avantages Fiscaux 2009 CES Révision ComptableDocument87 pagesAvantages Fiscaux 2009 CES Révision ComptableHmed HowaPas encore d'évaluation
- Présentation de La Prépa ECT Du Lycée Les Bruyères PowerPointDocument16 pagesPrésentation de La Prépa ECT Du Lycée Les Bruyères PowerPointEdmx DmxPas encore d'évaluation
- Manuel QualiteDocument22 pagesManuel Qualiterajoua87100% (1)
- Riva Limited 1683635476071 365692Document14 pagesRiva Limited 1683635476071 365692kevinPas encore d'évaluation
- Exemple PPSPS1Document27 pagesExemple PPSPS1Mominé VePas encore d'évaluation
- Fiches-Process - Recrutement-Indd - Fiches-Process - Recrutement - SolidereDocument26 pagesFiches-Process - Recrutement-Indd - Fiches-Process - Recrutement - SoliderehairouchePas encore d'évaluation
- Cours - Audit Comptable Et Financier 22 - 23Document36 pagesCours - Audit Comptable Et Financier 22 - 23Salma EZ-ZOUHRIPas encore d'évaluation
- Revenue Management 04-ChapuisDocument14 pagesRevenue Management 04-ChapuisTarom NetherlandsPas encore d'évaluation
- Audit Fonction Et ProcessusDocument19 pagesAudit Fonction Et ProcessusSAra AlOuane100% (1)
- Le Guide Du Préparationnaire - Master GE ISCAE (2ème Edition)Document75 pagesLe Guide Du Préparationnaire - Master GE ISCAE (2ème Edition)lea lamPas encore d'évaluation
- Analyse de La Liquidite Et de La SolvabiliteDocument6 pagesAnalyse de La Liquidite Et de La SolvabiliteMadi Kabafing KABAPas encore d'évaluation
- CDR Audit Versement Subventions Associations Web PDFDocument52 pagesCDR Audit Versement Subventions Associations Web PDFFbel XNONPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage ITSMAILDocument80 pagesRapport de Stage ITSMAILOussama el ghalPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 24Document51 pagesRapport de Stage 24Simon Pierre NGONO ETOGO75% (4)
- 8852-Article Text-25726-1-10-20170303Document17 pages8852-Article Text-25726-1-10-20170303TujggPas encore d'évaluation
- Catalogue Crok'Vacances 2016 Ci OrtfDocument116 pagesCatalogue Crok'Vacances 2016 Ci OrtfCIORTFPas encore d'évaluation
- 1 - L Information Le SI Et Le SI ComptableDocument13 pages1 - L Information Le SI Et Le SI ComptableAbdou DiattaPas encore d'évaluation
- DSCG 2021 Sujet Ue2 FinanceDocument11 pagesDSCG 2021 Sujet Ue2 FinanceandyroadPas encore d'évaluation
- CV Julie ClemenconDocument2 pagesCV Julie ClemenconJean HéryPas encore d'évaluation
- Les 14 Principes Du ToyotismeDocument19 pagesLes 14 Principes Du ToyotismeSékou KonéPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 6 La Gestion Des Carriéres Et MobilitéDocument5 pagesCHAPITRE 6 La Gestion Des Carriéres Et MobilitéĖlena SåīPas encore d'évaluation
- SWOT Quik SilverDocument9 pagesSWOT Quik SilvergueurPas encore d'évaluation