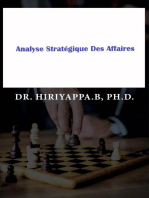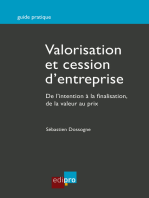Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Firme Néoclassique
La Firme Néoclassique
Transféré par
Hanane Aya0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
1K vues1 pageLa Firme Néoclassique
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentLa Firme Néoclassique
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
1K vues1 pageLa Firme Néoclassique
La Firme Néoclassique
Transféré par
Hanane AyaLa Firme Néoclassique
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 1
La Firme Noclassique
I-
La notion de la firme noclassique :
Pour la thorie noclassique, la firme est apprhende uniquement en termes technologiques ; elle est
assimile une fonction de production qui spcifie le niveau doutput Q obtenu partir dun niveau de N
inputs. Il est suppos que cette firme est dirige par un propritaire parfaitement rationnel qui choisit les
niveaux dinputs et doutput dans le but de maximiser son profit. Cette firme noclassique est dite :
Firme point : Assimile un agent individuel sans prise en considration de son organisation interne.
Firme automate : Suppose parfaitement rationnelle comme tout agent conomique, ne fait que
transformer de manire efficiente, des facteurs de production et sadapter mcaniquement des
contraintes techniques et des environnements donns.
1- Les fonctions de la firme noclassique :
La premire fonction consiste transformer les facteurs en produits, la technique de production est
donne et dclare efficiente (Le choix des techniques ne se pose pas).
La deuxime fonction de la firme dans le cadre de ce modle consiste traiter linformation et faire
lopration de slection, par voie du calcul, des variables juges optimales dont le but principal est de
produire des quantits par lesquelles le profit sera max.
2- Hypothses noclassique de base :
La maximisation du profit : Dans ce cadre, la firme par lintermdiaire de la fonction de production et
laide des instruments jugs efficaces analyse comment la production varie sous limpact des variations
de prix des inputs et de loutput pour arriver un niveau de profit plus grand (
.
La rationalit parfaite des agents : Chaque individu ne cherche que ses propres intrts pour optimiser
son bien-tre. Ce bien-tre est souvent calcul avec une fonction dutilit.
La concurrence pure et parfaite : Un march est en CPP, sil y a un grand nombre de vendeurs et
dacheteurs de la marchandise, chacun deux tant trop peu important pour affecter le prix de ladite
marchandise, les productions de toutes les entreprises sur le march sont homognes, il y a une parfaite
mobilit des ressources et les consommateurs, les propritaires des ressources et les entreprises sur
le march ont une connaissance parfaite des prix et des cots prsents et venir.
Les contraintes de technologie et de prix : La transformation des ressources en produits se fait selon
une fonction de production qui simpose lentreprise.
IIDpassements et ruptures :
Simon et la rationalit limite : H.Simon prend en compte lincertitude et linformation imparfaite des
agents, ainsi que les limites de leurs capacits de calcul, qui ne leur permettent pas de passer en revue
toutes les actions possibles, et enfin linterdpendance des agents, qui prennent leurs dcisions en
anticipant les actions des autres (comportements stratgiques). Cette rationalit procdurale ou
limite considre les objectifs et les moyens comme dterminer et non comme donns. Il en rsulte
la recherche non dune maximisation mais de la satisfaction dun niveau daspiration.
Lapproche comportementale de la firme (Cyert et March) : Elle met l'accent sur la faon dont les
dcisions sont prises au sein de l'entreprise. Ces auteurs prsentent la firme comme une coalition de
groupes dont les intrts convergent mais dont chacun manuvre pour son compte propre, ainsi
l'apparition de managers qui ne sont pas propritaires vince le critre du profit de la firme comme un
guide de gestion. Par consquent, des buts intermdiaires compltent les objectifs gnraux de la firme,
et sont lobjet de ngociations entre les diffrents groupes, cest la raison pour laquelle les dirigeants
cherchent dterminer un budget discrtionnaire pour faire accepter par les diffrents groupes les
objectifs fixs pour la firme.
Liebenstein et la thorie de lefficience X : Selon cet auteur, deux entreprises identiques qui utilisent
les mmes facteurs de production n'aboutissent pas aux mmes rsultats ; cela provient de la qualit de
l'organisation. Ce facteur organisationnel est appel "facteur d'efficience X", il permet d'obtenir la plus
grande intensit d'utilisation des facteurs et par l de faire la diffrence. Dans ce cadre, Liebenstein
propose ouvertement de faire pntrer dans la firme l'entrepreneur qui n'aurait jamais d en sortir, son
rle dans le cadre de l'organisation de la production s'affirmant par la manifestation d'un effet de
productivit (efficience induite) au travers de la motivation, de l'organisation de la gestion des affaires.
Conclusion : Si les thories de la firme ont nettement progress depuis la firme-point walrassienne, elles
restent cependant limites. En effet, les approches sont par consquent davantage rivales que
complmentaires, et il nexiste pas de thorie globale et cohrente de la firme. Dans ce sens, il sagit
lavenir de les combiner pour aboutir une thorie globale de la firme.
Vous aimerez peut-être aussi
- Valorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesD'EverandValorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Theorie de La FirmeDocument18 pagesTheorie de La FirmeToli NgamokoubaPas encore d'évaluation
- Lexique Francais Anglais Pour La LogistiqueDocument6 pagesLexique Francais Anglais Pour La Logistiquebusinessblogmaroc4195Pas encore d'évaluation
- La Théorie de Coût de TransactionDocument8 pagesLa Théorie de Coût de TransactionHanane Aya100% (1)
- J1L2 (Sujet) - Droit Bancaire Et FinancierDocument9 pagesJ1L2 (Sujet) - Droit Bancaire Et FinancierstefPas encore d'évaluation
- Economie Internationale: Chapitre IIDocument34 pagesEconomie Internationale: Chapitre IIHind SamihPas encore d'évaluation
- Intelligence Économique Cours 1Document15 pagesIntelligence Économique Cours 1Islam El Ousrouti100% (1)
- 1 - Segmentation StratégiqueDocument7 pages1 - Segmentation StratégiqueBaSsma EttaQuiPas encore d'évaluation
- La Théorie de Droit de Propriété Et La Théorie de L'agenceDocument18 pagesLa Théorie de Droit de Propriété Et La Théorie de L'agenceHanane Aya100% (1)
- Théories de La Firme - Support Cours N°1Document20 pagesThéories de La Firme - Support Cours N°1samirnetPas encore d'évaluation
- Cours Intelligence EcoDocument62 pagesCours Intelligence EcoYassine Boughaidi100% (1)
- Management StrategiqueDocument170 pagesManagement Strategiqueloe3007100% (2)
- Management Stratégique S6Document48 pagesManagement Stratégique S6lhaj nekkachPas encore d'évaluation
- Analyse Financière Des Etablissements de Crédit Exemple Du Secteur Bancaire MarocainDocument94 pagesAnalyse Financière Des Etablissements de Crédit Exemple Du Secteur Bancaire MarocainSaid Agouzal50% (2)
- La Méthode MRPDocument7 pagesLa Méthode MRPOmys Omys50% (2)
- Théories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardeD'EverandThéories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardePas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Stratégique V2 PDFDocument62 pagesFiche de Lecture Stratégique V2 PDFYassine AiniPas encore d'évaluation
- La Theorie Des Cout de TransactionDocument17 pagesLa Theorie Des Cout de TransactionRim RagbiPas encore d'évaluation
- Microeconomie IiDocument72 pagesMicroeconomie IiAMINE ET- TAHOURI100% (1)
- Les Principales Theories de La Firme PDFDocument6 pagesLes Principales Theories de La Firme PDFAnonymous huchhkZ1q100% (1)
- Afcm PDFDocument3 pagesAfcm PDFHamza Benzattat100% (1)
- Analyse Dedonnees avecSPSS PDFDocument38 pagesAnalyse Dedonnees avecSPSS PDFArthur OuattaraPas encore d'évaluation
- Cours Le Système DinformationDocument15 pagesCours Le Système DinformationMohamed ErrassafiPas encore d'évaluation
- La Théorie ÉvolutionnisteDocument13 pagesLa Théorie ÉvolutionnisteHanane Aya100% (2)
- Budgetaire PDFDocument144 pagesBudgetaire PDFManalHannanePas encore d'évaluation
- L'Environnement de L'entrepriseDocument9 pagesL'Environnement de L'entrepriseDon RedooPas encore d'évaluation
- Abc AbmDocument49 pagesAbc AbmOthmane MaaroufiPas encore d'évaluation
- 30 Questions QCM Corrigé en Audit - Cours FsjesDocument6 pages30 Questions QCM Corrigé en Audit - Cours FsjesAIT ABAHMMA HananePas encore d'évaluation
- La Différence Entre LCAG Et SWOTDocument2 pagesLa Différence Entre LCAG Et SWOTSamihaEss71% (7)
- Intelligence ÉconomiqueDocument15 pagesIntelligence ÉconomiqueDeep HousePas encore d'évaluation
- Le Prix de Transfert Et La Fiscalité MarocaineDocument4 pagesLe Prix de Transfert Et La Fiscalité MarocaineAli Boussil100% (1)
- Gmao EnitDocument4 788 pagesGmao Enitaboustif maslouhiPas encore d'évaluation
- Coût de Transaction & Théorie D'agence (Master ACG FSJESM)Document54 pagesCoût de Transaction & Théorie D'agence (Master ACG FSJESM)Anonymous CNS7K0S78% (9)
- Cours Complet Analyse FinancièreDocument153 pagesCours Complet Analyse FinancièreMOPas encore d'évaluation
- Tunisia PV Tender 10 MDocument23 pagesTunisia PV Tender 10 MDalila AmmarPas encore d'évaluation
- Théories de La Firme - Support Cours N°1 PDFDocument20 pagesThéories de La Firme - Support Cours N°1 PDFTALAIPas encore d'évaluation
- Environnement de L'entrepriseDocument7 pagesEnvironnement de L'entrepriseMohammed KhamarPas encore d'évaluation
- Communication Financière SamsungDocument18 pagesCommunication Financière SamsungAyatMouline0% (1)
- Avantage ConcurrentielDocument3 pagesAvantage Concurrentielmiya00% (1)
- La Theorie Des Cout de TransactionDocument17 pagesLa Theorie Des Cout de TransactionLilia LinaPas encore d'évaluation
- La Théorie de La Firme JaponaiseDocument16 pagesLa Théorie de La Firme JaponaiseHanane Aya33% (3)
- Le Modèle Néoclassique - CoursDocument10 pagesLe Modèle Néoclassique - Courscours_inseecPas encore d'évaluation
- Exposé PrésentéDocument14 pagesExposé PrésentégarouaouiPas encore d'évaluation
- La MicroeconomieDocument17 pagesLa MicroeconomiehamzzaaPas encore d'évaluation
- 8-Rapport Sur La Théorie de L'asymétrie D'information Et Rationalité Des Agents ÉconomiquesDocument18 pages8-Rapport Sur La Théorie de L'asymétrie D'information Et Rationalité Des Agents Économiquesmarouane belbahiPas encore d'évaluation
- Exposé: Gestion Du Portefeuille: Model Financier/ Indicateur de PerformanceDocument13 pagesExposé: Gestion Du Portefeuille: Model Financier/ Indicateur de PerformanceAhmédL'GààreAhméd100% (2)
- Cours Stratégie Des Entreprises Partie1Document21 pagesCours Stratégie Des Entreprises Partie1leviPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 StratégieDocument13 pagesChapitre 3 StratégieAbdel Malek100% (1)
- Encg Théorie Des Organisations PDFDocument28 pagesEncg Théorie Des Organisations PDFSoufianovich SoufianePas encore d'évaluation
- Le Surplus de Productivité GlobaleDocument3 pagesLe Surplus de Productivité Globaleassimil03Pas encore d'évaluation
- Zoom's Comptabilité Analytique PDF - Télécharger, Lire TÉLÉCHARGER LIRE ENGLISH VERSION DOWNLOAD READ. DescriptionDocument7 pagesZoom's Comptabilité Analytique PDF - Télécharger, Lire TÉLÉCHARGER LIRE ENGLISH VERSION DOWNLOAD READ. DescriptionMEHDIPas encore d'évaluation
- XXXXXXXXXXXXXXXXXDocument14 pagesXXXXXXXXXXXXXXXXXOumaima TemaraPas encore d'évaluation
- L'approche Stratégique Fondée Sur Les RessourcesDocument44 pagesL'approche Stratégique Fondée Sur Les RessourcesKhadija FahlatoPas encore d'évaluation
- Strategies Globales PDFDocument1 pageStrategies Globales PDFsmailPas encore d'évaluation
- Politiques Financières de Long Terme: FinanceDocument221 pagesPolitiques Financières de Long Terme: Financeilias spiderPas encore d'évaluation
- Marketing de BaseDocument3 pagesMarketing de BasehamzaPas encore d'évaluation
- La Culture EntrepreneurialeDocument24 pagesLa Culture EntrepreneurialeHamza BouchaabPas encore d'évaluation
- Analyse SwotDocument7 pagesAnalyse SwotfatiPas encore d'évaluation
- Analyse ConcurrentielleDocument3 pagesAnalyse Concurrentielleyah ia100% (1)
- Alliances Stratégiques Et Création de ValeurDocument34 pagesAlliances Stratégiques Et Création de ValeurIman Squalli Houssaini100% (1)
- Les Alliances StratégiquesDocument2 pagesLes Alliances StratégiquesmarhforPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Les Theories de La FirmeDocument3 pagesFiche de Lecture Les Theories de La Firmemido78100% (1)
- La Théorie Des Jeux Et de La Décision en Présence D'asymétrie D'information Du Crédit BancaireDocument16 pagesLa Théorie Des Jeux Et de La Décision en Présence D'asymétrie D'information Du Crédit BancaireWorld-Academic Journal100% (1)
- Sous Theme 3 TD1 Les Asymetries de L InformationDocument29 pagesSous Theme 3 TD1 Les Asymetries de L Informationmalaga04Pas encore d'évaluation
- Chaptire 1 - Partie 1Document12 pagesChaptire 1 - Partie 1carton SPSPas encore d'évaluation
- La Theorie de La ValeurDocument19 pagesLa Theorie de La Valeurmsgsoir2009100% (1)
- Icours104 S7 ch32Document19 pagesIcours104 S7 ch32lamiaa50% (2)
- La StrategieDocument8 pagesLa StrategiebencharkiPas encore d'évaluation
- Support Les Techniques Du Controle de Gestion Brasserie 2Document77 pagesSupport Les Techniques Du Controle de Gestion Brasserie 2aya chraibi100% (1)
- Economie D'echellesDocument14 pagesEconomie D'echellesSimohamed Benrekia0% (1)
- La Théorie de La Firme JaponaiseDocument16 pagesLa Théorie de La Firme JaponaiseHanane Aya33% (3)
- Le Diagnostic FinancierDocument15 pagesLe Diagnostic FinancierSahbi SkPas encore d'évaluation
- Les AmortissementsDocument8 pagesLes AmortissementsZaid El MezianiPas encore d'évaluation
- Fonds PropresDocument1 pageFonds PropresghizlanePas encore d'évaluation
- Marches Financiers - Les Produits FinanciersDocument18 pagesMarches Financiers - Les Produits FinanciersLamiaPas encore d'évaluation
- 10 Actions Pour Relancer Une Entreprise Au Bord de La Faillite - Entreprise Sans FautesDocument8 pages10 Actions Pour Relancer Une Entreprise Au Bord de La Faillite - Entreprise Sans FautesJohnson JongPas encore d'évaluation
- Comment Réaliser Une Facture ProformaDocument6 pagesComment Réaliser Une Facture ProformaHamdan MAMANPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument12 pages1 PBHicham98Pas encore d'évaluation
- Sujet Control de GestionDocument8 pagesSujet Control de GestionDéborahPas encore d'évaluation
- Projet de Création D'entrepDocument2 pagesProjet de Création D'entrepHajar ElrhaffouliPas encore d'évaluation
- Code Travail MaliDocument73 pagesCode Travail MaliFalaye KeitaPas encore d'évaluation
- Exemple QuestionnaireDocument4 pagesExemple QuestionnairePhilippePas encore d'évaluation
- EC 3 - Pourquoi Les Pouvoirs Publics Doivent - Ils Réguler La ConcurrenceDocument7 pagesEC 3 - Pourquoi Les Pouvoirs Publics Doivent - Ils Réguler La ConcurrenceMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- KbisDocument2 pagesKbisAlexandre MatuszakPas encore d'évaluation
- Diagramme de PertDocument9 pagesDiagramme de PertmosalsletPas encore d'évaluation
- M07-Marketing Ter Tsge WWW Bac-Ofppt Blogspot ComDocument162 pagesM07-Marketing Ter Tsge WWW Bac-Ofppt Blogspot Comapi-296425822Pas encore d'évaluation
- Méthode Echantillonage en GéographieDocument13 pagesMéthode Echantillonage en Géographieass20Pas encore d'évaluation
- Chapitre 6Document3 pagesChapitre 6kawtar hdidouPas encore d'évaluation
- Chap 2 - Les Cessions D'immobilisations: SommaireDocument7 pagesChap 2 - Les Cessions D'immobilisations: SommaireStéphane OhambaPas encore d'évaluation
- Modele Acte D'engagementDocument2 pagesModele Acte D'engagementzak.sb22Pas encore d'évaluation
- Evaluation Des StocksDocument24 pagesEvaluation Des StocksencglandPas encore d'évaluation
- Metallurgie Et Travail Des MetauxDocument36 pagesMetallurgie Et Travail Des MetauxSaid KciouiPas encore d'évaluation
- Gouvernance Du Système D'informationDocument11 pagesGouvernance Du Système D'informationachikfourPas encore d'évaluation