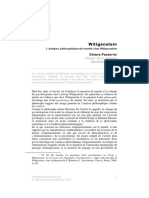Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Blondel Les Metaphores Vie Du Corps Blondel
Blondel Les Metaphores Vie Du Corps Blondel
Transféré par
Jaime Sologuren LópezCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Blondel Les Metaphores Vie Du Corps Blondel
Blondel Les Metaphores Vie Du Corps Blondel
Transféré par
Jaime Sologuren LópezDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les métaphores, vie du corps
Métaphores par lesquelles Nietzsche interprète la vie du corps, mais qu'est-ce que le corps ?
Une métaphore pour dire l'origine de toute « chose », et de toute interprétation. Que n'est-ce
donc sinon un cercle sans fin qui nous étreint dans nos propres limites.
(Extrait de l'ouvrage d'Éric Blondel Nietzsche, le corps et la culture, éd. Original PUF 1986,
L'Harmattan 2006, pp. 235-251)
[…]
Les questions : qu'est-ce que le corps (esprit) ? Qu'est-ce que la culture ? Qu'est-ce que la
volonté de puissance ? Se ramènent donc à celle-ci : qu'est-ce qu'interpréter ? « C'est à un estomac
que l'esprit ressemble le plus ».
a/ La métaphore gastroentérologique. - Comment procède le système digestif métaphore de
l'Interprétation ?
D'abord il assimile : absorbe ce qui étranger, tâche de réduire à sa singularité, à son identité
(éventuellement multiple) le divers et le pluriel. « Assimiler, c'est déjà rendre semblable à soi une
chose étrangère, la tyranniser - cruauté ». Chez le protoplasme, exemple choisi par Nietzsche, la
nutrition consiste à vaincre un être qui résiste, à se l'approprier, à se l'incorporer. Ici, la métaphore
juxtapose comme équivalents « digérer, vivre, absorber, incorporer ».
Travail secret, souterrain, mais obscure et répugnant. Voir les entrailles, ce serait voir une
réalité vraie – et Nietzsche songe aux haruspices -, mais une réalité à la fois menaçante et
écœurante, mixte de pudendum et d'horrendum : comme si la pluralité chaotique réelle faisait
d'abord peur, aussi bien à la conscience qu'à la morale. « Ce qui offense le sens esthétique dans
l'homme intérieur – sous la peau : masses sanglantes, intestins pleins, viscères, tous ces monstres
qui sucent et pompent – informes, ou laids, ou grotesques, et par surcroît désagréables au nez !
Donc suppression par la pensée ; ce qui, malgré cela, apparaît à l'extérieur éveille la honte (matières
fécales, urine, salive, sperme). Les femmes n'aiment pas entendre parler de la digestion. Byron ne
pouvait supporter de voir une femme manger. (…) Le corps caché derrière sa peau et qui doit avoir
honte de soi ! Le vêtement qui en recouvre les parties où sa nature intime s'extériorise ! (Pour autant
qu'il n'est pas forme extérieure, l'homme est pour soi-même objet de dégoût, - il fait tout ce qui est
en son pouvoir afin de ne pas y penser) ». « Quand nous aimons une femme, nous haïssons
facilement la nature, en songeant à toutes les nécessités naturelles répugnantes auxquelles cette
femme est astreinte (…). On se bouche les oreilles à toute physiologie (…). ''L'homme sous la peau''
est pour tous les amoureux une abomination et une pensée interdite, un blasphème contre Dieu et
l'amour ».
C'est pour opposer une vérité abominable aux charmes superficiels de l'idéal que Nietzsche
parle des entrailles : « Avec ce livre (les Confessions d'Augustin) on voit les entrailles du
christianisme : en le lisant, je m'y sens la curiosité d'un médecin et physiologiste radical ». Les
entrailles sont la réalité d'un corps qui incorpore et assimile la pluralité. Elles doivent réduire
l'excès. L'estomac doit, comme la culture et l'interprétation, refuser, sous peine de
dysfonctionnement. « L'épicurien choisit la situation, les personnes et même les événements qui
conviennent à sa constitution intellectuelle extrêmement délicate, il renonce au reste, c'est-à-dire à
presque tout, car ce serait pour lui un aliment trop fort et trop lourd. Le stoïcien au contraire
s'exerce à avaler cailloux et vers, tessons et scorpions et à surmonter son dégoût ; il faut que son
estomac finisse par être indifférent à tout ce que le hasard de l'existence y verse ». La capacité
d'absorption peut être un critère de la force : « L'homme fort, puissant dans les instincts d'une forte
santé, digère ses actes exactement comme il digère ses repas ; il vient à bout même des nourritures
lourdes : mais pour l'essentiel, il est guidé par un instinct intact et rigoureux, si bien qu'il ne fait rien
qui ne lui convienne, de même qu'il ne mange rien qui ne lui plaise ».
[suit une description des troubles de l' « absorption-assimilation » NdIL][...]
b/ La métaphore politique. - Mais Nietzsche est contraint, en vue d'expliciter le corps
comme interprétation, de se reporter à un autre domaine métaphorique : la politique. La culture,
comme « digestion-interprétation, est comparable à un corps politique. L'enchaînement-report est
nettement perceptible dans cette formule : « assimiler, c'est déjà rendre semblable à soi une chose
étrangère, la tyranniser ». Nietzsche poursuit sa description des jeux des pulsions avec la
terminologie suivante : « Il se subordonne... l'esclavage est nécessaire à la formation d'un organisme
supérieur, les castes de même... l'obéissance est une contrainte... la force de ravaler autrui à lui
servir de fonction... règne... les subordonnés ont à leur tour des subordonnés... lutte perpétuelle...
adversaires... se combattent... colonies... etc. ». Et il explicite ainsi son analyse métaphorique du
corps : « Le corps est l'édifice collectif de plusieurs âmes. L'effet, c'est moi ; il se passe ici ce qui se
passe dans toute collectivité heureuse et bien organisée ; la classe dirigeante s'identifie aux succès
de la collectivité. Dans tout vouloir, il s'agit simplement de commander et d'obéir à l'intérieur d'une
structure collective complexe ».
Le corps « est une collectivité inouïe d'êtres vivants, tous dépendants et subordonnés, mais
en un autre sens dominants et doués d'activité volontaire (…). Dans ce ''miracle des miracles'', la
conscience n'est qu'un instrument, rien de plus – dans le même sens où l'estomac est un instrument
du même miracle ». L'enchaînement de la métaphorique politique à celle de l'entérologie doit
permettre à Nietzsche d'interpréter celle-ci et de comprendre le jeu de l'assimilation comme rapport
de forces, de même qu'à son tour la métaphore philologique interprétera les règles de ces rapports
de forces comme jeu de l'interprétation, comme « délimitation toujours flottante de la puissance ».
« Si nous suivons le fil conducteur du corps, nous reconnaissons dans l'homme une pluralité
d'êtres vivants qui, luttant ou collaborant entre eux, ou se soumettant les uns les autres, en affirmant
leur être individuel affirment involontairement le tout. Parmi ces êtres vivants, il en est qui sont
plutôt maîtres que subalternes ; entre ceux-là il y a de nouveau lutte et victoire ». D'emblée,
Nietzsche insiste sur limage d'un jeu collectif : les pulsions, comme les individus dans un groupe
social, disposeraient d'une certaine forme d'intelligence, de conscience et de spontanéité. Il applique
ce schème à la digestion, qu'il métaphorise politiquement : « Un jeu collectif aussi subtilement
intelligent que, par exemple, la digestion. Il y a là le jeu collectif d'un très grand nombre d'intellects.
Où que je découvre la vie, j'aperçois ce jeu collectif. Et parmi ces nombreux intellects, il y a aussi
un chef ». Il peut développer la métaphore politique : « La splendide cohésion des vivants les plus
multiples, la façon dont les activités supérieures et inférieures s'ajustent et s'intègrent les unes aux
autres, cette obéissance multiforme, non pas aveugle, bien moins encore mécanique, mais critique,
prudente, soigneuse, voire rebelle. »
Cette conscience n'est pas l'apanage de l'intellect conscient : « La pensée morale suit notre
conduite, elle ne l'a dirige pas ». Dans cette conception politique organiciste de ce qu'on peut bien
nommer corps politique, c'est la multiplicité qui domine : « Partir du corps et de la physiologie :
pourquoi ? - Nous obtenons ainsi une représentation exact de la nature de notre unité subjective,
faite d'un groupe de dirigeants à la tête d'une collectivité (…) ; nous comprenons comment ces
dirigeants dépendent de ceux qu'ils régissent, et comment les conditions de la hiérarchie et de la
division du travail rendent possible l'existence des êtres parcellaires et du tout (…) ; comment la
lutte s'exprime même dans l'échange du commandement et de l'obéissance et comment une
délimitation toujours flottante de la puissance est nécessaire à la vie ».
La nouveauté, c'est ici la nature du rapport entre l'intellect conscient et le reste du corps, ou
plus exactement entre les groupes des pulsions eux-mêmes : il n'est causal ni dans un sens
spiritualiste (l'esprit est un jouet), ni dans un sens physiologiste-mécaniste. La corps n'est pas une
machine, mais une organisation politique fondée sur des rapports de forces instables et non
univoquement réglés par la logique causale consciente : point d'obéissance soumise ni de
fonctionnement harmonieusement réglé par des lois. Quelle est la règle de composition de ces
forces ? Nietzsche considère le mécanisme comme seulement « symbolique » de l'organisme et du
monde psychique. Il est exclu par la représentation des phénomènes vitaux comme conflits. « C'est
une erreur foncière que de croire à la concorde et à l'absence de conflit – ce serait la mort ! Où il y a
vie, il y a formation corporative où les compagnons luttent pour leur nourriture, se disputent
l'espace, où les plus faibles se soumettent, vivent moins longtemps, ont moins de descendance ; la
diversité règne dans les plus petites choses (…) - l'identité est une grande illusion (…). La
centralisation est loin d'être aussi parfaite – et la prétention de la raison à en être le centre est à
coup sûr le plus grave défaut de cette perfection ». Insensiblement, comme Freud, Nietzsche
personnifie sa description pour mettre en évidence les fluctuations et leur différence avec un rapport
strictement mécaniste : « Les relations des organes entre eux exigent déjà la pratique de toutes les
vertus : obéissance, assiduité, entraide, vigilance – la vie organique, qui est une autonomie, exclut
tout caractère machinal ». Un système mécanique aboutirait à un état analogue à la mort, tandis que
le Wille zur Macht suppose un flottement. Nietzsche souligne surtout l'impossibilité de parvenir à un
sens unique. La cinétique n'interdit pas seulement l'équilibre, l'annulation réciproque des forces,
mais la concorde. Si « le centre du système se déplace sans cesse », si la domination d'un groupe,
d'une unité est précaire, c'est que la pluralité ressort sans cesse ; Nietzsche attribue la domination à
des « conseils de régence », à des « aristocraties ». La vie est instabilité des rapports de force, il n'y
a pas domination mais lutte pour la domination, Wille ZUR Macht : « De nombreuses pulsions
luttent en moi pour la prédominance. Je suis en cela l'image de tout ce qui est vivant et je me
l'explique ». « L'homme, pluralité de ''volontés de puissances'' », « est une pluralité de forces
hiérarchisées, de telle sorte qu'il y a des chefs, mais que le chef doit procurer aux subordonnés tout
ce qui sert à leur subsistance ; il est donc conditionné par leur existence. Il faut que tous ces êtres
vivants soient d'espèce analogue, faute de quoi ils ne sauraient servir et obéir les uns les autres ; les
maîtres doivent en quelque manière être à leur tour subalternes, et dans des cas plus subtils il leur
faut temporairement échanger leurs rôles ; celui qui commande d'habitude doit pour une fois obéir
(…). Le centre de gravité est variable ; la continuelle production des cellules, etc. cause un
changement perpétuel du nombre de ces êtres. Et ce n'est pas d'une simple addition qu'il s'agit ».
Le conflit interdit l' « harmonie ». « La pluralité et l'incohérence des impulsions, l'absence
de système entre elles produit la ''volonté faible'' ; la coordination de ces impulsions sous la
prédominance de l'une d'entre elles produit la ''volonté forte'' ; dans le premier cas, il y a oscillation
et manque d'un centre de gravité ; dans le second cas, précision et décision claire ». Direction, et
non état d'équilibre. Les pulsions du corps sont donc « des êtres qui croissent, luttent, s'augmentent
ou dépérissent, si bien que leur nombre change perpétuellement et que notre vie, comme toute vie,
est une mort perpétuelle ». Le corps-esprit représente un équilibre contradictoire. Et c'est pourquoi
« la lutte s'exprime même dans le changement du commandement et de l'obéissance ».
Une hiérarchie est établie au profit d'un « groupe de dirigeants » qui prend « la tête d'une
collectivité ». C'est « l'aristocratie à l'intérieur du corps, la pluralité des maîtres », de telle sorte que
« le sujet est une multiplicité ». Mais cette composition instable entre l'unité et le pluriel, n'est-ce
pas également le statut de l'interprétation ? La logique métaphorique de la politique chez Nietzsche
et sa problématique de l'interprétation du texte apparaissent isomorphes.
« Si nous étions une unité, ce conflit ne pourrait en soi exister. De fait, nous sommes une
multiplicité qui s'est construit une unité imaginaire ». Semblablement, le texte serait compris, et
non à interpréter, s'il était une unité. De même que dans la domination du conscient, la lutte ne
s'abolit pas, mais persiste sous la forme d'un compromis tendu entre les affects, de même,
l'interprétation d'un texte est une unité qui n'en résorbe pas la pluralité : il n'y a pas d'interprétation
unique, ni d'unité de l'interprétation d'un texte. « Les affects sont une pluralité derrière laquelle il
n'est nul besoin de postuler une unité : il suffit de les considérer comme un conseil de régence ».
Tout comme il n'est pas possible d'attribuer un sens à un texte, selon Nietzsche, pour le corps « il
n'est pas nécessaire d'admettre qu'il n'y a qu'un sujet unique : qui sait s'il ne serait pas permis tout
aussi bien d'admettre une multiplicité de sujets dont la coopération et la lutte feraient le fond de
notre pensée et de toute notre vie consciente ? Une sorte d'aristocratie des « cellules » en qui réside
l'autorité ? Un groupe d'égaux qui sont habitués à gouverner ensemble et qui savent commander ?
Inversement, la conscience, multiple unité qui prétend s'imposer comme « monarque », revêt le rôle
d'une interprétation par rapport à l'ensemble du texte.
c/ La métaphore philologique de l'interprétation. - La métaphore philologique s'articule sur la
métaphorique politique : le corps fonctionne selon un schéma d'interprétation. Interpréter, c'est, face
à une pluralité, choisir des possibilités de sens d'un signe ou d'un ensemble de signes polysémiques.
C'est à la fois livrer le signe à sa plurivocité, et forcément abréger celle-ci : c'est libérer et dominer,
se rendre maître par des exclusives.
La domination de la conscience repose en réalité sur l'ignorance, mode d'interprétation. « Il
y a dans autant de ''conscience'' qu'il y a d'êtres (à chaque instant de son existence) qui constituent
son corps. Ce qui distingue ce ''conscient'' que d'habitude on s'imagine unique, l'intellect, c'est
justement qu'il demeure protégé et exclu de ce qu'il y a d'innombrable et de divers dans l'expérience
de ces diverses consciences ; c'est qu'il est une conscience de rang supérieur, une collectivité
régnante, une aristocratie, et de ce fait on ne lui présente qu'un choix d'expériences et d'expériences
simplifiées, faciles à dominer du regard et à saisir, donc falsifiées – afin que de son côté il persiste
dans ce travail de simplification et de clarification, donc de falsification et prépare ce qu'on appelle
communément un ''vouloir'' ; - chacun de ces actes volontaires suppose en quelque sorte l'élection
d'un dictateur. Mais ce qui offre ce choix à notre intellect, ce qui a au préalable simplifié, égalisé,
interprété les expériences, ce n'est certainement pas ce même intellect, pas plus qu'il n'est celui qui
exécute la volonté ». Selon le fil de la métaphore, le conscient est « dictateur », « monarque
général », mais son pouvoir repose sur ce qu'il y a de simplification dans un acte interprétatif :
« Une certaine ignorance dans laquelle on maintient le monarque au sujet des opérations de détail,
et même des troubles de la collectivité, fait partie des conditions qui lui permettent de régner ».
« De même qu'un général désire et doit rester dans l'ignorance d'un grand nombre de faits, afin de
na pas compromettre ses vues d'ensemble, ainsi il doit nécessairement y avoir dans la conscience
une pulsion qui exclut, écarte et choisit et ne se laisse exposer que certains faits ».
Mais que faut-il entendre par ignorance ? Nietzsche la présente comme « une certaine façon
de voir les choses en grand et en gros, de simplifier et de falsifier, selon des perspectives », comme
l'effet d'une « traduction » d'un « jeu collectif » où les expériences sont « simplifiées », « égalisée »,
« interprétées ». Or ce sont les opérations de l'interprétation, comme condition du perspectivisme
vital : « Il est nécessaire que tu comprennes que sans cette sorte spéciale d'ignorance la vie même
serait impossible, et que c'est une condition sans laquelle le vivant ne saurait se conserver ni
prospérer ; il te faut autour de toi une grande et solide cloche d'ignorance ». c'est par les signes,
abréviations simplifiantes, que la conscience interprète et domine. « Il n'y a pas de faits immédiats ;
il en est de même des sensations et des pensées ; dès que j'en prend conscience, j'abstraits, je
simplifie, je tente une construction ; c'est cela qu'on appelle prendre conscience des choses, c'est
une façon très active de les arranger (…). Une pensée, une sensation sont les signes de certains
phénomènes (…). C'est une simplification temporairement permise du véritable état des faits ». La
conscience est dans une situation d'interprétation. Ainsi, « l'''expérience interne'' ne devient
consciente qu'après avoir trouvé un langage intelligible pour l'individu, c'est-à-dire une façon de
traduire un état de conscience en états qui lui soient plus familiers ». Interpréter, c'est « se rendre
maître par signes d'une masse énorme de faits ». Or telle est la capacité de l' « intellect ». Dire que
le conscient est signe simplifiant, c'est donc lui attribuer le même statut que celui de l'interprétation,
ce qui suppose que le corps lui-même est comparable à un texte. « Une idée est une invention à
laquelle rien ne correspond exactement, bien qu'un grand nombre de choses y correspondent plus ou
moins (…). Mais ce monde imaginaire est pour l'homme un moyen de s'emparer par signes d'une
foule immense de faits et de se les graver dans la mémoire. Ce système de signes constitue sa
supériorité, justement parce qu'il est à l'opposé du détail des faits. La réduction des expériences en
signes, et la masse croissante des choses qui se laissent saisir ainsi, constituent sa force suprême ».
La capacité de signifier est une « faculté inouïe d'abréviation mise au service du commandement ».
Toutefois, la progression des métaphores se trouve bloquée. Par une sorte de cercle,
Nietzsche reporte la métaphorique philologique de l'interprétation sur les métaphores précédentes.
Pour l'expliciter, Nietzsche a recours aux images de l'assimilation et du compromis, qui ressortissent
aux métaphoriques digestive et politique. « La pense consiste à fausser par transformation, la
sensation consiste à fausser par transformation, le vouloir consiste à fausser par transformation ;
partout, c'est la faculté d'assimilation qui est à l'œuvre, et elle suppose la volonté de ramener à notre
ressemblance les choses extérieures. Il n'y a là aucun désir d'''objectivité'', mais une sorte
d'incorporation et d'adaptation pour des fins de nutrition ». « quiconque s'est fait du corps une idée
tant soit peu exacte – des nombreux systèmes qui y collaborent, de tout ce qui s'y fait en solidarité
ou en hostilité réciproque, de l'extrême subtilité des compromis qui s'y établissent... ». Nietzsche va
parfois jusqu'à glisser d'une métaphore à une autre : « Cette attitude envers la matière première
fournie par les sens (…) n'est pas dictée par le dessein de trouver le vrai, mais par une sorte de
volonté de dominer, d'assimiler, de se nourrir. Nos fonctions constantes sont absolument égoïstes,
machiavéliques, sans scrupules, astucieuses : le commandement et l'obéissance y sont poussés à
l'extrême ». Dans tous les cas, compromis et assimilation, de même qu'interprétation, constituent
« un équilibre de force momentané entre toutes nos pulsions constitutives ».
Tout ce que nous pouvons conclure quant au corps, c'est ce que suggèrent les notions de
compromis, d'assimilation et d'interprétation : Nietzsche constitue les prétendus faits en signes.
« Les séries et les successions apparentes de sensations, de pensées, etc., sont les symptômes des
enchaînements véritables (…). La pensée suivante est un signe de la façon dont l'ensemble de la
situation des forces s'est entre-temps modifié ». « Ce que nous appelons la ''vie'', c'est une
multiplicité de forces reliées par un phénomène de nutrition qui leur est commun. Ce phénomène de
nutrition comprend, comme moyen de réalisation, tout ce qu'on appelle sensation, représentation,
pensée, c'est-à-dire : 1° la résistance à toutes les autres forces ; 2° un arrangement de ces forces
selon une forme et un rythme particuliers ; 3° une appréciation au sujet de leur assimilation ou de
leur élimination ». La personnalisation croissante renforce le rapprochement avec l'art d'interpréter.
Vivre, c'est bien « digérer le vécu », mais au sens où interpréter correctement, c'est « ruminer ».
Nous avons donc moins une tentative de détermination du corps organique qu'une tentative pour
expliciter le concept d'interprétation, ou pour éviter d'avoir à le penser, comme si ce n'était pas un
concept.
« Ce sont nos besoins qui interprètent l'univers ; nos pulsions, leur pour et leur contre. Toute
pulsion est une sorte d'ambition de dominer, chacune a sa perspective propre qu'elle tâche d'imposer
comme norme à toutes les autres pulsions ». Donc : « tout sens est volonté de puissance ». La
culture est interprétation de la volonté de puissance des pulsions : « Dans quelle mesure les
interprétations du monde sont-elles les symptômes d'une pulsion dominante ? ». Mais cette question
n'aboutit qu'à un cercle : comme domination-interprétation, « toute morale n'est au fond qu'une
forme affinée des mesures prises par toute vie organique pour s'adapter et cependant se nourrir et
gagner de la puissance ». Le corps, comme rapport de forces des signes assimilés est un lieu
interprétatif. « La volonté de puissance interprète ( - la formation d'un organe résulte d'une
interprétation) : elle délimite, fixe des degrés, des différences de puissance. De simples différences
de puissance ne peuvent être senties comme telles ; il faut qu'il y ait une chose qui veut croître, qui
interprète d'après sa valeur propre toute autre chose qui veut croître (…). - En vérité, interpréter un
fait, c'est déjà un moyen de s'en rendre maître. Le processus organique présuppose une activité
interprétative continue ».
Mais comment définir l'interprétation ? ….
Vous aimerez peut-être aussi
- Comment Situer L'esprit Dans La Nature ?Document20 pagesComment Situer L'esprit Dans La Nature ?bobobPas encore d'évaluation
- Queue Du BonheurDocument62 pagesQueue Du BonheurAlexandre SilenusPas encore d'évaluation
- Yoga Et Bâton 6Document48 pagesYoga Et Bâton 6arbed100% (1)
- L'herméneutique de La Maladie Chez NietzscheDocument11 pagesL'herméneutique de La Maladie Chez NietzschePedro GobangPas encore d'évaluation
- Alain Badiou - Huit Thèses Sur L'universelDocument5 pagesAlain Badiou - Huit Thèses Sur L'universelcaroscribdoPas encore d'évaluation
- PDFDocument22 pagesPDFЕрика Иатнасна МайимонзеPas encore d'évaluation
- Définition Hasard - Encyclopédie Scientifique en LigneDocument6 pagesDéfinition Hasard - Encyclopédie Scientifique en Ligneptruong87100% (1)
- Métaphysique1 12Document78 pagesMétaphysique1 12Edoardo TascaPas encore d'évaluation
- Livret Agregation 2013Document35 pagesLivret Agregation 2013Lesabendio7Pas encore d'évaluation
- GardiesDocument8 pagesGardiesCarla MarxPas encore d'évaluation
- CRP Cohen Halimi 2007 2008Document27 pagesCRP Cohen Halimi 2007 2008Sacha DobridiovskyPas encore d'évaluation
- Bruno Karsenti: La Transcendance de L'autonomieDocument11 pagesBruno Karsenti: La Transcendance de L'autonomieDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Demulier Guerre-Paix PDFDocument15 pagesDemulier Guerre-Paix PDFAristo PatPas encore d'évaluation
- Cours Capes Notions 1 (Cohen-Halimi) - Seances 1 A 6 (Notes Marouan)Document44 pagesCours Capes Notions 1 (Cohen-Halimi) - Seances 1 A 6 (Notes Marouan)fezkfhaefcqjsPas encore d'évaluation
- 7PH06TE0120 SyntheseDocument2 pages7PH06TE0120 SyntheseSoma OthmanPas encore d'évaluation
- BOUVERESSE, J. - Une Épistémologie Réaliste Est-Elle PossibleDocument32 pagesBOUVERESSE, J. - Une Épistémologie Réaliste Est-Elle PossibleCarlo FuentesPas encore d'évaluation
- Fichage Kant Pas À PasDocument25 pagesFichage Kant Pas À PasJulien SorelPas encore d'évaluation
- LA QUESTION DE L'ETRE COMME FOND ABYSSAL D'APRÈS HEIDEGGER . Daniel PanisDocument21 pagesLA QUESTION DE L'ETRE COMME FOND ABYSSAL D'APRÈS HEIDEGGER . Daniel PanisnicolasPas encore d'évaluation
- Aristote de L Ame Lcournarie OkDocument47 pagesAristote de L Ame Lcournarie OkLivio Xylofono100% (1)
- Le Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotinDocument11 pagesLe Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotindoppiapresaPas encore d'évaluation
- PDF Nietzsche Blondel AuroreDocument77 pagesPDF Nietzsche Blondel AurorePerse OkuyanPas encore d'évaluation
- 7PH06TE0021 - Exemple Explication RousseauDocument3 pages7PH06TE0021 - Exemple Explication RousseauArnault “Arnault”Pas encore d'évaluation
- La Théorie de Lupasco OKDocument18 pagesLa Théorie de Lupasco OKtangoeugenPas encore d'évaluation
- Corps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)Document21 pagesCorps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)dhstyjntPas encore d'évaluation
- Victor Delbos - La Philosophie Pratique de Kant-Alcan (1905)Document818 pagesVictor Delbos - La Philosophie Pratique de Kant-Alcan (1905)Benoit GidePas encore d'évaluation
- Heidegger Et Le Problème Du Monde de 1927 À 1930.Document109 pagesHeidegger Et Le Problème Du Monde de 1927 À 1930.Frédéric DautremerPas encore d'évaluation
- Michel Henry Et L'histoire de La Philosophie (Fichant) PDFDocument16 pagesMichel Henry Et L'histoire de La Philosophie (Fichant) PDFxfgcb qdljrkfgle100% (1)
- OutilsDocument2 pagesOutilsmarikokyoPas encore d'évaluation
- VicoDocument96 pagesVicopippiPas encore d'évaluation
- 7PH06TE0420 Partie2Document16 pages7PH06TE0420 Partie2viator P.NPas encore d'évaluation
- Louis Guillermit - Critique de La Faculte de Juger Esthetique de Kant (1979)Document192 pagesLouis Guillermit - Critique de La Faculte de Juger Esthetique de Kant (1979)garoto36Pas encore d'évaluation
- Diderot Chardin Et La Matiere SensibleDocument18 pagesDiderot Chardin Et La Matiere SensibleJose MuñozPas encore d'évaluation
- Simondon Et PatockaDocument14 pagesSimondon Et PatockavolentrianglePas encore d'évaluation
- mémoireM2BOUDJEMA 1Document101 pagesmémoireM2BOUDJEMA 1Naïm BoudjemaPas encore d'évaluation
- L'imagination Productrice Dans La Logique Transcendantale de Fichte PDFDocument22 pagesL'imagination Productrice Dans La Logique Transcendantale de Fichte PDFdfsdfsdftePas encore d'évaluation
- Garrigou Lagrange Le RéalismeDocument13 pagesGarrigou Lagrange Le RéalismePagilisPas encore d'évaluation
- Paris 1 - Philosophie Générale Complémentaire L2S3Document64 pagesParis 1 - Philosophie Générale Complémentaire L2S3Arthur HemonoPas encore d'évaluation
- HasardDocument14 pagesHasardNoa DELHOMMOISPas encore d'évaluation
- ARISTOTE, Éthique À EudemeDocument10 pagesARISTOTE, Éthique À EudemewizzardravenPas encore d'évaluation
- VAR 57351 1001 24 04 2015 - 13 24 21 - AbbyyDocument14 pagesVAR 57351 1001 24 04 2015 - 13 24 21 - AbbyyKarim BoubayaPas encore d'évaluation
- Les Méditations CartesiennesDocument26 pagesLes Méditations Cartesiennesjules borrelPas encore d'évaluation
- Cours VeriteDocument12 pagesCours VeriteCloé JeanPas encore d'évaluation
- Le Saint Augustin D'étienne Gilson - Une Lecture de L'introduction À L'étude de Saint Augustin D'étienne GilsonDocument14 pagesLe Saint Augustin D'étienne Gilson - Une Lecture de L'introduction À L'étude de Saint Augustin D'étienne GilsonJean Marc VivenzaPas encore d'évaluation
- Thesis La Conception Du Bonheur Chez AristoteDocument145 pagesThesis La Conception Du Bonheur Chez AristoteCaglar KocPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie Sur La Morale (Descartes)Document3 pagesCours de Philosophie Sur La Morale (Descartes)NanaPas encore d'évaluation
- Seconds Analytiques PDFDocument83 pagesSeconds Analytiques PDFJPWKPas encore d'évaluation
- Kant e Derrida CosmoplitismoDocument14 pagesKant e Derrida CosmoplitismoMaíra MatthesPas encore d'évaluation
- Fichte Droit Naturel (Fischbach)Document24 pagesFichte Droit Naturel (Fischbach)xfgcb qdljrkfgle100% (1)
- Qu'Est-ce Que La Philosophie de Heidegger A D'original - Cairn - InfoDocument19 pagesQu'Est-ce Que La Philosophie de Heidegger A D'original - Cairn - InfoFred CaravagePas encore d'évaluation
- HLP - Metamorphoses Du Moi - Ruy BlasDocument10 pagesHLP - Metamorphoses Du Moi - Ruy BlaslyblancPas encore d'évaluation
- Gabellieri Ontologie de L'image Et Phénoménologie de La VéritéDocument45 pagesGabellieri Ontologie de L'image Et Phénoménologie de La VéritéphgagnonPas encore d'évaluation
- Valeur Morale Joie SpinozaDocument7 pagesValeur Morale Joie SpinozasantseteshPas encore d'évaluation
- Bien Et Bonheur Chez Kant PDFDocument293 pagesBien Et Bonheur Chez Kant PDFBassam BeylounehPas encore d'évaluation
- 1 1271 Te WB 01 22Document43 pages1 1271 Te WB 01 22jessPas encore d'évaluation
- Cours Meillassoux - Copie 2Document8 pagesCours Meillassoux - Copie 2TarikBrikiPas encore d'évaluation
- Trouillard - La Moné Selon ProclosDocument12 pagesTrouillard - La Moné Selon ProclosRupertoPas encore d'évaluation
- Nietzsche Et Pascal. Le Crépuscule Nihiliste Et La QuestionDocument22 pagesNietzsche Et Pascal. Le Crépuscule Nihiliste Et La QuestionelgianerPas encore d'évaluation
- Wittgenstein PastoriniDocument17 pagesWittgenstein PastoriniMikael MoazanPas encore d'évaluation
- Le Panpsychisme Leibnizien - BouveresseDocument15 pagesLe Panpsychisme Leibnizien - BouveresseAlabernardesPas encore d'évaluation
- Chenille (Lépidoptère) - WikipédiaDocument7 pagesChenille (Lépidoptère) - WikipédiaFATIMAPas encore d'évaluation
- ConvexitéDocument4 pagesConvexitétoni_yousf2418Pas encore d'évaluation
- Fiche Pédagogique - Problèmes Mathématiques - Additions Et SoustractionDocument27 pagesFiche Pédagogique - Problèmes Mathématiques - Additions Et SoustractionflobassmaniacPas encore d'évaluation
- Tab de Bord RHDocument10 pagesTab de Bord RHnajm007Pas encore d'évaluation
- CSP Note D Analyse Et de Propositions Programme Ecole MaternelleDocument50 pagesCSP Note D Analyse Et de Propositions Programme Ecole Maternellenadsb1951Pas encore d'évaluation
- Les Royaumes Unis de Kama FRENCHDocument101 pagesLes Royaumes Unis de Kama FRENCHLaurent Ferry Siégni100% (1)
- Algèbre II, Les Matrices Et App LinDocument14 pagesAlgèbre II, Les Matrices Et App LinZaki ZakiPas encore d'évaluation
- Les Offres PromotionnellesDocument60 pagesLes Offres PromotionnellesGina Sybille Zong MviangPas encore d'évaluation
- R Rec V.430 4 201508 I!!msw FDocument4 pagesR Rec V.430 4 201508 I!!msw FDora DoraPas encore d'évaluation
- Pareto MaintenanceDocument5 pagesPareto Maintenanceswxcc xwxwPas encore d'évaluation
- Polaris - CorailDocument4 pagesPolaris - Corailjerome.luganPas encore d'évaluation
- Regulateur MPPTDocument2 pagesRegulateur MPPTMillerPas encore d'évaluation
- RHEOLOGIEDocument52 pagesRHEOLOGIEfadwaPas encore d'évaluation
- TD - Circuits Et Transfos - FERRAHDocument8 pagesTD - Circuits Et Transfos - FERRAHImene FerrahPas encore d'évaluation
- Ondes Lumineuses 20Document5 pagesOndes Lumineuses 20Hamza Zazaoui100% (1)
- Bac Pro Tfca Epreuve U11 Sujet Reponse 2021 3Document17 pagesBac Pro Tfca Epreuve U11 Sujet Reponse 2021 3nifaamine95Pas encore d'évaluation
- BODACC-B 20110102 0001 p000Document160 pagesBODACC-B 20110102 0001 p000Josephine BonjourPas encore d'évaluation
- Réorganisation Stratégique d'INTERBEVDocument3 pagesRéorganisation Stratégique d'INTERBEVINTERBEVPas encore d'évaluation
- 7 Symboles Hydrauliques Norme NF Iso 1219 1Document10 pages7 Symboles Hydrauliques Norme NF Iso 1219 1Koukou AmkoukouPas encore d'évaluation
- Bac S Mathematiques Antilles Guyane 2015 Obligatoire Corrige Exercice 2 Probabilites DiscretesDocument12 pagesBac S Mathematiques Antilles Guyane 2015 Obligatoire Corrige Exercice 2 Probabilites DiscretesIheb HamedPas encore d'évaluation
- Gmao OmDocument62 pagesGmao OmHachem HammadiPas encore d'évaluation
- Béton Projeté TheseDocument230 pagesBéton Projeté TheseLaziz Atmani100% (1)
- Cours 0Document10 pagesCours 0Bilel DekhiliPas encore d'évaluation
- Methode Du 8DDocument5 pagesMethode Du 8DDABILA BAGNIPas encore d'évaluation
- Model de Business PlanDocument15 pagesModel de Business PlanSaad ZiadiPas encore d'évaluation
- Convertisseurs StatiquesDocument4 pagesConvertisseurs Statiquesjean louis arbezPas encore d'évaluation
- Euréka J'ai JouéDocument3 pagesEuréka J'ai JouéArthur RichetPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Compactage Du SolDocument3 pagesChapitre 1 Compactage Du Solno pain no gainPas encore d'évaluation
- Cours Sur Les Tableaux de KarnaughDocument4 pagesCours Sur Les Tableaux de KarnaughBrainsamaPas encore d'évaluation