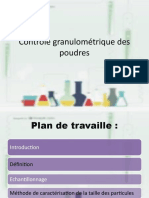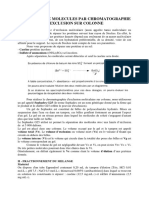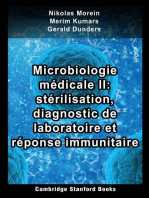Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
TP N°02 Tamisage de Poudres Analyse Granulométrique
Transféré par
Youcef BezTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
TP N°02 Tamisage de Poudres Analyse Granulométrique
Transféré par
Youcef BezDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université d’Alger 1 Ben Youcef BENKHEDDA
Faculté des Sciences
Département des Sciences de la Matière
TP N°2 Tamisage de poudres « Analyse granulométrique »
Introduction :
L'analyse granulométrique consiste à étudier la répartition des différents grains d'un échantillon, en
fonction de leurs caractéristiques (poids, taille, ...).
Dans le domaine pharmaceutique, la qualité des produits et l'intégrité des processus revêtent une
importance d’autant qu’elle conditionne en partie l’activité des médicaments, et les équipements de
tamisage jouent à cet égard un rôle essentiel.
Le contrôle granulométrique à l'aide de tamiseurs vibrants permet en effet d'éliminer les particules
indésirables, et donc d'éviter des problèmes susceptibles de conduire à des litiges. La qualité des
ingrédients et des produits finis est assurée, durant la production ainsi qu'avant l'utilisation ou l'expédition.
Parmi les conséquences technologiques de la granulométrie d’une poudre, nous pouvant citer son
influence sur :
La rhéologie : l’augmentation du degré de finesse entraine généralement une diminution de la
fluidité. La connaissance de degré de finesse permet l’addition d’une quantité convenable de lubrifiant.
Le pouvoir adsorbant des poudres.
La stabilité des suspensions
L’homogénéité et la stabilité des mélanges de poudres
Sur la qualité des comprimés (régularité de dosage, dureté, friabilité…)
Sur la biodisponibilité des PA peu solubles administré sous forme solide et sur leur vitesse de
dissolution
La stabilité physicochimique : l’augmentation du degré de finesse entraine une augmentation de la
surface, donc de la réactivité de la substance avec tous ses risques de dégradation.
Les caractères organoleptiques : augmentation du degré de finesse entraine une augmentation de
surface de contact avec les papilles gustatives et s’accompagne souvent de sensation d’amertume.
Objectif du TP :
- Le but de cette expérience est de déterminer et d’observer les différents diamètres de grains qui
constituent un granulat par l’analyse granulométrique.
- Faire une représentation graphique de l’analyse qui permettra d’observer et d’exploiter ces
résultats.
- Comparaison granulométrique entre plusieurs matières.
I- Principe de Tamisage :
1
Master 1 : Chimie Pharmaceutique 2018-2019
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université d’Alger 1 Ben Youcef BENKHEDDA
Faculté des Sciences
Département des Sciences de la Matière
- Consiste à faire passer une masse connue à travers une colonne de tamis soumis à des vibrations.
Chaque fraction refusée est ensuite pesée.
- Chaque tamis est formé par un tissage de fils qui laissent libres entre eux des intervalles carrés
appelés ouverture ou maille.
- Les tamis sont désignés par la longueur du côté de ces carrés « la taille des mailles » qui est
normalisée. Cette taille correspond aux termes d'une suite géométrique de raison 1,259. Chaque
dimension de maille d’un tamis correspond donc à la dimension du précédent multipliée par 1,259.
- Les tamis sont également repérés par un numéro d'ordre appelé module. Le premier tamis, 0,200
MM a comme module le numéro 20, le suivant le module 21 et ainsi de suite selon une progression
arithmétique de raison 1.
La pharmacopée donne une liste de tamis de contrôle dont les numéros vont de 38 à 11200 soit 38 μm à
11,2 mm d'ouverture de maille.
II- Analyse granulométrique par tamisage :
On distingue deux grandes classes pour l’analyse granulométrique, en pharmacie on a recours soit à des
méthodes directes qui reflètent directement la taille des particules (tamisage, le micro-tamisage, le
microscope « Méthode optique ») soit à des méthodes indirectes qui considèrent que la taille des
particules comme un paramètre susceptible d’intervenir dans un phénomène physique en l’occurrence le
mouvement des particules ( la diffraction à la lumière: le granulomètre laser, le compteur électronique des
particules..).
Mode Opératoire :
- On superpose les tamis de contrôle dont les dimensions des mailles vont en décroissant du tamis
supérieur au tamis inférieur.
- On recouvre le tamis supérieur après y avoir placé l’échantillon de poudre à étudier (ex 200g).
- Placez la tour de tamisage complète au centre de l’appareil et serrez la tour de tamisage
- Réglez la valeur d’amplitude optimale et la durée de tamisage.
- Démarrez le processus de tamisage.
- L’ensemble est agité pendant un certain temps (ex 10 mn) au bout duquel les particules se
répartissent sur les différents tamis : les plus grosses restent sur les tamis supérieurs les autres
traversent d’autant plus de tamis qu’elles sont plus fines.
- A la fin de l’opération, la fraction de poudre qui se trouve sur chaque tamis est pesée :
Master 1 : Chimie Pharmaceutique 2018-2019
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université d’Alger 1 Ben Youcef BENKHEDDA
Faculté des Sciences
Département des Sciences de la Matière
Rependre un à un les tamis en commençant par celui qui a la plus grande ouverture en
adaptant un récipient et un couvercle.
On agite chaque tamis en donnant à la main des coups réguliers sur la monture. D’une
manière générale, on peut considérer qu’un tamisage est terminé lorsque le refus sur un
tamis ne se modifie pas de plus de 1% en une minute de tamisage.
Verser le tamisât recueilli de chaque tamis dans un récipient.
Pesée la masse des granulats refusés dans chaque tamis.
Reproduire cette opération ainsi de suite jusqu’au dernier tamis.
- On trace un histogramme de fréquence : chaque fraction est représentée par un rectangle dont
la base représente l’intervalle entre les dimensions de mailles et la hauteur la fraction par
rapport à la totalité de la poudre (refus fractionné).
- On trace la courbe de fréquence en joignant le milieu du côté supérieur de chaque rectangle,
cette courbe donne un renseignement précis sur la répartition des particules en fonction de leur
grosseur, pour une poudre homogène la courbe aura une forme de cloche très étroite.
III- Exploitation des résultats :
Le pourcentage de grains dans chaque tamis est calculé à l’aide de la formule suivante :
mi
Xi = ( ) x 100
mT
(mi = tamisât recueilli de chaque tamis, mT= masse du produit)
La fraction de masse Xi est identifiée par une dimension Di (de chaque tamis). Si la durée de l’essai est
suffisante, nous admettons que sur chaque tamis, les particules retenues ont des dimensions plus
grandes que celles des ouvertures et par convention.
Master 1 : Chimie Pharmaceutique 2018-2019
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université d’Alger 1 Ben Youcef BENKHEDDA
Faculté des Sciences
Département des Sciences de la Matière
IV- Matériels et produits utilisé :
Liste du matériel Liste des matières
• Balance • Amidon de mais
• Spatule • Carbopol (polymère d'acide polyacrylique)
• Tamiseur • Alginate de sodium
• Mélange des matières précédentes
V- Questions :
Q1- Déterminez les masses des fractions de grain dans chaque tamis ?
Di mi X i relatif X i cumulé
Q2-Tracez la courbe relatives et cumulées pour chaque échantillon : Il suffit de porter les divers
pourcentages des tamisât cumulés (courbes cumulative) et relatifs (courbe relative) sur une feuille semi-
logarithmique :
• en abscisse : les dimensions des mailles.
• en ordonnée : les pourcentages sur une échelle arithmétique.
• La courbe doit être tracée de manière continue
Q3- Détermine (le) (les) diamètre(s) modal pour chaque poudre ?
Q4-Déterminer graphiquement les valeurs d10, d50, d90. Discuter la distribution des classes
granulométriques dans chaque échantillon de poudre.
Q5- Discuter l’homogénéité des poudres (étendue) ?
Q6- Quels sont les paramètres influençant les résultats de tamisage ? Commenter et conclure.
Master 1 : Chimie Pharmaceutique 2018-2019
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université d’Alger 1 Ben Youcef BENKHEDDA
Faculté des Sciences
Département des Sciences de la Matière
Master 1 : Chimie Pharmaceutique 2018-2019
Vous aimerez peut-être aussi
- Contrôle Granulométrique Des Poudres .Document30 pagesContrôle Granulométrique Des Poudres .Bouheraoua Rahma100% (1)
- GranulométrieDocument12 pagesGranulométriechaima gasmiPas encore d'évaluation
- TP CentrifugationDocument9 pagesTP CentrifugationKhalil Lasfer0% (1)
- But de TPDocument7 pagesBut de TPvisual and outfits victizmed kim taehyungPas encore d'évaluation
- TP N°:02: Filtration: Traitement Des EauxDocument10 pagesTP N°:02: Filtration: Traitement Des EauxnadhirPas encore d'évaluation
- TP SedimentationDocument9 pagesTP Sedimentationnadia benmehdia100% (1)
- TP - SédimentationDocument10 pagesTP - SédimentationDounia Saidi0% (1)
- TP Harrouche 2Document16 pagesTP Harrouche 2warda MaPas encore d'évaluation
- Projet-Plan-Dexperience 1Document25 pagesProjet-Plan-Dexperience 1cherni100% (1)
- TP RheoDocument19 pagesTP Rheoعبد العزيز مروى100% (2)
- TamisageDocument11 pagesTamisagehocine bariPas encore d'évaluation
- Universite de BlidaDocument6 pagesUniversite de BlidaLebel BachirPas encore d'évaluation
- TP FtirDocument10 pagesTP Ftiralexpagora100% (1)
- TP Ndeg3 Chimie Physique2 Tension de SurfaceDocument6 pagesTP Ndeg3 Chimie Physique2 Tension de SurfaceAbde TamPas encore d'évaluation
- tp13 Chromatographie ColorantsDocument3 pagestp13 Chromatographie Colorantslara100% (2)
- TP N1 Analyse GranulometriqueDocument6 pagesTP N1 Analyse GranulometriqueAbdallah HachaniPas encore d'évaluation
- TP 1 DissolutionDocument7 pagesTP 1 DissolutionAymene Salah Bendrihem100% (1)
- TP CCM 2deDocument3 pagesTP CCM 2deMed MohammedPas encore d'évaluation
- TP 2 Tda L3 GDPDocument3 pagesTP 2 Tda L3 GDPLina alikh100% (2)
- Compte Rendu TP 3 ÉlectrochimieDocument9 pagesCompte Rendu TP 3 ÉlectrochimieAbdessemed Shiraz NadaPas encore d'évaluation
- Compt Rendu Formation Des ImulsionsDocument5 pagesCompt Rendu Formation Des Imulsionscélia fer100% (1)
- TP MPD2Document8 pagesTP MPD2aimi amoulaPas encore d'évaluation
- TP PVT 02Document7 pagesTP PVT 02khelil mohamedPas encore d'évaluation
- TP 1 Emulsions Double m1Document5 pagesTP 1 Emulsions Double m1Chaima HamadiPas encore d'évaluation
- TP Chimie Compte Rendu Determination de La Concentration Dune Solution Par RefractometrieDocument3 pagesTP Chimie Compte Rendu Determination de La Concentration Dune Solution Par RefractometrieRoudaina Benzeguir100% (3)
- TP: Analyse Granulométrique Par Tamisage tp2: MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUEDocument8 pagesTP: Analyse Granulométrique Par Tamisage tp2: MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUEcélia fer100% (1)
- TP Analyse Granulometrique Par Tamisage PDFDocument6 pagesTP Analyse Granulometrique Par Tamisage PDFtatif100% (1)
- Dosage de La Vitamine C - BetaDocument9 pagesDosage de La Vitamine C - BetaSariak Riad0% (1)
- TP Refraction MolaireDocument9 pagesTP Refraction MolaireFatima YahiaPas encore d'évaluation
- TP 2 Dosage Par Etalonnage de L Eau de Dakin EleveDocument5 pagesTP 2 Dosage Par Etalonnage de L Eau de Dakin Elevekarim maziz100% (3)
- Poly TP Spectro de FlammeDocument5 pagesPoly TP Spectro de FlammeLaura Dijoux100% (1)
- Données TP 1 MESDocument21 pagesDonnées TP 1 MESislam oo100% (1)
- TP Extraction Liq-LiqDocument10 pagesTP Extraction Liq-LiqEmna LahmarPas encore d'évaluation
- Analyse Granulométrique, MaDocument5 pagesAnalyse Granulométrique, Mamonsterh5100% (4)
- Saidal Enregistré AutomatiquementDocument17 pagesSaidal Enregistré AutomatiquementKibane100% (1)
- Détermination de La Teneur en EauDocument1 pageDétermination de La Teneur en EauZineb Belala100% (2)
- TP 1 Preparation Solution 2020 2021 1Document6 pagesTP 1 Preparation Solution 2020 2021 1BillarjohnPas encore d'évaluation
- TP La Potentiométrie À Intensité NulleDocument6 pagesTP La Potentiométrie À Intensité NulleHakim KhenichePas encore d'évaluation
- CaféineDocument7 pagesCaféinehocine bariPas encore d'évaluation
- TP Masse Volumique Des GranulatsDocument5 pagesTP Masse Volumique Des GranulatsWanis BouhadjerPas encore d'évaluation
- TP Chromatographie Abdelouahed RhaouiDocument9 pagesTP Chromatographie Abdelouahed RhaouiAli BoutaharPas encore d'évaluation
- 1-Les Sirops PharmaceutiquesDocument50 pages1-Les Sirops PharmaceutiquesInés Nam100% (2)
- TP Gel FiltrationDocument4 pagesTP Gel FiltrationStéphane Bahanack100% (3)
- Analyse GranulométriqueDocument10 pagesAnalyse Granulométriqueimad dahmaniPas encore d'évaluation
- TP Foisonnement Du Sable - Porosité Des GranulatsDocument6 pagesTP Foisonnement Du Sable - Porosité Des GranulatsMag Doud100% (6)
- Brochure deTP Fabrication Et Controle Des ComprimésDocument3 pagesBrochure deTP Fabrication Et Controle Des ComprimésAymene Salah BendrihemPas encore d'évaluation
- Chromatographie Sur Couche MinceDocument25 pagesChromatographie Sur Couche MinceWinnie AhouhaPas encore d'évaluation
- Essai Granulometrique Par TamisageDocument21 pagesEssai Granulometrique Par TamisageDjaouadPas encore d'évaluation
- TP Milieu 3Document9 pagesTP Milieu 3Dahman DaoudiPas encore d'évaluation
- TP 2 Mise en Evidence D'un Excipient FiniDocument7 pagesTP 2 Mise en Evidence D'un Excipient FiniHamdaoui douniaPas encore d'évaluation
- TP de Biophysique 2013-2014Document24 pagesTP de Biophysique 2013-2014Youcef BonyPas encore d'évaluation
- TP Milieux Poreux DisperséesDocument18 pagesTP Milieux Poreux DisperséesDahman DaoudiPas encore d'évaluation
- Introduction Générale Sur La Chromatographie - CopieDocument29 pagesIntroduction Générale Sur La Chromatographie - CopieFatima Irjdaln100% (1)
- Tensioactifs Anioniques Tensioactifs Cationiques Tension Actifs Zwitterioniques Ou Amphotères Tensioactifs Non IoniquesDocument7 pagesTensioactifs Anioniques Tensioactifs Cationiques Tension Actifs Zwitterioniques Ou Amphotères Tensioactifs Non IoniquesFatima YahiaPas encore d'évaluation
- Dissolution FiltrationDocument72 pagesDissolution FiltrationLyes Dahmani75% (4)
- TP M2 Chimie AnlytiqueDocument6 pagesTP M2 Chimie AnlytiqueZakia MedadPas encore d'évaluation
- Microbiologie médicale II: stérilisation, diagnostic de laboratoire et réponse immunitaireD'EverandMicrobiologie médicale II: stérilisation, diagnostic de laboratoire et réponse immunitairePas encore d'évaluation
- 538c452c97b0f PDFDocument9 pages538c452c97b0f PDFaghilifPas encore d'évaluation
- TP Analyse Granulometrique Par TamisageDocument10 pagesTP Analyse Granulometrique Par TamisageCleovaldoLima67% (3)
- Analyse Granulométrique ExposéDocument37 pagesAnalyse Granulométrique Exposérania rassas100% (1)
- CHAP 234les Hydrocarbures Aromatiques PolycycliquesDocument5 pagesCHAP 234les Hydrocarbures Aromatiques PolycycliquesYoucef Bez100% (1)
- TP Hydrodistillation Lavande 07-08Document2 pagesTP Hydrodistillation Lavande 07-08Youcef Bez100% (1)
- I.Initiation Aux Outils InfoDocument3 pagesI.Initiation Aux Outils InfoYoucef BezPas encore d'évaluation
- TP N°01 Préparation Dune Pommade À Loxyde de ZincDocument4 pagesTP N°01 Préparation Dune Pommade À Loxyde de ZincYoucef Bez100% (6)
- Contrôlequalité Cours 1Document19 pagesContrôlequalité Cours 1Youcef BezPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 (Préparation Des Échantillons Pour Lanalyse ThermiqueDocument32 pagesChapitre 6 (Préparation Des Échantillons Pour Lanalyse ThermiqueYoucef BezPas encore d'évaluation
- Contrôle Qualité Industrie Pharmaceutique Cours 4Document3 pagesContrôle Qualité Industrie Pharmaceutique Cours 4Youcef Bez100% (1)
- T P-De-M Ate Riau - WatermarkDocument19 pagesT P-De-M Ate Riau - WatermarkJamal MouhimPas encore d'évaluation
- tp2 ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SECDocument5 pagestp2 ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SECSafa AdaikaPas encore d'évaluation
- Cours HydrogéoDocument30 pagesCours HydrogéoHind HindouPas encore d'évaluation
- Analyse GeoDocument6 pagesAnalyse GeoLotfy AleePas encore d'évaluation
- TP: Compactage Des Sols: (Essai Proctor)Document7 pagesTP: Compactage Des Sols: (Essai Proctor)Toufik FronçePas encore d'évaluation
- Analyse GranulometriqueDocument16 pagesAnalyse GranulometriqueCharaf Khelifi100% (1)
- TP N°01 Analyse GranulométriqueDocument3 pagesTP N°01 Analyse GranulométriqueAbdi LhsanPas encore d'évaluation
- TP3 stsbat1ANALYSE GRANULO Laboratoire Materiaux PDFDocument16 pagesTP3 stsbat1ANALYSE GRANULO Laboratoire Materiaux PDFCitron SucréPas encore d'évaluation
- TP Analyse GranulometriqueDocument4 pagesTP Analyse GranulometriqueMarouane Ezzaim100% (2)
- S7.10.1 Analyse GranulométriqueDocument6 pagesS7.10.1 Analyse GranulométriqueDramane CoulibalyPas encore d'évaluation
- TP Analyse GranlumtriqueDocument9 pagesTP Analyse GranlumtriqueLinda Mosiba100% (1)
- Analyse GranulométriqueDocument6 pagesAnalyse Granulométriqueadnane kassimiPas encore d'évaluation
- Essai Granulometrique Par TamisageDocument21 pagesEssai Granulometrique Par TamisageDjaouadPas encore d'évaluation
- Analyse Granulométrique Compte Rendu TP MDC Génie Civil PDFDocument10 pagesAnalyse Granulométrique Compte Rendu TP MDC Génie Civil PDFtatif100% (5)
- TP N1 Analyse GranulometriqueDocument6 pagesTP N1 Analyse GranulometriqueAbdallah HachaniPas encore d'évaluation
- TP 03Document6 pagesTP 03Rima ZAPas encore d'évaluation
- Liste Normes1Document8 pagesListe Normes1Saad El BouaziziPas encore d'évaluation
- Analyse Granulometrique Par TamisageDocument4 pagesAnalyse Granulometrique Par TamisageNassima Bireche100% (3)
- Analyse Granulométrique - Wikipédia PDFDocument8 pagesAnalyse Granulométrique - Wikipédia PDFBoukhobza SamiraPas encore d'évaluation
- Rapport TP GéologieDocument5 pagesRapport TP GéologieWido TixPas encore d'évaluation
- Analyse GranulométriqueDocument16 pagesAnalyse GranulométriqueLalia MimiPas encore d'évaluation
- TP TMC Analyse GranulometriqueDocument6 pagesTP TMC Analyse GranulometriqueIngénieurFaucon50% (2)
- Chapitre II Caractéristiques Des Matériaux Et Les Méthodes D PDFDocument19 pagesChapitre II Caractéristiques Des Matériaux Et Les Méthodes D PDFMoutiePas encore d'évaluation
- LDocument4 pagesLAmi Zaki100% (1)
- TP Analyse Granulometrique Par TamisageDocument6 pagesTP Analyse Granulometrique Par TamisageFarah FrgPas encore d'évaluation
- Cours Labo PARTIE 2 - LES GRANULATSDocument31 pagesCours Labo PARTIE 2 - LES GRANULATSbrahim_md67% (3)
- TP Mds N02-ConvertiDocument4 pagesTP Mds N02-ConvertiSouayeb Ala EddinePas encore d'évaluation
- ANALYSE GRANULOMETRIQUE Sable Et GravierDocument4 pagesANALYSE GRANULOMETRIQUE Sable Et GravierLamri Moulay LahcenePas encore d'évaluation
- TP MDC 1Document10 pagesTP MDC 1Bennour AymenePas encore d'évaluation
- TP Final 1Document8 pagesTP Final 1linaPas encore d'évaluation