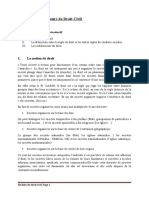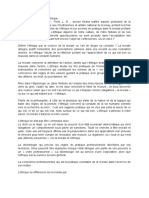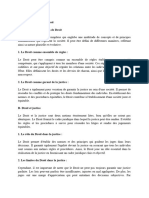Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rechtsphilosophie Grundwissen PH
Transféré par
Fadi Abdel Nour0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
173 vues46 pagesTitre original
Rechtsphilosophie-Grundwissen-Ph
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
173 vues46 pagesRechtsphilosophie Grundwissen PH
Transféré par
Fadi Abdel NourDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 46
Introduction : La relation entre le droit et la morale
La question de la relation entre le droit et la morale est au centre de la philosophie du droit
d'hier et d'aujourd'hui, dans la pratique juridique comme dans la théorie du droit. Héctor
Wittwer a déclaré dans une conférence donnée le 15 mai 2012 à Hanovre "que la question
de savoir comment le droit et la morale se rapportent l'un à l'autre reste l'un des
problèmes les plus intensément discutés en philosophie du droit". La même conviction est
exprimée dans une autre publication récente sur le sujet : Le "thème central de la
philosophie du droit dans la discussion actuelle" est le "pour et contre la séparation du
droit et de la morale dans le droit positif et donc l'opposition entre le droit naturel et le
positivisme juridique". C'est pourquoi il est judicieux de faire du droit naturel et du
positivisme juridique les deux grands thèmes de ce volume et de faire du rapport entre
droit et morale le fil conducteur du présent volume. Pour ce faire, une clarification
préalable du rapport entre la morale et la justice est nécessaire.
Clarification préalable : justice et morale
La plupart du temps, en philosophie du droit, la question de la relation entre droit et
morale est considérée comme celle de la relation entre droit et justice. Pourtant, la justice
n'est pas nécessairement synonyme de moralité. "De manière surprenante, le concept de
justice ne joue pas un rô le prépondérant chez [le philosophe moral par excellence]
Emmanuel Kant. Kant lui-même [ne fait] aucun lien entre son principe moral et le concept
de justice". Dans la section IV de l'introduction de la Métaphysique des mœurs, on peut
toutefois lire : "Ce qui est juste selon les lois extérieures est appelé juste (iustum), ce qui ne
l'est pas est injuste (iniustum)". (AB 23) On pourrait à ce stade faire une analogie entre les
"lois extérieures", c'est-à -dire le droit, et la morale, et dire que selon Kant, il est juste de
respecter les devoirs moraux parfaits. C'est pourquoi, avec la réserve formulée ici, le
rapport entre la morale et le droit peut être considéré comme le rapport entre la justice et
le droit. Ceci est plausible dans la mesure où le fondement de la justice est l'égalité - et le
fondement de toute norme morale est la reconnaissance de l'autre comme égal.
Aristote souligne dans l'É thique à Nicomaque que pour lui, toute vertu est contenue dans la
justice. Chez lui, la justice occupe donc une place de choix au sein de sa philosophie morale
et il existe un lien direct entre la morale (c'est l'éthique des vertus chez Aristote) et la
justice. "Elle est considérée comme la vertu la plus parfaite parce qu'elle est l'application de
la vertu la plus parfaite". Aristote résume ainsi : La justice et la vertu ou la morale "sont la
même chose, mais leur concept n'est pas le même, mais dans la mesure où il s'agit de la
relation à autrui, on parle de justice, mais dans la mesure où il s'agit d'un habitus qui
s'exerce dans les actes de justice, on parle de la vertu tout court". Alors que Platon admet
encore un parallélisme, voire une identité, entre un homme juste et une société juste,
comme nous le verrons plus tard, Aristote fait une nette différence entre un homme juste,
c'est-à -dire pour lui un homme vertueux, et une société ou une institution juste.
Aujourd'hui, c'est principalement de cette dernière forme que l'on parle lorsqu'on évoque
la justice. On parle généralement d'une justice institutionnelle, un terme qui s'est établi
plus tard en philosophie. Même John Rawls, qui a sans doute présenté avec sa Theory of
Justice la théorie de la justice la plus importante de notre époque, se consacre sans détour à
la justice dans la collectivité et non à l'individu juste.
Il faudra considérer la justice comme un idéal qui - pour reprendre une idée de Jü rgen
Habermas - est à la fois régulateur et constitutif, comme tous les idéaux des Lumières. On
entend par là que les idéaux structurent notre réalité. Prenons l'institution du procès : le
procès n'a lieu que parce qu'il repose sur l'idée de justice et que les parties qui souhaitent
un tel procès sont convaincues que la justice sera rendue grâ ce à lui, car sinon personne ne
se rendrait au tribunal. Les deux parties qui comparaissent devant le juge ont chacune le
sentiment d'être dans leur bon droit et trouveraient injuste que le juge n'en fasse pas
autant. La justice est donc constitutive de la mise en place et du déroulement du procès.
Mais en même temps, la justice est régulatrice, car on s'oriente vers l'idée idéale de la
justice et on essaie de la réaliser à nouveau dans chaque procès, et même mieux qu'avant.
La morale se rapporte à l'action humaine. En regardant une personne, nous pouvons
déterminer si elle s'oriente dans ses actions vers des normes morales. Nous ne parlerions
toutefois pas d'institutions morales ou immorales, mais d'institutions justes ou injustes.
Lorsqu'il s'agit d'institutions, par exemple d'un procès, d'un jugement ou d'un échevinage,
c'est le rapport entre justice et droit qui est abordé. On parle alors d'un jugement, d'un
tribunal ou d'un procès juste. On parle également d'un juge individuel juste ou injuste. Mais
dans ce cas, il s'agit de l'institution juridique du juge, car nous devons distinguer "la
fonction et la personne dans l'administration de la justice". Dans cette mesure, le rapport
entre la morale et le droit en référence aux institutions signifie le rapport entre la justice et
le droit.
Définition des concepts de "droit" et de "morale"
Pour Socrate, une différence entre le droit et la morale n'était pas encore concevable, car
pour lui, la vertu individuelle et le droit communautaire étaient identiques ; une infraction
au droit était en même temps une infraction aux règles morales. Formant d'abord une
unité, la morale et le droit se sont progressivement éloignés au cours de l'histoire : "Au
début du développement [du droit], il forme une unité difficilement séparable de la
religion, de la morale et des mœurs. Depuis Christian Thomasius et Emmanuel Kant, la
morale est conceptuellement séparée du droit, sans que l'on puisse finalement les séparer".
Les cinq différences suivantes entre le droit et la morale méritent d'être soulignées :
(1)Comme l'écrit Kant dans l'introduction à la Doctrine de la vertu, la loi morale exerce une
contrainte interne sur l'homme ; Kant la qualifie plus tard de conscience. Le droit, en
revanche, contraint l'homme de manière externe. C'est pourquoi le droit ne peut exister
qu'en relation avec le pouvoir de contrainte de l'É tat.
(2) L'élaboration des normes juridiques se distingue également des règles morales : Le
législateur adopte les normes juridiques. Pour les règles morales, une telle procédure est
impensable.
(3) Autre différence : les normes juridiques sont mises en vigueur à partir d'un certain
moment - par exemple "à partir de la publication au Journal officiel". Une telle mise en
vigueur est également impensable pour les règles morales.
(4) Enfin, en droit, la primauté du droit fédéral sur le droit régional est clairement établie,
c'est-à -dire que la règle "le droit fédéral prévaut sur le droit régional". Il est donc tout à fait
inoffensif que l'article 21 de la constitution du Land de Hesse prévoie encore aujourd'hui la
peine de mort. En outre, les décisions des instances supérieures annulent celles des
instances inférieures. L'unité juridique, c'est-à -dire la validité uniforme du droit sur
l'ensemble du territoire national, est en outre préservée par l'exception de litispendance.
En outre, en cas de subsidiarité formelle, une norme prime sur une autre. Dans le domaine
de la morale, en revanche, il faut décider soi-même, en cas de conflit d'obligations ou de
situation de dilemme, quelles règles morales doivent être considérées comme supérieures
pour celui qui décide et agit.
(5)Héctor Wittwer cite encore un autre critère de distinction plausible : "Dans le sens idéal-
typique, la morale et le droit sont tous deux des systèmes publics de normes pratiques pour
régler la vie en commun. Alors que la morale est un système informel de normes pratiques
dans lequel certains actes sont commandés ou interdits parce qu'ils sont considérés comme
commandés ou répréhensibles, le droit représente un système public formel de normes
pratiques dans lequel certains actes sont commandés ou interdits parce qu'ils ont été
commandés ou interdits en vertu de la loi par les instances autorisées à cet effet". Stefan
Weyers nomme également cette caractéristique distinctive : "Contrairement à la morale, le
droit implique une institutionnalisation".
Je résume les différences entre le droit et la morale, de sorte que nous arrivons à une
délimitation claire et donc à une définition du concept :
(1)Contrairement à la morale, le droit renonce à la conviction, car il peut compter sur la
contrainte étatique pour son application.
(2) Les lois résultent d'une décision du Parlement, ce qui n'est pas le cas des règles
morales.
(3) Les lois s'appliquent à partir d'une certaine date. Il est impensable que des normes
morales puissent entrer en vigueur à une date donnée.
(4) Dans le droit, il existe une primauté de certains droits sur d'autres, réglementée dans le
détail. En revanche, si des obligations morales sont placées sur un pied d'égalité, la décision
individuelle des personnes concernées est requise.
(5) La morale est l'ensemble des normes informelles, tandis que le droit est celui des
normes formelles.
2) Le rapport entre le droit et la morale dans le droit naturel, le positivisme juridique et le
national-socialisme
Après les premières explications préliminaires, tournons-nous maintenant vers les deux
orientations fondamentales de la philosophie du droit, le droit naturel et le positivisme
juridique. Le droit national-socialiste a toujours joué un rô le particulier dans la philosophie
du droit. Les opinions à son sujet ont toujours été controversées. Dans ce qui suit, nous
prendrons certes aussi position dans cette querelle, mais la présentation servira surtout à
clarifier davantage et plus profondément le droit naturel et le droit positif et leur
distinction.
Droit naturel
Socrate et Platon
Dans la polis, la demande d'un droit normé et juste se fait pressante, car après que la
vendetta, axée sur la famille ou le statut, eut survécu, il y eut des procès juridiques. La
transition a été représentée dans les tragédies en référence au conflit entre la classe sociale
et la polis. C'est évident dans l'Orestie. Après une série de vendettas conformes à son rang,
Oreste, qui a tué sa mère Clytemnestre conformément à son devoir, n'est plus la dernière
victime d'une autre vendetta, mais est soumis à une sorte de procès, au cours duquel un
jugement est certes rendu, mais qui a été manipulé par Pallas Athéna. Le fait qu'il y ait eu
un procès est déjà une innovation importante qui, de notre point de vue et interprétation
actuels, indique le début d'un processus de légalisation et de démocratisation.
Les Grecs étaient organisés de manière démocratique dans leurs procès. C'est pourquoi
leurs tribunaux étaient composés d'un grand nombre de juges populaires, parfois une
centaine et plus. Devant un individu, comme dans le procès romain et dans un procès
actuel, on argumente différemment que devant une foule, de manière plus calme et plus
précise. "Une foule, on essaie plutô t de la mettre de son cô té sur le plan émotionnel et
rhétorique". C'est pourquoi on estime encore aujourd'hui que "ce n'est que dans le silence
de la salle de délibération qu'il est possible de peser calmement toutes les raisons pour et
contre les points de vue présentés, ce n'est que là que le juge s'exprimerait de manière
impartiale sur l'affaire, ce n'est que là qu'une décision convaincante pourrait être prise. On
craignait qu'une délibération publique du jugement ne compromette les chances d'un
discours juridique impartial et n'encourage la formation de comités privés dans lesquels les
questions décisives pourraient continuer à être débattues sans être dérangées". Notre droit
s'inscrit à cet égard dans la tradition romaine et non dans la tradition grecque.
Socrate partait, comme nous l'avons dit, du principe d'une identité entre le droit et la
morale ou la justice. A la même époque, la thèse de la différence a été formulée : "C'est dans
la sophistique grecque du 5e siècle avant J.-C. que, pour la première fois, "droit" et "justice"
ne sont pas considérés comme s'accordant de manière évidente". Pour Socrate, en
revanche, les lois sont justes. Selon lui, Socrate n'a pas subi d'injustice lors de sa
condamnation à mort à cause des lois, mais à cause des hommes qui les ont mal
interprétées. "Il n'y avait pas de droit injuste, seulement des hommes injustes". Il faut
ajouter que la mentalité de Socrate ne lui permettait pas d'affronter une foule sur le plan
rhétorique.
En discutant de ce qu'est la justice, Platon a établi un parallèle entre la communauté et
l'individu et a dit qu'il était plus simple pour son analyse de la justice de lire la même chose
en gros caractères et "après avoir lu ceux-ci en premier, de considérer ensuite seulement
les plus petits pour voir s'ils sont vraiment les mêmes". Platon reconnaît dans la
communauté ce qui devrait se passer chez l'homme. Si les vertus s'harmonisent aussi bien
dans la communauté que chez l'individu, nous parlons d'une société juste ou d'un homme
juste. La justice est donc considérée par Platon comme la quatrième vertu, à cô té des trois
autres, la sagesse, le courage et la prudence. La vertu de sagesse revient à l'ordre
d'enseignement, la bravoure à l'ordre de défense et la vertu de prudence à l'ordre
nourricier, qui se compose des paysans et des artisans. Les classes ne doivent pas entrer en
concurrence les unes avec les autres, car cela nuirait à long terme à la communauté, voire
entraînerait sa disparition. La communauté ne perdure que si les vertus s'harmonisent
entre elles. Nous parlons alors d'une communauté juste. Il en va de même pour les
individus. Des vertus individuelles sont attribuées aux organes : la sagesse à la tête, le
courage au cœur et la prudence au ventre. Les organes doivent remplir les tâ ches qui leur
sont attribuées et ne doivent pas entrer en concurrence les uns avec les autres. Et si les
vertus sont en harmonie chez l'homme, il s'agit d'un homme juste. En ce qui concerne le
processus d'individualisation qui a débuté au XVe siècle et qui sera abordé plus loin, il faut
encore retenir pour la polis que personne ne pouvait quitter sa condition ou changer de
profession. Celui qui appartenait par exemple à la classe nourricière ne pouvait pas passer
à la classe enseignante ou inversement. Aujourd'hui, en revanche, il est tout à fait possible
de changer de profession et de lieu d'activité.
Qu'est-ce que cela signifie pour le droit chez Platon ? Dans son ouvrage Nomoi, il est dit que
la sagesse, le courage, la prudence et la justice doivent être les fondements des lois, qu'il
s'agisse du législateur de droit naturel (le législateur désigné par Zeus) ou de tout autre
législateur, y compris le législateur étatique. Quel que soit le législateur auquel on
s'adresse, il ne doit en tout cas porter son attention sur rien d'autre que sur la vertu
suprême, et c'est la justice accomplie. (630a-d) Platon considère donc la justice comme la
base du droit. Tout comme Socrate, il part lui aussi du principe de l'identité de la justice ou
de la morale ou de la vertu et du droit.
Dans l'Antiquité, la question de savoir si les hommes établissent le droit ou s'il existe un
droit naturel se posait régulièrement. Les sophistes parlaient de nomos ou de "thesei
dikaion" (justice établie par l'homme) d'une part et de physis ou "physei dikaion" d'autre
part. La justice équitable se divisait donc entre la justice faite par l'homme et la justice
naturelle.
Selon Karl-Heinz Ilting, nous trouvons dans la Stoa "pour la première fois la conception
d'un droit naturel au sens d'un système de normes universellement contraignant". "Pour
Zénon de Kition (336-264 av. J.-C.), le fondateur de la Stoa, le droit naturel est 'une loi
divine et possède en tant que telle le pouvoir de réglementer ce qui est juste et ce qui est
injuste'. Le droit naturel est supérieur au droit positif". Par conséquent, le droit naturel
aborde lui aussi la relation entre le droit codifié et la morale donnée par Dieu.
Qu'entendons-nous par "droit naturel" ? La meilleure façon de le caractériser est la
caricature que l'on trouve chez Uwe Wesel : Le chapeau haut de forme du magicien porte
l'inscription "nature" et le droit en jaillit comme un lapin. C'est de la nature que le droit sort
par magie. Dans ce cas, le droit naturel serait la base du droit positif, comme chez Hugo
Grotius. Mais le droit naturel est également considéré comme un correctif pour le droit
codifié, comme chez Ernst Bloch.
Karl-Heinz Ilting donne une définition englobant les deux variantes : "Par 'droit naturel', on
entend généralement le système de normes juridiques qui sont contraignantes pour tous
les hommes en tant qu'êtres de raison, même sans et, en cas de conflit, même contre toutes
les lois et directives positives, notamment étatiques, partout et à tout moment. La notion de
droit naturel ainsi définie, inchangée en tant que telle, a joué un rô le dominant dans
l'histoire de la pensée européenne depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours,
dans presque toutes les conceptions du droit et les discussions sur les normes, sous des
appellations variables et avec des connotations changeantes en fonction du contexte.
Comme le bien-fondé de la prétention à l'existence d'un tel système de normes obligatoires
n'est pas immédiatement certain, cette prétention à la validité a dû être à chaque fois
spécialement discutée, justifiée et développée dans des doctrines de droit naturel plus ou
moins élaborées".
Aristote
Aristote fait la distinction entre le droit naturel et le droit positif. Dans l'É thique à
Nicomaque, on peut lire : "Le droit politique se divise en droit naturel et droit légal
(positif). Le naturel est celui qui a partout la même validité, indépendamment du fait qu'il
semble bon ou non aux hommes ; le légal est celui dont le contenu est à l'origine indifférent,
mais qui, une fois fixé par la loi, a son contenu déterminé. Or, certains pensent que tout
droit est de cette dernière espèce, parce que tout ce qui est naturel est immobile et a
partout la même force, tandis que le droit est soumis au mouvement et au changement.
Mais il n'en est pas exactement ainsi, comme on le dit, mais seulement avec une différence.
Certes, chez les dieux, il se peut qu'il n'y ait pas de mouvement du tout. Chez nous, en
revanche, il y a certes aussi un domaine de la nature, mais celui-ci est entièrement soumis à
la loi du mouvement. Et pourtant, la différence entre ce qui est de nature et ce qui ne l'est
pas demeure. Or, quel droit est naturel et quel droit ne l'est pas dans les choses qui peuvent
aussi être autres, mais qui repose sur la loi et la convention, bien que les deux soient
également mobiles, cela se comprend de soi-même".
Selon Aristote, le droit naturel - indépendamment du consentement des hommes - est
universellement valable, alors que le droit fait par les hommes ne prend de valeur que
lorsqu'il est établi positivement. La différence est que le droit naturel est partout le même,
alors que le droit fait par l'homme ne l'est pas, "de même que les constitutions des É tats ne
le sont pas non plus, et pourtant l'une d'elles est la meilleure par nature, qu'elle se trouve
où elle veut". Il en résulte pour l'homme une difficulté qu'Aristote met en évidence : "Le
droit en soi est ce qui est fait et attribué d'une manière concrètement déterminée. Et
trouver ici toujours ce qui est juste exige plus que de connaître, par exemple, les remèdes
médicaux".
Cette difficulté apparaissait déjà dans l'Antigone de Sophocle, rédigée une bonne centaine
d'années avant l'É thique à Nicomaque d'Aristote. Antigone se réfère au droit naturel qui,
selon elle, existe toujours, même si personne ne sait d'où il vient. Parmi ces droits figure le
devoir que lui impose le droit naturel d'enterrer son frère Polyneikes. Elle n'en a cependant
pas le droit en vertu de la loi positive édictée par Créon. Ce conflit entre le droit naturel
"sans mur" et le droit positif, qui peut être d'"aujourd'hui ou d'hier", est l'objet de la
tragédie sophocléenne et s'y joue. Antigone formule le conflit de façon pointue ainsi :
"Celui qui a annoncé cela [Créon] n'était pas Zeus,
Même Diké, dans le conseil des dieux des morts
N'a jamais donné une telle loi aux hommes. Si grand
Ton ordre ne m'a pas paru bon, à moi qui suis mortel,
Pour qu'il ait pu faire les lois non écrites des dieux,
Ceux qui n'ont pas de murs, pourraient être dépassés.
Ils ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier,
Ils vivent toujours, personne ne sait depuis quand.
Je n'ai pas voulu m'en occuper, car l'orgueil humain
M'a effrayé, devenir coupable devant les dieux".
Pour surmonter la difficulté de trouver ce qui est juste dans le droit, Aristote introduit peu
après l'équité. Il écrit : "En effet, ou bien le droit n'est pas excellent et bon, ou bien l'équité,
si elle est différente du droit, n'est pas juste, ou bien si les deux sont excellents et bons, ils
sont semblables". Gü nther Bien qualifie ce "paradoxe trilemmatique dans sa simplicité" de
génial et explique ce qu'est l'"équité" dans le droit : "D'une part, l'équitable, comparé à un
certain droit, est un meilleur droit, d'autre part, il n'est pas meilleur que le droit dans le
sens où il serait d'un autre genre. Le droit et l'équité sont donc une seule et même chose, et
bien que tous deux soient justes et bons, l'équité est meilleure. Ou encore : l'équité est elle-
même un droit, mais meilleur qu'un certain droit, mais pas que le droit tout court. Comme
définition de l'équité, il en résulte : c'est une correction de la loi, là où celle-ci reste
déficiente en raison de sa version générale". Aristote définit ainsi : "Et c'est là la nature de
l'équité : c'est une correction de la loi, là où celle-ci reste déficiente en raison de sa
formulation générale. C'est aussi la cause du fait que tout n'est pas légiféré ; car il y a des
choses sur lesquelles on ne peut pas donner de loi". Pour pouvoir juger de manière
adéquate en tant que juge sur la base d'une loi générale et hautement abstraite ou sur la
base d'un principe de droit naturel qui n'a pas trouvé de normalisation en droit positif -
comme dans l'affaire Riggs contre Palmer citée par Dworkin -, il faut disposer d'un
jugement pratique personnel, c'est-à -dire d'une capacité morale. Les points de vue moraux
entrent dans le droit par le biais de l'équité. Mais il y a là un facteur d'incertitude important
: dans le droit actuel, nous parlons de la marge d'appréciation dont on dispose dans
l'interprétation de notions juridiques indéterminées. Cela pourrait favoriser l'arbitraire.
Nous devons manifestement vivre avec le fait que nous ne pouvons pas disposer d'une base
normative sû re pour un jugement équitable pour tous les cas, certes similaires dans la
réalité, mais en même temps très différents.
Dans une première clarification du rapport entre la morale et la justice, nous avons déjà
abordé la conception aristotélicienne de la justice, mais uniquement en ce qui concerne le
rapport à la morale. La clarification de ce qu'Aristote entend maintenant plus précisément
par "justice" et du rapport qu'elle entretient avec le droit doit encore être effectuée. Chez
Platon, la justice est la vertu suprême. Elle harmonise les autres vertus, à savoir la sagesse,
le courage et la prudence. Lorsqu'elles sont en harmonie, Platon parle d'une société juste
ou d'un homme juste. Aristote sépare strictement la considération de l'homme et de la
société, et on peut parler chez lui, lorsqu'il s'agit de la société dans son ensemble, d'une
justice institutionnelle, un concept déjà expliqué plus haut. Aristote connaît deux formes de
justice, il les appelle des justices particulières :
-Il y a tout d'abord la justice distributive ou répartitrice. Il en existe deux sortes : "L'une
[est] celle qui porte sur l'attribution des honneurs ou de l'argent ou d'autres biens [qui]
peuvent être distribués entre les citoyens - car ici l'un peut recevoir inégalement et autant
que l'autre - ; l'autre est celle qui règle les rapports des individus entre eux". On pourrait
aussi appeler la première sorte la justice au mérite, car ce qui compte ici, c'est l'adéquation
de la répartition. Chacun doit recevoir ce qui correspond à ses mérites pour la collectivité.
Le deuxième type de justice distributive est l'échange d'équivalents, qui est juste du fait
que l'on échange à des équivalents.
-Aristote connaît également la justice commutative ou compensatoire, qui accorde une
compensation aux personnes défavorisées, de sorte qu'elles soient mises sur un pied
d'égalité. Si quelqu'un a subi un préjudice lors d'une infraction à la loi, le juge doit réparer
ce tort. "Le juge [rétablit] ainsi l'égalité". La justice compensatoire joue aujourd'hui un rô le
important dans la théorie et la pratique politiques, lorsqu'il s'agit de combler l'écart entre
les riches et les pauvres ou du moins de ne pas le laisser se creuser davantage.
Les deux formes de justice reposent sur l'idée que tous les individus doivent être traités de
manière égale dans la communauté, car une inégalité de traitement est ressentie comme
une offense et une humiliation et constitue donc une atteinte à la dignité. Aristote estimait
que le juste est celui qui est un "ami de l'égalité". L'égalité est la caractéristique centrale de
la justice générale et donc, bien entendu, des trois justices particulières, la justice
distributive avec ses deux types et la justice compensatoire.
Quelle est donc la relation entre le droit et la justice chez Aristote ? Ils sont en interaction.
D'un cô té, le droit n'est juste que s'il traite tout le monde de la même manière. De l'autre,
n'est juste que celui qui respecte le droit : "Puisque le transgresseur de la loi nous a paru
injuste et l'observateur de la loi juste, il est évident que tout ce qui est légal est, en un
certain sens, juste et droit".
De Cicéron à Kant
Chez les philosophes du droit de l'Antiquité tardive et du Moyen  ge, les choses se
présentent ainsi : Pour Cicéron, une injustice commise reste une injustice, même s'"il n'y a
pas de loi écrite qui l'interdise, car celle-ci peut être reconnue comme injustice au moyen
de la raison. C'est par la nature, c'est-à -dire la raison, que l'homme peut faire la différence
entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste". Chez Cicéron, le droit et la morale sont
donc séparés. Chez Augustin, en cas de conflit entre le droit étatique et la morale fondée sur
la religion, c'est cette dernière qui prime et on a le droit de refuser d'obéir au droit
étatique. "La pertinence historique immédiate de cette séparation du droit et de la morale a
bien sû r été aussitô t perdue une fois que la religion chrétienne a été institutionnellement
ancrée dans l'É tat romain sous la forme d'une É glise d'É tat". C'est pourquoi, pour Thomas
d'Aquin, le droit positif ne pouvait être rien d'autre qu'une interprétation du droit naturel,
"puisque le droit naturel ne fournit pas d'instructions concrètes pour l'action". Le droit et la
morale formaient ainsi une unité. Ce n'est qu'à l'époque moderne que l'on assiste à
nouveau à la séparation du droit et de la morale, à commencer par Christian Thomasius
(1655-1728), puis surtout par Emmanuel Kant (1724-1804). C'est également l'avis d'autres
auteurs : "La séparation du "droit" et de la "morale", développée pour la première fois chez
Christian Thomasius, a acquis une importance considérable pour le développement
ultérieur du rapport "droit/justice". De même, chez lui, le droit codifié n'est plus issu du
droit naturel, car celui-ci n'a pas la force nécessaire que doivent avoir les normes
juridiques. C'est d'ailleurs une caractéristique incontestée du droit par tous les philosophes
du droit de tous bords : le fait qu'il soit doté d'un pouvoir de contrainte. C'est en effet l'une
des caractéristiques mentionnées au début qui distinguent le droit de la morale : "Par
"droit", on entend le système de règles effectivement en vigueur dans un système social,
dont les normes peuvent, le cas échéant, être imposées par la force dans le cadre d'une
procédure réglementée. C'est par ce caractère coercitif que le droit se distingue des autres
ordres de la vie sociale tels que la coutume, les mœurs, la convention et la morale".
Hugo Grotius
Au sein du droit naturel de l'époque moderne, l'unité du droit et de la morale était
cependant encore admise. C'est l'idée défendue par ses avocats selon laquelle la nature est
la représentation de ce qui est juste et donc obligatoire, dans laquelle le droit peut être
puisé et éventuellement corrigé. Chez Hugo Grotius (1583-1645), spécialiste du droit
naturel, il y a encore des signes clairs que pour lui le droit et la morale ne sont pas deux
domaines différents, car il parle du fait que le droit naturel peut être d'une part
moralement laid ou d'autre part moralement nécessaire. Chez Grotius, la morale est donc le
critère du bon et du mauvais droit. - La morale individuelle se retrouve chez lui dans les
droits individuels : les sujets de droit sont considérés comme égaux. De plus, il existe dans
son droit naturel des droits fondamentaux, comme le fait que la propriété peut être
défendue par chaque individu. Et les contrats doivent être respectés : "Il est dans le droit de
la nature de respecter les contrats". En outre, chez Grotius, comme chez Ernst Bloch, le
droit naturel a pour mission de corriger le droit positif. "Il a pour fonction de guider et de
compléter le droit positif, mais aussi de le critiquer et de le limiter, aussi grande que puisse
être l'autorité historique ou religieuse d'une loi positive".
Ernst Bloch
La fonction correctrice du droit naturel est au centre des préoccupations d'Ernst Bloch
(1885-1977). Philosophe bien plus tardif que Grotius, il est peut-être l'un des derniers
spécialistes du droit naturel en général. Cette fonction corrective n'est en aucun cas une
"volonté abstraite de mieux savoir". Le droit naturel n'a jamais été cela dans son histoire.
Dans le droit positif, l'ordre juridique existant est considéré comme primaire, alors que
dans le droit naturel classique, les droits fondamentaux politiques, que Bloch assimile aux
droits de l'homme, sont considérés comme primaires et l'ordre juridique objectif comme
secondaire. Ainsi, les droits fondamentaux seraient le critère auquel l'ordre juridique
objectif doit se conformer, car le droit naturel est "l'anticipation d'un mieux que ce qui est
devenu jusqu'à présent". Pour Bloch, cela ne peut être pensé que dans le contexte des
utopies sociales, de l'émancipation de la société, car le droit ne peut pas être suspendu en
l'air, mais régule l'ordre étatique ou social. Mais sur quoi le droit positif devrait-il s'orienter
? La réponse est : au droit naturel, qui vise à établir la dignité humaine et la justice.
Tout d'abord, l'établissement de la dignité humaine : "La quintessence ultime du droit
naturel classique, sans les autres accessoires, reste toujours le postulat de la dignité
humaine. Par conséquent, en tant qu'héritage propre au droit naturel qui a été
révolutionnaire : suppression de tous les rapports dans lesquels l'homme est aliéné avec
les choses pour devenir une marchandise et non seulement une marchandise, mais une
nullité en valeur intrinsèque".
Parlons maintenant de la justice : Bloch ne pense pas à une justice distributive offerte par le
patriarcat selon la formule "Suum cuique", qui "présuppose le père au foyer, le père au
pays, qui dépose d'en haut dans l'assiette de chacun sa portion de punition ou sa part de
biens sociaux (revenu, position)". Se démarquant des conceptions de la justice de
l'Antiquité, du Moyen-Â ge et des débuts de l'époque moderne, qui ne contiennent "aucun
mouvement venant d'en bas", Bloch a en vue la justice conquise par le bas, car il n'est pas
vrai que l'homme soit né libre et égal. Il n'a pas de droits innés. Les droits doivent être
acquis par la lutte. La "véritable justice, en tant que justice d'en bas, s'oppose à la justice
rétributive et distributive elle-même, à l'injustice intrinsèque qui prétend exercer la
justice".
Si l'on résume ce que Bloch entend par "droit naturel", qui constitue pour lui le critère et le
correctif des règles du droit positif, il s'agit pour lui des contenus centraux de la dignité
humaine et de la justice. Les normes juridiques doivent toujours être mesurées à l'aune de
ces principes. Comment Bloch justifie-t-il le fait que ces deux valeurs sont ou devraient être
la référence du droit ? Il le justifie par l'histoire et dit que depuis Spartacus, il y a quelque
chose de permanent dans le droit : la revendication de la dignité humaine. Bloch compte
également la justice - sous des formes certes différentes - parmi les "dispositions les plus
durables et les plus importantes du droit naturel". Pour lui, l'évidence du droit naturel en
tant que norme du droit positif découle de l'histoire : plus une chose est valable depuis
longtemps, plus elle est évidente. C'est un raisonnement qui est tout à fait critiquable, car
on pourrait parler ici de la force normative du fait, formulée ainsi : Ce qui est toujours déjà
valable est juste. Mais il s'agit là d'un raisonnement naturaliste erroné ou, plus
précisément, d'un "raisonnement historiciste erroné", comme l'appelle Herbert
Schnä delbach.
Le processus d'individualisation
Mais revenons à l'époque moderne. Hobbes (1588-1679) identifie le droit naturel à la
morale. Les fondements moraux du droit naturel sont pour lui les mêmes que pour Grotius,
et ce sont ceux dont Hobbes a besoin pour constituer sa théorie des contrats : la confiance
mutuelle et la volonté de cohabiter pacifiquement dans des conditions juridiques. Avec le
début du processus d'individualisation au XVe siècle, la question de la possibilité de
cohabitation des individus au sein de la communauté étatique s'est posée avec plus d'acuité
que jamais. La théorie hobbesienne du contrat constituait alors une réponse déterminante.
Selon Hobbes, la communauté repose "sur le contrat de chacun avec chacun".
Une date décisive pour le processus d'individualisation qui a débuté à cette époque est
l'impression des livres en 1440. Ce n'est qu'à partir de cette date que l'auteur d'un livre a
pu être identifié de manière indubitable. Jusqu'à cette date, un livre était souvent une
œuvre collective et devait l'être, car lors de la copie manuscrite des livres dans les
monastères, certains copistes ajoutaient ou supprimaient ce qui leur paraissait utile ou
superflu. Il était donc difficile de déterminer l'auteur original. L'Imitation du Christ de
Thomas de Kempen (1380-1471) est un document remarquable qui témoigne bien du
processus d'individualisation naissant, et ce à deux égards. La première preuve est
extérieure, donnée par les circonstances de la publication de ce livre : la version disponible
aujourd'hui a été achevée par Thomas a Kempis en 1441, soit un an après l'invention de
l'imprimerie. Mais avant cette date, il existait déjà plusieurs versions copiées à la main.
"Déjà vers 1500, les érudits étaient divisés [pour les raisons mentionnées] sur l'identité de
l'auteur de l'œuvre". La deuxième preuve du début du processus d'individualisation est le
contenu de l'ouvrage : il est consacré à l'individu et contraste ainsi "avec l'idée de
communauté soulignée à l'excès au cours des siècles médiévaux". Thomas von Kempen
anticipait l'individualisme "dès le début".
Les premiers autoportraits au nord des Alpes sont d'autres indices de l'amorce du
processus d'individualisation. Ils ont également été réalisés au 15e siècle, notamment le
premier d'une série d'autres par Albrecht Dü rer, datant de 1484. Jusqu'alors, on ne savait
pas toujours quel artiste avait créé une œuvre. Ainsi, lors d'une visite guidée de la
cathédrale de Naumburg, on entend dire à propos des célèbres statues de donateurs du
XIIIe siècle, comme celle d'Uta, qu'elles provenaient de l'atelier des maîtres de Reims, qui
avaient atteint l'apogée de leur création dans la cathédrale de Mayence et étaient les
créateurs des statues de donateurs de la cathédrale de Naumburg.
La religion a également réagi : avec la Réforme, l'individu chrétien a pris le pas sur la
communauté. Face à cette évolution sociale, la religion catholique communautaire n'était
plus forcément adaptée à notre époque. En ce sens, la Réforme était une nécessité sociale ;
on pourrait même dire que si Luther ne l'avait pas fait, un autre aurait dû le faire. Herbert
Schnä delbach appelle la subjectivisation par le protestantisme "l'éclaircissement dans le
domaine intérieur de la religion". Le contraste avec la religion communautaire catholique a
été abordé par Ludwig Feuerbach en 1830 dans ses réflexions sur la mort et l'immortalité,
lorsqu'il a constaté : Dans le protestantisme, la personne occupait une place centrale, alors
que l'É glise catholique était l'être communautaire, dans lequel l'homme n'était pas encore
livré à lui-même, mais se trouvait dans la communauté des croyants et y trouvait la plus
grande jouissance.
Pour d'autres, comme le sociologue Alois Hahn de Trèves, le processus d'individualisation a
même commencé plus tô t, avec l'introduction de la confession auriculaire par le quatrième
concile du Latran en 1215. La confession auriculaire est l'aveu individuel de culpabilité
devant Dieu. Avant son introduction, la communauté dans son ensemble confessait ses
fautes devant Dieu. Les différences temporelles dans la datation de l'individualisation ne
sont toutefois pas surprenantes, car il s'agissait d'un processus continu, qui s'est poursuivi
au fil des siècles.
Lorsque les hommes deviennent des individus, ils se détachent des règles et des
orientations d'action sû res qu'ils avaient grâ ce à leur appartenance à une classe sociale. Le
statut, le clan, la tradition familiale et la communauté religieuse, tels qu'ils existaient
encore dans l'Antiquité et au Moyen-Â ge - souvenons-nous des statuts de la polis cités par
Platon -, obligeaient les individus à s'orienter selon les règles internes de la communauté
ou du statut en question, par exemple la noblesse. Au chant 11 de l'Iliade, verset 401 et
suivants, Ulysse semble, de notre point de vue actuel, être placé devant le choix de tenir
bon dans la bataille ou de fuir. Mais en tant que membre de la noblesse, il n'avait pas le
choix, il ne pouvait que tenir bon. Aujourd'hui encore, l'expression "noblesse oblige" est
colportée et est même devenue le titre d'un film. Celui qui, à l'époque, se plaçait en dehors
de la communauté et se comportait comme un individu, était appelé "idió tes" (individu).
"Vivre en tant qu'individu (idió tes) était pratiquement impossible, difficile et
désavantageux". Cela valait encore pour les communautés et les familles chrétiennes
médiévales. Dès que les gens s'en détachent et deviennent des individus, l'insécurité de
l'orientation apparaît. Les hommes créent de nouvelles communautés plus grandes, la
société et l'É tat. Et là aussi, des incertitudes apparaissent quant à savoir si tout ce que les
hommes ont fait est juste. La nature et le droit naturel se glissent alors dans le rô le de
garants. On peut leur demander si ce qu'ils ont créé est juste. Ce n'est certainement qu'une
explication, mais plausible, de la nouvelle floraison du droit naturel à l'époque moderne.
Mais déjà chez Thomasius, et plus encore dans la conception kantienne, l'identification du
droit naturel avec la morale, qui existait encore chez Hobbes, était totalement impensable,
car chez Kant, la morale devait libérer les hommes de leur dépendance à l'égard de la
nature. L'homme peut se libérer des contraintes de la nature au moyen de la raison. Il se
donne lui-même les lois de son action sous la forme de principes et de maximes d'action
sur la base de l'impératif catégorique et ne se les laisse pas dicter par la nature. Les lois
qu'il s'est données sont alors aussi contraignantes que les lois de la nature, mais ce ne sont
pas des lois de la nature. Pour cette raison, le droit en tant que système de règles du social
ne peut pas dépendre du droit naturel, pas plus que la morale qui, chez Kant, est fondée sur
la raison.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Hegel (1770-1831) a lui aussi été contraint, en raison de l'évolution sociale, de répondre à
la question de savoir comment les individus s'associent pour former une société puis un
É tat. Il commence la description de l'évolution dans la Realphilosophie d'Iéna par l'analyse
du rapport social entre deux individus dans la société contemporaine et écrit : "Chacun est
égal à l'autre en ce qu'il s'oppose à lui. Se distinguer de l'autre, c'est donc s'assimiler à lui".
Les hommes sont égaux entre eux dans leur différence. Il existe donc entre eux une égalité
dans la différence. La différence fondamentale de deux individus, dans laquelle ils sont
égaux, est d'abord constatée par Hegel. En ce sens, la critique de Marx selon laquelle Hegel
ne part pas des individus réels dans sa philosophie du droit est erronée. Cependant, Marx
ne pouvait pas connaître la philosophie réelle hégélienne d'Iéna.
L'égalité fondamentale dans la diversité est l'état dans lequel se trouvent les hommes
depuis le début du processus d'individualisation. Cet état est la réalité que Hegel trouve et à
laquelle il se rattache. Et il y voit à juste titre l'égalité de tous les hommes entre eux, "car
chacun se connaît immédiatement dans l'autre et le mouvement n'est que le renversement
par lequel chacun apprend que l'autre se connaît également dans son autre". Hegel constate
ici que la reconnaissance mutuelle est une nécessité de toute relation interpersonnelle dans
la communauté étatique individualisée. Dans une formulation ultérieure de l'Encyclopédie
de 1830, il est dit que le fait d'être reconnu est "réciproque". La reconnaissance, qui est au
cœur de toute norme morale, existe et n'a pas besoin d'être formulée comme norme de
devoir. Pour Hegel, cette reconnaissance mutuelle et, avec elle, les règles morales et
juridiques, se fondent sur la Sittlichkeit.
Mais qu'est-ce que la Sittlichkeit pour Hegel ? Pour pouvoir le rendre compréhensible pour
nous aujourd'hui, je fais appel à l'explication de Habermas sur ce qu'est pour lui une "forme
de vie accommodante", qui rappelle une interprétation de la "moralité" hégélienne se
référant au présent. Habermas formule que les règles morales dépendent de formes de vie
accommodantes. On pourrait formuler cela en langage quotidien : Les normes morales et
juridiques doivent tomber sur un sol fertile. Chez Hegel aussi, le terrain pour les règles
morales et juridiques est simplement aplani par la Sittlichkeit. Celle-ci ne représente en
aucun cas la normativité morale ou juridique immédiate. Ce n'est que sur la base
d'évidences morales déjà existantes et bien ancrées que les normes morales et juridiques
peuvent déployer leur force. C'est en même temps la critique que fait Hegel de toute
éthique du devoir, en particulier de l'éthique kantienne, qui croit devoir imposer des
normes morales de comportement aux membres de la société : "La moralité est selon Kant
l'assujettissement de l'individu à l'universel", écrit Hegel dans son ouvrage L'esprit du
christianisme et son destin, rédigé entre 1798 et 1800.
Il existe certaines expressions de cette moralité dont parle Hegel. Il s'agit de la morale et du
droit. Ils sont issus de la moralité et forment donc une unité. Les formes concrètes du droit
sont par exemple la propriété ou le contrat. Ces exemples doivent montrer ce que Hegel
appelle l'évidence de la moralité. Hegel dit de la propriété qu'elle n'a pas besoin d'être
justifiée ou déduite, car il la considère comme existante : "Ce qui est désigné comme mien,
l'André n'a pas à le violer". On ne peut qu'approuver l'interprétation de Wolfgang Kersting
de ce passage : "La propriété d'autrui est la propriété d'un autre, il n'y a rien d'autre à dire".
Mais rien, selon Hegel, n'appartient à quelqu'un "par prise directe", il faut plutô t un contrat,
et cela signifie que "cette prise de possession directe n'a pas lieu, qu'elle n'est pas exclue en
soi, mais reconnue". Le contrat est une forme spécifique du droit et une évidence. "Le
contrat est valable en soi et pour soi", dit l'encyclopédie. C'est pourquoi, tout comme pour
la propriété, on ne peut faire de déclarations sur le contrat que sous forme tautologique :
"Ce qui est promis est promis, la propriété d'autrui est ce qui ne m'appartient pas". Afin de
préserver ces évidences pour une cohabitation sans heurts, la reconnaissance doit déjà
exister comme base des institutions juridiques telles que la propriété et le contrat : "La
reconnaissance est donc la première chose qui doit devenir". Or, selon Hegel, la
reconnaissance doit déjà être considérée comme acquise, car sinon la cohabitation dans la
communauté étatique individualisée aurait échoué depuis longtemps. C'est pourquoi Hegel
peut dire sans ambages et avec certitude : "Ê tre reconnu est une réalité immédiate". Or,
c'est la conséquence de la critique de Kant par Hegel : la reconnaissance n'a donc pas
besoin d'être posée aux hommes comme une exigence de devoir ; elle existe déjà dans une
société individualisée comme forme fondamentale de la vie commune humaine.
"Si les normes en vigueur jusqu'à présent se heurtent à un refus de reconnaissance, elles
perdent alors leur caractère discret et font face à la réalité insoumise avec une exigence
d'obéissance explicite". Pour rétablir l'état non perturbateur lors de telles violations de la
loi, il y a la punition : "La punition est la réconciliation de la loi avec elle-même", dit Hegel.
Le criminel pense avoir sa propre loi d'action individuelle et pouvoir imposer sa volonté
privée sur cette base. Une telle loi individuelle est pour le criminel le fondement de son
action. La punition permet de briser la volonté individuelle, d'abolir la loi individuelle et de
réconcilier la volonté individuelle avec la volonté générale, rétablissant ainsi l'ordre
juridique général. La loi ou le droit est réalisé dans l'É tat et dans celui-ci les institutions et
les organisations ont leur fonction dans le maintien de la volonté générale, par exemple la
police : "Chacun ne s'occupe que de lui-même et non de l'universel ; l'exercice tranquille de
son droit de propriété et la libre disposition de sa propriété est le dommage possible pour
André. [La police veille à ] la limitation de cela, à la prévention du dommage, même du fait
que l'on procède simplement par confiance".
On voit ici que Hegel a décrit l'É tat moderne dans lequel nous vivons. L'É tat moderne abrite
des individus qui doivent être maintenus ensemble d'une toute autre manière que dans les
communautés précédentes, comme le clan, la classe sociale ou la famille. Bien que
l'individualité soit préservée, il doit exister une communauté qui l'héberge et qui doit être
maintenue stable. Mais comment cela peut-il se faire ? C'est ce que nous dit Hegel dans la
note au § 150 de ses Lignes fondamentales de la philosophie du droit : "Ce que l'homme
doit faire, quels sont les devoirs qu'il doit remplir pour être vertueux, est facile à dire dans
une communauté morale, - il n'y a rien d'autre à faire par lui que ce qui est tracé, exprimé
et connu dans sa situation". Si une communauté étatique est amenée et maintenue en
harmonie de cette manière, nous avons sous les yeux notre société contemporaine.
Avec sa théorie, Hegel correspond bien mieux que d'autres théories à l'état dans lequel se
trouve la société depuis le début de l'individualisation. C'est pourquoi sa proposition de
solution, qui consiste à relier les hommes individualisés à leur communauté, est à mon avis
beaucoup plus plausible que les solutions de ses prédécesseurs. Chez Hobbes, par exemple,
l'individu cède son pouvoir et sa liberté au souverain ; dans la théorie de Locke, c'est la
société à laquelle l'individu s'identifie entièrement. Le pouvoir et la liberté ne sont pas
cédés à un seul autre homme comme chez Hobbes, mais à la société à laquelle l'individu
s'identifie. Chez Rousseau, la volonté générale, qui ne peut presque plus être comprise que
psychologiquement, garantit la liberté de l'individu. Kant parle d'une loi que l'on s'est
donnée et qui relie les individus entre eux. Parce que nous nous l'avons donnée, nous nous
identifions à elle. Nous avons donc le devoir d'agir selon cette loi. Parce que nous nous
sommes donnés la loi, nous avons du respect pour cette loi. Si nous n'agissions pas selon
elle, nous perdrions le respect de nous-mêmes. Telles sont les constructions au sein de la
philosophie jusqu'à Hegel, qui doivent continuellement conduire à un lien toujours plus
fort entre l'individu et sa communauté.
Comme nous l'avons vu, le droit et la morale forment une unité chez Hegel. Ils
s'épanouissent tous deux sur le terrain de la moralité. La question est de savoir si nous
devons qualifier la philosophie du droit de Hegel de conception de droit naturel. Il répond à
cette question au § 3 de ses Lignes fondamentales de la philosophie du droit : "Que le droit
naturel ou le droit philosophique soit différent du droit positif, inverser cela en disant qu'ils
sont opposés et contradictoires, serait un grand malentendu". Hegel part du droit étatique
existant, de ses institutions et de ses organisations, c'est-à -dire de ce qui est effectivement.
Il faut interpréter que pour Hegel, le droit est le droit positif dans lequel les principes du
droit naturel ont été intégrés - ils y survivent. C'est pourquoi il parle d'un grand
malentendu lorsqu'on veut opposer droit naturel et droit positif ou codifié.
Carl Gottlieb Svarez
Une transformation de l'idée de droit naturel a eu lieu au 18e siècle. Qu'est-ce qui avait
changé ? "A la place de systèmes doctrinaux complets qui prétendaient encore être
philosophiques et dont la tâ che était encore souvent transjuridique, à savoir la délimitation
de la doctrine naturelle des mœurs et du droit par rapport à la théologie morale, quelque
chose de nouveau est apparu. C'était la pénétration du droit naturel dans les différents
domaines du droit et donc une 'juridisation' encore plus forte du droit naturel". Cela
signifie que la justice ou la morale était considérée comme inhérente au droit ou que l'idée
de justice, et donc le point de vue moral, devait être pris en compte lors de la création du
droit. Le juriste Carl Gottlieb Svarez (1746-1798) a joué un rô le déterminant dans cette
vision. Il peut être considéré comme le véritable créateur du droit rural prussien, qu'il a
imposé malgré de nombreuses résistances, notamment celle de Frédéric-Guillaume II. Il est
entré en vigueur le 1er juin 1794. Il contient les droits naturels inaliénables de chaque
citoyen, tels que la liberté de pensée, de conscience, de mouvement et d'action, ainsi que la
possibilité d'acquérir et de transférer des biens. On y trouve également l'obligation de la
liberté de religion et la liberté de critiquer les institutions publiques et les états de droit
traditionnels. De cette manière, le droit naturel constituait la base de la législation. Svarez
considérait le droit ainsi obtenu comme un moyen de promouvoir la justice. On peut y voir
une interaction : D'une part, il y a l'influence de la pensée du droit naturel sur l'élaboration
du droit, d'autre part, le droit devait promouvoir la réalisation de la justice.
Il faut notamment mentionner ici - puisque cela nous occupera encore - l'influence du droit
naturel sur le code de procédure. En 1780, Svarez publia un projet de code de procédure
qui devait contribuer à l'élimination des procédures issues de l'Inquisition.
"Svarez, comme Carmer, voyait la cause principale de la lenteur ou de la complication de
nombreux procès dans l'habitude de laisser aux avocats le soin d'organiser le fond du litige
en se renvoyant mutuellement la charge des preuves. Pour remédier à cette situation, il
fallait introduire la maxime d'office, faire de l'avocat un auxiliaire du juge et faire du juge le
véritable fournisseur de preuves. Pour que sa tâ che ne soit pas trop lourde, le nouveau
code de procédure introduisit le devoir de vérité des parties et l'audition de témoins par le
tribunal. Enfin, dans l'intérêt des plus faibles économiquement, le système des frais a
également été réorganisé ; il s'agissait avant tout de transformer les nombreux frais
traditionnels et les avances fluctuantes en quelques taxes légales et en comptes de frais
fixes".
Rien qu'à travers ces quelques points de vue énumérés ici, on peut voir que pour Svarez, le
droit procédural devait contribuer à réaliser la justice dans le droit.
Positivisme juridique
Les positivistes juridiques voulaient en finir avec les lectures et les déterminations de
contenu extrêmement différentes que le droit naturel avait connues au cours de l'histoire.
Ils devaient y parvenir en s'abstenant de tout jugement de valeur, contrairement aux
spécialistes du droit naturel. La description du droit existant et l'évaluation du droit
devaient être strictement séparées. Le "positivisme" ne signifie pas ici une évaluation
"positive" du droit, mais plutô t ce qui suit : Les recherches des positivistes juridiques se
réfèrent à l'ordre juridique réellement existant, aux règles de droit empiriquement
constatables, aux principes juridiques et au droit des juges. "Le positivisme au XIXe siècle
désigne la conviction générale que les faits donnés, les faits positifs, sont la source de la
connaissance humaine". La "transposition de la compréhension scientifique des sciences
naturelles au droit et à la jurisprudence exclut tout recours scientifique à des normes
supra-positives, tout comme la prétention scientifique de l'étude dogmatique du droit aux
contenus historiquement toujours aléatoires, déterminés par la politique, la morale,
l'économie ou la théologie, des normes juridiques respectivement en vigueur, dans la
mesure où elle va au-delà de leur simple description. Il ne reste donc comme objets
principaux d'une analyse et d'une description strictement jurisprudentielles que la
structure formelle des règles de droit et leur lien fonctionnel".
C'est pourquoi nous allons maintenant aborder plus en détail une situation problématique
qui devrait contribuer à une meilleure compréhension de l'objet de la recherche positiviste
en droit : Dans la littérature, il est fait référence au problème algérien du positivisme
juridique démocratique. Ce terme fait référence au Front islamique du salut (FIS) algérien.
Le FIS voulait gagner les élections au Parlement algérien par des moyens légaux, non
violents et démocratiques, et ce dans le but déclaré d'abolir la démocratie en Algérie. On
peut considérer que cette décision d'abolir la démocratie après avoir gagné une élection
démocratique est illégale et illégitime. Mais pourquoi peut-on, en tant que positiviste
juridique, qualifier d'illégale la décision d'une majorité démocratiquement constituée ?
Probablement uniquement parce que l'on part du principe qu'il n'y a pas qu'une procédure
formelle que le système juridique qualifie de juste. Faut-il pour autant qu'il y ait une
référence à des normes supra-positives dans un droit issu d'une procédure démocratique ?
Doit-il y avoir une idée de justice fondée sur le droit naturel ? En tant que positiviste du
droit, il n'est pas nécessaire de chercher "plus profondément" une idée de justice pour
trouver un critère d'évaluation permettant de considérer l'action du FIS comme illégitime.
Le critère est toujours la procédure correcte. Si cette procédure est invalidée par la FIS, sa
démarche est à la fois illégitime et illégale. Les règles de procédure sont la référence. Nous
verrons plus loin en détail que le strict respect des règles de procédure est, pour les
positivistes du droit, la réalisation de la justice dans le droit.
Si l'on veut une description un tant soit peu pertinente et concise, il faut dire que pour le
positiviste juridique, le droit est "posé à un moment quelconque et modifiable à tout
moment". C'est pourquoi le positivisme est "la victoire durable du provisoire", mais en ce
qui concerne la modifiabilité, elle a des limites inhérentes à la matière : Le "manque de
clarté du droit lui-même [assure] la sécurité. Certes, dans un ordre juridique positivé, tout
le droit peut être modifié au moyen d'une simple décision, mais jamais tout à la fois".
"La théorie du droit positif est le positivisme juridique. Historiquement, il s'agit d'un
phénomène tardif. Il n'a pu voir le jour que lorsque les débats sur la question de la validité
sont devenus superflus : Le positivisme signifie présupposer la validité. Sous le règne du
droit naturel, cela n'était pas possible. Lorsque la positivation du droit a commencé,
l'autorité de Dieu, de la nature et d'autres mythes originels et initiaux était déjà tellement
affaiblie que les substances philosophiques ou religieuses n'étaient plus disponibles comme
objectif de recours pour les justifications de validité. Toute influence directement
religieuse, éthique, métaphysique, politique ou idéologique sur la validité du droit aurait
réduit à néant dès le départ sa volonté de faire de l'exercice de la liberté l'affaire de
l'individu, et devait donc être supprimée".
Cette préoccupation a toutefois existé ensuite, en particulier depuis le début du processus
d'individualisation décrit au milieu du XVe siècle.
Venons-en maintenant à l'évolution historique du positivisme juridique : John Austin
(1790-1859), généralement considéré comme le fondateur du positivisme juridique - faites
attention à ses dates de vie -, partait du principe, dans sa théorie de l'impératif, que toute
règle de droit était un ordre. "Cette conception est manifestement liée à l'horizon
d'expérience juridique de la monarchie préconstitutionnelle, et elle fournit difficilement
une image adéquate du droit moderne". Encore marqué par cette expérience, Austin
estimait que l'ensemble des ordres provenait du souverain et que cet ensemble devait être
saisi dans sa structure et dans son contexte. Cette théorie simple d'Austin ne pouvait plus
s'appliquer à la période post-absolutiste. Le système juridique moderne est plus complexe
et donc plus difficile à saisir. H. L. A. Hart (1907-1992) a directement critiqué Austin et a
montré que le droit doit être traité différemment dans sa justification et dans son mode de
reconnaissance qu'à l'époque de l'absolutisme. Et Hans Kelsen (1881-1973) a "contribué à
comprendre le droit positif comme un ordre uniforme de normes sociales et pas seulement
comme un ensemble de rapports de force et de règles de comportement donnés dans les
faits".
Hans Kelsen
Bien avant Hans Kelsen, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) s'est également consacré
au présent droit, tel qu'il est et non tel qu'il devrait être selon une idée de justice. Savigny a
mis le droit en ordre et, contrairement à Austin, a défendu la position selon laquelle le droit
n'était pas un ordre du souverain, mais provenait de l'esprit du peuple. Il s'est en outre
démarqué des conceptions métaphysiques des professeurs de droit naturel. C'était
également le souhait de Hans Kelsen, car selon lui, le droit naturel s'est toujours mis au
service d'intérêts idéologiques. Selon lui, les docteurs conservateurs du droit naturel
s'attachaient à la transfiguration de l'ordre juridique existant. Ils ont voulu montrer que "le
droit positif n'est que l'émanation d'un ordre naturel, divin ou raisonnable, c'est-à -dire
absolument juste et équitable, alors que la doctrine révolutionnaire du droit naturel
poursuit l'intention inverse : Remettre en question la validité du droit positif en affirmant
sa contradiction avec un ordre absolu présupposé d'une manière ou d'une autre".
Que veut donc Kelsen avec sa doctrine du droit pur, par opposition à la doctrine du droit
naturel ? "En soulevant le droit du brouillard métaphysique dans lequel la doctrine du droit
naturel enveloppe ce droit comme quelque chose de sacré par son origine ou son idée, la
Doctrine pure du droit veut le comprendre de manière tout à fait réaliste comme une
technique sociale spécifique". C'est cette technique sociale - et elle seule - qui doit être
analysée. Il ne s'agit pas de se demander quelle idée de droit naturel ou métaphysique se
cache derrière elle, mais d'effectuer une analyse objective, et plus précisément du droit en
général et non d'un droit particulier dans un ordre social ou un É tat donné. Kelsen montre
dans sa Théorie pure du droit comment une telle analyse doit être effectuée et comment on
peut montrer qu'un nouveau droit est créé, et comment on peut arriver à la raison ultime
de la validité du droit.
"Si l'on demande, par exemple, pourquoi un certain acte de contrainte, le fait, par exemple,
qu'un homme prive un autre de sa liberté en l'enfermant dans une prison, est un acte
juridique et appartient donc à un certain ordre juridique, la réponse est la suivante : parce
que cet acte a été prescrit par une certaine norme individuelle, une décision judiciaire. Si
l'on demande ensuite pourquoi cette norme individuelle est valable, et ce en tant
qu'élément d'un ordre juridique bien précis, on obtient la réponse suivante : parce qu'elle a
été fixée conformément au code pénal. Et si l'on s'interroge sur la raison de la validité du
code pénal, on tombe sur la constitution de l'É tat, selon les dispositions de laquelle le code
pénal a été élaboré par l'organe compétent à cet effet, selon une procédure prescrite par la
constitution. Mais si l'on s'interroge sur la raison d'être de la constitution sur laquelle
reposent toutes les lois et les actes juridiques adoptés en vertu des lois, on tombe peut-être
sur une constitution encore plus ancienne, et donc finalement sur une première
constitution historique, édictée par un usurpateur isolé ou par un collège constitué d'une
manière ou d'une autre. Que ce que l'organe constituant historiquement premier a exprimé
comme sa volonté doive être considéré comme une norme, c'est la condition fondamentale
d'où découle toute connaissance de l'ordre juridique fondé sur cette constitution".
Cette norme fondamentale pourrait avoir été édictée par un usurpateur, et dans ce cas
Kelsen ne serait pas si éloigné de la théorie de l'impératif d'Austin. Selon Kelsen, la manière
dont la norme fondamentale a été créée nous échappe toutefois. Kelsen part simplement du
principe qu'il doit exister une telle norme fondamentale.
La procédure d'affirmation de l'existence de la norme fondamentale est comparable à celle
de Kant, car la vérification de l'existence d'une norme fondamentale se fait chez Kelsen
selon la même figure que celle utilisée dans la Critique de la raison pure de Kant. Kant y
argumente de la manière suivante : "Et ainsi l'unité synthétique de l'aperception est le
point le plus élevé auquel on doit attacher tout usage de l'entendement, même toute la
logique, et, après elle, la philosophie transcendantale". S'il n'y avait pas ce point, il n'y
aurait pas de catégories, pas d'entendement, pas de pensée, en fin de compte pas de
connaissance. Mais puisqu'il y a connaissance, il doit y avoir aussi la synthèse
transcendantale de l'aperception. L'argumentation de Kelsen se déroule en conséquence :
puisqu'il y a des peines privatives de liberté, la décision du juge, la loi et la constitution, il
doit aussi y avoir une norme fondamentale, car sans elle, l'ordre juridique n'existerait pas.
La norme fondamentale ne fait pas partie des normes positives elles-mêmes. "Comme elle
n'est pas produite dans la procédure juridique, elle ne vaut pas comme norme juridique
positive, elle n'est pas posée, mais - en tant que condition de toute création de droit, de
toute procédure juridique positive - elle est présupposée". C'est pourquoi, en tant que
scientifique, il faut s'abstenir de toute autre discussion sur la norme fondamentale. Elle ne
serait qu'une "hypothèse épistémologique", tout comme nous la trouvons chez Kant.
Selon Kelsen, le juriste part dans son travail d'une norme de devoir donnée. "Un Sollen ne
peut être fondé que par un autre Sollen, une norme ne peut être fondée que par une autre
norme. Mais si l'on ne dispose pas d'une norme de droit positif supérieure, il faut alors aller
au-delà du droit positif. C'est ainsi que l'on parvient à la norme fondamentale. La doctrine
du droit pur partage avec le droit naturel l'hypothèse selon laquelle le droit positif doit
nécessairement se référer à une base normative supra-positive. Sur le plan du contenu, la
norme fondamentale de Kelsen se distingue toutefois profondément de la norme
fondamentale du droit naturel. Le droit naturel veut soumettre le droit positif à des normes
morales contraignantes. La doctrine juridique pure ne poursuit pas de telles ambitions".
Examiner de plus près la norme fondamentale et la soumettre à des spéculations n'est pas
dans l'esprit des préoccupations de Kelsen en matière de droit positif. Kelsen est d'avis,
comme Kant, que la connaissance scientifique a des limites qui ne doivent pas être
dépassées si cette connaissance veut satisfaire à l'exigence de l'attribut "scientifique" et
s'abstenir en même temps de toute spéculation débordante.
Kelsen résume ainsi son objectif : Seul le droit positif peut être connu, et c'est l'objet de la
théorie pure du droit. "Elle veut présenter le droit tel qu'il est, sans le légitimer comme
juste ou le disqualifier comme injuste ; elle s'interroge sur le droit réel et possible, et non
sur le droit juste. Elle se refuse à évaluer le droit positif. En tant que science, elle ne se
considère tenue à rien d'autre qu'à comprendre le droit positif dans son essence et à
travers une analyse de sa structure. C'est précisément par sa tendance anti-idéologique que
la doctrine pure du droit se révèle être une véritable science du droit". Kelsen s'oppose
expressément à l'insinuation selon laquelle le droit juste et bon au sens moral ne lui
importe pas, mais "cette exigence va de soi". Cette admission de Kelsen contredit ce que
Norbert Hoerster dit du positivisme juridique, à savoir que le positivisme juridique analyse
les normes juridiques, indépendamment du fait "qu'elles satisfassent ou non à certaines
exigences morales ou à certains idéaux de justice". Dworkin se trompe également dans son
hypothèse selon laquelle le positivisme juridique ne s'intéresse pas au droit juste. Il faut
répondre à Dworkin et Hoerster en leur demandant ce qui pourrait motiver les parties à
aller au tribunal, si ce n'est la conviction que le procès permettra d'établir la justice. La
justice est l'idée constitutive de l'aboutissement d'un procès, comme nous l'avons expliqué
au début en reprenant une idée de Habermas.
Herbert Lionel Adolphus Hart et Niklas Luhmann
Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) est un autre positiviste juridique non moins
important. Selon Hart, les normes juridiques ne sont acceptées comme règles obligatoires
que si le législateur "s'en tient à des règles fondamentales généralement reconnues qui
indiquent la procédure nécessaire à l'élaboration du droit. Ces règles fondamentales
généralement reconnues, qui définissent en détail ce que le corps législatif doit faire pour
créer des lois, ne sont pas des ordres suivis de manière habituelle, et ne peuvent pas non
plus être qualifiées d'habitudes d'obéissance à l'égard de certaines personnes. Elles
constituent la base d'un système juridique". Il s'agit ici des règles de procédure lors de la
génération de lois. Ces règles ne sont pas développées par Hart. Niklas Luhmann a en
revanche présenté une monographie intitulée Legitimation durch Verfahren, à laquelle je
me réfère ci-après.
Si le droit ne peut plus se référer à une vérité naturelle préexistante ou à un ordre du
souverain fondé sur la grâ ce de Dieu, comme le faisait encore John Austin, il a besoin d'une
autre base de légitimation pour être reconnu. Le titre de l'ouvrage de Luhmann indique
déjà quelle est cette base dans la démocratie, et Hart l'a également mentionnée : C'est la
procédure. Les procédures sont des systèmes sociaux d'un type particulier. Il s'agit tout
d'abord de la procédure judiciaire et ensuite de la procédure législative.
La fonction de la procédure judiciaire est d'aboutir à une décision contraignante qui est
acceptée non seulement par les parties, mais aussi par les tiers. Toutefois, seules les
décisions fondées sur des règles de droit obtenues dans le cadre d'une procédure
démocratique et juridique sont acceptées. Le droit et la démocratie se conditionnent
mutuellement. Les normes juridiques constituent, comme nous l'avons dit, les règles du jeu
social. La démocratie exige des règles du jeu démocratiques. Cela ne vaut pas seulement
pour les décisions de justice, mais aussi pour les procédures législatives. Contrairement aux
procédures judiciaires, elles ont un horizon ouvert. Les lois qui ne font pas leurs preuves
peuvent être modifiées et adaptées aux besoins sociaux, par exemple les lois régissant le
travail à temps partiel en fin de carrière. Les lois peuvent être adoptées à titre temporaire,
comme les lois fiscales relatives à la perception de l'impô t de solidarité pour les cinq
Lä nder de l'Allemagne de l'Est. "Mais on n'a jamais entendu dire qu'une décision de justice
ait été rendue à titre temporaire ou à titre expérimental, dans le but d'en vérifier
ultérieurement l'exactitude. Dans le cas d'une condamnation pénale avec sursis, c'est le
condamné qui doit faire ses preuves, pas le jugement".
Voilà pour la légalité. Passons maintenant à la question de la légitimité. "Comment est-il
possible, lorsque seul un petit nombre décide, de diffuser la conviction factuelle de la
justesse ou de la force contraignante de cette décision ?" Cela se fait en substituant à la
justification par le droit naturel l'égalité des chances d'obtenir des décisions satisfaisantes.
Ainsi, les procédures peuvent trouver un type général de reconnaissance "indépendant de
la valeur de satisfaction de la décision individuelle, et cette reconnaissance entraîne
l'acceptation et le respect des décisions contraignantes".
De cette manière, il est possible d'approuver les principes formels d'une procédure
juridique, mais de rejeter le contenu de la décision dans un cas concret. Les deux doivent
être strictement séparés. C'est souvent difficile pour les parties concernées, car "toutes les
décisions litigieuses laissent en moyenne 50 % de déçus avec une volonté d'apprendre
typiquement faible". Car "les deux parties qui se présentent devant le juge se sentent dans
leur droit". Contre les personnes peu disposées à apprendre, les décisions sont imposées
par des procédures de contrainte légalisées par l'É tat et régies par la loi. C'est la première
caractéristique du droit, mentionnée au début, qui le distingue de la morale. Il n'existe pas
de procédure de contrainte externe pour le respect des règles morales. L'utilisation isolée
de la contrainte dans le droit reviendrait toutefois à instaurer un régime de terreur. C'est
pourquoi s'y ajoutent des procédures régies par le droit, légalisées démocratiquement,
structurées de telle sorte qu'elles soient reconnues par tous et aptes à faire appliquer des
décisions contraignantes.
Les points mentionnés par Luhmann permettent de répondre à la question de savoir ce que
Hart entend par "droit". Chez lui, le droit est la combinaison de règles primaires et
secondaires. Les règles primaires sont des règles qui obligent les personnes d'un groupe
social à faire ou à ne pas faire quelque chose. S'y ajoutent ce que Hart appelle les règles
secondaires, c'est-à -dire les règles d'habilitation ou de pouvoir, les règles de
reconnaissance et les règles de procédure qui confèrent le pouvoir d'édicter, d'abroger ou
de modifier les règles du premier type. Les règles primaires sont celles qui régissent le jeu
social et dans lesquelles sont contenues les attentes mutuelles et les espérances. On attend
des autres ce que l'on attend de soi-même et ce que les autres attendent de nous. Ce sont
les règles du jeu social. Le droit définit et sanctionne la normalité sociale. Si l'on voyait les
choses autrement, ce serait comme si les règles d'un match de football n'étaient que des
instructions données à l'arbitre et que c'était là leur véritable sens - et non le fait de laisser
le jeu se dérouler selon les règles. Le droit n'est donc pas seulement un logiciel pour
l'appareil judiciaire.
Karl Marx
On peut classer Karl Marx (1818-1883) dans le positivisme juridique dans la mesure où il
critique le droit existant au moyen de son analyse du capitalisme. Selon lui, tout se passe
correctement à la surface de la circulation : Le capitaliste ou le propriétaire de l'argent doit
trouver "le travailleur libre sur le marché des marchandises, libre dans le double sens qu'il
dispose en tant que personne libre de sa force de travail comme de sa marchandise, que
d'autre part il n'a pas d'autres marchandises à vendre, qu'il est détaché et célibataire, libre
de toutes les choses nécessaires à la réalisation de sa force de travail". Ce que le capitaliste
fait de la marchandise achetée ne concerne plus le travailleur, car l'utilisation de la force de
travail n'est pas plus l'objet de la circulation que la consommation d'une bouteille de vin. Ici
aussi, le vendeur ne s'intéresse qu'au fait qu'il a reçu l'équivalent légitime, c'est-à -dire le
prix d'achat de la bouteille de vin, mais pas à ce que l'acheteur fait ensuite avec la bouteille
de vin, par exemple s'il la boit seul ou à deux, s'il la donne ou la revend. Lorsque le
capitaliste a acheté la force de travail à sa valeur marchande, il quitte avec elle la sphère de
l'échange, ferme la porte de l'usine derrière lui et consomme la force de travail comme
valeur d'usage pendant un certain temps. Le fait qu'il en tire ensuite plus que ce qu'il a payé
pour elle se fait selon la loi capitaliste de création de plus-value.
Au niveau de l'échange d'équivalents, tout se déroule en toute légalité. L'exploitation, c'est-
à -dire l'injustice, ne se trouve que sous la surface de l'échange, dans la production. Pour
Marx, cela devint particulièrement évident dans les premières phases du capitalisme avec
les conditions inhumaines de la production industrielle, décrites par Friedrich Engels en
1845 dans son ouvrage sur La situation de la classe ouvrière en Angleterre : "L'esclavage
dans lequel la bourgeoisie tient le prolétariat enchaîné n'apparaît nulle part plus
clairement au grand jour que dans le système des usines. C'est là que s'arrête, en droit et en
fait, toute liberté". Selon les mots d'Engels, la liberté de l'ouvrier décrite par Marx pour le
processus de circulation prend donc fin derrière la porte de la fabrique ; là , le droit qui
s'appliquait encore au niveau de la circulation n'est plus valable, c'est plutô t un état de non-
droit qui règne. Dans la production, les travailleurs risquaient toujours de perdre la vie ou
la santé.
Le droit, qui se situe dans la sphère de la circulation, veille à l'achat et à la vente équitables
de la marchandise force de travail, à l'échange d'équivalents. Il n'y a ici aucune trace
d'injustice. Le travailleur qui vend sa force de travail ne peut pas se plaindre, car le prix
qu'il reçoit est juste. Le droit devrait pouvoir s'étendre de la sphère de la circulation ou de
l'échange à la production, afin que là aussi, la justice puisse être établie. Les premiers pas
dans cette direction ont été faits par la législation sur les usines qui a débuté en 1833 avec
la limitation de la journée de travail des enfants, que Marx a qualifiée de première "réaction
consciente et planifiée de la société sur la forme naturelle de son processus de production".
Plus tard, le juriste socialiste autrichien Anton Menger (1841-1906) a également souligné
dans son livre Das Bü rgerliches Recht und die besitzlose Volksklassen (Le droit civil et les
classes populaires sans propriété) de 1890 que le droit devait intervenir dans le processus
de production. Le philosophe du droit soviétique Petr I. Stučka (1865-1932) y a même
reconnu plus tard le rô le révolutionnaire du droit. En revanche, le deuxième grand
philosophe soviétique du droit, Eugen Paschukanis (1891-1937), a parlé de la nécessité de
surmonter l'échange d'équivalents afin que l'opposition entre les intérêts individuels et
sociaux disparaisse, et avec elle le contrat de travail libre, sur la base duquel le prolétaire
n'a que la possibilité de "mourir de faim sans être dérangé". Contrairement aux deux autres
philosophes socialistes du droit, Paschukanis aspire à la suppression du droit et donc à
l'établissement d'une société communiste sans classes.
Les réflexions d'Anton Menger auraient eu une influence sur le Code civil entré en vigueur
en 1900. Son article 618 stipule que les locaux de travail doivent être aménagés de manière
à protéger les personnes des risques pour leur vie et leur santé. Si l'employeur ne respecte
pas ces obligations, il doit s'attendre à des sanctions en vertu du paragraphe 3 de l'article
618 du Code civil allemand. Entre-temps, il existe des lois détaillées sur la protection du
travail, en Allemagne la loi sur la mise en œuvre de mesures de protection du travail visant
à améliorer la sécurité et la protection de la santé des employés au travail du 7 aoû t 1996
et les divers décrets y afférents. Ce n'est qu'en raison d'une telle pénétration du droit dans
la sphère de production à travers la sphère de circulation que la justice peut être établie au
sens de Marx. C'est alors seulement que l'on peut parler d'un droit juste selon Marx.
Aperçu synthétique des fondements sociaux des idées de droit à l'époque moderne
Tant l'émergence de la théorie positiviste du droit que celle du droit naturel ont été
historiquement dépendantes des conditions sociales. Ainsi, l'épanouissement des idées de
droit naturel au début de l'époque moderne correspond à une toute autre et nouvelle
conception de l'É tat. Jusqu'alors, la communauté était pour les hommes un ordre donné et
établi par Dieu. Mais lorsque, depuis la Renaissance, les hommes se sont considérés comme
libres et indépendants et que la fonction d'intégration sociale de la religion s'estompait, les
ordres féodaux et absolutistes ne pouvaient plus être maintenus. De grandes idées
appelaient au renouveau et il fallait trouver une orientation pour la nouvelle voie. Les
hommes devaient désormais fonder eux-mêmes la légitimité et la légalité de l'ordre
étatique, puisqu'il n'était plus attribué à Dieu, mais aux citoyens. Il était évident de penser,
comme Hobbes, à une théorie du contrat : les citoyens, libres par nature, s'associent et
consolident cette association par un contrat conclu volontairement. Comme, en ces temps
de bouleversements, on n'était pas sû r d'avoir trouvé le bon ordre, on interrogeait la nature
et on s'en inspirait. De grandes idées de droit naturel, notamment les idées de liberté,
d'égalité, de justice et de propriété, ont pu se frayer un chemin dans les codifications, par
exemple dans le Landrecht prussien. Les hommes se sont inspirés de ces grandes idées, ont
lutté pour leur réalisation et ont fait leur droit eux-mêmes.
Au fil du temps, l'É tat démocratique mis en place par les hommes et indépendant des
autres pouvoirs a été considéré comme allant de soi. De même, le droit a été considéré
comme valable parce qu'il avait été établi par des hommes par le biais de la législation
qu'ils avaient conçue. C'est ainsi qu'est née la théorie du positivisme juridique. Les
positivistes juridiques ne s'occupaient plus que de ce droit codifié. Toutes les références à
l'ordre naturel, qui devaient apporter une sécurité, n'étaient plus d'actualité. Selon
Luhmann, c'est la raison pour laquelle "l'unité européenne de la nature et de la morale" a
été rompue.
La présentation suivante des différentes estimations de la nature du droit national-
socialiste permet d'approfondir la distinction entre positivisme juridique et droit naturel.
Le national-socialisme
Avant de présenter le droit codifié et la jurisprudence sous le national-socialisme, nous
nous intéresserons aux réactions souvent impuissantes après 1945 face à ce qui s'est passé
sous le national-socialisme. En tout premier lieu, il convient de citer Gustav Radbruch et ses
critiques.
Gustav Radbruch
Gustav Radbruch (1878-1949), l'un des philosophes du droit les plus influents du XXe
siècle et ministre de la justice du Reich sous la République de Weimar, écrivit en 1946,
après avoir fait l'expérience du droit national-socialiste, dans son essai intitulé Gesetzliches
Unrecht und ü bergesetzliches Recht, ce qui suit : "Le positivisme a en effet, avec sa
conviction que "la loi est la loi", rendu la profession juridique allemande sans défense
contre les lois au contenu arbitraire et criminel". Cette conviction, qui devait servir la
sécurité juridique, n'a pu avoir son effet malheureux que parce que "le positivisme
juridique présente, notamment en Allemagne, une affinité spécifique avec la pensée de
l'É tat autoritaire". Il s'agissait là d'une attaque frontale contre le positivisme juridique - et
d'une erreur d'appréciation, comme nous le verrons plus tard, car "croire en un juge qui
aurait appliqué les lois raciales de Nuremberg uniquement par contrainte et le cœur lourd,
parce qu'il voyait ses convictions morales rebondir sur un concept juridique sans valeur,
est assez aberrant au vu de la liberté d'interprétation de la magistrature nationale-
socialiste. Mais croire qu'un tel juge aurait agi tout à fait différemment, dans la mesure où
seule sa conscience, lourde de valeurs, aurait été juridiquement anoblie par le concept
juridique basé sur des valeurs, est encore bien plus aberrant".
Il faut cependant voir qu'avant 1945, Radbruch lui-même professait le positivisme
juridique. Le passage suivant de sa philosophie du droit de 1932 en témoigne : "Mais quelle
que soit l'injustice du droit dans son contenu, il s'est avéré qu'il remplit toujours un but, ne
serait-ce que par son existence, celui de la sécurité juridique. Le juge, en se mettant au
service de la loi sans tenir compte de sa justice, ne se met donc pas au service d'objectifs
arbitraires purement fortuits. Même si, parce que la loi le veut ainsi, il cesse d'être le
serviteur de la justice, il reste encore le serviteur de la sécurité juridique. Nous méprisons
le pasteur qui prêche contre sa conviction, mais nous vénérons le juge qui ne se laisse pas
ébranler dans son respect de la loi par son sentiment juridique réticent ; car le dogme n'a
de valeur qu'en tant qu'expression de la foi, mais la loi n'a pas seulement sa valeur en tant
que reflet de la justice, mais aussi en tant que garantie de la sécurité juridique, et c'est
avant tout en tant que telle qu'elle est remise entre les mains du juge. Un homme juste a
plus de valeur qu'un homme simplement juridique, simplement respectueux de la loi, mais
nous n'avons pas l'habitude de parler de juges "juridiques", mais seulement de "juges
justes", car un juge juridique est déjà , par là même et par là seulement, un juge juste. Mais
face au juge qui est lié par sa conscience à considérer comme valable tout droit établi, peut
se dresser un accusé que sa conscience lie à considérer comme non valable un droit injuste
ou inopportun, bien qu'il soit établi".
Radbruch professe ici le positivisme juridique. Néanmoins, il considère la justice "comme la
deuxième grande tâ che du droit". Il ne perd pas de vue le conflit persistant entre la sécurité
juridique et la justice ; après l'expérience du national-socialisme, il propose, dans l'article
que je viens de citer, la solution controversée et très discutée suivante, qui a été très
influente sur le plan de la pratique juridique et qui, d'après ce que je vois, l'est toujours :
"Le conflit entre la justice et la sécurité juridique devrait être résolu en ce sens que le droit
positif, garanti par les statuts et le pouvoir, a la priorité même si son contenu est injuste et
inapproprié, à moins que la contradiction de la loi positive avec la justice n'atteigne un
degré si insupportable que la loi, en tant que "droit incorrect", doive céder à la justice. Car
on ne peut pas définir le droit, y compris le droit positif, autrement que comme un ordre et
des statuts qui, par leur sens, sont destinés à servir la justice. Mesurées à cette aune, des
parties entières du droit national-socialiste ne sont jamais parvenues à la dignité du droit
en vigueur".
Radbruch a été critiqué pour avoir exacerbé le conflit de la manière décrite. Selon Helmut
Schelsky, ce conflit n'a pu naître que parce que Radbruch a tenté, dans une optique de
philosophie de la conscience, de tout subsumer sous une idée, faisant ainsi de la sécurité
juridique une composante d'une idée qui serait dérivée de quelque chose de plus
fondamental encore, comme la nature ou la raison. Schelsky diagnostique ainsi
l'orientation de Radbbruch vers le mode de pensée du droit naturel. En ce qui concerne la
sécurité juridique, il faut être d'accord avec Schelsky dans sa critique de Radbruch, il ne
s'agit pas d'un fondement dans la pensée du droit naturel, mais d'abord, de manière très
pratique, du fait que les personnes concernées par la jurisprudence ne doivent pas être
traitées de manière arbitraire, c'est-à -dire qu'il doit y avoir la certitude que le droit
s'applique à chacun de la même manière. Mais ne faut-il pas constater que l'idée de sécurité
juridique s'enracine dans la justice et qu'il est juste que la sécurité juridique soit garantie ?
Je pense que la sécurité juridique est enracinée dans la justice. Je reviendrai sur ce point de
vue à la fin de la discussion sur l'importance du droit procédural.
A mon avis, tout comme pour le problème algérien décrit plus haut, un examen tout à fait
formel aurait toutefois suffi pour répondre à la question de savoir si le droit sous le
national-socialisme a été élaboré dans le cadre d'une procédure correcte et s'il s'agissait
donc bien de droit. "Pour que le droit entre en vigueur, certaines conditions doivent être
remplies lors de sa production, des majorités doivent être obtenues, des lectures doivent
avoir lieu, des auditions doivent être menées. Seule la forme crée le contenu". Un contrô le
aussi simple aurait libéré Radbruch de son conflit, car la base d'un système juridique est -
comme Hart l'avait déjà constaté - la procédure correcte d'élaboration des lois. Or, chez les
nationaux-socialistes, ce n'est pas la procédure correcte qui était à la base de l'élaboration
des lois, mais la volonté du Fü hrer. L'arbitraire est exclu et la sécurité juridique est assurée
lorsqu'il est garanti que le droit est établi par une procédure légale et qu'il est appliqué de
la même manière dans tous les cas. Il n'est alors pas nécessaire de démontrer que la
sécurité juridique découle d'une idée de droit naturel. En fait, les nationaux-socialistes
défendaient une idée de droit naturel dont le contenu était l'idéologie nazie, comme nous le
verrons plus tard.
H. L. A. Hart montre d'une part une grande compréhension pour les motivations de
Radbruch, saturées d'expérience, mais affirme que l'on n'aurait pas dû appliquer la formule
radbruchienne dans la jurisprudence afin de pouvoir punir les crimes de l'époque nazie. Il
aurait fallu être honnête et modifier le droit a posteriori, même si cela aurait été en
contradiction avec le principe juridique ancestral de non-rétroactivité, inscrit au § 1 du
code pénal allemand. "Car si nous nous rallions au point de vue de Radbbruch et si nous
habillons, avec lui et les tribunaux allemands, notre protestation contre des lois
condamnables en affirmant que certaines normes ne peuvent pas être le droit en raison de
leur caractère moralement insoutenable, nous introduisons la confusion dans l'une des
formes les plus fortes, parce que les plus simples, de la critique morale". Cette confusion
prophétisée par Hart consisterait à dire : Ces normes juridiques sont moralement
défendables, mais pas celles-ci. On ouvre ainsi la porte à l'arbitraire.
Hart cite maintenant un cas concret que Radbruch avait également sous les yeux lors de sa
réflexion : en 1944, une femme a dénoncé son mari dont elle voulait "se débarrasser".
Comme il avait fait des remarques désobligeantes sur Hitler lors d'une permission au front,
elle le dénonça. L'homme a été condamné à mort, mais n'a pas été exécuté, il a été envoyé
au front en liberté conditionnelle. Die Frau wurde 1949 wegen Freiheitsberaubung in
mittelbarer Tä terschaft verurteilt, obwohl ihr Mann von einem Gericht aufgrund damals
bestehender Gesetze und damit geltender Rechtsvorschriften verurteilt worden war. Das
OLG Bamberg erklä rte in seiner Urteilsbegrü ndung, dass diese Gesetze »gegen das
Billigkeitsund Gerechtigkeitsempfinden aller anstä ndig Denkenden« verstießen. Das
Gericht bediente sich folglich der radbruchschen Formel. Fü r Hart hingegen gab es in
diesem Fall zum einen die Mö glichkeit, die Frau straflos ausgehen zu lassen, somit den
1944 geltenden Bestimmungen Genü ge zu tun, demnach der Rechtssicherheit Vorrang
einzurä umen und damit Moralprinzipien zu opfern. Zum anderen kö nnte man die Frau
aufgrund unverhü llt rü ckwirkender Gesetze verurteilen und damit den Moralprinzipien
Rechnung tragen; dieses tä te man in vollem Bewusstsein dessen, dass man die
Rechtssicherheit opfert. »So abstoßend eine rü ckwirkende Strafgesetzgebung und
Bestrafung auch sein mag, sie in diesem Falle offen durchgefü hrt zu haben, hä tte
wenigstens den Vorzug der Redlichkeit gehabt. Es hä tte deutlich gemacht, daß man bei der
Bestrafung der Frau zwischen zwei Ü beln zu wä hlen hatte: dem, sie unbestraft zu lassen,
und dem, ein wertvolles moralisches Prinzip preiszugeben, das die meisten Rechtssysteme
gutheißen. Wenn wir aus der Geschichte der Moral etwas gelernt haben, dann doch dieses,
daß man moralische Probleme nicht kaschieren sollte.« Dem ist nichts hinzuzufü gen, außer
dass die Rechtssicherheit auch ein moralischer Wert ist. Das Verfahrensrecht, das
Rechtssicherheit garantieren soll, wird an spä terer Stelle noch Thema sein; im Ü brigen
unter Bezugnahme auf Hart.
Legalitä t des nationalsozialistischen Rechts
Bei den Nü rnberger Kriegsverbrecherprozessen stellte sich ebenfalls die Frage des
Rü ckwirkungsverbots. Es wurde vorgebracht, dass zur Zeit der Taten
nationalsozialistisches Recht galt. Um ü berhaupt eine Gesetzesgrundlage fü r die Anklage
gegen die NS-Verbrecher zu haben, legte man das Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20.
Dezember 1945 zugrunde. Im Artikel 2 heißt es: »Jeder der folgenden Tatbestä nde stellt
ein Verbrechen dar: c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gewalttaten und Vergehen,
einschließlich der folgenden den obigen Tatbestand jedoch nicht erschö pfenden Beispiele:
Mord, Ausrottung, Versklavung; Zwangsverschleppung, Freiheitsberaubung, Folterung,
Vergewaltigung oder andere an der Zivilbevö lkerung begangene unmenschliche
Handlungen; Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiö sen Grü nden, ohne
Rü cksicht darauf, ob sie das nationale Recht des Landes, in welchem die Handlung
begangen worden ist, verletzen.«
Im Urteil wird auf diese Rechtsgrundlage Bezug genommen. Dort heißt es: Der »Gerichtshof
hat das Recht, Personen abzuurteilen und zu bestrafen, die durch ihre im Interesse der
europä ischen Achsenlä nder ausgefü hrten Handlungen, sei es als Einzelperson, sei es als
Mitglieder von Organisationen, eines der folgenden Verbrechen begangen haben.« Dann
folgt die Aufzä hlung aus dem Kontrollratsgesetz Nr. 10.
Das alles waren natü rlich Hilfskonstruktionen. Um in Zukunft fü r solche Verbrechen eine
Rechtsgrundlage zu haben, erfolgte die Menschenrechtsdeklaration vom 10. Dezember
1948.
Kehren wir zu dem Fall zurü ck, den das OLG Bamberg zu entscheiden hatte. Da hä tte sich
der andere große Rechtspositivist des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen, fü r die erste von Hart
aufgewiesene Mö glichkeit entschieden, denn fü r ihn galt Folgendes: »Vom Standpunkt der
Rechtswissenschaft ist das Recht unter der Naziherrschaft ein Recht. Wir kö nnen es
bedauern, aber wir kö nnen nicht leugnen, daß das Recht war.« Kelsen meinte, dass das
Recht bei den Nationalsozialisten unter den Bedingungen des rechtlichen Verfahrens
zustande gekommen sei: auf der Verfassung basierend, im parlamentarischen Verfahren
des Gesetzgebers. Das zur Rechtssetzung erforderliche Verfahren haben die
Nationalsozialisten allerdings abgeschafft. Das hat zum ersten Mal Franz Neumann in
seiner klassischen Analyse des nationalsozialistischen Staates gezeigt, in der er zu dem
Ergebnis kam, dass das Recht im NS-Regime nur noch »ein technisches Mittel zur
Durchsetzung bestimmter Ziele« gewesen sei. Das Recht war nur noch Mittel zur
Durchsetzung des Fü hrerwillens. »Wenn Recht und der Wille des Fü hrers identisch sind,
wenn der Fü hrer selbst ohne jedes Justizverfahren politische Gegner tö ten lassen kann und
diese Tat als hö chste Verwirklichung des Rechts gefeiert wird, dann allerdings kann man
von einem spezifischen Charakter als Recht nicht mehr sprechen.« Darum kö nnen die
Gesetze und die darauf basierenden Gerichtsentscheidungen wä hrend der NS-Diktatur
nicht als Recht ausgezeichnet werden. Die parlamentarischen Abstimmungen ü ber
Gesetzesvorhaben und die Gerichtsprozesse waren damals reine Scheinveranstaltungen.
Doch den Schein aufrechtzuerhalten, gehö rte zur Strategie der Machterhaltung. Das ist der
Tribut des Verbrechens an die Tugend: Weil die Menschen glaubten, dass sie in einem
Rechtsstaat leben, sollte dieser Schein aufrechterhalten werden, und so hielt man weiterhin
die Rechtsstaatsidee hoch. Auch das diente letztlich natü rlich nur der Machterhaltung.
»Schließlich nennen sich auch die Sondergerichte von modernen Polizeistaaten Gerichte
und fingieren oft genug einen ›due process of law‹14, indem sie ihm Hohn sprechen, als
Farce eines rechtsstaatlichen Verfahrens.«
Bereits der zum Nachdenken anregende Titel eines weiteren Klassikers einer Analyse des
NS-Regimes, Der Doppelstaat von Ernst Fraenkel aus dem Jahre 1941, zeigt das an. Nach
Fraenkel gab es bei den Nationalsozialisten zwei Systeme: die offizielle Fassade des
Rechtsstaates und dahinter ein Willkü rsystem. Auch Herlinde Pauer-Studer hat Fraenkels
Buch fü r ihre Analyse zurate gezogen. Sie kommt zu folgendem Ergebnis: »Existierende
legale Strukturen verwandelten sich in Instrumente, um illegale Formen von Macht zu
etablieren. Manipulation und Propaganda wurden benutzt, um die Brutalitä t von
Maßnahmen wie die Errichtung von Konzentrationslagern und die Eliminierung von
jü dischen Bü rgern aus offiziellen Positionen und dem ö ffentlichen Leben zu verschleiern.
Das Regime versuchte entschieden, einen Anschein von Legalitä t aufrechtzuerhalten.« Und
dieser Schein von Legalitä t war es, dem Kelsen erlegen war. Doch er hä tte schon frü h
erkennen kö nnen, dass der NS-Staat ein Doppelstaat war. Ein erstes augenfä lliges Beispiel
fü r das sich hinter der Fassade des Rechtsstaates Abspielende war das Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das bereits vom 7. April 1933 datierte. Es
enthielt den sogenannten Arierparagrafen, der Juden weitgehend aus dem Beamtenstand
ausschloss, was rein rechtlich unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ü berhaupt
nicht zu vertreten war. Das war pure Ideologie, in Rechtsform gekleidet. Das
»fundamentale Prinzip des Rechtsstaates, die Gleichheit vor dem Gesetz, ist nicht mehr
anerkannt«. So sieht es auch Ronald Dworkin: »Der Regierung der Nazis fehlte jede
Legitimitä t, und es gab keine anderen strukturierenden Prinzipien der Fairneß, die fü r eine
Durchsetzung ihrer Erlasse gesprochen hä tten. Es ist daher moralisch gesehen
zutreffender, zu bestreiten, daß es sich bei diesen Verordnungen um Recht gehandelt hat.
Die mit ihrer Durchsetzung beauftragten deutschen Richter sahen sich allein mit einem
prudentiellen und nicht mit einem moralischen Dilemma konfrontiert.« Hä tten die Richter
nicht im Sinne der Nationalsozialisten geurteilt, hä tten sie sich selbst gefä hrdet. Darum sei
es fü r sie ein Gebot der Klugheit gewesen, ihnen willfä hrig zu sein.
Das Naturrecht der Nationalsozialisten in der Selbsteinschä tzung nationalsozialistischer
Juristen
Die unterschiedlichen Reaktionen auf den Status nationalsozialistischen Rechts deuten auf
eine große Unsicherheit bei den Interpreten hin. Bei einer Analyse des
nationalsozialistischen Rechts mit dem grö ßeren zeitlichen Abstand von heute lä sst sich
auch das Verhä ltnis von Recht und Moral genauer herausarbeiten.
Wenn wir uns zunä chst die Selbsteinschä tzung der nationalsozialistischen Juristen
ansehen, werden wir feststellen, dass es keineswegs der Positivismus war, der es mö glich
machte, dass Juristen im Sinne der Nationalsozialisten agierten. Die nationalsozialistische
Rechtsauffassung war nach dem eigenen Selbstverstä ndnis damaliger Juristen
naturrechtlich begrü ndet. Allerdings muss man sagen, dass der Begriff des Naturrechts von
den Nazis in verbrecherischer Weise missbraucht wurde. Der nationalsozialistische
Rechtstheoretiker Hans-Helmut Dietze schrieb in seiner Habilitationsschrift von 1936, dass
der Nationalsozialist Naturrechtler sei. Dann heißt es weiter: »Nicht nur im
zwischenstaatlichen Denken wird der Nationalsozialismus vom Naturrecht beherrscht,
sondern auch im Begreifen des vö lkischen Rechtslebens. Somit ›gehö rt naturrechtliches
Denken … zu den Grundlagen der nationalsozialistischen rechtlichen Weltanschauung‹.›Der
Nationalsozialist ist Naturrechtler, weil das deutsche Volk eine natü rliche lebensgesetzlich
verbundene Gemeinschaft ist.‹« Auf den folgenden Seiten fü hrt Dietze fast alle
nationalsozialistischen Grö ßen mit Zitaten als Zeugen fü r das naturrechtlich basierte
nationalsozialistische Recht auf, darunter Hitler, Rosenberg, Frank, Goebbels, Gö ring, Ley
und auch Rechtswissenschaftler wie Karl Larenz. Auch hier zeigt sich die gä nzliche
Fehleinschä tzung von Radbruch. Nachdem die dem Naturrecht zustimmenden Nazigrö ßen
aufgefü hrt worden sind, ist bei Dietze von der »Absage an den Positivismus« die Rede. Die
Begrü ndung dafü r ist folgende: »Weil Gemeinschaft Verbindung aus Wesenswillen ist und
weil sich Wesenswille als die Fü lle menschlichen Wesens darstellt, ist jede Gemeinschaft
von vielgestaltiger Art und vielfä ltigem Leben. So auch ihr natü rliches Recht. Jedes positive
Gesetz bedeutet demgegenü ber eine Erstarrung, weil eine Festlegung konkreter
Entscheidungen und zugleich eine Vorentscheidung kü nftiger Fä lle.« Nun stellt Dietze die
Verbindung von positivem Recht und Naturrecht her: »Das positive findet im natü rlichen
Recht seine unverrü ckbare Grundlage. Es stellt sich lediglich als Positivierung der
natü rlichen Rechtsordnung einer Gemeinschaft dar.« Das Naturrecht bildet die Klammer
um Recht und Sittlichkeit: »Da das Naturrecht der Gemeinschaft durch den Wesenswillen
bestimmt wird, bildet es die Einheit von Recht und Sittlichkeit.« Der Einzelne kann in
einem Recht, das so auf Gemeinschaft ausgerichtet ist, keine Rolle spielen: »Die Frage nach
subjektiven Rechten im Dritten Reich ist schon falsch gestellt: es ist nicht so, als besitze der
Einzelne ›von Natur‹ bestimmte Grundund Freiheitsrechte; sondern der Einzelne ist von
Natur auf die Gemeinschaft angewiesen.« Nun stellt Dietze abschließend noch die Frage,
welchen Inhalt das Naturrecht der Nationalsozialisten hat. Die Antwort lautet: »Es [das
Naturrecht] wurzelt in den naturhaften Krä ften, aus denen alles wirkliche Leben der Natur
kommt: im Drä ngen des Blutes, in den Sä ften des Bodens und in der Innigkeit gleicher
Gesinnung.«
Dem Grundsatz nach in dieselbe Richtung geht das Selbstverstä ndnis eines der fü hrenden
Rechtsphilosophen in dieser Zeit, der nach dem Krieg noch eine maßgebliche Rolle in der
Rechtswissenschaft gespielt hat: Karl Larenz. Fü r ihn galt nicht jedwede, sondern eine
bestimmte Art des Naturrechts als Basis fü r das positive Recht: »Recht ist nach deutscher
Auffassung nicht eine Sache willkü rlichen Beliebens, auch nicht nur der ä ußeren
Zweckmä ßigkeit und Nü tzlichkeit, sondern eine mit dem sittlichen und religiö sen Leben
der Gemeinschaft eng verbundene Lebensordnung, die den Einzelnen mit eigenem
Geltungsanspruch gegenü bertritt und sie innerlich bindet. Damit ist die Meinung des
Naturrechts der Aufklä rungszeit unverträ glich, daß das Recht um der Interessen der
einzelnen Menschen willen da sei und durch sie, die Einzelnen, im Wege eines willkü rlichen
Aktes, eines Vertrages geschaffen werde. Denn mit dieser Begrü ndung auf den Einzelwillen
fä llt die unableitbare Wü rde des Rechts, seine Autoritä t, dahin und der Inhalt des Rechts
wird durch sie der willkü rlichen Festsetzung und damit den Erwä gungen des individuellen
Nutzens anheimgegeben.« Das hat nach Larenz folgende Konsequenz: »Die Beziehung des
Rechts auf die Gemeinschaft bedeutet endlich, daß der Inhalt eines bestimmten positiven
Rechts dem betreffenden Volksgeist, dem sittlichen Bewußtsein, den Sitten des Volkes
gemä ß sein muß.«
Es hat den Anschein, dass Recht und Moral bei den Nationalsozialisten eine Einheit bilden.
Das ist aber nicht der Fall, denn das, was die Nazis als Sittlichkeit ausgaben – der Begriff
fä llt bei Dietze und Larenz –, ist nicht Moral, sondern Ideologie, auf die im ü bernä chsten
Abschnitt eingegangen wird. Zunä chst aber zur Rechtsprechung in der NS-Zeit, um auch
einen Blick auf die Rechtspraxis zu werfen – und man wird sehen, dass die
nationalsozialistische Rechtsprechung das Programm ihrer Rechtstheoretiker punktgenau
erfü llte.
Nationalsozialistische Rechtsprechung
Den Verschleierungsversuchen der Nationalsozialisten, die ihre Ideologie mit
demokratischen, rechtlichen und moralischen Begriffen tarnten, sind, wie gezeigt, selbst
ehrbare Rechtsphilosophen wie Hans Kelsen aufgesessen. Hier nun ein konkreter Fall aus
dem Jahre 1938, an dem exemplarisch demonstriert werden kann, wie von den Nazis der
»Anschein von Legalitä t« mit vordergrü ndiger juristischer Argumentationslogik
aufrechterhalten werden konnte. Das nennt Herlinde Pauer-Studer treffend »distortions of
normativity«, also Verformung oder Verbiegung des Rechts. Gesetztes Recht wird mithilfe
von ideologischem Naturrecht unterlaufen. Es ging in einem Zivilprozess aus dem Jahre
1938 um die Kü ndigung einer Mieterin, die dagegen den Kü ndigungsschutz in Anspruch
nahm. In diesem Prozess kam ein Gesetz zur Anwendung, das aus dem Jahre 1923 stammte,
also nicht von den Nazis erlassen worden war, aber zur NS-Zeit noch in Kraft war. Es
handelt sich um das Mieterschutzgesetz. Danach kann der Vermieter nur dann kü ndigen,
wenn sich der Mieter einer erheblichen Belä stigung des Vermieters schuldig gemacht hat.
Die Belä stigung bestand nach Auffassung des Vermieters darin, dass die Mieterin Jü din
war. Doch wieso konnte diese Tatsache eine Belä stigung des Vermieters darstellen? Das
deutet der Richter so: Zunä chst heißt es im Leitsatz des Urteils: »Der deutsche Vermieter
hat der deutschen Volksgemeinschaft gegenü ber die Pflicht, die Bildung der
Hausgemeinschaft und ihre Erhaltung zu sichern.« Die Bestimmung des § 2 MietSchG »soll
die Ruhe, den Frieden und die Ordnung im Hause sichern und will den Vermieter
berechtigen, Mieter, die in unerträ glicher Weise die Ruhe und Ordnung stö ren, aus dem
Hause zu entfernen. § 2 MietSchG dient damit dem Schutz zur Erhaltung der
Hausgemeinschaft.« Nach der Bestimmung des Gesetzes kann der Vermieter kü ndigen,
wenn er belä stigt wird. Der Richter allerdings sieht nicht den Vermieter, sondern die
Hausgemeinschaft als belä stigt an. Damit identifiziert er kurzerhand Vermieter und
Hausgemeinschaft, um ein willfä hriges Urteil sprechen zu kö nnen.
Nun muss der Richter noch klä ren, ob die Mieterin etwas getan hat, denn der § 2 MietSchG
spricht ausdrü cklich von einem Verhalten, mit dem der Vermieter belä stigt wird, sodass
ihm die Fortsetzung des Mietverhä ltnisses nicht zugemutet werden kann. Darum
argumentiert der Richter im nä chsten Schritt folgendermaßen: »Es ist dabei bedeutungslos,
ob diese Tatsachen in einem Tun, Unterlassen oder in der persö nlichen Eigenschaft des
Mieters bestehen.« Eine persö nliche Eigenschaft stellt also nach Auffassung des Richters
ein Verhalten dar. Auf diese Weise wird das Recht verformt oder verbogen.
Nun der dritte Argumentationsschritt: Die Mieterin mü sste sich einer Belä stigung schuldig
gemacht haben. Sie trifft keine Schuld daran, dass sie Jü din ist. Darum argumentiert der
Richter so: »Die Tatsache, daß der Mieter Jude ist, ist von ihm nicht im eigentlichen Sinne
verschuldet. Im Sinne des § 2 Mieterschutzgesetz trifft ihn jedoch ein Verschulden. Er ist
nicht nur ein Fremdkö rper innerhalb der Gemeinschaft der deutschen Hausbewohner, ihm
fehlt auch darü ber hinaus die notwendige innere Einstellung zu einer Gemeinschaft mit
Deutschen.«
Zu guter Letzt hä tte noch eine Fristenbestimmung der Entscheidung des Gerichts
entgegenstehen kö nnen, der Aufhebung des Mietverhä ltnisses stattzugeben, denn nach § 2,
Abs. 3 MietSchG hä tte der Vermieter binnen sechs Monaten nach Kenntnisnahme des
Aufhebungsgrundes Klage erheben mü ssen. Der Vermieter wusste aber von Beginn des
Mietverhä ltnisses an, dass die Mieterin Jü din war. Diese Klippe wird nun argumentativ
geschickt folgendermaßen umschifft: »Der Grund fü r die Aufhebung ist bei der Beklagten
die Eigenschaft der Beklagten als Jü din und die Unmö glichkeit, mit ihr eine
Hausgemeinschaft zu bilden. Es handelt sich dabei um einen Dauerzustand, so daß die Frist
des § 2 Abs. 3 MietSchG nicht in Lauf treten kann.« Ein Dauerzustand unterliegt
logischerweise keiner Fristenbestimmung. So kommt unter dem Deckmantel juristischer
Argumentation ein willfä hriges Urteil zustande. – Wie schon gesagt, waren die
Gerichtsprozesse der Nationalsozialisten reine Scheinveranstaltungen. Aber den Schein
eines rechtsstaatlichen Verfahrens aufrechtzuerhalten, gehö rte im NS-Regime zur Strategie
der Machterhaltung.
Was an dieser Rechtsprechungspraxis, reprä sentiert durch ein zivilrechtliches Urteil,
auffä llt, ist ihre Ü bereinstimmung mit der Rechtstheorie jener Zeit. Fü r Dietze und Larenz
wird die Gemeinschaft als Zentrum naturrechtlich begrü ndet. In der Rechtsprechung wird
die Gemeinschaft, sei es die Hausgemeinschaft oder die Gemeinschaft der Deutschen, dem
Richterspruch zugrunde gelegt. Die Gemeinschaft steht gegen den Einzelnen und somit
gegen das subjektive Recht der Aufklä rungszeit, wie Larenz betont. Die Gemeinschaft saugt
den Einzelnen auf. Damit ist auch klar, dass gegen die subjektiven Interessen entschieden
werden muss, wenn sich eine Einzelne aufgrund ihrer Eigenschaft, Jü din zu sein, selbst aus
der Gemeinschaft ausschließt.
Ideologie
Mit juristischer Argumentationsweise wurde in dieser Mietrechtsentscheidung von 1938
die Ideologie der Nazis verschleiert, sodass noch heute Rechtsphilosophen auf diesen
Schein hereinfallen und behaupten, das Nazirecht wä re Recht. Nun muss noch geklä rt
werden, was Ideologie ist und was sie von der Moral unterscheidet.
Unter »Moral« verstehen wir das Ensemble von Regeln, die angesichts der Verletzbarkeit
der Menschen diejenigen schü tzen sollen, die vom Handeln anderer betroffen sind. Wichtig
in Abgrenzung zur Ideologie ist dabei, dass kein Mensch von der moralischen Gemeinschaft
ausgeschlossen ist, dass also jeder einen Anspruch auf diesen Schutz hat. Das ist bei
Ideologien anders. Speziell die NS-Ideologie schloss Juden aus der Gemeinschaft aus, wie an
dem Urteil von 1938 zu sehen war: Einem Juden fehle »die notwendige innere Einstellung
zu einer Gemeinschaft mit Deutschen«, hieß es darin. Darum wurde er von dieser
Gemeinschaft ausgeschlossen bzw. schloss sich nach Ansicht der Nationalsozialisten selbst
aus.
Die allgemeinen Merkmale einer jeden Ideologie sind die folgenden:
(1)Sie geht davon aus, dass die Welt ursprü nglich in Ordnung war.
(2)Die Gegenwart ist einem solchen Denken zufolge dekadent geworden. Das kann
entweder begrü ndet werden oder es wird als evident angenommen. Die Schuld fü r die
behauptete Dekadenz trugen nach Ansicht der Nationalsozialisten die Juden.
(3)Das auf Ideologie basierende politische Handeln will den ursprü nglichen Zustand
wiederherstellen oder zu einer besseren Welt fü hren. Fü r die Nationalsozialisten bestand
diese in einem biologisch sauberen Deutschland.
Diese drei Merkmale sind generell die einer jeden Ideologie. Ideologie ist demnach immer
Heilsversprechen, Eschatologie.
Mittels der Ideologie wird die Moral vollstä ndig ausgeschaltet. Das wollte Hitler. Er wollte
mit der jü disch-christlichen Tradition, in der das Morden und Quä len von Menschen
moralisch und rechtlich geä chtet wird, brechen. Die Juden, die diese moralische Tradition
vor mehr als zweieinhalb Jahrtausenden begrü ndet hatten, sollten selbst verschwinden.
Noch radikaler kann man die Moral nicht auslö schen. Das Recht auf Tö tung und Folterung
sollte wiederhergestellt werden. Hitler wollte, wie Hannah Arendt es ausdrü ckte, »die
Negation der Moral als solcher«, die »Umkehrung der Zehn Gebote«, und nicht den nur
punktuellen Verstoß gegen moralische Regeln etablieren und als erlaubt rechtfertigen.
(Arendt 2006, 13, 16) Und diese ideologische Umkehrung ist den Nationalsozialisten
partiell gelungen. Ideologie ist vor allem dann wirkungsvoll, wenn man sie mit einer
Moralfassade verkleidet. Das machten die Nazis mit ihren »pervertierte[n] Vorstellungen
von Ethos, Pflicht, Ehre, Loyalitä t, Tapferkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ein Beispiel ist
der Ehrenkodex, der innerhalb der SS existierte.« In der bekannten Posener Rede vom 4.
Oktober 1943 bezeichnete Himmler diejenigen SS-Mä nner als »moralisch anstä ndig«, die
angesichts der von ihnen produzierten Leichen nicht schwach geworden waren, die sich
keinen »Humanitä tsduseleien« hingaben. Diese Rede gipfelte in dem ideologischen Satz:
»Wir hatten das moralische Recht, wir hatten die Pflicht gegenü ber unserem Volk, dieses
Volk [gemeint sind die Juden], das uns umbringen wollte, umzubringen.«
Wie erreicht man eine solche Einstellung? Nimmt man die Welt mit ideologischen Klischees
wahr und ä ußert sich mithilfe solcher Floskeln, verstellt sich einem der Blick auf die
Realitä t. Darin kann man die Funktion jeder Ideologie erblicken. Sie »emanzipiert sich also
von der Wirklichkeit, so wie sie uns in unseren fü nf Sinnen gegeben ist, und besteht ihr
gegenü ber auf einer ›eigentlicheren‹ Realitä t, die sich hinter diesem Gegebenen verberge,
es aus dem Verborgenen beherrsche und die wahrzunehmen wir einen sechsten Sinn
benö tigen. Den sechsten Sinn vermittelt eben die Ideologie.« (Arendt 1986, 964) Das kann
man an einem Zitat aus dem Sassen-Interview mit Eichmann gut nachvollziehen. Darin
hä ufen sich die Floskeln. Eichmann spricht davon, dass er ein fanatischer Kä mpfer fü r die
Freiheit seines Blutes sei, dass fü r ihn heiliger Befehl sei, was seinem Volke nü tze, dass er
sich der Vorsehung unterzuordnen habe. Das ist reine NS-Ideologie, die zu einer vö llig
anderen Realitä tswahrnehmung fü hrt. Sie hat nach Arendt die Funktion, sich »gegen die
Wirklichkeit abzuschirmen« (Arendt 1978, 14). Auch dass Eichmann es sich als Niederlage
anrechnet, die »Endlö sung« mit 10,3 Millionen ermordeten Juden nicht komplett realisiert
zu haben, ist pure Ideologie, die zu einer gestö rten Realitä tswahrnehmung fü hrt.
Festzuhalten ist, dass eine Ideologie die Moral vollstä ndig ersetzen kann, insbesondere in
ihrem Verhä ltnis zum Recht. Ja, ein gä nzlich ideologisiertes Naturrecht vermag dem Recht
eine Basis zu geben, die bis in die Einzelentscheidungen hinein mit seinem
Gemeinschaftsbegriff durchschlä gt. Die enge Bindung von ideologischem Naturrecht mit
Rechtssetzung und Rechtsprechung war in der NS-Zeit Realitä t. Nationalsozialistisches
Recht wurde demnach keineswegs durch den Rechtspositivismus mö glich, wie Radbruch
und andere, ihm folgende Rechtsphilosophen unmittelbar nach dem Ende der
Naziherrschaft noch angenommen hatten.
Zusammenfassender Ü berblick zum Rechtspositivismus und Naturrecht
Bei den antiken Philosophen war die Bezugnahme auf das Naturrecht nicht immer klar und
eindeutig. Eindeutig aber ist, dass Sokrates, Platon und Aristoteles die Identitä t von Recht
und Moral postulierten. In Sophokles’ Antigone wird der Konflikt zwischen Naturrecht und
positivem Recht offen ausgetragen, wohingegen nach Aristoteles’ Ansicht beide
nebeneinander bestehen kö nnen. Die Probleme, die im Verhä ltnis von Moral und Recht
entstehen, werden bei Aristoteles durch die Einfü hrung des Billigkeitsgedankens gelö st.
Der Begriff »Billigkeit« verweist auf die Fä higkeit des Richters, angesichts abstrakter
positiver Gesetze im Einzelfall, der jedes Mal anders liegt, angemessen zu urteilen. Dazu
bedarf es einer moralischen Fä higkeit, der personalen praktischen Urteilskraft. Hugo
Grotius und Ernst Bloch sind reine Naturrechtler. Bei ihnen finden wir die zwei hier
vorgestellten Ausprä gungen des Verhä ltnisses von Naturrecht zum positiven Recht. Bei
dem einen ist das Naturrecht die Basis des positiven Rechts, aber auch Korrektiv, bei dem
anderen hat das Naturrecht allein korrigierende Funktion gegenü ber dem positiven Recht.
Mit dem Individualisierungsprozess ä ndert sich die Aufgabenstellung fü r die
Rechtsphilosophen gä nzlich. Jetzt muss die Frage beantwortet werden, wie denn die
vereinzelten Individuen zum staatlichen Zusammenleben finden und wie diese
Gemeinschaft Bestand haben kann. Hegels genialer Gedanke ist, dass die Antwort in der
wechselseitigen Anerkennung der Einzelnen liegt, die gleich in ihrer Verschiedenheit sind.
Nur auf der Basis schon bestehender eingelebter Selbstverstä ndlichkeiten der Sittlichkeit
kö nnen moralische und rechtliche Normen ihre Kraft entfalten. Recht und Moral sind
verschiedene Hervorbringungen der bereits bestehenden Sittlichkeit; sie bilden aber
insofern eine Identitä t, als sie gleichermaßen aus der Sittlichkeit entspringen. »Was der
Mensch tun mü sse, ist in einem sittlichen Gemeinwesen leicht zu sagen, – es ist nichts
anderes von ihm zu tun, als was ihm in seinen Verhä ltnissen vorgezeichnet, ausgesprochen
und bekannt ist.« Damit ist Sittlichkeit zugleich definiert. Hegel ist im Ü brigen der
Auffassung, dass die Unterscheidung von Naturrecht und positivem Recht ein
Missverstä ndnis sei.
Mit Carl Gottlieb Svarez ä ndert sich die Funktion des Naturrechts. Dessen Prinzipien sollen
in das kodifizierte Recht eingehen. Bemerkenswert ist das Gewicht, das Svarez auf die
Prozessordnung legt. Diese spielt eine nicht zu unterschä tzende Rolle in einer
individualisierten Gesellschaft, um alle Menschen gleichzustellen und damit fü r die
Manifestierung von Gerechtigkeit und Moral im heutigen Recht zu sorgen, worauf noch
zurü ckzukommen sein wird.
Die so unterschiedlichen Ausprä gungen des Naturrechts bedeuten eine Unsicherheit in der
Einschä tzung dessen, was rechtlich richtig ist. Darum wollen sich die Rechtspositivisten
ausschließlich dem kodifizierten Recht, den empirisch feststellbaren Rechtssä tzen,
Rechtsgrundsä tzen und dem Richterrecht widmen. Mit dem bestehenden Recht
beschä ftigte sich auch Karl Marx, der gemeinhin nicht als Rechtspositivist in Erscheinung
trat. Er stellte fest, dass das Recht auf der Zirkulationsebene angesiedelt ist. Dort ist es
gerecht. Es mü sse aber in die Produktionssphä re durchgreifen, damit auch dort gerechte
Bedingungen hergestellt werden kö nnen und damit man von gerechtem Recht sprechen
kann.
Das nationalsozialistische Recht ist ideologisiertes Naturrecht. Es wurzelt nach Aussage des
nationalsozialistischen Rechtstheoretikers Hans-Helmut Dietze »in den naturhaften
Krä ften, aus denen alles wirkliche Leben der Natur kommt: im Drä ngen des Blutes, in den
Sä ften des Bodens und in der Innigkeit gleicher Gesinnung«. Im Mittelpunkt dieses
ideologischen Naturrechts steht die Gemeinschaft. Auffallend ist, wie sehr die
Rechtsprechung der damaligen Zeit mit der Rechtstheorie ü bereinstimmt und ihre
Vorgaben umsetzt. Dabei wird zwar vordergrü ndig juristisch argumentiert, doch die
Grundlage des Urteils ist die Gemeinschaft, die Kern des ideologischen Naturrechts ist; sei
es nun die Hausgemeinschaft oder die Gemeinschaft der Deutschen, aus denen man
aufgrund seiner Eigenschaft, jü dischen Glaubens zu sein, ausgeschlossen ist. In der Tat sind
darum die Rechtsprechung und die Rechtsetzung nichts anderes als die Realisierung des
Fü hrerwillens. Nicht der Rechtspositivismus ermö glichte NS-Recht, sondern ideologisches
Naturrecht, das gesetztes Recht unterlä uft.
3. Das Verhä ltnis von Recht und Moral in der Gegenwart
Im Zentrum der Rechtsphilosophie von Ronald Dworkin (1931–2013) steht das Verhä ltnis
von Recht und Moral. Ausgangspunkt war ein Erlebnis, das er in seinem Buch Justice in
Robes wiedergibt und das Habermas folgendermaßen beschreibt und interpretiert: »›Zu
seiner Zeit als Richter am Supreme Court nahm Holmes auf seinem Weg zum Gerichtshof
den jungen Learned Hand‹ – der spä ter Dworkins Lehrer wurde – ›in seinem Wagen mit.
Hand stieg, an seinem Fahrtziel angelangt, aus, winkte und rief munter hinter dem
weiterfahrenden Auto her: ‚Sorgen Sie fü r Gerechtigkeit, Richter Holmes.’ Holmes ließ den
Fahrer den Wagen stoppen und zum ü berraschten Hand zurü ckkehren, um sich mit den
Worten aus dem Fenster zu lehnen: ‚That’s not my job.’ Anschließend kehrte der Wagen
wieder um und befö rderte Holmes zu seiner Arbeit, die angeblich nicht darin bestand, fü r
Gerechtigkeit zu sorgen.‹ Dworkin will mit dieser Geschichte eine Frage veranschaulichen,
die ihn ein Leben lang beschä ftigt: Welchen Einfluß dü rfen, ja sollen und mü ssen die
moralischen Ü berzeugungen eines Richters auf dessen Rechtsprechung haben?«
Nach Richter Holmes sind Recht und Moral zwei verschiedene Universen, die keinen
Einfluss aufeinander haben. Zu prü fen ist, ob man diese Auffassung in der gegenwä rtigen
Rechtspraxis und in der heutigen Rechtsphilosophie so wiederfinden kann.
Es wü rde gegen geltendes Verfassungsrecht verstoßen, bei rechtlichen Entscheidungen die
Unterscheidung zwischen Recht und Moral nicht zu beachten, denn nach Artikel 20, Absatz
3 des Grundgesetzes ist »die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden« – und nicht
an moralische Normen. Außerdem hat nach Artikel 101 des Grundgesetzes jeder das Recht
auf seinen gesetzlichen Richter. Und dieser ist kein Experte in Moralfragen, sondern
geschult in Rechtsfragen. »Das Recht hatte sich restlos den Hä nden staatlich geprü fter
Experten anvertraut, die ü ber die nö tige Qualifikation verfü gten. Schon Institutionen,
Habitus und Betriebswissen verengen die Kontingenzrä ume des positiven Rechts
erheblich, etwa durch den Initiationsritus der beiden Staatsexamina, die Konditionierung
des Referendariats, ü ber Richterfortbildung, Richterbefö rderung, Instanzenweg,
Kollegialgerichte, Gerichtsö ffentlichkeit oder Begrü ndungszwang.«
Die gesetzliche Verengung von Spielrä umen, moralische Gesichtspunkte bei gerichtlichen
Entscheidungen ins Spiel zu bringen, fü hrt in der Rechtsprechung zu folgender
Konsequenz: »Der Betreiber eines Kraftwerks, das die Umwelt verschmutzt, mag dafü r eine
einwandfreie Genehmigung haben. Er handelt rechtmä ßig, aber unmoralisch. Wenn sich
umgekehrt Atomwaffengegner vor Raketenstellungen auf die Straße setzen, so verstö ßt ihr
Protest gegen das Recht, hat aber die Moral auf seiner Seite.« Insofern kann ein Richter die
Handlung eines Angeklagten unter dem moralischen Gesichtspunkt billigen und ihn
dennoch rechtlich korrekt verurteilen.
Ungeachtet dessen besteht das Recht fü r viele Rechtsphilosophen nicht ohne Verbindung
zur Moral, wie noch zu sehen sein wird. Der kategorische Rechtsimperativ Kants
verpflichtet in der bekannten Formulierung das Recht auf die Moral: »Das Recht ist der
Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkü r des einen mit der Willkü r des andern
nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann.« Das
allgemeine Gesetz der Freiheit ist bei Kant der kategorische Imperativ, ein moralisches
Prinzip also, das fü r ihn den rechtlichen Regulierungen zugrunde liegen soll.
Die Rechtspraxis
Bevor die Theorien bedeutender Rechtsphilosophen der Gegenwart vorgestellt werden,
soll hier kurz auf die Rechtspraxis eingegangen werden, um zu zeigen, wie das Verhä ltnis
von Recht und Gerechtigkeit dort gehandhabt wird. Das Recht ist ein Hybridsystem, es ist
einerseits akademische und andererseits angewandte Wissenschaft, die aus
Rechtsprechung und Rechtsanwendung besteht. Darum ist es notwendig, sich neben der
Rechtsphilosophie auch die Rechtspraxis anzusehen.
Es kommt bei gerichtlichen Entscheidungen immer wieder zu Konflikten zwischen Recht
und Moral. Der Frankfurter Polizeivizeprä sident Wolfgang Daschner hatte den Kommissar
Ortwin Ennigkeit angewiesen, dem Angeklagten Magnus Gä fgen als letztes Mittel
kö rperliche Zwangsmaßnahmen, also Folter, anzudrohen, um den Aufenthaltsort des
Entfü hrungsopfers in Erfahrung zu bringen. Daschner wollte dadurch das Leben des von
Gä fgen entfü hrten Kindes, Jakob von Metzler, retten. Er konnte nicht wissen, dass der Junge
zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebte. Daschner berief sich bei seiner Verteidigung
auf den schuldausschließenden ü bergesetzlichen Notstand, weil zwei Rechtsgü ter
kollidierten. Von den Richtern wurde der ü bergesetzliche Notstand nicht anerkannt. Sie
argumentierten, dass es mildere Mittel als die Folterandrohung gegeben hä tte, um das
Leben des entfü hrten Kindes zu retten, zum Beispiel die Konfrontation des Tä ters mit der
Schwester des Opfers, die zum Kreis von Gä fgens Bekannten gehö rte. Die Richter mussten
Daschner verurteilen, ließen sich bei der Strafzumessung aber von moralischen
Gesichtspunkten leiten und bewerteten deshalb die Absicht Daschners, das Kind zu retten,
als einen Umstand, der fü r den Beschuldigten spricht. Darum urteilten die Richter mit
einem Strafmaß an der untersten Grenze und verwarnten Daschner mit Strafvorbehalt
nach § 59 StGB mit einer Bewä hrungszeit von einem Jahr. Aufgrund des Fristablaufs der
Bewä hrungszeit wurde der Strafvorbehalt gegenstandslos und damit dann die Strafe nach
dem Gesetz ü ber das Bundeszentralregister erlassen. – Deutlich wird also, dass Richter mit
der rein rechtlichen Bewertung nicht zufrieden sind, sondern durchaus moralische
Gesichtspunkte bei der Strafzumessung zum Tragen bringen.
Es kommt bei gerichtlichen Entscheidungen immer wieder zu Konflikten zwischen Recht
und Moral. In einer Entscheidung des Oldenburger Landgerichts wurde eine
Blockadeaktion von Greenpeace gegen das Dü nnsä ure-Verklappungsschiff »Kronos Titan«
Ende Mai 1988 als moralisch geboten, doch widerrechtlich gekennzeichnet, denn – so der
Richter Gerhard Gä rtner in der mü ndlichen Verhandlung – es sei fü r den Bü rger nicht zu
fassen, dass weiterhin Gift und Mü ll in die Nordsee gekippt und die Umwelt auf diese Weise
belastet wü rde. »Aus rechtlicher Sicht ist es fü r einen Richter zwingend, das Gesetz zu
beachten, selbst wenn er es fü r falsch hä lt.«
Die Rechtsphilosophie
Ronald Dworkin
Fü r Ronald Dworkin war die Geschichte von Richter Holmes so beeindruckend, dass fü r ihn
das Verhä ltnis von Recht und Moral bis zu seinem Lebensende ein zentrales Thema seiner
Rechtsphilosophie war. Dworkin geht in einer frü heren Phase der Entwicklung seiner
Theorie davon aus, dass in rechtlichen Entscheidungen moralische Prinzipien
Berü cksichtigung finden. Eines dieser Prinzipien, das er anfü hrt und das im Urteil des
Court of Appeals of New York 1889 im Fall Riggs gegen Palmer zum Zuge gekommen ist,
lautet: Niemand darf aus seinem eigenen Vergehen einen Nutzen ziehen. In dem genannten
Fall hatte ein Mann Angst um sein Erbe, als sein Großvater eine junge Frau heiratete.
Darum brachte er seinen Großvater um. Wegen des genannten, aus dem Gewohnheitsrecht
stammenden Prinzips wurde dem Mö rder dann die Erbschaft abgesprochen. »Der
Ursprung dieser Prinzipien als Rechtsprinzipien«, schreibt Dworkin, »liegt nicht in einer
bestimmten Entscheidung einer gesetzgebenden Kö rperschaft oder eines Gerichts, sondern
in einem Sinn fü r Angemessenheit. Der fortdauernde Einfluß der Prinzipien hä ngt davon
ab, daß dieser Sinn fü r Angemessenheit aufrechterhalten wird.« Die direkte Anwendung
des Rechts geschieht nach Rechtsregeln, richterliche Entscheidungen kommen aufgrund
von Prinzipien zustande, die zu angemessenen und damit gerechten Entscheidungen
fü hren. Angemessenheit, gedacht als Ergebnis praktischen Urteilens, war schon bei
Aristoteles fü r die Mö glichkeit gerechter Entscheidungen unverzichtbar. Er sprach, wie
oben erwä hnt, am Ende des 14. Kapitels vom fü nften Buch der Nikomachischen Ethik von
der Angemessenheit oder Billigkeit (epieikeia), die eine Art Gerechtigkeit sei.
Spä ter dann gelangte Dworkin zu der Einsicht, dass die Annahme, Recht und Moral seien
zwei unterschiedliche Systeme, selbst schon ein Teil des Problems sei. »Verstehen wir
Recht und Moral erst einmal als voneinander getrennte Normensysteme, dann gibt es
keinen neutralen Standpunkt, von dem aus die Verbindungen zwischen diesen beiden
vermeintlich getrennten Systemen beurteilt werden kö nnten.« Dworkin sieht das Recht
seither als einen Zweig der Moral an. »Die Moral sollte grundsä tzlich als baumartige
Struktur verstanden werden, wobei das Recht ein Zweig der politischen Moral ist, die selbst
vom Ast der allgemeineren persö nlichen Moral abgeht, die wiederum aus der noch
abstrakteren Theorie der gelungenen Lebensfü hrung herauswä chst.« Der Zweig des Rechts
wä chst aus der Moral als dem Stamm heraus. Dworkin geht von der Einheit der Werte aus,
die in der Moral und im Recht dieselben seien.
Herbert Lionel Adolphus Hart
Herbert Lionel Adolphus Hart war Lehrer von Dworkin, von dem Letzterer sich spä ter
allerdings kritisch absetzte. Harts Konzeption wird hier nur kurz prä sentiert, da sie oben
bereits unter dem Rubrum des Rechtspositivismus dargestellt wurde. Fü r Hart ist das
Recht seiner Struktur nach bereits gerecht und somit moralisch: »Es lä ßt sich nicht
leugnen, daß ein wesentliches Element im Begriff der Gerechtigkeit der Grundsatz der
Gleichbehandlung ist. Das ist die Gerechtigkeit in der Anwendung des Rechts, nicht die
Gerechtigkeit des Rechts. So liegt schon allein im Begriff des aus allgemeinen Regeln
bestehenden Rechts etwas, das uns daran hindert, das Recht so zu behandeln, als wä re es
moralisch vö llig neutral und ohne jeden notwendigen Berü hrungspunkt mit moralischen
Grundsä tzen.« An anderer Stelle stü tzt Hart seine These, wenn er sagt, dass rechtliche
Regeln inhaltlich mittels moralischer Prinzipien ausgedeutet werden. »Das Recht spiegelt
die Moral.« Und außerdem sei die Gerechtigkeit den Verfahrensstandards inhä rent. »In der
bloßen Vorstellung von der Anwendung einer generellen Regel liegt der Keim der
Gerechtigkeit«, sagt Hart. Englische und amerikanische Juristen nennen die
Verfahrensstandards »natü rliche Gerechtigkeit«. In den Verfahrensstandards liegt nach
Hart demnach die innere Sittlichkeit des Rechts. Nun wird Luhmanns Frage verstä ndlich,
warum »es neben dem Recht noch Gerechtigkeit geben solle«. Diese rhetorisch gemeinte
Frage verdeutlicht aber auch das zur Bedeutung des Verfahrensrechts Gesagte.
Bei uns heißt es in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts: »Das Verfahrensrecht
dient der Herbeifü hrung gesetzmä ßiger und unter diesem Blickpunkt richtiger, aber
darü ber hinaus auch im Rahmen dieser Richtigkeit gerechter Entscheidungen.« Die Richter
sind also der Auffassung, dass Gesetzmä ßigkeit, Richtigkeit und Gerechtigkeit durch das
Verfahrensrecht realisiert werden.
Jü rgen Habermas
Jü rgen Habermas (geb. 1929) sieht ebenfalls den Zusammenhang von Recht und Moral: Das
Recht muss »in Einklang stehen mit moralischen Grundsä tzen«. Nach seiner Auffassung hat
das Recht in der modernen Welt eine Entlastungsfunktion fü r die Moral, und das in
dreierlei Hinsicht: in kognitiver, motivationaler und organisatorischer Hinsicht.
(1)Die kognitive Hinsicht: Der moralisch handelnde Mensch muss sich in
Entscheidungssituationen selbst ein Urteil bilden. Das Recht hingegen sagt sehr eindeutig,
was verboten und was erlaubt ist. Das sei die erste der drei Entlastungen, die das moderne
Recht der Moral zu bieten hat. Innerhalb des Rechtes gibt es keine Widersprü che. Das
wurde am Anfang mit dem vierten der genannten Merkmale, die das Recht von der Moral
unterscheiden, dargestellt: Es gibt hier keine Dilemmata; vielmehr ist stets eindeutig
geregelt, was gilt.
(2)Die motivationale Hinsicht: Man muss die moralische Norm nicht nur kennen, sondern
zudem motiviert sein, nach ihr zu handeln. Trotz Kenntnis der moralischen Regel kann die
Motivation fehlen, nach ihr zu handeln. Man soll beispielsweise jemandem helfen, der
angegriffen wird und in Not ist. Das weiß man auch. Doch weil man beispielsweise Angst
hat, selbst angegriffen zu werden, oder aus anderen Grü nden fehlt die Motivation, seiner
moralischen Pflicht nachzukommen. Im Recht wird die Motivation durch die
Strafandrohung ersetzt. Will man Strafe vermeiden, handelt man den rechtlichen Normen
entsprechend.
(3)Die organisatorische Hinsicht: Angesichts der Armut und des Hungers in der Welt haben
wir die positive moralische Pflicht, zu helfen und andere Menschen in der Welt vor dem
sicheren Tod zu bewahren. »Die Umleitung von Nahrung und Medikamenten, Bekleidung
und Infrastrukturen ü bersteigt bei weitem Initiative und Handlungsspielraum von
Individuen«, so Jü rgen Habermas. Das Recht hingegen »kann Kompetenzen festlegen und
Organisationen grü nden, kurz ein System von Zurechnungen herstellen, das sich nicht nur
auf natü rliche Rechtspersonen, sondern auf fingierte Rechtssubjekte wie Kö rperschaften
und Anstalten bezieht«.
Diese drei Entlastungen erfä hrt laut Habermas der moralisch geforderte Akteur durch das
Recht. Hier wird nicht nur eine Komplementaritä t von Moral und Recht sichtbar, vielmehr
erkennt Habermas die Ü bernahme von Funktionen der Moral durch das moderne Recht.
Letzteres wird von ihm als erwartungsstabilisierende Ergä nzung zur Moral eingefü hrt.
Diese enge Verbindung von Recht und Moral erlä utert Habermas in einer spä teren
Publikation aus einer etwas anderen Perspektive, bei der er ebenfalls zur Konstatierung
eines engen Zusammenhangs von Recht und Moral kommt: Die Moral wird durch die
Kodifizierung in Menschenrechte nach seiner Ansicht in zwingendes Recht ü bersetzt, in der
es »in der robusten Gestalt effektiver Grundrechte politische Wirklichkeit werden kann«.
Und dann schreibt er weiter: »Der Begriff der Menschenrechte verdankt sich einer
unwahrscheinlichen Synthese aus diesen beiden Elementen [Recht und Moral].«
Robert Alexy
Robert Alexy (geb. 1945) thematisiert ebenso wie Habermas das Verhä ltnis von Recht und
Moral anhand der Menschenrechte. Allgemein zum Verhä ltnis von Recht und Moral sagt er,
dass es bestimmte Rechte gibt, die jedem gegenü ber als moralisch begrü ndbar gelten. Es
sind zunä chst die drei Typen der Grundrechte, die in Artikel 1–19 des Grundgesetzes
festgehalten sind. Hierbei handelt es sich nach seiner Ansicht um nichts anderes als die
Aufnahme der Menschenrechte in die Verfassung. Es gibt in dieser Hinsicht allerdings
durchaus eine andere Auffassung. So schreibt Héctor Wittwer: »Angesichts der Tatsache,
dass einerseits die Menschenrechte als ›unverä ußerlich‹ bezeichnet werden und dass
andererseits zumindest einige Grundrechte gemä ß Art. 18 Abs. I verwirkt werden kö nnen,
ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber begrifflich zwischen Menschenund
Grundrechten unterschieden hat. Die Menschenrechte werden als ›Grundlage jeder
menschlichen Gemeinschaft‹ bezeichnet. Dasjenige, was Grundlage eines anderen ist, ist
nicht Teil desselben. Demzufolge sind die Menschenrechte kein Bestandteil des deutschen
Rechtssystems. Dies unterscheidet sie von den in Abs. 3 genannten Grundrechten, die als
›unmittelbar geltendes Recht‹ alle drei staatlichen Gewalten in der Bundesrepublik
binden.« Das ist eine durchaus logische Einlassung, denn etwas, was unverä ußerlich ist,
wie die Menschenrechte, kann in der Tat nicht verwirkt werden, wie dies bei den
Grundrechten nach Artikel 18 GG aber der Fall ist. Verwirkt werden kö nnen Grundrechte,
sofern jemand eine Gefahr fü r die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt.
Menschenund Grundrechte kö nnen somit nicht identisch sein.
Doch zurü ck zu Alexy, der sich auf verschiedene Arten der Grundrechte bezieht. Es sind
zunä chst diese drei: Abwehr-, Vornahmeund Mitwirkungsrechte. Alexy nennt die beiden
letzten Schutzrechte und politische Rechte. Ganz gleich, wie man sie bezeichnet, gemeint ist
jedenfalls Folgendes: Die Abwehrrechte sollen den individuellen Gestaltungswillen des
Bü rgers vor Eingriffen des Staates schü tzen. Sie begrenzen den Handlungsspielraum
staatlicher Organe. Vornahmerechte sind solche, die ein Recht auf Vornahme staatlicher
Handlungen begrü nden kö nnen, die demnach den Schutz vor Eingriffen Dritter garantieren.
Der Staat ü bernimmt eine Schutzpflicht gegenü ber seinen Bü rgern. Der Stö rer muss vom
Staat gezwungen werden, seine Stö rung zu unterlassen. Beliebtes Beispiel ist, dass der
Staat gegen den nä chtlichen Ruhestö rer vorgehen muss. Mitwirkungsrechte sind solche, die
dem Einzelnen die Mö glichkeit geben, an der Gestaltung des Gemeinwesens mitzuwirken,
beispielsweise indem er an demokratischen Wahlen teilnimmt. Neben diesen fü hrt Alexy
noch zwei weitere an, zum einen »soziale Rechte, welche das Existenzminimum absichern;
und Verfahrensrechte, die die Durchsetzung der in (1) bis (4) genannten Rechte
gewä hrleisten«. Die Absicherung des Existenzminimums dient dazu, in Wü rde leben zu
kö nnen, ganz wie es Friedrich Schiller in seinem berü hmten Epigramm festgehalten hat:
»Zu essen gebt [dem Menschen], zu wohnen, habt ihr die Blö ße bedeckt, gibt sich die
Wü rde von selbst.« Und die Grundrechte bilden nach Auffassung der Autorinnen und
Autoren des Grundgesetzes die Basis, »auf denen die Wü rde des Menschen beruht«. Und
nicht umgekehrt. Es ist also nach Auffassung der Mü tter und Vä ter des Grundgesetzes nicht
so, dass die Menschenwü rde die Basis fü r die Grundrechte ist, sondern umgekehrt.
Alexy nennt einen ä ußerst gewichtigen Grund – der dem habermasschen Argument nicht
unä hnlich ist –, warum mittels der Menschenrechte Moral in Recht transformiert wird: Es
sei nä mlich nicht gewä hrleistet, dass die bloße moralische Geltung »stets ein
entsprechendes Verhalten aller garantiert. Das ist das Hauptargument fü r die
Transformation der Menschenrechte in positives Recht.« Erst die Transformation von
Moral in die Rechtsnormen der Menschenrechte verbü rgt das moralische Verhalten aller.
Ergä nzend sei wichtig, dass die Geltung der Grundbzw. Menschenrechte durch ein
Verfassungsgericht abgesichert wird. Damit ist der Gesetzgeber an die Grundund
Menschenrechte gebunden und kann zudem kontrolliert werden.
Norbert Hoerster
Norbert Hoerster (geb. 1937) sieht den Zusammenhang von Recht und Moral noch wieder
anders und fragt, ob es eine moralische Pflicht zum Rechtsgehorsam gebe. Er bejaht diese
Frage unter Bezugnahme auf Sokrates im bereits erwä hnten Dialog Kriton. Hoerster
argumentiert so, dass der Staat die »fundamentalen Gü ter und Interessen (wie Leben,
kö rperliche Integritä t, Bewegungsund Handlungsfreiheit)« des einzelnen Bü rgers schü tze.
Darum sei im Regelfall kein Bü rger »an einem Zusammenbruch staatlicher Ordnung
interessiert. Das heißt aber, daß er Verhaltensweisen ablehnen muß, die zu einem solchen
Zusammenbruch fü hren. Er muß es also auch ablehnen, wenn seine Mitbü rger den Respekt
vor dem geltenden Recht verlö ren.« Aus dieser interessengeleiteten Moral ergibt sich fü r
Hoerster die moralische Pflicht zum Rechtsgehorsam.
Niklas Luhmann
Um das Verhä ltnis von Gerechtigkeit und Recht bei Niklas Luhmann (1927–1998) zu
klä ren, ist die Kenntnis seiner Systemtheorie unabdingbare Voraussetzung. Darum eine
kurze Charakterisierung vorweg: Der Ausgangspunkt seiner Systemtheorie ist die immer
komplexer werdende Gesellschaft, die fü r die Aufrechterhaltung ihrer Funktionsfä higkeit
Subsysteme ausbilde. Sie stü nden fü r eine Art sozialer Arbeitsteilung und ü bernä hmen
abgegrenzte Aufgaben. So hä tten wir ein Rechtssystem, ebenso wie ein Erziehungsund
Wissenschaftssystem. Jedes einzelne System habe bestimmte Funktionen zu erfü llen und
jedes einzelne sei fü r die Erhaltung der Gesellschaft unverzichtbar. Eine Gesellschaft ohne
Rechtssystem beispielsweise sei nicht vorstellbar.
Im Rechtssystem steigt heutzutage die Zahl von Entscheidungen, die zu treffen sind, auf ein
unü berschaubares Maß. Darum kann in der Gegenwartsgesellschaft Gerechtigkeit die
Gewä hrleistung von konsistenten Entscheidungen im Rechtssystem bedeuten. Das
Rechtssystem mü sse darum in seiner Struktur so gestaltet sein, dass die Garantie gegeben
ist, dass gleiche Fä lle gleich und ungleiche ungleich entschieden werden. Dies geschieht
nach Luhmann dadurch, dass entschieden wird, wie bereits entschieden worden ist.
»Rechtsakte schließen an andere Rechtsakte an.« Außerdem geschieht das dadurch, dass
untere Gerichte sich an Entscheidungen hö herer Instanzen orientieren und ein hö heres
Gericht, wenn eine Entscheidung eines unteren Gerichtes diesem Prinzip nicht entspricht,
das Urteil kassiert. »Fü r parallel verlaufende Verfahren stand dazu die Einrede der
Rechtshä ngigkeit bereit. Mehr als ein einziges Gericht konnte nicht zur selben Zeit mit
derselben Sache beschä ftigt sein.« Eine solche Gewä hrleistung von konsistenten
Entscheidungen garantiert nicht nur die Gerechtigkeit im Recht, sondern auch die
Rechtssicherheit und Rechtseinheit.
Probleme mit dieser Konsistenzforderung als Maßstab fü r Gerechtigkeit ergeben sich nach
Luhmann erst bei der Gesetzgebung: »Gesetzgebung steht, da sie Recht ä ndert, in
notwendigem Widerspruch zur Forderung konsistenten Entscheidens. Sie ermö glicht es,
gleiche Fä lle ungleich und ungleiche Fä lle gleich zu entscheiden.« Solche Akte der
Gesetzgebung sind oft Anlä sse fü r eine ö ffentliche Debatte ü ber Gerechtigkeit.
Zum Zusammenhang von Recht und Moral wurden hier also sechs verschiedene
Auffassungen, die derzeit in der Rechtsphilosophie diskutiert werden, vorgestellt:
(1)In einer frü heren Phase seiner Theorieentwicklung geht Dworkin davon aus, dass das
Recht auf moralischen Prinzipien ruht, wie dem der Angemessenheit. Spä ter dann erklä rt
er, dass Recht und Moral eine Einheit bilden, weil die Werte in Recht und Moral dieselben
sind. Das Recht sei ein Zweig der Moral.
(2)Dem Verfahrensrecht ist die Gerechtigkeit inhä rent.
(3)Das Recht bietet Entlastungsfunktionen fü r die Moral, und auf der anderen Seite wird
die Moral zwingend, indem sie in Menschenrechte transformiert wird.
(4)Dies ist bei Robert Alexy ebenfalls das Hauptargument, warum Moral in Rechtsnormen
transformiert werden muss. Habermas und Alexy sind der Auffassung, dass Rechtsnormen
solche sind, die unsere wichtigen moralischen Regeln absichern.
(5)Es gibt eine moralische Pflicht zum Rechtsgehorsam.
(6)Die Gerechtigkeit ist nichts anderes als »die Konsistenz des Entscheidens«.
Die Bedeutung des Verfahrensrechts
Sowohl bei der Untersuchung der Rechtsprechung wie auch bei der der Rechtsphilosophie
wurde deutlich, dass das Verfahrensrecht eine zentrale Rolle spielt. Das muss es auch.
Franz Neumann sagte schon bei seiner Auseinandersetzung mit dem NS-Recht, dass das
»fundamentale Prinzip des Rechtsstaates die Gleichheit vor dem Gesetz« sei.
Das Verfahrensrecht muss nun genauer angesehen werden, um zu ermitteln, wie die
gleichheitsbasierte Gerechtigkeit im Recht durch das Verfahrensrecht Gestalt annimmt.
Erinnert sei an dieser Stelle an die These von H. L. A. Hart, dass den Verfahrensstandards
die Gerechtigkeit inhä rent sei. »In der bloßen Vorstellung von der Anwendung einer
generellen Regel liegt der Keim der Gerechtigkeit«, sagt Hart. Und Habermas ergä nzt, dass
»Legitimitä t durch Legalitä t mö glich ist, soweit die Verfahren zur Produktion rechtlicher
Normen [und Gerichtsurteile] auch im Sinne einer moralisch-praktischen
Verfahrensrationalitä t vernü nftig sind und auf vernü nftige Weise praktiziert werden«. Das
Bundesverfassungsgericht geht ü berdies davon aus, dass Gerechtigkeit, Moral und
Rechtmä ßigkeit durch die Verfahrensregeln verwirklicht werden, und angloamerikanische
Juristen nennen die Verfahrensstandards »natü rliche Gerechtigkeit«. Deutsche
Rechtsphilosophen betonen, dass »normative Richtigkeit oder Gerechtigkeit nicht an
Inhalten, sondern nur an richtigen Verfahren gemessen werden kann«.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass empirischen Untersuchungen zufolge fü r
Jugendliche die Verfahrensregeln entscheidend fü r die Gerechtigkeit im Recht sind. Sie
sprachen sich fü r das Recht des Angeklagten auf ein faires Verfahren aus. Auf einer Skala
von 1 bis 10 lag bei Heranwachsenden ab zwö lf Jahren die Bewertung bei 9,31. »Insgesamt
zeigt die Auswertung des Szenarios, dass die Jugendlichen alters-, geschlechtsund
religionsü bergreifend zumeist ein Bewusstsein der geltenden verfahrensrechtlichen
Prinzipien haben. Mit großer Mehrheit sprechen sie sich fü r zentrale Rechte des
Angeklagten aus.« Genau diese werden durch die deutsche Strafprozessordnung geschü tzt.
Nun genug der Theorie! Sehen wir uns das in den verfassungsgerichtlichen,
rechtsphilosophischen und empirischen Aussagen als so bedeutend herausgestellte
Verfahrensrecht genauer an. Es ist bei uns die Strafprozessordnung, die den Gang des
Strafverfahrens (Ermittlungsverfahren, Hauptverhandlung, Rechtsmittel) regelt. Das Gebot
des »Fair Trial« ist ein generelles Gebot fü r alle Verfahren und wird in Artikel 6 der
Europä ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gesichert. Fü r den Strafprozess erlangt
es besondere Bedeutung, denn der Strafprozess ist die »intensivste Konfrontation mit der
staatlichen Hoheitsgewalt«. Darum soll »Waffengleichheit” hergestellt werden und eine
mö glichst genaue rechtliche Regelung und Eingrenzung der staatlichen Machtbefugnisse
erfolgen. Der Staat ist unvergleichlich viel stä rker als der Beschuldigte oder Angeklagte, der
in der Regel keine strafprozessualen Kenntnisse hat und darum Rechte, die er nicht kennt,
logischerweise nicht wahrnehmen kann. Dem Beschuldigten oder Angeklagten steht nicht
der ganze Polizeiapparat mit all seiner kriminalistischen Technik zur Verfü gung, dem
Staatsanwalt hingegen sehr wohl. »Der Beschuldigte hat somit regelmä ßig keine Chance,
sich gegen den juristisch ausgebildeten, in der Sache unbefangenen sowie ü ber hoheitliche
Zwangsbefugnisse und den polizeilichen Ermittlungsapparat verfü genden Staatsanwalt
durchzusetzen.«
Deshalb mü ssen im Strafprozess zunä chst einmal einige Grundregeln eingehalten werden.
Zum Prinzip des »Fair Trial« gehö ren die Trennung von anklagender Staatsanwaltschaft
und unabhä ngiger Richterschaft. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Richter
unabhä ngig von der Fremdverwaltung des Staates. Diese Unabhä ngigkeit ist eine
Errungenschaft gegenü ber dem Inquisitionsprozess, in dem es eine »Einheit von
verfolgendem und urteilendem Richter« gab. Im Nationalsozialismus bestand diese
Trennung nur als Farce. Der Richter im heutigen Strafprozess muss die Wahrheit von Amts
wegen erforschen. (§ 244, 2 StPO) Außerdem muss der Staatsanwalt auch zugunsten des
Angeklagten ermitteln (§ 160, 2 StPO), denn jener hat, wie schon gesagt, die
kriminalistische Technik und den Polizeiapparat auf seiner Seite, die dem Beschuldigten
oder Angeklagten nicht zur Verfü gung stehen. Zum Prinzip des »Fair Trial« gehö rt weiter,
dass der Angeklagte sich nicht selbst belasten muss (nemo tenetur se ipsum accusare), und
es gilt die Unschuldsvermutung (in dubio pro reo), festgelegt in Artikel 6, 2 EMRK, in dem
es heißt: »Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis
ihrer Schuld als unschuldig.«
Weil der Beschuldigte zunä chst keine Chance hat, sich gegen die in jeder Hinsicht besser
ausgestattete Staatsanwaltschaft zu behaupten, hat er weiterhin das Recht auf einen
Verteidiger. (§ 137 StPO) Das ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts selbstverstä ndlich. Der
Beschuldigte kann in jedem Stadium des Verfahrens einen Verteidiger seines Vertrauens
hinzuziehen. In Verfahren vor dem Landgericht oder hö heren Gerichten muss er sogar
einen Rechtsanwalt haben, das heißt, es ist dem Gericht verboten, gegen einen
unverteidigten Angeklagten zu verhandeln. Der Verteidiger hat diverse Pflichten. Der
folgende Pflichtenkatalog ist »von Rechtsprechung und Rechtswissenschaft« entwickelt
worden : Der Verteidiger hat alles vorzubringen, was fü r den Beschuldigten gü nstig ist, er
hat dazu – wenn nö tig – an Zeugen und Sachverstä ndigen Kritik zu ü ben und die
Befangenheit eines Richters zu rü gen. Der Rechtsanwalt darf nicht zur Ü berfü hrung des
Angeklagten beitragen. »Die dem Verteidiger obliegende Wahrheitspflicht fü hrt nicht dazu,
daß er ihm zur Kenntnis gelangende belastende Umstä nde, die der
Strafverfolgungsbehö rde verborgen geblieben sind, offenbaren mü ßte.« Er muss
Freispruch beantragen, wenn ihm der Nachweis der Schuld des Angeklagten nicht
lü ckenlos gefü hrt erscheint. »Er ist Garant der Unschuldsvermutung.« Der eigene Glaube an
die Schuld darf ihn nicht davon abhalten, Freispruch zu beantragen, ja nicht einmal das
persö nliche Gestä ndnis des Angeklagten dem Verteidiger gegenü ber. Der Verteidiger hat
weiterhin Rechte, die von denen des Angeklagten oder Beschuldigten abgeleitet sind. Dazu
gehö rt die Akteneinsicht oder das Recht, Beweisanträ ge zu stellen.
Des Weiteren ist die Laienbeteiligung, das ist die Mitwirkung von Schö ffen, eine
demokratische Errungenschaft, die das Strafverfahren gerecht machen soll. Die Herstellung
und Gewä hrleistung der Ö ffentlichkeit ist ebenfalls einer der fundamentalen Grundsä tze
des Strafverfahrens. Er geht auf Montesquieu zurü ck. Mit ihm sollte eine die
Menschenrechte achtende Rechtspflege realisiert werden. Das Volk sollte die Kontrolle
haben und der Prozess der Geheimjustiz entzogen werden. Das ist ein Grundsatz, den wir
auch bei Kant finden: »Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren
Maxime sich nicht mit der Publizitä t verträ gt, sind unrecht.« (Zum ewigen Frieden A 93)
Das Inquisitionsverfahren war demgegenü ber ein Geheimverfahren.
Es gibt im Strafprozess zahlreiche weitere Regeln, die dazu dienen, die Gerechtigkeit zu
verwirklichen. Dazu gehö rt beispielsweise das Prinzip der Unmittelbarkeit und
Mü ndlichkeit (§ 250 StPO), das sicherstellen soll, dass das Gericht sich selbst einen
Eindruck von den Beweisen verschaffen kann und die Beweismittel nicht durch Surrogate
ersetzt werden. Das Gericht hat nach § 261 StPO das Recht der freien Beweiswü rdigung.
Diese Bestimmung lautet: Ȇ ber das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht
nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschö pften Ü berzeugung.«
Beweismittel, die dem Gericht bei der Beweisaufnahme zur Verfü gung stehen, sind Zeugen
(§§ 48–71 StPO), Sachverstä ndige (§§ 72–84 StPO), Inaugenscheinnahme (§§ 86 ff. StPO)
und Urkunden (§§ 249–256 StPO). »Es wird dem Richter nicht vorgeschrieben, unter
welchen Voraussetzungen er eine Tatsache fü r bewiesen bzw. nicht bewiesen zu halten
habe.« Weiterhin ist das Gericht weder an die Schlussvorträ ge der Staatsanwaltschaft noch
der Verteidigung gebunden, sondern es hat die Beweise selbst erschö pfend und
nachvollziehbar zu wü rdigen. »Freie Beweiswü rdigung« bedeutet aber nicht, dass das
Gericht willkü rlich verfahren darf. Es dü rfen nur solche Tatsachen zugrunde gelegt werden,
die das Gericht fü r erwiesen hä lt. Wenn die Tatsache allerdings aufgrund
wissenschaftlicher Erkenntnis feststeht, ist fü r die richterliche Beweiswü rdigung kein
Raum, zum Beispiel bei einer DNA-Analyse, einer Blutalkoholbestimmung und den
Gesetzen der Logik. Hingegen kö nnen wissenschaftliche Sachverstä ndigengutachten der
freien Beweiswü rdigung unterliegen. Beispielsweise lagen im Fall des Norwegers Anders
Breivik nicht ü bereinstimmende Sachverstä ndigengutachten vor, die das Gericht zu
bewerten hatte. Dies ist ein in der Ö ffentlichkeit sehr bekannter Fall, aber unterschiedliche
oder gar sich widersprechende Sachverstä ndigengutachten sind das tä gliche Brot der
Gerichte.
Resü mee und Ausblick
Die ausfü hrliche Darstellung der grundlegenden Bestimmungen der StPO sollen deutlich
machen, was Rechtsphilosophen wie Hart und das Bundesverfassungsgericht damit
meinen, wenn sie sagen, dass durch die Einhaltung der Verfahrensregeln Gerechtigkeit im
Recht hergestellt wird. Die Gleichbehandlung muss gewä hrleistet sein, vor allem vor dem
Gericht, weil der Strafprozess der stä rkste Eingriff der staatlichen Hoheitsgewalt in das
Leben des Einzelnen ist.
Nun kö nnte man mit Luhmann einwenden, dass hinter einem Gerichtsurteil immer das
Interesse an einem gewü nschten Ausgang des Verfahrens steht, das man regelmä ßig findet,
wenn man sich in die Gerichtscafeteria, ins Dienstzimmer des Richters oder in den Flur vor
den Verhandlungssaal begeben hat, um in Anwesenheit aller Parteien mal »vernü nftig
miteinander zu reden«. Dem wiederum kö nnte man mit Habermas entgegnen: »Soweit das
Aushandeln von Kompromissen nach Verfahren ablä uft, die allen Interessenten gleiche
Chancen der Teilnahme an den Verhandlungen sichern und wä hrend der Verhandlungen
gleiche Chancen gegenseitiger Einflußnahme aufeinander einrä umen, damit auch generell
gleiche Chancen fü r die Durchsetzung aller berü hrten Interessen schaffen, besteht die
begrü ndete Vermutung, daß die erzielten Vereinbarungen fair sind.« Nach einem Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2005 wurde der § 257c in die
Strafprozessordnung eingefü gt, wonach Verstä ndigungen ü ber die Rechtsfolgen des Urteils
unter den Beteiligten mö glich sind. Die neuesten Entwicklungen deuten darauf hin, dass
diese Form der Verstä ndigung in Zukunft hä ufiger in Anspruch genommen wird.
Schlü sselbegriffe
Beweiswü rdigung, freie Das Prinzip der freien Beweiswü rdigung nach § 261 StPO bedeutet,
dass das Gericht die Ergebnisse der Hauptverhandlung unabhä ngig, vollstä ndig und den
Gesetzen der Logik entsprechend bei der Urteilsberatung zu wü rdigen hat.
Billigkeit Fä higkeit, als Richter angesichts abstrakter Gesetze angemessen urteilen zu
kö nnen. Dazu bedarf es der personalen praktischen Urteilskraft.
Fabrikgesetzgebung Gesetzgebung, die nicht mehr nur auf den Austauschoder
Zirkulationsprozess beschrä nkt blieb, sondern auf den Produktionsprozess durchgriff. Die
Fabrikgesetzgebung setzte in England 1833 mit der zeitlichen Beschrä nkung des
Arbeitstages fü r Kinder ein. Sie wurde unter anderem weitergefü hrt mit dem Verbot von
Frauenarbeit in Bergwerken (1842), der allgemeinen Beschrä nkung der Wochenarbeitszeit
auf 63 Stunden (1847) bis hin zu den heutigen differenzierten
Arbeitsschutzbestimmungen.
Fair Trial Das Prinzip des »Fair Trial« ist in Artikel 6 der Europä ischen
Menschenrechtskonvention festgelegt und garantiert ein faires Gerichtsverfahren.
Gerechtigkeit Seit Aristoteles besteht Gerechtigkeit in der Gleichbehandlung aller
Menschen. Das Recht ist demnach gerecht, wenn die Menschen gleich behandelt werden.
Jede Ungleichbehandlung muss als Krä nkung und Erniedrigung empfunden werden.
Bezogen auf einen Gerichtsprozess ist Gerechtigkeit eine sowohl konstitutive wie
regulative Idee. Die Gerechtigkeit ist fü r das Zustandekommen und die Durchfü hrung des
Prozesses konstitutiv, weil die Parteien davon ü berzeugt sind, dass durch ihn Gerechtigkeit
hergestellt wird. Zugleich aber ist die Gerechtigkeit regulativ, weil man sich an der
Idealvorstellung von Gerechtigkeit orientiert und versucht, sie in jedem Prozess erneut und
noch besser zu realisieren.
Grundnorm Die Grundnorm ist in Hans Kelsens rechtspositivistischer Theorie die Basis, auf
der alles normierte Recht beruht. Sie ist aber nicht Gegenstand rechtswissenschaftlicher
Betrachtung. Sie ist irgendwann gegeben worden und jede Aussage darü ber wä re reine
Spekulation.
Ideologie Jede Ideologie geht erstens davon aus, dass die Welt ursprü nglich in Ordnung
war, und zweitens davon, dass die Gegenwart dekadent geworden ist. An der Dekadenz
waren der NS-Ideologie zufolge die Juden schuld. Drittens will das auf Ideologie basierende
politische Handeln den ursprü nglichen Zustand wiederherstellen oder zu einer besseren
Welt fü hren. Ideologie ist immer Heilsversprechen, Eschatologie.
In dubio pro reo Dieser Grundsatz bedeutet, dass der Angeklagte bis zum Beweis seiner
Schuld als unschuldig zu gelten hat. Festgelegt ist das in Artikel 6, 2 der Europä ischen
Menschenrechtskonvention.
Legal und legitim »Legitim« bedeutet, dass etwas allgemeine Anerkennung genießt, und
»legal« bedeutet, dass etwas gesetzmä ßig ist. Man hä lt es beispielsweise fü r ganz legitim,
wenn die Gewerkschaft mehr Urlaub fordert. Mehr Urlaub ist dann noch nicht gesetzlich
legalisiert, was aber, ausgelö st durch die legitime Forderung, geschehen kann.
Mehrwert Mit diesem Begriff bezeichnete Marx das, was der Kapitalist durch den Einsatz
der Ware Arbeitskraft mehr an Geld erwirtschaftet, als er fü r die Ware Arbeitskraft bezahlt
hat. Marx symbolisierte das so: G-W-G’, wobei G’ die ursprü ngliche Geldsumme, die er dem
Arbeiter fü r seine Ware Arbeitskraft bezahlt hat, plus einem Ü berschuss bedeutet.
Moral Ensemble von Regeln, die eingedenk dessen, dass Menschen verletzlich sind,
diejenigen schü tzen soll, die vom Handeln anderer betroffen sind.
Naturrecht Aus Sicht seiner Vertreter das System rechtlicher Normen, die natü rlicherweise
gegeben und die ü berall und jederzeit verbindlich sind. Mit ihnen sollten darü ber hinaus
die positivrechtlichen Normen auf ihre Richtigkeit hin ü berprü ft werden.
Nemo tenetur se ipsum accusare Dieser Grundsatz bedeutet, dass der Angeklagte in jedem
Stadium des Verfahrens ein Schweigerecht hat und sich weder selbst belasten noch
ü berhaupt zur Sache ä ußern muss.
Ö ffentlichkeitsprinzip Das Ö ffentlichkeitsprinzip ist im Strafverfahren ein hohes Gut und
ein Garant der Gerechtigkeit im Recht. Das Volk sollte damit die Kontrolle haben und der
Prozess der Geheimjustiz entzogen werden. Das ist ein Grundsatz, den wir schon bei Kant
finden: »Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich
nicht mit der Publizitä t verträ gt, sind unrecht.«
Recht Das Recht ist ein soziales Regelsystem. Kants bekannte Definition lautet: »Das Recht
ist der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkü r des einen mit der Willkü r des
andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann.«
Recht, positives Im Gegensatz zum Naturrecht ist das positive Recht das von Menschen
gesetzte Recht.
Rechtsbegriff, unbestimmter Es gibt unbestimmte Rechtsbegriffe, die den
Entscheidungsträ gern einen Ermessensspielraum erö ffnen. Man muss beispielsweise
rechtlich prü fen, ob ein »berechtigtes Interesse des Antragsstellers« vorliegt oder ob die
Entscheidung im Sinne des »Gemeinwohls« ist. Es werden vom Entscheidungsträ ger auch
Wertausfü llungen verlangt, wenn er etwa entscheiden muss, ob etwas »gegen die guten
Sitten« verstö ßt, ob etwas dem »Billigkeitsund Gerechtigkeitsempfinden aller anstä ndig
Denkenden« entspricht oder etwas »angemessen« ist. Darü ber hinaus gibt es unbestimmte
Rechtsbegriffe im tatsä chlichen Bereich: »bei Einbruch der Dunkelheit«, »bei Glä tte«. Fü r
alle drei genannten Arten unbestimmter Rechtsbegriffe findet der Entscheidungsträ ger in
den fü r solche Fä lle vorangegangenen Entscheidungen Orientierungen. »Rechtsakte
schließen an andere Rechtsakte an.« Es muss so entschieden werden, wie bereits
entschieden worden ist. Durch diese Gleichbehandlung sollen Gerechtigkeit und
Rechtssicherheit hergestellt werden.
Rechtshä ngigkeit Durch die Einrede der Rechtshä ngigkeit, die es im Straf-, Zivilund
Verwaltungsrecht gibt, soll vermieden werden, dass ein und derselbe Sachverhalt
gleichzeitig vor verschiedenen Gerichten mit mö glicherweise unterschiedlichen Urteilen
verhandelt wird. Durch diese Einrede soll die Rechtseinheit gewahrt bleiben.
Rechtspositivismus Die Rechtspositivisten wollen sich im Gegensatz zu den Naturrechtlern
jeder Wertung enthalten. Die Beschreibung des existierenden Rechts und die Bewertung
des Rechts werden von ihnen strikt getrennt. Die Forschungen der Rechtspositivisten
beziehen sich auf die tatsä chlich vorliegende Rechtsordnung, auf empirisch feststellbare
Rechtssä tze, Rechtsgrundsä tze und auf das Richterrecht.
Rü ckwirkungsverbot Im Artikel 103, 2 des Grundgesetzes heißt es: »Eine Tat kann nur
bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen
wurde.« Im § 1 StGB findet man die wortgleiche Formulierung.
Sittlichkeit Damit ist nach Hegel das Ensemble bestehender eingelebter
Selbstverstä ndlichkeiten gemeint. Auf ihrer Basis kö nnen moralische und rechtliche
Normen ihre Kraft entfalten. Recht und Moral sind verschiedene Ausprä gungen der
Sittlichkeit, bilden aber eine Identitä t, weil sie gleichermaßen aus der Sittlichkeit
entspringen. »Was der Mensch tun mü sse, ist in einem sittlichen Gemeinwesen leicht zu
sagen, – es ist nichts anderes von ihm zu tun, als was ihm in seinen Verhä ltnissen
vorgezeichnet, ausgesprochen und bekannt ist.«
Stoa Die Stoa ist eine philosophische Schule, die eine vernunftausgerichtete Lebensweise
propagiert. Benannt ist sie nach der mit Bildern geschmü ckten Halle in Athen.
Subsidiaritä t Formelle Subsidiaritä t liegt vor, wenn ein Tä ter wegen eines Tatbestands
nicht bestraft wird, falls ein anderer Tatbestand greift. Zum Beispiel kommt der § 316 StGB
nur zum Zuge, wenn nicht schon nach § 315a oder § 315c bestraft wird. § 316 StGB lautet:
»Wer im Verkehr (§§ 315 bis 315d) ein Fahrzeug fü hrt, obwohl er infolge des Genusses
alkoholischer Geträ nke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu fü hren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft, wenn die Tat nicht in § 315a oder § 315c mit Strafe bedroht ist.«
Verfahrensrecht Ein Prozess wird nach den Regeln des Verfahrensrechts durchgefü hrt.
Jeder Zweig der Gerichtsbarkeit hat ein Verfahrensrecht. Das Verfahren im Zivilprozess ist
in der Zivilprozessordnung (ZPO) normiert. Im Strafprozess gilt die Strafprozessordnung.
Im Verwaltungsprozess gilt die Verwaltungsgerichtsordnung. Im Arbeitsgerichtsprozess
gilt das Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG). Im finanzgerichtlichen Verfahren gilt die
Finanzgerichtsordnung (FGO). Es gibt viele weitere Verfahrensordnungen. Ein Verstoß
gegen das Verfahrensrecht kann ein Revisionsgrund sein.
Vous aimerez peut-être aussi
- Sujet La Justice Et Le DroitDocument4 pagesSujet La Justice Et Le DroitFred Loïck Etouolo100% (1)
- Philosophie Du DroitDocument10 pagesPhilosophie Du DroitLoïck Fréderick Etouolo100% (1)
- Le Droit Est LDocument13 pagesLe Droit Est LRachid LaabachiPas encore d'évaluation
- Philosophie Du DroitDocument15 pagesPhilosophie Du DroitLoïck Fréderick EtouoloPas encore d'évaluation
- Cours Principes de Droit PDFDocument15 pagesCours Principes de Droit PDFabidm2645Pas encore d'évaluation
- Philosophie - Terminale: La Justice Et Le DroitDocument2 pagesPhilosophie - Terminale: La Justice Et Le DroitAbdelhak LamiPas encore d'évaluation
- La Justice Cours de PhiloDocument10 pagesLa Justice Cours de PhiloBadr FenjiroPas encore d'évaluation
- La Question Philosophique de La Justice Et Du Droit 2022 3 EnvoiDocument8 pagesLa Question Philosophique de La Justice Et Du Droit 2022 3 EnvoiSarah AmmarPas encore d'évaluation
- Philosophie - XII JusticeDocument4 pagesPhilosophie - XII JusticeMathilde BourPas encore d'évaluation
- Cours de Theorie Du Droit Master Ii Recherche 2Document33 pagesCours de Theorie Du Droit Master Ii Recherche 2Issa Mika-ilaPas encore d'évaluation
- Nasra - Philosophie Du DroitDocument46 pagesNasra - Philosophie Du Droitzeidchem2003Pas encore d'évaluation
- La JusticeDocument2 pagesLa JusticeAbdoul RazzakPas encore d'évaluation
- Anthropologie Juridique Et Sociale - YsDocument35 pagesAnthropologie Juridique Et Sociale - YsIdrissa NiassyPas encore d'évaluation
- Droit Civil IntegraliteDocument17 pagesDroit Civil IntegraliteGqyPas encore d'évaluation
- Introduction Historique Au DroitDocument26 pagesIntroduction Historique Au Droitrinci100% (2)
- INTRO AU DROIT - Constantin Yatala NsomweDocument89 pagesINTRO AU DROIT - Constantin Yatala NsomweEmmanuel coffee 767% (3)
- La Validité Du DroitDocument4 pagesLa Validité Du DroitSoighir SDHPas encore d'évaluation
- Despre Aparenta Contradictie Dintre Drept Si Morala 2011Document12 pagesDespre Aparenta Contradictie Dintre Drept Si Morala 2011Mariana TibuleacPas encore d'évaluation
- Nouveau Document TexteDocument3 pagesNouveau Document Textebahri114Pas encore d'évaluation
- Dis Set AtionsDocument35 pagesDis Set Ationscolim41522Pas encore d'évaluation
- Evolutia DR Civil FrancezaDocument8 pagesEvolutia DR Civil FrancezaGabriela VecliucPas encore d'évaluation
- Droit CivilDocument54 pagesDroit Civilzetiyenga Ismaël Aser RubenPas encore d'évaluation
- Théories Du DroitDocument230 pagesThéories Du Droitbertolini thomasPas encore d'évaluation
- Droit Semestre 1 V2Document30 pagesDroit Semestre 1 V2SamuelPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie Sur Le DroitDocument31 pagesCours de Philosophie Sur Le DroitNanaPas encore d'évaluation
- Droit Et Justice Pour ÉlèvesDocument4 pagesDroit Et Justice Pour Élèvesamalbouchoucha7Pas encore d'évaluation
- Philosophie Du DroitDocument17 pagesPhilosophie Du DroitFrancia SuzyPas encore d'évaluation
- 1er Semestre - Droit CivilDocument13 pages1er Semestre - Droit CivilAdama NdiayePas encore d'évaluation
- La Légalité Criminelle Et La Norme JuridiqueDocument3 pagesLa Légalité Criminelle Et La Norme JuridiqueGrace KPATINVOPas encore d'évaluation
- Cours de Droit ConstitutionnelDocument244 pagesCours de Droit Constitutionnelgansonre gaiwara100% (1)
- Introduction Au DroitDocument47 pagesIntroduction Au DroitCheick BambaPas encore d'évaluation
- Introduction A L'Etude Du Droit S3. Prof: Thami BensaidDocument6 pagesIntroduction A L'Etude Du Droit S3. Prof: Thami BensaidLamyâa LahsainiPas encore d'évaluation
- Introduction Au DroitDocument18 pagesIntroduction Au DroitAlexander AlbrechtPas encore d'évaluation
- Cours Introduction Au Droit 2024 Partie 1Document21 pagesCours Introduction Au Droit 2024 Partie 144n7tksctxPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document11 pagesChapitre 1Julie FoxPas encore d'évaluation
- Droit CivilDocument2 pagesDroit CivilSalma BahbahPas encore d'évaluation
- TermS 05 Fiche Sur La Justice Et Le DroitDocument5 pagesTermS 05 Fiche Sur La Justice Et Le DroitAlpha Umar DialloPas encore d'évaluation
- Chapitre I IEDDocument86 pagesChapitre I IEDrehab bennaniPas encore d'évaluation
- L' ÉthiqueDocument3 pagesL' Éthiqueclaro leger100% (1)
- IntroDocument39 pagesIntroAbdalali Ait AzrailPas encore d'évaluation
- Introduction À Létude Du Droit, Licence 1 ESADocument42 pagesIntroduction À Létude Du Droit, Licence 1 ESAAmen AGBOTOPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel 1Document77 pagesDroit Constitutionnel 1Alexandre KouadioPas encore d'évaluation
- 2022 Capa - Seance1Document9 pages2022 Capa - Seance1Thomas GahePas encore d'évaluation
- Dworkin - Le PositivismeDocument0 pageDworkin - Le Positivismeraphael_rosa_10Pas encore d'évaluation
- O I J (Cours) - Version FinaleDocument79 pagesO I J (Cours) - Version FinaleTojo Fidèle RazafimandimbyPas encore d'évaluation
- 53db76eb8b77c PDFDocument31 pages53db76eb8b77c PDFKml1 OussamaPas encore d'évaluation
- Corrige Philo Baccalaureat TechnologiqueDocument13 pagesCorrige Philo Baccalaureat TechnologiqueVoulnangPas encore d'évaluation
- Chapitre 9 - Le Droit Et La JusticeDocument4 pagesChapitre 9 - Le Droit Et La JusticeLoukman Mahiza CompaoréPas encore d'évaluation
- A Propos Des ContradictionsDocument23 pagesA Propos Des ContradictionsPAULO AFONSO LINHARESPas encore d'évaluation
- ItapDocument15 pagesItapAlain JEAN FRANÇOISPas encore d'évaluation
- Dissertation Plan Droit-MoralDocument8 pagesDissertation Plan Droit-MoralMathis LeprincePas encore d'évaluation
- Juge PenalDocument24 pagesJuge PenalDobiePas encore d'évaluation
- Droit s5Document14 pagesDroit s5Choulli KawtarPas encore d'évaluation
- 1 Introduction 0 L'etude de Droit-1Document137 pages1 Introduction 0 L'etude de Droit-1Frindi WissalPas encore d'évaluation
- Philosophie Du DroitDocument78 pagesPhilosophie Du DroitRanto Andriampenitra RasoamanambolaPas encore d'évaluation
- TD 7 Interrogation RéponsesDocument17 pagesTD 7 Interrogation Réponsesnehasenanayake19Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Principales Caractéristiques Des Règles de DroitDocument7 pagesChapitre 1 - Principales Caractéristiques Des Règles de Droitleajohnson100% (1)
- Sociétés - C - CopieDocument1 pageSociétés - C - Copieoussama.michoPas encore d'évaluation
- Linterpretation Est CritiqueDocument17 pagesLinterpretation Est CritiqueFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- La Sociologie de Durkheim by Philippe Steiner.Document137 pagesLa Sociologie de Durkheim by Philippe Steiner.Fadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- La Qualite en Education Pour Reflechir A La Formation de Demain by Matthis BehrensDocument97 pagesLa Qualite en Education Pour Reflechir A La Formation de Demain by Matthis BehrensFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Philosophie de La ReligionDocument81 pagesPhilosophie de La ReligionFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Freud-Handbuch - Leben - Werk - Wirkung (PDFDrive)Document481 pagesFreud-Handbuch - Leben - Werk - Wirkung (PDFDrive)Fadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Philosophie (PDFDrive)Document227 pagesPhilosophie (PDFDrive)Fadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Hegel Au Prsent Kervgan Jean FraDocument327 pagesHegel Au Prsent Kervgan Jean FraFadi Abdel Nour100% (1)
- Vérité Et Sens Chez H.-G. GadamerDocument14 pagesVérité Et Sens Chez H.-G. GadamerFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- La Recherche Historique Sur Jésus - Menace Et - Ou Chance Pour La FoiDocument18 pagesLa Recherche Historique Sur Jésus - Menace Et - Ou Chance Pour La FoiFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- L'Etat - PréparationDocument4 pagesL'Etat - PréparationFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Anthologie de Sujets Et de Textes Sur L'artDocument11 pagesAnthologie de Sujets Et de Textes Sur L'artFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Hans Urs Von Balthasar Le ChristianismeDocument13 pagesHans Urs Von Balthasar Le ChristianismeFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Dieu Parle, FondementDocument14 pagesDieu Parle, FondementFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Eberhard JÜ Ngel - An Introduction To His TheologyDocument228 pagesEberhard JÜ Ngel - An Introduction To His TheologyFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Vivre Dans La Pluralité Des ReligionsDocument6 pagesVivre Dans La Pluralité Des ReligionsFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Ricoeur AlterityDocument15 pagesRicoeur AlterityFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Distance in The Trinitarian Theology of Hans Urs Von BalthasarDocument104 pagesDistance in The Trinitarian Theology of Hans Urs Von BalthasarFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Renaissance Et RéformeDocument47 pagesRenaissance Et RéformeFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- The Creative Thinker's Toolkit (PDFDrive)Document125 pagesThe Creative Thinker's Toolkit (PDFDrive)Fadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Faith Comes From What Is Heard ADocument269 pagesFaith Comes From What Is Heard AFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- L'herméneutique À L'école de Paul RicoeurDocument8 pagesL'herméneutique À L'école de Paul RicoeurFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- Support de Cours STDocument9 pagesSupport de Cours STFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- PsychanalyseDocument4 pagesPsychanalyseFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- De L' Herméneutique Théologique À La Théologie Interreligieuse Dans L'oeuvre de Claude GeffréDocument28 pagesDe L' Herméneutique Théologique À La Théologie Interreligieuse Dans L'oeuvre de Claude GeffréFadi Abdel NourPas encore d'évaluation