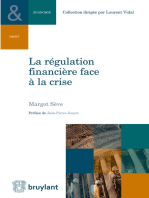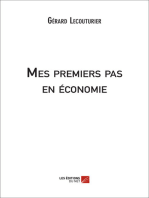Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Modele Is LM
Modele Is LM
Transféré par
Rodnny NjoyaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Modele Is LM
Modele Is LM
Transféré par
Rodnny NjoyaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
Le modle IS-LM Dernire mise jour le 19 dcembre 2010 Le modle IS-LM, fut popularis en 1939 par John HICKS1 (1904-1989) et en 1949, par Alvin HANSEN2 (1887-1975). Depuis lors, ce modle forme la base de tous les manuels de macroconomie. Ceci est peut-tre en train de changer, mais les alternatives srieuses sont assez peu populaires. 1) Explication de la courbe IS Cette courbe dcrit les combinaisons du taux d'intrt et du revenu qui sont compatibles avec l'galit entre l'pargne et l'investissement (voir figure). Son nom vient du fait que dans une conomie ferme (sans changes extrieurs), l'investissement doit tre gal l'pargne. Cette courbe est dcroissante car dans l'analyse keynsienne, l'investissement est (toutes choses gales par ailleurs et notamment les anticipations des investisseurs) une fonction dcroissante du taux d'intrt. o plus le taux d'intrt est bas, et plus les projets d'investissement dont l'efficacit marginale (profit escompt de l'investissement) est faible peuvent tre entrepris. Donc, quand le taux d'intrt baisse, l'investissement priv augmente, ce qui augmente le revenu par le jeu de l'effet multiplicateur. o Plus le taux dintrt est lev et moins les projets dinvestissement dont lefficacit marginale (profit escompt de linvestissement) est faible peuvent tre entrepris. Donc, quand le taux dintrt augmente, linvestissement priv baisse, ce qui rduit le revenu par le jeu de leffet multiplicateur.
On peut dmontrer que la pente de la courbe IS dpend de deux facteurs : l'lasticit de l'investissement au taux d'intrt. Si linvestissement est trs lastique au taux dintrt, toute variation du taux dintrt aura un fort impact sur linvestissement et la pente de la courbe IS sera faible (horizontale la limite). Si au contraire linvestissement est faiblement lastique au taux dintrt, toute variation du taux dintrt naura quun faible impact sur linvestissement et la pente de la courbe IS sera forte (verticale la limite) l'importance de l'effet multiplicateur. (quand i baisse, l'investissement augmente d'un montant donn, il s'ensuit un effet multiplicateur qui augmente Y d'un montant inversement proportionnel la propension pargner s=1-c). Plus s est faible et plus limpact multiplicateur est fort et la courbe IS faiblement pentue (horizontale la limite). Plus s est lev et plus limpact multiplicateur est faible et la courbe IS fortement pentue (verticale la limite) En pratique, le cas qui nous intressera plus particulirement dans la suite est celui dinlasticit de linvestissement au taux dintrt et donc celui dune courbe IS verticale qui en rsulte. La figure ci-aprs illustre nanmoins les diffrentes possibilits.
1 2
John R. HICKS, 1939, Mr. Keynes and the Classics: A suggested Interpretation" , Econometrica. Alvin HANSEN, 1949, Monetary Theory and Fiscal Policy , McGraw-Hill
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
La courbe IS
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
2) Explication de la courbe LM Cette courbe dcrit les combinaisons du taux d'intrt et du revenu qui sont compatibles avec l'galit entre l'offre et la demande de monnaie. Son nom vient du fait que la demande de monnaie s'crit L et l'offre de monnaie s'crit M. Nous avons vu que dans l'analyse keynsienne l'offre de monnaie tait exogne et que la demande de monnaie : dpendait positivement du revenu (demande de monnaie des fins de transaction et de prcaution) ngativement du taux d'intrt (demande de monnaie des fins spculatives).
Donc, toutes choses gales par ailleurs (cest--dire si loffre de monnaie ne change pas), lorsque le revenu augmente, la demande de monnaie des fins de transaction et de prcaution augmente ce qui - offre de monnaie constante -ncessite une hausse du taux d'intrt pour permettre une rduction de la demande de monnaie des fins spculatives. La courbe LM est donc croissante. On peut dmontrer ensuite que la pente de la courbe LM dpend de deux facteurs : l'lasticit de la demande de monnaie des fins de transaction et de prcaution par rapport au revenu. Si la demande de monnaie des fins de transaction et de prcaution est trs lastique par rapport au revenu, une faible augmentation de revenu entranera une forte hausse de la demande de monnaie des fins de transaction et de prcaution et ncessitera une forte hausse du taux dintrt pour dgager les liquidits jusque-l conserves pour la spculation. La pente de la courbe LM sera donc dautant plus forte et verticale la limite. Si en revanche la demande de monnaie des fins de transaction et de prcaution est faiblement lastique au revenu alors une augmentation de revenu entranera une faible hausse de la demande de monnaie des fins de transaction et de prcaution et ncessitera seulement une faible hausse du taux dintrt. La pente de la courbe LM sera faible et mme horizontale la limite. l'lasticit de la demande de monnaie des fins de spculation par rapport au taux d'intrt. Si la demande de monnaie des fins spculatives est fortement lastique au taux dintrt, une hausse de revenu crera une demande de monnaie supplmentaire et entranera une hausse du taux dintrt. Cette hausse du taux dintrt librera une forte quantit de monnaie jusque-l conserve des fins spculatives. En dautres termes, une augmentation donne de revenu ne ncessitera quune faible hausse du taux dintrt pour satisfaire les besoins en monnaie dtenue des fins de transaction et de prcaution. Ds lors, cela signifie que lorsque la demande de monnaie des fins spculatives est fortement lastique au taux dintrt la pente de la courbe LM sera assez forte et mme verticale la limite. En revanche, si la demande de monnaie des fins spculatives est peu sensible au taux dintrt, la pente de la courbe LM sera faible et mme horizontale la limite. Cest ce dernier cas, dit de trappe liquidit , qui nous intressera par la suite.
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
La courbe LM
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
3) L'quilibre de sous-emploi
Le taux d'intrt et le revenu d'quilibre sont donns par l'intersection des deux courbes. Cet quilibre du march des biens et services (IS) et du march montaire (LM) ne correspond pas ncessairement au plein emploi. En fait, il est mme peu probable qu'il corresponde spontanment au plein emploi. Il convient de revenir ici l'ide mentionne en introduction, selon laquelle lconomie est, selon les keynsiens orthodoxes, intrinsquement instable et sujette des chocs erratiques. Ces chocs proviennent principalement des variations de lefficacit marginale du capital qui rsultent elles-mmes dune modification de ltat desprit des chefs dentreprise (les esprits animaux de KEYNES). De ce fait, un point tel que E peut tre dplac sous l'effet de ces chocs et n'a aucune raison particulire d'tre au niveau de plein-emploi. Do lintrt de faire intervenir lEtat dans lconomie au moyen des deux politiques conjoncturelles principales qui sont : La politique budgtaire La politique montaire
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
C Les politiques conomiques dans le modle IS/LM 1) La politique budgtaire Il sagira en fait dune politique de relance de la demande globale par l'investissement autonome. Si l'Etat investit par exemple d'un montant M, la courbe IS sera dplace vers la droite (sans que le taux d'intrt soit modifi car il s'agit d'un investissement autonome). Le problme de la politique conomique se rsume donc choisir le niveau de M de telle sorte que l'on se rapproche le plus possible du plein emploi. Comme ces courbes ne sont pas connues des dcideurs (ce ne sont que des modles), on parle de pilotage budgtaire . 3 cas sont envisager : En supposant que la dpense autonome tombe juste , on pourra obtenir exactement le niveau de plein emploi. Sinon on pourra au moins sen rapprocher. Enfin, si les agents conomiques dpensent trop , il y a alors une consquence indsirable : linflation. Ces 3 cas sont illustrs par les figures ci-dessous.
Cas numro 1 : le pilotage optimal de la demande aboutit au plein emploi
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
Cas numro 2 : le pilotage de la demande a rapproch lconomie du plein emploi, mais sans atteindre le plein emploi
Cas numro 3 : lexcs de dpense autonome a conduit lconomie au-del du niveau de plein emploi et dclenche linflation (mais nanmoins il ny a plus de chmage)
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
2 ) La politique montaire On peut galement s'approcher du plein emploi par une politique montaire approprie. Par exemple, si les autorits montaires augmentent la quantit de monnaie disponible dans l'conomie d'un montant M, on obtiendra un quilibre E. On supposera ici pour simplifier que linjection de monnaie ralise exactement le plein emploi, mais en fait, on pourrait nouveau distinguer 3 cas comme pour le pilotage de la demande par la politique budgtaire. La ralisation du plein emploi grce une politique montaire expansionniste
ce niveau, la seule diffrence entre la politique montaire et la politique budgtaire est que la politique montaire expansionniste rduit le taux d'intrt d'quilibre alors que la politique budgtaire augmente le taux d'intrt d'quilibre. Toutefois ces rsultats simples dpendent dhypothses discutables en ce qui concerne les pentes respectives de courbes IS et LM et des points o elles entrent en intersection.
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
D Approfondissements et controverses 1) L'effet KEYNES a) Un retour automatique lquilibre est-il possible ? Revenons la situation initiale dans laquelle aucune politique nest mene et o lon est donc dans un quilibre de sous-emploi. Peut-on imaginer, comme le pensaient les classiques et les noclassiques, que lconomie puisse revenir delle-mme au plein emploi, sans aucune intervention ? Pour KEYNES, comme pour les keynsiens orthodoxes, le retour l'quilibre automatique est trop hypothtique pour que l'on sattende ce qu'il se produise. la suite dune crise, lconomie peut s'terniser dans le sous-emploi ou, ce qui revient au mme, mettre trs longtemps pour revenir spontanment au plein-emploi : " long terme, nous serons tous morts" crivait KEYNES ce sujet. La lenteur de lajustement conomique spontan ncessite l'intervention de l'Etat. On trouve cependant dans la "Thorie gnrale" une analyse du retour automatique l'quilibre et c'est ce que l'on a par la suite appel "l'effet KEYNES". b) En quoi consiste l'effet KEYNES ? Lorsque l'conomie est en sous-emploi, KEYNES admet que cela fait baisser les salaires nominaux (c'est--dire les salaires montaires) du fait de l'excs d'offre sur le march du travail. Il s'ensuivra une baisse des cots de production pour les entreprises qui seront dans la possibilit de baisser leur prix, et qui le feront si la concurrence est suffisamment vive. La baisse des prix se traduit par une revalorisation du stock de monnaie disponible (l'offre de monnaie) et donc cela quivaut, toutes choses gales par ailleurs, un dplacement vers la droite de la courbe LM3. Pour une courbe IS inchange, l'quilibre passe alors de E E'' et l'on atteint le plein emploi automatiquement, sans que l'Etat n'ait besoin d'intervenir dans l'conomie. A noter que limpact de la revalorisation du stock de monnaie affecte la demande globale via une baisse du taux dintrt (et sans que la courbe IS ne se dplace).
Il faut s'imaginer la quantit de monnaie disponible comme tant fixe un moment donn (elle peut augmenter, mais de faon exogne, par cration montaire par exemple). Cette quantit de monnaie permet d'acheter des biens et services. Donc si le niveau des prix de ces biens et services baisse, c'est comme s'il y avait plus de monnaie. Il y a quivalence entre l'augmentation relle de la quantit de monnaie et l'augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie du fait de la baisse des prix. Or comme l'augmentation relle de la quantit de monnaie dplace la courbe LM vers la droite (ceci est expliqu dans lencadr sur la courbe LM), il s'ensuit que l'augmentation du pouvoir d'achat dplace elle aussi la courbe LM vers la droite. "Revalorisation du stock de monnaie disponible" signifie augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie disponible". Si vous avez 50 euros et qu'un place de cinma cote 10 euros, vous pouvez inviter 4 amis (plus vous). Si le prix des places baisse 8 euros, vous pouvez inviter 5 amis (plus vous) et il vous reste en plus 2 euros. Donc, du fait de la baisse du prix des places, le pouvoir d'achat de votre billet de 50 euros a augment. En effet, si le prix des places n'avait pas baiss, il vous aurait fallu 60 euros pour inviter 5 amis (plus vous) et mme 62 euros, pour cadrer avec notre exemple. Donc la baisse du prix des places de ((10-8)/10)*100 = 20% a le mme effet que l'augmentation de la quantit de monnaie dans votre portefeuille de 50 62 euros. En thorie, cela conduit donc un dplacement vers la droite de la courbe LM. Pourquoi un dplacement ? Et pourquoi vers la droite ? Relisez lencadr sur la courbe LM.
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
L'effet KEYNES
Cependant, ce mcanisme de retour automatique l'quilibre se heurte au scepticisme de KEYNES et des keynsiens orthodoxes. S'il existe bel et bien, il met trop de temps se raliser, et entre temps, il faut grer le chmage. De plus, ainsi que KEYNES le prcise, ce mcanisme, outre sa lenteur, se heurte en pratique deux obstacles : la trappe liquidit Linsuffisante lasticit de l'investissement priv au taux d'intrt.
2) La trappe liquidit Pour KEYNES, l'lasticit de la demande spculative de monnaie par rapport au taux d'intrt devient infinie quand le taux d'intrt est trs bas. Par exemple, tant que le taux d'intrt est suprieur 3%, la demande de monnaie a une lasticit au taux d'intrt "normale". Ainsi, plus le taux d'intrt baisse, plus la demande de monnaie des fins spculatives est importante. Lorsque le taux dintrt est infrieur un certain seuil (3% selon KEYNES), les agents ne se soucient plus du cot dopportunit de la monnaie, ils pensent que le taux dintrt ne peut quaugmenter et en attendant ils gardent leurs encaisses montaires sous forme spculative.
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
La trappe liquidit peut empcher le retour au plein emploi via leffet KEYNES
Ceci signifie que la courbe LM est horizontale car une augmentation de revenu peut bien augmenter la demande des fins de transaction/prcaution, cette demande supplmentaire ne pourra pas tre satisfaite par une rduction des encaisses spculatives puisque celles-ci sont insensibles au taux dintrt (on rappelle que loffre de monnaie totale est suppose constante). Cette situation de bas taux dintrt est dautant plus plausible que lconomie connat un marasme et donc que le revenu est faible. Il est donc probable qu partir dun certain niveau de revenu, le taux dintrt se remette croitre avec le revenu. On a alors nouveau une courbe LM qui crot normalement. Graphiquement, cela signifie que si la courbe IS croise la courbe LM dans sa partie horizontale, l'accroissement de la quantit de monnaie (que ce soit du fait d'une politique montaire ou, comme ici, du fait de la revalorisation du stock de monnaie lie la baisse des prix [elle-mme cause par la baisse des cots salariaux]) n'a aucun effet sur le niveau d'quilibre du revenu et ne peut donc pas ramener l'conomie vers le plein emploi. En dautres termes, l'effet KEYNES ne peut pas jouer du fait de la trappe liquidit (lasticit infinie de la demande de monnaie au taux d'intrt lorsque celui-ci devient trs bas)4.
4 Sur l'actualit de la trappe liquidit dans le cas du Japon en 1999, lire l'article de Paul KRUGMAN : Thinking about the liquidity trap , http://web.mit.edu/krugman/www/trioshrt.html .
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
3) L'inlasticit de l'investissement au taux d'intrt On retrouve aussi le scepticisme keynsien s'agissant des influences qui s'exercent sur l'investissement. Les keynsiens orthodoxes admettent bien une relation ngative entre l'investissement priv et le taux d'intrt montaire, mais ils pensent que cette relation est peu lastique, voire peut-tre inexistante dans certains cas. Ds lors, si l'investissement ne ragit pas aux variations du taux d'intrt, la courbe IS est verticale. De ce fait, l'effet KEYNES qui joue travers la revalorisation de l'offre de monnaie, n'a pas d'impact sur le niveau du revenu et ne permet pas le retour au plein-emploi en cas d'quilibre initial situ un niveau de sous-emploi. L'inlasticit de l'investissement au taux d'intrt peut empcher le retour automatique au plein emploi via leffet KEYNES
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
4) L'effet PIGOU Pour les no-classiques, la trappe liquidit et linlasticit de linvestissement au taux dintrt ne sont cependant pas le fin mot de l'histoire du retour l'ajustement automatique. En effet, selon PIGOU (1877-1959), le contemporain de KEYNES et comme lui lve d'Alfred MARSHALL, le retour automatique lquilibre (sans intervention de lEtat via une politique montaire ou budgtaire), est possible mme si : l'conomie est dans la trappe liquidit (LM horizontale) et/ou si linvestissement priv est inlastique au taux dintrt (IS verticale)
Cest L'effet PIGOU ou "effet d'encaisses relles"5, dj voqu propos de la contribution de PIGOU ldifice no-classique. L'effet PIGOU repose sur l'observation que la baisse des prix (lie au marasme de la demande) a aussi un effet sur les encaisses montaires prives (ou "encaisses relles ) qu'elle revalorise. Ds lors, la consommation augmente, ce qui a pour effet d'engendrer un dplacement autonome de la courbe IS vers la droite, ce qui peut permettre un retour au plein emploi, mme quand la courbe IS croise au dpart LM dans sa partie horizontale (trappe liquidit) et que la courbe IS est verticale (inlasticit de linvestissement au taux dintrt). Il est important de noter que la seule diffrence entre leffet KEYNES et leffet PIGOU rside dans le fait que leffet KEYNES dplace la courbe LM vers la droite alors que leffet PIGOU dplace la courbe IS vers la droite. Donc comprenne qui pourra ! L'effet PIGOU (effet d'encaisses relles)
Leffet PIGOU est aussi souvent appel effet PIGOU-PATINKIN et mme effet FISHER, quoique dautres conomistes en ait aussi voqu la possibilit, tels que de SCITOVSKI (1941), HABERLER (1946). La contribution de PATINKIN, date de 1965, et est gnralement considre comme majeure. Voir PATINKIN, Don. Money, Interest, and Prices 2nd ed. New York: Harper and Row, 1965. Don PATINKIN (1922-1995) est un conomiste amricain, spcialiste de thorie montaire et auteur, notamment, de deux livres sur John Maynard KEYNES. Il fut professeur l'Universit de Chicago puis l'universit hbraque de Jrusalem. En savoir plus sur Wikipdia : http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Patinkin
Thmes d'histoire des ides conomiques : Le modle IS-LM
La controverse sur la possibilit dun retour automatique lquilibre dans un contexte dquilibre de sous-emploi ne fut jamais tranche, chacun acceptant les arguments thoriques de lautre, mais se retranchant derrire la force respective des effets en jeu pour pencher lun en faveur de limpossibilit dun retour automatique lquilibre dans un temps raisonnable (KEYNES) et lautre au contraire en faveur de la possibilit dun retour automatique lquilibre de plein emploi quel que soit le temps ncessaire (PIGOU). Les faits ont cependant donn raison KEYNES et ceci doublement. Dune part parce que le retour automatique lquilibre suppos ne sest jamais produit et ensuite parce que tous les gouvernements se sont empresss de sappuyer sur les prconisations de KEYNES pour piloter leurs conomies au moyen des politiques budgtaires et montaires. La controverse allait alors se dplacer sur la question de lefficacit relative de ces deux politiques et opposer cette fois keynsiens orthodoxes (HICKS, TOBIN, entre autres) et montaristes (FRIEDMAN, encore que celui-ci ait finalement rcus lutilisation du schma IS-LM pour rgler les diffrents thoriques, soulignant que celui-ci tait de toute faon construit sur des hypothses contestables la base, notamment sagissant de la fonction de consommation, voir plus loin la thorie du revenu permanent propose par FRIEDMAN comme alternative). 5) La controverse sur l'efficacit respective des politiques montaire et budgtaire Ainsi, l'une des grandes controverses de la fin des annes 1960, qui allait opposer les keynsiens orthodoxes comme James TOBIN (prix Nobel d'conomie en 1981, form Harvard, puis professeur l'universit de Yale) aux montaristes comme Milton FRIEDMAN, fut-elle de savoir laquelle des deux politiques, budgtaire ou montaire, serait la plus efficace pour piloter l'conomie amricaine au plein emploi (les conomies des autres pays tels que la Royaume-Uni, lAllemagne ou la France sessayant avec plus ou moins de retard et de succs mimer les dbats quils observaient outreAtlantique)6. La politique budgtaire tait gnralement prfre par les keynsiens orthodoxes la politique montaire, parce que les effets des mesures de politique budgtaire taient considrs comme plus directs, plus prvisibles et plus rapides que ceux de la politique montaire. Nous allons maintenant voir comment ces conceptions ont t justifies dans le cadre du modle IS-LM. a) Linefficacit de la politique montaire pour les keynsiens orthodoxes Pour les keynsiens orthodoxes, la politique montaire tait inefficace soit cause de la trappe liquidit (dont nous ne parlerons plus ici car le sujet ntait plus dactualit dans les annes 1950 et 1960)7, soit parce que l'investissement est inlastique aux variations du taux d'intrt et donc parce que la courbe IS est verticale ou trs pentue (cest le cas que nous retiendrons ici). On a ainsi le mme schma que celui dcrit dans un graphique prcdent. La seule diffrence est que le dplacement de LM n'est pas caus par la baisse des prix, mais par l'augmentation de l'offre de monnaie (politique montaire). Le rsultat est cependant loquent : la politique montaire expansionniste n'a aucun impact sur l'activit. Ou alors, son impact est trop faible car la courbe IS est trop inlastique. Par contre la politique budgtaire un impact maximum (faire lexprience de dplacer IS vers la droite la place de LM).
Do le grotesque de certains cours dconomie que lon pouvait suivre dans les annes 1970 en France, cours qui se donnaient doctement comme tant de la plus vive actualit, alors quils se rfraient en fait des dbats ayant eu lieu dans les annes 1960 aux Etats-Unis. 7 La trappe liquidit est cependant revenue au cur de lactualit dans le contexte du marasme de lconomie japonaise des annes 1990, ainsi que nous lavons dj indiqu en suggrant de lire l'article de Paul KRUGMAN : Thinking about the liquidity trap .
Thmes d'histoire des ides conomiques : Les no-keynsiens
La controverse sur l'efficacit respective des politiques montaire et budgtaire
15
www.economie-cours.fr
Thmes d'histoire des ides conomiques : Les no-keynsiens
b) Linefficacit de la politique budgtaire pour les montaristes Pour les montaristes, c'est l'inverse : ce n'est pas l'investissement qui est inlastique au taux d'intrt, c'est la demande de monnaie. Il s'ensuit que c'est la courbe LM qui est verticale. Ds lors, c'est la politique budgtaire qui n'a aucun effet sur l'activit. Elle ne fait qu'augmenter le taux d'intrt, ce qui dcourage l'investissement priv (c'est l'effet d'viction). Par contre, la politique montaire a un impact maximum (faire lexprience de dplacer LM vers la droite la place de IS quand IS est verticale ou voir le schma prsent plus loin). 6 ) La courbe de PHILLIPS et l'inflation par les cots La courbe (ou relation) de PHILLIPS traite de la relation entre linflation et le chmage, lune des plus fameuses et des plus controverses de la macroconomie. Elle rsulte dune tude statistique, faite par lconomiste no-zlandais Alban William PHILLIPS (1958), de la relation entre le niveau du chmage et le taux de variation des salaires nominaux, au Royaume-Uni, au cours de la priode 1861-1957. Comme lillustre le graphique ci-aprs, la relation quil a trouve est non linaire et inverse. Pour un niveau de chmage denviron 5,5 %, le taux de variation des salaires nominaux tait gal 0 %, tandis que lorsque le niveau de chmage tait gal 2,5 %, le taux de variation des salaires nominaux tait denviron 2,0 %. la suite du travail novateur de A. W. PHILLIPS, l'ide s'est dveloppe chez les keynsiens qu'il existait une relation inverse entre l'inflation et le chmage8. Dans le cadre du modle ISLM, les variations de la demande globale affectent le niveau rel de revenu et lemploi, tant que le pleinemploi nest pas atteint. Jusqu ce que le plein-emploi soit atteint, les salaires nominaux sont supposs insensibles aux variations de la demande globale. La courbe de PHILLIPS permet de relier la thorie keynsienne orthodoxe de la production et de lemploi une thorie des salaires et de linflation, par l'intermdiaire de la thorie de l'inflation par les cots. L'inflation par les cots c'est tout bonnement l'ide que les prix sont fixs en ajoutant une marge de profit au cot de production. Donc quand les salaires augmentent, les prix augmentent aussi. Par consquent, sur la figure ci-dessous, le taux de croissance des salaires a t remplac par celui des prix, ce qui fait de la courbe de PHILLIPS une relation inverse entre l'inflation et les salaires9.
Larticle de PHILLIPS fut publi en 1958 dans la revue Economica et sintitulait "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957". 9 Le premier avoir remplac le taux de croissance des salaires par le taux dinflation dans la relation de PHILLIPS fut lconomiste amricain Richard LIPSEY en 1960, dans un article publi dans Economica et intitul "The Relation Bewteen Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1862-1957: A further analysis". Par la suite, Paul SAMUELSON et Robert SOLOW ont dvelopp la notion darbitrage entre inflation et chmage.
16
www.economie-cours.fr
Thmes d'histoire des ides conomiques : Les no-keynsiens
La courbe dcouverte par A. W. PHILLIPS
La relation inflation-chmage qui se dduit de la courbe de PHILLIPS
Cette courbe a connu un grand succs car elle semblait indiquer que l'on pouvait rduire le chmage en acceptant un peu plus d'inflation et, rciproquement, qu'on ne pouvait rduire l'inflation qu'au prix d'une augmentation du chmage. Retour l'index thmatique
17
www.economie-cours.fr
Vous aimerez peut-être aussi
- Daniel COHEN Richesse Du Monde Pauvretés Des Nations PDFDocument18 pagesDaniel COHEN Richesse Du Monde Pauvretés Des Nations PDFHamza ZinbiPas encore d'évaluation
- Corrigé 7,8 Et 9Document10 pagesCorrigé 7,8 Et 9Youssef Ý'đPas encore d'évaluation
- Résumé Éco MonétaireDocument8 pagesRésumé Éco MonétaireIdrissBouâliPas encore d'évaluation
- Emf II - Résumé (Ch1, Ch2, Ch3)Document12 pagesEmf II - Résumé (Ch1, Ch2, Ch3)OmàrZiràriPas encore d'évaluation
- L'Inflation & Chomage (Chap2-3)Document45 pagesL'Inflation & Chomage (Chap2-3)El Hanafi MohamedPas encore d'évaluation
- Resume Modele IS-LMDocument4 pagesResume Modele IS-LMJean LotusPas encore d'évaluation
- Macro Le Modele Is LMDocument12 pagesMacro Le Modele Is LMEtienne Dos SantosPas encore d'évaluation
- CHAPITRE Modele IslmDocument12 pagesCHAPITRE Modele IslmChristian NdongPas encore d'évaluation
- Série TD EMF S3 2021 - EtudiantsDocument7 pagesSérie TD EMF S3 2021 - EtudiantsabdellahotPas encore d'évaluation
- Economie MonétaireDocument4 pagesEconomie MonétaireSalah El MasoudiPas encore d'évaluation
- Cours D'économie MonétaireDocument359 pagesCours D'économie MonétaireReda NayjibPas encore d'évaluation
- La Politique Monetaire Resume de Cours 2Document4 pagesLa Politique Monetaire Resume de Cours 2Bennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- Support de Cours EcoMon&Fin - S4Document86 pagesSupport de Cours EcoMon&Fin - S4Sa MiaPas encore d'évaluation
- Resume Eco MonetaireDocument5 pagesResume Eco MonetaireHEROPas encore d'évaluation
- Résumé Du Cours de L'économie Monétaire Chapitre 3Document9 pagesRésumé Du Cours de L'économie Monétaire Chapitre 3mahjouba zaaoitPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - L'Approche KeynésienneDocument5 pagesChapitre 2 - L'Approche KeynésienneCours d'EconomiePas encore d'évaluation
- Correction de La Série 1 Économie MonétaireDocument5 pagesCorrection de La Série 1 Économie Monétaireboutaina benghezalPas encore d'évaluation
- La Demande de La MonnaieDocument27 pagesLa Demande de La MonnaieAbdou ElkabirPas encore d'évaluation
- Economie Monétaire S3 BenhrimidaDocument8 pagesEconomie Monétaire S3 BenhrimidazinebPas encore d'évaluation
- Questions Déconomie Monétaire Et Financière s3Document4 pagesQuestions Déconomie Monétaire Et Financière s3قناة خديجة المكناسيةPas encore d'évaluation
- Politique MonétaireDocument11 pagesPolitique Monétaireboutaina nina100% (1)
- La Demande de La MonnaieDocument27 pagesLa Demande de La MonnaieAbdou ElkabirPas encore d'évaluation
- Exercice Taux de Change FinanceDocument6 pagesExercice Taux de Change FinancehichamPas encore d'évaluation
- S2 - SEG - ANNÉE 2017-2018 SERIE 2 de Macro-Économie: Chapitre Les Fonctions de La Consommation Et de L'épargne. CorrectionDocument5 pagesS2 - SEG - ANNÉE 2017-2018 SERIE 2 de Macro-Économie: Chapitre Les Fonctions de La Consommation Et de L'épargne. CorrectionYasmine FahssiPas encore d'évaluation
- TD 3 MF Corrigé WDocument15 pagesTD 3 MF Corrigé WDima SaadPas encore d'évaluation
- TD 5Document2 pagesTD 5Abdelkaber abdelkaberPas encore d'évaluation
- Examen MacroéconomieDocument1 pageExamen MacroéconomieAdil BentalebPas encore d'évaluation
- MonnaieDocument40 pagesMonnaieBlegnoua Alexandre David100% (1)
- Création MonétaireDocument15 pagesCréation MonétairebernadinPas encore d'évaluation
- Examen Economie MonetaireDocument16 pagesExamen Economie MonetaireAsmae OuahidiPas encore d'évaluation
- Chap 1 Fonction de Demande de MonnaieDocument8 pagesChap 1 Fonction de Demande de MonnaieDouanguim LitisiaPas encore d'évaluation
- IS LM CoursDocument9 pagesIS LM CoursJiddou Medlaghdhef100% (2)
- Cours de Comptabilité Nationale Economie & Gestion Complet Et Exclusif Pr. F. ZAARAOUIDocument63 pagesCours de Comptabilité Nationale Economie & Gestion Complet Et Exclusif Pr. F. ZAARAOUIali0% (1)
- Economie Monétaire S4 Omar BELKHEIRI (Fsjes-Tanger - Com)Document29 pagesEconomie Monétaire S4 Omar BELKHEIRI (Fsjes-Tanger - Com)Ismail El AlamiPas encore d'évaluation
- TD #11 - La Création Monétaire - 1ere - 2010-2011 - PDFDocument8 pagesTD #11 - La Création Monétaire - 1ere - 2010-2011 - PDFAnonymous T47rCfwwPas encore d'évaluation
- Is LMDocument19 pagesIs LMB.IPas encore d'évaluation
- 1 Les Motifs de Détention de La Monnaie Pour Néoclassique Et Chez Key1Document1 page1 Les Motifs de Détention de La Monnaie Pour Néoclassique Et Chez Key1Najoua ChahbounePas encore d'évaluation
- Chapitre IIDocument6 pagesChapitre IIAyoub FakirPas encore d'évaluation
- Consommation 2nd PartieDocument6 pagesConsommation 2nd PartieBennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- Politique Économique Et Monétaire 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion Et ComptabilitéDocument5 pagesPolitique Économique Et Monétaire 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion Et ComptabilitéMohamed Zoubair100% (1)
- S4 Cours D - Économie Monétaire 2Document10 pagesS4 Cours D - Économie Monétaire 2Houssam Aouragh100% (2)
- Chapitre 3 - Les Grands Courants de La Pensée Économique - Partie 1Document22 pagesChapitre 3 - Les Grands Courants de La Pensée Économique - Partie 1Sif Fatima ezzahra100% (1)
- TD Cout Complet Louis Le Grand PDF - 211117 - 144902Document14 pagesTD Cout Complet Louis Le Grand PDF - 211117 - 144902YOBOUEPas encore d'évaluation
- Partie I 3 Les Options Stratégiques 2Document8 pagesPartie I 3 Les Options Stratégiques 2Rany ASPas encore d'évaluation
- Chap-5 Revenu National D'équilibreDocument9 pagesChap-5 Revenu National D'équilibreKouakou Jean eliezer100% (1)
- Correction de La Série 2 Économie MonétaireDocument7 pagesCorrection de La Série 2 Économie Monétaireboutaina benghezalPas encore d'évaluation
- La Théorie Des Marchés Contestables 4Document19 pagesLa Théorie Des Marchés Contestables 4Salma SaadanePas encore d'évaluation
- Le Circuit ÉconomiqueDocument5 pagesLe Circuit ÉconomiquelomanaPas encore d'évaluation
- Corrige Exam Emi l3 Eco - Session 1 2019-2020Document2 pagesCorrige Exam Emi l3 Eco - Session 1 2019-2020GuillaumeKouassi100% (1)
- Cours Economie Monétaire - S3 - Benhrimida - 1Document8 pagesCours Economie Monétaire - S3 - Benhrimida - 1douniaPas encore d'évaluation
- Le Modèle de La Concurrence Pure Et ParfaiteDocument29 pagesLe Modèle de La Concurrence Pure Et ParfaiteIve DiaganaPas encore d'évaluation
- Cours Economie MonétaireDocument75 pagesCours Economie MonétaireRima Rim0% (1)
- TD MonnaieDocument27 pagesTD MonnaieGangster marocianPas encore d'évaluation
- 1-1. Les Fondements de La Politique EconomiqueDocument3 pages1-1. Les Fondements de La Politique EconomiquePaulMartyPas encore d'évaluation
- 3ème Partie Les Échanges Extérieurs 2 Louverture de Léconomie 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion PDFDocument8 pages3ème Partie Les Échanges Extérieurs 2 Louverture de Léconomie 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion PDFAbdèlàzizPas encore d'évaluation
- Résumé Économie MonétaireDocument8 pagesRésumé Économie MonétaireDOUNIA EL MALLAHIPas encore d'évaluation
- Comptabilité Générale Séance 2 Du 22 FévrierDocument21 pagesComptabilité Générale Séance 2 Du 22 FévrierBASMA AMIMAR100% (1)
- Serie D'Exercices Ses N°7, 8 & 9: I. Troc Et MonnaieDocument3 pagesSerie D'Exercices Ses N°7, 8 & 9: I. Troc Et MonnaieIsrael Djegue100% (1)
- Devoir Surveillé N° 1 2010 2011 Enoncé ConvertiDocument4 pagesDevoir Surveillé N° 1 2010 2011 Enoncé ConvertiSaad JamaaPas encore d'évaluation
- Economie 2016 08Document43 pagesEconomie 2016 08oussamaPas encore d'évaluation
- Dossier Phillips JoDocument9 pagesDossier Phillips JoOlivier SilverPas encore d'évaluation
- Ebf Suite OrdiDocument4 pagesEbf Suite OrdiNahil MenniPas encore d'évaluation
- L'équilibre Chomage Inflatio Budg Fis ChanDocument20 pagesL'équilibre Chomage Inflatio Budg Fis Chanchaymaa.rami07Pas encore d'évaluation
- Chapitre 3 La Courbe de PhillipsDocument7 pagesChapitre 3 La Courbe de Phillipsصالح بن نصر100% (2)
- Inflation Et ChomageDocument31 pagesInflation Et ChomageHafssa BENDRISS100% (2)
- Fiche 6 - Coût Du Travail Et ChômageDocument4 pagesFiche 6 - Coût Du Travail Et ChômageMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Economie Generale Premiere AnneeDocument65 pagesEconomie Generale Premiere AnneeAndriambololosoa Hyacinthe TOVONIAINAPas encore d'évaluation
- (PE) Politique MonétaireDocument12 pages(PE) Politique MonétaireGaliPas encore d'évaluation
- UIPA Cours Analyse Macro Approfondie - M2 EcoDev UIPA 2021-2022Document42 pagesUIPA Cours Analyse Macro Approfondie - M2 EcoDev UIPA 2021-2022Aimé ZezePas encore d'évaluation
- AndriamamenosoaFidy ECO Lic 19Document49 pagesAndriamamenosoaFidy ECO Lic 19eltifiPas encore d'évaluation
- Cycles Et Crises Économiques, Cours de PrépaDocument26 pagesCycles Et Crises Économiques, Cours de PrépaBourhan KayalPas encore d'évaluation
- CHOMAGE CoursDocument15 pagesCHOMAGE CoursBennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- MacroFinInter Chap 1a 25:09Document79 pagesMacroFinInter Chap 1a 25:09jules quessettePas encore d'évaluation
- Résumé de La Théorie Économique Contemporaine - PDF PDF Inflation Offre Et DemandeDocument1 pageRésumé de La Théorie Économique Contemporaine - PDF PDF Inflation Offre Et DemandekhraisssihamePas encore d'évaluation
- Le Modèle IS-LM-2Document8 pagesLe Modèle IS-LM-2Safae BouhmidPas encore d'évaluation
- Politique Économique Du DéveloppementDocument220 pagesPolitique Économique Du DéveloppementBoubacar TemePas encore d'évaluation
- Chapitre 1 IntroductionDocument100 pagesChapitre 1 IntroductionLivredeluxePas encore d'évaluation
- QCM Problemes Economie SocialeDocument2 pagesQCM Problemes Economie Socialemalaga0489% (18)
- Fiche de Lecture La Pensee Eco Depuis KeynesDocument13 pagesFiche de Lecture La Pensee Eco Depuis KeyneskrikiPas encore d'évaluation
- 4 Chap 02 Politique Monétaire Objectifs Et InstrumentsDocument26 pages4 Chap 02 Politique Monétaire Objectifs Et InstrumentsrassouakPas encore d'évaluation
- Serie3 Corr-04Document6 pagesSerie3 Corr-04Yosra BaazizPas encore d'évaluation
- C. Théorie Keynésienne Et Économie de Loffre2Document41 pagesC. Théorie Keynésienne Et Économie de Loffre2GuillaumeKouassi100% (3)
- Veritable COURS DE MACROECONOMIE ISS 2020Document21 pagesVeritable COURS DE MACROECONOMIE ISS 2020Désiré Tshibangu Kabuya100% (2)
- Exercice PDFDocument6 pagesExercice PDFYosra BaazizPas encore d'évaluation
- Chômage Et Inflation: Vérification de La Courbe de Phillips en République Démocratique Du CongoDocument6 pagesChômage Et Inflation: Vérification de La Courbe de Phillips en République Démocratique Du Congowilsonmaka010Pas encore d'évaluation
- BEAC Working Paper 05 15Document30 pagesBEAC Working Paper 05 15Eddy merffi kimpoloPas encore d'évaluation
- Économie de L - Emploi - Partie 1Document39 pagesÉconomie de L - Emploi - Partie 1Redmi PhonePas encore d'évaluation