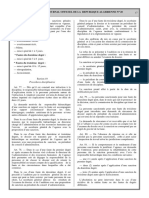Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
LEFORT, Claude. Réflexions Sociologiques Sur Machiavel Et Marx
Transféré par
Gabriel VecchiettiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
LEFORT, Claude. Réflexions Sociologiques Sur Machiavel Et Marx
Transféré par
Gabriel VecchiettiDroits d'auteur :
Formats disponibles
RÉFLEXIONS SOCIOLOGIQUES SUR MACHIAVEL ET MARX : LA POLITIQUE ET LE RÉEL
Author(s): Claude Lefort
Source: Cahiers Internationaux de Sociologie , Janvier-Juin 1960, NOUVELLE SÉRIE, Vol.
28 (Janvier-Juin 1960), pp. 113-135
Published by: Presses Universitaires de France
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40689087
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Cahiers Internationaux de Sociologie
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
ÉTUDES CRITIQUES
RÉFLEXIONS SOCIOLOGIQUES SUR MACHIAVEL ET MARX :
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
par Claude Lefort
A la question : « qu'est-ce que le réalisme en politique », formulée
par certains écrivains du passé, fait écho cette autre, sans laquelle
la première n'aurait pu être sérieusement posée, ni ne serait encore
entendue de nous : « qu'est-ce que le réel ? » C'est pour l'avoir affron-
tée, sans se laisser entièrement divertir par l'objet de ses préférences
qu'une théorie politique si liée soit-elle à une pratique, a pu acquérir
une portée universelle, devenir la propriété commune, inaliénable,
d'hommes vivant dans des temps nouveaux, occupés à des tâches
spécifiques, dont le milieu social actuel paraît détenir l'origine et le
sens. Sans doute, le sociologue est-il destiné par vocation à entendre
mieux que tout autre, cette question, à reconnaître la légitimité
d'une réflexion, qui, pour s'exercer dans le cadre particulier d'une
société et d'une époque, n'en a pas moins le pouvoir de traverser
l'épaisseur temporelle d'une expérience singulière et de circons-
crire par ce mouvement même le champ d'une expérience accessible
à tous. S'il y parvient, c'est à la condition, toutefois, de s'interdire
de convertir la pensée d'autrui en phénomène : tentation à laquelle
cèdent également un empirisme relativiste, satisfait de décomposer
la vie sociale en éléments et de les ranger chacun à sa place comme
si la classification avait quelque affinité secrète avec le savoir;
un historicisme dogmatique auquel le mythe d'un élargissement
progressif de la compréhension sert d'assurance contre la vérité ; ou
encore un pseudo-criticisme, qui a trouvé refuge dans l'idée d'un
dialogue inépuisable entre le présent et le passé, où le passé privé
de son être et de son droit à la vérité n'offre plus que la matière
complaisante d'une reconstruction indéfiniment arbitraire. La
tentative de situer une œuvre culturelle dans un milieu social et
historique n'acquiert un sens que parce que le sociologue veut lui
rendre la parole ; si les propositions énoncées et l'exercice même de
la pensée s'éclairent par la référence à un monde qui fut celui
de l'écrivain, cette lumière souligne encore la présence de l'œuvre,
rend sensible à l'exigence de connaissance qui était à son origine
et que nous ne pouvons que reprendre à notre propre compte pour
- 113 -
rtAwrenfl INTBBN. DB SOCIOLOGIE 8
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
la comprendre. Le monde que l'écrivain a cherché à connaît
pouvons bien, grâce aux moyens d'investigation dont nou
sons, et en vertu de la position privilégiée que confère le p
le reconstituer comme le cadre d'une expérience sociale défini
donne un accès à son œuvre, il n'en reste pas moins vrai qu'au
que nous visons celle-ci, nous sommes induits par elle à vi
objet, à participer de son interrogation - à la recherche comm
auteur, bien qu'autrement que lui, d'une intelligibilité qu
détermination particulière ne saurait épuiser. Dans un tel
sement de perspective, le critique ne trouve pas seulemen
sion de multiplier des corrélations entre l'œuvre et le m
découvre simultanément que ni Tune ni l'autre ne sont c
apparaissent d'abord au regard de la conscience naïve press
identifier : l'œuvre n'est ni image, ni expression, ni somme ou
système d'idées (ou du moins ne l'est-elle pas en tant qu'elle est
vue œuvre), ni quoi que ce soit dont nous puissions trouver la clé,
à partir d'un ensemble de données de fait distinct, dont nous
puissions faire l'inventaire ; elle n'existe que dans la forme d'un
travail et par la vertu d'une intention dont le mobile est celui-là
même qui détermine l'activité du sociologue : l'insertion dans
un être avéré du monde ; pas davantage, le milieu social ne se
réduit-il à la série des termes dont l'agencement décrit, selon des
plans différents d'incidence économique, politique ou culturel, des
modes de relations définies, auquels pourrait être attribué un
coefficient de réalité et d'efficacité ; il est, en tant que milieu spé-
cifique des hommes d'une époque, avènement de la société comme
telle, en tant que théâtre d'une socialisation déterminée, celui de
la socialisation humaine. A peine convient-il de parler, à ce sujet,
d'une découverte, car tel est bien 16 sentiment immédiat de tout
homme qui, dans les conditions singulières que lui compose le
présent historique, ne peut jamais manquer de se fonder sur un
aulre présent - si sensible soit-il à ce qui advient hic et nunc, et
convaincu que sa propre existence, dans toutes les modalités, de
l'assomption à la consomption, est matière de l'histoire de son
temps - présent de toute société, que l'imagination d'un avenir
conçu dans l'aversion qu'inspire l'ordre de fait, ne peut même
déposséder de son être, tant il appert que toute anticipation, comme
toute remémoration, comme toute aperception empirique s'effectue
dans un cadre d'existence sociale indéterminée d'où elle tire sa
légitimité, que toute appréhension d'un monde historique - notre
monde ou le monde des autres hommes - renvoie à une expérience
de l'histoire qui n'est pas elle-même dans l'histoire. Et, de manière
analogue, tel est encore le sentiment immédiat de quiconque lit
une œuvre du passé, parcourant le temps dans les deux sens à la
fois, 8'établissant dans le lieu d'où parle l'écrivain, se donnant pour
objet son objet, et l'attirant à soi pour le situer dans les horizons dû
monde actuel, instituant ainsi une dimension nouvelle de la présence
où la pensée transcende tout ordre fini de signifiant ou de signifié.
Dans sa recherche, le sociologue ne peut que convertir ce senti-
ment en idée. Gomment s'aliénerait-il dans les représentations et
- 114 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
les définitions qu'il élabore quand il vérifie sur son exemple la
structure paradoxale de l'expérience sociale - plus attentif que
tout autre aux conditions singulières de sa connaissance et trouvant
dans cet état le motif d'une interrogation infinie ; comment consen-
tirait-il à réduire une œuvre du passé à quelque image pour y
repérer la trace d'un déterminisme extrinsèque, quand il doit
reconnaître que son propre travail est reprise et prolongement de
celui de ses devanciers, destiné lui-même à devenir objet d'une
appropriation, inscrit donc, tant par son origine que par ses effets,
dans un processus de socialisation, mais attestant que chaque
moment y figure un recommencement et y conserve un pouvoir
qui survit à la dissolution de toute détermination particulière.
Non seulement l'œuvre de caractère politique, notamment celle
d'intention réaliste, rend sensible à cette exigence, mais elle porte
en elle la mise en demeure la plus pressante. L'écrivain a voulu
observer le monde, voir les choses telles qu'elles sont, découvrir
les motifs en vertu desquels agissent les individus et les groupes,
et les causes qui expliquent le devenir des sociétés, et, de cette
connaissance, tirer les principes d'une action efficace. Ainsi nous
confronte-t-il à une entreprise à laquelle nous ne saurions feindre
de prêter une attention désintéressée. Alors même que nous conser-
vons la faculté de suspendre notre jugement, en regard de telle
ou telle de ses thèses, notre interprétation fait cependant paraître
une attitude théorique et un parti pratique, qui annonce la rencontre
nécessaire de notre pensée avec la sienne. La tâche de comprendre
ce qu'il a voulu dire appelle la question de savoir si ce qu'il a dit
est vrai ou non. Et, sans doute, son langage incite-t-il à se délivrer
du poids de cette question ; puisqu'il parle de son temps, puisque
sa pensée se meut apparemment dans les horizons d'un monde qui
n'est pas le nôtre, puisque sa connaissance des choses fonde l'idée
d'une intervention dans le réel qui ne peut être entièrement
conservée, la tentation est plus forte à son sujet qu'à l'égard de
tout autre de renvoyer son réalisme aux conditions d'une époque,
d'exploiter cette évidence que la théorie politique est de toutes les
expressions idéologiques la plus directement reliée à un cadre
social déterminé. Mais la question retrouvée, aussitôt que nous
prenons conscience de notre position propre à l'égard de l'œuvre du
passé et du monde présent, en acquiert une portée d'autant plus
sensible. Qu'est-ce qui, dans l'œuvre de caractère politique, en
dépit de ce qu'elle naît dans les frontières d'une société et qu'elle
approche celle-ci sous les traits particuliers que lui compose un
état de la production, des institutions et de la culture, fraie une
voie d'accès à la réalité ?
* *
C'est par quelques réflexions sur l'œuvre de Machiave
Marx - éloignées dans le temps, nées dans un milieu
rent, hantées par des problèmes politiques spécifiq
points de départ et d'aboutissement ne sont pas su
- 115 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LEFORT
que nous nous proposons de repérer cette voie. La confro
a cet avantage, qu'en nous constituant comme troisième te
elle souligne en permanence, dans la relation au passé, la
critique qui nous est réservée : le chemin de l'identificati
souvent emprunté sous le couvert d'une restitution de l'é
« en personne », est coupé quand il s'avère qu'une même a
est requise à l'égard de deux objets apparemment irréducti
à l'autre. Puisque nous ne pouvons reprendre entièrement
compte à la fois l'enseignement de Machiavel et celui de M
conscients de leur mutuelle contestation, ni non plus trouver
dans une neutralité à l'égard des deux où ne manquerait pas de
s'abîmer notre intention de connaissance, ni davantage réduire
l'un à l'état de simple phénomène sans compromettre le statut de
l'autre, ces interdits nous pressent de chercher, au delà d'une
comparaison entre des idées, dont certaines seraient à prendre et
d'autres à laisser, un ordre de communication tel que les divergences
composent dans notre réflexion une problématique de la réalité.
Confronter l'œuvre de Machiavel et celle de Marx est suggéré
par cette observation que l'une et l'autre ont été habitées par une
même passion réaliste. Par ce terme, nous voulons d'abord dési-
gner, selon l'usage commun, un mode d'action qui prétend répondre
à des mobiles et se subordonner à des fins, dont l'observation
montre qu'ils sont effeclivemeni les mobiles et les fins d'une humanité
empirique. Sans doute le réalisme ne contient-il pas la détermina-
tion d'une politique à l'exclusion de toute autre, puisque l'action
est relative à des conditions historiques toujours singulières, et
que dans le cadre d'une société et d'une époque, la diversité des
intérêts auxquels sont attachés les individus et les groupes lui
crée plusieurs champs d'application possibles ; il n'en demeure pas
moins vrai que le réalisme ne mériterait pas son nom, s'il se rédui-
sait au seul agencement de certains moyens d'adaptation à la
réalité, indifférent à l'inspiration qui le gouverne. Le réalisme
récuse l'utopie, encore qu'il soit évident qu'une utopie puisse
eile-même donner lieu à un examen attentif des conditions de fait,
si elle veut animer une politique. A l'exigence de tenir compte de
telles conditions, il ajoute la volonté d'y reconnaître l'origine d'une
nécessité pratique, tant il est certain qu'elles circonscrivent une
ou plusieurs conduites, les frontières d'un système de réalité au
delà desquelles l'arbitraire du désir, pour avoir encore à se régler
sur certaines propriétés de l'objet, n'en condamne pas moins
irrémédiablement le sujet à perdre le contrôle de ses opérations.
Le réalisme de Machiavel, comme celui de Marx, est soutenu par
l'idée que la réalité empirique, telle que la compose l'histoire des
hommes, est entièrement accessible à la connaissance, et que celle-ci
y découvre le fondement de l'action adéquate. Ce qui constitue
l'originalité commune de leur démarche, c'est qu'ils partent l'un
et l'autre de la certitude que le réel est ce qu'il est, et que d'une
certaine manière il n'y a rien à y changer, et qu'ils en induisent
cependant une tâche pratique : paradoxe délibérément affronté
et apparemment résolu dans la pensée que cette tâche est elle-
- 116 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
même inscrite dans la réalité empirique, soit peu à peu composée
au cours d'une histoire cumulative, jusqu'à l'étape où sa définition
devient évidente, soit toujours présente et toujours exposée au
hasard de l'aventure sociale dans une histoire répétitive. Le réa-
lisme ne fait que marquer le moment d'une réalité reconnue pour
ce qu'elle est, mais ce moment, pas plus dans Machiavel que dans
Marx, ne se définit par la seule référence à la conscience réfléchis-
sante : il est lui-même moment de la réalité comme telle, marquant
l'avènement définitif ou l'affleurement momentané d'une réalité
égale à elle-même.
En vain chercherait-on un démenti à cette idée dans la phrase
bien connue de Marx : « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter
le monde de diverses manières, il importe maintenant de le trans-
former. » L'exigence de l'action ne vient pas s'ajouter à celle de la
connaissance : encore moins doit-elle être entendue comme l'annonce
d'une révolte contre le réel, d'un bouleversement des données
naturelles de l'existence humaine que nous a dévoilé la réflexion
sur l'histoire : elle ne fait que suivre cette découverte que la réalité
est praxis, que la conscience philosophique dans sa tentative de
convertir le monde en simple objet de représentation est elle-même
l'indice d'un état social, dans lequel la pensée est condamnée à
ignorer ses mobiles et à s'abîmer dans la contemplation d'une
image où se reflètent les conditions de son propre exercice ; que la
promesse d'une transformation de la structure de la société est
inscrite dans la situation présente faite à la classe exploitée. Une
telle exigence ne peut prendre la forme d'un impératif, auquel il
serait possible d'obéir ou de se dérober, comme si l'action politique
inaugurait un nouvel ordre d'existence, dont le seuil dût être franchi
en vertu d'une décision : la conduite de Marx, durant sa vie entière,
ne laisse aucun doute sur le sens qu'il entend donner à son insertion
dans la réalité, tant il est manifeste que le travail théorique, dans
une solitude presque entière, n'acquiert à ses yeux aucun statut
particulier qui le distingue de ses activités d'homme public, comme
rédacteur en chef d'un journal révolutionnaire ou comme dirigeant
de la Ligue communiste ou de la Première Internationale.
Si rien dans ses écrits - reproche adressé à quiconque de
déserter le camp révolutionnaire en raison d'un attachement à des
valeurs petites-bourgeoises, doute émis à son propre sujet sur les
mobiles qui détournent de la pratique politique ou même y condui-
sent - ne prépare à la réthorique moderne de l'engagement, c'est
de toute évidence que le réalisme est autre chose qu'une attitude
vis-à-vis du réel : il désigne le phénomène de la réalisation, le
devenir réel de l'homme, son avènement d'homme social à la
société. Or, si loin qu'il faille se reporter, hors du marxisme, pour
repérer le chemin suivi par la pensée de Machiavel, on observera
néanmoins une station parallèle. La connaissance du passé
enseigne ce que sont les hommes, la lecture de l'histoire empirique
est lecture de la nature humaine : le réalisme consiste à agir de
telle manière qu'une situation présente étant ramenée aux termes
d'une situation passée, nous puissions soit appliquer les remèdes
- 117 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
adéquats qui ont été autrefois découverts soit en imaginer d'autr
avertis que nous sommes des erreurs commises ; notre pouvoir
d'intervention est, dans tous les cas, fondé sur la constance des
passions humaines et de la lutte qui oppose partout une classe
privilégiée et le peuple : origine de toutes les difficultés et de
toutes les solutions. L'action inspirée par une connaissance exacte
des faits ne peut donc, quel que soit son objectif particulier, trans-
former les termes auxquels elle a affaire ; elle ne peut que les
aménager de manière à assurer son succès mais, ce faisant, elle se
soumet à une nécessité, dans laquelle il faut reconnaître la structure
de la réalité. Qu'il s'agisse de l'évolution de la République romaine
- objet des Discorsi - ou des divers modes de fondation d'un
État princier - objet du Principe - la même conclusion s'impose :
la lutte des hommes crée des situations déterminées qui appellent
un petit nombre de solutions, à défaut desquelles la défaite des
gouvernants et la ruine des sociétés sont inévitables. Le réalisme
machiavélien, comme le réalisme marxiste, procède d'une connais-
sance qui n'embrasse rien moins que l'étendue de l'histoire humaine
et s'éprouve par l'action, dans la jubilation de rendre au réel sa
véritable identité.
La volonté de préparer une telle restitution, en pensée et en
acte, engendre tant dans l'œuvre de Machiavel que dans celle de
Marx une démarche critique dont on peut suivre le mouvement à
des niveaux comparables. Même rupture avec la tradition cultu-
relle de leur temps, consommée ici dans la destruction de la philo-
sophie politique classique, notamment d'inspiration platonicienne,
là dans celle de l'hégélianisme ; même revendication de l'histoire
empirique comme seul champ de la connaissance, formulée contre
un rationalisme finaliste ; même refus de substituer à l'ordre
des passions ou des intérêts une essence de l'homme raisonnable,
fondement du bon régime ; même accusation portée contre un
humanisme moral qui, sous couvert d'un attachement à des
valeurs abstraites, laisse le terrain libre & l'exercice désordonné
de la violence ; même dénonciation, enfin, du christianisme dont
renseignement détourne les hommes de leur condition présente
et les livre sans défense à la pire des oppressions. Cette parenté
dans la critique rend en outre sensible à ce qui pourrait, à première
vue, paraître la rencontre contingente de deux caractères : le
commun mépris de la plupart des hommes politiques contem-
porains. Aux yeux de Marx, Louis Bonaparte, Bismark, les hommes
d'État anglais, à ceux de Machiavel, les souverains qui régnent sur
la France, l'Espagne et l'Angleterre et le Pape, sont des personnages
maladroits, privés de l'intelligence de leur rôle ; aux yeux de l'un
et de l'autre, ceux qui sont les plus près de partager leurs espoirs,
républicains anti-médicéens ou révolutionnaires socialistes, sont
le plus sévèrement jugés, comme incapables de reconnaître lá
nécessité inscrite dans les rapports de faits existants et de prévoir
les événements. La critique des illusions dont sont la proie les
hommes présents fait écho, en toute rigueur, à celle des idéologies
philosophiques, morales et religieuses qui obscurcissent la pensée.
- 118 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
Si Ton convient que la volonté d'approcher le réel, comme tel,
trace des parcours similaires, que la recherche des terres et des mers
inconnues à laquelle Machiavel se plut à comparer son entreprise,
contraint le navigateur, si différente que soit la direction suivie,
à user des mêmes repères, que dans une même pensée, s'articulent
nécessairement la critique des mythes qui masquent l'accès au
monde et celle des conduites imaginaires qui en brouillent les
lignes présentes, nous voici aussitôt sollicités, semble-t-il, à confron-
ter les objectifs atteints, pour mesurer leur divergence.
Mais comment imaginer toutefois que l'intention réaliste ait
pour effet d'engendrer des représentations du réel essentiellement
différentes ? Au lieu de nous presser de définir les désaccords
apparents, ne sommes-nous pas en droit de nous demander si, au
niveau m erti e de l'intention qui fut celle de Machiavel et de Marx,
ne se dévoile pas un rapport de la pensée politique au monde qui,
à soi seul, atteste éloquemment d'une nouvelle structure de la
réalité ? Cette question fut sans doute à l'origine de l'interprétation
si suggestive qu'Antonio Gramsci a ébauchée, dans ses notes sur
Machiavel ( 1 ). Son mérite vient de ce que se situant dans les horizons
du marxisme, elle ne vise nullement à enfermer la pensée machia-
vélienne dans les limites d'un cadre social où s'épuiserait sa signi*
fication, mais bien plutôt tend à relier les deux théories comme deux
moments constitutifs d'une expérience sociologique de la réalité,
Gramsci propose, en effet, de reconnaître chez Machiavel l'esquisse
d'une philosophie de la praxis, à laquelle la suite des temps devait
donner sa signification entière, en permettant de viser, en toute
connaissance ce qui ne pouvait d'abord qu'être pressenti ou aperçu
comme une exigence. Ce rapprochement - qui risquerait de paraî-
tre arbitraire s'il procédait d'une comparaison entre les thèses
énoncées par les deux écrivains - s'imposerait en revanche à notre
esprit si nous devenions attentifs à la relation instituée entre
l'œuvre réaliste et son public. L'œuvre, jugeons-nous, vise le
réel, mais elle veut être entendue, elle appelle certains hommes à
communiquer avec elle dans la réalité. Le lecteur ordinaire en est
si persuadé qu'il ne manque pas de reprocher à Machiavel tout
à la fois de formuler certaines idées et de s'adresser aux tyrans ;
c'est qu'il est sensible à l'interpellation que la pensée réaliste porte
en elle. Or, à nous interroger sur le sens de cette interpellation qui,
en apparence, contredit l'appel révolutionnaire du marxisme,
nous ne pouvons que reconnaître l'absurdité des interprétations
traditionnelles : l'œuvre n'a acquis une portée pratique, n'a eu
elle-même une existence pratique que parce qu'elle a mis en
question ce qui était établi et convaincu un public de la nécessité
de cette mise en question. Machiavel a bien pu exposer les termes
d'une politique tyrannique et affirmer que le tyran doit agir
conformément à ces termes s'il veut être à la hauteur de son rôle :
cette observation ne prouve pas qu'il ait pris la parole pour s'adres-
(1) A. Gramsci, Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno,
Einaudi, ed., 1949.
- 119 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
ser au tyran. Davantage ; accorderait-on que Le Prince servît
d'enseignement à des souverains et des hommes d'État dépourvus
de scrupule, on n'en saurait conclure qu'il leur fût destiné. Tout
enseignement réaliste est à double effet, comme on peut le vérifier
chaque jour sur l'usage que la classe dominante fait du marxisme,
y découvrant sa vraie nature, la logique de ses propres intérêts
et les artifices nécessaires à sa conservation. Il est de l'essence du
réalisme de dévoiler le mécanisme de la vie sociale et donc d'être
mis à profit par chaque groupe, disposé à défendre sa position.
Mais pour savoir à quelle intention il répond, encore convient-il
de chercher jusqu'où il conduit les divers groupes, en quelle
mesure il peut être approprié, s'il n'apporte pas, enfin, à l'un d'entre
eux, un mode de pensée adéquat à sa nature.
L'interprétation du Prince s'éclaire donc quand nous aper-
cevons la fonction du réalisme dans la lutte de classe. Il n'est pas
douteux, selon Gramsci, qu'il soit la propriété du Pouvoir qui
défend les intérêts de la classe dominante. Gouverner met, en
effet, dans la nécessité constante d'évaluer une situation en termes
de rapports de force, qu'il s'agisse de la vie intérieure de l'État ou
des relations d'État à État. Toutefois, ce réalisme est toujours
dissimulé. Le Pouvoir n'est considéré comme légitime par les sujets
que dans la mesure où il maintient la fiction de la Loi ; il est
toujours contraint de donner raison de ses actions : raison qui n'est
pas la sienne, mais porte le masque de Dieu ou de la volonté uni-
verselle ; il exerce la violence dans une brume de justice et de piété
tissée par l'imagination collective. Le réalisme doit demeurer son
secret, car, à le proclamer, il détruirait le fondement de son auto-
rité. La vérité qui est la sienne ne peut être que l'objet d'un
enseignement discret, d'une communication de bouche à oreille,
qui ne doit pas franchir les frontières d'un cercle d'initiés. Dès lors,
les conditions de son accès limitent le champ de la connaissance.
Condamné à une demi-vérité, les représentants de la classe domi-
nante vivent dans un demi-mensonge ; ils agissent sous l'empire
de la nécessité, mais ne s'élèvent pas à la conscience de l'histoire.
Ils sont eux-mêmes victimes des illusions dans lesquelles leur
domination entretient les masses. Comment imaginer que Le
Prince de Machiavel leur soit destiné ? En vain dira-t-on qu'il les
persuade d'agir conformément à leurs intérêts ; s'il parle, c'est
qu'il se situe ailleurs, que leur contradiction n'est pas sienne. S'il
attire l'attention sur la nature du pouvoir, révèle qu'il est une
création humaine issue des conditions permanentes de la lutte
sociale, c'est qu'il s'adresse à ceux que le pouvoir aveugle, qui n'ont
pas compris encore qu'il est à leur portée, pour peu qu'ils soient
les plus forts, et quel est le prix de sa conquête. Machiavel s'adresse
donc aux masses de son temps, à la bourgeoisie montante de
Florence, qui n'a réussi à se donner pour chef qu'un Savonarole,
prophète désarmé, ou un Soderini, homme d'État sans caractère,
paralysé par des scrupules moraux, incapable d'opposer la violence
à celle de ses adversaires - soit à ceux qui demeurent envoûtés
par la tradition morale et religieuse et ne reconnaîtront leur
- 120 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
tâche historique qu'à la condition de faire table rase des idéologies.
Son Prince a une fonction révolutionnaire par sa seule intention :
il interpelle des hommes qui, mystifiés, n'ont pas d'intérêt à la
mystification ; il ne peut ainsi que se rattacher à l'entreprise
historique d'une classe qui, pour être vouée dans le présent à
l'irréalisme, n'en est pas moins appelée à se convertir au réalisme
absolu.
Que Machiavel ait eu; lui-même, conscience de son but, c'est
ce que nous enseigne la structure de son œuvre la plus célèbre. Ce
n'est pas un hasard, en effet, si le dernier chapitre du Prince
tranche soudain, par la passion de son ton, sur l'ensemble d'un
exposé apparemment inspiré du seul souci de connaître et de faire
connaître les conditions de la fondation d'un État et de l'exercice
du Pouvoir. Cette étrange rupture de langage est un avertissement.
Ce qui est dit à la fin a le sens d'un commencement : l'exigence
pratique fonde, dans la réalité, l'exigence théorique. Dans son
exhortation à délivrer l'Italie des Barbares, où se lit la tâche de
fonder un État unitaire, Machiavel, s'adresse certes à un prince,
mais c'est à un prince nouveau ; il principe nuovo ; non à l'un de ces
misérables tyrannaux, qui, pour user de la ruse et de la violence,
ne savent néanmoins que ramper au ras d'une histoire privée
de son sens, mais à un homme de la virtù, sans tradition dynastique,
sans racine dans le monde de la féodalité, occupé à la seule conquête
du Pouvoir, et qui doit être assuré de l'adhésion du peuple à son
entreprise. Tout se passe comme si Machiavel disait à ce condollierof
résolu à ne pas borner son ambition : « Si vous voulez le pouvoir
et soumettre l'Italie, vous aurez la masse pour vous, quels que
soient les moyens employés, car la masse veut ce pouvoir ; et si
vous ne craignez pas de vous appuyer sur elle, vous réduirez à
rien vos adversaires, car ce soutien est le seul garant de votre
sécurité. » Qu'un tel héros n'existât pas, à l'époque où Machiavel
rédigeait Le Prince, ne réduit pas la portée de son discours. Il s'y
trouve proclamé, pour longtemps, que la volonté d'un peuple
attend de trouver son expression dans celle d'un individu. En ce
sens, comme l'écrit Granisci, Le Prince est un mythe, dans l'accep-
tion sorellienne du terme, une idée qui, par son pouvoir d'anticiper
l'avenir, donne une nouvelle figure au présent. En ce sens, l'invo-
cation par Machiavel d'un « hypothétique homme de la provi-
dence », recouvre un appel réel à la bourgeoisie italienne, destiné
à lui faire prendre conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit
être, à la rassembler dans la forme d'une volonté collective.
A réduire son enseignement aux dimensions d'une époque, on
jugera que Machiavel a reconnu la nécessité d'une alliance entre
la bourgeoisie et la monarchie absolue, convaincu que l'une ne
pouvait se frayer la voie de son ascension qu'en s'en remettant à
l'autre du soin d'effacer tout particularisme. Mais cette découverte
n'implique-t-elle pas une perception nouvelle de l'histoire ? Le
sentiment de la nécessité d'une tache historique n'annonce-t-il
pas une nouvelle relation de l'homme à la société ? En comprenant
qu'un peuple doit consentir certains sacrifices pour s'émanciper
- 121 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
de la tutelle de la classe dominante, qu'il doit accepter la mé
du prince pour accéder à sa propre unité, Machiavel n'éba
pas la conception d'un réalisme populaire, dont la vérité
sera dans les conditions ultérieures de la lutte de classe ? La consti-
tution d'une volonté collective prendra assurément d'autres formes,
mais elle suivra le même cours : les masses devront se donner des
chefs capables de viser des objectifs déterminés, d'analyser les
rapports de force et de prévoir les événements ; elles devront sou-
tenir avec enthousiasme leur action, alors même que celle-ci
contredira de manière flagrante les normes de la morale tradi-
tionnelle. Tant le jacobinisme, qui rassemblera les bourgeois autour
de la dictature, dans ridée d'un commun sacrifice de l'intérêt
particulier à l'intérêt général, que le bolchevisme qui enseignera
au prolétariat la vertu d'une nouvelle obéissance dans une dis-
cipline appelée à détruire celle que lui impose sa condition présente,
composeront les incarnations modernes du Prince : figures où le
peuple déchiffrera les traits de sa propre histoire, personnes agis-
santes auxquelles il donnera, par sa foi, le pouvoir de transformer
le monde. Sans doute, la médiation changera-t-elle d'aspect, en
même temps que la tâche qui la fait naître. Du Prince-individu,
au Prince-parti de masse, le mythe s'élabore et associe davantage
la connaissance au sentiment ; mais la fonction du médiateur
demeure. Il est, à chaque fois, l'agent d'une volonté particulière
dont les mouvements sont comme réglés à distance par une volonté
universelle.
L'œuvre de Machiavel ne s'adresse donc pas seulement aux
hommes du xvie siècle, elle continue d'interpeller la postérité.
Mieux : ce que nous appréhendons comme un problème spéci-
fique de l'action révolutionnaire de notre temps et i quoi nous hési-
tons à donner une solution s'éclaire à la lumière de l'enseignement
machiavélien. Si nous doutons de la compatibilité des fins et des
moyens de la révolution, si l'idée d'une société sans classe, d'une
démocratie entière, d'une politique transparente au regard de
chaque homme paraît jeter un discrédit sur le Parti qui, du fait
de son existence, et dans sa structure, et dans ses activités, établit
et confirme un pouvoir spécifique de commandement, c'est que
nous n'avons pas su reconnaître que cette institution occupe dans
la société moderne la fonction princière, autrefois définie par
Machiavel. A réfléchir sur cette fonction, on se persuadera que le
parti ne peut être différent de ce qu'il est, que le chemin réel
de l'émancipation rejoint à chaque étape un relai, à défaut de quoi
la volonté collective s'abîmerait dans l'illusion. Pour que le peuple
s'élève du désir à, la volonté, il faut qu'il le rapporte à un agent
susceptible d'inscrire dans la réalité - force mesurée à d'autres
forces - une équivalence de ses intentions, il faut qu'il fasse, en
quelque sorte, l'économie de ses sentiments pour en investir le
capital dans l'entreprise pojitique figurée par le Parti. Comme
l'écrit Gramsci : c Le Prince moderne, en apparaissant, bouleverse
dans son ensemble le système intellectuel et moral, car son appa-
rition signifie précisément que chaque action est désormais conçue
- 122 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
comme utile ou nuisible, vertueuse ou criminelle, en tant qu'elle a
pour point de référence le prince moderne lui-même et sert à
accroître son pouvoir ou à l'entraver. Le prince prend la place,
dans la conscience, de la divinité ou de l'impératif catégorique, il
devient le fondement d'un « laïcisme » moderne et d'une complète
« laïcisation » de toute la vie et de tous les rapports traditionnels. »
Dans une telle interprétation, le marxisme permet de retrouver
le sens du machiavélisme, mais celui-ci, rejoint, définit à son tour
l'intention marxiste. A leur place, dans une société bouleversée
par l'essor de la bourgeoisie ou celui du prolétariat, inégalement
conscients du sens de l'histoire, Machiavel et Marx ont amené à
l'expression la philosophie de la praxis. Sans doute faut-il mettre
au crédit de Marx la découverte que la réalité sociale est praxis,
à tous ses niveaux. Allant au plus profond, il a observé que les
rapports établis entre les hommes s'instituaient en fonction de leur
activité productive, que le progrès de cette activité créait les
conditions de nouveaux rapports, que les classes ne cessaient de
lutter pour conserver ou acquérir le statut que leur avait fait
obtenir ou que leur promettait leur rôle dans la production ; et,
de cette observation, il a pu induire que les idées auxquelles les
hommes, à chaque époque, attribuaient une portée universelle,
avaient elles-mêmes la fonction pratique de légitimer l'état de fait
existant. Mais s'il est exact que son enseignement culmine dans
l'idée que l'histoire, avec l'avènement du capitalisme, met en
demeure les hommes de s'élever à la conscience de leurs fins, que la
lutte des classes engendre nécessairement dans la société moderne
une lutte pour le pouvoir, que le succès en est lié à l'essor d'une
volonté collective, on peut juger que l'œuvre machiavélienne en
était une préfiguration. Que la réalité soit praxis, signifie, à ce
niveau, que le présent est appréhendé comme ce qui est advenu
par l'action des hommes et appelle une tâche ; que la connaissance
de notre monde ne peut être séparée du projet de le transformer ;
que le vrai et le faux, le bien et le mal n'acquièrent une détermina-
tion qu'en tant que termes de l'action révolutionnaire, que dans
sa forme achevée la réalité est la politique. Considérée comme une
énigme, quand on y voit l'agencement de moyens destinés à la
conquête ou à la conservation du pouvoir, dans une indifférence
plus ou moins avouée aux fins de la moralité, la politique retrouve
sa dignité, quand on y reconnaît le lieu où s'inscrivent les signi-
fications élaborées dans tous les ordres d'activité, sous la forme
d'une série d'indices mesurant à la connaissance, à la prévision
et à la décision le champ du possible.
La politique révolutionnaire s'avère alors aussi nécessairement
fondée sur la lutte de classe que nécessairement distante, dans son
exercice, de la vie de la classe ascendante : elle se développe dans
un espace qui, pour s'ordonner au sein d'un univers culturel concret,
n'en est pas moins rigoureusement circonscrit par les exigences de
la conquête et de la conservation du pouvoir. Sans doute, les
conditions historiques déterminent-elles certains de ses traits.
A l'époque contemporaine, la volonté du prolétariat est celle d'une
- 123 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
classe d'un genre entièrement nouveau, dont la nature est telle
qu'elle ne saurait, par son émancipation, rétablir une nouvel
exploitation et une nouvelle domination sociales. La volonté du
prince ne peut donc que viser un État qui ne ressemble pas aux
États connus de nous ; les fins de la classe révolutionnaire et celle
du Parti ne peuvent que coïncider dans la conscience des fins d
l'humanité. Cependant, Tordre de la politique demeure spécifiqu
Il engendre des actions dont le sens est fixé par les lois qui gou-
vernent tous les rapports de force ; il impose l'usage de moyens qui
ne se laissent pas accorder immédiatement avec les fins de la
révolution. Davantage : en raison même de l'opacité qu'il conserv
au regard des masses, il appelle l'élaboration d'une stratégie part
culière dont l'objectif est d'obtenir et de maintenir leur consensu
de les convaincre de la légitimité de leur direction et de l'utilité
de leurs propres sacrifices.
La philosophie de la praxis, à, laquelle se réfère Gramsci, veut
donc faire entièrement droit aux exigences du réalisme et en resti-
tuer les articulations. Elle attire d'abord notre attention sur le
phénomène que constitue le réalisme populaire dans l'histoire
moderne : mises en demeure de s'affranchir de la domination d'un
Pouvoir qui méconnaît leurs revendications et leur interdit
d'acquérir le statut qui répondrait à leur fonction économique,
les masses ont le sentiment que ce Pouvoir doit être renversé et
qu'elles doivent confier leur sort à ceux qui s'avéreront capables
d'entreprendre et de conduire à son terme une révolution. C'est
parce qu'un tel sentiment existe, qu'un individu ou une minorité
agissante peut élaborer une politique réaliste : la lutte contre les
hommes en place trouve, en effet, dans cette inspiration la force de
rompre avec les mythes entretenus par le Pouvoir et de retourner
contre lui les armes auxquelles sa position déclinante l'empêche
désormais d'avoir recours avec succès. Cependant, la politique
réaliste doit constamment confirmer dans son sentiment le réalisme
populaire : les dirigeants doivent convaincre le peuple de la néces-
sité de se soumettre à leur commandement. C'est au cœur de cette
relation dialectique que l'œuvre théorique, Le Prince de Machiavel
ou le Manifeste communiste de Marx, révèle son efficacité pratique.
En énonçant qu'un pouvoir nouveau doit se substituer à l'ancien,
que la violence, appliquée en toute connaissance de cause détruira
la violence qui règne dans le présent, elle appelle la volonté collec-
tive à découvrir son expression dans celle de ses dirigeants ; en
formulant explicitement la critique de toutes les idéologies et en
révélant que les valeurs morales sont privées de contenu en dehors
de leur application dans la vie sociale, elle enseigne aux masses
à juger ses chefs sur les actes et non sur les intentions. Mais paral-
lèlement, elle veut apporter aux chefs la certitude qu'ils sont
dans le bon chemin quand ils subordonnent toutes leurs préoc-
cupations à la conquête du pouvoir, qu'à suivre la raison appa-
remment abstraite qui gouverne la politique, ils se font les agents
de la raison historique. La pensée réaliste apparaît alors comme un
moment nécessaire à l'avènement de la réalité, moment qui assure
- 124 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
le passage du réalisme populaire au réalisme politique, et garantit
à celui-ci qu'il est fondé sur celui-là, dont la fonction est de mettre
en pleine lumière les impératifs de l'action et d'amener les hommes
à s'y soumettre.
Mais a-t-on atteint le sens de l'œuvre quand on a dit qu'elle
avait une fonction ? Sans doute pourrions-nous suivre Granisci sur
son propre terrain et nous demander si Le Prince de Machiavel a
bien eu la signification qu'il lui attribue ; s'il existait dans les cadres
de la société italienne, au début du xvie siècle, une bourgeoisie
ascendante, en regard de laquelle Le Prince put prendre la valeur
d'un manifeste, si, dans la réalité, l'alliance établie dans quelques
grands pays entre la monarchie absolue et la bourgeoisie s'est
conclue sur la base du réalisme évoqué par Gramsci ou si, au
contraire, l'État national ne s'est pas élevé dans les brumes de
l'idéologie, sous le couvert du mythe d'une souveraineté quasi
divine qui déguisait aux hommes leurs vrais mobiles. Sans contester
l'importance d'une telle question, c'en est une autre que nous
voulons poser, à laquelle nous conduit la seule considération de
l'œuvre culturelle. A vouloir réduire au même dénominateur la
pensée machiavélienne et la pensée marxiste, par cette affirmation
qu'elles expriment l'une et l'autre un nouveau rapport, essentiel
lement pratique, avec le monde, Gramsci parvient-il à rendre
compte de leur intention réaliste ?
Sa tentative, il convient de l'observer, suppose que le discours
de l'écrivain soit réduit à un appel, dont l'œuvre proprement dite
constitue un commentaire plus où moins utile. Tout ce qui paraît
relever de l'ordre de la connaissance est alors apprécié en fonction
de son efficacité symbolique : ou bien la pensée de l'écrivain sert
le projet qu'il aurait de susciter un réalisme populaire et c'est donc
qu'elle le justifie ou bien elle ne s'accorde pas avec lui et lui apporte
même un démenti explicite et ce sont les conditions historiques qui
donnent la clé de ses divagations ou de ses contradictions. Dans
tous les cas, il est exclu que la pensée erre, par la vertu même de
son interrogation, que la connaissance ait une finalité propre, que
le réel, en devenant l'objet d'une réflexion, ne lui fixe pas les
limites qu'il trace à toute conduite humaine. Nous disions que la
philosophie de la praxis reconnaissait dans le machiavélisme
un moment de sa propre expérience ; toutefois, elle ne lui reconnaît
un sens que dans l'exacte mesure où ir s'inscrit comme un événe-
ment dans l'essor d'une classe sociale, et une portée actuelle que
parce que l'émancipation du prolétariat reproduit certains des
traits de l'émancipation bourgeoise. Vérifierions-nous que ce sens
et cette portée aient été justement évalués, il resterait que Le
Prince de Machiavel s'évanouit sous notre regard une fois que
nous en avons aperçu la fonction. Ce que la philosophie de la
praxis ne peut s'approprier, elle le considère comme simple
particularité, et le néglige, assurée depuis Hegel, que « le particulier
s'use en combattant ». Dans de telles conditions, on peut à bon
droit se demander si elle fait faire un pas décisif en avant à la
critique. Une fois récusée l'inspiration idéaliste qui fixe à l'œuvre
- 125 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
du passé sa position dans un itinéraire de l'Esprit humain, de
une méthode traditionnelle de substitution, qui permet de ram
l'œuvre aux dimensions d'un événement dont on peut déterminer
la cause et le résultat. L'œuvre apparaît un moment autonome,
puisqu'on nous dit qu'elle interpelle les hommes d'un temps et
qu'elle continue d'interpeller le lecteur présent, mais il s'avère que
la question entendue, on l'a soi-même suscitée dans des termes tels
qu'on l'a subordonnée à une alternative, en s'interdisant de laisser
à l'écrivain l'initiative d'une interrogation à laquelle il faudrait se
soumettre. On juge que Le Prince s'adresse à la bourgeoisie et la
met en demeure de mesurer le prix de sa victoire et sans doute
accorderait-on qu'on a pu se tromper dans cette interprétation
sociologique, mais on ne saurait admettre ou supposer que l'œuvre
nous guide dans notre réflexion sur la structure des sociétés, qu'elle
nous apprenne quelque chose que nous ne sachions déjà sur la
politique et l'histoire. S'exposant à un curieux paradoxe, la
philosophie de la praxis, tout occupée à démontrer la fonction
pratique de la théorie, oublie que celle-ci est elle-même le lieu d'une
pratique, elle ignore que la pensée est un travail, que sa réalité
se révèle dans ce travail ; justement convaincue qu'elle ne naît pas
de rien, qu'elle participe d'une histoire totale, elle pervertit le sens
de cette découverte en vidant la pensée de son histoire propre.
Ce paradoxe, il est vrai, a l'avantage de maintenir l'esprit en
repos. A-t-on été sensible au réalisme machiavélien et au réalisme
marxiste, il est rassurant d'imaginer que leur accord est préétabli
dans la réalité, que l'histoire gouverne et apparente leurs entre-
prises. En revanche, à considérer que l'œuvre exprime une expé-
rience singulière du monde, que l'intention « réaliste » naît et
chemine dans un espace de pensée où rien n'est accueilli par
hasard ou par erreur ; que ce que l'écrivain nous désigne comme
le réel, il le constitue par une activité qui se détermine elle-même,
de telle manière que nous n'accédons à ce champ qu'il nous ouvre
qu'en reproduisant le mouvement de sa réflexion, nous risquons
de voir dans son réalisme plutôt l'avènement de certaines questions
qu'une thèse, l'indication d'un parcours à suivre obligatoirement
par quiconque commence à s'interroger sur la politique plutôt
que la révélation de ce qu'elle est ; nous sommes amenés à restituer
à Machiavel et Marx un égal pouvoir de nous affronter à nos
propres problèmes.
C'est en vain, en effet qu'on voudrait enfermer dans une formule
le réalisme machiavélien ou marxiste ; et, pour avoir voulu la
donner, Gramsci n'a fait que nous rendre plus sensible à l'impossi-
bilité d'une telle entreprise. Non que son interprétation du Prince
soit moins convaincante qu'une autre, mais elle ignore ce qui en fait
l'originalité et, plus généralement celle de toute l'œuvre politique
de l'écrivain florentin - ses Discours sur la Première Décade de
Tiie-Live n'étant pas moins significatifs que l'ouvrage qui a
fasciné la postérité par sa concision et la rigueur de ses démons-
trations. Cette originalité ne consiste pas dans certaines proposi-
tions qui s'avéreraient supporter une thèse essentielle, elle tient
- 126 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
dans une démarche qui fait passer l'écrivain d'une position à une
autre, qui lui permet d'esquisser successivement telle et telle
thèse et de les détruire en tant que thèses, de conserver dans ce
mouvement des repères, de les multiplier et, grâce à eux, de
circonscrire un ordre de phénomènes dont jusque alors l'unité
n'avait jamais été perçue. Certes, on peut soutenir, avec quelque
raison, que le dernier chapitre du Prince suggère une représentation
déterminée de l'œuvre. Il n'est pas douteux, malgré les dénégations
de quelques critiques, que Machiavel ait conçu la nécessité d'une
unification de l'Italie et qu'il ait estimé qu'un pouvoir fort était
seul susceptible de la réaliser, en brisant la résistance des féodaux
et en suscitant l'enthousiasme d'un peuple auquel le pillage des
étrangers, l'oppression vorace des tyrans et la corruption des répu-
bliques avaient fait prendre en dégoût sa situation présente ; il
est probable qu'il eut l'intention de s'adresser simultanément à un
condottiero assez audacieux pour suivre le chemin tracé par Cesar
Borgia et aux jeunes hommes de la bourgeoisie qu'il côtoyait
quotidiennement afin de* montrer à l'un et aux autres les conditions
de l'émancipation de l'Italie, le sens de la conquête du pouvoir et
le sens d'une nouvelle discipline ; il est possible enfin qu'il ait
aperçu dans l'histoire de son temps l'exigence d'une alliance de la
monarchie absolue et de la petite bourgeoisie. Mais une telle
représentation ne donne pas pour autant la clé de son œuvre. Ce
qui importe est que le même homme qui écrivait une exhortation
à délivrer l'Italie des barbares, analysait les erreurs que fit
Louis XII en envahissant la Lombardie et indiquait à un éventuel
conquérant les moyens qu'il devrait employer pour s'emparer
de l'Italie. L'essentiel n'est pas davantage que Machiavel, comme
des générations de polémistes se sont acharnées à le souligner, ait
affirmé que le prince devait user de violence, de ruse et de mensonge
pour prendre le Pouvoir et le conserver, et qu'à défaut d'un
emploi méthodique de ces moyens, qu'à vouloir par exemple se
faire aimer de ses sujets grâce à ses libéralités, il était condamné
à, l'échec. Ce qui importe est que l'homme qui observait sans indul-
gence et avec le parti de la lucidité la conduite des maîtres du
Pouvoir et leur recommandait d'agir en toute rigueur selon leur
intérêt, ce même homme méprisait l'hypocrisie et le recours à la
force quand ils n'étaient pas subordonnés à une fin consciemment
visée. La vérité de son œuvre ne réside même pas dans la tentative,
si neuve soit-elle, pour repérer les conditions d'une rationalisation
de la violence, pour enseigner que la lutte des hommes, sans que les
termes en soient changés, est susceptible d'engendrer un état de
convenance réciproque où le Prince puisse satisfaire son appétit
de puissance, les Grands leur passion des honneurs et le peuple
son besoin de sécurité. Car une telle vérité réside aussi dans la
critique qu'il fait lui-même de cette tentative, convaincu qu'il
est que le Prince ne visant que son but privé, la masse n'obéissant
que par ignorance et les Grands n'étant tenus en respect que par
la force, un accord de leurs intérêts ne peut être réalisé que par
hasard ou grâce à une intelligence exceptionnelle des rapports
- 127 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
sociaux qu'un prince, aveuglé le plus souvent par l'ambition,
pas en mesure d'acquérir.
Quand on lit Le Prince, son style et l'ordonnance de ses
démonstrations donnent l'illusion d'un raisonnement qui, du pre-
mier au dernier mot, exposerait une même vérité ; mais la réflexion
dissipe cette illusion. C'est qu'il ne suffit pas de s'obliger à voir
les choses telles qu'elles sont, à viser la verità effeluale pour
qu'apparaisse un objet que nous puissions identifier comme le réel,
pour qu'une vérité s'institue qui annule la divergence des perspec-
tives. A vouloir observer le monde sans tomber dans les pièges de
la morale, Machiavel croit découvrir la nature de l'action politique.
Mais celle-ci est-elle particulière ? Le rapport d'une situation à ses
conséquences, celui des moyens à leurs fins ne déterminent-ils pas
toute action humaine ? La conduite d'un tyran de Syracuse
n'évoque-t-elle pas un crime parfait tout aussi bien qu'une
méthode de gouvernement ? Quand nous regardons agir les indi-
vidus, pouvons-nous leur trouver pour mobiles autre chose que
leurs passions ? Et si nous considérons le résultat de leurs actions,
pouvons-nous distinguer rétrospectivement la scélératesse de la
vertu ? Et si nous visons l'État, pouvons-nous faire l'économie
de définir un bien commun ; mais pouvons-nous alors admettre
que ce bien ne soit voulu par personne, sans rendre inintelligible
notre propre démarche, qui prétend l'établir, par une simple
lecture des choses et non par un illusoire recours au témoignage
de la conscience ? Si nous découvrons que les ruses du Prince
répondent à une nécessité inscrite dans sa fonction, qu'il est dans
la nature du Pouvoir de se travestir, d'apparaître comme légitime,
fondé en religion et en moralité pour être reconnu comme une force
incommensurable à celles qui combattent au sein de la société
civile, alors tout ce que nous prenions pour traits psychologiques
du gouvernant ne sont qu'à déduire de la vie collective ; il s'avère
que les masses « veulent » Le Princef que, comme dira Hegel, contre
leur volonté, sa volonté est leur volonté, que la ruse du Prince est
ruse de la raison. Mais comment parler d'une ruse de la raison, si
gouverner est seulement contenir ses sujets, si la loi de la coexis-
tence se réduit à conserver le fait de la coexistence, si, à l'envers
de la lutte des hommes, il n'y a rien d'autre que des hommes en
lutte ?
La découverte de Machiavel, dira-t-on alors, c'est précisément
que l'ordre de la société ne fait que reproduire l'ordre de la nature ;
que ce qui advient est l'effet de la passion des hommes, que la lutte
des classes est incessante et qu'il n'y a pas de bon régime. Mais son
réalisme part de ces données bien plutôt qu'il ne s'y réduit, comme
l'enseignent des Discours sur Tite-Live plus encore que son Prince.
A s'y arrêter, on ne comprendrait pas encore la variété des phéno-
mènes : il faut suivre le fil de l'expérience historique, repérer les
circonstances dans lesquelles les rapports sociaux s'établissent. Le
réel, ce n'est pas seulement qu'il y ait lutte de classes, exigences
rencontrées partout et toujours par le pouvoir, c'est que celles-ci
se manifestent dans telles conditions, qu'elles dessinent telle ou
- 128 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
telle tendance, qu'elles rendent nécessaires ou possibles telles ou
telles actions. Le réel, apprenons-nous dans les Discours, c'est
l'histoire, en entendant par histoire, autre chose que ce que l'his-
torien ou le philosophe de notre temps est venu à se représenter,
non pas l'histoire suite d'événements dont établit la connexion,
ou champ social circonscrit dans un temps aussi large ou restreint
qu'on voudra dont on cherche à restituer les multiples articula-
tions ; ni l'histoire conçue comme l'avènement progressif de l'huma-
nité à la conscience de soi-même ; mais la répétition dans l'infini
de la vie des peuples de l'entreprise que constitue la société :
rassemblement des hommes qui se situent comme dépendant d'une
même chose publique, acquièrent une identité collective, inscrivent
dans un même espace naturel leurs positions respectives, dans un
même espace culturel leurs institutions et se déterminent en tant
que communauté privée en face des peuples étrangers, trouvent
un certain équilibre dans leur rapport de forces, quitte à le remettre
constamment en question, et sont conduits par la volonté du
Maître, celle des plus forts ou celle de la majorité d'entre eux à
trouver les moyens de leur sécurité et de leur développement.
L'histoire est cette répétition. Mais cette répétition est historique,
en ce sens que les conditions dans lesquelles s'établit cette entre-
prise ne sont jamais les mêmes : pouT chaque société, dans chaque
époque, il y a un environnement singulier, une situation héritée,
une coutume, qui circonscrivent certaines possibilités et certaines
impossibilités. Ce qui est le plus réel, ce n'est donc pas ce qui peut
être formulé comme les alternatives fondamentales auxquelles
doivent faire face de toute nécessité les gouvernants, une fois décou-
verts les traits essentiels de la nature des hommes et de leurs rela-
tions, c'est bien plutôt le sort qui leur est réservé dans une série
de situations particulières.
Tel est le programme que Machiavel s'est proposé de remplir
dans ses Discours : donner une analyse intensive de Rome, qui
porterait en soi la loi d'une divagation constante, dans l'espace
et le temps de l'histoire universelle, dont le résultat devrait être
de révéler progressivement les fondements de toute politique en
même temps que d'ébaucher l'inventaire des situations typiques
où les choix se dessinent. Si la République romaine peut fournir
la matière d'un tel programme, c'est qu'elle n'est pas différente
de tous les autres régimes connus de nous. Bien mieux, et ce para-
doxe apparent est une invitation à la réflexion, elle ne cesse pas
d'être, à l'époque de sa plus grande gloire, le théâtre d'une lutte
implacable entre les classes. Non seulement sa grandeur n'y est
pas étrangère, mais elle en est le résultat. C'est parce que la plèbe
a résisté à la domination du patriciat, qu'elle a arraché des conces-
sions, conquis des droits, les moyens de préserver sa sécurité, que
le pouvoir s'est divisé, que ses organes se sont multipliés et limités
les uns les autres ; c'est parce qu'elle a obtenu des débouchés à
son ambition qu'elle a accepté les sacrifices nécessaires à la poli-
tique de conquête de la classe dominante. Les tumultes qui se sont
levés dans Rome ont contraint les gouvernants à trouver des
- 129 -
CAHESM XNTBBN. DB SOCIOLOGIE 9
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
artifices destinés à associer le peuple à leurs décisions sans ce
d'en être maîtres, et le peuple à leur obéir pour gagner des liber
de telle sorte que le mal s'est changé en bien et la passion pr
s'est muée en vertu civique.
Mais quand Machiavel analyse l'histoire romaine, ce qui
apparaissait d'abord comme un paradoxe de la conscience
commune, s'avère à l'origine d'un doute qui touche à l'essence du
réel. Dans la meilleure des Républiques, la conversion du mal
en bien, de la passion en vertu, de l'intérêt privé en intérêt commun
se révèle non seulement fragile, mais incertaine. La prudence de la
classe dirigeante, le désintéressement de la plèbe, le dévouement
des grands hommes au bien public, quand ils apparaissent, laissent
encore voir, à leur envers, la rapacité des possédants, la convoitise
des dominés, freinée par l'ignorance et la crédulité, l'ambition des
politiques ou des guerriers, bornée par la peur. La grandeur de
Rome tient-elle à ce que la lutte de classes s'y est changée en une
harmonie, que s'y est réalisée, comme on dirait de nos jours, une
intégration des conflits, ou tient-elle seulement à ce que s'est ins-
tituée une sorte de balance entre la guerre civile et la guerre étran-
gère ? Si Rome a grandi sur les ruines d'Albe, selon la formule
fameuse de Tite-Live, n'est-ce pas que l'impérialisme fut à la
fois l'exutoire et le régulateur de la lutte sociale ; de sorte que le
succès des institutions apparaîtrait plutôt comme le résultat d'une
aventure singulière que comme l'expression d'un bon régime.
Et si la tyrannie planait toujours comme un aigle prêt à s'abattre
sur ces oiseaux rapaces que figurait la noblesse romaine - comme
l'écrivait Machiavel - toute occupée à poursuivre sa proie, à
s'acharner sur le peuple pour parfaire son exploitation, n'est-ce
pas la preuve qu'il n'est pas de différence essentielle entre la meil-
leure des Républiques et le pire des régimes. Il est significatif que
le programme de Machiavel - trouver dans la République romaine
un système de référence qui rende intelligible l'histoire universelle
dans la variété de ses phénomènes empiriques et qui révèle les
conditions dans lesquelles un État peut s'élever et s'ordonner avec
succès ■ - s'accomplit dans une critique constante de Rome et de
toutes les catégories qui conféreraient à son régime une légitimité.
Ce qui importe, à suivre la démarche des Discours, ce n'est pas
que Machiavel établisse la supériorité du peuple sur les Grands,
quelle que soit la portée de cette affirmation, et de la République
sur le principat ; ni qu'il distingue avec toute la clarté souhaitable
la monarchie de la tyrannie, et le législateur, dont la violence
s'est donnée pour fin la fondation d'un ordre civil de l'imposteur
qui ne vise qu'à s'approprier le pouvoir. C'est qu'après avoir fait
cea distinctions, il les brouille ; c'est que s'il les brouille, il ne les
efface pas. Comparées l'une à l'autre, les notions acquièrent soli-
dairement une valeur ; reconsidérées hors de la comparaison,
elles perdent leur première identité. Ainsi en est-il du peuple,
jugé le plus sûr gardien de la liberté, mais que son ignorance et sa
simplicité exposent à toutes les erreurs, pour peu qu'il ne soit pas
guidé par la prudence d'un sénat; ainsi de la République, où le
- 130 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
gouvernement est à l'abri des entreprises d'un maître, où s'opère
naturellement une sélection des meilleurs dirigeants, mais qui est le
théâtre d'une lutte civile, telle que la classe dominante y exerce
une fonction comparable à celle du Prince, et qu'un individu, dans
certaines circonstances, pourrait remplir mieux qu'elle ; ainsi de la
monarchie, qui garantit par la loi la sécurité des citoyens, mais
dont les institutions sont celles-là mêmes qu'un tyran saurait créer
s'il a l'intelligence de son intérêt ; ainsi enfin du législateur auquel
on peut reconnaître le sentiment du bien commun, mais dont
l'entreprise est en tous points comparable à celle d'un imposteur
qui aurait réussi. La pensée de Machiavel ne cesse de nous déloger
des positions qu'elle nous fait atteindre, mais elle ne nous installe
pas pour autant dans un monde dont toutes les institutions seraient
devenues équivalentes : elle fait réapparaître dans une perspective
ce qu'elle avait effacé dans une autre ; elle maintient les contraires.
Une fois qu'elle a aperçu qu'aucune frontière ne sépare le bien du
mal, elle va jusqu'à reconnaître que le meilleur engendre le pire,
non pas que de bonnes intentions engendrent de mauvais effets,
mais plus profondément que ce qui atteint dans la réalité la forme
la plus achevée est l'agent de la décomposition la plus étendue ;
elle va jusqu'à repérer dans l'essor de la République romaine la
cause de la destruction de toute la vie civile, dans l'Antiquité, et de
l'avilissement des sociétés modernes : monstruosité, observe
Machiavel, dont aucun Prince - sinon le plus barbare - n'aurait
pu se rendre capable. Mais cette observation ne condamne pas
Rome : la grandeur de son entreprise reste un fait : et c'est sur ce
fait qu'il faut lire le destin des sociétés.
Comment définir le réalisme de Machiavel ? Ne s'agit-il que
de comprendre l'histoire, et de se borner à repérer des diffé-
rences et des similitudes, à chercher les causes par lesquelles les
sociétés naissent, s'élèvent et disparaissent ? Cette tentation est
sensible dans les Discours, elle engendre même à titre d'hypothèse
l'idée que la Fortune gouverne entièrement les actions des hommes;
non que le hasard rende incomparables les situations dans lesquelles
les hommes se trouvent placés, mais il leur interdit alors de faire
autre chose que ce qu'ils font. Cependant cette hypothèse ne
résiste pas à l'expérience du présent qui inspire la critique du
passé : l'analyse d'une situation révèle qu'à chaque moment une
question est posée à l'acteur qui dispose de plusieurs réponses
possibles. Le réalisme ne consiste-il pas précisément à définir les
termes d'une situation, à les disposer en forme de question ?
Machiavel proposerait un réformisme à plusieurs entrées : quels que
soient le régime considéré et les circonstances historiques, la possi-
bilité serait offerte de formuler la solution qui assurerait et amélio-
rerait le pouvoir de fait, d'achever ce qui est ébauché dans la réalité,
de donner à la tyrannie, à la monarchie ou à la république le visage
qu'elle cherche confusément. Mais encore faudrait-il qu'on ait
affaire à des genres réellement séparés. Si la tyrannie hante tous les
régimes, n'est-ce pas simultanément dans plusieurs perspectives
qu'il faut se situer ? Ne faut-il pas prendre à la fois le point de vue
- 131 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LEFORT
d'un Appius qui voulait détruire les libertés romaines et celui
des républicains qui voulaient les conserver ? Mais s'il faut rai-
sonner, comme le ferait un acteur, et reconnaître que ses modèles
sont toujours singuliers, comme le sont les conditions qu'il doit
affronter, ne faut-il pas aller plus loin en ce sens et élaborer une
méthode applicable quelle que soit la position de l'individu :
celle du Prince face au chef de guerre qui risque de lui porter
ombrage et celle de cet adversaire, celle du conspirateur qui veut
abattre le mat tre du Pouvoir et celle du mattre qui doit déjouer la
conspiration. Sans doute le problème de l'État et de la compa-
raison des régimes disparatt-il alors pour faire place à une recherche
des situations typiques, qui alimenterait une logique de l'action.
Le réalisme machiavélien s'achèverait.sur la réduction de la société
à un champ de forces, offert à l'habileté du stratège.
Toutefois, cette réduction n'est qu'un moment limite de la
réflexion machiavélienne. L'idée d'une logique de l'action qui
laisse indifférent aux mobiles et aux fins de l'acteur, l'idée d'une
logique des situations qui laisse indifférent à la valeur des régimes
n'abolissent pas la recherche des conditions dans lesquelles la poli-
tique parvient à arracher l'humanité au désordre de la lutte perma-
nente de tous contre tous, dans lesquelles la violence se règle et se
laisse canaliser par des institutions, et la dialectique de la peur et de
l'agression se distend jusqu'à permettre un échange entre les classes
et une vie commune.
Si la pensée de Machiavel vient jusqu'à nous, c'est qu'elle nous
contraint d'embrasser simultanément ces perspectives diverses.
Son réalisme, nous le faisons nôtre, quand nous observons que la
conquête du réel s'effectue, dans la critique de chaque image à
laquelle nous serions tentés de nous arrêter. Faut-il en tirer l'ensei-
gnement que la vérité de la pratique politique reste le secret de celui
qui choisit selon son tempérament et en fonction des conditions
singulières dans lesquelles il est placé, après avoir reconnu que son
action ne saurait s'inscrire dans un être de la société ? Ou bien sup-
poser que l'incertitude machiavélienne procède d'une erreur sur
le réel. Ce serait oublier que toute entreprise réaliste se développe
dans la contradiction, alors même qu'elle suit un cours différent, et
qu'elle ne saurait aboutir sans perdre son sens à une position
agnostique.
Quand il compare Marx et Machiavel, Gramsci suggère lui-
même la contradiction du réalisme marxiste, mais sans vouloir
l'affronter, tout occupé qu'il est à le fonder sur une image déter-
minée du réel. Il indique, en effet, tout à la fois, que le parti révo-
lutionnaire conserve la fonction du prince et qu'il ne peut manquer
d'exprimer dans sa pratique les principes du communisme, que son
but est le pouvoir et que celui-ci est l'attribut d'une classe, qui,
pour vouloir s'émanciper par la violence, ne peut par nature
instituer un nouveau mode de domination, que le prolétariat ne
peut se passer de la médiation de l'organisme politique pour accéder
à la conscience de soi et que cet organisme doit promouvoir un état
- 132 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
social dans lequel sa fonction serait supprimée. Cependant, les
impératifs socialistes auxquels se trouve soumis le « prince moderne •
n'introduisent pas, comme le juge Granisci, de simples correctifs
à la politique. Ils signifient qu'elle a acquis au sein de la classe
révolutionnaire une fonction entièrement nouvelle. Si la bour-
geoisie peut s'en remettre au prince du soin d'imposer un pouvoir
universellement respecté, de soumettre à une même norme les
diverses catégories sociales, de préserver la propriété, si, alors
même qu'elle a acquis le droit de choisir ses gouvernants, elle
confie à un groupe particulier la gestion de ses intérêts - confir-
mant le caractère spécifique de la politique - c'est qu'elle existe
comme classe de par son activité économique, qu'elle a déjà une
identité dans la fonction qu'elle exerce dans la production. Le
pouvoir ne peut donc que défendre ses intérêts quand ils sont
devenus les intérêts dominants, car l'appropriation des richesses
et l'exploitation du travail d'autrui lui ont permis de se subor-
donner dans la société civile toutes les autres catégories. La délé-
gation de pouvoir répond, en outre, à une nécessité inscrite dans
sa structure ; puisque le fonctionnement du capitalisme implique
la concurrence et l'isolement des producteurs, il appelle une instance
qui fasse prévaloir et défende leur intérêt commun, tant dans les
conflits qui les opposent aux autres classes que dans la lutte contre
le capitalisme étranger. Ainsi la bourgeoisie trouve-t-elle normale-
ment l'image de sa propre unité, située hors d'elle ; ainsi ne se
pose-t-elle comme sujet historique que par la médiation d'un
pouvoir qui transcende l'ordre des activités dans lequel elle se
constitue comme une classe économique. En revanche, le prolé-
tariat, à suivre les analyses de Marx, radicalement privé de la
richesse et du sens de son travail, ne peut confier à quiconque la
défense d'intérêts qu'il n'a pas. Victime d'une exploitation, qui
tend à le réduire à l'état d'une chose, il n'existe que par la résistance
qu'il lui oppose ; que cette résistance s'effectue dans le cadre de la
production ou qu'elle prenne la forme d'une lutte contre l'État,
elle ne saurait s'inscrire matériellement dans la société, comme la
conquête de positions qui marqueraient l'investissement progressif
de lá société bourgeoise. Pour que le prolétariat se constitue en
classe, il faut qu'il lutte ; aucun organisme ne saurait se substituer
à lui dans l'accomplissement de sa tâche historique, si utile puisse-
t-il être pour regrouper les éléments les plus conscients et les plus
combatifs et leur permettre de confronter d'une manière perma-
nente les moyens qu'ils emploient et les fins qu'ils visent. Non
seulement le réalisme marxiste ne culmine pas, comme le voudrait
Gramsci, dans l'élaboration d'une stratégie mise au point par les
dirigeants du parti, mais il rend difficilement concevable qu'il
puisse s'établir une distance entre la praxis de la classe, inscrite
dans son travail, ses luttes revendicatives et ses combats révolu-
tionnaires, et la praxis proprement politique. C'est qu'à le suivre,
la praxis prolétarienne esl la réalité elle-même. Le prolétariat est la
classe dans laquelle s'effectue, dès maintenant, une dissolution de
toutes les classes, qui réalise la société, entendue comme société
- 133 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
CLAUDE LE FORT
humaine, sans détermination ; il est la seule classe capable d
siper toute idéologie, parce quii n'est attaché à aucun in
particulier et qu'il éprouve dans son travail l'universalité d
position. En ce sens, il porte en lui le point de vue de la tot
comme Ta justement montré Lukacs, du temps où il se prop
d'éclairer la philosophie marxiste. Et, de ce point de vue, n
connaissance, la théorie révolutionnaire, ni la politique, l'acti-
vité du parti, ne peuvent se constituer comme des secteurs à part.
Davantage : la faculté d'appréhender la structure du capitalisme,
de reconnaître l'unité du processus de production, en dépit de son
morcellement, et la subordination de l'État aux intérêts de la
classe dominante, sous l'apparence d'une autonomie du pouvoir,
est fondée sur la nature de la classe révolutionnaire qui n'engendre
aucune aliénation.
Mais si tel est bien le mouvement de la pensée de Marx, si son
intention réaliste prétend se confondre avec l'intention du prolé-
tariat, comment ignorer cependant jusqu'où le conduit son obser-
vation du monde et son observation de ses propres catégories.
A l'époque ou Marx écrit, ce n'est pas le prolétariat qui a l'ini-
tiative historique, sinon en 1848 et 1870. La politique se présente
alors aux yeux du théoricien sous l'aspect des luttes entre les
États, cherchant à agrandir leur territoire, des mouvements d'éman-
cipation nationale, des tentatives de la bourgeoisie pour conquérir
le pouvoir, là où la féodalité n'a pas encore été déracinée. Et sans
doute, à travers cette histoire, Marx ne manque-t-il pas d'apprécier
les conflits dans la perspective de l'avenir du prolétariat. Mais dans
la mesure où ils n'ont pas une incidence directe sur son sort, le
réalisme se réduit à l'évaluation des forces en présence, à l'obser-
vation et à la critique de la conduite des protagonistes, à la prévi-
sion des événements. Comment négliger le fait que la pensée
marxiste est sans cesse ramenée à l'observation du jeu diplomatique
et que sa réflexion sur le monde soit alors privée de toute portée
pratique ? Chaque fois qu'elle retrouve cette portée, quand les
circonstances offrent au théoricien l'occasion d'intervenir dans la
politique révolutionnaire, sa conception du prolétariat se trouve,
en revanche, mise durement à l'épreuve par l'exigence de l'action :
le réalisme du chef tend à se substituer en dépit des principes au
réalisme supposé de la classe. Si Marx n'hésite pas à recommander
des mesures qui, soutient-il, apparaîtront plus tard comme des
mouvements spontanés du prolétariat, si l'anticipation de l'expé-
rience révolutionnaire lui semble naturelle, si les ouvriers empiri-
ques s'avèrent inadéquats à sa définition, c'est que la politique rede-
vient un ordre d'action autonome. Mais quand elle le redevient
- et l'on sait que ce mouvement à peine esquissé par Marx s'est
accompli dans le Léninisme - c'est le sens de la théorie du prolé-
tariat qui est mis en question, c'est la représentation de la classe
sociale comme praxis qui devient incertaine. Le parti, en se pré-
tendant le porteur de la vérité prolétarienne, en s'établissant comme
une institution analogue à celles qu'engendre la société bourgeoise,
en imitant dans sa structure celle d'une armée, témoigne en effet,
- 134 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LA POLITIQUE ET LE RÉEL
d'une aliénation imprévue de la classe révolutionnaire. Et c'est
en vain que la théorie chercherait à se réaffirmer en dénonçant cette
aliénation comme une nouvelle figure des aliénations de la société
capitaliste, dans la pensée que le prolétariat n'est que l'objet d'une
entreprise d'appropriation, car réduite à une fonction critique, elle
enseigne non moins éloquemment que la totalité est disloquée, et le
réalisme séparé de son objet. Comment conserverait-elle la certitude
de discerner le réel et l'imaginaire au cœur de la société capitaliste,
quand elle a perdu son fondement dans Vêtre de la classe révolu-
tionnaire ?
Ces quelques remarques suggèrent que l'entreprise réaliste de
Marx, pour différente qu'elle soit de celle de Machiavel, aboutit
aussi à une indétermination. Ce n'est pas un paradoxe de soutenir
que c'est en prenant la mesure de cette indétermination que
nous communiquons avec leur pensée, et à travers elle, inter-
rogeons notre temps. Leurs erreurs n'apparaîtraient plus comme
des erreurs, ni leurs contradictions comme des contradictions,
si nous parvenions à lire dans leur œuvre l'indication d'une pro-
blématique de la réalité. Ne suffît-il pas d'évoquer la philosophie
politique grecque et de rappeler l'emprise qu'elle exerça pen-
dant des siècles sur l'esprit des hommes pour convenir que le
réalisme machiavélo-marxiste appartient en propre à notre his-
toire. Qui, s'il choisit le parti de parler sérieusement, dira en notre
temps que les rapports entre les hommes doivent se régler sur
un modèle où s'imprime la loi du cosmos et de l'âme humaine ;
qui prétendra déduire des principes de la raison le juste fonction-
nement de la société ; ou énoncer les valeurs dont l'application
suffirait à guider l'action politique. Et Marx, et Machiavel sont
au cœur de notre pensée parce qu'ils ont détruit les artifices de
l'idéalisme pour affronter une société sans hiérarchie naturelle,
un pouvoir sans légitimité, une histoire sans finalité. Si, après avoir
erré dans Marx, on devait rejeter toutes ses thèses, il faudrait
convenir que le motif de son interrogation reste présent : que signifie
l'avènement d'une société universelle où l'homme se découvre radi-
calement étranger à l'homme ; et si, après avoir erré dans Machiavel,
on ne s'était arrêté à aucune image de la politique, il faudrait aussi
sûrement reconnaître que notre réflexion recommence avec la
sienne pour demander : le pouvoir est-il voué à la ruse et la société
au mensonge ?
C.N.R.S.
Paris.
- 135 -
This content downloaded from
201.17.126.51 on Fri, 02 Oct 2020 02:54:31 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- Sylvain Piron L'occupation Du MondeDocument122 pagesSylvain Piron L'occupation Du MondeBarbara ChastanierPas encore d'évaluation
- Claude Duchet SociocritiqueDocument6 pagesClaude Duchet SociocritiqueAnonymous Vh6KTNceos100% (1)
- Zs Piron Occupation Op Coro v2Document122 pagesZs Piron Occupation Op Coro v2Giovanni GiovannettiPas encore d'évaluation
- Méditations Pascaliennes Bourdieu Cap4 PDFDocument50 pagesMéditations Pascaliennes Bourdieu Cap4 PDFIrvzaPas encore d'évaluation
- Comment Passer Le Test Cattell'S en Ligne Gratuitement ?: 101 AvisDocument2 pagesComment Passer Le Test Cattell'S en Ligne Gratuitement ?: 101 Avisعماد سليماني0% (1)
- lsoc_0181-4095_1984_num_28_2_1994Document10 pageslsoc_0181-4095_1984_num_28_2_1994Hind Karou'ati OuannesPas encore d'évaluation
- Florence Giust-Desprairies: Entre Psychè Et Social-Historique, Le Chainon Manquant de L'intersubjectivitéDocument12 pagesFlorence Giust-Desprairies: Entre Psychè Et Social-Historique, Le Chainon Manquant de L'intersubjectivitéDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Pouvoir, Politique, Autonomie - C. CastoriadisDocument25 pagesPouvoir, Politique, Autonomie - C. CastoriadisTrabalhos FilosofiaPas encore d'évaluation
- Positions Et Perspectives Claude Duchet PDFDocument6 pagesPositions Et Perspectives Claude Duchet PDFSuny GomezPas encore d'évaluation
- MONGIN PEnser Le PolitiqueDocument7 pagesMONGIN PEnser Le PolitiqueGuillermosibiliaPas encore d'évaluation
- Ansart - Occultation IdeologiqueDocument17 pagesAnsart - Occultation IdeologiquejosiannefcPas encore d'évaluation
- Scubla, Lucien - Lire Lévi-StraussDocument842 pagesScubla, Lucien - Lire Lévi-StraussJohn Erike100% (1)
- Labyrinthe 900Document21 pagesLabyrinthe 900George Dos SantosPas encore d'évaluation
- Rancière Comunidad EntrevistaDocument15 pagesRancière Comunidad EntrevistaMANUEL ALEJANDRO JORDAN ESPINOPas encore d'évaluation
- Platon Et La Science SocialeDocument46 pagesPlaton Et La Science SocialezarerPas encore d'évaluation
- De La Theorie de L'habitus A La Sociologie Des Epreuves (Lemieux)Document24 pagesDe La Theorie de L'habitus A La Sociologie Des Epreuves (Lemieux)Filip TrippPas encore d'évaluation
- LEFORT, Claude. Société 'Sans Histoire' Et HistoricitéDocument25 pagesLEFORT, Claude. Société 'Sans Histoire' Et HistoricitéGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- Lordon Ideologie LegitimiteDocument27 pagesLordon Ideologie LegitimiteAnonymous VNwWDqlrPas encore d'évaluation
- This Content Downloaded From 47.63.1.122 On Sun, 08 Nov 2020 17:05:20 UTCDocument23 pagesThis Content Downloaded From 47.63.1.122 On Sun, 08 Nov 2020 17:05:20 UTCJavier CarmonaPas encore d'évaluation
- Pierre Bourdieu Lecon Sur La Lecon ManonDocument4 pagesPierre Bourdieu Lecon Sur La Lecon ManonMarcelo Astorga Veloso0% (1)
- Apologie Des Sciences Sociales - La Vie Des IdéesDocument8 pagesApologie Des Sciences Sociales - La Vie Des IdéesEmilia SanaPas encore d'évaluation
- Holisme Et IndividualismeDocument7 pagesHolisme Et Individualismelaotrasociologia129Pas encore d'évaluation
- Science Et Idéologie. 4.Document3 pagesScience Et Idéologie. 4.ClaudeTartobusPas encore d'évaluation
- Les Stéréotypes, C'est Bien. Les Imaginaires, C'est Mieux-Charaudeau - 2007Document17 pagesLes Stéréotypes, C'est Bien. Les Imaginaires, C'est Mieux-Charaudeau - 2007Lizainny QueirózPas encore d'évaluation
- Petitat-Transmission Et Interpretation PlurielleDocument15 pagesPetitat-Transmission Et Interpretation PlurielleDoa MahmoudPas encore d'évaluation
- Car La PhilosophieDocument5 pagesCar La Philosophieaichasakina cissePas encore d'évaluation
- ANSART - Malaise Dans La Temporalité - Idéologies Politiques Et Constructions Du Temps - Éditions de La SorbonneDocument21 pagesANSART - Malaise Dans La Temporalité - Idéologies Politiques Et Constructions Du Temps - Éditions de La SorbonnejosiannefcPas encore d'évaluation
- Freud Et La Théorie Sociale by Haber, StéphaneDocument277 pagesFreud Et La Théorie Sociale by Haber, StéphaneDorismond EdelynPas encore d'évaluation
- De La Sociocritique À L'argumentationDocument17 pagesDe La Sociocritique À L'argumentationMauro AsnesPas encore d'évaluation
- Burgel inDocument5 pagesBurgel inSEBALD77Pas encore d'évaluation
- Frédéric Brahami: Castoriadis - Le Projet D'autonomie Comme Projet de VéritéDocument9 pagesFrédéric Brahami: Castoriadis - Le Projet D'autonomie Comme Projet de VéritéDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Passeron Rationalité de L'action Sociale Chez Weber 1994Document41 pagesPasseron Rationalité de L'action Sociale Chez Weber 1994Matthieu HélyPas encore d'évaluation
- Socius-Positions Et PerspectivesDocument6 pagesSocius-Positions Et PerspectivesAbiPas encore d'évaluation
- Institution. Definition MaussDocument7 pagesInstitution. Definition MaussOthmane SehakiPas encore d'évaluation
- Institutions Et Critique Sociale. Une Approche Pragmatique de La DominationDocument20 pagesInstitutions Et Critique Sociale. Une Approche Pragmatique de La DominationStefany FerrazPas encore d'évaluation
- Notes MarxDocument12 pagesNotes MarxYasser Zguiri (YAZ?)Pas encore d'évaluation
- Martuccelli. Qu'est-Ce Qu'une Sociologie de L'individu Moderne? PDFDocument20 pagesMartuccelli. Qu'est-Ce Qu'une Sociologie de L'individu Moderne? PDFrubenhd_22Pas encore d'évaluation
- Postone Ou Castoriadis Par Bernard PasobrolaDocument6 pagesPostone Ou Castoriadis Par Bernard Pasobrolacastoriad100% (1)
- Essai de Psychologie Contemporaine - GauchetDocument12 pagesEssai de Psychologie Contemporaine - GauchetBen DaPas encore d'évaluation
- Les Limites de L'acceptable Jean-Pierre CavailléDocument348 pagesLes Limites de L'acceptable Jean-Pierre CavailléIntinionPas encore d'évaluation
- Silverman, Hugh (1986) Le Lieu de L'Histoire Sartre et FoucaultDocument7 pagesSilverman, Hugh (1986) Le Lieu de L'Histoire Sartre et FoucaultEbert ValentinPas encore d'évaluation
- Notice MscienceDocument18 pagesNotice MscienceCryptopher KPas encore d'évaluation
- Theses Sur Le Langage de Philosophe ADORNODocument8 pagesTheses Sur Le Langage de Philosophe ADORNOJussara Rauen RibasPas encore d'évaluation
- Extension Théorique Et Pratique de La Définition Sociologique de Representation SocialeDocument11 pagesExtension Théorique Et Pratique de La Définition Sociologique de Representation Socialemnsangou233Pas encore d'évaluation
- Sociologie de L'exprérience - Françõis Dubet (Article - 4 PGS)Document4 pagesSociologie de L'exprérience - Françõis Dubet (Article - 4 PGS)Enya FriedePas encore d'évaluation
- Texte Francais Sur Schutz PDFDocument10 pagesTexte Francais Sur Schutz PDFCuriosiPas encore d'évaluation
- ANSART_DialectiqueDocument16 pagesANSART_DialectiquejosiannefcPas encore d'évaluation
- Patrick Charaudeau Identités Sociales, Identités Culturelles Et CompétencesDocument8 pagesPatrick Charaudeau Identités Sociales, Identités Culturelles Et CompétencesDavid BuriticáPas encore d'évaluation
- Texte À Lire Sur Critique Des Réseaux SociauxDocument1 pageTexte À Lire Sur Critique Des Réseaux Sociauxmira ZPas encore d'évaluation
- Penser Dans Un Monde Mauvais - Geoffroy de LagasnerieDocument113 pagesPenser Dans Un Monde Mauvais - Geoffroy de LagasnerieAelessar NabodyPas encore d'évaluation
- IrreraO_AutourDeLInfra-IdeologieEtreSujetEntreNormesEtIdeologie_2016Document11 pagesIrreraO_AutourDeLInfra-IdeologieEtreSujetEntreNormesEtIdeologie_2016jose.piqueroPas encore d'évaluation
- Fauconnet, Paul Et Mauss - La SociologieDocument26 pagesFauconnet, Paul Et Mauss - La SociologiecadumachadoPas encore d'évaluation
- La SociologieDocument26 pagesLa SociologieEL MOUHIB EL MAHDIPas encore d'évaluation
- JP 45 Op Log ViesocDocument15 pagesJP 45 Op Log Viesoccecilia.girard0609Pas encore d'évaluation
- Sartre Repond in ArcDocument6 pagesSartre Repond in ArcJos StedilePas encore d'évaluation
- L'anti-Boukharine (Cahier 11) PDFDocument40 pagesL'anti-Boukharine (Cahier 11) PDFernesto_colocolinoPas encore d'évaluation
- LEFORT, Claude. L'aliénation Comme Concept SociologiqueDocument21 pagesLEFORT, Claude. L'aliénation Comme Concept SociologiqueGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- LEFORT, Claude. Société 'Sans Histoire' Et HistoricitéDocument25 pagesLEFORT, Claude. Société 'Sans Histoire' Et HistoricitéGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- LEFORT, Claude. Retour Sur Le CommunismeDocument9 pagesLEFORT, Claude. Retour Sur Le CommunismeGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- LEFORT, Claude. Staline Et Le StalinismeDocument16 pagesLEFORT, Claude. Staline Et Le StalinismeGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- LEFORT, Claude. La Première Révolution Anti-TotalitaireDocument8 pagesLEFORT, Claude. La Première Révolution Anti-TotalitaireGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- Ricoeur, Paul Et Domenach, Jean-Marie. Masse Et PersonneDocument11 pagesRicoeur, Paul Et Domenach, Jean-Marie. Masse Et PersonneGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- Editions EspritDocument22 pagesEditions EspritGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- Mini Ebook TextosDocument9 pagesMini Ebook TextosCarine AbyPas encore d'évaluation
- Fichier Du Personnel 1 DJOMADocument22 pagesFichier Du Personnel 1 DJOMAloua cece antoinePas encore d'évaluation
- Negocier Avec SuccesDocument58 pagesNegocier Avec SuccesSudo-force-lead •Pas encore d'évaluation
- Éthique Des Affaires - WikipédiaDocument17 pagesÉthique Des Affaires - WikipédiaLeonel NebouPas encore d'évaluation
- Unicef 230213 01 02Document36 pagesUnicef 230213 01 02Rodolphe MukokoPas encore d'évaluation
- Mon Stage en Cabinet DDocument4 pagesMon Stage en Cabinet DhPas encore d'évaluation
- Les Connecteurs Logiques (Sans Fond)Document1 pageLes Connecteurs Logiques (Sans Fond)Le Baobab Bleu100% (3)
- E Haker: Stefan ZweigDocument17 pagesE Haker: Stefan ZweigsdfsdfPas encore d'évaluation
- Attestation D'AccreditationDocument10 pagesAttestation D'AccreditationTafelney MedPas encore d'évaluation
- Objet: Candidature Pour Le Poste de Contrôleur Qualité.: SenicoDocument1 pageObjet: Candidature Pour Le Poste de Contrôleur Qualité.: SenicoDoudieu siewePas encore d'évaluation
- Multiprevention Fiche EPIDocument6 pagesMultiprevention Fiche EPIroukaPas encore d'évaluation
- 2ndes-Correction GodotDocument8 pages2ndes-Correction GodotGabriel QuiliPas encore d'évaluation
- BLOCH, Marc. Rois Et SerfsDocument230 pagesBLOCH, Marc. Rois Et SerfsEdilson MenezesPas encore d'évaluation
- FP17Document1 pageFP17Amelia matosPas encore d'évaluation
- Fiche 13 Enfant Etranger de Parent FrancaisDocument1 pageFiche 13 Enfant Etranger de Parent FrancaisKambaPas encore d'évaluation
- La Question de La Solitude Chez Maurice PDFDocument4 pagesLa Question de La Solitude Chez Maurice PDFBárbara BragatoPas encore d'évaluation
- Ethique & DéontologieDocument13 pagesEthique & Déontologiegracemiesi32Pas encore d'évaluation
- Management D Un Systeme de Securite Dans Le BatimentDocument127 pagesManagement D Un Systeme de Securite Dans Le BatimentLot Of KnowledgePas encore d'évaluation
- Appel Candidature Superviseur RegionalDocument1 pageAppel Candidature Superviseur RegionalDonassihi Issouf SoroPas encore d'évaluation
- Commentaire de Texte Désobéir Frédéric GrosDocument2 pagesCommentaire de Texte Désobéir Frédéric GrosMartin LesechePas encore d'évaluation
- La Générosité Et L'enhtousiame Disparaissent-Ils Fatalement Avec La JeunesseDocument2 pagesLa Générosité Et L'enhtousiame Disparaissent-Ils Fatalement Avec La JeunesseSouhaila NagibPas encore d'évaluation
- Balaio - ContrabassDocument2 pagesBalaio - ContrabassArthur BarbosaPas encore d'évaluation