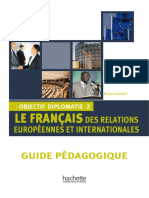Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Anglais
Anglais
Transféré par
frerekennethTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Anglais
Anglais
Transféré par
frerekennethDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
A mes dix enfants…
Je vous ai convaincu certes que la langue française demeure mon
métier, mon entreprise, mais ne devrait pas être votre identité…
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
2
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement.
Et les mots pour le dire arrivent aisément(…)
Hâtez-vous lentement sans perdre courage,
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.
Polissez-le sans cesse et le repolissez.
Ajoutez quelques fois, et souvent effacez »
(Boileau, l’art poétique)
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
3
Préface
Avant -propos
0. INTRODUCTION GENERALE
1. Justification du module et motivation
2. Objectifs
3. Méthode
4. Plan
5. Bibliographie
CHAPITRE I : CONCEPTS OPERATOIRES
1. Linguistique
2. Langage
3. Langue
4. Parole
5. Dialecte
6. Lexique
7. Mot
CHAPITRE II : PARAMETTRES DE LA COMMUNICATION
0. Notion de la communication
1. Schéma des opérations de la Communication
2. Fonctions du langage dans la communication
3. Langue comme moyen de guérir dans la gestion des services en milieu
hospitalier
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
4
CHAPITRE III : MOYENS DE LA COMMUNICATION ORALE
INDIVIDUELLE ET EN COMMUNAUTE
1. Moyens de la Communication orale individuelle
1. Physiologie de la parole
2. Alphabet phonétique international
3. Phonétique française
4. Langage verbal
2. Moyens de la Communication orale en communauté
1. Techniques de conduire un exposé ou une réunion
2. Lecture à haute voix devant un public visé
CHAPITRE IV : MOYENS DE LA COMMUNICATION ECRITE
O. Notion
1. Composition
2. Rapport de mission
3. Rapport de stage
4. Rapport de recherche
5. Compte-rendu
6. Procès-verbal
7. Curriculum vitae
8. Lettre administrative
9. Discours
CHAPITRE V : EXIGENCES DE L’ECRITURE
1. Qualités de bon style
Clarté
Précision
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
5
Ponctuation
2. Défauts de style
Pléonasme
Néologisme
Barbarisme
Solécisme
Archaïsme
Anachronisme
Locutions vicieuses
3. Exercices de substitution
4. Phrase
5. Accord de participe passé
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
6
PREFACE
C’est pour moi un réel et énorme plaisir de préfacer ce
manuel d’enseignement publié par le professeur Jean ELOHO OVUNGU
que je connais depuis bien longtemps, nous étions en 1997 au
département de français à l’IPN, il terminait le Graduat l’année où je
passais en Deuxième Licence, avec lui, nous avons le même Maitre,
Professeur Emérite LEMA VA LEMA, le Promoteur de nos thèses en
Littératures Francophones. Très doué, Jean ELOHO s’est entiché, depuis
lors, de la passion pour la recherche scientifique, il a déjà écrit plusieurs
ouvrages. Par sa ferme détermination, auparavant, en tant que chef de
travaux, il assumait de lourdes responsabilités de Rédacteurs en Chef de la
célèbre revue scientifique internationale Revue Africaine des Culture
REAFCU en sigle.
ABC de la communication orale et écrite en français, tel est
le titre de l’ouvrage dans lequel l’auteur expose minutieusement et d’une
manière concise les concepts clés et les notions fondamentales de cette
discipline scientifique rigoureuse.
L’objectif fondamental de ce manuel est celui de mettre est
de mettre à la disposition des apprenants un outil de travail fouillé, riche
d’enseignement rédigé dans un style scientifiquement autorisé, non
alambiqué et facilement accessible favorisant ainsi l’assimilation de la
matière.
En même temps, le manuel constitue un précieux instrument
pratique pour tous ceux qui s’intéressent à la compréhension et à la
résolution des questions de la communication. L’auteur y avoue que son
ouvrage est conçu conformément au référentiel du premier cycle en LMD,
dans ce contexte, il n’est aucun doute que le manuel porte essentiellement
sur trois aspects actifs de l’apprenant en sciences de la santé.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
7
Il s’agit , d’abord d’aiguiser ses compétences individuelles dans la prise de
parole en communauté, devant un public scientifique ou devant un patient ou
n’importe quel interlocuteur instruit, une tâche ardue assignée au deuxième et au
troisième chapitres de cet enseignement.
Ensuite, performer son expression dans la rédaction des documents
administratifs quotidiens au moyen des exercices intenses confectionnés au
quatrième chapitre. Enfin, rendre opérationnel le chercheur dans la présentation
des résultats de son exploration sur son projet tutoré ou sur une thématique bien
déterminée, il s’agit d’un effort inlassable que celui-ci doit fournir en
dissertation scientifique au deuxième semestre de sa formation universitaire
dans le cadre de la communication en tant plaque tournante du système éducatif
LMD (et unique facteur vivant qui établit le lien permettant à toute institution
(savante) de vivre et de fonctionner).
Plein succès à nouveau-né du monde professionnel et scientifique!
Professeur Docteur BUNGUDI LUWAYA Donatien
Coordonnateur de l’Unité d’Enseignement Communication
professionnelle à l’ISTM-KINSHASA.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
8
AVANT-PROPOS
Dans un pays comme la République Démocratique du Congo
où le Premier article de la constitution consacre l’officialité de la langue
française, je crois que l’importance de la communication orale et écrite en
français n’est plus à démontrer dans la mesure où le français s’impose à
tous les congolais comme moyen et surtout comme langue de
l’administration. Le français demeure à cet effet, la langue de
l’enseignement pour autant que ne peut accéder à la technologie
moderne, ne peut rendre la science que celui qui passe par l’école,
qui apprend et maîtrise cette communication. Car, tous les cours,
même celui d’anglais dont le début et les explications exigent
nécessairement l’intervention de cette langue, sont dispensés en
français. C’est ainsi que le locuteur doit maîtriser les règles du
fonctionnement de la communication française.
A cet effet, aussi bien pour les étudiants et/ou apprenants que
pour tous les fonctionnaires privés, public, la communication française en
tant que lien permettant aux sociétés d’exister et de fonctionner érige un
instrument administratif, technique et scientifique incontournable.
Cet ouvrage de ABC de la communication orale et écrite
destiné principalement aux apprenants en sciences de la santé, vise à
livrer, au-delà d’une information complète et détaillée sur la
communication professionnalisante en vogue, (il) tend aussi à attirer
l’attention des professionnels de santé sur l’existence désormais de langue
comme moyen majeur de guérir parmi d’autres (la personne,
l’environnement, les soins et la santé).
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
9
Ainsi, aux côtés des concepts centraux structurés en interaction dans
l’art de guérir, c’est-à-dire, la personne, l’environnement, les soins
et la santé, notre ouvrage prône d’ajouter la langue
(communication) pour nouer la jonction interactionnelle et systémique
entre ces quatre adjuvants1.
Notre ouvrage démontre que l’enseignement de la
communication s’installe au cœur du changement (dans le cadre
des intentions prônées en faveur du basculement comme le dit le
Ministre de l’ESU MOHINDO) vers l’approche par compétence
intégrée relative à la nécessité de transférer les apprentissages
dans les pratiques professionnelles.
En réalité, le manuel tend spécifiquement à doter les
apprenants d’un ensemble d’atouts susceptibles de leur permettre de
maitriser la communication en tant que processus dynamique par
lequel un individu institue une relation avec quelqu’un pour
transmettre ou échanger des idées, les connaissances et
surtout la science dans tous ses contours.2 .
En toile de fond, le manuel a pour objectif spécifique la
formation des étudiants en sciences de la santé appelés, à comprendre la
pratique des moyens étudiés, à s’assurer de bien défendre leurs projets de
recherche dans la rédaction scientifique conformément aux étapes
(déterminantes) selon que l’on est en licence, en maitrise ou en doctorat.
Somme toute, la communication est un phénomène
complexe. Il ne suffit pas qu’une personne émette un message pour qu’il y
ait communication. Un récepteur devra aussi être en contact avec
1
Ce sont des enseignements que l’on peut trouver gratuitement dans les nouvelles considérations de l’art
scientifique contenues dans le manuel du Professeur Jean ELOHO intitulé les Frêles pas du savant en devenir
et /ou les repères du savant confirmé publié chez REAFCU, KIN, 2021.
2 ième
Marie Claude Célinas, Communication efficace, de l’intention aux moyens d’expression, 2 édition, les
Editions CEC 2001, p 4
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
10
l’émetteur pour un message encodé dans les normes de façon à pouvoir
être décodé, alors qu’il ne prend signification que dans une situation.
Réussir une communication n’est pas toujours simple qu’on le croirait, car une
multitude de facteurs, comme nous l’enseignons, peuvent la perturber.
Si l’on est naturellement porté à jeter le blâme d’un échec sur les
personnes, l’émetteur ou le récepteur, il ne faudrait toutefois pas oublier que
chaque composante de la communication est en cause dans l’échec ou dans la
réussite de la communication ; c’est cependant à l’émetteur et au récepteur
qu’il revient d’intervenir dans les autres composantes pour modifier le code,
indiquer le référent, adapter le message ou choisir le canal.
ELOHO OMOKOKO OVUNGU.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
11
0. INTRODUCTION
Cet enseignement de Communication constitue un outil indispensable
dans la vie de professionnel de santé dans ses deux phases essentielles de
la communication en société. La première est la communication orale : elle
décrit les principaux aspects de la communication orale : sa physiologie,
ses caractéristiques habituelles, les fonctions jakobsoniennes du langage et
les aspects pragmatiques de la communication. Elle se termine par l’étude
des techniques de l’expression orale dans la vie tant communautaire que
professionnelle.
Quant à la seconde, elle concerne la communication écrite. Elle établit la
différence existant entre l’écrit et l’oral, précise les exigences de la langue
écrite et se clôture par quelques techniques de la communication écrite
dans la vie professionnelle.
Les objectifs pédagogiques opérationnels sont bien définis : à l’issue de
ce cours, les apprenants seront capables de :
Rendre compte de l’importance du français dans leurs vie
estudiantine et professionnelle ;
Prononcer correctement tous les phonèmes du français moderne tout
en respectant sa prosodie, (lire de façon audible, claire, vivante et
efficace des groupes des mots commandés par le sens);
Avoir une connaissance juste des techniques de l’expression écrite
dans la vie professionnelle pour rédiger correctement des lettres
administratives et officielles, un compte rendu ou un procès-verbal
d’une réunion, un rapport de mission, un rapport scientifique, un
rapport de recherche, etc. ;
Tenir un discours improvisé devant un grand public ;
Transcrire phonétiquement n’importe quel énoncé du discours
français.
IMPORTANCE DU COURS
Il avait plu au Ministre en charge de Enseignement Supérieur et
Universitaire d'introduire au début de l’année académique 2021-2022 un
cours intitulé « COMMUNICATION ORALE ET ECRITE en Français »
dans tous les Premières années LMD en sciences de la santé dans toutes
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
12
les sections n'organisant pas le français comme matière de leur
spécialisation afin de pallier l’insuffisance coupable constatée dans le
raisonnement et dans l’expression de l’étudiant congolais en ce temps de
mutation vers le système LMD. Son volume horaire est de deux crédits.
Ce recueil constitue un support aqueux destiné aux étudiants de LMD1de
l’ISTM/KIN et/ou à tout citoyen qui cherche à améliorer son niveau en
français parlé et écrit. Il est à la disposition de tout intellectuel, de tout
celui qui a déjà appris à parler et à écrire la langue française. Car nous ne
l'enseignons plus comme une langue nouvelle ou nous ne faisons pas
acquérir à ces étudiants une nouvelle compétence linguistique orale et
écrite.
L’importance du français en République Démocratique du Congo, n’est
plus à démontrer. Mais pourquoi privilégie-t-on la langue française dans
notre pays alors qu’il compte beaucoup de langues dont quatre sont
appelées nationales, vernaculaires que sont le kikongo, le lingala, le
Swahili et le Tshiluba.
A cet effet, le français est, en RDC, une langue officielle nous léguée par
les Belges, mais aussi et surtout constitutionnalisée par l’alinéa septième
du premier article de la constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006. Cela étant, il demeure le moyen de
communication entre tous les congolais. Il en est la langue de
l’administration. Le français est surtout la langue de l’enseignement dans
notre pays. Ainsi, ne peut accéder à la technologie moderne, ne peut rendre
la science que celui qui passe par l’école, qui apprend et maîtrise le
français. Car, tous les cours, même celui d’anglais dont le début et les
explications exigent l’intervention de cette langue, se donnent en français.
C’est ainsi que le locuteur doit maîtriser les règles du fonctionnement de
cette langue.
Comme aucun enfant congolais ne peut souffrir de manque d’éducation
(Cfr. Toutes les constitutions), la RDC est le premier pays francophone
d’Afrique et le deuxième du monde après l’Exagone.
Malheureusement, le constat est amer sur la maîtrise de cette langue de
Voltaire dans le milieu tant du Secondaire que de l’Ensignement Supérieur
et Universitaire. Les finalistes sont incapables de défendre leurs sciences
en français.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
13
CHAPITRE I: CONCEPTS VOISINS A LA COMMUNICATION
Le présent chapitre est consacré aux concepts opératoires afférents à la
communication.
1. LINGUISTIQUE
La linguistique est l’étude scientifique du langage humain articulé. Etude
scientifique : parce que la linguistique étudie les faits observables. Elle se
fonde sur l’observation des faits de la langue liés à la structure de celle-ci,
à son fonctionnement et à son utilisation. Il s’agit d’étudier la langue au
moyen d’observations contrôlées et susceptibles d’être vérifiées de façon
empirique, dans le contexte d’une théorie générale déterminée de la
structure linguistique.
Langage humain: l’objet de la linguistique est la langue, c’est-à-dire les
signes vocaux utilisés par l’homme pour communiquer, pour échanger des
idées, des sentiments. Sont donc exclus des préoccupations de la
linguistique les sons émis par exemple par les animaux, les machines, le
vent. L’expression « langage des oiseaux, des abeilles,.. » emploi le mot
« langage » au sens large.
Langage articulé : les signes linguistiques que les hommes utilisent pour
communiquer sont structurés. Ils peuvent être décomposés. Le scientifique
peut en reconstituer le mode d’organisation, la manière dont ils se
combinent et dont ils fonctionnent (le mode et les principes d’articulation,
d’organisation) en tant qu’ outil de communication.
Un linguiste est donc une personne qui étudie les langues.
2.LANGAGE
Est un système de signe capable de transmettre la pensée entre les usagers.
Il s’agit de tout moyen dont disposent les êtres pour se communiquer entre
eux3. Il est tout système de signes pouvant servir de moyen de
communication… il est, enfin, un phénomène universel. Bref, il est toute
manière de communiquer, de transmettre un message.
3
COSNER, (J) et COULON (D) -les voies du langage : communications verbales, gestuelles
et animales. Paris : Bordas, 1982, p 7.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
14
Il y a langage lorsqu’un signe sonore (bruit, cri, ..) ou visuel (geste,
panneau…) est lié à une signification (appel, ordre, défense…). Il suffit, en
effet, de produire le signe pour que ceux qui le voient ou l’entendent
comprennent ce qu’on veut transmettre comme message, mais à condition
d’avoir été instruit (par l’expérience ou par l’éducation) de sa signification.
Ainsi, on distingue : le langage visuel (geste, mimiques), le langage auditif
(sons), le langage olfactif (odorat) et le langage gustatif (goût).
Les signes décrits ci-haut sont souvent insuffisants et imprécis pour
exprimer toutes les pensées, tous les besoins : ils sont sujets à plusieurs
interprétations. Comme on peut le constater, la langue n’est pas innée. Car,
il est un système de signes conventionnés, socialisés et psychiques
disposé à transmettre la pensée entre les hommes d’une manière articulée
ou parlée. Ainsi, le moyen le plus précis et le plus commode que les
hommes aient inventé pour se communiquer avec force détails et précision
est le langage par les mots, c’est le langage qui utilise des signes vocaux,
formés de sons que les hommes émettent en faisant vibrer l’air aspiré des
poumons, par des mouvements particuliers des cordes vocales, de la langue
et des lèvres.
3. Langue : la langue est d’abord une réalité instrumentale, elle se
présente comme un instrument et un système de communication.
La communication se réalise par la transmission d’un message
(information) d’un destinateur (ou émetteur) à un destinataire
(récepteur). Les êtres humains communiquent entre eux surtout par
le moyen de la langue, c’est-à-dire par un système de signes oraux
(ou écrits) exprimant des idées. Ils peuvent aussi communiquer par
des gestes, des rites symboliques ou des codes visuels ou auditifs,
par exemple les panneaux de signalisation routière, les alphabets,
les symboles chimiques ou mathématiques, etc.
Langue est aussi une réalité sociale ,parler de langue, ce n’est
pas seulement utiliser un code ; c’est aussi parler des locuteurs de
ces langues, décrire leur histoire, leurs institutions et leurs conflits
aussi bien sociaux que politiques. C’est pourquoi, on envisage la
langue comme une institution sociale. La langue est un moyen de
communication qui appartient à une collectivité (groupe social) et
n’existe qu’en vertu d’une convention établie entre les membres
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
15
d’une communauté. En ce sens, elle demeure un bien collectif.
Langue et société sont deux réalités indissociables.
La langue est le reflet des valeurs sociales. La langue reflète les
valeurs et les rapports sociaux. Par exemple, le terme maman
(maama) dans la société congolaise est une marque de respect. Il
ne désigne pas seulement la mère biologique, mais toute femme
envers qui on a des égards. Il exprime un statut valorisé de la
femme. Ainsi, on peut l’utiliser pour désigner une sœur et même sa
propre épouse. L’emploi des titres qui expriment le statut social ou
la fonction est un excellent marqueur des rapports sociaux. Ex. En
français, l’usage des appellations madame/Monsieur par opposition
à Mademoiselle/Monsieur correspond à des signes de respect et de
hiérarchie. L’alternance mademoiselle/madame indique
généralement une distinction entre une femme mariée et une
célibataire.
Langage humain: l’objet de la linguistique est la langue, c’est-à-dire
les signes vocaux utilisés par l’homme pour communiquer, pour
échanger des idées, des sentiments.
Remarques :
1. La langue parlée (orale) s’apprend par l’usage quotidien. Elle est la
langue de tous, servant aux besoins ordinaires de la vie. Elle est apte
à exprimer surtout les faits et les sentiments simples.
2. La langue écrite s’apprend par un travail prolongé, par la maîtrise
de la grammaire, par la lecture attentive de grands et de bons
écrivains.
3. La langue est dite morte lorsqu’elle ne subsiste que sous sa forme
écrite, tandis que la langue vivante est celle parlée et écrite.
4. On écrit la langue vivante selon un système particulier, celui
alphabétique qui fait correspondre les lettres formant l’alphabet aux
sons.
Exemple :
la lettre f correspond aux sons /f/, mais la correspondance entre les
sons parlés et les signes écrits (graphies) n’est pas facile à
découvrir. Ainsi, par exemple, les deux lettres c h représentent un
seul son qui peut être :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
16
a / ʃ / dans chute, chat, chercher, choix…
b / k/ dans chorale, orchestre, chao, écho…
la lettre correspond au son /s/ dans sec, mission et au son /z/ dans
maison.
Langue maternelle : langue que le locuteur a apprise, acquise dès
l’enfance, au cours de son apprentissage du langage par les mots. Bref,
c’est la première langue que l’enfant apprend et maîtrise mieux.
Langue : une réalité instrumentale.
La langue constitue avant tout un instrument de communication. Grâce à
cet instrument, nous pouvons communiquer toutes sortes d’informations,
transmettre des idées, discuter sur divers sujets. La linguistique étudie la
langue comme un code, c’est-à-dire comme un ensemble de signes
conventionnels organisés (système) pour communiquer.
Dans ce contexte, la langue est d’abord une réalité instrumentale : elle se
présente comme un instrument et un système de communication. La
communication se réalise par la transmission d’un message (information)
d’un destinateur (ou émetteur) à un destinataire (récepteur). Les êtres
humains communiquent entre eux surtout par le moyen de la langue, c’est-
à-dire par un système de signes oraux (ou écrits) exprimant des idées. Ils
peuvent aussi communiquer par des gestes, des rites symboliques ou des
codes visuels ou auditifs, par exemple les panneaux de signalisation
routière, les alphabets, les symboles chimiques ou mathématiques, etc.
Les codes non linguistiques (panneaux routiers, symboles chimiques ou
mathématiques, etc.) peuvent cependant être exprimés linguistiquement.
C’est grâce à la langue qu’on peut acquérir les autres codes, car ces
derniers présupposent généralement l’existence de la langue. Par exemple,
l’apprentissage du code de signalisation routière ou de codes scientifiques
(mathématique, chimie, physique, etc.) exige la manipulation linguistique
de tous les signes.
La langue est le plus important de tous les systèmes de communication.
Non seulement elle permet toutes les significations possibles, mais elle
donne lieu, dans des situations appropriées, à des échanges d’informations.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
17
Langue : une réalité sociale
Parler de langue, ce n’est pas seulement utiliser un code ; c’est aussi parler
des locuteurs de ces langues, décrire leur histoire, leurs institutions et leurs
conflits aussi bien sociaux que politiques. C’est pourquoi, on envisage la
langue comme une institution sociale. La langue est un moyen de
communication qui appartient à une collectivité (groupe social) et n’existe
qu’en vertu d’une convention établie entre les membres d’une
communauté. En ce sens, elle demeure un bien collectif. Langue et société
sont deux réalités indissociables.
La langue est le reflet des valeurs sociales. La langue reflète les valeurs et
les rapports sociaux. Par exemple, le terme maman (maama) dans la société
congolaise est une marque de respect. Il ne désigne pas seulement la mère
biologique, mais toute femme envers qui on a des égards. Il exprime un
statut valorisé de la femme. Ainsi, on peut l’utiliser pour désigner une sœur
et même sa propre épouse. L’emploi des titres qui expriment le statut
social ou la fonction est un excellent marqueur des rapports sociaux. Ex.
En français, l’usage des appellations madame/monsieur par opposition à
Mademoiselle/monsieur correspond à des signes de respect et de
hiérarchie. L’alternance mademoiselle/madame indique généralement une
distinction entre une femme mariée et une célibataire.
La langue est un facteur d’identité et une marque d’appartenance sociale.
Le sentiment d’identification joue à deux niveaux : à l’intérieur de
différents groupes sociaux partageant la même langue et entre différentes
communautés linguistiques coexistant en situation de bilinguisme ou de
multilinguisme. Un signe d’identité et de différenciation. Une conséquence
importante de la dimension sociale de la langue est la valeur symbolique
du code (langue) comme facteur d’identification à un groupe ethnique. Si
par le passé l’unification des peuples s’est souvent réalisée par la force
militaire ou le désir d’identification linguistique accompagne ou suit le
processus d’unification politique : l’Allemagne, les Etats arabes, Israël
(religion et langue), les Catalans et les Basques d’Espagne exposent leurs
prétentions autonomistes à partir de leur langue, les Corses, les Bretons et
se reconnaissent comme différents des autres français en partant de leur
langue. Les congolais (Kinois) vivant à Bruxelles (Matonge) s’identifient à
partir du lingala.
Tous les individus de diverses catégories sociales peuvent parler la même
langue et se comprendre aisément malgré leurs différences. Les hommes se
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
18
reconnaissent et s’identifient à une prononciation particulière, un
vocabulaire particulier, des expressions particulières ( lingala ou français
des lubaphones, des tetelaphones, lingala des enfants de la rue est
identifiable.
A partir du niveau du français, on peut relever des écarts linguistiques
entre : ouvriers/paysans, villes/campagnes, intellectuels/ouvriers,
civils/militaires, étudiants/non étudiants, vendeurs à la criée/non vendeurs,
etc.).
Langue et nuances terminologiques : Ensemble de signes conventionnels
utilisés par les membres d’une communauté linguistique pour des fins de
communication.
Par opposition à dialecte : idiome ayant connu une extension géographique
considérable ou une extension démographique importante.
Langue Nationale : langue parlée par une communauté autochtone dans
un pays ou un Etat. (swahili, ciluba, kikongo, lingala sont des langues
nationales en RDC).
Langue ayant un statut reconnu par un Etat, mais qui demeure subordonnée
à la langue officielle. Dans les pays où l’on distingue langue(s) nationale(s)
et langue(s) officielle(s), (p. ex la RDC), le statut accordé correspond
généralement à une reconnaissance juridique différenciée ou inégale par
rapport à la langue officielle. Il y a quatre langues nationales en RDC, mais
une langue officielle (le français).
Langue officielle : langue dont le statut et les fonctions sociales sont
reconnus par l’autorité étatique (gouvernement, administration) qui l’utilise
dans ses communications institutionnalisées. Le français est la langue
officielle de la RD Congo. Le swahili et l’anglais sont de langues
officielles au Kenya…
L’expression langue officielle peut s’opposer dans certains cas à langue
nationale, langue vernaculaire ; parfois, ces différents statuts peuvent aussi
se correspondre : au canada, l’anglais et le français sont à la fois langues
officielles, nationales, véhiculaires, vernaculaires.
Langue véhiculaire se dit d’une langue servant aux communications
institutionnalisées ou commerciales, souvent entre des peuples de langues
maternelles. Le français, l’anglais, le swahili sont des langues véhiculaires
en Afrique. Dans la Province Orientale par exemple, le swahili permet à
communiquer lors des transactions diverses (topoke, hema, lendu, etc.)
Vernaculaire : du latin vernaculus « indigène, domestique » désigne un
idiome utilisé comme langue maternelle par une communauté donnée ; la
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
19
langue vernaculaire est souvent réservée à la communication individualisée
si elle ne constitue pas à la fois une langue nationale ou une langue
officielle dans un pays, il peut s’opposer à langue véhiculaire.
Langue maternelle : c’est la première langue apprise par individu au
contact de son environnement familial immédiat. Celle-ci n’est pas
nécessairement celle de sa mère (de ses parents). Dans la plupart des
familles des intellectuels congolais, le français constitue de plus en plus la
langue maternelle des enfants. Cas du plateau des résidents de l’UNIKIN.
Dialecte : du point de vue linguistique, ce terme désigne deux ou plusieurs
variétés d’une même langue. Par exemple, le Kikongo de kikwit et celui de
Boma, le swahili de Bukavu et celui de Lubumbashi, le lingala de
Mbandaka et celui de Kinshasa, le kitetela de Lodja et celui de Lubefu. Ce
terme a été utilisé par les colonisateurs, certains chercheurs européens avec
une connotation dépréciative.
« Dialecte », on peut le comprendre comme un système des signes et des
règles combinatoires de même origine qu’un autre système considéré
comme langue mais n’ayant pas encore acquis le statut culturel et social de
cette langue indépendamment de laquelle il s’est développé. En effet,
l’okutshu, le kikusu, l’ohindo sont des dialectes Otetela.
Le kindibu Pour le Kikongo ; le kihungana, le kingongo, le kisongo,…
pour le kimbala. Pour parler, l’homme se sert de parole pour se faire
comprendre.
Idiome :Terme servant à désigner le parler spécifique d’une communauté
donnée.
Souvent utilisé (langage familier) comme synonyme de langue Créole.
Créole : Langue mixte née du contact d’une langue coloniale avec diverses
langues autochtones, surtout du continent africain, et utilisée par une
communauté donnée comme langue maternelle. P.ex. le créole d’Haïti.
5. PAROLE : la parole est un ensemble des mots capables de transmettre
ou d’exprimer un message. Elle est un ensemble des mots prononcés ou
une suite des mots exprimant une pensée, un sentiment. Ces mots
doivent être liés entre eux grammaticalement et logiquement autour
d’un verbe pour former un sens complet : la phrase. La parole est
renforcée par les intonations, les gestes, les mimiques afin de compléter
le sens.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
20
5. LEXIQUE
C’est un ensemble des mots dans une langue donnée. Le lexique est
illimité. Pour parler et écrire, l’homme ordinaire peut maîtriser plus ou
moins 3.000 mots. Mais selon que l’âge est avancé et selon l’expérience
vécue (pour un homme surtout instruit) on peut utiliser 24.000 mots.
6. MOT
Ces signes vocaux appelés sons sont groupés en unités chargées de sens :
ce sont des MOTS. Un mot est compris comme un ensemble des sons ou
combinaisons des sons ayant un sens : Ex. : froid, je, combien ; mais
« khrost » n’est pas un mot, car n’ayant pas un sens en français. Comme
tous les êtres humains ne peuvent pas comprendre tous les sons de la même
manière, chaque peuple, chaque groupe d’individus inventent leurs propres
signes ayant leurs propres sons. Ainsi avons-nous par exemple : « aller »
français ; « to go » anglais : « kukwenda » : kikongo ; « kokende » :
Lingala…
Ces signes conventionnés (sons) qui sont ainsi, inventés par chaque groupe
d’hommes forment ce que nous appelons une LANGUE, voilà pourquoi
l’essentiel de notre enseignement gravitera au tour du MOT.
Formation des mots nouveaux
La langue vivante est celle qui se parle, qui vit, c'est-à-dire elle évolue,
s’enrichit avec les néologismes, avec les emprunts et les influences des
langues voisines. Ainsi, la langue française a aussi emprunté des préfixes
et les suffixes d’origine aussi bien latine que grecque.
Le mot comme nous l’avons déjà dit, est un ensemble des sons ou une
combinaison des sons ayant une signification. Bref, il est la combinaison
des sons exprimables. On distingue plusieurs sortes de mots : Variables,
Invariables, des mots radicaux, construits, dérivées, etc.
Mots variables
Il s’agit des mots qui changent de forme : ex : l’article, l’adjectif, le nom le
pronom. Ils disposent des formes différentes pour le masculin et singulier
et le pluriel (Ex. : celui, celle, ceux-ci, celles-ci ; heureux, heureuse ; frais,
fraîche ; enfant, enfants.
Tandis que le verbe -un mot variable- dispose aussi des formes différentes
pour le singulier et le pluriel, les trois personnes, les voix, les temps et les
modes. Ex. : le verbe « être » : Suis, es, sommes, êtes, fus, fûmes, furent,
serai, seront, etc.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
21
Mots invariables
Ce sont ceux qui ne changent pas de forme. Il s’agit des adverbes, des
prépositions, conjonctions. Ex.: à, en, quand, que, et, mais, etc.
Mot radical
Est celui qui paraît être un bloc de pierre formé d’un seul morceau.
Ex. Hier, maison, habit, paix, don...
Mot construit
Le mot est dit construit lorsqu’il est formé de plusieurs morceaux dont l’un
est un radical.
Ex. : Congolais est formé sur le radical « Congo » et le suffixe « lais ».
Immortels-radical : mort et de im (préfixe) et de el (suffixe) etc.
Mots dérivés
La plupart des mots dérivés (mots construits) sont formés en ajoutant au
mot radical, soit un préfixe, soit un suffixe.
Ex. - Impuissamment est formé d’im-puissam-ment.
- Embarquement est formé de em-barque-ment.
Cependant, certains dérivés se confondent au radical tel que « Vol » vient
de vol-er.
Remarque :
Aujourd’hui, on forme un grand nombre de noms à partir des
verbes. Ces noms désignent surtout l’action exprimée par le verbe
d’origine, mais ils permettent un changement dans l’expression.
Ex : les voitures stationnent sur les trottoirs, cela gêne les piétons. On peut
dire : « Le stationnement des voitures sur le trottoirs gêne les piétons »
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
22
Les suffixes et préfixe des mots
L’emploi des suffixes et des préfixes est nécessaires dans la mesure où il
donne d’emblée le sens des mots même qui viennent d’être créés.
Les suffixes
Les suffixes sont des particules qui s’ajoutent au radical pour donner un
mot dérivé avec un autre sens. Ainsi, à partir d’un même radical, divers
suffixes permettent de nommer l’action, soit par un verbe (arros + suffixeer
= arroser), soit par un nom (suffixe- âge = arrosage) ou de nommer la
personne, la machine ou l’appareil (suffixe –eur et euse = arroseur,
arroseuse…). Il arrive souvent que le radical subisse des changements (Ex :
clair- clarté), à la finale notamment (blanc-blancheur ; blanchir).
Exercices
A partir d’un verbe, on crée plusieurs mots. Ex : plongé - plongeur,
plongeon, plongeoir, etc.
Faites de même avec aimer, décorer, animer.
De l’adjectif au nom : Ex : la vie est chère= la cherté de la vie.
Faites autant avec sale, rare, propre, pauvre, possible, curieux, libre,
difficile. Formez le nom à partir des adjectifs : étroit, faible, jeune, petit,
poli, sec. Trouvez des adjectifs à partir des noms : danger (dangereux),
huile, orage, os, poisson, pâte.
Les préfixes
Les préfixes sont également des particules (préposition ou adverbe) qui,
placés devant un nom, un adjectif, un verbe ou un participe, modifient le
sens du mot primitif en y ajoutant un autre sens.
La classe grammaticale du dérivé est celle du mot radical : chance,
malchance (nom) : communal-intercommunal : partir (verbe) –repartir
Certains préfixes ne sont que des prépositions. Ex : avant, avant-centre ;
contre-attaque ; sur-survoler.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
23
D’autres mots sont formés parallèlement avec des préfixes savants : pré- et
inter- à la place de avant- et entre- ; post- à la place de après.
Ex : préhistoire, intercontinental ; post-nom.
Exercices : que signifie : interligne ; s’intercaler ; préavis ; prénatal ;
prédire ; préexister ; etc.
Quelques préfixes permettent de former des mots qui sont des contraires :
Ex : nom- l’insécurité, la malchance ; adjectif- impossible ; mécontent ;
désagréable ; décoller ; dérégler ; médire ; etc.
Exercices
a. Formez des adjectifs contraires sur les adjectifs : croyant, discret,
patient, poli, perméable, apte, exact, etc.
b. Formez des adjectifs contraires sur les verbes : diviser, lire, réparer
salir, voir, vaincre, expliquer, prévoir.
c. Sur quels verbes sont formés les contraires : incompréhensible,
indescriptible, indiscutable ?
Dégagez le préfixe de contraire dans : désarmer, désordre, malheureux,
embarquer, débarquer.
Il sied de noter que beaucoup de préfixes français provenant du grec
donnent facilement le sens nouveau au mot français c’est le cas de :
Aero-(air), aérogare, aérodrome, aéroport
Anthropo-(homme), anthropologie
Ant(i)- contre, à l’opposé de : antiseptique, antagoniste, antipathie
Archéo-(ancien), archéologie, archéologue
Auto-(soi-même), autogène, autodidacte
Biblio-(livre), bibliothèque, bibliographie
Bio-(vie), biologie, biographie
Chromo-(couleur), chromoplaste, chromosome
Dactylo-(doit), dactylographie
Démo-(peuple), démographie
Dynamo-(force) dynamomètre, dynamique
Dys (mal) dysenterie, dyspepsia
Gast(é), r(o)-(estomac)- gastrite
Géo-(terre)-géographie
Hemo-hemat(sang)-hémophilie
Hemi-(demi)- hémisphère
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
24
Hydro-(eau)-hydrographie, hydrothérapie, hydraulique
Hypo- (sous), hypocrite, hypothèse, hypogastrique
Iso (égal, même)-isothermie
Micro (petit) microscope, microbe
Mono (seuol), monologue, monarchie
Mis (qui hait) misanthrope, misogyne
Morpho (forme), morphologie
Nécro- (mort) -nécrologie,
Néo (nouveau), néocolonialisme, néologisme, néo-apostolique
Nero, néya (a, o) (nerf)- nerveux
Odon (o-() dent), odontologie
Ophtol- (oeil)
Paléo- (ancien)- paléographie
Patho- (douleur, maladie)- pathologie
Ped (o)-(enfant)-pédologie, pédophilie
Phono- (voix, son, son)-phonème
Photo- (lumière) -photographie
Pneum- (at) o-(souffle)-pneumonie
Poly-(plusieurs)-polyculture, polycopie
Psycho- (âme, esprit)- psychologie
Techno- (science) -technologie
Télé- (loin) -télévisé, téléphoné
Thermo (chaud, chaleur), thermomètre, thermogène
Zoo (animal) zoologie, zoophile.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
25
Eléments grecs servant de suffixes
Elément Sens Exemple de mots
1 Algie Douleur névralgie: gastralgie
2 Gène qui engendre pathogène, oxygène
3 Cratie, crate gouvernement démocratie, aristocratie
4 Nomie, nome Régie agronomie, astronomie
qui déteste, qui agrophobie,
5 phobie; phobe craint hydrophobie
6 Scope action de voir téléscope, microscope
Préfixe d’origine latine
Préfixe Sens Exemple de mots
1 Ab(abs,a) Éloignement Abdique, abstraction, amovible
Ab(an, acc, Adoucir, accourir, affaiblir,
af, al) ag, alléger, aggraver, apprêter,
2 ap, ar, as rapprochement arrondir
Bénéficier, bénédiction,
3 Bene (bien) Bien bienfait
4 Bis (bi, be) Deuxfois Bisaïeul, bipède, bévue
Opposition, à
Contra coté de, Contredire, contresigne,
5 (contre) contradiction contremaître
Enlever : emporter,
6 En (em) De, la, dans enfermer : embarquer
Eloignement,
Ex (é, ef, privation, Ebruiter, essouffler, ex-
7 es) exporter ministre
8 Extra Hors Extraordinaire, extraterrestre
9 Intro Dedans Introduire
10 Re (mes) Mal, négation Médire, méfait, mésestimer
Complètement, parsemer,
11 Por (per) A travers parfumer, performer
12 Retro En arrière Rétrograder, rétroviseur
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
26
Elément latin servant comme suffixes pour la formation de
certains mots savants composés
Préfixe Sens Exemple de mots
Somnambule,
1 Ambule Qui marche noctambule
Homicide, suicide,
2 Cide Qui tire fratricide
Mammifère, lactifère,
3 Fère Qui porte aurifère
Qui met en
4 Fuge fuite Vermifuge, centrifuge
Qui met au
5 Pare monde Ovipare, vivipara
Carnivore, omnivore,
6 Vore Qui mange herbivore.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
27
CHAPITRE II : PARAMETRES DE LA COMMUNICATION
1. Notion de la communication
La communication est un ensemble des phénomènes concernant la
possibilité à un sujet de transmettre une information à un autre
sujet ou aux autres sujets au moyen de langage articulé ou
d’autres codes.
Pour Marie Claude Célinas, la communication est un processus
dynamique par lequel un individu institue une relation avec
quelqu’un pour transmettre ou échanger des idées, les
connaissances, les émotions, ainsi bien par la langue orale ou écrite
que par un autre système de signes : gestes, musique, dessins etc.4
La communication établit le lien qui permet aux sociétés d’exister et
de fonctionner.
Le but de la communication est celui de transmettre la pensée, les
messages, les informations à autrui. L’information est comprise
comme une nouvelle qu’on entend pour la première fois.
On parle de la communication lorsqu’il y a compréhension du
message entre les sujets d’un groupe. Et l’on parle de la
compréhension quand le message encodé par le locuteur est
déchiffré, décodé par le récepteur, le receveur. Cette
compréhension n’est possible que lorsque les interlocuteurs (les
êtres en conversation) utilisent les mêmes signes vocaux, le même
code, c'est-à-dire la même langue.
2. Schéma des opérations de la communication
Un linguiste américain d’origine russe, ROMAN Jakobson, inspiré par
la théorie de l’information propose les éléments constitutifs
nécessaires à la réalisation de toute communication par le langage
humain articulé. Il s’agit de :
1. Emetteur (destinateur) : encodeur, expéditeur, locuteur, sujet
parlant. C’est lui qui émet, envoie le message, c’est lui qui en
4 ième
Marie Claude Célinas, Communication efficace, de l’intention aux moyens d’expression, 2 édition, les
Editions CEC 2001, p 4
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
28
est l’initiateur. Il peut s’agir également d’un groupe
d’individus, d’un journal, d’une radio, etc.
2. Récepteur (destinataire) : receveur, décodeur, auditeur…
c’est à lui que le message est destiné. Il peut être un individu
ou un groupe d’individus.
3. Message : l’objet de la communication c’est l’information à
transmettre…c’est le contenu de l’entretien.
4. Code : ensemble des signes et des règles de combinaison de
ces signes. L’émetteur y puise quelques signes pour encoder
son message. Le récepteur déchiffre, décode le message lui
destiné en utilisant les signes d’un même ensemble. Ainsi,
l’émetteur et le récepteur doivent utiliser le même code, les
mêmes signes, la même langue pour se faire comprendre. Le
français, par exemple, est un code commun entre enseignant
et étudiants.
5. Canal de communication : voie de circulation des messages,
de l’information. C’est un moyen qui met en contact
destinateur et destinataire ou qui établit et maintient la
communication, le dialogue, la discussion. Ainsi les canaux de
communication sont-ils définis par le milieu physique, social,
psychologique, par les moyens techniques auxquels le sujet
parlant a accès pour faire parvenir un message destiné à
l’auditeur de son choix (ex. radio, télévision, phonie, voix
humaine, sifflet, les professeurs n’acceptent pas l’interview).
6. Référent (contexte) : dans une communication, le message
est constitué à partir d’un contexte, d’une situation vécue,
d’une expérience, d’un thème, d’un programme ou d’un fait
imaginaire. Le référent sera compris comme ce à quoi renvoie
le signe (message). Ainsi, les interlocuteurs doivent-ils être
dans un même échafaudage socioculturel (langue) et le
message passe par un même code.
Remarques:
a) La communication a lieu si la réception du message a une
incidence observable sur le comportement du récepteur ;
b) Le but de la communication pédagogique est de transmettre
les éléments de formation pour produire chez l’apprenant les
changements d’aptitude souhaités ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
29
c) La condition spécifique de toute communication sociale est
d’être un phénomène bilatéral (E-R), un phénomène
réciproque (informer, écouter et réagir), un phénomène
d’échange (dialogue), une interaction, un phénomène de
compréhension réciproque (message transmis ou en
circulation entre l’émetteur et le récepteur doit être compris
par les deux) ou un phénomène unilatéral c'est-à-dire la
communication de l’émetteur vers le récepteur sans retour.
Bref, la communication peut se réaliser, soit de façon
unilatérale (sans réciprocité ex : radio, télé, professeur
n’acceptent pas l’intervention des étudiants), soit de façon
bilatérale (il y a dialogue, etc.);
d) Les signes d’un code ne sont pas naturels mais attributaires
et leurs significations doivent s’apprendre. Ces signes
renvoient aux situations vécues ou imaginaires ou encore
conceptuelles.
Référent
Emetteur Canal Récepteur
Message
Code
3. Fonctions du langage dans la communication
A ces six éléments constitutifs du schéma de la communication,
correspondent les six fonctions suivantes :
1. Fonction expressive
Elle concerne l’émetteur. En effet, elle exprime l’attitude du locuteur à
l’égard du contenu de son message et de la situation. Tout ce qui trahit
la personnalité de l’émetteur est de cette fonction. Ex : emploi de
« moi », « je », « nous » et parfois « on » dans certaines circonstances.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
30
2. Fonction conative
Elle se réfère au récepteur. L’usage de « toi », « tu » et de « vous » fait
partie de cette fonction.
3. Fonction référentielle ou dénotative
Elle est centrée sur le référent. Le message renvoie au contexte, aux
situations. Ex. : il, elle, le et ce concernent cette troisième fonction.
C’est à partir de la fonction référentielle que l’on peut distinguer les
niveaux de langue pour les classes sociales qui interviennent dans
l’interaction. Voilà pourquoi les interlocuteurs, pour mieux se
comprendre, doivent avoir un code commun, parler une même langue
soit orale, soit écrite (bien écrire et bien parler). En effet, un même
individu, le cas d’un secrétaire, il s’exprimera oralement ou par écrit de
façon différente selon qu’il est devant les étudiants, les enseignants, les
autorités académiques ou devant ses collègues administratifs, etc. Que
fait-il au juste ? Il adapte son langage à la situation de la
communication : les milieux sociaux, les cultures, la personnalité de
l’auditeur, l’humeur, les circonstances… tout ceci permet au locuteur
(émetteur) de varier (adopter) son langage oral ou écrit.
Ainsi, un sujet parlant peut changer de registre suivant son degré
d’attention.
En effet, il y a, à l’intérieur de chaque code, des niveaux, des registres
différents. Ainsi, l’oral ou l’écrit peut être familier (conversation entre les
membres d’une famille, entre amis, les proches) ou littéraire, soutenu
(pour les gens suffisamment instruits, les écrivains, les critiques ou
quand on s’adresse à un supérieur, à un étranger). Les différents
niveaux de langage sont : langage familier, langage populaire, langage
courant, langage littéraire (Châtié, soutenu), langage argotique, etc. Ce
serait une erreur de vouloir uniformiser tous ces niveaux dans le souci de
respecter le modèle unique. Toutefois, ce qui est souhaité et souhaitable
est de maîtriser plusieurs registres (façon de s’exprimer). Il faut savoir
adapter son langage à celui de son auditeur, de son interlocuteur. Le
niveau à utiliser doit être celui qui favorise le bon fonctionnement de la
communication : la langue qui permet la compréhension entre le
locuteur et le récepteur.
Illustration
Exemple A, pour désigner une femme en grossesse :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
31
1) Une femme qui attend famille : langue littéraire, soutenue
2) Une femme grosse : langue courante, familière
3) Une femme enceinte : langue populaire
4) Elle s’est fait arrondir le globe : langue argotique ou métaphorique
5) Elle a un député dans l’urne : langue argotique ou métaphorique
6) Elle a un polichinelle dans le tiroir : argotique ou métaphorique.
Exemple B : pour désigner une femme qui fait le trottoir
1) Une prostituée : langage soutenu
2) Une femme libre : langage courant
3) Une femme légère : langage populaire
4) Une ambulante, une horizontale, une omnibus, une
Trotteuse : langage argotique
5) Une couche-toi là : langage vulgaire
6) Une pute : langage vulgaire, registre bas.
Bref, les variations dans l’usage de la langue sont appelées des niveaux
de langues. On distingue, généralement, trois niveaux de la langue, qui
sont : soutenu, familier et courant. A ces trois, il faut ajouter le niveau
de langue argotique.
En effet, le niveau de langue soutenu (littéraire ou châtié) exige du
locuteur le respect de la syntaxe qui doit être soignée, une attention
réelle à son expression et à son comportement. Il s’agit d’une
communication avec une personne instruite, une autorité hiérarchique.
Tandis que le niveau de langue familier correspond à un discours
spontané qu’on engage avec les membres de famille, avec les amis, sans
contrainte du respect des règles grammaticales… Le niveau de langue
courant dans la vie quotidienne. Le vocabulaire, les expressions utilisées
dans ce niveau sont connus de tous. Quant au niveau de langue
argotique, il s’agit du langage particulier utilisé par un groupe social, un
groupe professionnel. Exemple, langage estudiantin. Il s’agit du jargon.
4. Fonction phatique
Il s’agit de contact physique ou psychologique. C’est ce qui sert à établir,
à maintenir ou à couper le contact.
Ex. : Allô, vous m’entendez ? Ne quittez pas l’écoute… il s’agit aussi de
toutes les formules de politesse à la fin d’une visite ou d’une lettre.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
32
5. Fonction métalinguistique
Elle est liée au code. Tout ce qui sert à donner des explications ou
précisions sur le code utilisé (langue) par l’émetteur relève de cette
fonction.
Ex. : Que voulez-vous dire ? Qu’est-ce que cela signifie?
6. Fonction poétique
Elle concerne le message en tant que tel. Tout ce qui apporte un
supplément de sens au message par le jeu de structure, de sa tonalité,
de son rythme, etc.
NB : Dans la pratique, ces six fonctions s’entrecoupent.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
33
3 : Langue comme moyen de guérir dans la gestion des
services en milieu hospitalier
0. Notion
La langue la langue constitue avant tout un instrument de
communication. Grâce à cet instrument, nous pouvons
communiquer toutes sortes d’informations, transmettre des idées,
discuter sur divers sujets. Mais, l’expérience scientifique démontre
aussi que la langue peut guérir la communauté et ses membres.
Il s’agit, somme toute, de la puissance ontologique de la parole, à ce
stade, il, (le langage) doit être perçu comme le siège où s’accomplissent
des actes qui visent à modifier la réalité. Par exemple, quand un
personnel soignant s’adresse à un malade après l’anamnèse pour lui dire
que tu es déjà guéris ou tu n’es plus malade, parce que je t’ai déjà
touché (je viens de te soigner), là, il parle certes, mais il ne fait pas que
parler, pourtant évidemment, l’on observera un nouveau comportement
de l’ex-malade ou du non malade, et on peut immédiatement contempler
une gaieté sans doute. L’allégresse et la jubilation sont affichées, parce
que, le médecin ou le personnel soignant a prononcé la guérison
(ressentie par le concerné).
Ainsi, sur le plan linguistique, comme en philosophie du langage,
précisément dans l’enseignement des Techniques de la communication
que notre groupe met désormais à la disposition des apprenants en
sciences de la santé à l’ISTM/Kinshasa, la pragmatique ne se réduit
pas en un seul code visant à exprimer la pensée et échanger des
informations. C’est-à-dire, après une longue expérience dans cette unité
de recherche, nous nous rendons déjà compte que la langue au tant que
le langage cache une information moins exploitée qu’est celle de la
puissance originelle. C’est, justement de cet aspect qu’il sera question de
pénétrer pour saisir son contour médical qualifié de thérapie
permanente ou mieux de panacée attitrée pour les actions idoines du
professionnel de santé.
1. Imposition thérapeutique de la langue
Dans le contexte linguistique, précisément dans l’enseignement des
Techniques d’’Expression Orale et Ecrite, la pragmatique ne se réduit pas
en un seul code visant à exprimer la pensée et échanger des
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
34
informations. C’est-à-dire, la langue cache une information moins
exploitée qui est la puissance originelle. C’est, justement de cet aspect
qu’il sera question de pénétrer pour saisir son contour médical qualifié
de thérapie permanente ou mieux de panacée attitrée pour les actions
idoines des professionnels de santé.
Il s’agit, somme toute de la puissance ontologique de la parole, à ce
stade, il, (le langage) doit être perçu comme le siège où s’accomplis
des actes qui visent à modifier la réalité. Par exemple, quand un
personnel soignant s’adresse à un malade après l’anamnèse pour lui dire
que tu es déjà guéris ou tu n’es plus malade, parce que je t’ai déjà
touché, là, il parle certes, mais il ne fait pas que parler, mais
évidemment, l’on observera un nouveau comportement de l’ex-malade
ou du non malade, on peut immédiatement contempler une gaieté sans
doute. L’allégresse et la jubilation sont affichées, parce que, le médecin
ou le personnel soignant a prononcé la guérison.
Il en est de même, lorsque le juge d’un tribunal déclare la séance est
ouverte, il accompli un véritable acte de parole qui consiste à ouvrir la
séance, aussi la séance n’est réputée ouverte qu’à la suite de l’acte
formulé. Aussi quand le jury prononce un résultat qui proclame un
message Finalisant du genre, tous les avantages dus aux licenciés vous
sont d’Office rattachés, lauréat vit à cet effet le déjà là.
2. Nécessité de la langue dans l’art de guérir : appréhension
fonctionnelle de la pragmatique.
Cela étant, dans le contexte qui est le nôtre, c’est-à-dire au sens de la
thérapie, la pragmatique sera appréhendée selon qu’il s’agit d’abord
d’une organisation, selon qu’il s’agira ensuite d’un projet et
essentiellement, selon qu’il s’agira enfin d’un résultat immédiat, les
trois évidences et acceptions correspondantes aux actes privilégiés de la
parole à savoir : actes locutoire, illocutoire et perlocutoire dans la
perspective des théories des actes du langage que professe Austin, il les
distingue d’ailleurs correctement et avec qui, nous essayons de
rapprocher nos connaissances dans cette considération triptyque :
- Acte locutoire : correspondant à l’organisation des mots selon
les règles syntaxiques, psychologiques, c’est-à-dire, selon les
situations, les problèmes, les étapes des conseils et d’orientation.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
35
- Acte illocutoire : correspondant aux projets, aux préventions,
acte de promesses (acte impérativement passif)
- Acte perlocutoire : correspondant aux résultats, c’est-à-dire,
les effets que la parole produit dans et pour le malade, (le
patient, par l’interlocuteur).
En s’adressant au patient, au malade ou à l’interlocuteur, autrement dit,
le Soignant en posant une question, il peut s’attendre au niveau
perlocutoire, à toute une série des réactions possibles. Il peut par
exemple, obtenir la réponse demandée tout comme une non réponse ou
une contestation de la part de celui-ci (l’interlocuteur) sur ses droits de
lui poser des questions ou d’en recevoir.
Cette théorie d’actes de langage est celui qui a donné naissance à la
pragmatique depuis Austin, elle n’a pas cessé de ressusciter la relecture
et commentaire, à la fois chez les philosophes du langage, comme chez
J. Searle, disciple d’Austin et chez certains linguistes parmi lesquels il
convient de citer Emile Benveniste et Oswald Ducrol.
En des termes moins savants, nous invitons les apprenant, le personnel
de santé à considérer la langue ou mieux le langage dans son champ
opératoire, comme l’un des moyens privilégiés dans l’ensemble des
actions et pratiques destinées à guérir, à traiter les malades dans la
mesure où, elles détiennent une vertu thérapeutique curative et/ou
préventive , tout dépend du choix opéré par le professionnel tant
au niveau du locutoire (choix des mots, pendant l’organisation),
illocutoire au niveau de la détermination du projet, qu’au niveau
du perlocutoire où le résultat devra être obtenu et réalisé.
Comme l’on peut s’en apercevoir, l’étude systématique du langage
présuppose la compétence linguistique des usagers (utilisateurs) que
sont les professionnels soignants et se préoccupe de mettre en évidence
aussi bien les éléments constitutifs et la structure fondamentale d’un
langage, le mode de relation de ce langage à la réalité dont il parle est
surtout l’interaction entre les usagers (malade- médecin)
C’est justement, à ce niveau que se révèle la réminiscence de la magie
triptyque de la parole avec ses composantes que sont : la syntaxe qui
renvoie aux locutoires, la sémantique qui plonge dans le locutoire, et
la pragmatique qui s’installe dans le perlocutoire.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
36
Chaque fois qu’on demande à un homme doué d’être pragmatique qu’est
-ce qu’on doit obtenir de lui réellement ? L’intérêt que le philosophe et
linguiste portent sur le langage s’explique par le fait qu’il est la forme la
plus haute d’une faculté inhérente à la condition humaine qui permet à
l’homme de se représenter et de le dominer ; car le langage facilite la
rencontre de l’homme avec sa réalité. Il en est la médiation obligée. Le
langage permet à l’homme de se comprendre et de bien saisir son
monde et ce monde.
2. Nécessité de la langue dans l’art de guérir
Il n’est aucun doute que la parole prononcée est une compétence du
professionnel de santé qui exige du répondant (qu’est le patient) un
comportement affèrent.
A cet égard, le langage a pour rôle essentiel, celui d’accompagner ou
mieux de garantir (au-delà de la confiance, la conviction), c’est à ce
niveau qu’elle constitue une puissance. Pour autant que la compétence
constitue une autorité, une aptitude, un pouvoir, une puissance selon
Chomsky qui est le premier à utiliser le concept compétence en tant que
système formé des règles dans la communication linguistique et les
éléments auxquels s’applique (les lexiques) la compétence est une
virtualité dont l’actualisation ou la réalisation (par la parole) demeure la
performance.
La performance, parce que l’on doit la simplifier, dérive de deux verbes :
parfaire et performer, c’est-à-dire résultat obtenu après la compétition
(parcourir), to perfom d’anglais (réaliser) Chomsky, l’utilise en 1966 pour
signifier réalisation d’un acte de la parole par la performance. Résultat
optimal que l’on peut obtenir de la suite d’une compétence (une
prouesse).
Ainsi, aux côtés des concepts centraux structurés en interaction dans
l’art de guérir, c’est-à-dire, la personne, l’environnement, les soins
et la santé, il conviendra d’ajouter la langue(communication) pour
nouer la jonction interactionnelle et systémique entre ces quatre
adjuvants5.
Notre enseignement se situe (au cœur du changement) aussi dans le
cadre des intentions prônées en faveur du changement ou du
5
Ce sont des enseignements que l’on peut trouver gratuitement dans les nouvelles considérations de l’art
scientifique contenues dans le manuel du Professeur Jean ELOHO intitulé les Frêles pas du savant en devenir
et /ou les repères du savant confirmé publié chez REAFCU, KIN, 2021.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
37
basculement (comme le dit le Ministre de l’ESU MOHINDO) vers
l’approche par compétence intégrée, précédemment celle relative à la
nécessité de transférer les apprentissages dans les pratiques
professionnelles.
Notre enseignement sur la pragmatique voudra fort bien contribuer au
rôle6 essentiel du personnel soignant consistant à aider le patient à
maintenir ou à recouvrer sa santé par l’accomplissement des tâches dont
il s’acquitterait lui-même s’il en avait la force ou la volonté, mais surtout
s’il disposait les connaissances voulues d’accomplir ses fonctions de
façon à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible.
Conclusion
Donc, la langue doit être appréhendée comme moyen fondamental pour
contribuer aux finalités édictées par la politique sanitaire nationale pour
le besoin de la communauté, un aspect visant une pédagogie centrée sur
l’apprenant dans une dynamique intégrative, cohérente et participative.
Aussi, dans les familles des situations professionnelles, le professionnel
de santé doit-il planifier son langage en tant que moyen de guérir dans
la prestation des soins tant au niveau gestion des services et des
structures, au niveau de formation en milieu hospitalier qu’au niveau de
recherche seul ou en collaboration.
6
Lire Referentiel de compétences de l’infirmier gradué des soins infirmiers généraux. Version Mars 2014
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
38
CHAPITRE III : COMMUNICATION ORALE INDIVIDUELLE ET EN
COMMUNAUTE
III.1. COMMUNICATION ORALE INDIVIDUELLE
1.1. PHYSIOLOGIE DE LA LANGUE (OU APPAREIL PHONATOIRE)
L’appareil phonatoire comprend l’ensemble des organes utilisés par la parole. Il
faut que plusieurs organes de cet appareil soient mis à contribution pour que le
son soit produit. Ces organes phonatoires sont les mêmes chez tous les êtres
humains normalement constitués.
1.2. L’Alphabet Phonétique International
Lors de la production du son si l’air expulsé des poumons ne rencontre aucun
obstacle (le passage est libre), le son produit est appelé voyelle. Si par contre,
dans son passage, l’air est contrarié par un obstacle on parle de consonne.
Chaque son est noté par un signe (à chaque son correspond un signe). Les
différents sons et leur notation ont été harmonisés par les linguistes. Ils
composent l’alphabet phonétique international (A.P.I.)
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
39
VOYELLES CONSONNES SEMI-CONSONNES
[a] date [b] bon [ ] Ex. dans « pied »
[ɑ] pâte [d] déjà
[ ]
[e] pré [f] fier
[ɛ] mère [g] gare [ ] Ex. dans « oui »
[ə] chemin [k] car [ ]
[i] cri [l] loup
[o] rose [m] main [ ] Ex. dans
[ɔ] note [n] non « nuit »[ ].
[ø] lieu [p] par
[œ] peur [R] rose
[u] trou [s] sol
[y] pur [t] tas
[ɑ] manger [v] ver
[ɛ] matin [z] zéro
[ɔ] saison [ʃ] chat
[œ] lundi [ʒ] jardin
[ŋ] agneau
[ŋ] smoking
1.3. PHONETIQUE FRANÇAISE
0. Notion et objet de la phonétique
La langue est une activité sonore qui se réalise entre la bouche de l’émetteur et
l’oreille du récepteur. Cette dernière retient mieux ce qui est prononcé, ce qui est
répété ou bien ce qui est négligé au cours de la communication. Elle est sensible
à la fois à l’harmonie et à la cacophonie, et elle est capable de dissocier les
différents paramètres des activités sonores : la hauteur des sons, l’intensité, le
timbre ou bien la durée peuvent être envoyés à l’oreille : ils sont produits par des
organes vocaux mais perçus et analysés par l’oreille.
En tant que système vocal, ‘’le langage [est] décrit par l’acousticien, par le
physiologiste, le phonéticien, le psychologue, le phonologue, l’oto-rhino-
laryngologiste, le phoniatre, le pédiatre, le psychiatre, le psychanalyste et le
philosophe’’ (Mounin, 1977 : 91). Mais la démarche de chaque science se
différencie de celle des autres. Le phonéticien peut être sensible à la production,
aux espèces des sons, aux nuances qui les distinguent les unes des autres et à la
prononciation des signes linguistiques, mais un autre chercheur peut étudier les
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
40
sons du langage humain de différents points de vue. Ce qui nous intéresse dans
cet exposé, c’est la démarche faite par la phonétique et par la linguistique.
Pour définir la phonétique, nous commençons par son étymologie. Le préfixe
‘’phon-‘’ (ainsi que le suffixe ‘’-phone’’) vient du grec : ‘’phône’’ signifie la
voix, le son. De même la phonétique aussi est un mot venant du grec. C’est un
adjectif dérivant du ‘’phône’’ : le mot ‘’phônêtikos’’ signifie un rapport aux
sons du langage humain. Il en ressort que la phonétique est un terme qui
concerne les sons produits par l’homme. La phonétique est l’étude des sons
d’une langue. Elle se fait indépendamment du rôle de ces sons dans la chaîne
parlée.
Puisque la langue est réalisée sur la substance sonore, c’est-à-dire qu’elle est un
système de signes vocaux, il est difficile de la distinguer des sons. Car un signe
linguistique trouve son existence par et dans des sons, parce que chaque signe
trouve sa valeur linguistique à l’aide des sons : par des sons, parce que chaque
signe a une valeur linguistique par opposition à un autre signe. D’autre part, du
point de vue de la prononciation, chaque signe linguistique a une forme définie
et acceptée par une communauté sociale. Chaque langue a ses sons particuliers.
Dans une langue, il y a un groupe de sons fixés par la communauté linguistique
qui la parle. Pour faire une communication verbale c’est-à-dire une
communication linguistique, chaque émetteur doit obéir à l’usage accepté par
telle ou telle communauté. A l’inverse, personne ne peut comprendre ce que dit
l’émetteur et il ne s’agira plus de communication linguistique. En définitive, le
langage humain trouve son existence et sa valeur sociale par les signes sonores.
On peut décrire les sons d’une langue selon trois points de vue différents :
D’après la manière dont ils sont produits par les organes de la parole ;
D’après les propriétés acoustiques des ondes sonores qui se propagent du
locuteur à l’auditeur, d’après leurs effets physiques sur l’oreille humaine et leurs
différents mécanismes. Ce qui donne les trois domaines de la phonétique, à
savoir : la phonétique articulatoire, la phonétique acoustique et la phonétique
auditive. Nous traiterons ici de la phonétique articulatoire qui est fondée sur
l’articulation des sons par les organes de la parole. La phonétique articulatoire
étudie les sons du langage en tant qu’entités physiques articulées par un
locuteur. Autrement dit, elle s’intéresse aux sons du point de vue de leur
réalisation par les organes de la voix.
La classification des sons est soumise à quelques critères :
La présence ou non d’un obstacle dans le chenal buccal (bouche) : on aura ainsi
la distinction entre les voyelles et les consonnes ;
Le voisement ou non. L’air chassé par les poumons passe sur les cordes vocales.
Celles-ci vibrent lorsqu’on prononce des voyelles et des consonnes sonores.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
41
Elles ne vibrent pas lors de la prononciation des consonnes sourdes. On aura à
partir de ce critère les sons voisés (sonores) et les sons non voisés (sourds).
Autrement dit, en termes articulatoires, on définit les voyelles comme des sons
voisés (sonores par nature). En ce qui concerne les consonnes, certaines sont
voisées (sonores) tandis que d’autres ne le sont pas.
1.3.1. VOYELLES
1. Critères articulatoires des voyelles :
- Le degré d’aperture (degré d’ouverture de la bouche). Selon ce critère, on
distingue :
Les voyelles ouvertes : [ ]
Les voyelles fermées : [ ][ ][ ]
Les voyelles mi-ouvertes : [ ][ ]
- Le lieu d’articulation permet de distinguer :
Les voyelles antérieures : [u] [o] [ɑ] [ɔ]
Les voyelles postérieures :[ ][ ][ ]
- La position des lèvres : selon ce critère, on distingue :
Les voyelles arrondies : [ ][ ][ ][ ][ ]
Les voyelles non arrondies : [ ][ ][ ][ ][ ]
- La nasalité : dans son itinéraire, l’air chassé des poumons peut sortir soit à
la fois par les fosses nasales et la cavité buccale, si le voile du palais est
abaissé, soit uniquement par la cavité buccale, si le voile du palais est
relevé. Dans le premier cas, on a des voyelles nasales ; dans le second cas,
on a des voyelles orales.
Voyelles orales : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Voyelles nasales : [ ][ ][ ][ ]
Exemples :
Ballon [ ]
Vent[ ]
Enfant[ ]
Parfum [parʃɛ]
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
42
2. Tableau vocalique
En additionnant ces critères, nous avons le tableau ci-dessous (l’exemple donné
dans ce tableau est celui du français qui a 16 voyelles) :
ANTERIEURES POSTERIEURES
Orales Fermées Ouvertes Fermée Ouverte
s s
[i] cri [ɛ] mère [u] sou [ɔ] note
[e] dé [a] date [o] rose [ɑ] pâte
[œ] leur
[ø] feu
[y] mur
[ə] gredin
Nasales [ɛ] brin [ɔ] bon
[œ] brun [ɑ] plan
3. TRIANGLE VOCALIQUE
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
43
1.3.2. CONSONNES
Les consonnes est un son comportant une obstruction, totale ou partielle, en un
ou plusieurs points du conduit vocal. La présence de cet obstacle sur le passage
de l’air provoque un bruit qui constitue la consonne.
Les critères pour définir les consonnes sont :
1. La nature de l’obstacle : l’obstacle peut être de plusieurs natures :
Une occlusion totale suivie d’une ouverture brusque produit les consonnes
occlusives p, b, t, d, k, g ;
Une friction, c’est-à-dire une occlusion partielle permettant quand même à
l’air de s’échapper (sifflement dû au passage difficile de l’air à travers les
parois du chenal buccal. Les principales consonnes fricatives
sont :[ ][ ][ ][ ][ ][ ] ;
La nasalité : l’air passe à la fois par la bouche et par les fosses nasales.
On aura les consonnes [ ][ ][ ][ ] ;
2. le point d’articulation, c’est-à-dire le lieu où se situe l’obstacle dans le
chenal buccal, par le rapprochement ou le contact de deux articulateurs.
Les organes de la parole qui correspondent aux différents points
d’articulation sont :
les lèvres : correspondent aux labiales ;
les dents : à partir desquels sont produits les dentales ;
les lèvres et la pointe des dents : pour les apico-dentales [ ][ ]
les alvéoles : pour les alvéoles
Le palais : pour les palatales ;
Le voile du palais : pour les vélaires ;
La luette : pour les uvulaires ;
L’apex (pointe de la langue) : pour les apicales ;
Le dos de la langue : pour les dorsales ;
Le pharynx : pour les pharyngales.
3. le mode d’articulation : ce critère est déterminé par la vibration ou non
des cordes vocales. Lorsque la consonne est accompagnée d’une vibration
des cordes vocales, elle est dites sonore(ou voisées). Ex. [ ][ ][ ][ ].
Les nasales sont toujours sonores. Lorsque les cordes vocales ne vibrent
pas, la consonne produite est dite sourde (ou non voisée). Ex. [ ][ ][ ][ ].
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
44
En combinant ces trois critères (nature de l’obstacle, point d’articulation mode
d’articulation) nous pouvons présenter les différentes consonnes dans un
tableau :
4. Tableau consonantique
Labiale Dentale Labiale Dentales
s s s
Orales occlusives [b] bal [d] dur [g] gare
sonores [p] pot [t] tir [k] col
[v] vol [z] zut [ʒ] jour
sourdes [f] fer [s] sol [ʃ] char
Fricatives [l] lac [R] rat
sonores [w] oui
[y] nui [j]
Liquides yeux
Semi-voyelles
postérieures
antérieures
Nasales [m] [n] non [ŋ] [ŋ]
mer digne smoking
Les semi-voyelles (ou semi-consonnes)
On appelle semi-consonne ou semi-voyelle un type de sons caractérisés par un
degré d’aperture de la cavité buccale intermédiaire entre celui de la consonne la
plus ouverte et celui de la voyelle la plus fermée. On a les semi-voyelles
suivantes :
[ ] Ex. dans « pied » [ ]
[ ] Ex. dans « oui » [ ]
[ ] Ex. dans « nuit »[ ].
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
45
Certains linguistes établissent une distinction entre les termes « semi-voyelles »
et « semi-consonnes », le premier étant utilisé lorsque le son se trouve en début
de syllabe, devant la voyelle, et le second lorsque le son se trouve après la
voyelle. Pour éviter ce débat, on utilise le terme global de « glide ».
1.4. Le langage verbal
Parler consiste à produire un bruit qui est la voix, le véhicule du message oral.
La voix est donc l’ensemble de sons produits par le larynx, lorsque l’air expiré
fait vibrer les cordes vocales. La phonation est l’ensemble des phénomènes
intervenant dans cette production sonore. Les sons peuvent être utilisés d’une
manière élémentaire ou intégrés à la parole. Nous imprimons à cette voix les
facteurs déterminants ci-après:
- Un relief, c’est la diction,
- La hauteur, c’est la sublimité,
- Une vitesse propre, c’est le débit,
- Une mélodie, (une prosodie), c’est l’intonation,
- Un timbre.
1.4.1. La diction
La diction est la façon de réciter ou de prononcer un discours. On parle de la
diction d’un journaliste, d’un orateur, d’un politicien, d’un prédicateur, etc. on
donne parfois comme synonyme à la diction les termes élocution,
prononciation.
1.4.2. La prononciation :
Ce mot définit tout ce qui concerne la correction et la qualité des formes sonores
en fonction d’un usage établi, en particulier les voyelles. La prononciation est
donc « la manière de produire, de réaliser les phonèmes d’une langue et les
traits prosodiques qui, dans la chaine parlée, accompagne la réalisation des
phonèmes (Galisson et coste, 1979 :448).
Prononçons-nous bien le français ? Du fait que, pour la plupart d’entre nous, le
français n’est pas notre langue maternelle, nous le parlons avec les substrats de
nos langues maternelles, et cela pour des raisons tout à fait simples : le français a
8 voyelles (i, e, é, è, ê, u, a, et o) et 16 phonèmes vocaliques (i, a, o, y, u),
Par contre, les langues Congolaises dont surtout les langues nationales ont,
tantôt 5 voyelles, et donc 5 phonèmes (i, u, e, o, et a) ; c’est le cas du ciluba, du
kikongo et du kiswahili. Tantôt 7 voyelles et aussi 7 phonèmes (i, u, a, e, o,)
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
46
1.4.3. L’articulation :
L’articulation est la prononciation des sons en les différenciant pour former les
mots. La parole est articulée en interrompant et en modulant le flux d’air à l’aide
des lèvres, de la langue, des dents, de la mâchoire et du palais. Pour les
phonéticiens de la phonétique articulatoire, elle ne concerne que les consonnes,
la prononciation se préoccupant de la production des seules voyelles. Pour
Saussure7, l’articulation est la façon de détacher et d’enchainer correctement les
sons de la langue, et en premier lieu, les consonnes, il s’agit des sons qui
proviennent d’une entrave du passage de l’air dans les organes supra glottiques,
procédant soit d’une fermeture (occlusion), soit d’un rétrécissement
(constriction) du conduit vocal. Pour une bonne articulation, il faut un bon
entraînement. Ce dernier consiste à faire des lectures à haute voix en détachant
les syllabes et à éviter de parler en gardant les dents serrées ou en pinçant les
lèvres.
1.4.4. La hauteur :
La hauteur de la voix, au cours d’une conversation, varie selon les personnes
Essentiellement déterminées par la longueur, la forme et la position des cordes
vocales, elle peut être volontairement modifiée, dans certaines limites, par
l’intermédiaire des muscles respiratoires et de ceux du larynx, en faisant varier
la pression d’air, ainsi que la tension et la position des cordes vocales (qui
peuvent s’éloigner ou se rapprocher l’une de l’autre) l’association de ces
élément détermine la fréquence de la vibration des cordes vocales : plus celle-ci
est élevée, plus la voix est aigue.
1.4.5. Le timbre de la voix :
C’est l’ensemble des caractéristiques qui permettent de différencier une voix. Il
provient en particulier de la résonance dans la poitrine, la gorge, la cavité
buccale et le nez, l’intensité des sons sont contrôlées par la force des vibrations,
qui dépend du débit avec lequel l’air est expiré.
1.4.6. La prosodie :
C’est le domaine de la phonétique qui s’intéresse à tout ce qui échappe à
l’articulation en phonèmes. Il s’agit donc d’un domaine assez vaste, qui
recouvre un ensemble hétérogène de phénomènes ayant la caractéristique
commune de ne jamais apparaître seuls et de nécessiter le support d’autres
signes linguistiques. Parmi les phénomènes importants dans le cadre de la
prosodie, on peut évoquer la mélodie, le ton, l’accent, l’intonation, le débit,
etc.
7
Lire le cours de linguistique générale
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
47
Les facteurs de la prosodie : tous ces facteurs prosodiques, appelés aussi
suprasegmentaux parce qu’ils échappent à la segmentation en unités sont, en
grande partie, déterminés par trois paramètre acoustiques, à savoir : la hauteur,
l’intensité et la quantité, qui sont des données physiques, mesurables grâce à des
appareils acoustiques de plus en plus performants (comme l’oscilloscope, le
spectrographe, etc.) la quantité peut être définie comme la durée nécessaire à la
réalisation d’un son, mesurable en centièmes de seconde la durée d’un son varie
en fonction d’un certain nombre de paramètres comme l’environnement
phonétique, la force articulatoire du locuteur, etc.
Importance des facteurs prosodiques :
Longtemps marginalisés, à la fois parce qu’ils sont peu ou mal transcrits à l’écrit
(qui constituait l’objet d’étude favori de la linguistique), les phénomènes
prosodiques acquirent progressivement une grande importance dans l’analyse
syntaxique, sémantique et pragmatique en effet, la prosodie joue un certain
nombre des fonctions linguistiques essentielles dont on peut citer ici les plus
importantes :
La fonction distinctive :
Certains facteurs prosodiques servent à distinguer un mot à un autre, il en est
ainsi, par exemple, de la durée des voyelles dans des langues comme le latin ou
l’arabe, de l’intensité (en anglais, par exemple, le même mot import peut être un
verbe ou un nom, selon que l’on accentue la première ou la deuxième syllabe
(respectivement import et import) exemple en lingala moto feu, moto homme,
moto la tête…
La prosodie est donc la mélodie, le ton varie de la voix que l’on prend en parlant
elle comporte trois types des catégories selon que les phrases sont déclaratives,
ou exclamatives.
a. La phrase déclarative : elle sert à affirmer et à informer.
- la journée est belle et les apprenants se saluent devant leurs salles de
cours.
Cette phrase a deux parties : une montante, dite protase, qui est soulignée
(intonation ouvrante) et une descendante, dite apodose ((intonation fermante)
b. La phrase interrogative : elle est uniquement montante (protase)
Est-ce clair ?-pierre est-il déjà parti ?
Mais une phrase interrogative peut contenir partiellement une apodose. Dans ce
cas, le sens communiqué n’est pas tout à fait le même que celui communiqué
dans une phrase interrogative normale qui ne contient que la protase :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
48
- Pourquoi n’irions-nous pas à la faculté ce soir ?
Ici, la protase n’affecte que la partie soulignée, tandis que l’autre partie est
fermante. Le locuteur qui pose cette question souhaite qu’on aille à la faculté
c’est même une invitation y aller. Mais dans pourquoi n’irions-nous pas à la
faculté ce soir ? Pourtant sur la seule intonation montante, le locuteur pose une
question et veut obtenir une réponse.
c. La phrase exclamative :
Elle est ouvrante : c’est affreux ; ou fermante : c’est affreux !
Comme on le voit bien, la prosodie sert la compréhension et traduit les
sentiments, l’émotion, la passion, la sincérité, …Elle peut affecter des mots.
Pour acquérir une bonne intonation, il faut s’exercer, patiemment, s’écouter,
écouter les locuteurs natifs du français et se contrôler.
La fonction significative :
Elle peut être rendue essentiellement par l’intonation par exemple, en français,
la différence sémantique entre il vient et il vient ? Est exprimée, à l’oral, par une
différence intonative (dans le cas de la phrase assertive, l’intonation est
descendante ; elle est montante dans la phrase interrogative), l’intonation joue,
dans la deuxième phrase, un rôle sémantique comparable à celui rendu par une
marque grammaticale (de type est-ce que).
Exercices d’application Numero I :
Opposition entre les phonèmes i/et /y /
- une rue lugubre me répugne.
- me jures-tu que tu ne fumes plus ?
- il cultive une multitude de tulipes.
- tu vis une minute de solitude
- Victor Hugo vécut rue des Ursilines
- jules suce une prune mûre et sucrée
- As-tu visité et bien vu Bruges et Bruxelles ?
- Que le public ridiculise une musique si pure et si divine, c’est curieux !
- Il plut si dru qu’il y eut une crue Budite
- La lune brille au-dessus de riches cultures
- Ursule eut de justes scrupules
a. Opposition entre u/ et y/
- Une source pure cours sous la mousse timide
- Ne cours plus sur la pelouse du couvent
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
49
- Surtout ne fumes plus tout ce que tu trouves ou tu tousseras beaucoup
plus !
- Joues-tu chaque jour de la flûte près de la source murmurante sans
invoquer la muse Euterpe ?
- Souffres-tu toujours d’une coupure au genou ?
b. Oppositions entre [œ] et [ø]
- Le jeune veuf demeure seul.
- Leur fureur fut si aveugle qu’ils tuèrent leur tuteur
- Les dîneurs veulent leur tilleul
- Leur sœur cueille des fleurs
- Ce club les jeunes aveugles qui ne veulent pas demeure seuls
- Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville (Paul Verlaine)
- Le jeune des jeunes est pénible
- Ce recueil des œuvres des Sainte-Beuve est le seul orgueil
- Ces deux jeunes veuf refusent de se remarier
c. Exercices avec quelques sons nasaux :
- Les thons sont de bons poissons
- « les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une
langueur monotone tout suffocant et blême, quand sonne l’heure, je me
souviens des jours anciens et je pleure et je m’en vais au vent mauvais
qui m’emporte deçà, delà, pareil à une feuille morte » (Paul Verlaine)
- Bon nombre de bons sont longs à fondre.
- Selon la façon dont on gonfle, le ballon rebondit vite
- Humbert est à jeun lundi
- Recompte donc le nombre de leçon déjà étudiées
- Ce matin-là, chacun eut un défunt à Verdun
- Jules fut un tribun comme pas un
- L’ensemble blanc d’Hortense est élégant
- En entrant dans la chambre de ses parents, Laurent chantait lentement
- En entendant ce chant du mendiant, le gendre d’Armand pensa à sa
propre enfance
- Il est grand temps d’entreprendre des changements profonds dans
l’enseignement des langues vivants
- Le singe grimpe bien d’instinct
- Ce marin américain revient de bien loin
- A vingt heures, le doyen vint à l’examen de latin
- Un monde sans conscience engendre un monde sans confiance
- En un an, on rencontre bien des gens gentils
- Un long ronron de mon chaton montre bien combien il est content
- Ce grand gamin brun a un accent londonien
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
50
1.4.7. Le débit
Le débit correspond à la vitesse de notre parole, au nombre de mots en une
minute, il est le mouvement de notre parole , on estime le débit normal entre 120
et 160 mots à la minute, un maximum de 200 mots peut aussi être acceptable, les
facteurs du débit sont la maitrise du langage (maitrise du vocabulaire et des
règles syntaxiques), du contenu à transmettre de la façon de respirer (éviter
l’asphyxie, les phrases trop longues ; éviter de parler vite, etc.) et l’ expérience
de la prise de parole par son débit, le discours acquiert certaines qualités :
- Un débit lent, calme, posé, confère au discours autorité, solennité, gravité
- Un débit rapide, précipité traduit le dynamisme, la colère, la gaieté
l’empressement mais il peut traduit aussi la timidité l’hésitation, le
manque de confiance en soi-même, le sentiment d’incompétence, la
culpabilité, le manque d’autorité, etc.
III.2. COMMUNICATION ORALE EN COMMUNAUTE
Techniques de conduire un exposé ou une réunion
Exposé préparé (ou la réunion)
Dans ce point, nous allons essayer de présenter succinctement comment réussir
cet exercice. Trois étapes sont à respecter :
a) A la maison ou au bureau (avant la séance)
A ce niveau, il faut bien préparer le sujet et le maîtriser :
Chercher la documentation pour y puiser la matière ;
Circonscrire (délimiter) le sujet ;
Rédiger le texte ;
Avoir un canevas, c'est-à-dire un guide présentant les grandes
articulations du sujet ;
Se proposer des questions et prévoir leurs réponses.
b) Dans la salle ou devant les auditeurs (pendant l’exposé)
Disposer d’une tenue d’un responsable, celle qui inspire confiance ;
Garder une attitude détendue : être gai, souriant, paisible ;
Eviter de se munir de beaucoup de papiers ;
Savoir écouter pour bien intervenir ;
Savoir apprécier, féliciter quelqu’un qui est bien intervenu dans ses
réponses, ses réactions…
Etre patient pour répondre à une question ;
Etre modeste, humble, simple : n’utiliser que les termes connus par le
public, c'est-à-dire adapter son langage à celui du public si non, on ne se
fera pas comprendre ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
51
Connaissant bien la capacité de compréhension de nos auditeurs, il faudra pour
nous faire comprendre : Etre audible et pour cela,parler pour celui qui est au
fond : Exposé préparé
2.1. Lecture à haute voix
La multiplicité et la diffusion prodigieuse des textes imprimés ne font
ombre d’aucun doute. Mais l’on constate paradoxalement que les gens,
même les plus instruits, lisent de moins en moins. Ils préfèrent pour être à
la pointe de l’actualité suivre les informations véhiculées par les images
(TV, films, théâtres, etc.) ou transmises oralement (par la radio, par les
appareils cellulaires, etc.). Cependant, ceux qui lisent les romans, les
journaux, les revues sont des gens qui sont soumis aux contraintes
professionnelles. Il s’agit de la lecture attentive, réfléchie. Elle permet
d’exercer sa réflexion et d’acquérir la connaissance solide. Mais la lecture
dont il est question dans ce point est seulement la lecture rapide
d’information courante et cela à haute voix devant un public.
Pour bien réussir cet exercice rocailleux, il faut éviter la lecture de mot
par mot. Car cette méthode la rend très lente. Or, on sait que l’œil voit des
ensembles plus importants et les mots essentiels ; il va aussi plus vite que
les muscles utilisés par la parole (lèvres, langue, cordes vocales, repris du
larynx dont les vibrations produisent la voix). Ainsi doit-on lire aussi vite
que possible mais tout en comprenant ce qu’on lit et en retenant
l’essentiel.
- La bonne lecture dépendra de :
L’intérêt qu’on accorde au passage, la longueur de la ligne, de l’écriture ;
La dimension ou le caractère de l’écriture, la difficulté du texte (manière
nouvelle ou non, vocabulaire familier), état de fatigue.
Retenons pour mémoire que « l’idée maîtresse du texte se trouve souvent dans la
première (introduction) ou dans la dernière phrase (conclusion) ; ce sont là
« des zones où il faut ralentir la lecture.
La lecture d’un texte à haute voix devant un public hétérogène présente
beaucoup de dangers pour sa réussite. En effet, le lecteur peut marmonner,
trébucher, trembler, se reprendre ou bien même si la lecture est correcte, le ton
et le débit sont si monotones qu’on perd le fil d’idées au bout de quelques
secondes. Pour surmonter cette difficulté, trois solutions sont à proposer : être
audible, être clair et être vivant.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
52
NB : Débit : c’est la manière de parler, de lire et non une quantité de liquide,
d’un gaz, d’électricité fournie par une source en un temps bien déterminé ; il
n’est pas non plus un endroit où l’on vend en détail. Exemple débit de boisson.
Il ne signifie pas non plus un compte de ce qui est dû au commerçant.
- Audible vient de AODIRE, d’audition qui signifie action d’entendre. On
a ainsi auditoire, auditif, auditeur, dont on doit connaître le sens.
a. Etre audible
Pour parvenir à se faire entendre, comprendre, il faut :
a. 1. Bien articuler
En effet, pour que l’auditoire (le public) ne perde pas un mot, une syllabe du
texte, il ne faudra pas parler entre les dents ; il faut prononcer distinctement les
voyelles, les consonnes.
a. 2. Regarder l’auditoire
Ne perdez pas contact avec le public en restant les yeux fixés au texte, si non
votre voix s’adressera au plancher. Comme l’œil va plus vite que la voix,
efforcez-vous à retenir l’ensemble de mots tout en regardant l’assistance.
Il faut noter que, pour bien lire, sans hésitation, on devra prendre connaissance
du texte avant de se présenter au public.
b. Etre claire
b. 1. Groupement des mots :
Liez en lisant d’un seul trait, les mots dont le sens rend solidaire.
b. 2. Ponctuation
Soutien essentiel du sens et du mouvement de la phrase, la ponctuation doit être
scrupuleusement respectée pendant la lecture. Elle permet aussi de respirer,
d’avoir le souffle ; mouvement de l’air que l’on expulse par la bouche ou par le
nez, pour venir à bout d’une longue phrase.
b. 3. Liaison
La rencontre de certains mots est désagréable à l’oreille et donne à la
prononciation une allure saccadée : d’où la nécessité de faire ou de respecter à la
lecture ou à la conversation la liaison.
La liaison est un phénomène d’union dans la prononciation. C’est l’union de
deux mots dont le premier se termine par une consonne et le deuxième
commence par une voyelle ou par un h muet de telle façon que la consonne
prenne appui sur la voyelle et forme une autre syllabe avec elle. En d’autres
mots, le phénomène de liaison consiste à prononcer une consonne
obligatoirement notée à la fin d’un mot lorsque le mot suivant commence par
une voyelle ou par un h muet.
Sortes de liaison : obligatoire, facultative et interdite.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
53
Liaisons obligatoires :
On lie un adjectif ou un déterminant au nom :
Ex : Les agents de la fonction publique ; petit enfant ; deux amis.
Exception : si l’adjectif se termine par R+ consonne normalement non
prononcée, la liaison se fait avec « R ».
Ex : Un court instant ; nord est ; corps à corps
Les dates. Ex : le trois avril ; le deux octobre.
On lie le verbe au pronom personnel il ou elle à la forme interrogative
directe.
Ex. : Croit-il être intelligent ? Prend-il ce chemin ?
Par analogie, on dira : mange-t-il bien ? Quand sera-t-il de retour ?
NB : T est une consonne euphonique qui est placée pour éviter le hiatus, la
cacophonie, c'est-à-dire la succession des voyelles qui forment un son
désagréable à l’oreille.
Autres exemples de consonne euphonique dans : vas-y, va-t’en ; que l’on se le
dise. Elle est aussi appelée mot explétif. Elle n’a pas de fonction grammaticale.
Après l’impératif + en ou y.
Ex : Buvez-en ; allez-vous-en.
Il y a liaison après « est » et « sont ».
Ex : il est allé au marché. Elles sont habiles.
Après les prépositions : chez, dans, sous, bien, tout...en…
Ex. : Rentrez chez elle ; dans une heure ; sous ordre ; en allant en Europe …
On fait la liaison après quand (affirmation devant est-ce que).
Ex : Quand est-ce que vous rentrez ? Quand elle est arrivée, elle t’a vu courir
derrière…
Mais on ne fera pas la liaison lorsque « quand » n’est pas suivi de « est-ce que »
ou de pronom personnel il ou elle.
Ex : Quand auras-tu cet argent ? Quand iront-ils à Kikwit ?
Après très, plus.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
54
Ex : Très urgent ; la vie devient de plus en plus …
La liaison est également obligatoire dans les mots figés ou le pluriel
normatif.
Ex : les Etats-Unis ; les Champs-Elysées ; les jeux olympiques ; Mesdames et
messieurs
Liaisons facultatives
o Elles peuvent se passer entre un nom au pluriel et l’adjectif qui suit.
Ex : les femmes aimables ou femmes//aimables.
o Entre le verbe et le mot suivant.
Ex : - Il chante une chanson ou il chantait//une chanson.
- Nous avons eu ou nous avons //eu.
o Après le participe présent.
Ex : -Voyant ainsi ou voyant//ainsi.
- Allant au campus ou allant //au campus.
o Entre pas et encore.
Ex : Pas encore ou pas //encore
o Plus ou moins ou plus // ou moins.
Liaisons interdites (les autres cas)
o Devant un mot commençant par un h aspiré.
Ex : le //handicapés ; le //héros ; le // hasard, le haricot etc.
o Avec la consonne graphique muette après (R).
Ex : Vers elle ; envers elle ; corps à corps ; de part et d’autre, nord-est.
o Après une pause.
Ex : j’ai vu des …//orages ; il a dit //oui
o Pour des raisons d’euphonie.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
55
Ex : Pot // à tabac ; deux heures// et demie.
o Dans certains mots composés.
Ex : Nez//à nez ; salle // à manger.
Remarques :
1. Les (h) aspirés sont nombreux dans des mots d’origine germanique
(néerlandais, allemands, anglais). Les plus usuels sont : la hanche, la
haie, la hauteur, la honte, la hernie, les héros, le hublot, le hors-bord,
hurler, la hutte, la hollande, la houille, le hibou, etc.
2. L’élision consiste en la suppression dans la prononciation et dans
l’écriture, d’une voyelle devant un mot commençant par une voyelle ou
un « h » muet. Ex : La histoire = L’histoire, L’étudiant.
3. L’enchainement s’applique à des consonnes qui sont toujours
prononcées et qui se lient à la voyelle du mot qui suit.
Ex : un(e) ami (e) ; une petit(e) enfant.
LES SONS DU FRANÇAIS
Exercices II
A l’oral, la langue française utilise trente-six sons, appelés phonèmes. Le
nombre de sons est donc plus grand que le nombre de lettres. Voilà pourquoi, en
français, la prononciation et l’orthographe sont parfois si différents. Les sons du
français se répartissent en voyelles, en consonnes et en semi-voyelles.
Voici quelques énoncés qui vous permettront de tester et de travailler votre
diction. Certains mots n’existent pas, ils sont créés pour ce travail spécifique. Ce
texte est de « bourgeois gentilhomme » de Molière, Acte II, Scène IV :
1. Alerte, Arlette, allaite! Un gradé dragon dégrade un dragon gradé.
2. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, etc.
3. Voici six cents chasseurs séchant sachant chasser sans chien.
4. Ton thé t’a-t-il ôté ta toux tenace ? ton temps têtu te tatoue ?
5. L’assassin sur son sein suçait son sang sans cesse.
6. Trois très gros, gras, grands rats gris grattent. Mur gâté, trou s’y fit, rat
s’y mit.
7. Cinq capucins portaient sur leur sein le sein du Saint-Père. Pour qui sont
ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? six slips chics, six chics slips.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
56
8. Didon dina, dit-on, du dos d’un dodu dindon. Papa boit peint dans les
bois. Dans les bois, papa boit et peint.
9. Donne-lui à minuit huit fruit cuits et si ces huit fruits cuits lui nuissent,
donne-lui huit fruits crus.
10. La cavale au valaque avala l’eau du lac. L’eau du lac lava la cavale au
valaque.
11. Sage chasseur âgé aux yeux chassieux sachant chasser sans chien chose
aisée, ce chat chauve caché sous ces six chiches souches de sauge sèche.
12. Si six cents scies scient six cents cigares, six cents scies scient six
cigares.
13. Ces cent six sachets, sachez cela, si chers qu’Alix à Nice tout en le
sachant, chez chasachax choisis, sont si chers chacun si chers qu’ils
charment peu !
14. Je veux et j’exige dix-huit chemises fines et six fichus fins ! je veux et
j’exige d’exquise excuse !
15. Ciel, si c’est cinq sous ces six ou sept saucissons-ci, c’est cent cinq sous
ces cent sept saucissons aussi.
16. Les grains de gros grêlons dégradent Grenade. Le scout mange son
casse-croute cru.
17. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à
l’excuisse. Ces fiches-ci sont à statistiquer.
18. Quand te désoriginaliseras-tu ? je me désoriginaliserai quand tous les
originaux seront désoriginalisés.
19. Dis-moi petite pomme, quand te dépetitepommeras-tu ? je me
dépititepommerai quand toutes les petites pommes se
dépetitepommeront. Or, toutes les petites pommes ne se
dépetitepommeront jamais, petite pomme ne se dépetitepommera jamais.
20. Si l’Américain se désaméricaniserait, comment le réaméricaniserions-
nous ? On le réamericanirait, comme on l’a désamericanisée, la
cathédrale.
21. Si la cathédrale se décathédraliserait, comment la décathédraliserait-on la
cathédrale ? on la recathédraliserait, comme on l’a décathédralisée, la
cathédrale.
22. Les chemises de l’archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? des
poches plates, des plates poches.
23. Lise et José, lisons ensemble et sans hésiter les des honnêtes indigènes
de Zanzibar
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
57
24. A dire de plus en plus vite : allez ! allo ? aller allo ? l’hallali, l’hallali
pour l’alouette.
25. Un pêcheur prépare pitance, plaid, pliant, pipe, parapluie, prend panier
percé pour ne pas perdre petits poissons, place dans poche petit pot
parfaite piquette, puis part pédestrement pêcher pendant période permise
par police.
26. Quand un cordier cordant veut corder une corde, pour sa corde cordée,
trois cordons il accorde. Mais si l’un des cordons de la corde décorde, le
cordon décordant fait décorder la corde.
27. Un ange qui songeait à changer son visage pour donner la chance, se vit
si changé, que loin de louanger ce changement, il jugea que tous les
autres anges jugeraient que jamais plus ange ainsi changé ne
rechangerait jamais, et jamais plus ange ne songea à se changer.
28. Très grand rodeur, quand redoreras-tu sûrement et d’un goût rare mes
trente-trois ou trente-quatre cuillères d’or trop argentées ? Je redorerai
sûrement quatre grandes cuillères d’or trop argentées, quand j’aurai
redoré sûrement et d’un goût rare tes trente-trois ou trente-quatre autres
grandes cuillères d’or trop argentées.
29. Quand un cordier cordent veut corder une corde, pour sa corde cordée,
trois cordons il accorde. Mais si l’un des cordons de la corde décorde, le
cordon décordant fait décorder la corde.
30. Une rue lugubre me répugne. Il cultive une multitude de tulipes et jules
suce une prune mûre et sucrée.
31. Tu vis une minute de solitude alors que Victor Hugo vécut rue des
Ursulines.
32. As-tu visité et bien vu Bruges et Bruxelles ? Que le public ridiculise une
musique si pure et si divine, c’est curieux !
33. Ursule et juste scrupule. Une source pure cour sous la mousse timide. Ne
cours plus sur la pelouse du couvent. Le chou cru est dépourvu de goût.
Surtout ne fumes plus tout ce que tu trouves ou tu tousseras beaucoup
plus ! et souffres-tu toujours d’une coupure au genou ?
34. Le jeune veuf demeure seul. Leur fureur fut si aveugle qu’ils tuèrent leur
tuteur. Les dîneurs veulent leur tilleul. Leur sœur cueille des fleurs.
35. Ce club, les jeunes aveugles qui ne veulent pas se remarier demeurent
seuls. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Le jeûne des
jeunes est pénible. Ce recueil des œuvres de Sainte- Beuve est leur
orgueil.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
58
Exercices III
JE SUIS GRELOT
Je suis grelot
Je suis mon nom
Je ne suis le gloglo d’étau intutoré d’ilot
ni le gluau d’étau ou de cymbale de flot
Je suis mon nom
Je suis grelot du dos Deleau
Je suis don du dos de l’eau
Mon nom d’onde luciole est d’aura d’Eden
Ce patronyme d’irradiation idéotextolatrie
Je ne serai du lot balourd
Lot lourdaud migratoire d’essai sans cesse
Je suis mon nom
Je suis grelot
Halo promu au grand écho
Echo d’Aiglons psalmodiés par griots d’aubaine
Je suis mon nom
JELOV
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
59
CHAPITRE IV : MOYENS DE LA COMMUNICATION ECRITE
Notions
Communication écrite renvoie nécessairement à la composition comprenant les
genres majeurs (nouvelle, roman, poème, texte de théâtre…) et les genres
mineurs (phrase, dissertation, rapport, compte rendu, lettre cv,discours…).
Dans le compte de cet enseignement, nous allons nous limiter aux
genres mineurs qui touchent directement aux objectifs professionnels des
apprenants à former en sciences de la santé.
Dans l’exercice de ses fonctions administratives, tout agent de n’importe quelle
administration (fonctionnaire, enseignant, étudiant, futur cadre de ce pays) est
obligé de bien écrire en français châtié, acceptable. Il est aussi appelé à rédiger
et à tenir des documents administratifs à fournir à ses autorités hiérarchiques.
Ainsi, l’agent de l’administration publique qui aura à rédiger une
correspondance qu’est un maillon de la chaîne administrative. Il doit alors
connaître et maîtriser les principes fondamentaux ci-après :
- Le respect de la hiérarchie qui crée et maintient l’ordre et la discipline
au sein de son service, de son institution ;
- La dignité, car le rédacteur rédige au nom de l’administration et non en
son nom propre ou de ses intérêts. C’est pourquoi, il sera poli et courtois
dans ses écrits.
2. COMPOSITION
La composition n’est rien d’autre que tout exercice d’écriture qui traduit le
niveau du raisonnement du rédacteur à l’occurrence de la dissertation, qui est
du reste, un exercice de la composition par excellence par lequel on peut à
juste titre évaluer le niveau de maturité scientifique d’un cadre. Elle est un
développement logique d’une maxime ou d’une pensée d’un auteur célèbre.
Ou carrément l’enchevêtrement d’un projet de recherche ou l’analyse d’une
thématique d’orientation. Dans le contexte qui est le nôtre, il s’agit surtout du
développement dans lequel l’apprenant examine en détail par des exemples et
des citations une thématique, une matière, une question d’actualité
scientifique ou un ouvrage précis.
La dissertation française comprend trois parties obligatoires :
1. Introduction
C’est la partie dans laquelle le chercheur présente le problème posé, il clarifie la
question soumise en réflexion. Dans l’introduction, le rédacteur doit répondre à
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
60
la question de quoi s’agit-il ? Il n’est pas question de donner les éléments de
réponse ou de développer les idées. Une bonne introduction peut comprendre
trois séquences à savoir : l’entrée en matière, le problème posé et l’annonce,
succinctement l’introduction peut annoncer les principales étapes du
développement.
L’introduction exige la compréhension du sujet. Cette compréhension suppose
l’analyse du sujet, c’est-à-dire l’explication du sujet ou la définition des mots
clés. La précision du sens exact de chaque terme. Pour un article en sciences de
la santé par exemple, l’explication des mots clés est obligatoire.
L’introduction doit être basée sur la compréhension du sujet et la capacité de
distinguer l’essentiel des accessoires dans la reformulation du sujet.
2. Développement
Le développement exige comme préalable, l’élaboration d’un plan logique de la
succession de grandes idées ou de grandes articulations du sujet. C’est le corps
du travail qui devra être organisé autour d’un plan de travail bien conçu par le
dissertateur lui permettant de bien agencer ses idées répondant à la cohérence
de trois principes : D’abord traiter le sujet et discipliner l’attention pour
éviter toute déviation par rapport au sujet traité, Ensuite, garder
l’originalité, Enfin, ne jamais trahir la vérité (et éviter de se contredire).
Le développement est appuyé par des citations qui dotent l’argumentation d’une
force probante et d’une autorité légendaire. Chaque paragraphe devra
développer une seule idée essentielle.
3. Conclusion
Dans la conclusion le rédacteur reprend brièvement les points essentiels du
développement ; le rédacteur doit exprimer clairement et nettement le résultat
auquel on est parvenu. C’est la synthèse ou la solution trouvée au problème posé
à l’introduction et analysé au développement. Il existe aussi de conclusion
perspective qui ouvre des voies aux nouvelles recherches scientifiques dans
lesµ même domaine ou alors on peut élargir le débat en évoquant d’autres
aspects susceptibles de retenir l’attention des personnes intéressées.
Bref, l’introduction pose le problème, le développement expose ou analyse ce
problème ou le sujet sous plusieurs aspects (les paragraphes), et la conclusion
exprime ce qu’on a souhaité avoir ou être.
Une citation doit être entre guillemets. La citation montre que vous n’êtes pas le
premier scientifique à avoir abordé ce sujet. Cependant, pour passer d’une idée à
une autre, d’un paragraphe à un autre, on doit utiliser les mots de transition,
mots de liaison.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
61
Notez bien : vous devez connaître ces mots charnières et savoir les employer.
3. RAPPORT
Dans le langage courant, on confond souvent le Compte Rendu et le Rapport.
Certains dictionnaires disent que ces deux concepts sont des mots synonymes. Il
est donc difficile, délicat d’établir une distinction entre ces deux mots. Mais, la
différence peut être établie à partir de la réalité professionnelle.
A cet effet, lorsqu’il est demandé de relater un événement, d’exposer une
situation en toute objectivité, il convient de dire qu’il s’agit d’un C.R à dresser.
Cependant, s’il vous est demandé de faire un examen personnel sur une
situation et d’en proposer une conclusion, une solution, une sanction, il
conviendra de parler d’un RAPPORT. Ainsi, dans le rapport, on fait une analyse
personnelle et on propose une solution, une sanction, etc.
Notion
Le rapport est un écrit d’une certaine ampleur qui analyse des faits ou une
situation en vue d’une décision à prendre par l’autorité hiérarchique,
responsable qui aurait diligenté ce rapport ou cette mission. On peut encore
définir le rapport comme « une étude approfondie d’une question intéressant
la vie d’une entreprise, le fonctionnement d’une administration donnant
lieu à l’autorité de prendre une décision, une sanction ».
Ainsi, le secrétaire, c'est-à-dire l’envoyé en mission, le rédacteur du document
doit être un connaisseur en la matière, un véritable collaborateur, un technicien
de l’autorité. Il rédigera son rapport avec objectivité et sincérité. Car, il sera
témoin et en même temps juge qui, après avoir analysé la situation, les
événements, propose à l’autorité des mesures (décisions, sanctions) à prendre.
Le rapporteur propose, suggère mais n’impose pas de décisions au chef.
1 .Différence entre rapport, C.R. et P.V.
Le rapport se distingue du C.R. par le champ d’application très
étendu ; il est nécessaire et utilitaire pour le destinataire.
Le rapporteur propose de solutions au chef (autorité hiérarchique qui en
décidera). Le verbe pour formuler les propositions sera au conditionnel. Car le
chef n’est pas obligé d’entériner ces propositions.
Le rapport est signé par le rédacteur seul ; le secrétaire est témoin et juge.
Le rapport se distingue du PV : Le PV est établi par une personne qualifiée.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
62
Le PV est signé par le verbalisateur (OPJ) et le(s) déclarant(s). Le déclarant
signe pour que le document ait une force de foi, pour l’authentifier.
84
Le PV évoque un contre sens. Car, il est toujours écrit tandis que le rapport peut
se faire oralement ou par écrit.
La première partie du rapport ressemble assez au PV par son souci d’objectivité.
Mais le rapport nécessite une analyse, une démonstration et des propositions
concrètes à soumettre à l’autorité hiérarchique.
Remarques
Le rédacteur d’un rapport doit se soumettre à un certain nombre des
règles morales qui sont :
- L’exactitude dans sa pensée : Les informations doivent être objectives.
- La loyauté : ne pas subordonner l’information à la base du rapport, à la
doctrine ou à un autre intérêt.
- La sincérité : le rédacteur (homme qui était en mission) ne se demandera
pas quelles remarques ou réflexions qui pourront être susceptibles à
plaire au destinataire ou à flatter son amour propre. Aucun fait n’est à
écarter pour la simple raison que son exposé serait désagréable à
l’autorité appelée à prendre une ou des décisions. Ainsi le rédacteur sera-
t-il un juge honnête, impartial qui devra manifester la neutralité, et
capable, de faire abstraction de son propre sens, de son propre intérêt et
sa propre passion.
L’autorité hiérarchique (le destinataire) n’est pas obligée d’exécuter ou
d’accepter les propositions des sanctions telles que lui suggérées par le
rédacteur du rapport.
2. Présentation du rapport
Il n’y a aucun modèle, aucune règle spéciale pour rédiger un rapport, mais il est
exigé sincère. Cependant, si le rapport est adressé à un ministre ou à un
Président de la République, il sera rédigé à la première personne du singulier et
s’adresser au destinataire à la deuxième personne du pluriel. Il s’agit du pluriel
de majesté. Le rapport, comme toute composition, comprend trois parties :
L’introduction
Le rédacteur fait connaître d’une façon précise le sujet traité, l’objet du rapport
et les instructions auxquelles il se réfère.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
63
Ex : A la suite de mon C.R n°007 du 28/12/200…vous avez bien voulu me
demander par la note n°14 du …./200… de vous faire parvenir d’urgence un
rapport détaillé sur le fonctionnement du centre de santé…
Ou …J’ai l’honneur de vous présenter les résultats de mon enquête du
…./.…200…sur l’évolution des enseignements à l’ISTM/Kinshasa.
Le développement ou le corps (nœud)
Celui-ci est constitué de fond même du rapport. Il contient des analyses, des
justifications, des argumentations relatives au sujet traité.
La conclusion (la finale)
Elle énonce, sous une forme claire, les propositions auxquelles le
développement a conduit. Ces propositions destinées à un supérieur hiérarchique
seront formulées au conditionnel. Car, c’est à l’autorité qu’appartient la
décision.
Erreurs à éviter quand on rédige un rapport
- Affirmer sans prouver.
Ex : « j’estime que la réclamation des résultats sur les points de l’interrogation
est dépourvue de tout fondement », il faut justifier ta position.
- Enoncer une opinion personnelle ne reposant sur aucun fait précis.
2. Différents types des rapports
A titre d’exemple, nous pouvons citer : rapport de mission, rapport de stage,
rapport des recherches, rapport scientifique, etc.
Parlons succinctement du rapport de stage
Le stage-période passée dans une institution (entreprise)- vous permet de
concilier la théorie et la pratique. Il est aussi une occasion de contribuer et
d’apprendre.
Le rapport dans ce cas consiste à décrire une ou des tâches que vous avez
réalisées sous la surveillance de votre maître de stage appelé encadreur local.
Comme toute composition, le rapport comprend trois parties à savoir :
a. Introduction
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
64
Dans cette partie, on y fera mention :
Du pourquoi sur le choix de l’institution (sanitaire) ;
De la présentation de cette institution d’accueil avec un bref aperçu
historique de son (ses) activité(s) ;
De la structure de son organisation (organigramme),
Du service (département) d’affection pendant le stage (ex. pédiatrie, salle
d’opération ; service du personnel, budget, etc)
La mission spécifique vous confiée.
b .Corps/ Développement
On trouvera dans ce point la description de toutes les tâches effectuées pendant
cette période de stage. Il sied de signaler le poste que l’on occupe dans
l’organigramme de ce centre ; on parlera également des personnes avec qui on a
été en contact, des résultats obtenus et de leurs analyses. Enfin, il faudra
présenter d’éventuelles difficultés rencontrées et des solutions y apportées.
c .Conclusion
Il s’agit d’insérer :
Le résumé du stage et de son accomplissement ;
Ce que le stage vous a apporté ;
Les propositions à soumettre :
o à l’institut d’origine c'est-à-dire l’autorité hiérarchique ;
o à l’institut d’accueil.
A cause de sa fonction utilitaire, le rapporteur de ce document évitera tout
enjolivement super flux. Il ne produira qu’un document objectif (fondé sur les
données vérifiées et tenues pour exactes), complet (n’omettant aucun aspect de
question des faits ou idées traités), être synthétiques (toutes les données de la
question examinée seront coulées sous forme d’un ensemble cohérent).
Le plan d’un rapport de stage
Le rapport de stage contient les pratiques suivantes :
- Page de garde
On y trouvera :
Nom, post-nom, prénom si on en a un ;
Intitulé (titre ou poste) et type de votre stage ;
Date ou période du stage ;
Nom plus logo de l’institution (université) ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
65
Nom de votre maître de stage plus intitulé du poste.
- Remerciements
Ils sont adressés au maître de stage et à une ou deux autres personnes en citant
leur nom, poste et la justification de cette gratitude. On peut aussi les destiner à
l’ensemble du personnel en général et à une ou deux personnes en particulier.
- Sommaire ou table de matière
Pour beaucoup de lecteurs (enseignants par exemple), faute de temps, ne lisent
que cette partie et la conclusion. C’est pourquoi, il faut bien choisir, avec
précision et clarté, les termes des titres pour que très rapidement la structure et le
contenu de votre rapport soient identifiables et compris. « En lisant votre plan, il
est déjà possible aux enseignants de juger votre travail. Il traduit la
problématique que vous allez développer, c'est-à-dire votre analyse du sujet ».
Introduction,
Développement,
Conclusion,
Bibliographie,
Annexes (si cela est possible pour compléter l’argumentation).
4. COMPTE-RENDU (C.R)
Définitions
Le compte-rendu est un document dans lequel le secrétaire-rapporteur
(rédacteur) relate de manière concise, claire, précise, soit un événement, soit une
situation des faits, soit encore une discussion qui se déroulent ou qui se sont
déroulés au cours d’une réunion. Il peut encore être défini comme un type
d’information qui donne une image directe et succincte d’un événement, d’une
négociation, d’un document (livre).
- Objet
Il s’agit d’informer un supérieur hiérarchique ou de conserver une trace écrite de
ce qui était relaté. Il laisse un témoignage durable d’une phase de discussion ou
d’opération en cours.
Sortes de compte-rendu
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
66
- Compte rendu analytique appelé improprement procès-
verbal
Dans ce genre de document, le secrétaire se borne à rappeler l’essentiel de
discussion ou des résolutions. Il sera le plus complet en n’omettant aucune
circonstance notoire.
- Compte rendu sténographique
Quand l’importance du sujet s’impose, les débats ou les discussions sont parfois
reproduits in extenso. Ce genre de C.R est utilisé dans les assemblées
parlementaires, les conférences internationales.
Mais nous, nous parlerons surtout du CR analytique (CR des réunions).
La présentation des comptes rendu d’une réunion
- Le titre
Ex. : C.R. de la réunion du... entre le DG et tous les chefs de promotion de
l’ISTM/Kinshasa.
- Phrase liminaire ou prologue : elle rappelle la date, l’heure, le lieu de
la tenue de la réunion, les noms et la qualité des membres présents et les
noms des excusés. Afin d’éviter toute erreur ou omission, le secrétaire de
la séance fait circuler une feuille appelée liste d’émergement ou liste des
présences où chacun insérera son nom et sa qualification.
Ex. Ce mardi, …./…/200… s’est tenue à 10h30’ en G1 SI de ISTM-Kinshasa,
sous la présidence du DG, une réunion en vue de fixer le montant des frais
d’études à payer pour l’année académique….
L’an deux mille dix-sept, le ….. Jour du mois de : s’est tenue, dans le local n°2,
une réunion présidée par le DG de l’ISTM-Kinshasa…
Etaient présents voir liste en annexe
Se sont excusés cfr liste en annexe.
- La présentation des points inscrits à l’ordre du jour, à soumettre à
l’appréciation de l’assistance.
Exemple :
- Lecture et adoption du C.R. de la réunion passée.
- Budget ou analyse des besoins de l’ISTM/Kin pour l’année
académique…
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
67
- Effectifs des étudiants pour tout l’institut
- Montant à payer par étudiant
- Divers
Après l’adoption de l’ordre du jour, le secrétaire cède la parole au président de
séance afin de développer tous ces points.
- Développement
Le secrétaire terminera ce document en écrivant par ex :
o Commencée à 10h30’, la séance fut levée à… ;
o L’ordre du jour étant épuisé, le président leva la séance à … ;
o La prochaine réunion aura lieu le …/../20… dans cette (même) salle et à
la même heure (par exemple) ;
Remarque :
Le C.R. est signé par le secrétaire rapporteur à gauche et le président à
droite.
Le secrétaire est un témoin qui rapporte seulement ce qu’il voit, entend,
vit et non juge.
Toute modification de fond et de forme sera apportée à la séance
suivante dans la rubrique « lecture et adoption du C.R. de la réunion
passée ».
Les copies de C.R sont distribuées ou remises aux participants et aux
excusés.
On peut rédiger un compte rendu d’un événement, tels que le match, les
théâtres, le film ou C.R. d’un livre.
5. PROCES-VERBAL (P.V)
Le procès-verbal n’est pas toujours un acte officiel établi par OPJ. C’est
pourquoi l’on distingue deux sortes de PV, qui sont :
Procès-verbal des événements périodiques
Ce PV suit le schéma du CR analytique. D’où il est défini comme « exposé
précis et fidèle qui relate les débats d’une assemblée, du conseil, du comité de
gestion, etc. ».
A la différence du CR analytique, celui-ci reproduit in extenso les interventions
les plus importantes en indiquant le nom et la qualité des intervenants dans le
débat, la discussion. S’il y a eu vote, on y mentionnera le mode de scrutin (à
main levée, scrutin secret) et le nombre des voix obtenues.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
68
Procès-verbal des événements imprévus, sporadiques.
Il s’agit des cas par exemple des PV de tricherie, de vol, de viol, d’assassinat,
etc.
Ce genre de P.V est dressé par une personne qualifiée appelée officié de police
judiciaire (OPJ en sigle). Il est alors compris comme « un acte juridique » c'est-
à-dire il est destiné à faire foi en justice. En effet, lorsqu’il est signé par le(s)
déclarant(s), il acquiert alors cette qualité.
Ainsi, il ne peut être attaqué que par la procédure d’inscription en faux ou par la
preuve testimoniale. Il est à noter que :
Le(s) déclarant(s) signe(nt) ce document après avoir lu et approuvé l’exactitude
des questions posées et de leurs réponses. C’est cette signature qui confère au
PV son caractère juridique, digne de foi.
Le PV est rédigé à la première personne du pluriel. Ce « nous » se dissout dans
la fonction de l’OPJ ou avec les participants.
Dans le cadre de notre cours et de notre vie professionnelle, quand on parle du
PV, il s’agit des événements sporadiques ou imprévus dont le rédacteur est un
OPJ. Tout responsable d’une entreprise, d’une association, d’un groupe peut ou
doit jouer le rôle d’OPJ lorsqu’il y a un événement nécessitant un interrogatoire,
un jugement, une preuve de culpabilité ou d’innocence à établir.
Titre de procès-verbal
Le titre est constitué par le mot « procès-verbal » suivi de l’indication sommaire
de l’objet de ce PV.
Ex : PV de tricherie ou PV d’assassinat, etc.
Texte de procès-verbal
Le texte, pour la rédaction de ce document, comprend trois parties ci-après :
Le préambule ou l’introduction : il contient l’énoncé de circonstance de
temps, de lieu, des personnes et d’action.
Le développement ou le corps : par le jeu des questions-réponses, le
verbalisateur (OPJ) va recueillir les informations sur l’événement qui fait
objet de ce PV. Il est à noter que le type des questions à poser n’est pas
stéréotypé. Elles dépendent d’une circonstance à l’autre.
La conclusion ou la finale : dans cette partie, le rédacteur (OPJ) indique
des propositions ou des suggestions. Il y mentionne la date à laquelle ce
PV a été rédigé suivi de la signature du verbalisateur et du déclarant ou
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
69
des déclarants après que celui-ci ait pris connaissance du texte, en
d’autres termes après avoir accepté tous les termes contenus dans le
texte.
Il est à noter, cependant, que le déclarant signera sans lui faire lire les
propositions ou suggestions qui pourront constituer la sanction.
Comme on peut le remarquer, il n’aura pas de liste des présences ni l’ordre du
jour. Le PV n’est signé que par le verbalisateur à droite et le(s) déclarants(s) à
gauche.
6. CURRICULUM VITAE (C.V)
C’est un mot latin qui signifie « Cours de la vie ». Il est un document important
qui présente le parcours professionnel d’un individu. On peut définir ce concept
comme « ensemble des renseignements concernant l’état civil, les titres, les
capacités et les activités passées d’une personne ».
Il comporte les étapes suivantes à respecter :
L’identité
- Nom et post-nom (prénom) ;
- Nationalité ;
- Lieu et date de naissance ;
- Village d’origine ;
- Secteur d’origine ;
- Territoire d’origine
- Province d’origine ;
- Profession ;
- Grade ;
- N° matricule ;
- Etat civil ;
- Lieu et date de mariage ;
- Nom et post-nom (prénom) de l’époux (se) ;
- Nom, post-nom, date et lieu de naissance des enfants ;
- Adresse complète ou n° tél….
Etude faites
- Enseignement supérieur et universitaire.
- Ecole secondaire
- Ecole primaire.
Diplômes obtenus
Exemple :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
70
15 juillet 1999 : Attestation de fin d’études n°… en Pédagogie appliquée
de l’ISP/Mbandaka Juillet 1996 : diplôme d’Etat n°…en Pédagogie
Générale.
Fonctions exercées/Expériences professionnelles
Exemple :
1995-1999 : enseignant (D6) au Complexe Scolaire de Gombele à Lemba
Righini ;
1999-2006 : Chef de bureau au Ministère de l’EPSP à Kinshasa Gombe,
etc.
Domaines de recherche
NB : c’est pour les enseignants de l’ESU et pour les chercheurs.
Publications et travaux rédigés
NB : c’est pour les enseignants de l’ESU et pour les chercheurs.
Activités para-académiques et extra- académiques
Exemple :
Entraîneur de l’équipe de football de l’ISTM/Kinshasa ;
Metteur en scène pour la troupe de théâtre ;
Secrétaire de la ligue de football de la ville de Kinshasa, etc.
5.8 Langues parlées couramment ou connaissances linguistiques
Je jure sur mon honneur que ces informations sont sincères et exactes.
Fait à …..le...…1…/20……
Nom et post-nom
Signature
Remarques importantes :
1. Indiquer aussi toute formation suivie.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
71
2. Ce type de CV est très détaillé. C’est pour quelqu’un qui est marié avec
des enfants et qui a une longue expérience dans sa vie professionnelle.
3. Ne reprendre que les rubriques qui vous concernent c'est-à-dire pour
lesquelles vous avez les éléments à signaler.
Quels sont les inconvénients d’un CV dont l’identité est détaillée comme ci-haut
indiquée ?
Que peut-on retenir de ce chapitre ?
Pour réussir toute composition, il faut respecter et appliquer les règles de la
stylistique et de la grammaire française (précision des termes, clarté, harmonie
dans la construction des phrases, accord des participes passés, conjugaison, etc.)
Quand on traite un sujet, il faut le terminer, c'est-à-dire l’aborder entièrement.
Toute composition française comprend généralement trois parties :
l’introduction, le développement et la conclusion qui sont développés sur la
dissertation.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
72
7. LETTRE ADMINISTRATIVE
Tout agent de l’administration publique est obligé de rédiger une
correspondance, lui, en tant que maillon de la chaîne administrative. Il doit
à cet effet connaître et maîtriser les principes fondamentaux ci-après :
- Le respect de la hiérarchie qui crée et maintient l’ordre et la
discipline au sein de son service, de son institution ;
- La dignité, car le rédacteur rédige au nom de l’administration et non
en son nom propre ou de ses intérêts. C’est pourquoi, il sera poli et
courtois dans ses écrits.
Voilà pourquoi, cette partie qui est essentiellement consacrée à la rédaction
des documents administratifs est d’une grande utilité pour nos apprenants
dans la mesure où elle traitera de la lettre administrative et du discours qui
sont des documents réguliers.
La lettre administrative est un moyen de communication par écrit. Il s’agit de la
missive, de la correspondance. Elle sert à transmettre ou à recevoir les
informations. Le concept lettre peut revêtir plusieurs significations selon les
circonstances de son emploi. Ainsi aurons-nous:
Lettre ouverte : c’est un article à caractère polémique ou revendicatif
rédigé dans un journal sous forme d’une lettre.
Lettre morte : c’est une lettre sans suite, sans réponse, etc.
Homme des lettres : écrivains mais par extension, on parle de tout celui
qui a suivi et suit les études littéraires.
Lettre en un mot : c’est un élément, un composant d’alphabet servant à
transcrire une langue.
Ex.: a, b, c, d, e, f…, z.
0.1. TYPES DE LETTRES
0.2. Lettre usuelle
Félicitation, faire-part, naissance, mariage, baptême, décès, remerciements…
0.3. Lettre administrative
Répond à des normes précises (règles de bienséance, formules d’entrée et de
clôture).
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
73
La nécessité d’une correspondance
La lettre en tant que missive reste nécessaire et irremplaçable dans toutes les
circonstances en dépit de la présence des téléphones. Il est donc indispensable
de savoir écrire.
Autres temps, la lettre était un jeu d’esprit, un exercice de style. Mais
aujourd’hui, la fantaisie, le bavardage de la grande époque est passé et a cédé la
place au sérieux culturel. La correspondance revêt un caractère utilitaire.
FONTENAY disait : « la lettre est le meilleur et le plus sûr moyen de régler
courtoisement de façon précise et tangible nos rapports sociaux. Par rapports
sociaux, nous entendons nos sentiments profonds, nos besoins, nos obligations
amicales et nos relations d’affaires.
Qualité de style épistolaire
Tout le monde n’est pas appelé à écrire un roman, une tragédie, une nouvelle, un
recueil de poèmes avec succès. Mais nous pensons que chacun de nous possède
ce qu’il faut, dès l’obtention de diplôme d’Etat, pour écrire une lettre
convenable. La lettre comme missive doit revêtir les caractères suivants : la
clarté, la précision, la correction, la concision, la courtoisie, la simplicité. Le
style sera simple et direct. Ainsi, les termes cérémonieux, les tournures
maniérées, les images pittoresques n’y ont plus de place. Et FONTENAY
d’ajouter : « fuyons, comme la peste, l’emphase, la boursouflure, la prétention,
le cliquant, la plume à main, restons nous-mêmes ».
La recherche de la simplicité dans nos écrits ne doit pas nous conduire à la
vulgarité liée à la familiarité déplacée. Cherchons plutôt le juste milieu.
Exposons le message avec exactitude, précision et cela de façon complète et
claire. Faisons un choix juste des mots en évitant des mots passe-partout, des
termes ambigus.
C’est pourquoi avant de rédiger sa lettre que l’on réfléchisse sur le message à
transmettre et que l’on se pose des questions ci-après :
Qu’a-t-on exactement à écrire ?
Quels sont les détails les plus importants ?
Sur quel point doit-on insister plus particulièrement ?
Que doit-on attendre de son destinataire ?
A côté de la simplicité, la correction et la clarté, la politesse (courtoisie), la
précision, la lettre ne laissera paraitre ni l’impatience, ni la mauvaise humeur.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
74
NB : Une lettre écrite avec beaucoup de fautes dénote le manque d’instruction
et fait tourner au ridicule son auteur.
1. Présentation de la lettre
Notre correspondant (destinataire) devra être favorablement impressionné par
notre lettre. Par conséquent, il nous revient de soigner au maximum la
présentation matérielle de notre correspondance :
1.1. Qualité du papier
Il est recommandé d’utiliser le papier blanc et de bonne qualité, de préférence de
format moyen. Il faudra prévoir une marge.
1.2. Encre
On aura à choisir parmi ces trois couleurs : noir, bleu, violet. L’encre noire est
classique, elle ne peut déplaire à personne.
1.3. Ecriture
Elle doit être lisible et sans rature. La lettre sera aérée, sans gommage et sans
surcharge. Soignez également l’orthographe.
2. Composition de la lettre
Une lettre est composée de deux sortes d’éléments : éléments externes au texte
et ceux internes au texte.
2.1. Les éléments externes
1. Lieu et date
2. En-tête : adresse exacte de l’expéditeur ou de l’établissement.
3. Adresse du destinataire ou suscription (située sous le lieu et date). C’est
le texte (adresse) à mettre sur l’enveloppe.
4. Référence : N° Réf. Ex. N/Réf. 619/ISTM/SGAC…de celui qui écrit ;
V/Réf. de celui à qui on répond. C’est une mention qui a pour but de
rappeler les documents antérieurs auxquels on se reporte et qui motivent
la suite qu’on leur donne. Bref, c’est l’indication pour retrouver très
rapidement dans le dossier, le document auquel le correspondant se
réfère.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
75
NB : On peut ne pas mettre la référence
5. Vedette ou appellation.
6. Objet ou concerne ou encore affaires ; il s’agit d’un résumé du contenu
de la lettre.
7. Signature. NB : une lettre sans signature est un tract, elle doit être
manuscrite et lisible.
8. P.S. (Post-scriptum). Il est facultatif, on l’utilise lorsqu’on a oublié
quelque chose qu’on devra insérer. Il s’écrit après avoir apposé la
signature, il doit être bref.
9. a. Transmis copie pour information.
b. C.I. : copie pour information (à gauche et en bas).
2.2. Les éléments internes
Le contenu d’une lettre varie selon la nature et l’objet de ladite lettre.
Cependant l’entrée en matière et la finale méritent une attention particulière.
On compare ce point à la manière dont un visiteur se présente et prend congé de
vous. Ainsi a-t-on deux formules :
2.3. Formules introductives ou d’entrée
Comment débuter une lettre administrative ? On introduit une lettre de la
manière la plus brève mais claire. Lorsqu’un inférieur écrit à un supérieur, il
commencera par exemple :
J’ai l’honneur de venir auprès de votre haute personnalité, solliciter une
vacance en qualité d’infirmier, (d’AG, de technicien n...).
Par la présente, je viens introduire ma demande d’emploi en qualité
de…
L’honneur m’échoit de venir déposer ma lettre de recours… ou vous
transmettre le rapport (le C.R.) du…
Lorsqu’on répond à une lettre, on pourra utiliser une de quelques formules
suivantes :
J’accuse bonne réception de votre lettre du … relative à …
J’ai l’honneur d’accuser bonne réception de votre lettre du … relative à
l’objet ci-haut…
Suite à votre lettre du … relative à …
Je vous suis très reconnaissant d’avoir bien voulu m’informer de…
Je suis heureux d’apprendre par votre lettre du … ma nomination comme
chef de travaux…
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
76
Par ma lettre du … je vous priais ou demandais de m’envoyer…
C’est avec beaucoup de regret que je réponds à votre lettre de demande
de transfert…
2.4. Formules finales, de politesse ou de clôture.
Comment terminer une lettre ?
Veuillez accepter, monsieur/madame… l’expression de mes sentiments
distingués.
Dans l’espoir d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le
DG (Son Excellence), l’expression de mes sentiments de franche
collaboration.
Espérant que cette requête retiendra bien votre particulière attention, je
vous prie d’accepter, Mr/Mme, mes respectueuses salutations.
Tout en vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Mr/Mme,
mes remerciements anticipés et patriotiques.
Agréez, madame/ révérende sœur/ révérend père/ son éminence,
l’expression de mes sentiments patriotiques et révolutionnaires, etc.
Pour vous permettre d’avoir une vision plus ou moins concrète, exacte sur ce
point, voici comment vous devez présenter votre papier.
Enfin, je vous convie de consulter les quelques lettres administratives en annexe.
Présentation de la lettre
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
77
Exp :………………………. Lieu et date N° Réf……………………..
Objet : Demande d’emploi A Monsieur le Médecin directeur
de l’HGR/Kin
à Kinshasa-Gombe
Monsieur le Médecin Directeur,
1er § J’ai l’honneur de venir très respectueusement
auprès de votre bienveillance solliciter une vacance en qualité de…
2ème § En effet, je suis détenteur d’un diplôme de licence en
Techniques médicales.
3ème § Je vous prie d’agréer, Monsieur le Médecin
Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.
Nom et post nom
Signature
C.I : -DAF
-AGT
- Comptable
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
78
Exp : Kinshasa, le ……. N° Réf
Transmis copie pour information à :
- Son Exc. Mr le Min à l’ESU
- Mr le SG à l’ESU
- Mr le président du C.A des IST
Tous à
Kinshasa-Gombe
Objet : A Mr le DG de l’ISTM-KIN
A KINSHASA XI
Monsieur le Directeur Général,
1er § Par la présente, je viens auprès de votre
haute personnalité solliciter une vacance entant qu’infirmier A2.
2ème § En effet, je suis détenteur……………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3ème § Veuillez agréer, Mr le DG, l’expression de
mes sentiments distingués ………….……………………………………
Nom et post-nom
Signature
P.S. (si possible)
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
79
8. DISCOURS
Les fonctions des discours dans la communication
Quand nous parlons ou quand nous écrivons, nous produisons un discours.
Mais, selon les circonstances, la situation et la personne (ou les personnes) à qui
nous nous adressons, nos intentions sont différentes : on peut vouloir raconter
une histoire, décrire un lieu, expliquer le fonctionnement d’une machine,
convaincre quelqu’un qu’il a tort, etc.
Quelles sont donc les principales fonctions des discours ?
1. Raconter : le discours narratif
Nous vivons dans un monde des récits tous les jours, nous racontons, ou on nous
raconte, des faits, des anecdotes de la vie quotidienne. La presse écrite, la
télévision rapportent des évènements politiques. Des exploits sportifs, des faits
divers qui ont réellement eu lieu. Les romans, les bandes dessinées nous
plongent dans des histoires imaginaires. Les films, eux aussi, racontent des
histoires en images.
Pour qu’il y ait un récit, il faut qu’un évènement au mois, grand ou petit, se soit
passé. L’histoire a un début et une fin : entre les deux, la situation, par étapes, a
évolué par exemple, entre le moment ou le petit prince apparait dans le désert à
l’aviateur et celui où il meurt, piqué par un serpent, il a fait plusieurs rencontres
qui lui ont montré qu’il ne pouvait pas s’adapter à la vie sur notre planète.
Dans chaque histoire, il y a un ou plusieurs personnages. Ils agissent sur les
évènements ou bien ils en sont les victimes. Dans les contes, on trouve toujours
un héros, des ennemis, une victime chacun, ainsi a un rôle dans l’histoire.
L’histoire se déroule dans certains lieux et à une certaine époque, qu’on peut ou
non déterminer. Les verbes et les indications de temps montrent la succession
des actions et leur progression.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
80
2. Décrire : le discours descriptif
Les guides et les dépliants touristiques, les publications des agences
immobilières, les catalogues, et, d’une façon générale, toute la documentation
technique décrivent les paysages, maisons, objets, etc., avec ou sans images.
On trouve également des descriptions insérées dans les récits quand on raconte
une histoire, on a besoin en effet de faire imaginer au lecteur les lieux où elle se
déroule (paysages, habitations), les personnages, hommes ou animaux, qui en
sont les acteurs. Le portrait est une forme particulière de la description.
3. Expliquer : le discours explicatif
Dans une encyclopédie, un ouvrage documentaire, un manuel, on trouve des
textes explicatif qui fournissent des informations de manière organisée ; les
phénomènes (scientifique, historique, etc.)
Sont expliqués, décomposés logiquement dans un guide touristique, le mode
d’emploi d’une machine ou la règle d’un jeu, les informations sont associées à
des explications qui permettent d’agir : d’organiser son voyage de se servir de la
machine, de jouer…
Par opposition au discours argumentatif, le discours explicatif est neutre ; son
auteur ne se manifeste pas.
4. Convaincre :
Le discours argumentatif, c’est quand on veut défendre son opinion, son
innocence ou quand on veut montrer à quelqu’un qu’il a tort, on cherche à le
convaincre. Pour cela, on avance des raisons que l’on juge bonnes : ce sont des
arguments. L’auteur d’un texte argumentatif s’adresse directement à son lecteur.
Il veut le faire réfléchir mais souvent aussi toucher sa sensibilité. Il organise ses
arguments de manière logique ; pour les rendre plus parlant, il fait appel à des
exemples.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
81
Les avocats, les hommes politiques produisent des discours argumentatifs, mais
on en rencontre également dans les romans ou les pièces de théâtre, chaque fois
qu’un personnage veut convaincre.
5. Plusieurs types de discours dans un même texte
Dans une même œuvre, on en rencontre tous les types de discours ; c’est le cas
en particulier des romans. Ces extraits tirés du petit prince de saint–Exupéry le
montrent clairement :
« Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute
terre habitée (…) Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand un
drôle de petite voix m’a réveillé. » (Discours narratif).
« La cinquième planète était très curieuse. C’était la plus petite de toutes. Il y
avait juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbères. »
(Discours descriptif)
« Quand il est midi aux Etats –Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur
la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au
coucher du soleil. » (Discours explicatif).
« La preuve que le petit prince a existé, c’est qu’il était ravissant, qu’il riait, et
qu’il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c’est la preuve qu’on
existe. » (Discours argumentatif)
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
82
CHAPITRE VI : EXIGENCES DE L’ECRITURE
1. QUALITES D’UN BON STYLE
La première qualité du bon style est la clarté, c’est-à-dire, on rédigera un
texte avec exactitude et précision complètement et clairement. En d’autres
termes, on veillera à l’orthographe, à la ponctuation, à la syntaxe, à la
présentation et à l’exactitude des faits.
Ainsi, un bon style doit revêtir les qualités suivantes :
La précision des termes : c’est le choix judicieux des mots. Il faut choisir
les mots et les placer à l’endroit qu’il faut. Pour cela, on évitera les termes
incolores et vagues (Ex. chose, machin, homme, gens, ceci, cela, personne,
affaires, quelques choses) ; les Verbes plats ou passe-partout (ex : dire,
faire, être, avoir, mettre, se trouver, pouvoir, y avoir…) pour les remplacer
par des termes et verbes propres.
1. La clarté : est la qualité qui consiste à respecter les règles du
français et à éviter les ambigüités, les confusions, les
interprétations erronées et les amphibologies (ex : j’ai vu la voiture
du DG dont le derrière est rouge).
2. La concision : être bref dans le parler ; c’est-à-dire ne parler,
n’aborder que l’essentiel en évitant le bavardage creux.
3. L’harmonie du style : implique un usage très minimum des
conjonctions, des pronoms relatifs, des participes présent et des
adverbes. Car, tout ceci alourdit le style.
4. La ponctuation : c’est une technique et un art d’indiquer des
pauses, des changements mélodiques ou des registres de la voix
dans un discours écrit.
Elle est l’ensemble des signes conventionnels servant à indiquer, dans
l’écrit, les faits de la langue orale comme pause et l’intonation ou à
marquer certaines coupures et certains liens logiques. Elle est comparable
aux fenêtres pour servir d’aération.
Les signes de ponctuation ou signes syntaxiques servent à distinguer selon
le sens, les phrases et les membres de phrases dans la langue écrite.
Quoique négligée à tort par bien des gens, la ponctuation est un élément de
clarté, de lisibilité : elle permet de saisir l’ordre, la liaison, le rapport des
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
83
idées. Elle évite de fausses interprétations. Mal placée, la ponctuation peut
modifier complètement le sens de la phrase.
Ex : Le client prétendait le vendeur ne respecte pas ses engagements. Il y a
deux possibilités pour la bonne compréhension, qui sont en plaçant les
signes de ponctuation :
1ère : le client prétendait : « le vendeur ne respecte pas ses engagements ».
2ème : Le client, prétendait le vendeur, ne respecte pas ses engagements.
Les principaux signes de ponctuation sont :
Le point : (.) : marque la fin d’une phrase.
Ex : nous suivons le cours de logique et expression orale et écrite.
Remarques :
1. La lettre qui commence la nouvelle phrase doit être en majuscule.
Ex : Faites attention, car le DG vous parle.
2. Si la phrase se termine par un point d’interrogation, ou par le point
d’exclamation ou de suspension ; ces signes tiennent lieu d’un point
ordinaire, c’est-à-dire le premier mot de la phrase suivante sera en
majuscule.
Le point d’interrogation (?) : s’emploie à la fin d’une phrase
interrogative.
Ex : Que feras-tu demain ?
Remarques :
1. Ce signe exige l’inversion du sujet.
Ex : Peux-tu venir avec nous ?
2. Phrase interrogative peut se retrouver insérée dans une autre phrase.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
84
Ex :
- Avant-hier, vous en souvenez-vous ? Nous suivons le concert de
Koffi OLOMIDE.
- Tu viens déjeuner demain, lui demanda-t-elle à mi-voix.
Lorsque l’interrogation est indirecte, on n’a pas de phrase interrogative et il
ne faut pas de point d’interrogation et il n’y a pas non plus d’inversion du
sujet.
Ex :
- que vous êtes belle!
- furieux, il cria : « Va-t’en! »
- Puisse-t-il réussir! Ô rage! Ô désespoir! Ô vieillesse ennemie!
- Quelle fille!
La virgule (,) : marque une pause de peu de durée à l’intérieur de la
phrase. Elle s’emploie :
- Entre les termes coordonnés, obligatoirement entre les termes
coordonnés sans conjonction.
Ex : Voici des fuites, des feuilles et des branches.
NB : on ne l’emploie pas entre différentes parties d’une somme.
Ex : Vint francs cinquante centimes.
- Elle s’emploie généralement quand les termes sont coordonnés par
une autre conjonction que et, ou ni.
Ex : Il est riche, mais avare. Il a réussi, car il travaillait bien.
Cependant, une virgule peut apparaître lorsqu’il y a une raison particulière,
par exemple quand la conjonction unit des phrases dont les sujets sont
différentes.
Ex : La fille s’est éloignée, et les garçons sont restés sur place.
- On la retrouve également devant les conjonctions et, ou, quand elles
sont répétées.
Ex : Notre terre est belle, riche et féconde.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
85
- On l’utilise aussi devant etc.… terminant une énumération.
Ex : Nous t’avons demandé d’amener des papiers, des crayons, des stylos,
etc.
- Entre les termes subordonnés. Lorsque les termes subordonnés ont
une valeur explicative, ils sont généralement séparés par des
virgules de ce qui les entoure. C’est le cas de l’opposition et de
l’épithète détachée.
Ex : Mon père, homme réfléchi, de culture est un C.T. à l’ISTM. Kinshasa.
NB : Parmi les propositions, la virgule permet de distinguer celles qui sont
déterminatives et celles dites explicatives.
Ex :
- Je n’aime pas les chiens qui sont méchants, c’est-à- dire parmi les
- chiens, je n’aime pas ceux qui sont méchants.
- Je n’aime pas les chiens qui sont méchants, c’est-à- dire je n’aime
- pas les chiens parce qu’ils sont méchants.
Elle sépare la phrase intercalée ou incidente du reste de la phrase.
Ex :
- Je vous disais, avait répété le DG, que je vous appellerais la veille
de
- nouvel an.
- Sois sage à ma douleur, et tiens-toi plus tranquille(Baudelaire).
- J’irai, m’a-t-il répondu, si vous m’accompagnez.
Le point-virgule (;) : marque une pause de moyenne durée
Les deux points (:)s’emploient:
o pour annoncer la citation d’un texte, la reproduction des paroles ou
des pensées de quelqu’un (sans conjonction de subordination).
Ex : Le Professeur OWANDJALOLA WELO disait aux étudiants pendant
les défenses : « Soyez à l’aise. Sentez-vous libre, car, il s’agit d’un examen
à livre ouvert ».
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
86
o Pour annoncer le développement d’un terme à l’intérieur d’une
phrase.
Ex : j’avais déjà manifesté ma pensée par quelques publications
56 : la
discorde chez l’ennemi.
o Pour une énumération.
Ex : Tout cela était beau de force et de grâce : le paysage, l’homme,
l’enfant…
Les points de suspension (…) : indiquent qu’une phrase est laissé
inachevée, volontairement ou la suite d’une cause extérieure.
Ex : Je viendrai te rendre visite pour…
Les parenthèses () : s’emploient pour intercaler dans la phrase
quelques indications, réflexions indispensables ou non.
Ex : Les chiens de chasse qui ont du flair (odorat) très développé sont
indispensables.
Les crochets [] : jouent le même rôle que les parenthèses mais on
les emploie aussi pour isoler une indication, pour éviter une
succession des parenthèses.
Ex : Chateaubriand se fait l’apologie de christianisme [(Cfr. Génie du
christianisme, 1802)].
Les guillemets « » : s’emploient au commencement et à la fin d’une
citation, d’un discours direct, d’une locution étrangère, au
vocabulaire ordinaire sur laquelle on veut attirer l’attention.
Le tiret (-) : s’utilise dans un dialogue pour indiquer le changement
d’interlocuteur. Il se met aussi de la même manière que les parenthèses
avant et après une proposition, une expression ou un mot qu’on veut
séparer du contexte. C’est-à-dire, « il serve aussi à détacher un élément de
la phrase pour mettre en valeur, à renforcer une virgule » (3).
Il ne faut pas confondre les signes de ponctuation des signes graphiques.
En effet, ces derniers sont accents (é, è, ê), la cédille (Ç ex. Leçon,
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
87
français, garçon, etc.), le tréma (ex : Maïs, Zaïre, Saül, ambigüe, etc.),
l’apostrophe (l’ex : l’histoire, l’étudiant, l’homme, etc.), le trait d’union (-
ex : MBONGO-PASI ; Arc-en-ciel, etc.).
2. DEFAUTS DE STYLE
1. Le pléonasme
C’est la faute qui consiste à utiliser plusieurs mots à la fois exprimant la
même idée (alors qu’un seul suffirait)8.
Ex : le but final, descendre en bas, achever complètement, ajouter un plus ;
collaborer ensemble, avancer en avant, prévoir d’avance ; s’entraider
mutuellement, rentre de nouveau, avoir mal à sa tête, il n’y a que
seulement ; comme par exemple, voire même, et puis ensuite, totalement
idem ; abolir totalement.
Remarque :
I. Le pléonasme est vicieux lorsqu’il n’ajoute rien à la force du discours.
Ex : reculer en en arrière, monter en haut, etc.
c. Il est employé parfois comme figure de style lorsqu’il renforce
l’idée que l’on veut exprimer.
Ex : Je l’ai vu de mes propres yeux ; je l’ai entendu de mes propres
oreilles.
d. Certains pléonasmes sont d’ores et déjà entrés dans la langue et
admis aujourd’hui dans le langage vulgaire.
Ex : S’immiscer dans, coïncider avec…, saupoudrer le sol…
2.Le néologisme
C’est la création des mots nouveaux soit par paresse soit par nécessité
scientifique.
Ex : Alunir, amerrir, missile sol-sol, cadeauner, dévierger.
8
BLED(E), Cours supérieur d’orthographe, Paris classique hachettes, 1988, p7
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
88
Il peut aussi se définir comme emploi des mots anciens mais pris dans un
nouveau sens.
Ex : Biper, macadam, poubelle, délestage, sandaye, palolaye, sakombi, etc.
3.Le barbarisme
Il s’agit d’une faute qui consiste à se servir d’une expression qui n’existe
pas dans la langue ou si elle existe, elle est employée dans un sens inusité.
En effet, selon THOMAS (A.V.), le barbarisme est « l’emploi des mots
altérés, et par extension, des mots forgés ou pris dans sens contraire au bon
usage »9
Ex :
- Confusionner = couvrir de confusions,
- Remplir un but = atteindre un but,
- jouir d’une mauvaise santé= jouir d’une mauvaise réputation
- Demander excuse = demander pardon ou faire des excuses…
Les barbarismes du français en RDC sont :
- Enceinter→ rendre enceinte, grosse, mère ;
- Voter quelqu’un → voter pour quelqu’un ;
- Téléphoner quelqu’un → Téléphoner à quelqu’un ;
- Pomper les roues d’une voiture → gonfler ;
- Je viens de prêter l’argent chez vous → emprunter ;
- Partir avec quelque chose → emporter quelque chose ;
- Belinda se rappelle de son aventure → elle se rappelle son aventure
du 09/06/2013 ;
- Gagner la victoire → remporter la victoire.
- Payer quelque chose → acheter quelque chose, mais on paie de
l’argent ;
- Des lunettes solaires, ou antisolaires → lunettes fumées ;
- Cogner une souche → heurter une souche ;
- Refuser une demande → rejeter une demande ;
- Par manque de moyens → faute de moyens ;
- Chacun de sa façon → chacun à sa façon ;
- C’est un bonjour → c’est un beau jour ;
9
THOMAS (A.V), Dictionnaire des difficultés de la langue française. Paris ; Larousse, 1956
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
89
- Boire un comprimé → prendre un comprimé ;
- Dans un laps de temps → dans un certain laps de temps ;
- Se prétendre → avoir la prétention de ;
- Il a durée à la maison → il a mis longtemps, a tardé ;
- Mboyo a intervenu → Mboyo est intervenu ;
- Eyenga se souvient son mariage → elle se souvient de son mariage ;
- Gambembo sieste → Gambembo fait la sieste ;
- Je tire votre intention → j’attire votre attention.
4.Le solécisme
C’est une faute qui consiste à violer une règle de la syntaxe et de la
construction. Les solécismes les plus fréquents au Congo Démocratique
sont :
C’est plus pire que → c’est pire que ;
Celui dont la chose intéresse → Ce lui que la chose intéresse ;
Il a été permis de s’asseoir → Il a été autorisé de s’asseoir ;
Il se dirige à Kilamba → il se dirige vers Kilamba ;
Il a parlé que les étudiants sont → il dit que les…. ;
Nous sommes à quatre → nous sommes quatre ou au nombre de
quatre ;
Eyenga entre dans l‘auditoire ensemble avec Mboyo → Eyenga et
Mboyo entre dans l’auditoire ou Eyenga entre dans l’auditoire avec
Mboyo ;
Ce sont nous qui avons bien répondu → C’est nous qui avons bien
répondu ;
Matwiki est rentré à la maison il y a trois jours → Matwiki est
rentré à la maison depuis trois jours ;
Après deux heures de mon arrivée → deux heures après mon
arrivée ;
L’idée lui a pris → l’idée lui est venue ;
Mao a recouvert sa santé → Il a recouvré sa santé ;
C’est très bon que → C’est si bon que.
b. L’archaïsme
C’est un emploi des mots anciens tombés en désuétude ou des locutions
surannées.
Ex : Moult → beaucoup ; à cause que → parce que.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
90
c. L’anachronisme
C’est une faute qui consiste à distribuer par les mots que l’on emploie, des
usages, des idées aux hommes d’une époque où ces idées (usages)
n’étaient pas encore connues.
Ex :
- Appeler un Congolais aujourd’hui Zaïrois,
- Il est quatre heures au lieu de six heures.
C’est-à-dire être hors du temps.
d. Expressions vicieuses
Ce sont des fautes, des incorrections d’emploi vicieux des termes ou de la
syntaxe. Il s’agit de l’emploi incorrect des prépositions, des pronoms, des
conjonctions, des adverbes, etc. On rencontre ce genre des fautes dans les
travaux (expression écrite) et exposés oraux des étudiants et de beaucoup
de locuteurs de la langue française.
Nous allons essayer d’en présenter quelques-unes.
Locutions vicieuses → dites ou écrivez
- On t’appelle par le professeur → le professeur t’appelle.
- Jacques MATWIKI m’a parlé qu’il était malade→ Jacques
MATWIKI m’a dit qu’il était malade.
N.B. : on dit quelque chose à quelqu’un ; mais on parle de quelque chose à
quelqu’un.
- Roger BILO a marié ma sœur, il est donc mon beau-frère → Roger
BILO a épousé ma sœur, il est donc mon beau-frère.
C’est-à-dire il s’est marié à ma sœur.
NB : Marier signifie céder, donner en mariage. Ainsi, un père, un frère…
peut marier sa fille, sa sœur à quelqu’un. Tandis qu’épouser veut dire
prendre en mariage. Ainsi un beau-frère est celui qui a épousé ma sœur.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
91
- Henri KUYALA est venu en bicyclette → Henri KUYALA est
venu à bicyclette tandis que MAWA est allé à pied. Mais on dira
qu’il est allé en voiture, en avion.
- Il a toqué à la porte → il a frappé à la porte.
- Je me porte un peu bien→ je me porte assez bien.
NB : Peu est un adverbe de quantité. Ainsi, si l’on veut connaître
l’évolution de la santé, on vise son état et non la quantité de sa santé.
Et pour exprimer cette nuance, le français recommande l’emploi de
« assez »
Quelle heure fait-il → quelle heure est –il.
Remarque : il peut faire beau, frais, froid, chaud, mais il peut être deux
heures, douze heures.
Il est interdit de ne pas tricher, mentir → il est interdit de tricher, mentir.
Ceci signifie qu’il est défendu de mentir.
- Le CT NGO est-il là ? Non plus → le CT NGO est- il là ? Non, il
n’est pas là.
- As-tu rencontré le frère KOLOLO ? Non plus → As-tu rencontré le
frère KOLOLO ? Non, je ne l’ai pas rencontré.
NB : non plus s’emploie à partir de la 2ème négation consécutive.
Ex : Avez-vous vu le CT NGO ? Non, je ne l’ai pas vu. Et le professeur ?
Non plus ou je ne l’ai pas vu non plus.
- N’avez-vous pas mangé des mangues ? Rép : Oui, j’en ai mangé→
si, j’en ai mangé.
On répond par « si », si la réponse à la question posée à la forme interro-
négative est affirmative.
- Je vous prends congé→ je prends congé de vous.
- Le professeur vous a besoin→ le professeur a besoin de vous.
- Avant-hier MAZEMBE a joué avec VITA CLUB→ Avant- hier,
- MAZEMBE a joué contre VITA CLUB.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
92
NB : jouer avec …insinue l’idée d’amusement.
Ex : jouer avec son chien. Mais jouer contre suggère l’idée d’une épreuve,
d’une compétition.
- Ce livre est pour moi→ Ce livre est à moi.
En effet, peut-on poser la question :
« Pour qui est ce livre ? » non, mais « A qui est ce livre » ?
Rép : Il est à moi ou à Joseph ; mais non il est pour moi ou pour joseph.
- Nous avons salué le Papa → nous avons salué papa.
- Elle a visité la sœur et l’oncle→ Elle a visité ma sœur et mon
oncle.
Mais, on peut dire : Nous avons rencontré la sœur de MOSEKA.
- Il rasé sa barbe→ il s’est rasé la barbe.
- Nous n’avons pas un stylo→ Nous n’avons pas de stylo.
- Ce couple n’a pas des enfants→ Ce couple n’a pas d’enfants.
- Tu commets beaucoup des fautes→ tu commets beaucoup de fautes.
- Vous avez obtenu peu des points→ Vous avez obtenu peu de points
- Enlevez ce tas des pierres→ Enlevez ce tas de pierres
- Je n’ai pas de l’argent→ Je n’ai pas d’argent
Il n’y a plus de la viande, c’est-à-dire il n’ya plus de viande.
NB : On peut dire : Il n’y a pas de la viande à vendre
Celui qui parle a effectivement de l’argent pour autre chose, pour un autre
projet.
Il a la viande, peut-être pour manger et non pour vendre.
Cependant, quand on dit : « je n’ai pas d’argent » cela veut dire que « je
n’ai absolument rien ».
- Je l’ai dit ; je l’ai donné un stylo→ Je lui ai dit ; je lui ai donné un
stylo
- Un congolais auquel j’ai parlé → Un congolais à qui j’ai parlé
Quel étudiant qui est intelligent → Quel étudiant est intelligent
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
93
- Combien d’étudiants qui sont en ordre ? → Combien d’étudiants
sont en ordre ?
- Pierre MAO a succédé son père→ Pierre MAO a succédé à son père
- 30. Il a profité l’occasion pour→ Il a profité de l’occasion pour…
- Les étudiants risquent de réussir→ Les étudiants ont des chances
de réussir.
NB : Réussir n’est pas un danger, un mal. Ainsi, il n’y a pas de risques
lorsqu’on réussit.
- Pour qui êtes-vous en deuil→ De qui êtes-vous en deuil ? On est en
deuil de quelqu’un.
- Nous voulons à ce qu’elle rentre→ nous voulons qu’elle…demain.
- Répondez de façon à ce que → Répondez de façon que.
- Fidèle MUSIETA l’a menti → Fidèle MUSIETA lui a menti.
NB : Mentir est un verbe transitif indirect. Ainsi, on ment à quelqu’un. On
peut également dire, « Mentir sur un point ou sur quelque chose »
- Je l’ai pardonné→ je lui ai pardonné.
En effet, on ne pardonne pas quelqu’un mais on pardonne à quelqu’un sa
faute.
- Delphin MANENE a passé par chez moi→ Delphin MANENE est
passé chez moi.
NB : on peut aussi employer le verbe « passer » avec l’auxiliaire « avoir ».
Ex : J’ai passé toutes les vacances à Kikwit.
Il peut également être à la forme pronominale.
Ex : L’aventure s’est passée au n°17 de l’avenue Kamba dans la commune
de KIMBANSEKE.
- Nous tenons l’assemblée chaque le 15 du mois→ Nous tenons
l’assemblée le 15 de chaque mois.
- C’est le Docteur GUSWA Madidi qui l’a consulté→ C’est le
Docteur GUSWA Madidi qu’il a consulté.
- Sa petite sœur a convulsé→ Sa petite sœur a eu des convulsions
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
94
- De toutes les façons, vous ferez ce TP→ De toute façon, vous
ferez ce
- TP.
- Nous avons débuté les cours à 08h30’→ nous avons commencé le
cours à 08h30’.
- Il a changé ses francs à dollars→ il a changé ses francs contre les
dollars.
- Remettez au CP deux barres de craies, une tige de la cigarette→
remettez- lui deux craies, une cigarette.
- Gisèle MUZINGA a distingué en G3 GIS→ Gisèle MUZINGA a
réussi avec distinction en G3 GIS ou elle a obtenu la distinction en
G3 GIS.
- La limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 15 juin.
Dépassé ce délai, aucun dossier ne sera accepté→ 15 juin, passé ce
délai, aucun dossier ne sera accepté.
- Dites-nous qui voyez-vous→ Dites-nous qui vous-voyez.
- Paul MAYELE est le plus intelligent parmi les garçons → Paul
MAYELE est le plus intelligent des garçons.
- Rendez-nous notre dix francs→ Rendez-nous nos dix francs ou
notre billet de dix francs
- La réunion aura lieu le jeudi en huit → La réunion aura lieu jeudi en
huit.
- EYALE a ma dette→EYALE a une dette envers moi
- Les pygmées sont généralement courts→ Les pygmées sont
généralement de courte taille ou ils sont de taille économique.
- En se promenant, nous avons rencontré Hélène ILANGU → En
nous promenant, nous avons rencontré Hélène ILANGU.
- Quelle eau qui est bonne à boire ? →Quelle eau est bonne à boire ?
- Combien d’étudiants qui ont réussi ? → Combien d’étudiants ont
réussi ?
- Seul le TP de Charles MAKUNI qui est sans fautes ? → Seul le TP
de Charles MAKUNI est sans fautes ?
- Je suis allé rendre visite à une fille à l’hôpital que j’aime bien→ Je
suis allé à l’hôpital rendre visite à une fille que j’aime bien.
- Va prendre le chapeau de ton oncle qui est dans l’armoire → Va
prendre le chapeau de ton oncle dans l’armoire.
- Cette étudiante se méconduit depuis les humanités→ Cette
étudiante se conduit mal depuis les humanités.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
95
NB : se méconduire comme méconduite : c’est du Belgicisme.
- Est- ce que le CT a-t-il enseigné ? → Est-ce que le CT a enseigné ?
Ou le CT a-t-il enseigné ?
Les prépositions à et de ont de valeur distincte dans le même texte.
Chacune confère un sens différent au texte.
- Un sac à farine → un sac de farine.
Ici, le sac est vide et est destiné à l’usage → Ici le sac contient de la farine.
- De soi-disant preuves → de prétendues preuves.
NB : L’expression soi-disant n’est pas appliquée à des choses. Ne
l’utilisez pas lorsqu’il ne s’applique à aucun nom.
Ex : Théthé n’est pas venue soi-disant qu’elle avait la grippe, mais on
dira : Théthé n’est pas venue parce qu’elle prétendait avoir la grippe
ou sous prétexte qu’elle avait la grippe.
L’expression reste toujours invariable.
Ex : une soi-disant femme mariée. Le soi-disant CP signifie, celui qui se
dit CP.
- Une tasse à café → Une tasse de café.
- Une assiette à soupe → une assiette de soupe. C'est-à-dire l’assiette
contient de la soupe.
- Je suis émotionné, c’est émotionnant → je suis ému ; c’est
émotionnant.
- Pallier à une situation, à un défaut → Pallier une situation, un
défaut. Mais remédier à une situation.
3. EXERCICES DE SUBSTITUTION
1. Substitution du verbe « avoir » par un verbe précis :
1. Avoir un but → viser un but ;
2. Avoir un gain → réaliser un gain ;
3. Avoir de vives douleurs → sentir de vives douleurs ;
4. Avoir un idéal → poursuivre un idéal ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
96
5. Avoir l’espérance→ nourrir de l’espérance ;
6. Avoir une bonne réputation → jouir d’une bonne réputation ;
7. Avoir un prix → gagner un prix ;
8. Avoir quelque chose à la main → tenir quelque chose… ;
9. Avoir une crise → traverser, connaître ;
10. Avoir une influence → exercer une influence ;
11. Cette mission a beaucoup d’avantages → …offre beaucoup… ;
12. Avoir des traits communs → présenter des… ;
13. Avoir des difficultés → éprouver des… ;
14. Avoir le pouvoir → détenir le pouvoir ;
15. Avoir deux mètres de long → mesurer deux mètres… ;
16. Avoir une bonne conduite → mener une bonne conduite ;
17. Avoir un bon métier → exercer un bon métier.
2. Substitution du verbe faire par un autre verbe plus précis :
1. Faire un fossé → creuser… ;
2. Faire une collection → rassembler…;
3. Faire un discours → prononcer…;
4. Faire un programme → tracer…;
5. Faire une loi → élaborer…;
6. Faire une alliance, un traité→ conclure… ;
7. Faire un effort → déployer, fournir… ;
8. Faire un calcul, un paiement → effectuer.. ;
9. Faire une liste→ dresser… ;
10. Faire un inventaire → effectuer…;
11. Faire un long trajet → parcourir… ;
12. Faire des sacrifices → consentir, s’imposer… ;
13. Faire un rapport → rédiger … ;
14. Faire des progrès → réaliser des … ;
15. Faire un marché → conclure un marché ;
16. Faire un cri→ pousser un cri ;
17. Faire une fonction → exercer une fonction ;
18. Faire l’intérim→ assurer l’intérim ;
19. Faire une résistance → opposer une résistance ;
20. Faire un combat → livrer un combat ;
21. Faire naître un conflit → provoquer un conflit ;
22. Faire naître la douleur → raviver la douleur ;
23. Faire un procès → intenter un procès ;
24. Faire une faute → commettre une faute ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
97
25. Faire renaître la paix → restaurer, rétablir la paix ;
26. Faire agir quelqu’un → pousser quelqu’un à agir ;
27. Faire cesser la violence → réprimer la violence ;
28. Faire cesser un mal entendu → dissiper un malentendu ;
29. Faire disparaître l’erreur → rectifier…;
30. Faire disparaître l’obstacle → aplanir l’obstacle ;
31. La vérité se fait voir → la vérité émerge ;
32. Faire diminuer l’autorité → affaiblir l’autorité ;
33. Faire voir sa richesse, sa fortune→ étaler sa richesse ;
34. Faire naitre une idée → suggérer… ;
35. Faire durer l’amitié → entretenir…;
36. Faire cesser la colère → apaiser la colère ;
37. Faire cesser une épidémie → éradiquer une épidémie ;
38. Faire cesser la loi → abolir … ;
3. Substitution du verbe « mettre »par le plus précis:
3. Mettre une échelle contre quelque chose → appuyer… ;
4. Mettre du beurre sur le pain → étendre… ;
5. Mettre le nom sur la liste → inscrire… ;
6. Mettre en prison → incarcérer ;
7. Mettre la signature → apposer… ;
8. Mettre beaucoup de temps au travail → consacrer… ;
9. Mettre une affiche sur le mur → placarder… ;
10. Mettre dans le trou → introduire… ;
11. Mettre la paix dans le pays → rétablir la paix… ;
12. Mettre la sonde dans une plaie → introduire… ;
13. Mettre une note dans un journal → insérer… ;
14. Mettre à la place de → substituer… ;
15. Mettre en garde contre un danger → prévenir… ;
16. Mettre une monnaie en circulation → émettre… ;
17. Mettre au deuxième rang → reléguer… ;
18. Mettre en liberté un esclave → affranchir… ;
19. Mettre dans le dépôt des marchandises → consigner… ;
20. Mettre en danger ses intérêts → compromettre... ;
21. Mettre en ordre une maison → arranger… ;
22. Mettre son argent en banque → placer… ;
23. Mettre la couleur sur un tableau → appliquer… ;
4. Substitution du verbe « voir » par un verbe plus précis
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
98
1. Voir un malade → visiter…;
2. Voir la beauté de → apprécier… ;
3. Voir une affaire → examiner… ;
4. Voir un spectacle → contempler…;
5. Voir un tableau → regarder…:
6. L’inspecteur voit la classe de 4ème primaire →… visite, inspecte ;
7. Il faut bien voir le caractère de son fiancé → …étudier le… ;
8. Comment tu dois voir cette situation → juger
9. Voir un problème → envisager ;
10. Voir la réalité d’un fait → constater… ;
11. Dieu voit nos vices les plus secrets → pénètre nos… ;
12. Ne voir aucun moyen → ne trouver.
5.Substitution du verbe « dire » par un verbe plus précis
1. Dire son avis →émettre son avis ;
2. Dire des mensonges → raconter… ;
3. Dire des aventures → raconter…;
4. Dire des bêtises→ débiter… ;
5. Dire ses sentiments → exprimer… ;
6. Dire la fraude → dévoiler, livrer ou divulguer… ;
7. Dire une histoire → rapporter… ;
8. Dire un secret → dévoiler, livrer ou divulguer… ;
9. Dire des avis → émettre… ;
10. Dire des blasphèmes → proférer… ;
11. Dire une situation à quelqu’un → exposer… ;
12. Dire un mot de bienvenue → adresser un mot de bienvenue ;
13. Dire des chagrins à quelqu’un → confier… ;
14. Dire une règle → énoncer une règle...
6.Substitution du verbe « se trouver » par un verbe intransitif ou
pronominal exprimant un sens plus précis
1. Dans notre pays se trouve une famine affreuse → sévit
2. Sur ce beau visage se trouve une joie céleste → rayonne… ;
3. Au-dessus du toit se trouve une aigle → plane l’aigle… ;
4. Sur cette liste se trouve son nom → figure son nom… ;
5. Dans la cour se trouve une eau verdâtre → dort une eau… ;
6. Sur son front se trouve une sueur → perle une sueur… ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
99
7. Sur son dos se trouve une longue chevelure → descend… ;
8. Sur cette planche se trouve un fruit pourri → pend un fruit… ;
9. A Mont-Ngafula se trouve l’UPN → fonctionne l’UPN ;
10. Dans votre regard se trouve la colère → brille la colère ;
11. Dans votre âme se trouve une colère → bouillonne une colère ;
12. Au fond de mon cœur se trouve l’espérance → se repose… ;
13. Sur ce joue se trouve la santé ou la joie → resplendit… ;
14. Au pied de colline se trouve une vaste plaine → s’étend… ;
15. Dans cette affaire se trouve une grande difficulté → se présente… ;
16. Des meubles chers se trouvent dans cette maison → garnissent cette
maison ;
17. Une épidémie se trouve dans ce village → ravage ;
18. Dans une éternelle oisiveté se trouve ces peuples pauvres →
croupissent… ;
19. A côté de toute règle se trouve un petit défaut → se dissimule… ;
20. Dans la cuisine se trouve une charmante servante → se tient….
7.Substitution du verbe « y avoir » et « être » par d’autres Sur la
table il y a ou est une soupe chaude → fume une soupe ;
1. Cette fille est belle pour toi → cette fille te convient ;
2. Le professeur est contre ce projet → condamne, désapprouve ce
projet ;
3. Sur le chemin de la gloire, il y a plusieurs embuches→ se
dressent… ;
4. Sous la peau de l’agneau il y a/ est un loup → se cache un loup ;
5. Sur cette plaine, il y a ou est une tour → s’élève une tour ;
6. Une sourde agitation est au-dessous de tout → prime au-dessus de
tout ;
7. Le bien de la patrie est au-dessus de tout → prime.
8. Substitution des mots « chose » et « quelque chose de » qui sont des
termes très vagues par ceux qui peuvent préciser l’idée que l’on veut
rendre
1. Le manque de jugement est une chose irrémédiable → un défaut ;
2. La pauvreté est une chose mauvaise → un vice ;
3. L’amour est une chose à cultiver → une vertu à cultiver ;
4. Dans son discours il y a quelque chose de vrai → il y a du vrai ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
100
5. La démocratie est une chose à encourager → une qualité à
encourager ;
9. Dans le parler ou dans l’écrit, il faudrait veiller à la suppression
de la négation chaque fois que celle-ci est possible.
Exemple :
- Ne pas se soucier de chaque chose → désintéresser de chose ;
- Ne plus étudier → cesser d’étudier ;
- Ne pas reconnaître les résultats des élections → contester ;
- Ne pas laisser le C.P. se marier → empêcher le C.P. de se marier ;
4. NECESSITE DE REDIGER UNE PHRASE CONFORME
0. Notion
Pour nous exprimer, nous construisons des phrases. La phrase reste la
partie la plus importante d’un énoncé, d’un discours.
En effet, les groupes des mots constitués par les fonctions nominales
n’expriment que des fragments d’idées. Ces groupes des mots ne donnent
pas une idée complète. Ainsi pour exprimer une idée complète, un
événement bien déterminé qui a eu lieu à un moment bien donné, il faut
mettre les groupes nominaux en rapport avec un verbe. Alors naît la phrase
simple : Exemple : Les études supérieures et universitaires ne sont pas
faciles.
Les énoncés d’une langue sont formés des phrases. Est appelé « énoncé »
l’ensemble des phrases dont la dimension peut être variable. La dimension
est mesurée par la durée de la communication (volume du message).
Tandis que les paragraphes s’organisent en chapitres et ceux-ci en parties.
Le mot « phrase » désigne une suite de mots constituant un ensemble
syntaxiquement cohérent, identifiable à l’écrit par la présence d’une
majuscule à l’initiale du premier mot, et délimité par un signe de
ponctuation forte(point, point d’interrogation, point d’exclamation):
Exemple : La vie est belle. La phrase est une unité présentant un sens
complet, obéissant à des règles de construction et qui peut être décomposée
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
101
en un certain nombre de constituants : La vie (sujet)/ est (verbe)/belle
(attribut).
La phrase est le plus petit énoncé complet d’une idée conçue par le
sujet parlant.
C‘est une suite des mots ordonnés d’une certaine manière qui
entretiennent entre eux certaines relations, c'est-à-dire qui répondent
à certaines relations de grammaire et qui ont un certain sens.
Selon André Martinet, la phrase est un énoncé dont tous les
éléments se rattachent à un prédicat unique ou à plusieurs prédicats
coordonnés.
Mais nous retiendrons surtout cette définition : « la phrase est un ensemble
des mots liés entre eux grammaticalement et logiquement autour d’un
verbe pour former un sens complet ».
Exemple d’un ensemble des mots non liés entre eux grammaticalement :
République le président bien aimons notre de nous.
Exemple d’un ensemble des mots liés grammaticalement et non
logiquement.
Le Président Félix TSHISEKEDI est assis derrière vous.
Pour le 1er cas, la phrase correcte sera : « Nous aimons bien le Président de
notre République ».
Quant au second cas, nous disons que la phrase n’est pas logique et donc
inadmissible pédagogiquement, parce qu’au moment de la communication,
le Président Félix TSHISEKEDI n’est ou n’était pas assis derrière (dans
l’auditoire). Cependant, cette phrase est correcte grammaticalement.
1. SORTES DES PHRASES
Cette division a été motivée par les éléments qui constituent la phrase.
1.1. La phrase simple
Ex. :
Marie-Jeanne MBOYO suit attentivement notre leçon.
ESEKA Wale, étudiante de G1 EASI de l’ISTM/Kinshasa a une
démarche irréprochable.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
102
Une phrase simple est celle qui n’a qu’un seul verbe conjugué. Elle peut
être à son tour minimale ou étendue :
Simple minimale
Ex:
a. Nous étudions bien Thérèse.
b. Jules dort.
c. OWANDJALOLA Welo était professeur ordinaire.
La phrase simple minimale est celle qui contient le minimum d’éléments.
Celle à laquelle on ne peut rien retrancher.
Simple étendue
Ex. :
Albert BASELE, licencié en F.L.A de l’ISP KANANGA, est votre
enseignant.
André MAYAMBA, étudiante, toujours régulière, arrive tous les
jours à temps au cours à l’ISTM-KIN.
La phrase dont on peut supprimer un ou plusieurs éléments et sans en
modifier profondément le sens est nommée phrase simple étendue. La
phrase simple étendue est celle à laquelle on ajoute d’autres éléments pour
préciser les premiers termes.
Remarque :
1. La phrase simple qui est construite avec le verbe conjugué est
appelée phrase verbale.
Ex:
Respectez toute autorité
Payer bien nos enseignants est notre slogan.
2. La phrase simple n’ayant pas de verbe conjugué est appelée phrase
averbale ou nominale.
Ex:
L’arrivée du ministre à l’ISTM/KIN ce 30/7/2020.
Défense de fumer.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
103
1.2. La Phrase Composée
Ex:
Je suis venu, j’ai vu et j’ai vaincu
Gertrude PALA est partie, dit-on, pour accueillir sa mère.
Est appelée phrase composée, celle qui comprend plusieurs sous phases
simples verbales. Elle peut contenir soit :
des sous phrases simples juxtaposées, celles-ci étant liées entre elles
par un signe de ponctuation.
des sous-phrases simples coordonnées. Ce sont alors des phrases
reliées entre elles par une conjonction de coordination.
Ces divers types de sous-phrases simples peuvent se rencontrer dans une
même phrase composée.
Ex « il n’y a personne : les deux amis regardent ailleurs ou font semblant ».
Il existe d’autres types de phrases composées dans lesquelles entrent les
sous-phrases complexes, notion que l’on verra au point suivant.
1.2.1. La phrase complexe
Ex:
Je me demande quelle heure il est.
L’homme que vous apercevez est le chef de section.
Le professeur qui vous enseigne la logique s’appelle
OWANDJALOLA WELO.
La phrase complexe est une phrase dans laquelle on a introduit une
proposition subordonnée dans un de ses termes.
Il sied de rappeler que:
(1) Les termes de la phrase sont : sujet, base, complément ou attribut.
Ex :
Nous suivons les conseils du professeur.
Les étudiants sont des tricheurs.
Nous souhaitons votre réussite.
Nous souhaitons que vous réussissiez.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
104
Qui veut la réussite revoit régulièrement la matière.
(2) La proposition subordonnée est un membre (terme) de la phrase,
une espèce de syntagme comprenant un verbe, un sujet ainsi que le
prédicat. Ce syntagme (terme) a comme fonction, dans la phrase,
sujet ou complément.
Ex. : Le cours que vous suivez est facile.
Cette phrase complexe a comme proposition subordonnée « que vous
suivez ».
Cette subordonnée à un verbe conjugué « suivez », un sujet « vous » et un
complément d’objet direct « que » qui est un pronom relatif.
Cette proposition a une fonction dans la phase : complément déterminatif
de cours.
(3) Les propositions subordonnées peuvent se classer en deux groupes :
1. Celle qui tient (occupe) la place d’un terme tout entier. Elles sont
appelées des propositions termes.
Ex:
Chaque parent veut que son enfant réussisse.
Notre souhait est que vous réussissiez.
Le professeur demande quand vous serez de retour.
2. Celles qui constituent seulement une partie d’un terme (1er ou
3ème). Elles sont ainsi appelées propositions-éléments.
Ex:
L’étudiant dont on parle a réussi à l’examen.
Ils ont remis le devoir que j’avais donné.
N.B : Ces propositions-éléments s’accrochent à un autre mot par le verbe
de base.
En général, les propositions subordonnées conjonctives sont des
propositions-termes. Tandis que les propositions-éléments sont des
subordonnées relatives. Cependant les subordonnées indéfinies sont des
propositions-termes.
Exemples:
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
105
Qui veut réussir revoit la matière régulièrement.
Il le raconte à qui il veut…
Je ne sais pas qui je suis.
Bref, les propositions subordonnées s’accrochent à la phrase complexe de
deux façons :
Par un mot de liaison qui est :
1. Soit une conjonction de subordination
Exemples :
Il estimera qu’il vient à peine de se coucher ;
Nous disons que vous réussissez.
2. Soit un pronom relatif.
Exemples :
Votre père qui nous attend est patient.
Appelez l’étudiant dont je vous ai parlé.
Le cours que vous suivez est facile.
3. Soit un mot interrogatif (adjectif, adverbe, pronom)
Exemples :
Je me demande quelle heure il est.
KALALA WENU a dit comment il est passé de classe.
Le cours que vous suivez est facile.
Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.
Retenons que les propositions subordonnées dans une phrase complexe
peuvent exercer aussi bien les fonctions nominales (épithète, apposition,
complément du verbe, attribut). En outre, une phrase composée peut
contenir des sous-phrases complexes.
Exemple pour ce dernier cas : « Cette croyance survivait pendant quelques
secondes à mon réveil ; elle ne choquait pas ma raison mais passait comme
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
106
des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le
bougeoir n’était pas allumé.
2. TYPES DES PHRASES
Le locuteur recourt à plusieurs types de phrases selon le motif qui le
pousse à communiquer avec les autres. Ainsi distinguons-nous :
2.1. Type déclaratif ou énonciatif
C’est la phrase par laquelle le locuteur (sujet parlant) communique,
énonce, déclare ou exprime simplement une information à autrui.
Exemples :
Je vous apprends à bien parler et à bien écrire ;
Votre stylo est perdu.
2.2. Types interrogatifs
On parle de ce type de phrase lorsque l’émetteur cherche à s’informer, à se
renseigner auprès de son destinataire, de son auditeur en lui posant une
question.
Exemples :
Avez-vous déjà remis votre TP ?
Avez-vous quel âge ?
La phrase du type interrogatif en oral se termine par l’intonation est
montante, ascendante. Tandis que la forme interro-négative ne s’écrit
qu’aux modes indicatifs, conditionnels.
Remarque :
0. Avez-vous déjeuné ce matin.
Réponse : Oui ou Non.
1. Où est parti le chef de promotion ?
Réponse éventuelle : il est parti à la section.
2. Je veux connaître quand tu seras de retour.
Réponse éventuelle : je serai de retour à 20 heures.
Au regard de ces phrases et de leur réponse, nous disons qu’il y a quatre
sortes d’interrogations à savoir :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
107
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
108
a. Interrogation directe
Exemples :
qu’apprenez-vous?
Le Chef de travaux, est-il sage ?
Longonya joue-t-elle au volley balle ?
A-t-elle réussi au TP ?
b. Interrogation indirecte
Exemple : je demande quand nous sortirons d’ici.
Question : quelle différence percevez-vous entre l’interrogation directe et
celle dite indirecte ?
c. Interrogation totale
Elle exige la réponse oui ou non. Elle porte sur toute la phrase.
Ex. : Avez-vous compris ? Rép. Oui ou non.
Elle présente 3 structures :
Inversion du sujet pour la langue soutenue, châtié, littéraire.
Ainsi y aura-t-il un trait d’union entre le verbe et le pronom (sujet).
Ex. : - Etes-vous en pause ?
- Sais-tu conduire ?
Quand le sujet est un nom, il est repris par un pronom.
Ex. : le CT, peut-il te recevoir,
Si le verbe est au temps composé, le sujet (pronom) se mettra entre
l’auxiliaire et le participe passé.
Ex. : - Avez-vous mangé ?
- Est-il rentré ce matin ?
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
109
Lorsque le verbe se termine par une voyelle, il faut intercaler un-t-
(consonne euphotique).
Ex. : - Y’a-t-il des étudiants dans la salle ?
- Thérèse SHITA joue-t-elle à la dame ?
Il sied de vous rafraîchir la mémoire en disant : « Je peux » devient à
l’interrogation « puis-je ? ».
Est-ce que…plus forme affirmative (langue courante) s’emploie
aussi.
Ex. : Est-ce que vous étudiez bien ?
L’intonation (voix montante) est indiquée par le point
d’interrogation même dans la langue familière.
Ex. : - Vous étudiez bien ?
- Elle a fini de travailler ?
Lorsque l’interrogation se combine avec la forme négative, la réponse
affirmative débute avec si et non avec oui.
Ex. : N’avez-vous pas mangé ? Rép. : Si, j’ai mangé.
Enfin, « n’est-ce pas », en fin de phrase, implique que l’on est presque sûr
de la réponse.
Ex. : Avez-vous compris, n’est-ce pas ? Rép : Oui, j’ai compris.
d. Interrogation partielle
L’interrogation porte sur un élément de la phrase. Elle se fait au moyen des
mots interrogatifs, pronoms, adjectifs, adverbes etc. la réponse ne sera oui
ou non.
Voici quelques exemples :
1. Pronoms
a. Qui : il s’emploie pour les personnes. Il peut être (ses fonctions)
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
110
Sujet : Qui est entré ?
COD : Qui as-tu vu ? Qui MUNDUKU à Malembe a-t-il vu ?
(Langage soigné). Qui est-ce que MUNDUKU a vu ? (Langage
Ordinaire) MUNDUKU a vu qui ?
Complément avec une préposition : à qui, avec qui, par qui.
Ex : - A qui parlez-vous ? A qui est-ce que vous parlez ?
- Vous parlez à qui ?
- Avec qui parlez-vous ?
- Vous parlez avec qui ?
- Avec qui Paul est-il sorti ? (Langage soutenu.).
b. Qui : il s’emploie pour les choses. Il peut être :
Sujet : Ex : Qu’est ce qui a causé cet incident ?
COD : Ex : Que veux-tu ? qu’est-ce que tu veux ? Tu veux quoi ?
Qu’a mangé cet étudiant ?
Qu’est-ce que cet étudiant a mangé ?
Complément avec une préposition : quoi.
Ex : - De quoi ces hommes parlent-ils ? De quoi parles-tu ?
- Par quoi vont-ils commencer ?
Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles.
Il s’agit des pronoms représentant une personne ou une chose déjà
nommée.
Ex :
- Il y a trois mangues, laquelle préfères- tu ?
- Lequel des étudiants choisissez-vous ?
2. Préposition
Ex : Pour lequel de ces candidats voterez-vous ?
NB : il y a trois guichets, auquel dois-je m’adresser ?
Nous avons quatre groupes d’études, duquel faites-vous partie ?(LP).
Adjectifs (interrogatifs) : quel, quelle, quels, quelles plus nom.
Ex :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
111
- Quel professeur aimez- vous ?
- Quelle robe préférez- vous ?
- Pour quelle entreprise ta sœur travaille-t-elle ?
3. Adverbes : où, quand, comment, combien, pourquoi ?
Forme interrogative avec un pronom sujet.
Ex: où allez-vous?
Forme interrogative avec un nom sujet.
Ex : Quand Gertrude GIBAU était-elle décédée ?
Les adverbes où, quand, combien peuvent être précédés d’une
préposition :
Ex :- Depuis combien de temps serez-vous à l’ISTM-Kinshasa ?
b) Par où es-tu passé pour atteindre l’auditoire ?
Cependant :
a) Il n’y a pas d’inversion du nom lorsque le verbe est suivi d’un
complément.
Ex : Avec qui est sorti Jean-Paul GIDINDA ? Mais, on dira : « Avec qui
Jean-Paul GIDINDA est-il allé au Ciné ? »
b) L’infinitif peut être employé dans une phrase interrogative pour
apporter une nuance d’hésitation, de délibération.
Ex : A qui m’adresser ? Que faire maintenant ? Où aller ?
Que faire ?
Ne dites pas : mais dites
Qu’est-ce que faites-vous ?→Qu’est-ce que vous faites ?
Qui a-t-il téléphoné ?→ Qui a téléphoné
Lequel livre voulez-vous? → Quel livre voulez-vous ?
NB : réponse négative avec pas encore, plus rien, personne, pas, jamais,
non.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
112
3. Répondez négativement :
Qui vient là ?
Que voyez-vous sur la table?
Avez-vous déjà mangé?
Avez-vous revu le professeur avant son départ pour Kikwit ?
Aimeriez-vous devenir témoins de Jéhovah ?
Avez-vous déjà été chef de promotion ?
Est-il encore malade?
4. Répondez négativement tout en remplaçant les mots entre () par un
pronom qui convient :
a. A-t-elle rencontré (quelqu’un) ?
b. As-tu pris (quelque chose) sur la table ?
Comment transformer l’interrogation directe en interrogation indirecte ?
Interrogation Interrogation Constatation
directe indirecte
1 Avez-vous bien Dites-moi si vous Si interro directe ne
mangé? avez bien mangé. commence pas par un mot
interrogatif, interro indirecte
sera introduite par l’adverbe
interrogatif
2 Où vas-tu ? A Dis-moi où tu vas. Si interro directe commence
quoi songes-tu ? Dis-moi à quoi tu par un mot interrogation,
Quel est ton songes. Dis-moi c’est ce même mot qu’on
âge ? quel est ton âge. emploiera dans
l’interrogation indirecte
Est-ce que vous Dites-moi si vous Est-ce que devient si
le voyez ? le voyez. Dites- Que devient ce que
Que voulez- moi ce que vous Qu’est-ce que devient ce qui
vous ? voulez. Dites-moi
3 ce que vous voyez.
2.3. Type impératif
C’est quand on interdit un acte, quand on donne un ordre à autrui pour que
ce dernier agisse de telle manière.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
113
Exemple :
a. Ne viens pas me voir.
b. Etudiez régulièrement.
c. Qu’ils sortent.
d. Allez-vous-en.
e. Cessez d’écrire.
f. Rangeons rapidement les dossiers.
Remarque :
1. A ce type de phrase, nous pourrons joindre :
a) La phrase optative : phrase dans laquelle la réalisation de l’acte ne
dépend pas de la volonté humaine.
Exemples :
Soyez heureux!
Dormez bien!
Que la terre des ancêtres vous soit légère!
Bonjour, bonne chance! Bonne guérison!
Bon voyage!
Ces phrases expriment un souhait.
b) La phrase interpellatrice : phrase par laquelle on établit ou rompt
simplement la communication avec autrui, le contact avec son
interlocuteur.
Ex : Allo! Oui! A qui j’ai l’honneur! S’il vous plait!
Ce type de phrase (type impératif) utilise deux procédés
principaux
1.3.1. L’impératif sans sujet
Ex : va-t’en. Sortez. Prions.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
114
La première personne du pluriel s’emploie quand le locuteur s’associe à
l’interlocuteur. Cet impératif exprime une exhortation.
Ex : Je vous dis : « Allons-y maintenant ».
Il peut être employé quand on s’adresse à soi-même.
Ex : « Soyons courageux », se disait-il.
Tandis que la deuxième personne du pluriel s’emploie quand on s’adresse
à plusieurs interlocuteurs ou à un interlocuteur que l’on vouvoie.
Ex : « Mes chers frères, rentrez à la maison » ; « MBO, taisez-vous »
Les phrases à l’impératif se terminent souvent par un point. On peut mettre
aussi un point d’exclamation quand elles sont prononcées avec une force
particulière.
Ex : Le chef des travaux me retint par le bras en criant : « Attendez »
0. Le subjonctif introduit par que lorsque la personne à qui on adresse
un acte est distincte de l’interlocuteur ou lorsqu’elle est absente
Ex : Qu’il rentre vite! Qu’ils rentrent en ordre!
e. On peut atténuer la rigueur d’un ordre ou d’une défense par
l’utilisation de formules de politesse ou de référence.
Ex : « S’il vous plait… ».
- « Ayez l’amabilité de… ».
- « Faites-moi plaisir …».
- « Donnez-vous la peine de sortir…».
- « Veuillez agréer, Monsieur… ».
f. La phrase impérative peut utiliser d’autres procédés afin d’exprimer
un ordre ou une défense.
En voici quelques exemples :
L’infinitif sans sujet : dans des inscriptions ou des textes s’adressant
à des lecteurs non précisés.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
115
Ex : - Ne pas dépasser la dose indiquée ;
- Déposer tout ici.
Des phrases nominales : surtout dans les inscriptions.
Ex :
- Défense de fumer ;
- Entrée interdite,
- Prière s’adresser au secrétariat.
0. Dans la communication orale : des phrases averbales et des mots-
phrases.
EX :
- Silence.
- Feu!
- Chut.
L’ordre peut être également donné par des phrases qui ne sont pas de forme
impérative mais qui seront des formes interrogatives ou des énonciatives.
Ex :
- Voulez-vous vous taire ?
- Je vous prie de vous taire.
2.4. TYPE EXCLAMATIF
Il est, quant à la nature du message, une phrase énonciataire, mais dans
laquelle le locuteur exprime ses sentiments avec force particulière. C’est
une expression d’un sentiment vif (indignation, surprise, admiration, etc).
Ex : - Comme vous êtes intelligents!
- Comme elle est pâle!
- Que votre père est courageux!
- C’est formidable!
Chaque cas de ces quatre types de phrases peut se présenter sous plusieurs
formes.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
116
3. FORMES DES PHRASES
3.1. Affirmative ou négative
Ex : Le Professeur appelle le joueur KALALA ; le Professeur n’appelle
pas le joueur KALALA.
3.2. Active ou passive
Ex : Le maître TABIBI a puni MBUKU
L’élève MBUKU a été punie par le maître TABIBI
3.3. Emphatique ou neutre.
N.B. : une phrase est dite emphatique quand elle consiste à nuancer
l’information par la mise en évidence d’un de ses éléments (termes).
Ex : - Jacques OTETE, lui, prépare sa leçon.
- Toi, Jacques OTETE prépare ta leçon.
- La leçon, OTETE la prépare.
Lorsqu’une phrase n’est pas emphatique, elle est alors neutre, c'est-à-dire
elle est déclarative, interrogative, impérative ou exclamative mais à la
forme affirmative, négative, à la forme active ou passive.
Ex : Jacques OTETE prépare sa leçon.
Ainsi, une phrase ne peut être à la fois affirmative et négative, active et
passive, emphatique et neutre.
4. LOIS DE LA CONSTRUCTION DE LA PHRASE
La construction logique d’une phrase consiste à énoncer les éléments dans
un ordre logique, c'est-à-dire : sujet, verbe, attribut ou complément d’objet
direct, complément d’objet indirect, complément circonstanciel. Il se
présente schématiquement comme suit :
P = S + V + C/ Attribut,
Ex : - Les étudiants suivent les cours ;
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
117
- Ils sont contents.
P = S + V Ex : vous mentez. Ils dorment.
P = V + C Ex : Remettez le livre.
P = V+ Attr. Ex : Soyez polis.
P=V Ex : Sortez ; ne reviens plus.
Cependant, pour certaines raisons stylistiques, cet ordre n’est plus respecté.
Il s’agit des cas suivants :
Dans une phrase interrogative directe.
Ex :
- Avez-vous terminé le TP ? P = V+S+C
- Ces étudiants ont-ils réussi en première session ?
Il est à noter qu’il y a inversion du sujet.
Dans une phrase intercalée ou incise.
Ex : - Ne vous vengez pas, dit la Bible ;
- Revoyez régulièrement vos notes, nous conseillait le professeur
TSHONGA Onyumbe.
- L’argent, nous faisait remarquer notre père, ne doit pas nous
guider.
Dans une phrase commençant par : à peine, peut-être, sans doute,
aussi, alors, sans suivi immédiatement d’une virgule. Cette phrase
exigera l’inversion du sujet quand celui-ci est un pronom personnel.
Mais si le sujet qui suit immédiatement à peine, ainsi, peut-être,
etc., est nom, celui-ci sera repris après le verbe comme pronom
personnel.
- Ex : - A peine le Professeur était-il rentré qu’il attrapa deux
tricheurs.
- peut-être allait-elle venir vous rendre Visite.
- Ainsi vous demanderai-je de bien travailler.
Cependant cet ordre (ordre classique ou canonique) n’est pas absolu. Il doit
être complété par les lois suivantes :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
118
1. La loi de clarté :
Elle veut que l’on évite ce qui peut prêter à l’interprétation ambigüe du
texte. En plaçant les pronoms relatifs aussi près que possible de leur
antécédent, et le complément du mot complété, ordinairement le pronom
relatif suit immédiatement l’antécédent.
Ex : Philippe MABWA est parti avec Cathy MBUNGU et sa mère (la mère
de qui) on dira : MBUNGU et sa mère sont parties avec Philippe
MABWA.
2. La loi de l’harmonie :
Il faut placer d’abord les compléments les plus courts et les plus longs
ensuite pour donner un rythme à la phrase.
Ex : le maître a donné une récompense amplement méritée à son élève,
hier.
On dira : le maître a donné hier, à son élève, une récompense amplement
méritée.
3. La loi du relief :
Elle exige que l’on place en tête de la phrase ou à la fin, l’élément que l’on
veut mettre en évidence.
Ainsi au lieu de : EYENGA Wale était mariée à vingt-cinq ans, on dira : A
vingt-cinq ans, EYENGA Wale était mariée.
4. La loi de la musicalité :
On demande que l’on évite le hiatus (un groupe de deux voyelles contigües
appartenant à deux syllabes différentes)
Ex : « Il alla à Aketi, et acheta le riz à bas prix».
Il y a répétition trop rapprochée de syllabes de même consonance. Il faut
dire : « Il partit pour Aketi et acheta le riz à bas prix».
Construisons correctement nos phrases pour bien nous faire comprendre.
Ainsi devons-nous comprendre, que connaître et employer les sortes, les
types et les formes des phrases demeure un devoir de chaque locuteur de la
langue française.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
119
4. ACCORD DES PARTICIPES PASSES
1. En général
1. Rappel / Modes et temps
Parler des participes passés, c'est recourir à la conjugaison des verbes
surtout aux temps composés (ou surcomposés) dans lesquels apparaît le
participe passé du verbe conjugué. Ainsi rappelons-nous les notions des
modes et des temps soulevées au chapitre précédent.
2.Modes
Les modes sont les diverses manières de concevoir et de présenter l'action
exprimée par le verbe. Il y a des modes personnels et des modes
impersonnels.
a. Les modes personnels des verbes permettent d'exprimer des
nuances de sens et admettent la distinction des personnes
grammaticales. Il y en a quatre :
1. L'indicatif exprime l'action ou l'état dans la réalité,
comme réelle. Ex:
- ESAMBO répond à la question : Mode : indicatif/temps : présent
- EYENGA viendra ce soir : Mode indicatif/temps : futur.
2. L'impératif exprime l'action sous forme d'ordre, de conseil, de
souhait, de recommandation, d'interdiction, d'exhortation, de
prière...
Ex : Adresse-toi au CT MADIDI: Mode impératif/temps : présent.
Remarque :
b) L'impératif est utilisé surtout à l'oral et au présent; le passé de
l'impératif est rare. Ex : Aie terminé ton TP avant midi, ayons/ ayez
terminé avant...
c) l'impératif, les verbes du 1er groupe ne prennent pas -s à la 2ème
personne du singulier.
Cependant, par euphonie, lorsque le verbe se termine par une voyelle (-e
ou -a pour le verbe aller), on ajoute un -s quand le mot qui suit est un des
pronoms personnels en ou y). Ex : Parles-en : Vas-y.
Certains verbes ne se conjuguent pas à l'impératif ; il s'agit des
verbes devoir, pouvoir, valoir, faillir, falloir, neiger, pleuvoir...
Quelles formes particulières pour les verbes :
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
120
- Aller Va chercher ton stylo ; allons chercher... allez chercher votre
stylo.
- Savoir Sache te taire ; sachons nous taire ; sachez-vous taire.
Le conditionnel exprime une action comme éventuelle, qui dépend
d'une condition.
Ex:
- J'aurais dû faire demi-tour : Mode conditionnel/temps passé
- Cet ouvrier travaillerait jour et nuit : Mode conditionnel/ temps
présent.
Le conditionnel comporte deux temps : Le présent et le passé.
Ex:
• Si cet homme sacrifiait son enfant, il gagnerait
Si la condition peut être réalisable, on emploie le présent du
conditionnel.
• Si cet homme avait sacrifié son enfant, il aurait gagné
Si la condition n'est plus réalisable, on emploi le passé du conditionnel
• Si cet homme sacrifie son enfant, il gagnera.
Si la condition est réalisable, on n'emploie pas le conditionnel, mais
l'indicatif.
Remarque :
La condition est souvent exprimée par une proposition subordonnée
conjonctive, mais elle peut également l'être par :
- un groupe nominal. Ex : Avec le sacrifice de son enfant, il aurait
gagné.
- Un gérondif : Ex : En sacrifiant son enfant, il aurait gagné.
- Un groupe pronominal : Ex : Avec nous, il aurait gagné.
On emploie également le conditionnel quand on veut atténuer un propos,
exprimer un doute, un souhait, un regret.
Exemples :
• Cet homme gagnerait à réfléchir un peu.
• En jouant ainsi, on dirait qu'il est sur le point de gagner.
• Il voudrait gagner la partie.
• Cet homme aurait voulu gagner la partie.
Quand le présent du conditionnel évoque une action « postérieure » à une
action passée, on l'appelle le futur du passé ; il est considéré alors comme
un temps de l'indicatif. Ex : Je croyais qu'il sacrifierait son enfant; Je me
suis trompé.
3. Le subjonctif permet d'exprimer une éventualité, un désir, un
souhait, une attente, une crainte, un regret... Sans que l'on sache
précisément si l'action est réelle ou non. Les verbes au subjonctif
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
121
sont généralement inclus dans une subordonnée introduite par la
conjonction que. Nous rencontrons 4 temps du subjonctif :
a. Le présent : Il exprime aussi bien le futur que le présent.
Ex:
- Il faut que je fasse demi-tour Mode subj/temps présent.
- Bien que la vitesse fût limitée, certains roulaient vite.
b. L'imparfait : il marque un rapport de temporalité entre le verbe
de la principale et le verbe de la proposition subordonnée.
Ex : Bien que la vitesse fût limitée, certains roulaient vite.
c. Le passé : Celui-ci exprime l'antériorité par rapport au
présent. Ex : Bien que la vitesse ait été limitée, certains ont
roulé vite.
d. Le plus- que- parfait, il exprime l'antériorité par rapport au
présent.
Ex : Bien que la vitesse eût été limitée, certains avaient roulé vite.
Il est important de retenir qu'aujourd'hui l'imparfait et le plus- que-parfait
du subjonctif ne se rencontrent plus que dans les textes littéraires. Enfin,
on peut aussi employer le subjonctif dans des phrases simples ou dans des
propositions relatives.
Ex:
- Que personne ne sorte !
- Il n'y a qu'un étudiant intelligent qui puisse répondre à cette question.
A. b. Les modes impersonnels des verbes ne varient pas selon les
personnes grammaticales. Il s'agit de :
1° L'infinitif : Forme nominale du verbe qui exprime simplement la nom
de l'action. Tout en restant invariable, il peut occuper toutes les fonctions
du nom. Ex : Travailler, - Il faut bien manger...
2° Le participe : Forme adjective du verbe, il permet d'exprimer les
mêmes nuances que l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire occuper les mêmes
fonctions de l'adjectif qualificatif, le participe présent reste invariable,
alors que le participe passé (varie) s'accorde avec le nom qu'il qualifie.
Ex:
- Une faute avouée est à moitié pardonnée.
- Un homme travaillant jour et nuit gagne honnêtement sa vie.
3° Le gérondif : Forme adverbiale du verbe exprime, par rapport à un
verbe principal une action simultanée et indiquant une circonstance. Il est
un participe présent précédé de EN. Il est toujours complément
circonstanciel (généralement de manière). Ex: En travaillant, vous
réussirez facilement.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
122
B. Temps
Ce sont des formes que prend le verbe pour indiquer à quel moment de la
durée on situe l'action dans l'une des trois époques : présent, passé, futur.
En d'autres termes, le temps d'un verbe permet de se situer (action-parole-
état) sur un axe temporel (passé-présent-futur).
Passé Futur
Présent
Rappel
Soient les phrases :
2. Les enfants abandonnés constituent un danger pour le pays.
3. Julie DELO est rentrée tard à la maison.
4. Goldonie ESAMBO a acheté cette belle robe.
4. Cette robe, Goldonie ESAMBO l’a achetée
5. La robe que, Goldonie ESAMBO a achetée est belle.
Pour faire l’accord des participes passés, il faut maîtriser les trois règles
suivantes :
a. Le participe passé employé seul, sans auxiliaire s’accorde en genre
et en nombre avec le nom ou le groupe des mots auxquels il se
rapporte. Cfr phrase n°1.
Car il est considéré comme un adjectif qualificatif remplissant toutes les
fonctions de celui-ci.
b. Le participe passé employé avec l’auxiliaire ETRE s’accorde en
genre et en nombre avec le sujet du verbe conjugué. Cfr phrase n°2.
c. Le participe passé employé avec auxiliaire avoir s’accorde avec son
COD si celui-ci le précède. Cfr phrase n°4.
N.B. : Comme le participe passé employé sans auxiliaire joue le rôle d’un
adjectif qualificatif, il suivra les mêmes fonctions que celui-ci. Ainsi
pourra-t-il être :
Epithète (et s’accordera en genre et en nombre avec le mot auquel il
se rapporte).
Ex : - Les étudiants renvoyés étaient des Fraudeurs.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
123
- GAMBAMBA Tshitshi porte une chemise déchirée.
Epithète détachée, il s’accorde avec le nom, le pronom ou le groupe
de noms ou de pronoms auquel il se rapporte.
Ex :
- Menacée, cette fille a cherché à s’enfouir ;
- Battus à plate couture, les joueurs de MAZEMBE quittent le terrain,
la tête basse.
- Elles s’en vont, déçues de mon refus.
Attribut du sujet : (nom ou pronom) et relié à ce dernier par un
verbe copule autre que ETRE. Il s’accorde alors avec ce sujet :
Exemples :
- Vous semblez fatigués ;
- Ils ont l’air découragés ;
- Cette fille se sent abandonnée ;
- Ces fleurs me paraissent flétries ;
- Ils resteront handicapés.
Attribut d’un COD et il s’accorde avec ce complément.
Exemples:
- Je les ai trouvés abattus.
- Gardez bien ces documents enfermés dans votre coffre-fort.
- Simon KAPALAY considère toutes ces filles comme infectées
par le VIH/SIDA
- Nous vous croyons fort affectées par la triste nouvelle que vous
avez reçue.
2. CAS PARTICULIERS
1. Le participe passé suivi d’un infinitif
Exemples :
- Je les ai entendues pleurer. (Filles)
- Les étudiants que tu as vus tricher ont zéro.
- La chanson que vous avez entendu exécuter est la composition de
Werrason NGIAMA.
- Les arbres que nous avons vu couper appartiennent à Célestin.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
124
Constatations (règles) :
Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir suivi d’un infinitif
(pleurer, tricher), s’accorde en genre et en nombre avec son COD qui le
précède et si celui-ci fait en même temps l’action de l’infinitif (pleurer,
tricher). Cfr Ex. 1 et 2.
Le participe passé (entendu/vu) suivi d’un infinitif (exécuter/couper)
conjugué avec l’auxiliaire avoir reste INVARIABLE s’il n’a pas de COD
qui le précède et qui ne sera pas en même temps sujet du verbe à l’infinitif.
En effet, le COD de la phrase est celui du verbe à l’infinitif. Cfr. exemple
n°3 et 4.
Le participe passé FAIT suivi d’un infinitif
Exemples:
- Je les ai fait inscrire à l’ISTM/KIN.
- Les enfants que tu as fait appeler sont des paresseux.
Constatations : le participe passé fait suivi d’un infinitif reste
INVARIABLE, car le COD est celui de l’infinitif.
Le participe passé des verbes pronominaux
Notion : Un verbe est appelé pronominal lorsqu’il est précédé (à l’infinitif)
d’un pronom personnel de conjugaison désignant la même personne que le
sujet. Ce pronom se réalise dans la conjugaison de la manière suivante :
me, te, se, nous, vous, se.
Ex : Se laver : je me lave ; Tu te laves ; il se lave ; nous nous lavons ; vous
vous lavez ; ils se lavent.
Sortes des verbes pronominaux.
Avec le pronom personnel de conjugaison ANALYSABLE, nous
distinguons :
L’accord du participe passé se fait selon une règle complexe. Sans
auxiliaire ou composé avec l’auxiliaire être, il s’accorde comme un
adjectif. Dans certaines locutions, il reste cependant invariable quand il est
antéposé : la lettre ci-jointe, ci-joint une lettre.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
125
Par ailleurs, les pronominaux toujours conjugués avec être suivent
cependant les règles concernant les verbes conjugués avec avoir. Avec
l’auxiliaire avoir, le participe passé ne peut s’accorder qu’avec un
complément d’objet direct placé avant lui : ils ont lu, ils ont lu la lettre,
voilà la lettre qu’ils ont lue.
Certaines difficultés sont à signaler. Le complément d’objet est un pronom
neutre : elle est meilleure que je ne l’aurais cru. Le complément n’est pas
un objet direct mais un circonstanciel : les cent francs que cela m’a coûtés.
Le verbe est impersonnel : la pluie qu’il y a eu. Le participe a pour
complément un infinitif lui-même complété : tu as fait tous les efforts que
tu as pu ; les airs que j’ai entendu jouer (en revanche : les musiciens que
j’ai entendus jouer, car que représentant les musiciens est bien un
complément d’objet direct de entendre).
Enfin, pour les verbes pronominaux, l’identification du complément
d’objet direct est parfois difficile : ils se sont lavé les mains, les mains
qu’ils se sont lavées (les mains objet direct antéposé ou postposé), ils se
sont plu (pas d’objet direct, se objet indirect).
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
126
CONCLUSION GENERALE
La communication orale et écrite en français comme nous l’avons conçue au
regard du référentiel du premier cycle en LMD, porte essentiellement sur trois
aspects actifs de l’apprenant en sciences de la santé.
Il s’agit d’abord d’aiguiser ses compétences individuelles dans la prise de parole
en communauté, devant un public scientifique ou devant un patient ou n’importe
quel interlocuteur instruit, une tâche ardue assignée au deuxième et au troisième
chapitres de cet enseignement.
Ensuite, performer son expression dans la rédaction des documents
administratifs quotidiens au moyen des exercices intenses confectionnés au
quatrième chapitre.
Enfin, le rendre opérationnel dans la présentation des résultats de son
exploration pour son projet tutoré ou sur une thématique bien déterminée, il
s’agit d’un effort inlassable que doit fournir l’apprenant en dissertation
scientifique au deuxième semestre de sa formation universitaire dans le cadre de
la communication en tant que plaque tournante du système éducatif LMD et
unique facteur vivant qui établit le lien permettant à toute institution (savante) de
vivre et de fonctionner.
Somme toute, la communication est un phénomène complexe. Il ne suffit pas
qu’une personne émette un message pour qu’il y ait communication. Un
récepteur devra aussi être en contact avec l’émetteur pour un message encodé
dans les normes de façon à pouvoir être décodé, alors qu’il ne prend
signification que dans une situation.
Réussir une communication n’est pas toujours simple qu’on le croirait, car une
multitude de facteurs, comme nous l’enseignons, peuvent la perturber.
Si l’on est naturellement porté à jeter le blâme d’un échec sur les personnes,
l’émetteur ou le récepteur, il ne faudrait toutefois pas oublier que chaque
composante de la communication est en cause dans l’échec ou dans la réussite
de la communication ; c’est cependant à l’émetteur et au récepteur qu’il revient
d’intervenir dans les autres composantes pour modifier le code, indiquer le
référent, adapter le message ou choisir le canal.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
127
BIBLIOGRAPHIE
1. ALMERAS (J), FURIA (D) et SERRE (P.Ch). ; Méthodes de réflexion
et techniques d’expression, 4e éd. Revue et augmentée. Paris : Armand
Colin, 1970, 461 P
2. BARIL (D) et GUILLET (J) ; Technologies de l’expression écrite et
orale, Paris : Sirey, 1975 et 1978, 281 P
3. BASELE KITOKO (A), Pour bien parler et écrire le français,
Bandundu ; 1995 43 P
4. BLED (E) ; Cours supérieur d’orthographe, Paris : Classiques Hachettes,
1988 ; 285 P
5. BRAUNS (J) ; Technique de la parole française, 2e éd, Paris Namur :
Wesmel, 1966.
6. BRUN (J), DOPPAGNE (A), Chevalier (J.M) ; l’art de composer et
rédiger, Bruxelles, 1966
7. COURRAULT (T), Manuel pratique de l’art d’écriture. Paris : Hachette,
1957 ; 276 p.
8. DOPP (J) ; Notions de logique formelle, Louvain : publication de
l’Université de Louvain, 1972, SP.
9. DUBOIS (C) ; Dictionnaire encyclopédique, Paris : Larousse, 1987.
10. GREVISSE (M), Le bon usage (grammaire française aujourd’hui), 9e éd.
JDU CULOT (Gembloux, Belgique) et Hatier (Paris), 1969.
11. HANLT (C) ; La technique du style, 100e éd. Liège Paris : H. Dessain.
1962 ; 384 p.
12. JASPERS (K), Introduction à la philosophie, Paris : Pion, 1975.
13. MAMBOTE METO Mwanz, Parler et écrire correctement le français.
Kinshasa, Novembre 2007, 4. Op.
14. MANKANGU et al, Quel français parlons-nous ? Des fautes à éviter,
Kinshasa, CRP, 1999 ; 47p.
15. DANISA et al, Manières de dire…Expressions et locutions françaises,
Kinshasa, CRP, 1999 ; 40 p.
16. MUTUNDA MWAMBO, Eléments de logique, Kinshasa : éd. Du
CERDAF, 2001 ; 110p.
17. RISS (C.N), Correspondance administrative, Kinshasa : COOPECCO,
SD, 47p.
18. OWANDJOLA WELO (A), Cours de logique, expression orale et écrite,
inédit, RDC, ISTM/Kinshasa, 2008 ; 57p
19. THOMAS (A), Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris :
Larousse, 1956.
20. ELOHO OVUNGU, Thème et écriture dans l’œuvre dramatique d’Aimé
Césaire, UPN, 2019.
21. ELOHO OMOMOKOKO OVUNGU, Techniques d’Expression orale et
écrite en français, ISTMKIN, 2021.
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
128
22. ELOHO OMOMOKOKO OVUNGU, Techniques de la communication
en français, ISTM KIN, 2022.
23. MARIE CLAUDE CELINAS, Communication efficace, de l’intention
aux moyens d’expression, 2ième édition, les Editions CEC 2001, p 4
Prof Jean ELOHO OVUNGU/Communication en Français LMD1
Vous aimerez peut-être aussi
- Lesot Adeline Bescherelle Lessentiel Pour Mieux Primer A 2Document460 pagesLesot Adeline Bescherelle Lessentiel Pour Mieux Primer A 2Yesmine Cherif100% (11)
- Français ScientifiqueDocument260 pagesFrançais ScientifiqueZara Rose100% (4)
- Enseigner le français langue étrangère et seconde: Approche humaniste de la didactique des langues et des culturesD'EverandEnseigner le français langue étrangère et seconde: Approche humaniste de la didactique des langues et des culturesPas encore d'évaluation
- Le français langue étrangère et seconde: Enseignement et apprentissageD'EverandLe français langue étrangère et seconde: Enseignement et apprentissageÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- L'apprentissage du français en vue de l'intégration: réflexions autour de formateurs migrants et d'élèves allophonesD'EverandL'apprentissage du français en vue de l'intégration: réflexions autour de formateurs migrants et d'élèves allophonesPas encore d'évaluation
- Objectif Diplomatie Guide Pedagogique PDFDocument161 pagesObjectif Diplomatie Guide Pedagogique PDFYassine FKPas encore d'évaluation
- ObjDiplom2 PDFDocument126 pagesObjDiplom2 PDFCarmina ChrapkiewiczPas encore d'évaluation
- Guide Aplus2Document138 pagesGuide Aplus2Galilea RuanoPas encore d'évaluation
- Communication Orale Et Écrite en Situation ProfessionnelleDocument54 pagesCommunication Orale Et Écrite en Situation Professionnellebrandao sultan100% (2)
- Cécile Van Den Avenne - Savoir Rédiger - Studyrama (2009)Document139 pagesCécile Van Den Avenne - Savoir Rédiger - Studyrama (2009)anniePas encore d'évaluation
- Didactique Du Français PDFDocument0 pageDidactique Du Français PDFelouadil100% (3)
- Enseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?D'EverandEnseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?Pas encore d'évaluation
- Vocabulaire CM1 Rentrée 2018 1Document6 pagesVocabulaire CM1 Rentrée 2018 1Sokoura90Pas encore d'évaluation
- Pedagogie S Active S en Langues Vivantes Memoire Meef DamiendechanteracDocument55 pagesPedagogie S Active S en Langues Vivantes Memoire Meef DamiendechanteracBilal BilallPas encore d'évaluation
- Le Francais de Proche en Poche - ANULI - Sem1Document186 pagesLe Francais de Proche en Poche - ANULI - Sem1Frațilescu Fabian Constantin AlexandruPas encore d'évaluation
- Le prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesD'EverandLe prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesPas encore d'évaluation
- PDF Blanchet Didac-Part1Document16 pagesPDF Blanchet Didac-Part1jirehikoliPas encore d'évaluation
- Pfe CemefDocument21 pagesPfe Cemefboujmaa oumaimaPas encore d'évaluation
- La Formation Des AdverbesDocument34 pagesLa Formation Des AdverbesPauline MamaníPas encore d'évaluation
- Turc PDFDocument13 pagesTurc PDFArias Roland R.Pas encore d'évaluation
- Guía Francés Primer Ciclo de Secundaria PDF 05-08-20Document110 pagesGuía Francés Primer Ciclo de Secundaria PDF 05-08-20Anyi Hernández100% (3)
- Aplus2 TBK IntroDocument8 pagesAplus2 TBK Introsol ximena escandellPas encore d'évaluation
- Séquence Découverte 1Document17 pagesSéquence Découverte 1HENRY0% (1)
- Français Médical PDFDocument13 pagesFrançais Médical PDFMario avotra fandresena RazafimiarakaPas encore d'évaluation
- DFLE I - Fiche de BaseDocument41 pagesDFLE I - Fiche de BaseAlex Jose FombePas encore d'évaluation
- Construction Des SavoirsDocument9 pagesConstruction Des SavoirsSirine Ben sassiPas encore d'évaluation
- Sujet 7 OposDocument6 pagesSujet 7 OposVirgi RebolloPas encore d'évaluation
- BadulescuDocument13 pagesBadulescuBassem EllafiPas encore d'évaluation
- André Vaillant - Grammaire Comparée Des Langues Slaves. Tome IV, La Formation Des Noms-Klincksieck (1974.)Document809 pagesAndré Vaillant - Grammaire Comparée Des Langues Slaves. Tome IV, La Formation Des Noms-Klincksieck (1974.)MirikaaPas encore d'évaluation
- Belembe Version ActuelleDocument39 pagesBelembe Version ActuelleBelju ZogoPas encore d'évaluation
- OutalebDocument9 pagesOutalebfaisma1Pas encore d'évaluation
- Eoe 1Document61 pagesEoe 1arvelinmayele1Pas encore d'évaluation
- Cours de Eoe-1Document51 pagesCours de Eoe-1timotheenvenidagbengbasaPas encore d'évaluation
- Mémoire Comp CulturelleDocument90 pagesMémoire Comp CulturelleAbdelatif EL AadiouiPas encore d'évaluation
- Cours de Communication Écrite Et OraleDocument67 pagesCours de Communication Écrite Et OraleAboubouPas encore d'évaluation
- Didact2 Chapitre05Document11 pagesDidact2 Chapitre051192427601Pas encore d'évaluation
- Thèse Anselmo Fusionnée 26 06 18Document604 pagesThèse Anselmo Fusionnée 26 06 18dienotandalaPas encore d'évaluation
- Cours 1 DidaDocument8 pagesCours 1 DidaDounia MaamriPas encore d'évaluation
- Une Approche Communicative de L' Enseignement/ Apprentissage Du Fran Ais Langue!trang"re, Une Alternative Possible en Contexte Universitaire JaponaisDocument16 pagesUne Approche Communicative de L' Enseignement/ Apprentissage Du Fran Ais Langue!trang"re, Une Alternative Possible en Contexte Universitaire Japonaishanyshady348Pas encore d'évaluation
- Prof. DR Blaise Bulele Cours Techn de Communication Ulk 2024Document131 pagesProf. DR Blaise Bulele Cours Techn de Communication Ulk 2024laza4000Pas encore d'évaluation
- Séance 1 Bref HistoriqueDocument5 pagesSéance 1 Bref HistoriqueSafa IseedPas encore d'évaluation
- COURS EOR Par MIMBUDocument62 pagesCOURS EOR Par MIMBUChristianPas encore d'évaluation
- Sujet 3Document4 pagesSujet 3rocioPas encore d'évaluation
- UE Langue en Situation UE1Document14 pagesUE Langue en Situation UE1adil.31.05.2003Pas encore d'évaluation
- Technolecte Et Difficultes Des EtudiantsDocument90 pagesTechnolecte Et Difficultes Des EtudiantsRachid OuaoumanaPas encore d'évaluation
- 1.3 Les Methodes D Enseignement Du FLEDocument2 pages1.3 Les Methodes D Enseignement Du FLENadia GuendoulPas encore d'évaluation
- ElzoDocument22 pagesElzoel hadji ndiayePas encore d'évaluation
- Interactions3 Guide PDFDocument159 pagesInteractions3 Guide PDFMaksimPas encore d'évaluation
- Ruiz de ZarobeDocument11 pagesRuiz de ZarobeAndrés LedesmaPas encore d'évaluation
- Acte Conference Jacky GirardetDocument18 pagesActe Conference Jacky Girardetrastignac2007Pas encore d'évaluation
- BG Digital Final 1Document181 pagesBG Digital Final 1Gavra IcaPas encore d'évaluation
- Le Rôle Des Documents Authentiques Dans L'enseignementDocument8 pagesLe Rôle Des Documents Authentiques Dans L'enseignementMaroua BaddouPas encore d'évaluation
- La Méthodologie DirecteDocument4 pagesLa Méthodologie Directehoufani.inel7Pas encore d'évaluation
- La Traductologie Et Les Cours de TraductDocument14 pagesLa Traductologie Et Les Cours de TraductLeo MerlinPas encore d'évaluation
- Analyse Du Discours Et Didactique Des LEDocument7 pagesAnalyse Du Discours Et Didactique Des LEt tPas encore d'évaluation
- Jétu99 Prépubli Définitif2Document43 pagesJétu99 Prépubli Définitif2Josephine JaskoPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument14 pages1 PBLudmila GatmanPas encore d'évaluation
- De Diverses Méthodes D'apprentissage Pour Le FLEDocument11 pagesDe Diverses Méthodes D'apprentissage Pour Le FLEa3420615Pas encore d'évaluation
- Act 3 de MatematicaDocument3 pagesAct 3 de MatematicaYulieth Araujo CarreroPas encore d'évaluation
- Les Exercices de Grammaire Et Le Développement de La Compétence Communicative: Une TypologieDocument106 pagesLes Exercices de Grammaire Et Le Développement de La Compétence Communicative: Une Typologieaha dyvePas encore d'évaluation
- DismoicestquoilamdiationDocument6 pagesDismoicestquoilamdiationVIRGINIEPas encore d'évaluation
- Comment Enseigner - FOS PDFDocument4 pagesComment Enseigner - FOS PDFJulissa VargasPas encore d'évaluation
- Pupvd 2792Document122 pagesPupvd 2792Mohamed RadwanPas encore d'évaluation
- La pédagogie à travers le débat-éloquence: Un guide pour les formateursD'EverandLa pédagogie à travers le débat-éloquence: Un guide pour les formateursPas encore d'évaluation
- Cervenkova Largot Et Langue Commune procédés de FormationDocument10 pagesCervenkova Largot Et Langue Commune procédés de Formationalu0101440873Pas encore d'évaluation
- Article PortuguesDocument88 pagesArticle PortuguesDiana BolancaPas encore d'évaluation
- VocabulaireDocument4 pagesVocabulaireNoria TrachenPas encore d'évaluation
- Repartition FIA330-2Document27 pagesRepartition FIA330-2Elie ShweihPas encore d'évaluation
- Séance 3 Les Procédés de Formation Du Lexique - La DérivationDocument19 pagesSéance 3 Les Procédés de Formation Du Lexique - La DérivationHashas2022Pas encore d'évaluation
- Ateliers 3 6 VOCABULAIRE I La Formation Des MotsDocument2 pagesAteliers 3 6 VOCABULAIRE I La Formation Des MotsMaxime ArgantPas encore d'évaluation
- La Grammaire Du Français Points de Vigilance VFDocument6 pagesLa Grammaire Du Français Points de Vigilance VFhessasPas encore d'évaluation
- Colloque-Adjectif 2007 - ResumesDocument21 pagesColloque-Adjectif 2007 - ResumesMarius Iancu100% (1)
- Fiches de Revision Lexique Maitresse Aux LunettesDocument7 pagesFiches de Revision Lexique Maitresse Aux LunettesdgomezrPas encore d'évaluation
- FR l3 linguistique-LOUNISDocument28 pagesFR l3 linguistique-LOUNISNero HomersPas encore d'évaluation
- La Nominalisation Des VerbesDocument3 pagesLa Nominalisation Des Verbesđức quang phạmPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 2003 MorphoDocument22 pagesChapitre 4 2003 Morphodaniel200173chingombePas encore d'évaluation
- Vocabulaire Au Cours Moyen 2013Document22 pagesVocabulaire Au Cours Moyen 2013Mamadou BaroPas encore d'évaluation
- Vocabulaire Cm1 005Document40 pagesVocabulaire Cm1 005mimi crouzatPas encore d'évaluation
- UD1 FRANCAIS 6ème Année Du Primaire - Exercices de Soutien. MES FICHESDocument2 pagesUD1 FRANCAIS 6ème Année Du Primaire - Exercices de Soutien. MES FICHESmariam2000bouf100% (1)
- Jitwongnan Jarukan m2r Lpvs BifféDocument175 pagesJitwongnan Jarukan m2r Lpvs Bifféhalima.lagra30Pas encore d'évaluation
- Pascale Cole 111202 Avec Couv 201150Document11 pagesPascale Cole 111202 Avec Couv 201150claudine tPas encore d'évaluation
- Morphologie. Structure Morphématique Du Mot. Crit - Res de Classement Des Mots en Catégories, Les Parties Du Disco UrsDocument7 pagesMorphologie. Structure Morphématique Du Mot. Crit - Res de Classement Des Mots en Catégories, Les Parties Du Disco Ursjakubes2Pas encore d'évaluation
- Less and FullDocument8 pagesLess and FullMed ChaibPas encore d'évaluation
- Morphemes FrancaiseDocument5 pagesMorphemes FrancaiseLaura IsabelPas encore d'évaluation
- Sores Oa TRDocument176 pagesSores Oa TRBrocherPas encore d'évaluation
- Les Principaux Préfixes Et SuffixesDocument9 pagesLes Principaux Préfixes Et Suffixesbfmvscbyx9Pas encore d'évaluation
- Exploitation de Texte 1Document46 pagesExploitation de Texte 1Losseni FOFANA100% (1)
- Trabajo Linguistica TerminadoDocument13 pagesTrabajo Linguistica Terminadoandrea rojasPas encore d'évaluation