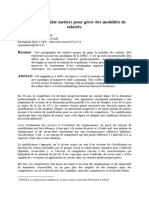Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CH3-MSGN Synthese
CH3-MSGN Synthese
Transféré par
leturgie62136Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CH3-MSGN Synthese
CH3-MSGN Synthese
Transféré par
leturgie62136Droits d'auteur :
Formats disponibles
Management Sciences de Gestion et Numérique (STMG)
Classe de Terminale RH-GF – Condorcet – 21/22 – MY
Thème 01 : Les organisations et l’activité de production de biens et de services
QDMSGNG N° 02 : Quelles ressources pour produire ?
Chapitre 03 : QUELLES RESSOURCES HUMAINES POUR PRODUIRE
Synthèse
L’évolution de l’environnement et les choix stratégiques de l’organisation nécessitent d’adapter par
anticipation les ressources humaines qui contribuent, par leur nombre et leurs compétences, à la
création de valeur.
A. Comment adapter les emplois et les compétences aux besoins de l’activité de
production ?
a. Qu’est-ce que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ?
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (ou « Gépec ») est une démarche
prospective qui vise à adapter les emplois, les effectifs et les compétences des salariés aux besoins
immédiats et futurs de l’organisation.
C’est un outil d’accompagnement du changement qui implique de nombreux acteurs de l’organisation.
Depuis 2005, le code du Travail impose une obligation de négocier la GPEC avec les partenaires
sociaux tous les 3 ans (négociation triennale) :
• aux entreprises qui emploient au moins 300 salariés ;
• aux entreprises de dimension communautaire employant au moins 150 salariés en France.
La GPEC peut être négociée à trois niveaux :
• au niveau de l’entreprise ;
• au niveau d’une branche professionnelle ;
• au niveau d’un territoire.
b. Les objectifs de la GPEC
Au niveau de l’entreprise, la GPEC permet d’anticiper l’impact des évolutions environnementales (aux
niveaux légal, réglementaire, technologique, socio-politique, économique, écologique) et des décisions
stratégiques sur les ressources humaines nécessaires à l’activité de production.
En ce sens, la GPEC vise à pérenniser l’organisation en mettant à sa disposition les effectifs et les
compétences dont elle aura besoin pour maintenir un haut niveau de performance économique sur le
court terme et moyen terme.
Dans le même temps, la GPEC concourt à l’amélioration des conditions de travail, à la santé des
salariés et à la transmission des savoirs. Les actions engagées sont nécessaires aux besoins des
salariés et répondent ainsi à leur développement professionnel.
SYNTHESE – MSGN – CH3 – T1/Q2 Page 1 sur 3
c. La démarche de la GPEC
Pour mener à bien une démarche de GPEC, il est primordial que l’organisation suive un processus en
4 étapes successives :
1. Dresser un état des lieux des emplois et des qualifications disponibles dans l’organisation :
cette première étape consiste à prendre une photographie de l’organisation. Une cartographie
complète des métiers et des compétences ainsi que des outils utilisés dans le cadre de la gestion
des ressources humaines (GRH) est construite.
2. Anticiper les besoins, en matière d’emplois et de compétences, de l’organisation dans le futur
compte tenu de l’évolution de son environnement et de sa stratégie.
3. Mesurer les écarts entre l’existant et le futur : cette projection permettra de mettre en évidence
des écarts tant sur le plan quantitatif (effectif salarié) que sur le plan qualitatif (évolution des
compétences induite par l’évolution des métiers).
4. Mettre en œuvre les outils GRH (mobilités internes, formations, recrutements, licenciements,
entretiens annuels, etc.) pour réduire les écarts existants.
L’implication de tous les acteurs de l’organisation est déterminante dans la réussite de ce processus.
Il est donc important de communiquer envers les salariés, les managers et les partenaires sociaux afin
que chacun en comprenne les objectifs, y adhère et y participe.
Enfin, la démarche de la GPEC n’est pas un projet à court terme car elle s’étale sur une période de 3
à 5 ans. Il est donc important d’évaluer les actions mises en œuvre afin de les réajuster si nécessaire
aux nouveaux besoins détectés.
B. Quels sont les enjeux de la GPEC ?
a. Les enjeux de performance économique
La performance économique d’une organisation est étroitement liée à la manière dont elle gère ses
effectifs mais aussi son capital humain, c’est-à-dire l’ensemble des aptitudes et des talents qui rendent
les salariés plus productifs.
Face aux évolutions de leurs environnements (politique, économique, sociologique, technologique,
écologique et légal), les organisations doivent anticiper leurs besoins en matière d’emplois, d’effectifs
et de compétences pour maintenir, voire développer leur niveau de performance, de compétitivité et
accompagner les changements auxquels leurs salariés sont confrontés.
Le capital humain est un facteur clé qui contribue fortement au développement et à la pérennité des
organisations sur leur marché. À ce titre, il convient d’optimiser les dispositifs de formation pour
développer la qualification des salariés et accompagner au mieux les changements dans l’organisation
du travail induits par les changements de la production.
Enfin, toujours dans un souci de performance économique, il est indispensable de réduire les risques
et les coûts liés aux éventuels déséquilibres constatés (situation de sureffectif ou de sous-effectif, par
exemple).
SYNTHESE – MSGN – CH3 – T1/Q2 Page 2 sur 3
b. Les enjeux sociaux
Anticiper les évolutions d’activité et de métier, c’est aussi se poser la question du vieillissement des
salariés et du transfert de leurs compétences au moment de leur départ à la retraite pour éviter une
perte de savoir-faire préjudiciable à l’organisation. Le maintien dans l’emploi des séniors tout comme
la préservation de la santé des salariés et l’amélioration continuelle de leurs conditions de travail font
aussi partie des enjeux sociaux de la GPEC.
C. Comment les nouvelles exigences productives transforment-elles les relations de travail ?
a. Le télétravail
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être
exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon
volontaire et en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Dans toute entreprise ou établissement public, il peut être décidé de mettre en place le télétravail, soit
en négociant un accord collectif, soit, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur
après avis du comité social et économique. En l’absence de ces textes, le salarié et l’employeur
peuvent également s’entendre dans une forme de gré à gré, « par tous moyens » : un écrit, un e-mail,
voire un échange oral peuvent suffire.
Le télétravailleur a les mêmes droits et avantages professionnels que ceux dont bénéficie le salarié
travaillant dans les locaux de l’entreprise (droit à la formation, accès aux informations syndicales et
aux élections professionnelles, etc.).
b. Le travail collaboratif
Le travail collaboratif est le travail réalisé en commun par plusieurs personnes qui mutualisent leurs
connaissances et leurs compétences, s’organisent et coordonnent leurs actions pour obtenir un
résultat dont ils sont collectivement responsables.
Ce nouveau mode de travail repose sur :
• Les technologies de l’information et de la communication qui en sont l’outil indispensable ;
• Une organisation du travail horizontale, où tous les membres du groupe interagissent d’égal à
égal, contrairement aux méthodes de travail plus traditionnelles dans lesquelles la hiérarchie
est au centre ;
• Des espaces de travail repensés, avec des bureaux ouverts, des espaces partagés et une mise
en commun de services et d’équipements pour que les salariés se rencontrent de manière
interactive et puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Ce phénomène est
appelé coworking en anglais.
c. Le portage salarial
Le portage salarial est un mode de travail qui permet à une personne d’entreprendre et de se lancer
dans une activité professionnelle tout en bénéficiant du statut de salarié et de sa couverture sociale.
Le portage salarial met en relation trois parties :
1. Le salarié en portage, qui effectue des missions auprès de son client.
2. L’entreprise cliente, qui règle le montant des prestations directement à la société de portage
salarial.
3. La société de portage, qui reverse au salarié porté le chiffre d’affaires réalisé, sous forme de
bulletins de paie après avoir cotisé aux différentes caisses (retraite, prévoyance, sécurité sociale,
etc.).
Le portage salarial est donc un nouveau mode de travail à mi-chemin entre le travail indépendant et le
salariat.
SYNTHESE – MSGN – CH3 – T1/Q2 Page 3 sur 3
Vous aimerez peut-être aussi
- FICHE E4 A REMPLIR OrganisationDocument2 pagesFICHE E4 A REMPLIR OrganisationThierry Tran100% (2)
- Domaine de La Gestion Social 1 & 2Document51 pagesDomaine de La Gestion Social 1 & 2Jean Yves YENG100% (1)
- Module GpecDocument27 pagesModule Gpecngzouly100% (2)
- Le RecrutementDocument18 pagesLe RecrutementJihane Jiji100% (3)
- La Matrice SWOT: Élaborer un plan stratégique pour votre entrepriseD'EverandLa Matrice SWOT: Élaborer un plan stratégique pour votre entrepriseÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cours Gouvernance de SI Partie3 MansouriDocument72 pagesCours Gouvernance de SI Partie3 MansouriMontasser Taktak100% (1)
- 015 - Procedure de Retrait - Rappel - V2 - 2 PDFDocument1 page015 - Procedure de Retrait - Rappel - V2 - 2 PDFOualid HarroudPas encore d'évaluation
- PdauDocument2 pagesPdauAmar Younes67% (3)
- 20190130-4607564 INFINITT SFAM Assurance PDFDocument13 pages20190130-4607564 INFINITT SFAM Assurance PDFsamjs atedhPas encore d'évaluation
- 2 - La GPECDocument7 pages2 - La GPECsanaPas encore d'évaluation
- La Gestion Prévisionnelle Des Emplois Et Des CompétencesDocument4 pagesLa Gestion Prévisionnelle Des Emplois Et Des Compétencesnathalie.peyrePas encore d'évaluation
- GPECDocument10 pagesGPECLoliloloPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 La GpecDocument24 pagesChapitre 3 La GpecahmedcomptaliaPas encore d'évaluation
- Mana Tremplin Tle CH04 Corr SyntheseDocument2 pagesMana Tremplin Tle CH04 Corr SyntheseMax glavanPas encore d'évaluation
- GPECDocument16 pagesGPECyasmineberrada2014Pas encore d'évaluation
- Module GpecDocument21 pagesModule GpecSinary DoumbiaPas encore d'évaluation
- GPECDocument5 pagesGPECAnaëlle CHARTOIREPas encore d'évaluation
- GPEC SouhailDocument7 pagesGPEC SouhailyazPas encore d'évaluation
- GPEC (Support de Cours)Document20 pagesGPEC (Support de Cours)Lh Lh100% (3)
- Comment Mettre Place Une GPEC en EntrepriseDocument8 pagesComment Mettre Place Une GPEC en EntrepriseMahdi AllaniPas encore d'évaluation
- Gpec - CoursDocument12 pagesGpec - CoursLéaPas encore d'évaluation
- GPECDocument8 pagesGPECAbidPas encore d'évaluation
- Résumé de Cours de Management D'entrepriseDocument11 pagesRésumé de Cours de Management D'entreprisecilekkoksuPas encore d'évaluation
- I: L'analyse Des Emplois: 1: DefinitionDocument5 pagesI: L'analyse Des Emplois: 1: DefinitionZakaria Bensassi NourPas encore d'évaluation
- Comment Et Pourquoi Mettre en Place Sa GPECDocument8 pagesComment Et Pourquoi Mettre en Place Sa GPECChristel ESSONGOPas encore d'évaluation
- Questionnaire GPECDocument8 pagesQuestionnaire GPECerdoPas encore d'évaluation
- Copie de GPECDocument3 pagesCopie de GPECkarimPas encore d'évaluation
- La GPECDocument5 pagesLa GPECKarim HaddadiPas encore d'évaluation
- Cartographie MetiersDocument17 pagesCartographie MetiersLyesPas encore d'évaluation
- GPECDocument4 pagesGPECdeelar2100% (1)
- CcOURS DE GRH ULPGL L2 A Et B Sept 2022 Economie Et GestionDocument77 pagesCcOURS DE GRH ULPGL L2 A Et B Sept 2022 Economie Et Gestionmatthieukenny66Pas encore d'évaluation
- GPEC CoursDocument20 pagesGPEC CoursSindtPas encore d'évaluation
- La GpecDocument2 pagesLa GpecRim El HarchaouiPas encore d'évaluation
- La Gestion Prévisionnelle Des Emplois Et Des Compétence1Document12 pagesLa Gestion Prévisionnelle Des Emplois Et Des Compétence1fatna badriPas encore d'évaluation
- CH3-MSGN RH GpecDocument5 pagesCH3-MSGN RH Gpecleturgie62136Pas encore d'évaluation
- GPECDocument12 pagesGPECdecarsinPas encore d'évaluation
- GPECDocument10 pagesGPECchimerePas encore d'évaluation
- Bâtir Une Gpec Alcodefi FinaleDocument109 pagesBâtir Une Gpec Alcodefi Finalehaythem aouiniPas encore d'évaluation
- GpecDocument4 pagesGpecNahali AdnenPas encore d'évaluation
- Cours Gpec 1 AbamaDocument23 pagesCours Gpec 1 AbamaAbamaPas encore d'évaluation
- GPEC Et BTPDocument1 pageGPEC Et BTPJam SaxionPas encore d'évaluation
- GPEC2Document8 pagesGPEC2ASMAEPas encore d'évaluation
- Ressources - Droit À La DéconnexionDocument8 pagesRessources - Droit À La Déconnexioncoline achillePas encore d'évaluation
- 2024 Notes MRH S2Document13 pages2024 Notes MRH S2babsguy34Pas encore d'évaluation
- Cours GRH Et Droit de TravailDocument25 pagesCours GRH Et Droit de Travaildhdh0% (1)
- Guide GPEC EureciaDocument14 pagesGuide GPEC EureciaMohamed KOUNAIDIPas encore d'évaluation
- Support de Cours La Gestion Prévisionnelle Des Emplois Et Des Compétences GPEC VFDocument5 pagesSupport de Cours La Gestion Prévisionnelle Des Emplois Et Des Compétences GPEC VFabderrahmaneoulmaleh186Pas encore d'évaluation
- Dtoit Du TravailDocument27 pagesDtoit Du TravailhafidPas encore d'évaluation
- Définition de La GEPPDocument2 pagesDéfinition de La GEPPzemalache imenePas encore d'évaluation
- Resume Cours Gpec Et Gepp - 022030Document6 pagesResume Cours Gpec Et Gepp - 022030chidoromfortuneoyono628Pas encore d'évaluation
- Support 01 Cours Polytech Management Et GRH - EntrepreneuriatDocument39 pagesSupport 01 Cours Polytech Management Et GRH - EntrepreneuriatFranz NfonyelePas encore d'évaluation
- Révision Partiels Outils RHDocument6 pagesRévision Partiels Outils RHCorine OwonaPas encore d'évaluation
- Cas Société GénéraleDocument2 pagesCas Société GénéraleRuskov TvPas encore d'évaluation
- RESUME GRH-AbdelilahDocument8 pagesRESUME GRH-AbdelilahFORSEE MouradPas encore d'évaluation
- Développement Des CompétencesDocument8 pagesDéveloppement Des CompétencesLucyPas encore d'évaluation
- GPEC - CoursDocument6 pagesGPEC - CoursMAIRAU SylviePas encore d'évaluation
- Cours GPEC LPRH MAJ 28012021 - Séance 4Document19 pagesCours GPEC LPRH MAJ 28012021 - Séance 4damsdu13Pas encore d'évaluation
- Cours 1 Introduction Du Cours de GPEC 2020Document26 pagesCours 1 Introduction Du Cours de GPEC 2020Omar GueyePas encore d'évaluation
- 3.1 Le RecrutementDocument8 pages3.1 Le Recrutementkof100% (1)
- Gestion Des Ressources Humaines 2Document47 pagesGestion Des Ressources Humaines 2NguyễnNgọcThanhYếnPas encore d'évaluation
- Partie PratiqueDocument4 pagesPartie PratiqueZeineb SialaPas encore d'évaluation
- DéfisDocument12 pagesDéfisgrandgerardPas encore d'évaluation
- De La Gestion Prévisionnelle Des Emplois À La GPECDocument5 pagesDe La Gestion Prévisionnelle Des Emplois À La GPECRachid LahcenPas encore d'évaluation
- GPECDocument22 pagesGPECElmedaker RedaPas encore d'évaluation
- Le management par objectifs: Maximiser les performances de votre équipeD'EverandLe management par objectifs: Maximiser les performances de votre équipePas encore d'évaluation
- Fiche N°20 Traitement Des Frais de TransportDocument4 pagesFiche N°20 Traitement Des Frais de Transportdidier amoussou100% (1)
- Arrêté Du Concours 2019-2Document9 pagesArrêté Du Concours 2019-2Loic MCPas encore d'évaluation
- O F P P T: Résumé Théorique Et Guide Des Travaux PratiquesDocument124 pagesO F P P T: Résumé Théorique Et Guide Des Travaux PratiquesYounes CherkaouiPas encore d'évaluation
- Formation CMUDocument7 pagesFormation CMUMamadou GueyePas encore d'évaluation
- Modèle Excel Budget de Trésorerie - CopieDocument36 pagesModèle Excel Budget de Trésorerie - CopieOlivia CrémelPas encore d'évaluation
- FT GeoStrap (FR)Document1 pageFT GeoStrap (FR)BOUZIANE MessaoudPas encore d'évaluation
- Entraînement-n°2-Les-travaux-de-fin-dexercice-CONTROLE 1Document3 pagesEntraînement-n°2-Les-travaux-de-fin-dexercice-CONTROLE 1AbrahamMateoPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 - Gestion - Bac Economie & Gestion (2015-2016) MR SOLTANI MOHAMED HEDIDocument5 pagesDevoir de Contrôle N°1 - Gestion - Bac Economie & Gestion (2015-2016) MR SOLTANI MOHAMED HEDIMohamed AjroudPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges Audit Energetique Dans Le Secteur Tertiaire 2011Document64 pagesCahier Des Charges Audit Energetique Dans Le Secteur Tertiaire 2011Wafa MersniPas encore d'évaluation
- Concours de Recrutement Des Techniciens 3 Grade Liste Des Candidats Convoqués Aux Épreuves Écrites Le 10/09/2023 À 07h30 Centre de Concours: FESDocument88 pagesConcours de Recrutement Des Techniciens 3 Grade Liste Des Candidats Convoqués Aux Épreuves Écrites Le 10/09/2023 À 07h30 Centre de Concours: FESd.diamentinePas encore d'évaluation
- Ias 27 Et La ConsolidationDocument2 pagesIas 27 Et La ConsolidationMouna HadhoudPas encore d'évaluation
- Missions AttributionsDocument13 pagesMissions Attributionssalma laraPas encore d'évaluation
- 378 Padova-Steel 210218Document8 pages378 Padova-Steel 210218Marius CiobotaruPas encore d'évaluation
- 4 - Cours Consolidation M2CCA Chapitre 6 22 23Document5 pages4 - Cours Consolidation M2CCA Chapitre 6 22 23HOUEHOUPas encore d'évaluation
- Devoir de Maison Modele RHDocument5 pagesDevoir de Maison Modele RHAdéola Isdyne Christy Richmond BoussariPas encore d'évaluation
- Fascicule I - La Stratégie D'entreprise 2021 PDFDocument44 pagesFascicule I - La Stratégie D'entreprise 2021 PDFAdoum IssaPas encore d'évaluation
- Direction de La Recherche Et de L'ingénierie de Formation: Corrige Fourni A Titre IndicatifDocument6 pagesDirection de La Recherche Et de L'ingénierie de Formation: Corrige Fourni A Titre IndicatifSalimPas encore d'évaluation
- Optimalisez Votre Entreprise - MFINANCESDocument14 pagesOptimalisez Votre Entreprise - MFINANCESSOSTHENE JACKSON Djeumo NANAPas encore d'évaluation
- Projet Économie Des TransportsDocument10 pagesProjet Économie Des TransportsDon Prévu IbambiPas encore d'évaluation
- Expose D'ogeDocument8 pagesExpose D'ogeKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation
- WITH MESH-detailingDocument283 pagesWITH MESH-detailingSUBBUPas encore d'évaluation
- Examen Gestion Financiere 1ere SessionDocument8 pagesExamen Gestion Financiere 1ere Sessiondeniz zinedPas encore d'évaluation
- ChapitreII Analyse de DéfaillancesDocument9 pagesChapitreII Analyse de DéfaillancesRabeh BenzadaPas encore d'évaluation
- Management Theories Et PratiquesDocument16 pagesManagement Theories Et PratiquesAbdallah NeilyPas encore d'évaluation
- Rapport Annuel VF MARSA MAROC 2017Document23 pagesRapport Annuel VF MARSA MAROC 2017saadPas encore d'évaluation