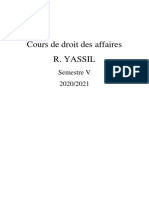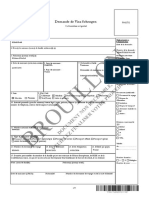Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Note Philo
Note Philo
Transféré par
el bardaiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Note Philo
Note Philo
Transféré par
el bardaiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Selon Rousseau, La pitié est l’origine de la morale
Il pense que l’homme nait naturellement bon, mais c’est la société qui le corrompt
et le déprave
L’homme est animé par deux tendance
-l’amour de soi: instinct de conservation (de la vie) conforme à la vie (ni mauvais
ni bon)
-la pitié : Capacité d’éprouver de la souffrance au spectacle (à la vue) de la
souffrance d’autrui
= les animaux eux même sont capable d’empathie
« On ne plaint jamais dans autrui que les maux dont on ne se croit pas soi-même
exempt » On a plus de mal à ressentir de la pitié pour une personne qui est dans
une situation, dans laquelle on sera probablement jamais.
Conception de la pitié comme fondement, comme origine de la morale : la pitié est
la condition de la moralité
Si on n’est pas capable d’éprouver de la pitié => on ne peut pas reconnaître la
souffrance des autres => on ne peut pas reconnaître autrui comme notre semblable =>
il n’y a pas de communauté humaine pas de fraternité => pas de véritable moralité
Si on ne re ressent pas souffrance de l’autre on ne peut pas agir moralement face à
lui.
Problèmes :
La pitié est subjective et sélective
- on a du mal à ressentir de la pitié pour des personne, lointaine, dont on ne
perçoit pas clairement la souffrance : exemple les réfugiés, on ne voir pas leur
visage
La vie en société développe l’amour propre (on s’aime, notamment dans le regard des
autres). Exige l’amour des autres, recherche d’une certaine reconnaissance qui va
créer de la jalousie, de l’envie qui va éteindre et même étouffer la pitié
L’impératif catégorique d’Emmanuel Kant
Impératif catégorique = devoirs absolus = ne dépendent que d’eux même
Agir moralement c’est agir par respect de ces devoirs absolues
Impératifs hypothétiques = visent le bonheur
-conditionnels
-relatifs ils dépendent d’une autres fins que d’eux même
-particuliers dépend de chacun, de nos désirs..
Impératifs catégoriques = visent le devoir, la moral
-Inconditionnels
-Absolue ne dépendent de rien d’autre que d’eux même
-Universels
« Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par
ta volonté en une loi universelle pour l’humanité »
La maxime = Le principe que lequel te base ton action exemple le mensonge.
Est-ce que tu peux vouloir le mensonge pour tout le monde ? Non.
« Agis en considérant autrui comme une fin et jamais simplement comme un moyen »
Comme une fin = qqn qui à la possibilité de se donner à lui même ses propres fins,
un être qui aurait une liberté une capacité à se définir. Être rationnel, qui peut
être un sujet moral, donc il faut le respecte et il ne faut pas le traiter comme un
moyen. Cette personne à une dignité.
Il distingue : les choses ont un prix, les personnes ont une dignité
LIBERTÉ : On est bien plus libres lorsqu’on obéit à la loi, moral, cad qui
provient de notre raison, plutôt que lorsqu’on cède à notre passion à nos désirs,
ressentis de façon passives.
Si on agit par respect pour les impératifs catégoriques : on a agit moralement.
Respecter les devoirs absolues c’est respecter sa propre raison : c’est agir
librement indépendamment de mobiles sensibles.
L’utilitarisme (répondre à Kant) :
On a dit la vérité, on agir moralement. On peut dire la vérité et entrainer par la
même des conséquences catastrophiques : gestapo vient vous voir et vous demande si
vous cachez des résistants
Moral de kant est une morale du devoir avant tout fondée sur la raison, qui refuse
les morales d’autorité = morales dans lesquelles l’individu trouve la règle de son
action en dehors de lui-même. Par exemple dans les commandement divins, règles
sociales…
L’homme n’a qu’à faire usage de sa raison pour savoir ce qu’il doit faire, il ne
reçoit donc pas les règles morales de qqn d’autres. Chaque homme peut trouver en
lui ce qu’il doit faire, le devoir n’est donc pas relatif, il ne varie pas selon
les individu, il doit être universel. Le caractère morale d’un action dépend de la
VOLONTÉ de l’individu d’agir moralement, ce n’est pas l’action qui est moral mais
bien l’intention. Les conséquences, les effets de l’actions n’ont aucune
importance. « ce qui fait que la volonté bonne est telle, ce n'est pas son aptitude
à atteindre tel ou tel but proposé c'est seulement le vouloir ».
L’utilitarisme = conséquentialisme
Ce sont les conséquences de l’action qui font qu’elle est bonne on qu’elle est
mauvaise. Pour eux une action est bonne, à condition qu’elle soit utile, les
conséquences doivent être utiles. Utile = maximiser la quantité de plaisir pour un
maximum d’individu.
Se demander : cette action sera-telle bénéfique pour un max d’individu ? Si c’est
le cas on fait une bonne action
Agir moralement = minimiser la souffrance, maximiser le plaisir
=> Il faut faire un calcul rationnel qui nous permet d’évaluer les conséquences
prévisibles de nos actions, afin d’agir au mieux en fonction des circonstances
#Le 19 avril 2019, en France différentes associations de protection de
l'environnement ont organisé une action de désobéissance citoyenne pour demander au
gouvernement un changement de politique radical afin de lutter efficacement contre
le réchauffement climatique
Vous aimerez peut-être aussi
- Le devoir (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLe devoir (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cours Sur Les Modes Alternatifs de Règlement Des DifférendsDocument88 pagesCours Sur Les Modes Alternatifs de Règlement Des DifférendsTchuente Accord100% (1)
- La Comptabilité Générale s1 s2Document215 pagesLa Comptabilité Générale s1 s2sylvain koudadjePas encore d'évaluation
- Corrigé Des Activités Fiche 3Document9 pagesCorrigé Des Activités Fiche 3Lina Dhaoui100% (1)
- Resume SOFT SKILLS Attitudes Et Valeurs Au Travail U2Document8 pagesResume SOFT SKILLS Attitudes Et Valeurs Au Travail U2ilyas emos40% (5)
- Sequence 2, Attitudes Et Valeurs Au TravailDocument7 pagesSequence 2, Attitudes Et Valeurs Au TravailmarouanePas encore d'évaluation
- Marie Montpetit - Qui Suis-JeDocument132 pagesMarie Montpetit - Qui Suis-JemoussaouimohamedPas encore d'évaluation
- 55 Fiche Bac Sur La LibertéDocument5 pages55 Fiche Bac Sur La LibertéFagarou rekPas encore d'évaluation
- Loi Des Finances 2023-1Document48 pagesLoi Des Finances 2023-1Arinas.ik100% (4)
- Attestation D'Inscription Au Permis de Conduire: Le Candidat Est: Oui Non Le Candidat Déclare: Oui NonDocument2 pagesAttestation D'Inscription Au Permis de Conduire: Le Candidat Est: Oui Non Le Candidat Déclare: Oui NonLeprovost RomainPas encore d'évaluation
- Duetto Chitarra GangiDocument1 pageDuetto Chitarra GangiMatteo DecarolisPas encore d'évaluation
- PHILO COURS 16 Elément de Philosophie MoraleDocument4 pagesPHILO COURS 16 Elément de Philosophie Moralecheikhibrahimandiaye2022Pas encore d'évaluation
- Liberte - Devoir - MoraleDocument3 pagesLiberte - Devoir - Moralemarceau.gervais111Pas encore d'évaluation
- 7 Cours Sur Le Devoir Et Le BohneurDocument6 pages7 Cours Sur Le Devoir Et Le BohneurJonas DronetPas encore d'évaluation
- Philo Chap 2 Partie 2Document9 pagesPhilo Chap 2 Partie 2bahm82758Pas encore d'évaluation
- Notion 5 - Le DevoirDocument5 pagesNotion 5 - Le DevoirBlanca VelazquezPas encore d'évaluation
- Philo - Le DevoirDocument8 pagesPhilo - Le DevoirAmine BenPas encore d'évaluation
- Devoir Intégrité ConscienceDocument6 pagesDevoir Intégrité ConscienceFRABATO7Pas encore d'évaluation
- Chapitre 3 ConsienceDocument4 pagesChapitre 3 ConsienceElise SermonPas encore d'évaluation
- Devoir Mon CoursDocument11 pagesDevoir Mon CoursanarelkhouryPas encore d'évaluation
- Amour Et Responsabilite ResumeDocument21 pagesAmour Et Responsabilite Resumebarett3Pas encore d'évaluation
- Le Devoir - Imperatif - Kant - WDocument15 pagesLe Devoir - Imperatif - Kant - WMehdi JerjiniPas encore d'évaluation
- Ethique Et Bonheur SalomonDocument3 pagesEthique Et Bonheur Salomon6kzpk7c75xPas encore d'évaluation
- Le DevoirDocument3 pagesLe Devoirchloemanceau29Pas encore d'évaluation
- Qu'avons-Nous À Gagner À Faire Notre DevoirDocument4 pagesQu'avons-Nous À Gagner À Faire Notre DevoirjuliettePas encore d'évaluation
- 2013 2014 Synthese-Morale-DevoirDocument1 page2013 2014 Synthese-Morale-DevoirKoké Lamine TraoréPas encore d'évaluation
- Explication de Texte BR 2Document5 pagesExplication de Texte BR 2Dunand LynnaPas encore d'évaluation
- Kilian LE MEUR L3 Philo DisserteDocument3 pagesKilian LE MEUR L3 Philo DisserteSeth McKaLeMPas encore d'évaluation
- Repère ÉthiqueDocument54 pagesRepère ÉthiqueAnthony MattaPas encore d'évaluation
- Note Philo Cours 5Document2 pagesNote Philo Cours 5opheliebolduc42Pas encore d'évaluation
- Révision PhiloDocument98 pagesRévision PhiloMehdi EssoulimaniPas encore d'évaluation
- LibertéDocument10 pagesLibertézarroug zarrougPas encore d'évaluation
- Repère ÉthiqueDocument55 pagesRepère ÉthiqueAnthony MattaPas encore d'évaluation
- Bonheur: (Nature Humaine, Raison)Document39 pagesBonheur: (Nature Humaine, Raison)Lorine DmciPas encore d'évaluation
- Philo Le DevoirDocument12 pagesPhilo Le DevoirEvrardPas encore d'évaluation
- Ismontic CCS 2021 2022 Attitudes Et Valeurs Au TravailDocument49 pagesIsmontic CCS 2021 2022 Attitudes Et Valeurs Au Travailnissrinmahan02Pas encore d'évaluation
- Le Devoir Philosophie Bac S Es LDocument15 pagesLe Devoir Philosophie Bac S Es LAdnane KarmouchPas encore d'évaluation
- PHILOSOPHIEDocument13 pagesPHILOSOPHIEflorinda MAYYPas encore d'évaluation
- Fiche (Livre) - L'existentialisme Est Un Humanisme de SartreDocument2 pagesFiche (Livre) - L'existentialisme Est Un Humanisme de SartreAudrey L.Pas encore d'évaluation
- Pourquoi Obéir Aux Règles MoralesDocument5 pagesPourquoi Obéir Aux Règles MoralesMayalen EtcheverryPas encore d'évaluation
- SOS Disserte Faut-Il Aider Les FaiblesDocument7 pagesSOS Disserte Faut-Il Aider Les FaiblesTom MentecPas encore d'évaluation
- La Morale Est-Elle Une Affaire de SentimentsDocument2 pagesLa Morale Est-Elle Une Affaire de SentimentsMalak BenjellounPas encore d'évaluation
- 8 Processus de Communication Pour Éviter DDocument4 pages8 Processus de Communication Pour Éviter DDragonredmenPas encore d'évaluation
- DevoirDocument4 pagesDevoirsidikaPas encore d'évaluation
- LE DEVOIR Chapitre 10Document7 pagesLE DEVOIR Chapitre 105grg8fq6nkPas encore d'évaluation
- La MoraleDocument5 pagesLa MoraleHv13 l'enfant EsckobaPas encore d'évaluation
- Le Consommateur Et Son ComportementDocument10 pagesLe Consommateur Et Son Comportementabdelmajid en-namiPas encore d'évaluation
- Chap 5 - La Morale - PA4 - DMDocument9 pagesChap 5 - La Morale - PA4 - DMDaniel MoukouriPas encore d'évaluation
- Sensibilité, Florent GuénardDocument3 pagesSensibilité, Florent GuénardLea DubPas encore d'évaluation
- La MoraleDocument3 pagesLa MoraleSacha BollaroPas encore d'évaluation
- Conscience - InconscientDocument7 pagesConscience - Inconscientmarceau.gervais111Pas encore d'évaluation
- DéontologismeDocument26 pagesDéontologismeFady ABDELNOURPas encore d'évaluation
- La Liberté PhiloDocument2 pagesLa Liberté PhilopwakefioldPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 5 - Le DevoirDocument12 pagesCHAPITRE 5 - Le DevoirjojocokonutsPas encore d'évaluation
- Amour Et ResponsabiliteDocument20 pagesAmour Et Responsabilitebarett3Pas encore d'évaluation
- Peut-On Vouloir Le Bonheur Des AutresDocument5 pagesPeut-On Vouloir Le Bonheur Des AutresjuliettePas encore d'évaluation
- Philo SynthèseDocument13 pagesPhilo SynthèseCatie LilaPas encore d'évaluation
- Philo - Bac Fr. S.Document62 pagesPhilo - Bac Fr. S.Lounatic ZoldyckPas encore d'évaluation
- TD1 Hugo-1Document6 pagesTD1 Hugo-1sircPas encore d'évaluation
- Devoir Ethique 2 BonDocument9 pagesDevoir Ethique 2 Bondelanautakou38Pas encore d'évaluation
- 2018 Séance 3 MBER Ego, Conscience Et BonheurDocument8 pages2018 Séance 3 MBER Ego, Conscience Et BonheurLa MémothèquePas encore d'évaluation
- De L'independance À L'autonomieDocument13 pagesDe L'independance À L'autonomieSandrine BASTIDEPas encore d'évaluation
- Fiche Morale Devoir BonheurDocument6 pagesFiche Morale Devoir BonheurElisa GuerreroPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - La Liberté, Volonté Et CaractèreDocument3 pagesChapitre 3 - La Liberté, Volonté Et Caractèrehugogilberte1202Pas encore d'évaluation
- La Liberté Est-Elle Contraire À La Nature Humaine ?Document7 pagesLa Liberté Est-Elle Contraire À La Nature Humaine ?Anisse ZemmaPas encore d'évaluation
- Hume La Morale ExtraitsDocument5 pagesHume La Morale Extraitsk Francis SOMDAPas encore d'évaluation
- Vampirisme Nécrophilie Nécrosadisme Nécrophagie Épaulard Alexis Bpt6k858722nDocument112 pagesVampirisme Nécrophilie Nécrosadisme Nécrophagie Épaulard Alexis Bpt6k858722ngarminecachetPas encore d'évaluation
- Le Nom de Votre Société: Adresse Email Code Postale Ville Site Web TéléphoneDocument8 pagesLe Nom de Votre Société: Adresse Email Code Postale Ville Site Web TéléphoneGuy BEUGREPas encore d'évaluation
- Cours IR - Revenu Global ImposableDocument35 pagesCours IR - Revenu Global ImposableDriss MoumenPas encore d'évaluation
- Coach A Formulaire Dinscription Aux Sessions de Coaching 2020 2021 1Document1 pageCoach A Formulaire Dinscription Aux Sessions de Coaching 2020 2021 1Oussama Elamine TzPas encore d'évaluation
- La Mode en FranceDocument9 pagesLa Mode en FranceMadalina Andreea TeodorescuPas encore d'évaluation
- Fiche de Soucription Contrat Marchand Cabine Limite PDFDocument3 pagesFiche de Soucription Contrat Marchand Cabine Limite PDFMictaMarinaKonéPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Des Affaires en Ligne 2021 (1,2 Et 3)Document23 pagesCours de Droit Des Affaires en Ligne 2021 (1,2 Et 3)Chaki SalahPas encore d'évaluation
- b2 - Conversation - La Commercialisation Du CannabisDocument1 pageb2 - Conversation - La Commercialisation Du CannabisChristine SzaboPas encore d'évaluation
- Dios Tu Nombre Exaltaré GuitarraDocument1 pageDios Tu Nombre Exaltaré GuitarraObed SalasPas encore d'évaluation
- Rat 2023Document2 pagesRat 2023fortysevenproPas encore d'évaluation
- L'Histoire de L'apostasieDocument8 pagesL'Histoire de L'apostasieromain.zerbini94Pas encore d'évaluation
- Tous Les Établissements Publics, Soumis Au CMPDocument3 pagesTous Les Établissements Publics, Soumis Au CMPAssafiani ZainebPas encore d'évaluation
- TD 4 - Gestion Des CTDocument3 pagesTD 4 - Gestion Des CTFanny HUMBLOTPas encore d'évaluation
- وكيل معتمد لدى الجماركDocument7 pagesوكيل معتمد لدى الجماركDhiaELHakPas encore d'évaluation
- 04 DetenteDocument4 pages04 DetentennmkksnfcdPas encore d'évaluation
- Cgi 2024Document282 pagesCgi 2024Rayana NdiayePas encore d'évaluation
- Cerfa CS 1673887142247Document4 pagesCerfa CS 1673887142247Wieme KhaddarPas encore d'évaluation
- Civitas Europa - Contrôle de Constitutionnalité - CopieDocument43 pagesCivitas Europa - Contrôle de Constitutionnalité - CopieNdourPas encore d'évaluation
- CV Pour Recherche de StageDocument1 pageCV Pour Recherche de StageAnahan R R KonePas encore d'évaluation
- Alg49268 PDFDocument4 pagesAlg49268 PDFRabah KhemiletPas encore d'évaluation
- TD NormalisationDocument3 pagesTD Normalisationcesar BALOITCHAPas encore d'évaluation