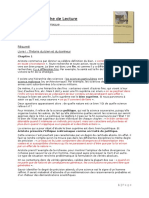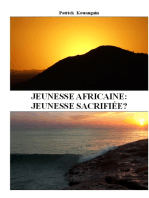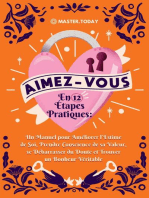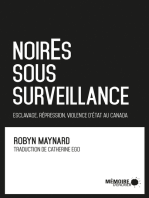Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bonheur: (Nature Humaine, Raison)
Transféré par
Lorine Dmci0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
18 vues39 pagesTitre original
Untitled
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
18 vues39 pagesBonheur: (Nature Humaine, Raison)
Transféré par
Lorine DmciDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 39
BONHEUR (NATURE HUMAINE, RAISON)
LE BONHEUR EST-IL LE SOUVERAIN BIEN ? La raison est la capacité de produire des
raisonnements, mais également celle de distinguer le Bien du Mal, et de nous diriger vers le Bien.
[BIEN(S) : ce qui a de la valeur, de l’importance, et que donc nous désirons. C'est ce qui est
approuvé par notre raison. BIEN SUPRÊME / SOUVERAIN BIEN : le bien qui a le plus de valeur,
d’importance, et auquel les autres sont rattachés. Il s'agit de la fin (le but) de toute existence
humaine.]
Selon Épicure (-342-270 av. J.-C.), dans la Lettre à Ménécée, le bonheur est le Bien
Suprême. C’est l’étude de l’homme qui doit nous amener à énoncer une morale. En effet, comment
savoir ce qui est bon pour l’homme et ce qu’il doit faire si on ne sait pas ce qu’il est ? Le corps de
l'homme et son esprit ne sont qu’un agrégat d’atomes, sujets au plaisir et à la douleur. Lorsque nous
perdons des atomes ou en avons en surplus, nous souffrons, et lorsque nous les récupérons ou les
éliminons, nous éprouvons du plaisir. Le bonheur s’obtient facilement, puisqu’il consiste en
l’absence de souffrance. Il suffit d’agir en fonction des besoins du corps, soit pour éliminer la
souffrance, soit pour l’éviter. D’où une gestion des désirs, qu’il classe en trois catégories : les désirs
naturels et nécessaires (comme boire et manger ce dont on a besoin), les désirs naturels mais non
nécessaires (comme manger du poisson plutôt que du pain sec), et les désirs non naturels non
nécessaires (comme celui de la richesse ou du pouvoir). Seuls les besoins doivent être satisfaits.
Cette théorie nous amène à comprendre que le bonheur s’acquiert grâce à la maîtrise de soi et de ses
pensées. C’est ainsi qu’Épicure nous demande de nous habituer à ne plus craindre la mort, ni les
dieux, ni la souffrance. Et nous devons considérer le bonheur comme étant accessible. C'est
l’exercice de la philosophie qui le permet.
PEUT-ON CONCILIER LE BONHEUR ET LA VERTU ? Selon Épicure, le bonheur et la
vertu sont indissociables. Il existe trois vertus : la prudence, l'honnêteté et la justice. On ne peut être
heureux sans être vertueux, et, notamment prudent. C'est le raisonnement vigilant qui nous permet
de faire les bons choix.
Aristote (-384 – 322 av. J.-C.) avait approfondi cette réflexion dans son Éthique à
Nicomaque. Le bonheur consiste, pour tout être, dans la réalisation de sa nature, c'est-à-dire dans
l'exercice de la vertu. Or la vertu propre de l'homme, qui est un être doué de raison, est l'aptitude à
la vie raisonnable. Cette vertu est une disposition acquise par l'habitude, ce qui suppose volonté et
responsabilité. Par « vertu » Aristote désigne l’excellence, c’est-à-dire un accomplissement de soi
selon le meilleur de soi (à la fois noblesse, énergie, mérite, équilibre). Dans l’excellence, devoir et
bonheur ne font qu’un. Toute action doit donc viser le bonheur. Mais le bonheur ne se réduit pas au
plaisir : il est l'association du bien, du beau et de l'agréable. Ceux qui aiment les nobles actions y
prennent plaisir. Le plaisir devient critère de la bonne action et de l'homme bon : le véritable
homme bon doit prendre plaisir à l’action bonne. À l’inverse, l’homme vicieux est chargé de
regrets. Et cela pour plusieurs raisons : il n’éprouve aucune affection à l’égard de lui-même car il
n’est pas aimable. Et sa nature dépravée le déchire car il jouit du mal fait tout en le regrettant.
Aristote considère cependant que l’on ne peut pas écarter complètement la chance de la définition
du bonheur, car certaines choses extérieures le favorisent. Il lui semble difficile d’accomplir des
bonnes actions quand on est dépourvu de ressources (amis, richesse, influence politique). Il existe
également des avantages, comme la noblesse de race, une heureuse progéniture et la beauté
physique.
LE BONHEUR EST-IL UNE AFFAIRE PRIVÉE OU PUBLIQUE ? La pensée grecque,
avec son idéal de sagesse comprise comme maîtrise de soi et de ses pensées, pourrait nous donner
l'impression que le bonheur est une affaire privée (ne concernant que l'individu).
Mais Aristote insiste bien sur la dimension collective du bonheur. La vertu n'est possible que
dans la Cité, car l'homme est naturellement fait pour vivre en communauté : c'est un « animal
politique », et la Cité est la forme la plus haute de la vie sociale, supérieure au village ou à la
famille. La Cité est comme un organisme régi par des fonctions propres auxquelles doivent
concourir les différentes parties.
Il y a donc un lien étroit entre la morale et la politique. La Déclaration d'indépendance des
États-Unis (1776) affirme : « […] parmi [l]es droits [inaliénables des hommes] se trouvent la vie, la
liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir
ces droits […] Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ces fins, le
peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement. »
Le lien entre la morale et la politique permet l'apparition, en Europe, de la doctrine
utilitariste. Il s'agit d'un courant inauguré par Jérémy Bentham (1748-1832) et qui fait de la
maximisation de l'utilité, c'est-à-dire la recherche du plus grand bonheur pour le plus grand nombre,
le but suprême. Cette doctrine compare l'utilité des individus dans la société. Il est possible de faire
du plaisir et du bonheur le but de la société, en considérant que ce qui est valable pour un individu
l’est pour tous les autres. Tous les humains recherchent le plaisir (le bonheur) et tous les humains
évitent la souffrance (le malheur). Il suffit, pour être moral, de ne pas provoquer la souffrance. John
Stuart Mill (1806-1873) reprend cette théorie dans De l’Utilitarisme, en 1861. Mill évalue les
résultats observables d’une action pour déterminer sa valeur morale, et fonde le devoir sur la
recherche du bonheur général. Il considérait que certains plaisirs étaient de meilleure qualité,
comme les plaisirs esthétiques, nécessitant des efforts et de l’éducation pour être appréciés.
L’éducation pour tous devrait permettre l’amélioration du bonheur général en ouvrant de nouvelles
voies vers l’épanouissement. Convaincu que l’accomplissement humain nécessite la liberté
individuelle, il prône la liberté de penser et d’expression dans son ouvrage De la liberté (1859), et
défend la cause des femmes (en particulier leur droit de vote) dans De l’assujettissement des
femmes. Conscient du rôle de l'économie dans la gestion politique, il développe sa théorie dans les
Principes d'économie politique (1848). Le bonheur est affaire publique et non privée. Tant que les
institutions sociales ne favoriseront pas l'accord entre les intérêts de l'individu et les exigences
collectives, le bien collectif doit l'emporter sur le bonheur personnel. Tant que les institutions
n'auront pas progressé, le sacrifice de soi sera considéré comme la plus haute vertu.
DEVOIR (RAISON, NATURE HUMAINE)
DÉFINITIONS ET PROBLÉMATIQUE. La nature humaine est double : une nature
animale (inclinations, désirs) et une nature rationnelle. Nous ne faisons pas spontanément le Bien.
La raison oblige la volonté à choisir le Bien : c'est l'idée de DEVOIR. Le devoir se distingue de la
nécessité (les lois de la nature) qui s'impose à tous et ne laisse aucune alternative : ainsi, on doit
boire pour vivre, qu'on le veuille ou non. Le devoir, au contraire, en impliquant la volonté, permet la
liberté du choix.
Comment comprendre l' émergence du devoir puisque celui-ci s'oppose à la réalisation de
tous nos désirs ? Comment formuler un devoir pour tous ? Y a-t-il une chose bonne absolument ?
LA CONCEPTION KANTIENNE. Emmanuel Kant (1724-1804) a proposé un travail
approfondi relativement au concept de devoir, dans les Fondements de la métaphysique des mœurs
(1785). C'est la raison pratique qui détermine la volonté, par le moyen de l'impératif. Il est une loi
pratique commandant la conduite, et prescrivant ce qui doit être. Le devoir n'est que l'intention et la
volonté de bien faire, exigence purement désintéressée, simplement motivée par le respect de la loi
et du caractère universel de celle-ci : avant d'agir en suivant une règle, je dois me demander si elle
est universalisable sans contradiction avec ma raison. Par exemple, je ne peux pas, sans
contradiction, me donner comme devoir de mentir. Mais je pourrai considérer que je dois mentir
pour me dégager d'une situation problématique. Dans ce cas, il s'agit d'un « impératif
hypothétique ». L'impératif hypothétique dépend d'une condition et est donc relatif, alors que
l'impératif catégorique est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il commande absolument. Chacun éprouve
l'obligation de se soumettre à la loi morale, même s'il n'en tient pas compte. Il faut distinguer
l'action conforme au devoir et celle accomplie par devoir (sans considération de l'intérêt, de la
satisfaction qu'on peut en tirer).
On peut dès lors mieux comprendre la nature humaine. En devenant une personne, l'homme
s'élève au-dessus de lui-même. Il devient un but final et membre d'un règne des fins : la personne
est une fin en soi ne pouvant pas être employée comme moyen. Elle ne doit jamais être asservie (ou
asservir une autre personne). La personne a une dignité et a donc une valeur absolue (elle ne peut
pas avoir une valeur marchande ou sentimentale). Le devoir ordonne de traiter tout être humain (y
compris moi-même) avec respect, qui est le seul sentiment rationnel. On ne peut donc pas se
sacrifier pour le bien d'autrui.
Par conséquent, l'homme souhaite le bonheur, mais ne peut pourtant pas l'atteindre. Le
Souverain Bien est l'union du bonheur, qui vise la satisfaction des penchants sensibles, et de la
vertu, qui est ce qui rend digne d'être heureux. On ne saurait fonder la morale sur la recherche du
bonheur, car il n'y a pas de loi universelle et nécessaire de ce dernier. On doit donc fonder la morale
sur une loi de la raison. Ce n'est plus la loi qui dérive du bien, mais le bien qui se règle sur la loi.
Dès lors, se soumettre à la loi de la raison c'est agir librement, dans la mesure où il s'agit d'une loi
que l'être raisonnable se donne à lui-même sans dépendre d'aucun mobile extérieur ou d'aucun
penchant sensible. La volonté est dite autonome lorsqu'elle est déterminée par la loi morale et
hétéronome lorsqu'elle est déterminée par des mobiles sensibles. C'est ce qui explique le conflit
entre la moralité et le bonheur, l'accomplissement du devoir n'étant pas forcément agréable pour un
être soumis à des inclinations sensibles. Le désir d'être heureux n'est plus le seul désir de l'homme,
ni son désir le plus profond, même si le bonheur est une aspiration légitime, et si c'est même un
devoir que d'y travailler en tant qu'il peut favoriser la moralité. On assiste à un affranchissement de
la volonté à l'égard du désir, où il s'agit d'apprendre à désirer et à vouloir autrement.
DEVOIR ET ALTRUISME. Selon Matthieu Ricard, nous avons pour devoir de
développer l'altruisme (la prise en compte des autres) par la méditation bienveillante. Cela est
possible car nous possédons des tendances morales naturelles (ce qu'illustrent les expériences avec
de très jeunes enfants qui manifestent un souci désintéressé des autres et sont amenés à comprendre
leurs besoins et à les aider). Nous sommes dotés d'une empathie (capacité cérébrale de ressentir la
souffrance lorsque l'autre souffre).
LIBERTÉ (MORALE et RAISON)
ANALYSE ET PROBLÉMATIQUE. Si le bonheur est universalisable en tant que
Bien Suprême, comment expliquer le plaisir éprouvé à faire le mal ? La liberté de choisir le Bien ou
le Mal ne remet-elle pas en cause la possibilité d'une universalité de la morale ? Y a-t-il une
positivité du mal telle qu’il puisse être désiré ? Afin que l’homme reste maître de son humanité,
supposant liberté et responsabilité, il est nécessaire de maintenir une volonté du mal au sens strict,
ce qui signifie que l’homme peut choisir librement, en toute conscience, de faire le mal. Mais est-il
pour autant nécessaire de poser une volonté absolument diabolique, l’homme devenant alors un être
inhumain, assoiffé de violence ? Sans doute pas dans la plupart des cas : il est possible de garder un
espoir en l’homme, de croire qu’il n’est pas radicalement mauvais, autrement dit, qu’il ne fait pas le
mal pour le mal. Le MAL se définit par la souffrance infligée ou ressentie. Comment se libérer de
celle-ci ?
POURQUOI CHOISIR LE MAL ? 1) Il découle de la transgression un sentiment de
puissance et de liberté. 2) La sanction apparaît comme un mal nécessaire, à condition qu’il soit
pédagogique. 3) Un mal peut donc générer un bien. Il est possible de montrer que les conséquences
du mal peuvent être bonnes, en étant le fruit d’un calcul rationnel : il faut alors bien distinguer le
mal commis par un homme réfléchi et le mal commis par l’homme passionnel, le premier étant le
fruit d’une volonté parfaitement libre et maîtrisée, le second le fruit d’une volonté asservie. Le mal
peut ainsi acquérir une positivité telle qu’il peut être rationnellement choisi, et ce aussi bien du
point de vue collectif que du point de vue individuel. Il reste cependant un mal. 4) Si la liberté
existe, nous sommes maîtres de notre existence. Le mal en serait le prix à payer. L’individu porte la
responsabilité du mal car il l’a choisi.
L'EXISTENTIALISME DE SARTRE : l'homme est condamné à être libre. Comme le
dit Sartre (1905-1980), « il y a toujours une possibilité pour le lâche de ne plus être lâche, et pour le
héros de cesser d’être un héros ». Dans L’Existentialisme est un humanisme (1945), il présente une
morale concrète, par opposition aux morales théoriques (religieuse ou laïque qui, toutes deux
affichent des valeurs comme existant a priori). La liberté est le fondement de toutes valeurs. La
valeur morale se réalise dans l'action. L'homme étant totalement libre, il est entièrement responsable
de ses actes. Dieu n'existant pas, il ne peut définir le bien ; il est délaissé et ne trouvant rien à quoi
se raccrocher, il doit prendre en main sa destinée. Ainsi, l'homme doit se construire ses propres
valeurs à tout instant, en effectuant des choix, même lorsqu'il s'abstient car l'abstention est aussi un
choix.
LA LIBERTÉ COMME FONDEMENT DE LA MORALE. C’est parce que
l’homme est capable de prévoir les conséquences de ses actes et de les assumer qu’il en est
responsable. La nature de l’homme nous permet de relier la liberté et la responsabilité. C’est ce que
fait Vladimir Jankélévitch (1903-1985) dans ''La responsabilité dans son for intime'' (Le Je-ne-sais-
quoi et le Presque rien, 1957) : “La responsabilité implique une vocation. Quelque chose
m’incombe, je ne sais quelle charge impondérable et impalpable, un inexistant fardeau que je ne
puis ni soupeser ni assigner, qui n’est ni quantifiable ni localisable […]. En effet, un homme, parce
qu’il est un homme, ne fait pas de soi ce qu’il veut (même s’il en a le « droit ») ; un homme ne peut
pas faire de son être-propre n’importe quoi ; tout comme s’il n’était pas lui-même son être lui-
même, ni tout entier son être tout entier, il n’a pas la libre et arbitraire disposition morale de cet être,
par exemple pour le vendre ou le supprimer ; par une contradiction ironique, [cet être pleinement
libre n’a pas sa liberté même à sa plénière discrétion], il n’est pas indifféremment libre de sa liberté,
ni libre à son gré, il n’est pas le maître en sa propre maison ! Tel est le paradoxe de l’obligation
morale…Disons, pour nous faire comprendre, que noblesse oblige ; la grandeur de l’homme est
lourde à porter (bien que l’être d’un être n’ait de poids que par manière de parler).”
DIGNITÉ ET SENTIMENT DE DIGNITÉ. Il faut distinguer la DIGNITÉ
ONTOLOGIQUE [tout être humain a une valeur inaliénable], de la DIGNITÉ POSTURALE
[pudeur, contenance, comportement respecteux des règles], qui peut être perdue ou retirée.
L'humanité est à conquérir : il y a quelque chose de plus haut que moi en moi. L'homme a la
capacité à se défaire de la mauvaise conduite. La dignité est une notion morale. Un homme vaut
mieux que ce qu'il a fait de mal.
LA LIBERTÉ COMME SAGESSE, RAPPORT MORAL À SOI. Il s’agit de la
position stoïcienne. Les stoïciens pensaient que l’univers était gouverné par une « âme du monde »
qui se conformait à des principes rationnels à la portée de la raison humaine. L’ordre naturel, étant
l’ordre juste des choses, ne devrait pas susciter en nous de résistance, et nous devrions sereinement
accepter ce qui nous arrive. Elle est notamment développée par Epictète (50-125), dans son
Manuel. On ne peut parvenir à la véritable liberté qu’en sachant d’abord distinguer ce qui dépend de
nous et ce qui n’en dépend pas. La liberté consiste donc à accepter la nécessité. La philosophie
stoïcienne est donc une philosophie de la renonciation, source de la liberté et du bonheur. L’objectif
est de libérer des tourments.
NATURE (humaine et origine de la morale)
La CULTURE est l'ensemble des institutions, des dispositifs techniques et des oeuvres de
l'art et de l'esprit que l'humanité a produit au cours de l'histoire en transformant la nature et en
transformant sa propre nature. Elle s'oppose à l'état de NATURE qui est la condition des êtres qui,
comme les animaux, ne se sont pas modifés eux-mêmes par des artifices, des institutions, des
règles.
Un premier problème est de savoir s'il est possible de distinguer en l'homme nature et
culture. Nous avons tendance à partir de l'homme culturel pour déterminer ce qu'il y aurait de
naturel en lui. Mais on peut aussi se demander si la culture ne contrarie pas la nature en en faisant
un homme civilisé.
Nous pouvons tenter de déterminer ce qu'est la nature humaine d'un point de vue biologique.
C'est ce que fait Charles Darwin. Dans L'Origine des espèces (1859), Darwin avance que toutes les
espèces vivantes sont parentes d'espèces plus anciennes, et peuvent être replacées sur un unique
arbre généalogique remontant à Luca (Last Unique Common Ancestor). Ensuite, le processus de
sélection naturelle (dont la sélection sexuelle) explique en grande partie l'évolution des espèces, leur
adaptation à leur milieu et leur diversification. Darwin emprunte à Malthus l'idée d'une « lutte pour
l'existence » liée à des ressources naturelles limitées par rapport à un nombre croissant d'individus.
L'apparition d'un caractère susceptible de donner un avantage à un individu ou à une espèce aura
tendance à en privilégier la survie : ils seront sélectionnés naturellement et transmettront ce
caractère à leur descendance. Les individus ou espèces désavantagés auront tendance à disparaître.
Mais l'homme semble particulier, et Darwin lui consacre un ouvrage : La Filiation de l'homme (The
Descent of Man and Selection in Relation to Sex) (1871). Il y développe deux idées importantes. 1)
La sélection sexuelle a été le moteur puissant de l'hominisation. 2) De nombreux traits humains
(morphologiques, comportementaux et cognitifs) sont produits par la sélection naturelle. Le
Chapitre V (« Sur le développement des facultés intellectuelles et morales au cours des temps
primitifs et civilisés ») applique ces vues à la morale. Pour devenir sociaux, les ancêtres simiens de
l'homme ont dû acquérir les sentiments instinctifs qui poussent à vivre réunis en groupes. Ils
devaient se sentir inquiets une fois séparés de leurs camarades, pour lesquels ils devaient ressentir
quelque degré d'amour ; ils devaient s'avertir l'un l'autre du danger, et s'apporter une aide mutuelle
dans l'attaque ou la défense. Les qualités sociales (sympathie, courage, fidélité) ont été acquises par
les ancêtres de l'homme, grâce à la sélection naturelle. Chez l'homme civilisé, la sélection naturelle
est supplantée par l'effet des principes moraux. Apparus du fait de la persistance des instincts
sociaux, ces principes résultent du sentiment de sympathie. Du point de vue de la tribu, la
sympathie favorise une meilleure coopération, une meilleure coordination. Un peuple égoïste et
querelleur ne sera pas cohérent, et sans cohérence rien ne peut être réalisé. Une tribu richement
pourvue de qualités se répandrait et serait victorieuse sur les autres tribus. Mais dans le cours du
temps, elle serait à son tour dominée par quelque autre tribu encore plus hautement douée. Ainsi les
qualités sociales et morales tendraient lentement à avancer et à se diffuser partout dans le monde. Si
les meilleurs dans la lutte pour la vie l'emportent et diffusent ensuite leurs propriétés héritables,
pourquoi reste-t-il des altruistes, puisque ceux-ci ne font qu'aider les autres à leur détriment ?
Comme les capacités de raisonnement et de prévision des membres s'amélioraient, chaque homme
apprit que s'il aidait ses pareils, il recevrait généralement de l'aide en retour. Il put acquérir
l'habitude d'aider ; et l'habitude de réaliser des actions bienveillantes renforce le sentiment de
sympathie qui donne la première impulsion aux actions bienveillantes. En outre, les habitudes
suivies durant de nombreuses générations tendent probablement à devenir héréditaires. Mais un
autre stimulant, beaucoup plus puissant, pour le développement des vertus sociales, est offert par la
louange et le blâme de nos pareils. Les membres de la tribu approuvaient la conduite qui leur
apparaissait comme étant favorable au bien général, et réprouvaient celle qui leur apparaissait
comme mauvaise. Faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent est la première pierre de
la moralité. Avec une expérience et une raison accrues, l'homme perçoit les conséquences les plus
éloignées de ses actions, et les vertus relatives à soi-même, telles que la tempérance, la chasteté, en
viennent à être hautement estimées ou même tenues pour sacrées. Notre sens moral ou conscience
devient un instrument hautement complexe, puisant son origine dans les instincts sociaux,
largement guidé par l'approbation de nos pareils, réglé par la raison, l'intérêt personnel, et dans des
temps plus tardifs par des sentiments profondément religieux, et confirmé par l'instruction et
l'habitude. D'autres paramètres sont à prendre en compte. Les habitudes nomades ont été dans tous
les cas préjudiciables. La possession de quelque propriété, une demeure fixe, et l'union de plusieurs
familles sous un chef sont les réquisits indispensables pour la civilisation. De telles habitudes
rendent indispensable la culture du sol. Et on a constaté qu' un climat frais imprime une direction à
l'industrie et aux différents arts qui est favorable. Et de conclure à une forme de spécificité de
l'homme : en lui, la sélection naturelle n'est plus le seul moteur de l'évolution. En outre, il y a un
autre problème. Naturellement, les faibles sont éliminés. Mais les hommes civilisés, au contraire,
font tout leur possible pour mettre un frein au processus de l'élimination. Ainsi les membres les plus
faibles des sociétés civilisées propagent leur nature. Cela est dû à notre instinct de sympathie que
nous ne saurions réfréner, même sous la pression d'une raison implacable. On pourrait cependant
apporter un frein à cet effet mauvais par l'abstention du mariage des faibles de corps ou d'esprit. Le
fonctionnement économique apporte un frein : l'homme accumule des biens et les lègue à ses
enfants, de sorte que les enfants des riches ont un avantage sur les pauvres dans la course au succès,
indépendamment d'une supériorité corporelle ou mentale. Au contraire, les enfants des parents qui
meurent jeunes, et chez qui vigueur et santé font régulièrement défaut, viennent à hériter plus tôt
que les autres enfants, et sont susceptibles de se marier plus tôt, et de laisser un plus grand nombre
de descendants hériter de leur constitution inférieure. Quand un pauvre devient modérément riche,
ses enfants entrent dans des métiers ou des professions dans lesquels il y a assez de lutte, de sorte
que les habiles de corps réussissent le mieux. Nul doute que la richesse, lorsqu'elle est très grande,
ne tende à transformer les hommes en d'inutiles parasites, mais leur nombre n'est jamais
considérable. Toutefois, la transmission du capital favorise, par son accumulation, la progression
des arts et permet aux peuples d'étendre leur domination (et donc remplacer) les races inférieures.
Une certaine élimination des pires dispositions est toujours en cours. Les malfaiteurs sont exécutés,
ou emprisonnés pour de longues périodes, de telle sorte qu'ils ne peuvent transmettre librement
leurs défauts. Les personnes mélancoliques et démentes sont enfermées, ou se suicident. Les
hommes violents et querelleurs parviennent souvent à une fin sanglante. Les individus remuants
qui refusent de s'assujettir à une activité régulière émigrent vers d'autres contrées. Les femmes
débauchées mettent peu d'enfants au monde, et les hommes débauchés se marient rarement. Et ils
souffrent de maladies. Les causes de progrès les plus efficaces semblent consister en une bonne
éducation durant la jeunesse, tandis que le cerveau est impresionnable, et d'un haut niveau
d'excellence, inculqué par les hommes les plus capables et les meilleurs, incorporé dans les lois, les
coutumes et les traditions de la nation, et imposé par l'opinion publique.
Un autre problème est, par conséquent, le paradoxe d'un être naturel qui rejette ce qu'il y a
de naturel en lui. Pourquoi est-il le seul être naturel à être culturel ? N'est-il pas dès lors dans la
nature de l'homme d'être civilisé ? Cette capacité à ne pas être déterminé par la nature est ce qu'on
nomme la liberté. L'homme se définit-il par cette liberté ? N'est-elle pas la cause de la créativité et
de la perfectibilité humaines ? C'est ce que montrent de nombreux philosophes.
Jean-Paul Sartre va même jusqu'à nier l'existence d'une nature humaine comprise comme
l'ensemble des caractéristiques innées que posséderait tout homme. Il n'y a pas de nature humaine
car l'homme est libre : il est ce qu'il se fait. D'où la formule : « l'existence précède l'essence ». Ce
sont les choix de chaque homme qui font ce qu'il est.
La conséquence de cette liberté est la multiplicité des choix culturels, des choix de
civilisation.
ÉTAT, JUSTICE, LIBERTÉ
ANALYSE ET PROBLÉMATIQUE. La POLITIQUE est l’ordre qui doit résoudre le
problème d’organisation de la vie commune des hommes sous des lois qui les arrachent à la
violence. Celle-ci caractérise leur état avant qu’ils ne se donnent des institutions ou lorsque celles-ci
s’effondrent à l’occasion d’une guerre civile.
Comment expliquer que la politique puisse arracher les hommes de leur condition naturelle
(animale), et leur ôter leurs instincts brutaux pour édifier une société composée d’individus au
comportement parfaitement adapté ? Comment contenir l’insociabilité ? Peut-on inculquer la justice
et le sens des valeurs humaines aux citoyens afin de préserver la paix ? L’État est l’autorité qui a
pour mission de maintenir l’ordre. Doit-il le faire à tout prix, au mépris de la liberté des citoyens ?
Peut-on concilier l’autorité et la liberté ?
LA POLITIQUE A POUR BUT D’ASSURER LA SÉCURITÉ. POUR CELA, IL EST
NÉCESSAIRE DE PRENDRE EN COMPTE LA NATURE HUMAINE. Il y a un lien entre la
théorie politique proposée par un philosophe et sa conception de la nature humaine. Car il est
nécessaire, pour que la théorie ne soit pas qu'un idéal irréalisable, qu'elle prenne en compte la nature
de ceux qui doivent être dirigés. Il y a 4 conceptions. 1) l'homme peut faire le choix libre de la
violence ou du respect, du bien ou du mal. 2) L'homme est naturellement raisonnable. Cette
hypothèse peut être liée à un système républicain ou une anarchie. 3) L'homme peut être amélioré
par la technique. Cette vision transhumaniste et/ou posthumaniste implique un système libertarien.
4) L'homme est naturellement violent. Cette hypothèse peut être reliée à un système absolutiste.
L’hypothèse de l’état de nature nous donne un point de départ pour certaines théories
politiques car elle présente la nature humaine comme violente. Les humains comprennent qu’ils ont
un intérêt vital à ne pas se nuire. D’où l’émergence du Droit. Thomas Hobbes (1588-1679) est l’un
des premiers théoriciens de l’ÉTAT DE NATURE. Il en fait un état de guerre de tous contre tous,
dans son oeuvre Le Léviathan (1651). Hobbes décrit ce qu’aurait pu être l’homme s’il n’y avait pas
eu d’ÉTAT CIVIL, régi par des lois. Les hommes n’y seraient gouvernés que par l’instinct de
conservation, le désir de ce qui serait bon pour eux. Chacun serait seul juge des moyens nécessaires
pour réaliser ses objectifs. C’est cela qui explique que les hommes entrent en conflit et le chaos qui
en découle. Cette guerre aurait pu amener à la destruction de l’homme. L’homme aurait compris que
pour survivre, il avait intérêt à convenir d’un PACTE DE NON AGRESSION. Hobbes propose
l'argument suivant pour justifier le pouvoir commun : les opinions divisées au sujet du meilleur
usage et de la meilleure application de leur force font que les individus se font obstacle et annulent
leur force par leur opposition mutuelle, ce qui a pour conséquence la guerre à propos des intérêts
privés. Avec un pouvoir commun, les hommes sont unanimes dans l'observation de la justice et des
autres lois de nature. Ils confient tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme ou à une
seule assemblée. Toutes les volontés sont réduites en une seule volonté : celle de la majorité. Il y a
une unité réelle réalisée par une convention de chacun avec chacun : "J'autorise cet homme ou cette
assemblée, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui
abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière." La multitude unie
forme une République (civitas) et génère le Léviathan (dieu mortel) auquel nous devons notre paix
et notre protection). L'effroi modèle la volonté de tous en vue de la paix. Le Souverain en est le
dépositaire. Il possède le pouvoir souverain et donc absolu. Tout autre homme est un sujet.
LE DROIT ET LE DEVOIR. La politique doit rendre la concorde possible malgré les
désaccords inévitables (dus aux intérêts privés) et assurer l’ordre public. Ce dernier, instauré par le
moyen du Droit, a pour mission de tenir en échec les forces de chaos social. Le DROIT est
l’ensemble des lois régissant le groupe humain. La LOI est une règle imposée à tous qui délimite les
possibilités du comportement humain (interdictions et autorisations). L'existence du droit implique
l'apparition du DEVOIR comme obligation de respect des lois.
Il faut prendre en compte la nature humaine. De là se construit le concept de DROIT DE
NATURE. Il faut prendre en compte également les aspirations humaines, d’où le concept de DROIT
NATUREL. Il prend en compte les aspirations communes à tous les hommes : la vie (la sécurité),
la liberté, le bonheur… Selon Hobbes, la sécurité est un droit naturel. Selon Rousseau, la sécurité et
la liberté sont des droits naturels. Et selon Mill, la sécurité, la liberté et le bonheur sont des droits
naturels. Et pour finir, il faut prendre en compte la possibilité d’efficacité du droit, d’où l’idée de
DROIT POSITIF.
Le DROIT POSITIF est l’ensemble des lois positives en ce sens qu’il détermine
objectivement le comportement de chaque individu : celui-ci a le droit de faire tout ce qui lui est
permis par la loi, de réclamer ce qui lui revient en vertu de la loi [racine latine : positum : posé]. Le
droit positif est le droit institué (décidé, instauté, imposé). Le droit apporte à la société la concorde
en imposant un comportement à chacun afin de ne pas nuire à autrui. En cela, il est le fondement de
toute société. La légalité est dès lors la conformité aux lois. Elles sont le refus de la violence dans
les relations humaines. Par le droit positif, émerge la liberté civile. [LIBERTÉ CIVILE : je peux
faire tout ce que je veux, à condition de respecter la loi. Elle s'oppose à la liberté naturelle.
LIBERTÉ NATURELLE : possibilité de l'animal de faire tout ce qu'il veut, dans la limite de ses
forces. Cette liberté est celle de l'état de nature, où les hommes vivent comme des animaux. Elle est
liée au droit de nature. DROIT DE NATURE : loi du plus fort].
DROIT ET JUSTICE. Le droit positif engendre une obligation, un devoir liés à l’utilisation
de la force : la sanction. Si l’on ne respecte pas la loi, on est passible de sanction. Comment
expliquer qu’une société qui interdit aux hommes de se nuire mutuellement ait recours au mal
[SANCTION : souffrance infligée à celui qui est dans l’illégalité] ? Il y a trois niveaux dans le
comportement humain.1) L'homme se comporte mal : il ne respecte pas les lois. 2) Il obéit mais
parce qu’il a peur de la sanction (d’où la possibilité du principe du ''pas vu, pas pris''. 3) Il obéit
parce qu’il sait qu’il est nécessaire, parce que bon pour la communauté, d’obéir. L’idéal est que les
hommes atteignent tous ce troisième niveau. À l’éducation civique, il faut donc rajouter l’éducation
morale et intellectuelle.
Il en résulte une triple définition de la justice : les lois / les institutions chargées de faire
respecter les lois et de sanctionner : elles assurent un traitement équitable des citoyens / la Justice
morale, c’est-à-dire le Bien. Les deux premiers niveaux sont politiques, alors que le troisième est
moral.
Il faut par conséquent procéder à la distinction entre la LÉGALITÉ (ce qui est conforme aux
lois) et la LÉGITIMITÉ (ce qui est conforme aux exigences de justice). Dans le Savant et le
Politique, Max Weber forge le concept politique de violence légitime. Weber définit en effet l’État
comme l’institution détenant le monopole de l’usage légitime de la force physique [...]. Le terme
important de cette définition est ''légitime''. Car si des personnes ou des groupes peuvent faire usage
de la violence, elle n’est en aucun cas légitime. Seul l’État est habilité à utiliser la violence sans
qu’on puisse lui en dénier la légitimité. Cela fait partie de ses prérogatives légales. Même quand
l’État autorise les individus à user de la violence (cas de la légitime défense), les individus tiennent
cette légitimité de l’État, sous forme de délégation.
Il en découle deux visions du rapport entre politique et morale. Tout d'abord celle de
Machiavel, présentée dans Le prince (1532). Il considère que la politique ne doit pas être assujettie
à la morale de façon à gagner en efficacité. D'où la célèbre maxime selon laquelle la fin justifie les
moyens. Cela s'oppose à la moralisation de la vie politique prônée par Platon dans Criton, et La
République . La politique doit être assujettie à la morale. Il développe l'idée de ''philosophe-roi''.
Seul le philosophe peut gouverner la Cité, car il a la connaissance du Bien et du Vrai et peut amener
les citoyens à se diriger vers ces objectifs.
LE BUT DE LA POLITIQUE EST D’ASSURER UNE BONNE DIRECTION DE LA
COMMUNAUTÉ. LE RÔLE DE L' ÉTAT. Si les hommes ont des intérêts particuliers, comment
peuvent-ils accéder au sentiment de communauté autrement que par la contrainte ? En assurant une
bonne direction commune. Une société se constitue lorsqu’une communauté se dote d’une structure
hiérarchique, avec notamment l’apparition de l’ÉTAT, structure chargée de diriger la société, c’est-
à-dire l’ensemble des hommes. Le mot ''diriger'' a deux significations : l’État détient l’autorité /
l’État donne la direction à suivre pour la société. Lorsque les hommes font le choix de vivre
ensemble, ils constituent une SOCIÉTÉ. Lorsqu’ils conçoivent un but commun, indépendamment
des intérêts personnels, ils constituent une COMMUNAUTÉ. La difficulté de la politique est de
créer le sentiment communautaire et de faire comprendre que l’intérêt de la communauté passe
avant celui de l’individu. D’où la nécessité d’une structure détenant l’autorité : elle fixe le chemin
commun à parcourir, et remet dans le droit chemin les individus qui s’en écarten en ayant recours à
la force. Lorsque la communauté se soumet à l'autorité de l'État, elle se constitue comme PEUPLE,
ou ensemble de SUJETS / CITOYENS.
LA RÉPARTITION DU POUVOIR. Dans la mesure où l’État a recours à la force,
notamment dans le cadre de la sanction, il peut être considéré comme une structure de domination
et d’oppression. Car il détient le pouvoir. La violence de l’État n’est légitime (justifiée et
acceptable) que si l’État, dans l’emploi de cette violence, se conforme strictement aux lois qui la
règlent et se soumet ainsi lui-même aux lois, tout comme les citoyens. L’histoire a proposé des
solutions diverses. Les premières ont favorisé l’autorité absolue. C’était vital. Mais en Europe, sous
l’influence des thèses philosophiques, le principe de liberté a progressivement déstabilisé les
fondements traditionnels de l’autorité (l’Église et l’État monarchique). Rousseau, dans Du Contrat
social, en pensant la souveraineté républicaine, voit la concorde comme l’instrument de la liberté
des hommes. Un homme ne doit pas renoncer à sa liberté (droit naturel). D’où l’idée de CONTRAT
SOCIAL. Il s’agit d’un pacte que tous les individus font de façon à assurer la sécurité, l’égalité et la
liberté : ''Je m'engage à ne pas te nuire et en échange tu t'engages à ne pas me nuire''. Seule la vie en
société rend possible une vie vraiment libre, mais à certaines conditions. Les citoyens doivent se
soumettre aux lois qu'ils se sont prescrites. Quand les citoyens votent les lois, ils constituent le
Souverain. Lorqu'ils obéissent aux lois, ils sont sujets. Il n'y a pas de délégation du pouvoir. Les
citoyens se gouvernent directement. Pour ce faire, il est nécessaire que les lois soient votées à
l'unanimité. Les citoyens devront prendre en considération l'intérêt général et laisser de côté l'intérêt
privé. Ils doivent prévoir des sanctions en cas de désobéissance. Il peut y avoir des peines
d'emprisonnement de mort, d'exil et de mort. Les sanctions, et la peine de mort en particulier, ne
peuvent être légitimes qu'à condition d'être votées à l'unanimité. Ce qui revient à reformuler le
contrat social ainsi : ''je m'engage à ne pas te nuire et si je ne respecte pas cet engagement, j'accepte
d'être condamné à mort ; et en échange tu t'engages à ne pas me nuire et si tu ne respectes pas cet
engagement, tu acceptes d'être condamné à mort''. Ce qui légitime le pouvoir, c'est la possibilité de
concilier la liberté et l'obéissance aux lois grâce au principe d'autonomie (obéir aux lois qu'on se
prescrit).
TRAVAIL (TECHNIQUE, NATURE)
ANALYSE ET PROBLÉMATIQUE. L'homme, en tant qu'animal, est un être naturel, et est
donc soumis aux lois naturelles. Il n'est pas en mesure de les changer. Or il rejette certaines lois
naturelles comme, par exemple, le vieillissement, la mort, la souffrance, la maladie, la survie du
plus apte et l'élimination du plus faible... Il souffre du manque de liberté, puisqu'il est soumis à la
nature et se pense dans un rapport de force avec elle. Pourtant il semble être capable de
s'émanciper : il serait un animal différent des autres car capable de limiter le rapport de force avec la
nature en sa faveur, en utilisant le travail et la technique. Le mot tekhné désignait, dans l'Antiquité
grecque, l'ensemble des pratiques utilitaires et des beaux-arts (travail, technique et art), toutes les
activités par lesquelles les hommes produisent quelque chose que la nature ne leur fournit pas
spontanément. Le mot "travail" a progressivement réduit son champ aux productions nécessaires à
la vie sociale.
Par conséquent, est-il le symptôme de la soumission de l'homme, trop faible par rapport à
une nature hostile ? Comment expliquer que l'homme, déjà soumis au déterminisme naturel, se
soumette à cette activité contraignante qu'est le travail ? Préfère-t-il se soumettre au déterminisme
culturel, choisi, voulu, plutôt qu'au déterminisme naturel ? Le travail et la technique, en tant
qu'ensemble de moyens visant l'utilité, la facilité et l'efficacité, n'ont-ils pas été inventés pour
pallier la faiblesse naturelle de l'homme et la nécessité naturelle ? Le travail et la technique nous
libèrent-ils de la nécessité naturelle ?
LE TRAVAIL ET LA TECHNIQUE NOUS LIBÈRENT DE LA NÉCESSITÉ
NATURELLE. La nature se présente comme un milieu hostile auquel nous devons arracher, par la
médiation du travail, ce qui nous est utile et ce que nous désirons.
Michel Foucault (1926-1984), dans Les Mots et les choses (1966), montre que le travail est
cette activité par laquelle l’homme maîtrise la nature pour mettre à distance le risque de mort. Mais
l’homme s’use, perd sa vie à échapper à la mort.
Mais cette contrainte permet de pallier sa faiblesse naturelle car le travail est une
transformation réfléchie de la nature. C'est ce que montre Karl Marx (1818-1883), dans Le Capital
(1867). L'homme utilise la force musculaire et la possibilité du mouvement. La nature devient alors
un ensemble de matières premières à partir desquelles l'homme peut agir. L'homme part d'une forme
(celle de la matière à l'état naturel) et agit de façon à donner une autre forme : le travail se définit
comme acte de transformation. L'effort physique développe la puissance musculaire ; et l'utilisation
efficace et régulière du corps développe l'habileté, la dextérité et améliore l'acuité sensorielle. Il
devient plus performant, il se modifie dans un sens positif puisqu'il s'améliore, il progresse. Le
travailleur a conscience de sa possibilité de transformation de la nature. Par là, il prend conscience
de sa puissance et se construit comme être libre. L’homme serait donc le seul animal à pouvoir
s’émanciper de la nécessité naturelle.
Afin de diminuer, et même éliminer l'effort qu'est le travail, l'homme a développé la
technique. Par la technique et le travail, l'animal s'humanise et crée la culture. L’homme transforme
le monde naturel en un monde humain, artificiel, où l’on constate la marque de son intelligence, ses
désirs, sa volonté, sa liberté. À l’origine, l’homme était l’animal le plus fragile. Son intelligence lui
a permis d’évoluer de façon à limiter la nécessité naturelle.
L'HOMME S'ENFERME DANS LA LOGIQUE DU TRAVAIL ET DE LA
TECHNIQUE. Le travail et la technique permettent à l'homme de s'émanciper du déterminisme
naturel, mais il s'enferme dans la logique du travail et de la technique, et crée un déterminisme
social s'ajoutant au déterminisme naturel. L'homme s'est libéré de l'emprise de la nature pour se
rendre prisonnier du monde du travail. Le développement technique accentue cet enfermement.
Du fait de la division sociale du travail (chacun effectue une tâche spécialisée et doit donc
entretenir des relations d’échange avec les autres membres de la société pour satisfaire ses différents
besoins), l’individu acquiert une dimension collective. Le travail nécessite la coopération entre les
hommes. Ils prennent conscience de leur interdépendance et devraient dépasser l'égoïsme. D’où le
rôle social du travail et de la technique, qui ont donc une valeur morale puisqu’ils poussent
l’individu à prendre en considération autrui. Pourtant, la réalité paraît démentir ce schéma
théorique. Il semble que les conditions concrètes du travail conduisent à l’aliénation de l’ouvrier et
non à la réalisation de soi. C'est à cette prise de conscience que nous pousse Karl Marx, dans les
Manuscrits de 1844 (Économie et philosophie). Le centre de l’aliénation consiste en ce que le
produit du travail échappe au travailleur et contribue à l’appauvrir, économiquement et
humainement. Il y a une dépossession du travail dans le fait qu'il est extérieur à l’ouvrier. La
technique accentue cela car elle est au service de la productivité économique.
Le système économique instaure un rapport de forces, qui était déjà pressenti par Hegel
(1770-1831), dans sa Phénoménologie de l'esprit (1807) : il l'illustre avec la dialectique du maître et
de l'esclave, consistant en trois étapes (l'esclave se soumet au maître et travaille pour lui / l'esclave,
qui n'a plus peur de mourir, se révolte, et provoque une lutte à mort avec le maître / le maître se
soumet car il a peur de mourir et devient l'esclave de l'esclave).
Ce rapport de forces se retrouve à un niveau plus élevé, entre l'individu et la société. C'est ce
que montre Friedrich Nietzsche (1844-1900), dans Aurore (1881) : le dur labeur du matin au soir
mobilise les facultés du travailleur et dompte les individus. Comment comprendre la glorification
moderne du travail ? L’apologie du travail témoigne de la peur devant ce qui est unique et singulier.
Car le labeur est une police qui discipline, servant à contenir l’homme, à dompter ses forces vives.
Il arrache à la réflexion et à la pensée. Cela permet d’assurer la sécurité de la société. Les slogans
insensés à la mode, tels que ''dignité de l'homme'' et ''dignité du travail'', mystifient la réalité et
entravent le mouvement du char de la culture. Quel sens y a-t-il à parler de ''dignité'' à propos du
travail exténuant auquel est condamnée la masse, et quel sens y a-t-il à parler de ''dignité de
l'homme'' à propos de tous les millions d'hommes, dont la condition se caractérise par une misère
terrible et par la nécessité de trouver un travail, aussi exténuant qu'il soit, de façon à pouvoir
survivre ? En dépit de ses phrases grandiloquentes, le monde moderne se comporte de façon tout à
fait esclavagiste. Dans sa tentative d'échapper à la mort causée par la famine et de continuer à tout
prix à végéter, la majorité des hommes accepte de subir un travail et des conditions qui sont
serviles. Les classes dominantes pourraient reculer d'horreur à la vue de l'énorme part de douleur, de
la ''cruauté que révèle l'essence de toute culture''. Si tel était le cas, ''le cri de la pitié'' et ''le désir de
justice et d'une égale répartition de la douleur'' feraient ''s'écrouler le mur de la culture''.
Il faut distinguer ce travail servile de l’authentique travail qui manifeste notre pouvoir de
création. Dans Le Gai savoir (1882), si le dur labeur motivé par le gain mutile les facultés
humaines, au contraire, le travail du penseur ou du contemplatif est plaisir et joie. Le travail est
aujourd’hui subordonné au profit (en cela il est une torture), alors que pour certains, il est
inséparable de la joie. Ainsi artistes et contemplatifs lient travail et plaisir. Pour eux, l’ennui est le
prélude nécessaire à la joie : ''Pour le penseur et l’esprit inventif, l’ennui est ce ''calme plat'' de
l’âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux''.
Son désir de puissance pousse l'homme aux excès aussi bien dans la sphère du travail que
celle de la technique. On accuse les machines remplaçant le travail humain, par exemple, de
provoquer le chômage. L'homme est lui-même considéré comme un moyen de production, il
devient un instrument au service de la production. Martin Heidegger (1889-1976), nous mettait en
garde contre l'instrumentalisation de l'homme dans La Question de la technique (1953). Nous en
sommes venus à ne plus penser les choses qu’en termes techniques, y compris l’homme. Il est
devenu un objet manipulable ou une ressource à exploiter de la manière la plus productive possible.
Selon Hannah Arendt (1907-1975), dans la Condition de l’homme moderne (1958), il est
important de séparer la logique de la technique de celle du travail. En tant qu’animal laborans,
l’homme est soumis aux cycles vitaux du travail par lesquels il doit sans cesse entretenir et
renouveler sa vie. En tant qu’homo faber, il fabrique des œuvres techniques qui construisent un
monde stable et durable. La logique du travail (biologique : ce qui est produit doit être consommé
immédiatement) diffère de la logique de la technique (durabilité, monde stable, objectivité du
monde). Elle critique la modernité qui brouille cette distinction. L’assujettissement de la technique à
la logique du travail conduit à la perte du monde. La technique renverse le rapport de l’homme à la
machine. Le corps humain se plie aux rythmes de la machine.
TECHNIQUE (NATURE, LIBERTÉ, SCIENCE)
ANALYSE et PROBLÉMATIQUE. La technique est : 1) tout type de savoir-faire permettant
de remplir une activité ou de fabriquer un objet avec efficacité et de la manière appropriée et 2) un
ensemble de règles ou une méthode produisant un certain résultat ayant pour but l’utilité.
L’efficacité et l’utilité permettent le progrès technique et l’amélioration de la condition
humaine. Pourtant l’homme est craintif vis-à-vis de la technique : il lui reproche sa dépendance (il
pense ne plus pouvoir désormais s’en passer et s’en sent prisonnier) et ses excès (elle provoquerait
certains désastres naturels et moraux). Comment expliquer qu’il puisse craindre ce dont il est
l’inventeur ? Comment l’homme ne pourrait-il pas tirer profit de l’exploitation de la nature par les
moyens techniques ? Le monde de la technique est marqué par deux images contradictoires : une
image de conquête, qui présente l’homme en train de relever des défis que lui pose la nature ; une
image de soumission ensuite, qui présente l’homme dominé par ses propres instruments de
domination, obligé d’obéir à des systèmes techniciens qui finissent par apparaître comme une
nouvelle fatalité.
L’HOMME A UN RAPPORT DE MÉFIANCE À LA TECHNIQUE. Il voit en elle une
puissance dangereuse. Il craint d’être totalement dépassé par son invention. Or, elle est la
manifestation du pouvoir de l’homme. Il la gère et la maîtrise. La méfiance est donc injustifiée si
l’on accorde à la technique une autonomie, et les craintes qui y sont liées sont du domaine du
fantasme, où l’imagination conçoit et anticipe un scénario « catastrophe ». L’intelligence artificielle
(et les robots) provoque en particulier de telles angoisses, car on suppose que de telles créations
pourraient détenir une telle autonomie. On présuppose l’émergence de capacités mentales, dont la
conscience et l’émotion, et, en outre, l’animosité des robots à l’égard des hommes, ainsi que leur
désir de dominer le monde. L’homme projette sur ses inventions sa propre nature. Par définition, les
machines sont indépendantes des actions et de l’énergie humaines, mais elles restent confinées à des
projets précis, définis par les ingénieurs. Quant aux robots, ils disposent de programmes
informatiques, ainsi que de « sens artificiels » (l’équivalent d’un voir ou d’un toucher), ils peuvent
s’adapter à des déplacements, à des pièces, à des tâches différentes, mais demeurent dépendants des
programmateurs. Il ne faut pas confondre un automate (autonomie mécanique) et un robot qui serait
autonome au sens philosophique, donc doté d’une pensée, d’une conscience, d’une volonté propres
et capable de prendre des décisions qui lui sont également propres (autonomie de mouvement et
autonomie de pensée).
Jacques Goimard, dans Critique de la science-fiction (2002), dénonce cette crainte
irrationnelle du robot et de la machine.
Si en apparence l’homme craint le développement des sciences et des techniques car elles
permettraient des inventions ayant la possibilité de nous dépasser, en réalité, il craint les
débordements liés à l’utilisation de la technique, et les conséquences néfastes d’une telle utilisation.
Or le rapport réel est un rapport d’inventeur à invention, de sujet ayant un but à moyen. Car la
technique n’est qu’un moyen d’atteindre un but préalablement conçu par l’homme, et ce, à partir
des connaissances dont il dispose en sciences et techniques (d'où la définition de la technique
comme savoir-faire). La technique est issue du rapport entre l’homme et la nature. Il analyse ses
difficultés environnementales, conçoit des solutions à ses difficultés, et met en pratique ces
solutions : savoir-faire, méthode, objet, outil, machine, robot.
LA TECHNIQUE MODERNE EST DEVENUE UN MODE DE PENSÉE. Nos réussites
techniques successives nous ont transformés intellectuellement, car dorénavant, la technique est
devenue un mode de pensée. C'est ce que montre Martin Heidegger (1889-1976) dans La Question
de la technique (1953) : « Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par
laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être extraite et
accumulée. » La technique, dans son sens moderne, agresse et exploite la nature, réduite à une
source d'énergie. On ne voit plus dans la terre et le sol qu'une mine de charbon ou de minerai. On ne
suit plus le rythme de la nature. Concevoir la technique comme quelque chose de neutre, c’est la
concevoir comme un instrument ni bon ni mauvais, et tout dépend de la façon dont on l’utilise.
Mais la technique moderne n’est plus un instrument. Elle est devenue un but. Quand il ne saura plus
que calculer et prévoir, tout penser en termes de rentes et de capitaux, l’homme ne sera pas
seulement incapable d’apprécier la beauté gratuite d’une œuvre d’art : il sera incapable de
comprendre qu’il n’est pas un objet, parce que la différence entre lui et les objets aura été peu à peu
gommée. Nous en sommes venus à ne plus penser les choses qu’en termes techniques, afin de
dominer la nature et l’asservir aux besoins de l’homme. Le danger est que la technique devienne
l’unique mode de pensée, càd la seule façon que nous ayons de penser quelque chose. Car alors, il
nous faudra craindre que l’homme se pense lui-même en termes techniques. Or cela a déjà lieu. La
technique n’est plus un projet dont l’homme serait encore le maître : elle est bien plutôt la façon
dont l’homme moderne se comprend lui-même et comprend la nature, en sorte que l’homme lui-
même est mis au service de la technique et non l’inverse.
[La technique comme mode de penser, un exemple : les transhumanistes et post-humanistes
de la Silicon Valley]
Hannah Arendt (1907-1975), dans la Condition de l’homme moderne (1958) complète le
point de vue de son maître Heidegger. La technique ne se contente plus d’imiter ou de prolonger les
phénomènes naturels, mais elle en vient à créer des phénomènes qui n’existent pas sur terre, mais
seulement dans l’univers, comme les explosions thermonucléaires. Laissé à sa logique propre, le
monde technique, artificiel, semble imiter de plus en plus le fonctionnement aveugle des
mécanismes naturels. L’utilité devient le maître-mot. Tout se dégrade en moyens.
L’instrumentalisation du monde s’accompagne d’une « dévaluation sans limite de tout », « d’un
processus de non-sens croissant ».
DANS SON RAPPORT À LA TECHNIQUE, L'HOMME FAIT L’EXPÉRIENCE DE LA
LIBERTÉ ET DE LA RESPONSABILITÉ. LA TECHNIQUE PERMET DE SE LIBÉRER DU
DÉTERMINISME NATUREL. Grâce au progrès technique, l’homme se libère progressivement du
déterminisme naturel (ou nécessité naturelle). [DÉTERMINISME NATUREL : ensemble des lois
de la nature déterminant les phénomènes]. Par sa pensée, l'homme refuse le déterminisme, par ses
possibilités d’action, il concrétise ce refus. L'homme peut donc lutter contre la nécessité naturelle, et
ce, en exploitant la connaissance scientifique des lois de la nature qu'il développe depuis des siècles.
Il acquiert ainsi davantage de libertés.
Descartes (1596-1650), dans le Discours de la méthode (1637), développe le programme de
maîtrise technique du monde. L'homme doit se « rendre comme maître et possesseur de la nature ».
Nous ne pouvons pas transformer les lois de la nature. Mais en les connaissant et en nous y pliant,
nous pouvons agir sur la nature. La connaissance de la physique, de la mécanique des forces et des
mathématiques permet à l’homme de se livrer à l’application technique, et notamment à la
fabrication de machines. La connaissance du vivant permet, elle, de développer cette technique
qu'est la médecine, afin de lutter contre la maladie et repousser la mort.
L’homme peut aussi profiter des opportunités naturelles, car il peut y puiser son inspiration
(comme la toile d’araignée donnant l’idée du tissage, ou la structure d’un insecte donnant l’idée de
protections corporelles), ou exploiter certains phénomènes, comme le feu. Il est le seul animal à
avoir réussi à vaincre sa terreur du feu pour tenter de le maîtriser et d'en faire un outil. Le feu
illustre l'idée que la technique permet de pallier la faiblesse naturelle de l’homme.
C'est ce qu'illustre Platon (427-347 av. J.C.), dans le Protagoras, avec le mythe d’Épiméthée
et Prométhée : « Alors Prométhée, ne sachant qu’imaginer pour donner à l’homme le moyen de se
conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts [au sens de techniques] avec le feu
; car, sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile ; et il en fait présent à
l’homme. » Cela aurait permis le développement de cette technique indispensable à notre survie
qu'est la politique, conçue comme technique de gestion du groupe en fonction de buts communs.
La technique prouve le pouvoir de l’intelligence à concevoir un modelage de la matière, et la
puissance du corps à le réaliser. C’est ce que montre Aristote (384-322 av. J.-C.) dans Les parties
des animaux : la main est un outil, elle en est même plusieurs. L’homme est l’être capable
d’acquérir le plus de techniques. Il n’est donc pas le moins bien doté des animaux. Ceux-ci n’ont
qu’un seul moyen de défense et il ne peuvent pas le changer pour un autre, contrairement à
l’homme. Aristote définit la technique comme « une disposition à produire accompagnée d’une
règle vraie » : il faut suivre des règles pour produire un objet.
Aussi Bergson (1859-1941), nous propose-t-il, dans L’Evolution créatrice (1907) une
nouvelle définition de l’homme : non pas Homo sapiens [être humain intelligent], mais Homo faber
[être humain fabriquant]. “En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la
démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire
des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication.”
Par la technique, l'homme prend conscience de son propre pouvoir et de sa puissance. Il
expérimente la liberté. Les obstacles peuvent être surmontés, les désirs - même les plus fous -
peuvent être assouvis. Prenons par exemple Félix Baumgartner, et son Space Jump World Record
2012. Cet exemple illustre bien la capacité qu'a l'homme de dépasser des limites physiques,
intellectuelles et techniques. Mais aussi morales et légales : est-ce bien raisonnable de prendre de
tels risques ? Prendre le risque de la mort, c'est tenter d'acquérir plus de libertés.
UN ENJEU MORAL. Ce ne sont pas les inventions techniques qui sont à craindre, mais ce
que l’homme en fait. L’enjeu de ce thème est donc la morale. Le bien et le mal ne sont pas à
chercher dans la technique, mais dans l’homme. La nouveauté des technologies contemporaines
implique de repenser le domaine de la morale. D’où ce qu’on nomme le « principe de précaution » :
s’il y a le moindre doute sur la possibilité de perte de maîtrise (notamment au niveau des
conséquences), il faut s’abstenir. La bio-éthique a été élaborée afin de prendre en compte les enjeux
moraux des nouvelles techiques : elle est l'ensemble des réflexions morales, et par extension
politiques (car il est parfois nécessaire de légiférer). Elle se fonde sur Kant (1724-1804),
Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) et son deuxième impératif catégorique, qui exige
que nous traitions autrui toujours comme une fin, et jamais comme un moyen. En tant qu’êtres
rationnels, nous savons quelles causes peuvent provoquer quelles conséquences. Nous avons donc
la responsabilité de nos actes. Nous devons donc être prudents. L’homme doit résister à la séduction
du pouvoir technique, permettant de sauter le fossé entre l’imagination et la réalisation. La raison,
en tant que capacité de distinguer le bien du mal et de nous diriger vers le bien, nous pousse à lier la
technique à l’idée de progrès. Les innovations ouvrent la porte à de nouvelles possibilités d’action.
Mais toutes ne sont pas acceptables. On ne doit pas réaliser toutes les inventions que l’on est
techniquement capable de produire.
LE DEVOIR (MORAL) ENVERS LES GÉNÉRATIONS FUTURES. Il en découle, selon
Hans Jonas (1903-1993), dans Le Principe responsabilité (1979), une responsabilité et prudence
accrues : “Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais
encore connues et l’économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves
librement consenties, empêche le pouvoir de l’homme de devenir une malédiction pour lui. […] La
promesse de la technique moderne s’est inversée en menace.” Il nous propose un impératif moral
guidant nos actions : « Un impératif adapté au nouveau type de l’agir humain et qui s’adresse au
nouveau type de sujets de l’agir s’énoncerait à peu près ainsi : « Agis de façon que les effets de ton
action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre. » Nos
actions peuvent avoir de grandes conséquences sur la qualité de vie des hommes, et même sur la
survie de l'humanité. Les pousser à survivre dans des conditions difficiles est immoral, tout comme
le fait de rendre la Terre inhabitable, car trop polluée.
ART (TECHNIQUE, LIBERTÉ)
ANALYSE et PROBLÉMATIQUE. L'art désigne 1) la création artistique, la recherche du
beau, 2) la technique, le savoir-faire et 3) l'action de l’artisan produisant une œuvre grâce à sa
maîtrise technique, ou celle de l’artiste dont le talent, voire le génie permettent la création de la
beauté.
Peut-on considérer qu’il y a art s’il n’y a pas de beauté ? Le fait que l’activité artistique ait
été assujettie aux canons esthétiques n’illustre-t-il pas le lien entre l’art et la beauté ? Mais cela n’a-
t-il pas enfermé l’art dans ces canons esthétiques, déterminant un idéal qui devient un modèle pour
tout artiste ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre de la créativité artistique, et donc de la liberté ?
LES CANONS ESTHÉTIQUES ET LA MAÎTRISE TECHNIQUE. L’art a été assujetti aux
canons de la beauté jusqu’au 19è siècle, c’est-à-dire soumis à des règles de maîtrise technique,
visant à faire émerger la beauté. Le canon est une règle de mesure servant de référence à l'artiste
désirant produire une oeuvre belle. Il y a une différence entre une représentation réaliste d'un objet
ou d'un corps et sa représentation idéalisée, visant une beauté absolue parfaite. Le point commun à
tous ces canons est le recours aux mathématiques. Il y a une beauté objective.
Le respect du canon est donc le moyen d'évaluer l'oeuvre et l'artiste : une oeuvre respectant
le canon est artistique et l'homme qui l'a produite est un artiste. Le talent est alors assimilé à la
maîtrise technique respectueuse du canon en vigueur. Quant au génie, il est une maîtrise technique
hors du commun, exceptionnelle, mais également la capacité de faire évoluer le canon. Lorsque
l'oeuvre est techniquement exceptionnelle, on dit alors qu'elle est un chef-d'oeuvre. Elle doit alors
servir de modèle à imiter par les disciples. L'artiste génial, ou « Génie » doit devenir un maître qui
enseigne. Par exemple, Léonard de Vinci (1452-1519) a peint La Joconde (1503-1507 ; 53x79 cm).
Cette oeuvre est considérée comme la plus exceptionnelle pour la période Renaissance, notamment
grâce à son sfumato.
L'IMITATION ET LA BELLE REPRÉSENTATION. C'est parce que l'artiste est fasciné par
les beautés naturelles qu'il a le désir de les imiter. Il souhaite également les fixer temporellement, et
lutter ainsi contre l'effet destructeur du temps. L'artiste est en mesure de reproduire le réel, d'en
proposer une illusion. Comme, par exemple, Zeuxis, qui avait peint des raisins si réalistes qu'un
oiseau aurait tenté de picorer les grains.
C'est le thème de l'illusion qui pousse Platon (427-347 av. J.-C.) à critiquer l'art dans la
République. L'artiste produit une copie de la réalité : à quoi bon ? En outre, le talent de l'artiste
amène les spectateurs à préférer l'illusion à la réalité, ce qui est un scandale philosophique. Les
citoyens doivent en effet rechercher le Vrai et le Bien. L'art doit donc être interdit. C'est une
position exceptionnelle dans l'histoire de la philosophie.
Nous pourrions nous questionner sur ce qui pousse les hommes à imiter la nature, comme le
fait Friedrich Hegel (1770-1831), dans son ouvrage Esthétique (1835). Il définit l'imitation comme
“la reproduction habile d'objets tels qu'ils existent dans la nature […] dont les résultats restent
toujours inférieurs à ce que nous offre la nature.” Le but est de montrer son habileté, sa technique et
son talent à reproduire quelque chose de naturel. Car il se réjouit d'avoir réussi à imiter l'oeuvre de
Dieu, comme si, pouvant reproduire son oeuvre, il pouvait se placer à sa hauteur.
Emmanuel Kant (1724-1804), dans la Critique de la faculté de juger (1790), nous montre
que l'artiste se dépasse en proposant une belle représentation. Il lui est donc possible d'embellir ce
qui est laid. Comme, par exemple, Rembrandt (1600-1669) et son Boeuf écorché, ou le théâtre
tragique (belle représentation de la laideur morale). L'art ne copie pas la nature, mais il est le fruit
d'une activité qui produit le beau, en donnant la beauté de la forme à des choses qui dans la nature
peuvent être laides, selon une perspective (une manière ou un style) propre à l'artiste, en utilisant
des éléments sensibles (couleur, son).
Cependant, Hegel suggère que le contentement de l'artiste dans l'imitation n'est que de
courte durée : plus la chose fabriquée est ressemblante, moins elle apporte de joie. La joie est plus
grande lorsque l'objet fabriqué est unique. L'auteur doit créer quelque chose qui lui est propre.
Mikel Dufrenne (1910-1995) va encore plus loin dans son oeuvre Esthétique et philosophie
(1967) : l'art nous apprend à transfigurer le quotidien, en nous faisant reconnaître la beauté en toute
chose.
LA SOUMISSION AUX RÈGLES ESTHÉTIQUES ET SOCIALES. L'artiste doit se
conformer à ces critères, et donc subir la pression sociale.
Le musée semble accentuer cette soumission. Accéder à l'exposition de ses oeuvres dans un
musée n'est pas donné à tout artiste. Le musée a pour objectif de mettre en valeur les oeuvres qu'il
présente et de proposer un contexte favorable à leur réception. L'humilité des spectateurs face aux
oeuvres est une posture de soumission, qui se compose avec les domaines politique et social, avec
lesquels elle fait système. Elle introduit en nous l'habitude d'admirer les oeuvres, les artistes et leurs
mécènes.
On comprend dès lors les règles imposées et le respect de la bienséance, et par conséquent,
la censure de certaines œuvres, jugées scandaleuses. Comme par exemple, Edouard Manet,
Olympia (scandale : prostituée avec une attitude de défi), ou Gustave Flaubert, Madame Bovary
(scandale : adultère → procès).
LE REFUS DE LA SOUMISSION. Hans Belting, dans Le chef-d'oeuvre invisible, nous dit
que l'admiration pour leurs prédecesseurs exposés dans des musées a conduit les artistes à modifier
leur pratique. Les oeuvres muséales sont un horizon inatteignable pour les artistes. D'où d'autres
modalités de production : écarts, déformations (Munch, Le Cri), des sujets nouveaux (Renoir, Le
Déjeuner des canotiers), des séries d'oeuvres (Monet, Les meules), des oeuvres inachevées (Rodin,
La porte de l'enfer).
En outre, la soumission aux règles esthétiques, et en fin de compte sociales, nous fait
comprendre la rébellion de certains artistes. Provoquer le plaisir du spectateur n'est-il pas le vrai but
de l'art ? Au vingtième siècle, l’artiste se libère du joug des règles et de la beauté. L’art peut être
beau, mais cela n’est pas une nécessité. Il est lié à notre capacité de ressentir des émotions,
notamment celle de plaisir. La beauté était considérée comme objective et devient subjective : le
sentiment de plaisir ressenti lors de la contemplation de l’œuvre.
C’est ce que montre Kant, dans la Critique de la faculté de juger esthétique. Kant considère
que la phrase : « Ceci est beau » est un jugement de goût. Le goût est la capacité d’apprécier la
beauté ou la laideur. Il part du problème suivant : pourquoi est-il attendu des autres qu’ils aient le
même jugement que le nôtre alors que celui-ci est subjectif ? Il y a plusieurs explications. 1) Nous
confondons l’agréable (ce qui plaît dans la sensation : le plaisir sensoriel) et le beau (ce qui plaît à
l’esprit : plaisir intellectuel). Le plaisir sensoriel est subjectif car il est lié à la physiologie
particulière de chacun. En revanche, les capacités intellectuelles étant universelles et fonctionnant
de la même manière chez tous les hommes, comment expliquer les différences ? D’où la deuxième
explication. 2) Nous confondons les types de jugements. Quand je pense que le jugement « Ceci est
beau » est vrai , je commets une erreur. Le jugement de goût n’est pas un jugement logique, il ne
peut donc être ni vrai ni faux. 3) C’est le « libre-jeu » de l’entendement et de l’imagination qui est à
l’origine du plaisir esthétique. L’imagination est la faculté de recomposition des images, des mots,
des idées. Celle-ci prend plaisir à la créativité et à l’originalité.
DE NOUVEAUX BUTS. L’artiste se fixe de nouveaux buts : la créativité et l’originalité.
[Créativité : capacité à créer du nouveau, grâce à l’imagination (mais également les sensations et la
mémoire) / Originalité : capacité d’être à l’origine de quelque chose].
Le talent est alors redéfini comme la maîtrise technique au service de la créativité, et le
génie comme la maîtrise technique au service d’une créativité exceptionnelle. De ce point de vue,
l’art contemporain nous montre une très grande différence entre les artistes. Par exemple, entre
Marcel Duchamp (Fontaine) et Pablo Picasso (Guernica). Mais Marcel Duchamp fait preuve
d’originalité et de créativité, et a une importance particulière dans l’histoire de l’art. Il est l’artiste
qui nous fait le mieux comprendre la rébellion contre les canons esthétiques et la maîtrise technique.
Il désire montrer que le seul critère qui permette de distinguer une oeuvre d'art d'un objet
quelconque est la décision du créateur. Avec L.H.O.O.Q, il « s’attaque » à l’œuvre emblématique,
modèle de perfection : la Joconde.
L'INSPIRATION ET LA CRÉATION. L'art contemporain nous donne parfois l'impression
d'une dérive vers le “n'importe quoi”. Cela est probablement dû à la recherche de nouveauté. Mais
cela ne montre-t-il pas la limite de la créativité humaine ? Comment proposer de nouvelles
approches ?
Il y a d'abord la possibilité de mêler divers domaines de manière à les magnifier. C'est ce
que propose par exemple la Compagnie Kafig, dirigée par Mourad Merzouki, qui mêle arts du
cirque, danse hip hop et projections numériques dans son spectacle Pixel.
En outre, pour relancer l'inspiration il est nécessaire que l'artiste comprenne le
fonctionnement de l'esprit dans l'acte créatif. Francis Bacon conseille de relancer l'inspiration grâce
à la consultation des catalogues, magazines, et aux visites d'expositions et de musées.
L'imagination a besoin d'éléments de base pour recomposer. Il suffit dès lors de récupérer des
éléments visuels complexes, comme des oeuvres d'art, pour nourrir à nouveau la créativité.
L'ARTISTE. L’art est donc expression de soi. Tout d’abord, une expression symbolique, où
les sons, les formes, les couleurs, les mouvements, les matières sont des symboles renvoyant à
d'autres réalités, matérielles ou immatérielles (comme les idées ou les émotions).
L’artiste exprime sa vision du monde, mais également sa sensibilité [Ex : Francis Bacon,
Études d'après le portrait du Pape Innocent X : “J'ai voulu représenter le cri.” (1953) / Ex :
Salvador Dali, surréalisme : laisser l'inconscient s'exprimer par l'art]
L’art servirait donc de purgation de nos émotions négatives : la catharsis.
ART ET LIBERTÉ. L’art nous montre que l’homme cherche à se libérer d’un grand nombre
de contraintes, naturelles ou sociales. L'art est donc expression de la liberté humaine, ou, de sa
recherche.
C’est la raison pour laquelle l'art n'est pas assujetti à l'utilité. Mais il peut être utilisé. L'art
raconte mieux notre monde que les articles de journaux et les livres. Il participe de l'esprit de son
temps. Il peut en être prisonnier, voire complice. L'art contemporain est par exemple du côté des
élites. Il peut être un moteur de l'histoire. Vladimir Kandinsky pense que les artistes tirent
l'humanité vers le haut (vers de plus en plus de spiritualité). L'art peut critiquer son temps. Les
artistes considèrent alors qu'ils ont un rôle social. [Art engagé, ex : Piotr Pavlenski, artiste russe
utilisant les performances artistiques comme moyen de lutte contre le gouvernement asservissant de
Poutine / Pierre Pinoncelli : performance impliquant une auto-mutilation afin de faire libérer une
otage]
VALEUR CULTURELLE DE L'ART. L’art est donc fait pour durer, d’où le recours aux
musées. Les œuvres produites constituent un patrimoine humain qu’il faut protéger et préserver. [Ex
: le déplacement du Temple d’Abou Simbel en Egypte]
Hannah Arendt, dans La Crise de la culture, a bien mis en évidence l’importance de l’art
par rapport aux autres productions humaines. Elle refuse de faire de l’art « un objet de raffinement
social et individuel ». Les œuvres ne sont pas des moyens accordés aux individus pour se cultiver ;
elles ont une réalité objective ; « leur plus fondamentale qualité : ravir et émouvoir le lecteur ou le
spectateur par-delà les siècles… »
CONSCIENCE (TEMPS)
La conscience est d'abord un état : être conscient. Elle admet des degrés qui sont ceux de la
vigilance : la veille attentive, la rêverie, le sommeil, l'anesthésie, le coma, l'état végétatif. Il faut
distinguer ce sens de celui qui intéresse la philosophie, à savoir la conscience comme un acte de
pensée dirigé vers un certain objet : “j'ai conscience de ceci ou de cela”. D'où ce qu'on nomme la
CONSCIENCE RÉFLEXIVE : lorsque je réfléchis sur mes pensées, je pense à ce que je suis en
train de penser : je pense que je pense. Elle permet également la CONSCIENCE DE SOI : c'est
l'expérience que nous faisons de nous-mêmes comme sujet des pensées que nous avons. Elle est
donc CONSCIENCE PHÉNOMÉNALE : effet que cela fait d'exister comme être pensant. À la
différence des tables ou des chaises, ils s'apparaissent à eux-mêmes, cela leur fait quelque chose
d'être ce qu'ils sont. La conscience phénoménale est l'expérience vécue brute.
PROBLÉMATIQUE. Le sujet est l’individu qui est doué de conscience, c’est-à-dire la
capacité de savoir ce qui se passe en soi. Il y aurait donc une séparation interne à notre esprit entre
le soi et la conscience de soi. Rapporter la conscience à un sujet, c’est considérer qu’il y a en nous,
malgré les changements, unité et permanence : d'où le le concept de “substance”, la partie
permanente de l’être, celle qui demeure alors que les changements ont lieu. Quel est le statut de la
conscience : est-elle dans le sujet, comme une capacité parmi d’autres, ou bien est-elle ce qui fait le
sujet ? Comment pouvons-nous obtenir une connaissance objective de la conscience, alors que par
essence celle-ci constitue la subjectivité ?
LA CONSCIENCE ET LA LIBERTÉ. Henri Bergson, dans La conscience et la vie (1911),
pose le problème philosophique suivant : l’univers est constitué de matière, dont le comportement
est déterminé (rien d’imprévisible). La matière se caractérise par son inertie, sa géométrie et sa
nécessité. Comment expliquer l’apparition de la Vie, c’est-à-dire de formes vivantes dotées d’un
mouvement imprévisible et libre ? Bergson propose cette solution : la matière est traversée par la
conscience créatrice qui l’entraîne à l’organisation et fait d’elle un instrument de liberté. La
conscience est mémoire et anticipation, ce qui rend possible le choix. Choisir, c’est répondre à une
excitation déterminée par des mouvements plus ou moins imprévus. Chez l’humain, la conscience
travaille par l’intermédiaire d’un cerveau. Le cerveau est un organe qui permet de choisir le
mécanisme conduisant à l'action la plus appropriée dans une situation donnée. La conscience ne
saurait se réduire à cette activité cérébrale. L’activité mentale de l’homme déborde son activité
cérébrale. La conservation et même l’intensification de la personnalité sont possibles et même
probables après la désintégration du corps. La science sera peut-être un jour en mesure de valider
cette hypothèse. La conscience humaine rend possible la liberté conçue comme un choix non
déterminé, non subi, non automatique. Elle est imprévisibilité et créativité. Cela explique, dans
l’évolution des espèces, que la vie est allée en se compliquant. Il y a une poussée intérieure, un élan
vital, une force qui évolue, portant en elle instinct et intelligence. D’où les deux voies d’évolution
de la vie : 1) obtenir sur place tout ce qu’il faut au lieu d’aller le chercher, ce qui implique la
tranquillité, la torpeur et le degré le plus bas de conscience : l’inconscience et l’instinct, ou 2) aller
chercher tout ce qu’il faut, ce qui implique le mouvement, l’action, la liberté et des variations de la
conscience (au degré maximal lorsque les choix à faire sont cruciaux). La conscience est
coextensive à la vie, mais certaines formes de vie y ont renoncé. La conscience s’oppose à la
matière, mais la vie réconcilie la matière qui est nécessité et la conscience qui est liberté. Matière et
conscience dérivent probablement d’une source commune. La vie est la liberté s’insérant dans la
nécessité et la tournant à son profit. Cela est possible car le déterminisme auquel la matière obéit
peut se relâcher de sa rigueur. La matière emmagasine une énergie de puissance qui sera utilisée
comme énergie de mouvement. La cause libre est capable de fléchir la nécessité à laquelle est
soumise la matière. Elle obtient d’elle des mouvements de plus en plus puissants.
LA CONSCIENCE ET LE TEMPS. Selon Bergson, il faut distinguer le temps scientifique et
la durée vécue par la conscience. Comment la science s'y prend pour mesurer la durée d'un
événement ? Il s'agit d'un temps abstrait, rapportant des mouvements à un espace. Dans cette
optique, il n'existe pas de temps dans la réalité physique. Ce n'est qu' un concept créé pour mesurer
des données de la réalité. Si la science opère de cette façon, c'est pour s'économiser l'attente en
éliminant la durée, et pour anticiper sur l'événement. Le temps scientifique nous livre une image
symbolique du monde dans laquelle le temps peut être annulé, dans laquelle l'avenir le plus lointain
est fictivement contemporain du présent : un monde dans lequel le temps ne dure pas. L'expérience
dans laquelle se révèle, dans sa pureté, la durée réelle, ce n'est pas le spectacle du monde extérieur
qui nous le donnera, mais le retour sur l'intimité de notre propre conscience.
[COMPARAISON AVEC DESCARTES . Là où Descartes croyait trouver le permanent (ce
qu'il nomme la substance pensante, c'est-à-dire ce qui subsiste indépendamment des changements
mentaux), le cogito, "une chose qui pense", Bergson voit essentiellement une chose qui dure et qui
s'écoule.]
Bergson nous invite à regarder en nous et à découvrir "les données immédiates de la
conscience". Méthode proposée par Bergson pour accéder à ces données immédiates de notre
conscience : « il faut d'abord opérer une conversion de l'attention vers le monde intérieur ; puis
écarter du champ de la conscience le langage, créé pour satisfaire aux besoins de la vie sociale et de
la conversation, et les images déposées en nous par une longue fréquentation avec le monde des
objets ; enfin obtenir de notre attention une coïncidence intime avec l'expérience intérieure qui,
alors seulement, se révélera dans toute sa pureté. Vivre, pour une conscience, c'est dérouler dans le
temps la succession de ses idées, de ses sentiments, de ses impressions. Mais la tentation est grande
de se représenter cette succession comme un défilé d'états nettement distincts en des limites bien
tranchées ; un sentiment, puis une image, puis une autre image... »
« L'apparente discontinuité de la vie psychologique tient donc à ce que notre attention se fixe sur
elle par une série d'actes discontinus, on obtient ainsi (...) un équivalent statique qui se prêtera
mieux aux exigences de la logique et du langage. » (L'Évolution créatrice)
« Tandis que j’éprouvais une succession d’états, ils étaient si solidement organisés, si profondément
animés d'une vie commune, que je n'aurais su dire où l'un quelconque d'entre eux finit, où l'autre
commence. En réalité, aucun d'eux ne commence ni ne finit, mais tous se prolongent les uns dans
les autres." (La Pensée et le mouvant)
[COMPARAISON AVEC L'ASSOCIATIONNISME et KANT. Cette conception de l'unité et
de la fluidité du moi est éloignée de l'empirisme associationniste. Pour celui-ci, le moi n'est qu'une
série d'états discontinus. Kant le corrige en faisant du moi une unité synthétique, transcendante et
immuable, un lien s'imposant du dehors à l'éparpillement des atomes de conscience : ce qu'il y a de
commun à toutes mes pensées, c'est qu'il y a un JE qui les pense : c'est ce qu'il nomme l'aperception
transcendantale. Mais c'est toujours supposer qu'il y a des états distincts. Au contraire, selon
Bergson, l'unité est immanente au courant de conscience lui-même.]
Ce sont les nécessités de l'action nous obligent à morceler le flux de notre conscience. Le
langage a aussi sa part dans ce morcellement du courant de conscience ; parce que la pensée
s'exprime par des mots (reliés à des définitions) distincts qui se succèdent, nous croyons qu'elle est
elle-même de nature discontinue.
Le présent de la conscience a continuellement derrière lui la totalité de son passé :
«Conscience signifie d'abord mémoire» (L'Énergie spirituelle). Tout notre passé s'accumule
continuellement et se conserve indéfiniment. Il est là, présent derrière nous, et il nous suffirait de
nous détourner de l'intérêt que nous portons au présent et à l'action, de rêver au lieu de vouloir. De
notre passé une très petite part seulement est, à chaque moment, utile à l'action. La conscience est
centrée sur l'action. La durée est tendue vers l'avenir. « Je crois que notre vie passée est là, et que
tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu depuis le premier éveil de notre conscience, persiste
indéfiniment. Mais supposez qu'à un moment donné je me désintéresse de la situation présente, de
l'action pressante. Supposez, en d'autres termes, que je m'endorme. Alors ces souvenirs immobiles,
sentant que je viens d'écarter l'obstacle, de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de
la conscience, se mettent en mouvement.(...) Toute conscience est donc mémoire, - conservation et
accumulation du passé dans le présent. Mais toute conscience est anticipation de l'avenir. L'avenir
(...) nous tire à lui. (...) La conscience est un pont jeté entre le passé et l'avenir. » (L'Énergie
spirituelle).
TEMPS (CONSCIENCE, SCIENCE)
ANALYSE ET PROBLÉMATIQUE. Notre existence est soumise au cours irréversible du
temps, et la mort en est le terme inéluctable. L’homme est voué à la finitude. Il ne peut pas se
soustraire à sa condition. Comment l’homme peut-il supporter la conscience de sa finitude ?
Pourquoi avons-nous l’impression que nous avons besoin de temps pour notre existence ? Comment
comptons-nous utiliser cette dimension ? Le désir d'échapper au temps traduit celui d'échapper à la
mort, c'est-à-dire d'excéder les limites de l'existence. Peut-on alors agir sur le temps ?
LA CONSCIENCE DU TEMPS NOUS REND MALHEUREUX. Notre existence est
contingente : le fait d’exister est sans nécessité, car notre naissance aurait pu ne pas avoir lieu
puisqu’elle est la conséquence d’une rencontre fortuite entre deux êtres. En outre, nous ne savons
pas profiter du temps présent. Notre mort, enfin, est un événement certain et incompréhensible.
Blaise Pascal (1623-1662), dans ses Pensées (1654), décrit la finitude de notre existence : ''Je suis
dans une ignorance terrible de toutes choses. (...) Je vois ces effroyables espaces qui m’enferment,
et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt
placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à
ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne
vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme une ombre qui
ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que
j’ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter.'' (B 194) L’homme supporte la
conscience de sa finitude par la distraction. Nous utilisons la capacité de diriger, de détourner notre
conscience vers un objet ne provoquant pas l’angoisse. C’est ce que Pascal nomme le
''divertissement''.
LA CONSCIENCE DE LA FINITUDE ET LA DIGNITÉ. L’homme supporte la conscience
de sa finitude en prenant conscience de sa dignité, de sa noblesse. La souffrance en est le prix à
payer. C'est ce que montre Pascal : ''L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature : mais
c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une
goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble
que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui ; l’univers n’en
sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée.'' ( B 347 ) La conscience des conditions
permet une maîtrise relative de son existence.
La conscience du temps qui passe est liée à l'idée d'irréversibilité de l'existence, bornée par
le spectre de la mort. L'appréhension de notre fin peut nous pousser à jalouser l'animal sans
mémoire ou à reconnaître la vertu nietzschéenne de l'oubli.
Mais nous pouvons utiliser notre raison afin de nous apaiser. Si la peur de la mort n'est
qu'une erreur de raisonnement, comme le suggère Épicure dans la Lettre à Ménécée, comment
pourrions-nous craindre ce dont l'expérience nous est impossible ?
Dans cette optique, l'ennui est une expérience intéressante. En effet, l'ennui nous fait
éprouver le simple fait d'exister. C'est la thèse d'Alain Jay, dans Quel ennui (2007) : la conscience
n'est plus divertie par les objets du monde, elle fait face à elle-même, ou plutôt, elle sent une
présence diffuse qui n'est autre qu'elle-même. Dans l'ennui, on est enfermé en soi, sans issue. '' Dans
l'ennui il faut admettre que la conscience, tout en étant pleinement consciente, n'est plus conscience
de quelque chose.'' La conscience se sent.
AGIR SUR LE TEMPS. Pour être heureux, faut-il vivre au présent ? Selon Pascal, l'homme
ne vit jamais dans le présent, qui est pourtant le temps de son existence. Nous vivons dans
l'anticipation de l'avenir ou dans le souvenir du passé. C'est d'abord un mauvais calcul : car nous
délaissons ainsi le seul temps qui est vraiment celui dans lequel nous existons : le présent. Et c'est
ensuite une preuve du néant de notre vie : car nous ne nous occupons que des temps qui n'existent
pas (le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore), aux dépens du seul temps qui existe : le présent.
Nous fuyons le présent, parce qu'il est désagréable et nous rend tristes. Même lorsqu'il est agréable,
nous sommes tristes de penser qu'il est en train de fuir. Le but de notre vie, ce vers quoi nous nous
tournons, c'est l'avenir. Notre vie se réduit donc à l'espoir de vivre. Nous ne pouvons donc pas être
heureux, puisque le seul bonheur possible est dans le présent.
Il est possible d'être submergé par la fuite du temps et de ne pas pouvoir inscrire son action
dans la durabilité. Pour Sénèque, il est vain de vouloir agir sur le futur, car cela nous empêche de
profiter du présent et ruine nos chances d'atteindre la sérénité. La vie en elle-même n'est pas si
courte ; c'est nous qui la rendons brève en nous dispersant, en nous affairant. Les ''occupés'' sont
tendus vers l'avenir, toujours incertain ; ils manquent le présent, qui seul est en notre pouvoir. Il faut
se concentrer sur lui pour connaître une sérénité profonde, la tranquillité d'âme : ''Vis dès
maintenant''. Nous gaspillons notre temps car nous croyons qu'il est infini. Épictète, lui, écrit : ''Le
moment t'appelle''. L'instant présent est une épreuve : le moment est venu de montrer ce que la
philosophie a appris aux jeunes gens.
Le caractère irréversible du temps marque les corps et les esprits. L'expérience du remords
exprime cette idée d'un temps sur lequel on ne peut revenir alors qu'on désirerait pouvoir le faire.
Ce passé absent me pèse. De plus, si le passé échappe à mon intervention, s'il provoque angoisse et
nostalgie, il me rappelle également que mon existence ''vaut une fois pour toutes''. C'est ce que
montre Louis Lavelle. Pourtant, cette irréversibilité, qui exprime notre finitude, est aussi ce qui
permet de donner un sens à l'existence. Une vie infinie enlèverait tout intérêt à l'action, car tout
serait toujours possible. L'irréversibilité du temps et le caractère fini de notre existence nous
obligent à faire des choix. Ils donnent une consistance à notre liberté et une valeur à notre existence.
Nos actes ont un sens parce qu'ils s'inscrivent irrémédiablement dans un temps fini.
L’homme transcende, c’est-à-dire dépasse, le donné pour viser au-delà de lui ce qui n’est pas
encore. En ce sens, il ex-siste (ex : dehors, sistere : se tenir). Ma conscience, introduisant un
décalage entre moi et moi, m’empêche de coïncider avec moi, et me donne sans cesse du
mouvement pour aller vers le futur. L’homme est cet étant particulier qui existe car il n’est pas ce
qu’il est à tel moment à ses yeux et aux yeux des autres. L’existence n’est pas un état, mais un
processus. Avant tout, l’homme est ce qu’il se fait. C'est ce montre Jean-Paul Sartre dans
L’existentialisme est un humanisme : l’homme surgit dans le monde, et il se définit après. L’homme
est seulement, non seulement tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il se conçoit après
l’existence, comme il se veut après cet élan vers l’existence ; l’homme n’est rien d’autre que ce
qu’il se fait. Il n'y a pas de nature humaine prédéfinie, mais liberté de choix. Chaque être humain, à
travers ses actes et ses choix, propose des valeurs. Par là, il engage une conception de l’humanité.
Mais il doit en assumer la responsabilité.
Hartmut Rosa explique que nos sociétés sont vouées à accélérer, puisque nos économies sont
fondées sur la croissance (Accélération. Une critique sociale du temps, 2010). ''La croissance est
l'augmentation du produit intérieur brut d'une année sur l'autre. Or, pour produire plus, dans la
même unité de temps, il n'y a qu'une solution, à population égale : il faut aller plus vite. Nous
sommes donc pris, malgré nous, dans ce régime temporel démentiel. Être aliéné, c'est devenir
étranger à soi-même, ne plus sentir ses émotions. Quand les gens font un burn-out, ils fournissent
toujours le même témoignage : ils admettent qu'ils ont un travail, une famille, des amis, que tout va
bien objectivement, et pourtant, ils se sentent vides, sans émotion. Le monde extérieur ne leur parle
plus. Ils sont secs. Voilà, ça c'est l'aliénation. Quel est le contraire de l'aliénation ? C'est la
résonance, le fait d'entrer dans une relation de réciprocité avec le monde.
Henry David Thoreau le dénonçait déjà en 1854, dans son oeuvre Walden, ou la vie dans les
bois. Accablés par le poids de leurs multiples possessions, courbés sous le fardeau des obligations,
épuisés par un travail dont ils n'ont plus la force de profiter des fruits, les hommes mènent une vie
d'insensés et n'ont pas le temps d'être autre chose qu'une machine. Pour échapper au ''calme
désespoir'' de nos vies, il faut simplifier et revenir à l'essentiel : se protéger du froid, couvrir notre
nudité, restaurer notre chaleur vitale, afin de pouvoir enfin ''s'aventurer dans la vie'' et ''donner toute
sa valeur au moment présent''. ''Chaque homme a pour tâche de rendre sa vie digne d'être
contemplée par ses heures les plus élevées, les plus critiques. (…) Je m'en allai dans les bois parce
que je voulais vivre sans hâte, faire face seulement aux faits essentiels de la vie, découvrir ce qu'elle
avait à m'enseigner, afin de ne pas m'apercevoir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. Je ne
voulais pas non plus apprendre à me résigner, à moins que cela ne fût absolument nécessaire.''
L'homme tente d'agir sur le temps. Il résiste d'abord, par ses oeuvres artistiques qui sont une
tentative d'immortalité selon Hannah Arendt.
Il le quitte également, pour rejoindre le temps sacré, forme d'éternité, ainsi que le définit
Mircea Eliade.
LE TEMPS N'EXISTE-T-IL QUE POUR UNE CONSCIENCE ? EN QUOI LA DURÉE
EST-ELLE L'ÉTOFFE DE NOTRE CONSCIENCE ? Le temps semble n'être que la conscience du
changement. Il paraît objectif et quantifiable sur une frise chronologique ou sur une horloge. Mais
l'instant passé ne peut pas être court ou long, puisqu'il n'existe plus. Selon Augustin (354-430), dans
Les Confessions, le temps n'est pas quelque chose en lui-même, mais suppose une activité de l'esprit
(la mémoire, l'attention au présent et l'anticipation). Le problème insoluble de savoir si le temps
existe ou n'existe pas n'est résolu que si on fait appel au souvenir et à l'anticipation comme une
certaine continuité dans le changement, on comprend donc le temps sans pouvoir l'expliquer.
La durée relève de l'expérience individuelle et subjective que fait la conscience de la
temporalité. Elle est un temps vécu qui acquiert une épaisseur par la conscience : celle-ci retient le
passé par le souvenir et tend ou se projette vers l'avenir. Elle suppose que soit encore présent ce qui
n'est plus (le passé immédiat) et que soit déjà esquissé ou anticipé ce qui n'est pas encore (le futur
immédiat). La durée est hétérogène et qualitative (elle est l'ensemble de nos impressions,
sentiments, pensées, c'est-à-dire de notre vie consciente, selon Henri Bergson. La durée constitue la
texture même de notre conscience. Bergson montre qu'elle permet à notre esprit de se lier à notre
corps, au passé d'investir le présent, à l'imagination de prendre corps dans l'action, à la personne de
s'approprier le monde.
Le devenir renvoie à l'idée de changement ; devenir pour une chose, c'est devenir autre
(passer d'un état à un autre) et conserver son identité (il faut bien que, d'une certaine manière,
quelque chose demeure le même). Ainsi, quand je deviens adulte, il y a bien des changements qui
font que je ne suis plus un enfant, mais en même temps, c'est bien moi dans ce qui me définit en
propre qui change, et cette identité persiste en deçà des changements. Pour chacun d'entre nous, il y
a deux lignes d'évolution, l'une qui retrace le parcours de notre corps, l'autre celui de notre esprit.
L'enfant est saturé d'une énergie toujours en excès sur ses projets et dont il ne sait comment se
débarrasser, sinon en jouant et en gesticulant, en se lançant dans toutes sortes d'actions en pure
perte. Cette vitalité physique atteint son pic au sortir de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, en
tout cas bien avant que l'esprit de l'humain ne soit arrivé à sa pleine maturité. Mais le sort est d'une
ironie cruelle : la conscience continue à élargir son spectre, nous accumulons des expériences et des
connaissances, nos jugements gagnent en fermeté longtemps après que notre corps a entamé son
dépérissement. Avant l'intersection entre les deux lignes, nous ne sommes pas encore nous-mêmes.
Comme si le fait d'avoir de nombreuses années derrière soi empêchait de vivre... Comme si le passé
emplissait tout l'espace disponible au point d'étouffer le présent...
LE TEMPS EST-IL RÉEL ? Si la forme du temps est subjective, cela signifie que les
phénomènes ne sont pas dans le temps, mais que le temps est la forme par laquelle nos
représentations sont forgées, ainsi que le pensait Emmanuel Kant (1724-1804). Dans la Critique de
la Raison pure (1781), Kant montre que le contenu de la représentation du temps n'est pas dérivé de
l'expérience. Il le prouve en montrant qu'on n'arrive pas à la pensée du temps par abstraction à partir
d'expériences de simultanéité ou de succession, car pour pouvoir penser la simultaniété
(appartenance de deux objects distincts dans un même temps) et la succession (appartenance d'un
même objet dans deux temps distincts), il faut déjà penser le temps. La représentation du temps est
la condition de possibilité de toute intuition sensible. Elle est donc a priori. On peut penser un
temps vide, sans phénomènes, mais on ne peut penser des phénomènes en dehors du temps.
LE TEMPS SCIENTIFIQUE COMME UNITÉ DE MESURE. Mais s'il existe un temps
réel, il est inhérent aux réalités créées, et les phénomènes physiques permettent d'en établir une
mesure. Le temps se résout en une juxtaposition d'instants qui n'ont pas plus de durée que le point
n'a d'étendue. Le temps physique est quantitatif et homogène (une minute équivaut à une autre
minute).
INCONSCIENT (CONSCIENCE, LIBERTÉ)
ANALYSE et PROBLÉMATIQUE. [SENS 1]. Le terme a d’abord qualifié un état
d’inconscience, une sorte de degré zéro de la conscience. Ce sens domine notamment au XIXè
siècle, dans le contexte des premiers développements de la psychologie alors envisagée comme
science de la conscience. [SENS 2]. Mais c’est avec Freud, le fondateur de la psychanalyse, que la
notion d’inconscient psychique devient une structure essentielle du psychisme humain. [SENS 3].
Par extension, l'inconscience désigne une absence de conscience morale, où l'on ne parvient plus à
distinguer bonnes et mauvaises actions.
Le sujet est-il menacé par cette structure ? Dans la troisième acception du mot,
l’inconscience signifie que celui qui fait le mal le fait sans s’en rendre compte. L’existence d’un
psychisme inconscient remet-elle en question la possibilité de la morale ? L’existence de
l’inconscient remet-elle en cause la maîtrise qu’a l’homme de lui-même ? Mais si l’inconscient
existe, comment expliquer que l’on puisse en parler alors que par définition il est non conscient,
c’est-à-dire non accessible à notre conscience, et donc à notre connaissance ?
LES LACUNES DE LA CONSCIENCE : LES PRÉMISSES DE LA
DÉCOUVERTE DE L’HYPOTHÈSE DE L’INCONSCIENT. Dans l'Antiquité, les
penseurs ont eu des intuitions quant au fonctionnement problématique de notre esprit, mais ils n'ont
pas été en mesure de penser un psychisme inconscient. Ils avaient l'habitude de considérer que les
rêves avaient une signification (messages divins envoyés aux hommes). Mais le plus intéressant est
l'idée d'une lutte interne entre les passions et la raison. On trouve ce thème dans la célèbre tragédie
de Sophocle (495-406 av. J.-C.), Oedipe-roi. Mais également chez Platon (427-348) , qui dans le
Phèdre (mythe de l'attelage ailé), décrit cette lutte interne comme deux chevaux, un mauvais
et un bon, tiraillant le char comparé à l'âme. L'âme est tiraillée par des tendances contraires.
Aristote (384-322) reprend cette idée de lutte interne dans son Éthique à Nicomaque. Il distingue
des parties de l'âme. Une partie de l'âme exhorte les individus à accomplir les plus nobles actions.
Mais elle est en conflit avec un autre principe auquel il oppose une résistance. Mais l'âme déviante
ne voit rien. Il y a une lutte interne. Nous devons obéir à la partie rationnelle de notre âme.
Au XVIIè siècle, DESCARTES, dans la Lettre à Chanut (6 juin 1647), part d'un errement de
la raison : comment expliquer son attirance pour les femmes qui louchent, alors qu'il considère
qu'elles ont un défaut ? Il procède à une enquête qui l'amène à remonter dans son enfance afin de
comprendre cette limite présente. Il se souvient qu'il était amoureux, enfant, d'une petite fille qui
louchait. Il prend conscience que c'est ce sentiment qui explique son comportement d'adulte. Le fait
de s'en ressouvenir lui permet de reprendre la maîtrise de lui-même et de ne plus éprouver ce type
d'attirance. Descartes pense que toute pensée est accompagnée de conscience et qu'il suffit d'utiliser
correctement ses facultés afin d'accéder à la maîtrise. Descartes analyse les mystères de la vie
affective et cherche des explications à la part d’irrationnel qui accompagne les passions et leur
donne leur force. La maîtrise qu’a l’homme sur lui-même nécessite l’accès à la connaissance de son
être. Chacun est par là invité à assumer l’entière responsabilité de ce qu’il est et de ce qu’il pense.
Au XIXè siècle, Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860), affirme, dans son œuvre Le
monde comme volonté et comme représentation (1819) que la volonté, le vouloir-vivre nous dirige
inconsciemment. La philosophie de Schopenhauer soutient que toute la nature est l'expression d'une
volonté insatiable de vie. Elle engendre la souffrance qui ne cesse que momentanément, pour
laisser, parfois, la place à l'ennui. Le comportement des animaux et des hommes est entièrement
régi par la fuite de la souffrance. La passion amoureuse et l’instinct sexuel sont fondamentalement
une seule et même chose. Il faut reconnaître, dans la sexualité, une expression du primat du vouloir-
vivre sur l’intellect, primat qui implique que « les pensées nettement conscientes ne sont que la
surface », et que nos pensées les plus profondes nous restent en partie obscures, quoiqu’elles soient,
en réalité, plus déterminantes, plus fondamentales. Ces pensées profondes sont constituées par la
Volonté, et la Volonté, comme vouloir-vivre, donc vouloir-se-reproduire, implique, en son essence,
la sexualité. En affirmant ainsi le caractère obscur pour la conscience des pensées liées à la
sexualité, Schopenhauer esquisse une théorie d’un moi non-conscient. C’est à partir de ce fond non-
conscient, c’est-à-dire à partir de la sexualité, qu’il faut comprendre l’existence, chez l’être humain,
de l’intellect. L’instinct sexuel est l’instinct fondamental, « l’appétit des appétits » : par lui, c’est
l’espèce qui s’affirme par l’intermédiaire de l’individu, « il est le désir qui constitue l’être même de
l’homme ». « L’homme est un instinct sexuel qui a pris corps ».C’est donc à partir de lui qu’il faut
comprendre toute passion amoureuse. Tout amour cache, sous ses manifestations, des plus vulgaires
aux plus sublimes, le même vouloir vivre, le même génie de l’espèce. Pourtant, dira-t-on, n’y a-t-il
pas, entre l’instinct sexuel et le sentiment amoureux, une différence essentielle, puisque le premier
est susceptible d’être assouvi avec n’importe quel individu, tandis que le second se porte vers un
individu en particulier ? Schopenhauer ne nie aucunement une telle distinction. Il fait même de
l’individualisation du choix amoureux l'énigme centrale de la psychologie amoureuse. Le choix des
amants est apparemment la caractéristique essentielle de l’amour humain. Cela ne signifie pas, pour
autant, qu'on ne peut pas expliquer ce choix par le génie de l’espèce. La préférence individuelle, et
même la force de la passion, doivent se comprendre à partir de l’intérêt de l’espèce pour la
composition de la génération future. « Que tel enfant déterminé soit procréé, voilà le but véritable,
quoique ignoré des intéressés, de tout roman d’amour ».C’est dans l’acte générateur que se
manifeste le plus directement, c’est-à-dire sans intervention de la connaissance, le vouloir-vivre. Or,
l’amour, la reproduction, ne sont que ce par quoi le mal, la misère, sont perpétués dans le monde. La
passion amoureuse est ainsi, au centre de la tragédie sans cesse réitérée que constitue l’histoire du
monde. La tragédie est d’autant plus grande qu’en procréant, l’individu prend obscurément
conscience de sa propre mort : il n’est rien, seule compte l’espèce, et l’espèce n’est faite que
d’autres individus qui, comme lui, connaissent la souffrance et l’angoisse. La lucidité, et le
sentiment de pitié dont l’homme est susceptible à l’égard des autres êtres vivants, imposent de
mettre un terme à ces souffrances, en renonçant à la procréation.
LA RÉVOLUTION FREUDIENNE AU XXè SIÈCLE : « LE MOI N’EST PAS
MAÎTRE DANS SA PROPRE MAISON » (Sigmund Freud, 1856-1939). Il s’intéresse à des
maladies face auxquelles la médecine traditionnelle reste impuissante : des symptômes qui ne
semblent liés à aucun dysfonctionnement organique. PROBLÉMATIQUE. Comment expliquer que
nous n’ayons pas accès à ce qui se passe en nous, voire à ce qui provient de nous ? Il explique les
maladies en termes psychiques : sens , signification, intention, désir et langage (alors que la
psychiatrie de son époque considérait la maladie mentale comme une fatalité de naissance).
Sigmund FREUD montre, dans son Introduction à la psychanalyse (« Les trois humiliations ») que
dès l'Antiquité, les penseurs avaient l'intuition d'un inconscient psychique. Il tente de comprendre
les raisons qui ont amené les hommes à rejeter cette hypothèse : c'est à cause de la mégalomanie
humaine. Celle-ci a pourtant subi trois humiliations : l'humiliation cosmologique [la science a
montré que la terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du
système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur,] l'humiliation
biologique [ qui a détruit les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la
création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa
nature animale] et l'humiliation psychologique [le moi n'est pas maître dans sa propre maison, il en
est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de
sa conscience, dans sa vie psychique]. Selon Freud, l’hypothèse de l’inconscient est nécessaire et
légitime. En effet, elle explique les données lacunaires de la conscience et elle apporte du sens et de
la cohérence. En outre, elle permet de guérir les malades. Freud conclut que le psychisme ne se
réduit pas à la conscience, qui ne comporte qu’un contenu minime à chaque moment. Il y a donc des
contenus latents. Freud critique une conception traditionnelle de l’esprit humain. Nombreux sont les
philosophes qui associent cet esprit à la conscience, avec le présupposé que la conscience a accès à
tout contenu mental et assure la maîtrise de ce qui se produit dans notre esprit (comme le faisait
Descartes). Il préfère d’ailleurs changer le concept et utiliser le terme de « psychisme ». Le
psychisme serait constitué de la conscience et de l’Inconscient. Il y aurait beaucoup plus de
contenus mentaux, de pensées que les pensées simplement conscientes. Nous pourrions d’ailleurs
confirmer le propos freudien en citant l’exemple de la mémoire. Certains contenus sont conscients,
d’autres ne le sont pas mais pourtant présents dans l’esprit. Freud ne comprend pas l’erreur faite
traditionnellement. En effet, il affirme qu’il existe des preuves fournies par ce que nous
expérimentons du point de vue psychologique.
LES 4 PREUVES DE L'EXISTENCE DE L'INCONSCIENT SELON FREUD.
PREUVE 1. Les actes manqués (ils sont manqués du point de vue de la conscience, mais
réussis du point de vue de l'Inconscient, et montrent l'intention de celui-ci de se manifester).
PREUVE 2. Les rêves. Freud a conçu une méthode d'analyse des rêves. Il considère que leur
interprétation est la voie royale à l'Inconscient, car le désir, y compris le cauchemar, serait une
réalisation de désir inconscient. L'interprétation repose sur le principe du déterminisme psychique.
Il utilse la technique d'association libre des idées. La cohérence et l'efficacité sont des critères d'une
bonne analyse. Interpréter c'est trouver le sens (alors qu'expliquer c'est inqiduer la cause). Les rêves
ont un sens et une cause. Il distingue le contenu manifeste du contenu latent du rêve.
[L'INTERPRÉTATION DES RÊVES SELON FREUD. L'interprétation permet d'accéder
au contenu latent, en défaisant le travail d'élaboration du rêve (le contenu latent est transformé en
contenu manifeste. Ce travail est rendu nécessaire par la censure et le refoulement. Il s'agit d'un
codage pour contourner la censure). Il y a 4 formes du travail d'élaboration. TRANSPOSITION : un
désir est représenté par une scène, une image. Représentation métaphorique (ex : causalité
représentée par la succession). CONDENSATION : plusieurs éléments sont concentrés sur un
même élément du contenu manifeste. DISPERSION : plusieurs éléments du contenu manifeste
renvoient au même élément latent. DÉPLACEMENT : les détails anodins du contenu manifeste
sont liés à des pensées latentes importantes, avec un déplacement de l'intensité affective]
PREUVE 3. Les symptômes psycho-somatiques (maladies mentales)
PREUVE 4. La réussite psycho-thérapeutique.
CRITIQUE DES SOIT-DISANT PREUVES FREUDIENNES. Preuve (ce qui
détermine la certitude) :
-fait concret illustrant la thèse (pas prudent de s’en contenter),
-fait expérimental vérifiant la thèse,
-recherche d’un fait concret ou expérimental n’infirmant pas la thèse,
-démonstration (il faut joindre les deux types de preuves).
Or Freud utilise des faits psychiques et non matériels, concrets. En outre, ces faits
psychiques sont interprétés (ils renvoient à autre chose de non connu par la conscience).
Enfin, il utilise une pseudo-démonstration : si je trouve un sens caché alors il y en a un. La
démarche de Freud n’est donc pas réellement scientifique. Freud a doté l’inconscient des attributs
de la conscience. L’inconscient freudien ne serait que « la conscience du sujet qui interprète sa
propre vie mentale inconsciente à la lumière de ses croyances conscientes. »
INCONSCIENT ET LIBERTÉ. L’analyse de l’inconscient restaure cependant la liberté
de choix. Remis devant le choix qu’il n’avait pas fait, ou avait mal fait, le patient retrouve sa liberté
de choix, et reprend le contrôle de son existence. La psychanalyse ne menace pas la conscience.
Elle permet de rendre compte des lacunes de la conscience, sans pour autant en réduire la valeur.
[Freud énonce une topique comme une représentation spatiale du psychisme. Les réalités
psychiques sont représentées comme des lieux, comme des zones, qui en expliquent le
fonctionnement. La seconde topique (1915-1917), corrigeant les défauts d'une première, est
présentée dans les Nouvelles conférences sur la psychanalyse. Il y décrit le Ça (lieu des pulsions /
ensemble des pulsions eros (pulsions de vie) et thanatos (pulsions de destruction, de mort) qui
constituent le fond de la personnalité), puis le Moi (partie de la personnalité qui assure toutes les
fonctions conscientes : perception, jugement, raisonnement), et enfin le Surmoi (instance née du
complexe d’Œdipe et constituant le lieu des interdictions sociales et familiales). Le Moi et le
Surmoi sont issus du ça et entrent en conflit avec lui par les procédés de résistance, censure et
refoulement.]
LANGAGE
ANALYSE ET PROBLÉMATIQUE. Le langage est la faculté qu'a l'homme de
communiquer avec ses semblables. Cela est rendu possible par ses capacités physiques puisqu'il est
doté d'un organe vocal permettant l'émission de sons, et surtout de sons articulés. Cela est
également rendu possible par son fonctionnement cérébral puisqu'une zone du cerveau est dédiée au
langage. Le langage est donc une capacité intellectuelle. Si la capacité d'émettre des sons et des cris
est naturelle, en revanche, le fait d'articuler les sons est acquis grâce à l'éducation.
Comment les hommes ont-ils acquis cette capacité ? Il semblerait que ce soit une
particularité humaine que de relier une signification mentale à un référent extérieur grâce au
langage . Cette capacité semble fonder la possibilité des échanges humains, leur organisation de
groupe et la construction de toute manifestation culturelle. Le langage n'est-il pas l'élément
essentiel, parce que fondateur, de notre culture ? Mais si le langage fonde la culture, son but
essentiel n'est donc pas la communication, mais l'action sur les autres et le monde. Ne manifeste-t-il
pas la puissance de l'homme ? Et plus particulièrement de sa pensée ? Ses capacités intellectuelles
rendent possibles l'existence de contenus mentaux. Grâce à ces capacités, et en particulier sa
conscience, il a une représentation de lui-même et du monde extérieur. Cette représentation passe
régulièrement par le langage : nous pensons souvent avec des mots et notre pensée peut être
comparée à un dialogue avec nous-mêmes.
LA CONSTRUCTION DU VOCABULAIRE. L'ORIGINE NATURELLE DE LA
LANGUE. La pensée traditionnelle défend l'idée que la Nature s'exprime par la voix humaine,
notamment par l'intermédiaire des poètes. Pythagore (580- 495 av. J.-C.) enseigne que les noms ont
un lien de nature avec les objets qu'ils désignent. Dans toutes les traditions anciennes, on admet une
correspondance entre les objets et leurs noms. La Nature et ses lois entrent dans le discours, le
logos, par le biais du langage, parce que celui-ci intrinsèquement la reflète.
Dans la tradition indienne, les mots qui désignent les dieux, convoquent les dieux. D'où la
nécessité de modérer soigneusement son langage, de ne pas tenir un propos qui pourrait les offenser
et provoquer leur courroux. La Parole, Vac en sanskrit, est toujours pensée comme une puissance et,
prononcée par les sages, elle engendre immédiatement un effet que même les dieux ne peuvent
contrecarrer. Le pouvoir de la chose se communique au pouvoir des mots. Le mot est donc magique
par essence et le langage sacré.
S'il y a un lien entre la nature et le langage, se tromper, c'est dire ce qui n'est pas. Dire la
vérité, c'est dire ce qui est ; la vérité ramène la conscience à l'Être.
Comment les mots sont-ils apparus ? Rousseau (1712-1778), dans l' Essai sur l'origine des
langues (1781), met en avant l’importance des passions agréables (et notamment le sentiment
amoureux) dans l’émergence des premières langues. Lorsque se formèrent les premiers liens
sociaux, naquirent aussi les passions. Les langues furent d’abord purement familiales et limitées.
Seule la vivacité des passions permit leur développement. Les premières langues sont l’expression
des premières passions. Il distingue les langues méridionales, nées des passions, qu’il oppose aux
langues du Nord, nées des besoins. C'est donc la pensée qui serait à l'origine des mots, du langage.
Le lieu géographique expliquerait le choix des mots.
Pour Platon (427-347 av. J.-C.), dans le Cratyle, le langage est un intermédiaire entre le
monde sensible et intelligible. Il y a deux manières de se représenter la réalité : le monde du
changement incessant (monde sensible) ou le monde des essences, immuable (monde intelligible).
S'exprimer, c'est élever sa pensée au-dessus de la réalité sensible pour accéder à la réalité
intelligible. Le mot n'est pas l'imitation de la chose dans ce qu'elle a de sensible mais dans ce qu'elle
a d'intelligible. Le langage est dans l'ordre de la généralité, car on ne donne pas un nom particulier à
chaque objet. Quand l'esprit nomme, il procède par catégories d'objets. Il abstrait les propriétés et
les rassemble sous un concept déterminé. Le nom est alors un instrument qui sert à instruire et à
discerner l'essence des choses. Le Cratyle (-386-385) propose une thèse naturaliste, défendue par
Cratyle, affirmant que les noms sont justes par nature et qu'il existe pour chaque objet une juste
dénomination. Les choses ont elles-mêmes une certaine réalité stable qui leur appartient et qui n'est
pas relative à nous. Le nom est un instrument qui sert à instruire et à discerner l'essence des choses.
L’ORIGINE CONVENTIONNELLE DES MOTS (NOMENCLATURE) : LES
"ÉTIQUETTES". Dans le Cratyle, Hermogène défend la thèse conventionnaliste affirmant que la
nature n'est pour rien dans cette justesse, qui est affaire d'accord ou de simple convention entre les
hommes. Socrate assimile la thèse d'Hermogène à un relativisme : si c'est l'homme qui donne valeur
et sens aux choses, il n'y a alors ni vérité, ni erreur, il n'y a rien que l'on puisse dénommer ou
qualifier avec justesse. Il n'y aura plus moyen de dialoguer. Le législateur doit savoir transposer en
sons et en syllabes le nom naturellement adapté à chaque chose. Il fabrique et établit tous les noms
en ayant en vue le nom en soi ( = nom approprié à chaque objet). Il y aurait un nom unique pour
chaque chose, mais qui se trouverait appliqué par le législateur à une matière sonore variable selon
les lieux, d'où les variétés des langues. Il y a une seule juste dénomination pour chaque chose
qu'imitent plus ou moins bien les noms des différentes langues. C'est le dialecticien, celui qui
connaît l'art d'interroger et de répondre, qui devra diriger et juger l'ouvrage du législateur. Le
déchiffrement philologique (étymologique) dépend d'un choix ontologique. Il vaut mieux apprendre
et rechercher les choses elles-mêmes en partant d'elles-mêmes qu'en partant des noms. Le vrai
langage commence quand cesse l'imitation grossière des objets et là où commence la pensée. Le
langage est comme un habillage de la pensée. ''La rectitude d'un nom est ce qui […] indique la
chose telle qu'elle est.'' Platon défend la thèse naturaliste. Pourtant c'est la thèse conventionnaliste
qui finira par s'imposer historiquement, notamment avec l'apparition de la linguistique.
Bergson (1851-1941), dans Le Rire (1901), a bien vu cette dimension conventionnaliste. Les
mots disent-ils la réalité des choses ? Ils se glissent entre les choses et nous. Ils nous dérobent aussi
notre individualité car ils ne peuvent pas rendre compte des ''mille nuances fugitives et des milles
résonances profondes qui en font quelque chose d’absolument nôtre.'' Le mot n'est pas la chose. Il
ne peut pas représenter la chose, ni la personne dans son individualité. Le langage ne peut pas
atteindre ce qui surgit dans la nouveauté de l'instant, ce qui est unique dans la diversité infinie du
monde. Le langage est donc abstrait et anonyme. Cela est dû à l’utilité et l’action.
Enjeu : langage humain et langage animal. Si les animaux ont des systèmes de
communication (y compris par signes – exemple de la "danse des abeilles"), seul l'homme a la
capacité d'articuler des sons ayant un sens. Descartes ( 1596-1650), le montre dans sa Lettre au
Marquis de Newcastle (23 nov.1646). Seuls, les hommes ont des pensées qu’ils peuvent
communiquer.
Cette complexité est également due au langage acquis. Par exemple : le mot « entropie »
ouvre sur l'univers, et nous amène à développer des pensées de plus en plus complexes. Ce qui
signifie que la pauvreté de la langue a pour conséquence l'indigence de la pensée. Le
développement intellectuel des hommes est possible grâce à l'acquisition de nouveaux mots (leur
définition impliquant l'acquisition de connaissances et la possibilité de nouveaux questionnements à
partir de là).
LE LANGAGE FONDE UN LIEN ENTRE LES HOMMES ; LA CULTURE EN EST LA
CONSÉQUENCE. L'homme a besoin d'exprimer ses pensées, c'est-à-dire de les extérioriser afin
qu'autrui puisse y avoir accès. Nous savons qu'autrui est comme nous un être conscient. Mais
l'altérité empêche une communication directe entre les consciences : je n'ai pas accès directement à
la conscience d'autrui. Le langage est une médiation entre ma pensée et celle d'autrui.
Le langage fonde la possibilité des échanges. Aristote (-384-322) développe cette idée dans
la Politique. L’homme est un animal sociable à un plus haut degré que les autres espèces vivantes
car il vit en groupe. La nature a doté l’homme de la capacité de parole, qui est liée à la vie
politique : elle permet de parler du juste et de l’injuste. La loi est d’ailleurs un texte, donc du
langage adapté au thème du juste et de l’injuste. C’est au sein de la cité que l’homme accomplit sa
nature.
LE LANGAGE MANIFESTE LA PUISSANCE DE LA PENSÉE. Le langage est moyen
d'action. Si le langage relie les pensées des hommes, comment expliquer les conflits ? Dès
l'Antiquité, Platon (-428-347), dans le Gorgias (-348-347), nous met en garde contre le pouvoir de
la parole. Il oppose Socrate face aux Sophistes : la dialectique (méthode du dialogue, par le jeu des
questions et des réponses, en vue du Vrai et du Bien) face à la rhétorique (art de manier le langage
de manière à convaincre/persuader) et sophistique (utilisation de la rhétorique afin de s'imposer,
sans souci du Vrai, ni du Bien).
Le rhéteur Gorgias (-480-375), dans L'Éloge d'Hélène, montre que le discours est magique
et puissant. La parole peut faire cesser la peur, dissiper le chagrin, exciter la joie, accroître la pitié.
La poésie, qui est un discours marqué par la mesure, accentue ces effets. L'âme est affectée par le
discours. C'est parce que les gens n'ont pas la mémoire du passé, ni la vision du présent, ni la
divination de l'avenir, que le discours a autant de force. ''La plupart du temps, la plupart des gens
confient leur âme aux conseils de l'opinion. Mais l'opinion est incertaine et instable, et précipite
ceux qui en font usage dans des fortunes incertaines et instables.'' Le discours persuasif contraint
l'âme. La persuasion imprime dans l'âme tout ce qu'elle désire. Elle agit telle la drogue sur les corps.
"Dire, c'est faire" : c'est la thèse développée par Austin (1911-1960), dans Quand dire, c'est
faire (1962). Le langage n’est pas qu’un moyen d’action, il est une action. Par le langage, notre
pensée agit sur la réalité. Que signifie le langage banal ? Énoncer c'est agir et produire des effets.
RELIGION (RAISON, VÉRITÉ)
ANALYSE ET PROBLÉMATIQUE. Par "foi", on entend en Occident une adhésion à un
credo, à ce que l'on nomme les vérités de la foi, adhésion qui relève d'un acte de croyance
nécessaire au salut de l'homme. Le domaine de la foi est donc avant tout celui de la religion. Celle-
ci se définit par le besoin de cette croyance en quelque chose : le Sacré immanent ou transcendant.
Croire, c'est poser une chose comme vraie ou fausse, bonne ou mauvaise. Il s'agit notamment de
poser la vérité ou la fausseté de la proposition : "Le Sacré (ou Dieu, selon les religions) existe." Il
est admis que celui qui a la foi est un homme religieux, alors que celui qui ne l’a pas est athée.
Comment expliquer une telle rupture chez les humains ? Les athées accusent les croyants d'être
faibles intellectuellement, d'être irrationnels.
Foi et raison s'opposent-elles ? Peut-on affirmer que celui qui a la foi est irrationnel ? Peut-
on affirmer que la religion est irrationnelle ? Pouvons-nous connaître l'existence du Sacré, de Dieu,
mais également leur nature alors que nous n'en avons aucune expérience, notamment lorsque le
Sacré ou Dieu sont considérés comme transcendants ? Ceci étant dit, dans les religions posant un
Sacré comme immanent, qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit du Sacré, c'est-à-dire de quelque chose qui
doit inspirer un respect absolu, inviolable ? Est-ce bien raisonnable, par exemple, de présenter,
comme le fait le Rig Véda (texte religieux de l'Inde ancienne) la vache comme un animal sacré ?
Nous sommes obligés de nous questionner quant à l'attitude de l'incroyant : qu'est-ce qui
rationnellement lui permet de rejeter les vérités de la foi comme des illusions (parfois jugées
dangereuses) ? Peut-on prouver rationnellement l'inexistence du Sacré ou de Dieu ? Car la raison est
la faculté humaine qui nous permet de distinguer le vrai du faux (et le bien du mal) en passant par
des processus complexes (comme la démonstration, par exemple).
Enfin, nous devons nous questionner sur les capacités intellectuelles de l'homme : comment
pourrions-nous poser qu'il y aurait d'un côté des individus rationnels (car athées) et des individus
irrationnels (car ayant la foi) ? L'homme n'est-il pas universellement rationnel ? Comment un
homme pourrait-il accepter de remettre son esprit à l'arbitraire ? Au fond, n'est-il pas irrationnel de
rejeter la foi ? L'opposition entre les deux signifie-t-elle le rejet de l'une au profit de l'autre ? Ne
doit-on pas plutôt considérer qu'elles sont deux fonctionnements possibles de l'esprit humain ?
Pourquoi l'esprit humain, tant désireux d'atteindre la vérité, serait-il amené à accepter des vérités
non validées par la raison ? Qu'est-ce qui pousse les hommes à croire ? N'oublions pas que la
croyance fait partie des nombreuses capacités de notre esprit.
UN PREJUGÉ : CELUI QUI CROIT SERAIT FAIBLE INTELLECTUELLEMENT. Il
semblerait qu’il y ait faiblesse intellectuelle car les capacités ne donnent pas accès au Sacré, ni à la
transcendance. La transcendance correspond à l’existence d’un être immatériel extérieur au monde
humain et auquel l’homme a accès uniquement par la foi. Il y a donc une différence entre l’homme
et la transcendance, d’où l’idée de Sacré, c’est-à-dire l’idée d’un domaine précieux (valeur
incommensurable), intouchable, inviolable face auquel l’homme doit avoir une attitude de respect
(la piété).
Nos sens ne nous donnent pas accès non plus à un Sacré lié à une immanence. L’immanence
correspond à l’existence d’un être matériel interne au monde humain, mais ayant une particularité,
une supériorité expliquant son statut sacré.
Nous pourrions penser que la raison est plus performante que nos sens. Pourtant, elle ne
nous donne pas accès non plus à la transcendance. Ce domaine immatériel lui semble inaccessible.
Elle n’est pas en mesure de démontrer l’existence de Dieu. Il existe des soi-disant démonstrations
de l’existence de Dieu, mais elles sont mal construites. Elles ressemblent davantage à des
arguments.
LE CROYANT N’EST PAS DÉNUÉ DE RAISON. Le croyant a conscience de la limitation
de la raison, et pourtant il a la foi. Selon Pascal (1623-1662), dans les Pensées, la foi présente des
avantages. Il est dans l’intérêt de l’homme de croire en l’existence d’un Sacré. Son texte s’adresse
notamment aux athées qu’il considère comme condamnés à une existence tragique car c’est une
existence sans Dieu. L’athée est condamné à subir l’angoisse de la mort et du temps qui passe. Ces
angoisses ne peuvent être apaisées que par foi (Dieu infiniment bon et survie de l’âme). Pascal
propose de développer la foi en se concentrant sur Dieu (en éliminant toute source de distraction
pour l’esprit), en espérant découvrir notre foi. En outre, comme les athées sont sensibles à
l’utilisation de la raison pour accéder à une conclusion, Pascal propose l’utilisation du calcul des
probabilités pour montrer que la foi est plus intéressante que l’athéisme. Il y a 4 possibilités : je
crois que Dieu existe et Dieu existe réellement / je crois que Dieu existe et Dieu n’existe pas / je ne
crois pas et Dieu existe / je ne crois pas et Dieu n’existe pas. La première est la plus intéressante car
j’ai tout à gagner (argument du pari, fragment 233). C'est le cœur qui sent Dieu. Le cœur est
l'intuition évidente d'une vérité (et donc une connaissance immédiate) qui n'est pas démontrable.
Les vérités de la foi ne sont pas les vérités de la raison.
D’où l’existence de 2 théologies : révélée et rationnelle. La théologie révélée est un corps de
doctrines relatives au Sacré. La religion révélée est transmise par des prophètes ou des messies, qui
transmettent aux hommes les enseignements divins. La théologie rationnelle se résume en un
système philosophique : il s’agit d’un discours rationnel sur Dieu. On la nomme aussi religion
naturelle.
LE CROYANT A CONSCIENCE DE L’IRRATIONALITÉ DU CONTENU DES
DOGMES, MAIS IL LES ADMET QUAND MÊME. Le Dogme est l'ensemble des contenus
religieux désignés comme la vérité religieuse. Il se présente comme incontestable. Il présente un
certain nombre de miracles, que celui qui a la foi doit accepter. Le miracle est un fait extraordinaire
contraire aux lois de la nature, positif (conforme au plan de Dieu), non explicable scientifiquement
car surnaturel. Il est attribué à une puissance divine. Il adresse aux hommes un signe sensible de sa
présence dans le monde. Le croyant ayant conscience de l’irrationalité des contenus religieux passe
tout de même outre et effectue ce qu'on nomme ''le saut de la foi.'' La foi n’est pas affaire de
conviction rationnelle, mais d’une persuasion intime qui est l’acte décisif de la croyance.
LA RAISON PEUT S’OPPOSER DE FAÇON IRRATIONNELLE À LA FOI : N’ Y A-T-IL
PAS UNE « FOI » DE L’INCROYANT ? La raison ne semble pas en mesure de prouver
l’inexistence de Dieu. Il faudrait démontrer l’existence de la seule matière. Or les scientifiques
admettent l’hypothèse de l’immatérialité. Si l’immatériel existe, cela ne veut pas pour autant dire
que Dieu existe. Il faudrait encore le prouver. C’est la raison pour laquelle l’argument du mal
semble meilleur : comment Dieu, infiniment bon, pourrait-il exister alors qu’il existe tant de mal ?
La raison ne peut pas démontrer l’existence ni l’inexistence de la transcendance. Elle utilise
un détour : si l’on arrive à déterminer l’origine humaine de la religion, alors on prouve qu’elle est
inventée et qu’elle n’est qu’une illusion. L'illusion est une erreur impliquant un enfermement, une
impossibilité de prendre conscience de l’erreur; Ici, l’illusion consisterait à concevoir l’existence de
Dieu comme vraie. Or il est possible de trouver plusieurs raisons qui auraient poussé les hommes à
inventer la religion, car celle-ci aurait une utilité, notamment sociale.
LA FAIBLESSE SOCIALE AURAIT FAIT ÉMERGER LA RELIGION. Cela semble
confirmé par l’étude historique. C'est la théorie de Karl Marx, dans Pour une philosophie du droit
de Hegel (1843) : la religion est présentée comme un remède aux souffrances du peuple (''opium du
peuple''). Les conditions sociales et de travail font que le peuple éprouve une grande angoisse face à
son existence : courte, sans sécurité et dramatique. La religion apporte une consolation : il y a une
vie spirituelle après la mort qui est une éternité de bonheur, à condition de s’être bien comporté (en
fonction des préceptes moraux des textes religieux). Si la société était plus juste et permettait le
bonheur du peuple, celui-ci n’aurait pas besoin de se réfugier dans la religion. Marx considère en
outre que la religion est une illusion car elle affirme l’existence d’une transcendance immatérielle.
Or selon Marx il n’existe de réalité que matérielle.
Certes la religion a une utilité. Mais cela ne prouve pas que Dieu n’existe pas. L’argument
du matérialisme est meilleur, mais il faut le prouver, ce qui n’a toujours pas été fait… Marx rejette
donc la religion de façon irrationnelle.
LA RELIGION APPORTERAIT UNE SOLUTION À LA FAIBLESSE
PSYCHOLOGIQUE. Quand bien même l’organisation politique et économique permettraient de
meilleures conditions de vie sociales et l’élimination de la misère, cela n’ôterait pas toute souffrance
psychologique. Cette faiblesse serait palliée par la religion. D'où la thèse de Freud, exposée dans
L’Avenir d’une illusion (1927) : ''Les idées religieuses (...) sont des illusions, la réalisation des
désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité : (...) le besoin d’être protégé
en étant aimé. L’angoisse humaine en face des dangers de la vie s’apaise à la pensée du règne
bienveillant de la Providence divine, l’institution d’un ordre moral de l’univers assure la réalisation
des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines, et la
prolongation de l’existence terrestre par une vie future fournit les cadres du temps et le lieu où ces
désirs se réaliseront. Des réponses aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces
énigmes : la genèse de l’univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s’élaborent suivant les
prémisses [propositions servant de point de départ à un syllogisme, à une démonstration] du
système religieux.''
Ludwig Feuerbach (1804-1872), propose une théorie plus intéressante encore dans
L’Essence du Christianisme (1841) : la religion serait la projection de désirs humains. L’homme
projette en Dieu les propriétés qu’il juge les plus humaines, mais sous une forme idéalisée. Il peut
se reconnaître en Dieu (il reconnaît dans Dieu ses propres qualités), mais encore s’y perdre (ces
perfections divines renvoient l’homme à ses imperfections d’être fini, à cette incapacité de réaliser
concrètement, à lui seul, l’essence de l’homme). L’amour de l’homme pour Dieu n’est que l’amour
de l’homme pour l’homme.
LA FAIBLESSE SERAIT EXPLOITÉE PAR LA RELIGION QUI AURAIT INTÉRÊT À
L’ENTRETENIR. L’ascétisme est la volonté de contrainte par laquelle le religieux s’efforce de
soumettre sa raison. Comme il est admis que la raison cultive l’amour-propre, il s'agit aussi de se
mortifier, ce qui revient à nier les valeurs de la chair, pour sublimer les valeurs de l’esprit. D’où la
pratique de la pénitence, du jeûne, de la flagellation rituelle. La religion relèverait d’une démission
de la liberté de l’esprit. C’est l’une des critiques que fait Nietzsche (1844-1900).
Le Crépuscule des idoles (1889)
''L’Église combat les passions par l’extirpation radicale : sa pratique, son traitement c’est le
castratisme. Attaquer la passion à sa racine, c’est attaquer la vie à la racine : la pratique de l’Église
est nuisible à la vie… Le même remède, la castration et l’extirpation, est employé instinctivement
dans la lutte contre le désir par ceux qui sont trop faibles de volonté, trop dégénérés pour pouvoir
imposer une mesure à ce désir ; par ces natures qui ont besoin de la Trappe, d’une définitive
déclaration de guerre, d’un abîme entre eux et la passion. Ce ne sont que les dégénérés qui trouvent
les moyens radicaux indispensables ; la faiblesse de volonté, pour parler plus exactement,
l’incapacité de ne point réagir contre une séduction n’est elle-même qu’une autre forme de
dégénérescence. L’inimitié radicale, la haine à mort contre la sensualité est un symptôme grave.''
L’Antéchrist (1895)
''Le Christianisme est la religion de la compassion. La compassion est l’opposé des émotions
toniques qui élèvent l’énergie du sentiment vital. Elle a un effet déprimant. C’est perdre de sa force
que de compatir. La compassion rend la souffrance contagieuse. Elle contrarie la loi de sélection. En
maintenant en vie des ratés et des condamnés elle donne de la vie une image sinistre. Dans la
compassion, c’est la vie qui est niée. La compassion est la praxis du nihilisme. Elle conserve et
multiplie la misère.''
''Je condamne l’Église ; elle est la pire corruption qui soit. (…) Elle vit des misères et elle en crée.
Elle suce tout sang, tout amour, tout espoir de vie, avec son idéal de sainteté anémique. L’au-delà
est la volonté de nier toute réalité. La croix est le signe de reconnaissance de la conjuration contre la
santé, la beauté, la réussite physique, l’audace, l’esprit, la qualité d’âme, contre la vie même…''
FOI ET RAISON NOUS POUSSENT TOUTES DEUX VERS LE BIEN. Si les
religions sont des illusions, nous avons le devoir, au nom de la vérité, de les rejeter. Faut-il préférer
la vérité qui dérange à l’illusion qui réconforte et guide les hommes vers le Bien ? Même si elles
sont des illusions, ne serait-il pas utile de les conserver ?
LA RELIGION COMME INSTRUMENT D’UNIFICATION SOCIALE. L'idée que la
religion est utile socialement est développée par le biais du concept de ''ciment social'' élaboré par
Durkheim (1858-1917), dans De la définition des phénomènes religieux (1912). Il appartient à une
lignée de 8 générations de rabbins. Agnostique, il refuse de devenir rabbin. Agrégé de philosophie,
il se tourne vers la sociologie, et nous propose une définition sociologique de la religion : ''Une
religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-
dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale,
appelée Église, tous ceux qui y adhèrent.'' (Livre I, chap I, § IV). Il complète cela dans Les Formes
élémentaires de la religion (1927) : ''Il ne peut y avoir de société qui ne sente le besoin d’entretenir
et de raffermir, à intervalles réguliers, les sentiments collectifs et les idées collectives qui font son
unité et sa personnalité. Or, cette réfection [action de refaire, de remettre à neuf, de reconstruire]
morale ne peut être obtenue qu’au moyen de réunions, d’assemblées, de congrégations où les
individus, étroitement rapprochés les uns des autres, réaffirment en commun leurs communs
sentiments.''
MORALE SACRÉE ET MORALE LAÏQUE. Si la religion se révèle utile socialement, c'est
parce qu'elle intègre une morale nous poussant au Bien. Mais la laïcisation des États nous amène à
distinguer une morale sacrée d'une morale laïque. La morale se définit par trois caractéristiques : 1)
la distinction du Bien et du Mal, 2) le choix du Bien, 3) l'ensemble de règles permettant de se
diriger vers le Bien. Une morale sacrée a plusieurs caractéristiques : l'universalité, l'origine divine,
la sanction juste, car divine, de toute faute (pas de principe ''pas vu, pas pris''). Le but de la morale
sacrée est le salut de l’âme et la grâce divine. La morale, la politique et la religion ont un but
commun : faire en sorte que l’homme se comporte bien. Foi et raison ne s'opposent donc pas, de ce
point de vue. On peut remarquer des points communs entre, par exemple, les 10 commandements
(ou décalogue) issus de l'Ancien Testament et les règles laïques (et lois politiques) : 7 de ces 10
commandements sont acceptés dans la morale laïque : impact de la religion indépendamment du
désir de laïcité ou universalité du Bien ? Il en va de même pour les 7 péchés capitaux (ils sont dits
tels car à la source d'autres vices) élaborés par Saint Thomas d'Aquin (paresse, avarice, colère,
envie, gourmandise, luxure, orgueil). Il est intéressant de noter que certains des 7 péchés capitaux,
eux, sont valorisés par les sociétés démocratiques de consommation de masse. C’est Abélard qui
distingua le vice (penchant mauvais) du péché (consentement de la volonté au mal).
VÉRITÉ (RAISON, SCIENCE)
INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE. L’homme possède des connaissances sur le
monde et lui-même. Il s’agit d’un ensemble de discours vrais que l’homme formule. La vérité se
définit donc comme la conformité du discours à la réalité.
Comment l’homme accède-t-il à la vérité ? Quels sont les moyens qu’il utilise ? Comment
sait-il que ces discours sont vrais ? Y a-t-il des critères de vérité ? L’idée d’accès à la vérité sous-
entend que l’homme doit franchir des étapes pour obtenir la connaissance : quelles sont-elles ? Dans
l’idéal, l’homme souhaite atteindre la Vérité absolue, c’est-à-dire la certitude concernant toute
chose. Or, comment l’homme pourrait-il accéder à la Vérité absolue alors que certains domaines
(Dieu, l’immatérialité par exemple) lui semblent inaccessibles ?
L’HOMME ACCÈDE À LA CONNAISSANCE GRÂCE À SES FACULTÉS
INTELLECTUELLES ET CORPORELLES. LA VÉRITÉ COMME OBJECTIVITÉ : UN
CRITÈRE ISSU DE LA PERCEPTION. Le point de départ de la connaissance est la perception,
c’est-à-dire la conscience des différentes sensations. Celles-ci sont le résultat de l’exercice des cinq
sens. SENS ----> sensation(s) (données sensorielles empiriques) ----> perception (elle utilise les
sensations pour construire le monde perceptif qui nous est familier, fait d'objets dans un milieu
unifié, l'espace en trois dimensions).
Cette idée fonde l’empirisme, la théorie selon laquelle la connaissance s’acquiert grâce aux
sensations. Racine grecque : empeira, expérience. L'empririsme est aussi défini comme la
connaissance acquise par expérience.
La biologie explique le fonctionnement du système perceptif. Le système nerveux, par le
biais du cerveau, permet le lien entre la pensée et le monde extérieur. Il faut distinguer les cinq sens
(la faculté de perception qui est une faculté corporelle et intellectuelle) et les sensations qui sont le
résultat de l’utilisation du fonctionnement des sens. Les sensations sont des informations sur le
monde extérieur, mais elles n’en fournissent pas la connaissance. Afin de l’obtenir, l’esprit doit
effectuer plusieurs taches, comme par exemple le mot associé à une réalité, ou encore le lien fait
entre les réalités… Les sensations fondent la possibilité de construire des discours sur la réalité.
Elles sont comme des « matériaux » de base pour toute pensée. Il est probable que sans sensation, il
n’y ait pas de pensée.
Denis Diderot (1713-1784), dans la Lettre sur les aveugles (1749), montre que nos
représentations mentales sont liées à nos sens. S'il nous manque un sens (comme la vue), les idées
sont différentes car l'esprit adapte sa capacité de connaître à ses facultés sensorielles. Par exemple,
un voyant peut définir un miroir, mais cette définition n'aurait aucun sens pour un aveugle.
John Locke (1632-1704) est l’un des représentants emblématiques de l’empirisme. Dans son
œuvre Essai philosophique concernant l’entendement humain (1690), il défend la thèse selon
laquelle notre esprit, au départ, est comme une table rase (tabula rasa) que va graver l’expérience
(la connaissance acquise par les sensations). Si la première source de la connaissance est la
sensation, la seconde est la réflexion. Contre Descartes, il affirme qu’il n’y a pas de principes innés
dans l’esprit de l’homme. Nos connaissances ne sont pas gravées naturellement dans l’âme,
puisqu’elles ne sont pas connues des enfants et des idiots. Ce sont les sensations qui fournissent les
premiers matériaux de la pensée.
Selon David Hume, toute connaissance dérive des données sensibles. Toutes les idées, soit
de la mémoire (souvenirs), soit de l'imagination (images) proviennent d'impressions fournies par les
sens. Comment la connaissance humaine peut-elle aller au-delà de ces impressions sensibles ? Par
un jeu propre à notre nature, celui des associations d'idées. Il y a trois sortes d'associations. Notre
imagination peut nous suggérer une réalité absente soit par ressemblance (tel portrait me fait penser
à la personne qui y est représentée), soit par contiguïté spatiale ou temporelle (telle personne me fait
penser à telle autre, parce qu'elles sont souvent ensemble), soit par causalité (la fumée aperçue au
loin me fait penser au feu). On voit que c'est l'habitude dans laquelle nous sommes de joindre telle
idée à telle autre qui assure une stabilité et un minimum de cohérence au sein de notre expérience
quotidienne. Telle est aussi l'origine de ce que nous appelons les lois de la nature. Hume s'intéresse
tout particulièrement au principe de causalité, car il est à l'origine de l'idée de nécessité : à une
certaine température, je sais que l'eau bout et que c'est une loi nécessaire. Mais d'où vient cette loi ?
Pour Hume, à bien y réfléchir, je ne connais réellement que les deux bouts de la chaîne : la
température et l'ébullition, mais je ne sais rien de l'entre-deux. La nécessité que j'attribue au passage
de l'un à l'autre n'est que la force de cette habitude que j'ai de lier les deux idées, et de la probabilité
infiniment faible que la première ne soit pas suivie de la seconde. On voit comment l'empirisme
conduit au scepticisme : la connaissance rationnelle, scientifique, n'est qu'une forme de croyance
parmi d'autres.
La réalité à laquelle nos sens nous donnent accès étant matérielle, l’objectivité est donc une
vérité matérielle.
LA PERCEPTION NE SUFFIT PAS POUR ACCÉDER À LA VÉRITÉ : LA RAISON
EFFECTUE L’ESSENTIEL DU TRAVAIL D’ACCÈS À LA VÉRITÉ. Les philosophes rationalistes
considèrent que les sens sont trompeurs. Il y a une différence entre le monde réel et le monde tel
que nous le percevons (tel que nous nous le représentons). Il est nécessaire de relier les éléments
disparates de la réalité de façon cohérente. C’est le rôle de la raison. Elle est la capacité de
raisonner, d’enchaîner logiquement des pensées. Elle permet d’accéder à ce qui n’est pas
perceptible (par exemple les liens de cause à conséquence, les forces à l’œuvre dans la nature…).
Un raisonnement est le lien entre plusieurs phrases. Mais pour qu'il y ait un raisonnement valide,
ces phrases doivent être reliées correctement ensemble. On dit que leur lien doit être « nécessaire »
(il ne peut pas être autre que ce qu'il est).
La raison fournit un critère de vérité : la cohérence logique ou « validité ». Il s’agit de la
cohérence du discours avec les règles de la raison.
C’est la Logique en tant que science du raisonnement qui énonce les règles de liaison. Elle
est apparue en Grèce antique. Afin d'éliminer certaines ambiguïtés liées au langage, la logique s'est
formalisée, symbolisée. Il y a donc des raisonnement bien construits (logiques, cohérents, valides)
et des raisonnement mal construits (illogiques, incohérents, invalides). Mais il ne suffit pas de bien
raisonner pour accéder à la vérité. Un raisonnement peut être bien construit (valide, cohérent,
logique), mais avoir une conclusion fausse. Cela signifie que l'une des phrases (ou plusieurs ou
toutes) du raisonnement est fausse. Dans ce cas, nous avons un argument. [ARGUMENT :
raisonnement valide, mais dont la conclusion est hypothétique (donc vraie ou fausse, mais
invérifiable). En philosophie, étant donné les thèmes étudiés, on ne peut qu'argumenter. Lorsque le
raisonnement est bien construit et que la conclusion est vraie, il s'agit d'une démonstration.
DÉMONSTRATION : raisonnement bien construit dont la conclusion est vraie. Les mathématiques
accèdent à la démonstration.]
INTUITION INTELLECTUELLE ET ÉVIDENCE. Afin d'obtenir une démonstration
(raisonnement bien construit concluant à la vérité), il est nécessaire que toutes les étapes constituant le
raisonnement soient vraies. Il y a donc une difficulté quant à l'étape fondamentale (le fondement) : celle-ci
doit être vraie. Mais il n'est pas question de démontrer toute phrase, car autrement nous ne ferions que tenter
de démontrer et ferions une sorte de régression à l'infini. Or, il nous faut un point de départ afin d'accéder à
des connaissances et progresser. Soit on demande d'accepter que le fondement est hypothétique. Nous
fondons telle connaissance sur telle hypothèse. Si l'hypothèse se révèle fausse, alors la conclusion qui en est
tirée le sera probablement aussi. C'est le principe de l'histoire des sciences, qui procède par confirmations et
infirmations. Soit le fondement est évident. L'évidence est ce dont on voit la vérité immédiatement, sans
avoir à faire de démonstration.
Descartes affirme que c'est la capacité d'intuition intellectuelle qui nous donnerait accès à ces
évidences. Il semblerait que cette faculté n'ait, en réalité, aucune existence.
TABLEAU RÉCAPITULATIF / Trois moyens de connaître et trois critères :
MOYENS DE CRITÈRES / THÉORIE EXEMPLE DE
CONNAÎTRE TYPES DE PHILOSOPHE
VÉRITÉ
Capacités Vérité formelle, Rationalisme (la Descartes
intellectuelles et validité, cohérence, vérité s'acquiert
surtout la raison logique grâce à la raison)
Sensations Vérité matérielle, Empirisme (la Locke, Epicure
d'adéquation, de connaissance
conformité, s'acquiert grâce aux
objectivité sensations)
Intuition Évidence (ce dont la Intuitionnisme Descartes
intellectuelle vérité se voit) (certaines vérités
s'acquièrent
immédiatement)
AFIN DE TIRER PARTI DE NOS POSSIBILITÉS LA MÉTHODE S’AVÈRE
NÉCESSAIRE. L’homme possède, en théorie, trois moyens d’accéder à la vérité. Comment
expliquer, qu’en pratique, cet accès soit si difficile ? LA NÉCESSITÉ D'UNE MÉTHODE.
Descartes (1596-1650) , dans le Discours de la méthode (1637), nous met en garde : « Le bon sens
est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux mêmes
qui sont les plus difficiles à contenter en toute chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en
ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt cela témoigne que la
puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on nomme le
bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes : et ainsi que la diversité de nos
opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce
que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car
ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. » Une méthode
s’avère nécessaire : elle consiste à conduire efficacement ses pensées afin d’atteindre la certitude.
Descartes la distingue de la vérité, car la certitude est l’assurance que nous avons atteint la vérité. Il
propose notamment un principe de départ qui est de rejeter comme absolument faux tout ce qui est
douteux. Il faut donc commencer par trier nos pensées : nous pouvons conserver celles qui sont
certaines et rejeter celles qui sont incertaines. Cela permet de lancer la recherche de la vérité. Il
accède à une première certitude : « je pense, donc je suis » (une chose qui pense). Il veut déterminer
comment l’esprit accède à la certitude de cette phrase. Or c’est parce qu’elle est évidente. Donc
l’évidence devient critère de vérité. Or elle n’est pas liée aux sensations ni à la raison. C’est
l’intuition (troisième faculté intellectuelle permettant l’accès à la vérité) qui permet l’évidence.
Descartes applique la méthode des mathématiques qui prend pour point de départ des évidences sur
lesquelles tout le reste est construit. En philosophie, c’est le cogito qui sert de fondement. Il énonce
4 préceptes : « Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je la connusse
évidemment être telle » (règle de la clarté et de la distinction, est vrai ce qui est évident, càd clair et
distinct). Ce que c'est qu'une perception claire et distincte est défini dans les Principes de la
Philosophie, I, articles 43 et 45 : « [...] la connaissance sur laquelle on peut établir un jugement
indubitable doit être non seulement claire, mais aussi distincte. J'appelle claire celle qui est présente
et manifeste à un esprit attentif ; de même que nous disons voir assez fort, et que nos yeux sont
disposés à les regarder ; et distincte, celle qui est tellement précise et différente de toutes les autres,
qu'elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut. »
« Le second de diviser chacune des difficultés que j’examinerais en autant de parcelles qu’il se
pourrait » (diviser les difficultés) « Le troisième de conduire par ordre mes pensées, en commençant
par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître (…) jusques à la connaissance des plus
composés »(aller du plus simple vers le plus complexe) « Et le dernier de faire partout des
dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de rien omettre. » (tout
prendre en compte)]
Une méthode est l’organisation de l’utilisation des facultés. Elle permet l’efficacité et la
fécondité (la capacité à accéder à des connaissances) car elle permet de tirer le meilleur parti de
notre potentiel et de corriger les défauts de la perception et du raisonnement.
QUATRE MÉTHODES PARTICULIÈREMENT FÉCONDES :
1) La mathématisation, le protocole expérimental, le recours à la technique (instruments
divers), le recours à l'informatique. La mathématisation permet le perfectionnement de la
démonstration, en coopération avec la Logique. La rigueur de la démonstration permet
d’accéder à la certitude.
2) Elle est une partie du protocole expérimental en sciences de la nature puisqu’elle est liée à la
construction théorique et à l’émission de lois. Elle se construit à partir d’observations
particulières : l’esprit construit une universalisation cohérente des phénomènes particuliers
et concrets. Puis l’esprit conçoit la phase expérimentale : quelle expérience (passant donc
par le recours à la perception et la réalité concrète) pourrait-on concevoir nous permettant
de vérifier la vérité de la construction théorique ? Galilée (1564-1642) est l’inventeur de la
physique mathématique et expérimentale. L’apport de cet homme a donné une très grande
fécondité concernant la connaissance du monde. Il a conçu de très ingénieuses expériences
dites de laboratoire (expériences conçues intellectuellement et n’étant pas de simples
observations), comme celle du plan incliné qui avait pour but de vérifier la possibilité
théorique d’un double mouvement de rotation de la Terre (Galilée défendait la thèse
héliocentrique).Mais l’histoire des sciences a montré qu’il était toujours possible de créer
une expérience prouvant la construction théorique. D’où l’idée de méthode de Karl Raimund
Popper (1902-1994) : le caractère distinctif d’une théorie scientifique n’est pas sa
vérifiabilité, mais au contraire sa falsifiabilité : la possibilité de voir l’expérimentation la
démentir. Une théorie qui a résisté victorieusement aux contrôles qui auraient pu la réfuter
est confirmée, mais cela ne signifie pas qu’elle est vérifiée. (La logique de la découverte
scientifique, 1934 / Misère de l'historicisme, 1944 : la science procède par rejet
d'hypothèses. Une théorie est jugée plus féconde à sa capacité à rendre compte d'un grand
nombre de phénomènes (phénomènes terrestres, cosmiques) et à sa prédictivité.
3) Dans le domaine de l’observation et de l’expérimentation, la technique a montré son
efficacité. Elle est un palliatif à la faiblesse et à la limitation des sens. Elle a permis l’accès à
de nombreuses découvertes décisives dans l’accès à la vérité, comme par exemple celle de la
cellule et de l’A.D.N., grâce au microscope.
4) Le recours à l'informatique permet à l'homme d'aller plus loin dans ses recherches et calculs.
Certaines données sont inaccessibles à l'esprit humain, notamment certains calculs. Il est un
palliatif à la faiblesse humaine. Par exemple, un logiciel est indispensable pour comprendre
l'origine du monde et calculer la probabilité d'apparition de la vie.
SCIENCE (RAISON, VÉRITÉ)
ANALYSE ET PROBLÉMATIQUE : de l'antiquité et jusqu'au XIXe siècle, la science
désigne une connaissance universelle, distincte de l'opinion. Aujourd'hui c'est un type de
connaissance discursif établissant des relations ou des lois nécessaires. La science a pour but de
produire un savoir, c’est-à-dire un ensemble de connaissances relatives à un champ d’investigation
particulier (le vivant, la société, le relief…), par le détour d’une méthode d’investigation propre à
chacun de ces champs. Par exemple : la démonstration en mathématiques, par l’expérimentation en
physique ou encore par le biais d’une enquête en histoire. Ces connaissances ne sont donc pas
immédiates, simplement délivrées par nos sens : les sciences produisent une connaissance du monde
en s’appuyant sur des règles, des principes, des lois, ou, mieux, des démonstrations quand cela est
possible. Ce sont les scientifiques qui produisent ces règles, principes, lois.
Il existe une distinction entre trois grandes classes de sciences (« Formelles », « Nature »,
«Humaines et Sociales »), car elles ne portent pas sur les mêmes objets et d’autre part, par le degré
de certitude et de nécessité à l’œuvre dans les lois, principes ou connaissances produites par
chacune de ces classes.
La philosophie se propose de réfléchir aux conditions de possibilités de ces mêmes
connaissances : c’est le domaine de l’épistémologie, domaine partagé par les philosophes et les
scientifiques. Elle a à voir avec notre faculté à exercer une analyse critique plutôt qu’à répondre
spontanément -et donc de manière irréfléchie- aux questions que l’on se pose. Plus encore, sans la
raison, l’ensemble des phénomènes resterait pour nous inintelligible, incompréhensible. La raison
est donc un pouvoir, une lumière qui éclaire le monde et qui nous permet ainsi de lever l’obscurité.
C’est pourquoi on parle aussi des philosophes des Lumières à propos du courant rationaliste qui
apparaît dès le XVIIè siècle pour se développer durant le XVIIIè.
LA CONSTRUCTION DU FAIT SCIENTIFIQUE. Selon Gaston Bachelard, dans La
Formation de l'esprit scientifique (1938), l'hypothèse provoque l'expérience «Rien ne va de soi.
Rien n'est donné. Tout est construit.»
Claude Bernard, dans l' Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865) montre
que la démarche hypothético-déductive est celle la plus couramment utilisée par les chercheurs,
c'est la démarche classique de la science moderne. Elle se compose des étapes suivantes : 1) le
chercheur constate un fait, 2) à propos de ce fait, une idée naît dans son esprit, 3) en vue de cette
idée, il raisonne, institue une expérience, en imagine et en réalise les constitutions matérielles, 4) de
cette expérience résultent de nouveaux phénomènes qu'il faut observer, et ainsi de suite.
L’hypothèse n'est pas une simple conjecture, mais une explication intelligible. Elle relève de
l’imagination, mais de l’imagination rationnelle : le savant risque une explication audacieuse, qui
propose une hypothèse imprévue. L’hypothèse est donc un effort de l’intelligence pour résoudre la
contradiction posée par le problème. L'hypothèse est un effort pour comprendre (prendre ensemble)
tous les faits, pour les systématiser. Le processus de vérification, quant à lui, marque le retour de
l’esprit à l’expérience. Mais c’est l’hypothèse qui provoque et dirige l’expérience . L’activité de la
raison dans la méthode expérimentale apparaîtra mieux encore dans les cas où l’hypothèse ne peut
être soumise directement à la vérification, dans les cas où la vérification de l’hypothèse n’est
possible que par la médiation d’une déduction. C’est de cette manière que Pascal vérifie l’hypothèse
de la pression atmosphérique formulée par Torricelli : [hypothèse] si vraiment c’est la pression
atmosphérique qui explique que l’eau dans les pompes vides ne monte qu’à 10,33 m, que le mercure
dans le tube à mercure ne monte qu’à 76 cm, [déduction] alors la hauteur du mercure dans le tube
devrait diminuer en raison directe de l’altitude (en même temps que le poids de la colonne d’air).
De l’hypothèse Pascal a déduit une conséquence. C’est un raisonnement de type hypothético-
déductif comme les raisonnements que nous avons rencontrés en mathématiques. Seulement, tandis
qu'en mathématiques le raisonnement hypothético-déductif se suffit à lui- même, dans les sciences
de la matière ce raisonnement est intégré à l'expérimentation dont il ne constitue qu’une étape. La
conséquence déduite de l’hypothèse doit être prouvée par l’expérience.
SCIENCE ET TECHNIQUE. L'expérience dépend de l'instrument qui la rend possible «les
instruments ne sont que des théories matérialisées» selon Gaston Bachelard (Le nouvel esprit
scientifique, 1938). Trop souvent, pour le sens commun, l’observation scientifique est considérée
comme une attitude passive, où le savant ne ferait que constater ce qui s’imposerait à ses sens. « Les
faits parlent d’eux-mêmes » a-t-on coutume de dire, comme si le réel se livrait de lui-même à
l’élucidation du savoir. La perception immédiate, loin d’être la clef de la science, comme le croient
les empiristes, a fait longtemps échec aux progrès de la science. L’observation empirique n’est pas
la source de la science mais c’est un obstacle à la connaissance scientifique. C’est ce que Bachelard
appelle un «obstacle épistémologique». Dans l’épistémologie moderne de Bachelard, les données
de l’expérience ne sont jamais données spontanément, mais sont construites grâce à certains
instruments (par exemple, le calcul de la trajectoire d'une comète dépend de la précision du
télescope qu'on utilise). Les instruments eux-mêmes ne sont construits par le scientifique pour tester
une théorie qu'il a élaborée avant même que les faits qu'il décrit n’aient été rendus sensibles. D’où
l’idée que l’instrument matérialise une théorie : pour l’inventer, il fallait que la théorie ait déjà
prévu la possibilité des données qu'elle voulait tester. La réalité scientifique n’est donc pas la réalité
spontanément et passivement observée. C’est une réalité construite. Le fait n’a de signification
scientifique que lorsqu’il est transposé de façon à pouvoir nous livrer des caractéristiques
objectives, mesurables.
UNE VÉRITÉ EST TOUJOURS PARADOXALEMENT TEMPORAIRE : « pouvoir être
testé, c'est pouvoir être réfuté » selon Karl Popper, dans Conjectures et réfutations (1953). C'est à
cet effort que nous invite Karl Popper, à travers son concept de falsifiabilité. Logicien et philosophe
des sciences , Popper affirme que le critère de la scientificité d'une théorie n'est pas dans son
caractère vérifiable mais dans sa falsifiabilité c'est-à-dire le fait qu'elle peut être réfutée. Il s'en suit
que pour lui aucune théorie n'est vraie, mais seulement et provisoirement non réfutée. D'où l'idée
d'histoire et de progrès des sciences.
Gaston Bachelard est l’un des premiers à avoir montré que les vérités scientifiques
progressent sans s’annuler, préservant en elles une forme d’immuabilité. Ainsi la physique de
Newton et ses lois sur la gravitation n’a pas été annulée par celle, plus récente d’Einstein, sur la
relativité, mais incluse en elle. Le progrès en physique procède par emboîtement successif de
théories, où des théories toujours plus vastes embrassent des théories antérieures.
Le principe qui commande tout l'effort de la science et de la philosophie rationaliste, c'est
que le monde est intelligible. On peut bien sûr voir cela comme un POSTULAT (on demande
d'accepter comme vrai ce principe), comme le fait Einstein. Bertrand Russell remarque lui aussi
qu'à vouloir tout fonder rationnellement, on perpétue l'idée d'un caractère définitif et absolu de la
vérité, qui n'est paradoxalement pas loin d'être de l'ordre du religieux. Il nous appelle donc à être
plus prudent et à renoncer à l'idée de vérité absolue pour lui préférer l'idée de vérités "techniques",
qui se caractérisent par leur caractère opératoire, à travers la prédiction d'une trajectoire par
exemple. Une telle conception permet d'échapper à une conception absolutiste de la vérité mais
aussi relativiste. Elle permet d'affirmer en effet que toutes les opinions ne se valent pas, que
certaines sont plus efficaces que d'autres ce qui doit nous inciter à toujours rechercher la vérité, à en
améliorer toujours la formulation.
Vous aimerez peut-être aussi
- Ethique À Nicomaque Présentation Des Quatre Premiers LivresDocument3 pagesEthique À Nicomaque Présentation Des Quatre Premiers Livreszamouradam0Pas encore d'évaluation
- La liberté (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLa liberté (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Epicurisme Et StoicismeDocument2 pagesEpicurisme Et StoicismeIsak ValtersenPas encore d'évaluation
- Le bonheur (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLe bonheur (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Chapitre 9Document26 pagesChapitre 9delanautakou38Pas encore d'évaluation
- Le devoir (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLe devoir (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- LibertéDocument10 pagesLibertézarroug zarrougPas encore d'évaluation
- La justice et le droit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLa justice et le droit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Fiche BonheurDocument2 pagesFiche BonheurLille bbPas encore d'évaluation
- BONHEUR RévisionDocument1 pageBONHEUR RévisionChachaPas encore d'évaluation
- Bonheur Et Devoir Cours EntierDocument10 pagesBonheur Et Devoir Cours EntierRaphaël MenahezePas encore d'évaluation
- La Morale, Le Devoir Et Le Bonheur - Cours de Philosophie en Terminale Scientifique Et TechnologiqueDocument9 pagesLa Morale, Le Devoir Et Le Bonheur - Cours de Philosophie en Terminale Scientifique Et TechnologiqueAdnane KarmouchPas encore d'évaluation
- Expose de Philosophie Sur La LiberteDocument8 pagesExpose de Philosophie Sur La Libertekarim traorePas encore d'évaluation
- Unité 5Document11 pagesUnité 5Camila GuevaraPas encore d'évaluation
- Etat LiberteDocument5 pagesEtat Libertebertoade7718Pas encore d'évaluation
- Des Sujets de Philosophie CorrigesDocument34 pagesDes Sujets de Philosophie CorrigesSamry dyijPas encore d'évaluation
- La LibertéDocument11 pagesLa Libertéjacquelourdes34Pas encore d'évaluation
- Le DevoirDocument20 pagesLe DevoirHector Ignacio RODRIGUEZ ALVAREZPas encore d'évaluation
- Cours Sur Le BonheurDocument4 pagesCours Sur Le BonheurApisek Senthilkumar100% (1)
- SUJETS Philosophie corrigé-WPS OfficeDocument37 pagesSUJETS Philosophie corrigé-WPS OfficeAlexis Yogo75% (4)
- Bonheur ReperesDocument4 pagesBonheur ReperesdinamoueliseePas encore d'évaluation
- Peut-On Vouloir Le Bonheur Des AutresDocument5 pagesPeut-On Vouloir Le Bonheur Des AutresjuliettePas encore d'évaluation
- Cours AxiologieDocument4 pagesCours AxiologieMamadou Moustapha Sarr67% (3)
- Notion 5 - Le DevoirDocument5 pagesNotion 5 - Le DevoirBlanca VelazquezPas encore d'évaluation
- CH3 - Le Désir Constitue-T-Il Un Obstacle Au BonheurDocument11 pagesCH3 - Le Désir Constitue-T-Il Un Obstacle Au BonheurPsukhePas encore d'évaluation
- Ethique À Nicomaque Résumé DétailléDocument14 pagesEthique À Nicomaque Résumé Détailléd13jm71% (7)
- Ethique Et Bonheur SalomonDocument3 pagesEthique Et Bonheur Salomon6kzpk7c75xPas encore d'évaluation
- Cours Sur La LibertéDocument10 pagesCours Sur La Libertédrover.lobster0zPas encore d'évaluation
- FrenchDocument3 pagesFrenchPeachy AestheticPas encore d'évaluation
- Le BonheurDocument3 pagesLe BonheurCalista PIRIS FERNANDESPas encore d'évaluation
- Expose de PhilosophieDocument7 pagesExpose de Philosophiekarim traorePas encore d'évaluation
- Que Gagne-T-On À Être JusteDocument2 pagesQue Gagne-T-On À Être JusteHélia KarimiPas encore d'évaluation
- Fiches BaccalauréatDocument10 pagesFiches BaccalauréatHéloise VenayrePas encore d'évaluation
- 18 - Le Bonheur Et Le DevoirDocument42 pages18 - Le Bonheur Et Le Devoircornholio68cornholioPas encore d'évaluation
- Sijet Et CorrigesDocument23 pagesSijet Et Corrigesladjibamba0767Pas encore d'évaluation
- Je Veux - de La VolontéDocument4 pagesJe Veux - de La Volontéthierry raffinPas encore d'évaluation
- HttpwwwneotrouvecomLa Decouverte NeoTech Pouvoir Zon de Franck WallaceDocument227 pagesHttpwwwneotrouvecomLa Decouverte NeoTech Pouvoir Zon de Franck WallaceNe1am100% (2)
- Chapitre 3 - La Liberté, Volonté Et CaractèreDocument3 pagesChapitre 3 - La Liberté, Volonté Et Caractèrehugogilberte1202Pas encore d'évaluation
- Le Devoir - Imperatif - Kant - WDocument15 pagesLe Devoir - Imperatif - Kant - WMehdi JerjiniPas encore d'évaluation
- Dissertation Avec Textes - Le Bonheur Est-Il Une Affaire PrivéeDocument2 pagesDissertation Avec Textes - Le Bonheur Est-Il Une Affaire Privéemanel rhPas encore d'évaluation
- Ethique de La Gouvernance 2Document4 pagesEthique de La Gouvernance 2Dylan KramohPas encore d'évaluation
- Le Bonheur Est Il Une Affaire de RaisonDocument3 pagesLe Bonheur Est Il Une Affaire de RaisonFélicia MartinsPas encore d'évaluation
- Synthèse BonheurDocument3 pagesSynthèse Bonheur00.glazes-rapiers100% (1)
- La Liberte Mene T Elle Necessairement Au BonheurDocument4 pagesLa Liberte Mene T Elle Necessairement Au BonheurDamien BoyavalPas encore d'évaluation
- 0 Inquiétude Morale 11122010Document5 pages0 Inquiétude Morale 11122010mimolocmicPas encore d'évaluation
- EpictèteDocument4 pagesEpictèteInés AmchterPas encore d'évaluation
- PhiloDocument4 pagesPhiloflorian.kazusPas encore d'évaluation
- Tle Philo L4 La Vie en SociétéDocument10 pagesTle Philo L4 La Vie en SociétéRODJA CYBERPas encore d'évaluation
- Révision PhiloDocument98 pagesRévision PhiloMehdi EssoulimaniPas encore d'évaluation
- SPINOZA (Récupération Automatique)Document11 pagesSPINOZA (Récupération Automatique)ejager045Pas encore d'évaluation
- Consequentialism FRDocument36 pagesConsequentialism FRdelanautakou38Pas encore d'évaluation
- Devoir Du MoisDocument6 pagesDevoir Du MoisCyrius AHOUANDJIPas encore d'évaluation
- Fiche Morale Devoir BonheurDocument6 pagesFiche Morale Devoir BonheurElisa GuerreroPas encore d'évaluation
- Toutes Les Questions Et Réponses Philosophie BacDocument24 pagesToutes Les Questions Et Réponses Philosophie BacClaire Ems100% (1)
- Liberté Cours PhiloDocument7 pagesLiberté Cours PhiloYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- NotionsDocument4 pagesNotionsTrash CanPas encore d'évaluation
- Fiches MoraleDocument11 pagesFiches MoraleFrank SeguePas encore d'évaluation
- Racial-Vitalisme PDF v.2Document370 pagesRacial-Vitalisme PDF v.2Jean BuissonPas encore d'évaluation
- Est-Il Immoral D'être Heureux ?Document4 pagesEst-Il Immoral D'être Heureux ?Sarah BelaouniPas encore d'évaluation
- Mini Manuel de GénétiqueDocument269 pagesMini Manuel de Génétiquefadel yasminePas encore d'évaluation
- Parasites Et AdaptationDocument42 pagesParasites Et AdaptationTeary EggyPas encore d'évaluation
- Le Jeu Des Possibles - Franà Ois JacobDocument119 pagesLe Jeu Des Possibles - Franà Ois Jacobathamos100% (2)
- La Logique Du Vivant PDFDocument22 pagesLa Logique Du Vivant PDFAnonymous PSO0vRfPas encore d'évaluation
- La Connerie Artificielle - PDFDocument9 pagesLa Connerie Artificielle - PDFVerdoPas encore d'évaluation
- Bonheur: (Nature Humaine, Raison)Document39 pagesBonheur: (Nature Humaine, Raison)Lorine DmciPas encore d'évaluation
- Planning Et Estimation Des Projets STA 2-1-1Document86 pagesPlanning Et Estimation Des Projets STA 2-1-1Merveille AizannonPas encore d'évaluation
- Correction Question de Synthèse Critères de BeautéDocument6 pagesCorrection Question de Synthèse Critères de BeautéMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Ecologie Comportementale Cours Et Questions de Réflexion.Document13 pagesEcologie Comportementale Cours Et Questions de Réflexion.djaouad bourouaisPas encore d'évaluation
- Swinburne - Y A-T-Il Un Dieu ? Chapitre 4Document11 pagesSwinburne - Y A-T-Il Un Dieu ? Chapitre 4vordevanPas encore d'évaluation
- Cazorla-Detection Jeunes TalentsDocument47 pagesCazorla-Detection Jeunes TalentsYacine IdbahsinePas encore d'évaluation
- Cours AIDocument60 pagesCours AIFifi JojoPas encore d'évaluation
- 1978 Anthropologie GnostiqueDocument124 pages1978 Anthropologie GnostiqueChristian KABAMBIPas encore d'évaluation
- La Phalène Du Bouleau Et La Reproduction SexuéeDocument5 pagesLa Phalène Du Bouleau Et La Reproduction SexuéeFadhel SlamaPas encore d'évaluation
- Utilisation Des Methodes D'aide A La Decision Pour Le Diagnostique Des Huiles de TransformateurDocument5 pagesUtilisation Des Methodes D'aide A La Decision Pour Le Diagnostique Des Huiles de TransformateurBrahim CherfaPas encore d'évaluation
- Phénoménologie de La Vie Animale PDFDocument4 pagesPhénoménologie de La Vie Animale PDFMaximePas encore d'évaluation
- Examen de Juin en Biologie CorrigeDocument12 pagesExamen de Juin en Biologie Corrigelaurent2101Pas encore d'évaluation
- Dossier Pour La Science N°14 - 1997-01..03 - L'évolutionDocument144 pagesDossier Pour La Science N°14 - 1997-01..03 - L'évolutionDaniel CaillouxgratosPas encore d'évaluation
- HARUN YAHYA - French - LES PREUVES DE DEVOUEMENT DANS LE REGNE ANIMAL REVELENT L'ŒUVRE D'ALLAHDocument61 pagesHARUN YAHYA - French - LES PREUVES DE DEVOUEMENT DANS LE REGNE ANIMAL REVELENT L'ŒUVRE D'ALLAHmehdiPas encore d'évaluation
- Nature HumaineDocument5 pagesNature HumaineJacky SawPas encore d'évaluation
- 2.8.sociobiologie DiasDocument72 pages2.8.sociobiologie Diasmohamed outalebPas encore d'évaluation
- Daniel Madrasse - La Souffrance Et Le Moyen Dy Mettre FinDocument189 pagesDaniel Madrasse - La Souffrance Et Le Moyen Dy Mettre FinTimePas encore d'évaluation
- Evolution Des Etres Vivants Et Histoire de La TerreDocument9 pagesEvolution Des Etres Vivants Et Histoire de La TerreEddir BelmPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°2 Lycée Pilote - SVT - Bac Sciences Exp (2011-2012) MR Ezzeddini Mohamed PDFDocument4 pagesDevoir de Contrôle N°2 Lycée Pilote - SVT - Bac Sciences Exp (2011-2012) MR Ezzeddini Mohamed PDFفوزيسوالميPas encore d'évaluation
- Stabilité Et Variabilité Des Génomes Et Évolution 2 PDFDocument8 pagesStabilité Et Variabilité Des Génomes Et Évolution 2 PDFMANERERPas encore d'évaluation
- Dehasse - Le Chien Agressif - 2008Document347 pagesDehasse - Le Chien Agressif - 2008Stana BatinovićPas encore d'évaluation
- Note de CoursDocument25 pagesNote de Courselena.rids135Pas encore d'évaluation
- 5-Quel Avenir Amelioration Plantes 2742000755 ContentDocument74 pages5-Quel Avenir Amelioration Plantes 2742000755 ContentLÿ DîePas encore d'évaluation
- L'Être Subconscient DR E (... ) Géley Gustave Bpt6k77243xDocument201 pagesL'Être Subconscient DR E (... ) Géley Gustave Bpt6k77243xgussviiPas encore d'évaluation
- Jeunesse africaine: jeunesse sacrifiée?D'EverandJeunesse africaine: jeunesse sacrifiée?Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5)
- Aimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableD'EverandAimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- La Franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes: Édition intégrale des trois volumes : Vol. 1 : L'Apprenti - Vol. 2 : Le Compagnon - Vol. 3 : Le Maître -D'EverandLa Franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes: Édition intégrale des trois volumes : Vol. 1 : L'Apprenti - Vol. 2 : Le Compagnon - Vol. 3 : Le Maître -Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Magnétisme Personnel ou Psychique: Éducation de la Pensée, développement de la Volonté, pour être Heureux, Fort, Bien Portant et réussir en tout.D'EverandMagnétisme Personnel ou Psychique: Éducation de la Pensée, développement de la Volonté, pour être Heureux, Fort, Bien Portant et réussir en tout.Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveD'EverandLa Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (12)
- Vocabulaire du franc-maçon: Petit lexique des termes et abréviations maçonniques courantesD'EverandVocabulaire du franc-maçon: Petit lexique des termes et abréviations maçonniques courantesPas encore d'évaluation
- La matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome VIII. L'effet du Souffle des Ténèbres sur les Eaux primordiales. La Pensée divine en Mouvement de dedans en dehors.D'EverandLa matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome VIII. L'effet du Souffle des Ténèbres sur les Eaux primordiales. La Pensée divine en Mouvement de dedans en dehors.Pas encore d'évaluation
- Gestion des déchets solides urbains: aperçu, concepts, applications et perspectivesD'EverandGestion des déchets solides urbains: aperçu, concepts, applications et perspectivesPas encore d'évaluation
- Ce que doit savoir un Maître Maçon (Annoté): Les Rites, l'Origine des Grades, Légende d'HiramD'EverandCe que doit savoir un Maître Maçon (Annoté): Les Rites, l'Origine des Grades, Légende d'HiramÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- L'entretien de recherche qualitatif, 2e édition: Théorie et pratiqueD'EverandL'entretien de recherche qualitatif, 2e édition: Théorie et pratiquePas encore d'évaluation
- Les cent faits divers les plus fous de 2017D'EverandLes cent faits divers les plus fous de 2017Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsablesD'EverandGuide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsablesPas encore d'évaluation
- La volonté de Puissance: Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Études et Fragments)D'EverandLa volonté de Puissance: Essai d'une transmutation de toutes les valeurs (Études et Fragments)Pas encore d'évaluation
- Transformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitD'EverandTransformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (14)
- NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression et violence d'État au Canada: Esclavage, répression et violence d'État au CanadaD'EverandNoirEs sous surveillance. Esclavage, répression et violence d'État au Canada: Esclavage, répression et violence d'État au CanadaPas encore d'évaluation
- Les partis politiques français: Attention dangerD'EverandLes partis politiques français: Attention dangerÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Mémento 13e degré du R.E.A.A.: Paroles de Chevalier de Royal-ArcheD'EverandMémento 13e degré du R.E.A.A.: Paroles de Chevalier de Royal-ArcheÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Histoire de la psychologie scientifique: De la naissance de la psychologie à la neuropsychologie et aux champs d'application les plus actuelsD'EverandHistoire de la psychologie scientifique: De la naissance de la psychologie à la neuropsychologie et aux champs d'application les plus actuelsPas encore d'évaluation
- Anges & Jinn; Qui sont-ils?: Série sur les Connaissances Islamiques des EnfantsD'EverandAnges & Jinn; Qui sont-ils?: Série sur les Connaissances Islamiques des EnfantsPas encore d'évaluation
- Pour un développement de l'approche psychosociale dans les projets de solidarité internationale: Retours d’expériences au RwandaD'EverandPour un développement de l'approche psychosociale dans les projets de solidarité internationale: Retours d’expériences au RwandaÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Coronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTD'EverandCoronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTPas encore d'évaluation
- Hygge: L'art Danois de Créer des Habitudes de Confort, de Joie et de Bonheur (Comprend des Activités, des Recettes et un Défi Hygge de 30 Jours)D'EverandHygge: L'art Danois de Créer des Habitudes de Confort, de Joie et de Bonheur (Comprend des Activités, des Recettes et un Défi Hygge de 30 Jours)Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (6)
- 101 Choses À Savoir Sur Le Sexe Et Sa Vie Intime: Le Sexe Dont Vous Avez Toujours RêvéD'Everand101 Choses À Savoir Sur Le Sexe Et Sa Vie Intime: Le Sexe Dont Vous Avez Toujours RêvéPas encore d'évaluation
- Témoins de Jéhovah et Franc-Maçonnerie : l'enquête vérité: Inclus : l'histoire du nom JéhovahD'EverandTémoins de Jéhovah et Franc-Maçonnerie : l'enquête vérité: Inclus : l'histoire du nom JéhovahPas encore d'évaluation