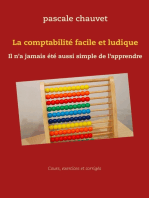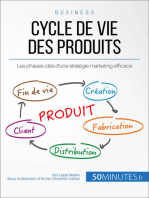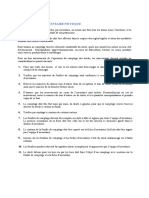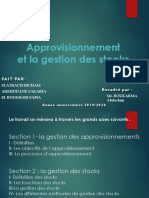Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
9.audit Des Stocks
9.audit Des Stocks
Transféré par
Najoua BenqTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
9.audit Des Stocks
9.audit Des Stocks
Transféré par
Najoua BenqDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
I. STOCKS : DEFINITION, HIERARCHIE ET POLITIQUE D APPROVISIONNEMENT 1. DEFINITION DES STOCKS : Stocker, c'est engager des dpenses pour acqurir des biens qui ne produiront des revenus qu'ultrieurement. La norme comptable dfinit les stocks comme l ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d exploitation de l entreprise pour tre :
Soit vendus en l tat ou au terme du processus de production venir ou encours. Soit consomms en premier usage.
Ils sont composs de marchandises, matires premires et matires consommables, produits intermdiaires, produits rsiduels, produits en-cours, emballages qui sont la proprit de l entreprise.
Est considre comme marchandise au sens de la norme, tout ce que l entreprise achte pour Le revendre en l tat. Les matires premires sont des objets et des substances plus ou moins labors, ils sont destins entrer dans la composition des produits traits ou fabriqus. Les matires et fournitures consommables sont constitues par tous produits, matires, substances ou fournitures acquis par l entreprise, qui concourent par leur consommation la fabrication, au traitement ou l exploitation sans entrer dans la composition des produits traits ou fabriqus.
Les emballages sont des objets destins contenir les produits ou marchandises et livrs la clientle en mme temps que leur contenu.
Les emballages en stocks comprennent :
les emballages non rcuprables (emballages perdus), les emballages susceptibles d tre provisoirement conservs par les tiers et que l entreprise
qui les livre s engage les reprendre dans des conditions dtermines condition que ces emballages ne soient pas commodment identifiable unit par unit. Dans le cas contraire, ces emballages constituent des immobilisations (compte 2333)
Les produits en-cours sont des biens ou services non achev la date de clture de l exercice. Les produits intermdiaires sont ceux ayant atteint un stade d achvement mais destins normalement entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Les produits rsiduels, comprennent les dchets et rebuts de fabrication et par extension, les produits finis et les produits intermdiaires invendable ou inutilisables en tant que tel. Les produits finis correspondent aux biens et services qui ont atteint un stade d achvement dfinitif dans le cycle de production.
2. HIERARCHIE DES PRODUITS Il existe une hirarchie des produits ncessaires l'activit, une classification en fonction de leur prix, des quantits utilises, de leur frquence d'utilisation, des quantits minimales d'achat, des dlais, etc. Une classification commode est la classification ABC, base sur le principe de la loi des 20/80 de Pareto. Par exemple ;
Classe A : produits trs chers, rares, dlais longs Classe B : produits moyennement chers, disponibilit alatoire sur le march Classe C : produits courants, peu chers
Il est clair qu'en fonction de sa classe, chaque produit aura un mode de gestion spcifique. 3. POLITIQUE DE REAPPROVISIONNEMENT Dfinir une politique de rapprovisionnement consiste essentiellement rpondre trois questions :
QUOI (quel produit) faut-il rapprovisionner ? QUAND faut-il rapprovisionner ? COMBIEN faut-il rapprovisionner ? Date ou quantit FIXE. Date ou quantit VARIABLE.
En fonction du QUOI ? Les choix suivants se prsentent :
Suivant les combinaisons des rponses, il est donc possible de dfinir quatre politiques de base pour rapprovisionnement du stock 1 - Rapprovisionnement Date et Quantit fixes Dite aussi mthode "calendaire", les livraisons de pices se font dates fixes. Les quantits livres sont gales et peuvent se rapprocher de la "quantit conomique" ou correspondre une livraison partielle d'un contrat annuel.
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
2 - Rapprovisionnement Date fixe et Quantit variable Egalement appele mthode de recompltement, pour chaque produit un niveau optimum de stock est dfini. A priode fixe, le magasinier analyse son stock et commande la quantit permettant de recomplter au niveau requis. Il est possible de faire des priodes d'inventaire ou d'analyse, diffrentes suivant les catgories de produits. 3 - Rapprovisionnement Date variable et Quantit fixe Plus connue sous le nom de mthode du point de commande, celle-ci consiste dfinir, dans un concept de flux tir et de juste temps, le niveau de stock qui dclenche l'ordre d'achat, de faon tre livr juste au moment de l'utilisation de la dernire pice. Ce niveau de stock (point de commande) doit permettre de satisfaire les besoins durant le dlai allant de la date de dclenchement de commande la date de livraison.
4 - Rapprovisionnement Date et Quantit variables Cette mthode est principalement utilise pour les articles de classe A dont les prix de revient varient fortement ou dont la disponibilit n'est pas permanente. Exemple : Mtaux prcieux, bois exotiques... L'achat se fait sur estimation en fonction des opportunits du march. Dans les estimations, il faudra prvoir les besoins pour les commandes spcifiques, les fabrications de l'entreprise, les alas de fabrication... Rsum Combinaisons de politiques Quantit Fixe Date Fixe Approvisionnements "automatiques" Quantit Variable Mthode de recompltement Achats opportunistes Date Variable Point de commande
II. L EVALUATION DES STOCKS : 1. LA VALEUR D ENTREE : 1.1. CAS GENERAL Les stocks sont enregistrs
leur cot d acquisition pour les biens acquis titre onreux ; leur cot de production pour les biens produits par l entreprise.
Le cot d acquisition des biens en stocks est leur cot rel d achat form :
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Du prix d achat factur augment des droits de douane et autres impts et taxes non rcuprables et diminus des taxes lgalement rcuprables ainsi que des rductions commerciales obtenues (rabais, remises, ristournes) ds lors que ces rductions peuvent tre rattaches chaque catgorie d achat et qu elles sont significatives. Des charges accessoires d achat engages jusqu' l entre en magasin de stockage, il s agit essentiellement des charges directes sur achat et approvisionnement (Transport, frais de transit, commissions et courtages, frais de rception (dchargement, manutention ), assurances, transport l exclusion des taxes lgalement rcuprables). Toutefois l entreprise peut inclure dans le cot d acquisition la fraction des charges indirectes susceptibles d tre raisonnablement rattaches l opration d achat et d approvisionnement. Le cot de production des biens en stocks est form de la somme : Des cots d acquisition des matires et fournitures utilises pour la production de Des charges directes de production telles les charges de personnel, les services Des charges indirectes de production, dans la mesure o il est possible de les rattacher l lment. extrieurs, les amortissements raisonnablement la production de l lment qui ont t engages pour amener les produits l endroit et dans l tat o ils se trouvent. 1.2. CAS PARTICULIERS Stocks acquis par voie d change : la valeur d entre du bien acquis est en principe gale la valeur actuelle du bien cd ; toutefois, si cette valeur actuelle n est pas significativement diffrente de la valeur comptable nette du bien cd, cette dernire est retenue comme valeur d entre du bien acquis. Stocks acquis titre gratuit : la valeur d entre des biens est gale la valeur actuelle, valeur estime , la date d entre, en fonction du march et de l utilit conomique du bien pour l entreprise. Stocks acquis titre d apport : la valeur d entre est gale au montant stipul dans l acte d apport. Stocks acquis conjointement ou produits conjointement : la valeur d entre de ces biens est dtermine partir de leur cot global d achat ou de production, proportionnellement la valeur relative qui peut tre attache chacun de ces biens ds qu ils peuvent tre individualiss. 4
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Produits rsiduels : sont inscrire en stock pour leur valeur probable de ralisation (cours du march s il en existe un) sous dduction des charges de distribution engager. cas exceptionnels : Dans les cas exceptionnels, o il n est pas possible de calculer le cot d achat ou le cot de production, la valeur d entre est dtermin : comme gale au cot d achat ou au cot de production dans l entreprise des biens quivalents constat ou estim une date aussi proche que possible de la date d entre, dfauts, comme gale aux prix de vente estim la date du bilan sous dduction d une marge normale sur cot d acquisition ou sur cot de production. Stocks dtenus l tranger et destins y tre vendus et dont le cot est exprim en devises : Ces stocks font l objet d une conversion en dirhams par catgories de marchandises ou de produits sur la base du cours moyen de change leur date d achat ou d entre (moyenne pondr des cours de change pendant la priode d achat ou d entre) ou sur la base d un cours estim aussi proche que possible de ce cours moyen. 1.3. STOCKS DE BIENS INTERCHANGEABLES : Pour les articles, objets ou catgories individualiss et identifiables, le cot d entre est dtermin par article, objet ou catgorie. En revanche, pour les articles ou objets interchangeables, et non identifis par unit, aprs leur entre en stock, le cot d entre du stock observ une date quelconque et notamment l inventaire, est obtenu selon l une des deux mthodes suivantes :
X Mthodes du cot moyen pond r : Le cot moyen pond r apr s chaque entr e :
CMPU aprs chaque entre = Valeur du stock prcdent + valeur de l entre (achat ou production) Quantit en stock + quantit entre (achete ou produite) Le cot moyen pond r de p riode de stockage : Le cot unitaire d entre du stock la date de l inventaire est gal la moyenne des derniers cots unitaires d entre observe sur la dure moyenne d coulement du dit stock, cette moyenne des derniers cots tant pondre par les quantits entres. Exemple L entreprise a consomm dans l anne 450 units, son stock moyen est de : Stock initial + stock final = (300 +300)/2 = 300 units; 2
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
La dure moyenne de stockage est de : (300 x 12 mois)/450 = 8 mois (en moyenne une unit entre demeure 8 mois en stock avant d tre consomme). On retient donc le cot moyen des entres des 8 derniers mois pour valuer le stock final. Le C.M.P des entres des 8 mois derniers mois est de : (150x135+200x120)/(150+200) = 44.250/350= 126,43 DH. La valeur du stock final est donc gale : 300x126, 43 DH = 37.929 DH La mthode du premier entr e, premier sorti (FIFO) Toute sortie est valoris au cot d entre le plus ancien, ds lors le stock final est valu aux cots
X
d entres les plus rcents, les quantits tant regroupes par lots homognes quand leur date d entr et leur valeur. 2. LA VALEUR ACTUELLE A LA DATE D INVENTAIRE La valeur actuelle des biens en stock est dtermine partir du march et de l utilit du bien pour l entreprise : La rfrence au march s effectue partir des informations les mieux adaptes la nature du bien (prix du march, barmes, mercuriales ) et en utilisant des techniques adquates (indices spcifiques, dcotes ); Pour les matires premires et les fournitures, la rfrence au march correspond le plus souvent au prix actuel d achat, major des charges actuelles accessoires d achat. Pour les produits finis et les marchandises, la rfrence au march correspond gnralement leur prix de vente probable, diminu du total des charges restant engager pour raliser la vente (charges de distribution y compris les charges postrieures la vente telles celles relatives au cot des garanties ) Pour les produits en cours, leur prix de vente probable ( l tat de produit fini) doit tre diminu des charges de distribution mais aussi des cots de production restant engager (cot d achvement). Le prix de vente probable doit tenir compte, dans le respect du principe de prudence, des perspectives de vente et notamment : du prix du march s il en existe un son niveau actuel (date de l inventaire) ou futur (en cas d volution la baisse) ; des particularits des produits ou marchandises en stock et notamment de leur inadaptation aux conditions nouvelles du march (cas des articles dmods ou obsoltes ) ou de leur tat (articles dfra chis ou ab ms )
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
3. LA VALEUR AU BILAN (VALEUR COMPTABLE NETTE) Cas gnral En application du principe de prudence est retenue comme valeur comptable nette, dans le bilan, la valeur d entre ou si elle lui est infrieure la valeur actuelle. Si la valeur actuelle est infrieure la valeur d entre, il est appliqu cette dernire une correction en diminution sous forme d une provision pour dprciation. Valeur d entre > Valeur actuelle provision pour dprciation = Valeur d entre Valeur actuelle VCN = Valeur d entre provision pour dprciation = valeur actuelle
Le bilan devant toujours faire appara tre distinctement les trois valeurs suivantes : La valeur d entre (maintenue en critures en tant que valeur brute). La provision pour dprciation (en diminution) La valeur comptable nette (par diffrence)
Cas particulier des contrats de vente ferme Lorsque le prix de vente stipul est considr comme sr, couvre tout la fois les cots dj engags sous forme de produits finis, produits en cours ou matires premires, fournitures ou marchandises et ceux restant supporter jusqu excution totale du contrat, le cot d entre de ces biens est conserv comme valeur du bilan sans que soit constate une provision pour dprciation.
III. LES ECRITURES COMPTABLES DE REGULARISATION DES STOCKS 1 . Inventaire intermittent Dans cette organisation comptable, c'est seulement en fin de priode que sont inscrits dans les comptes de la comptabilit gnrale les existants chiffrs en valeur. Comptabilisation des variations de stocks : 1. Annulation des stocks initiaux 2. Constatation des stocks finals Comptabilisation des provisions pour dprciation des stocks 1. Annulation des provisions/stocks initiaux 2. Constatation des provisions/stocks finals N.B Une autre mthode de rgularisation des provisions consiste comparer, pour chaque catgorie de stock, la provision sur le stock final et celui sur le stock initial, afin d'enregistrer la diffrence (dotation ou reprise) 7
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Variation des stocks=stock final-stock initial La variation des stocks est : - positive en cas d'augmentation des stocks (SF>SI) - ngative en cas de diminution de stocks (SF<SI) C'est la nature du solde du compte de variation de stocks qui permet de dterminer le signe (+ ou -) de la variation NB : -les variations de stocks sont calcules sur les valeurs d'entre -les stocks qui figurent dans la balance avant inventaire sont les stocks initiaux
L'inventaire comptable permanent
C'est l'organisation des comptes, qui, par l'enregistrement des mouvements (entres, sorties) permet de conna tre de faon constante, en cours d'exercice, les existants chiffrs en quantit et en valeurs, la mthode s'applique particulirement aux stocks. Les entreprises peuvent, tenir l'inventaire permanent dans les comptes de stocks correspondants de la classe 3 suivant les modalits dfinies ci-aprs : - En ce qui concerne les stocks acquis par l'entreprise l'ext rieur : les achats des marchandises, matires et fournitures les comptes 6111 et suivants (sauf 6114 variation des stocks de marchandises). 6121 et suivants (sauf 6124 variation des stocks de variation de stocks de marchandises). 6121 et suivants (sauf 6124 variation des stocks de matires et fournitures) sont dbits par le crdit des comptes intresss des classes 4et 5 : En cours d'exercice les comptes de stocks fonctionnent comme des comptes de magasin : * Ils sont dbits des entres conscutives aux achats par le crdit des comptes 6114 et 6124 : * Ils sont crdits des sorties valorises en cots par le dbit des ces mmes comptes : En fin d'exercice, les soldes des comptes issus des postes 611 et 612 reprsentant respectivement le montant des achats revendus de marchandises (achats de l'exercice corrigs de la variation de stock) et le montant des achats consomms de matires et de fournitures (achats de l'exercice corrigs de la variation de stocks); - En ce qui concerne les stocks produits par l'entreprise elle-m me: En cours d'exercice les comptes de stocks fonctionnent comme des comptes de magasin :
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
* Ils sont dbits des entres valorises en cots de production par le crdit du compte 7132 variations de stocks de biens produits ; * Ils sont crdits des sorties, selon, un cot calcul conformment aux mthodes d'valuation utilises par l'entreprise, par le dbit du compte 7132 : En fin d'exercice, le solde du compte 7132 reprsente la variation des stocks des produits au cours de l'exercice : - En ce qui concerne les produits en cours : Comptabilisation des mouvements de stocks : Stocks acquis par l'entreprise l'extrieur :
6121 34552 4411
Achats de matires premires Etat TVA rcuprables / charges Fournisseurs Matires premires Variation des stocks de matires et fou.cons
Entre en magasin
258750 51750 310750
3121 6124
258750 258750
6124 3121
Variation de stocks de matires et fou.cons Matires premires
Sortie du magasin
261100 261100 298.4 298.4
6587 3121
Autres charges non courantes de l'exercice Matires premires Constatation de la diffrence d'inventaire Mali 3121 Matires premires 21000 258750 261100 298,40
6124 Variation des stocks de matires et four. cons 261100 258750 6121 Achats de matires premires 258750 S .D. 2350
S .D. 18351 .60
S .D. 258750 Stocks produits par l entreprise
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Courant 2001 3151 7132 Produits finis Variation des stocks de bien produits Entre en magasin de produits finis D Clients Ventes de biens produits au Maroc (5050*200DH) Etat T.V.A facture d Variation des stocks de biens produits Produits finis Sortie du magasin de produits finis 31/12/95 3151 7587 Produits finis Autres produits non Courants de l exercice 750 750 Fn 727500 727500
3421 7121 4555
1212000
1010000 202000
7136 3151
757500
757500
Constatation de la diffrence d inventaire (boni)
3151 Produits finis 75000 727500 750 757500
7132 variation des stocks de biens produits 757500 727500
S.D : 45750(S.F.rel)
S.D : 30000
10
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Stocks de produits en cours : 31/12/95 Biens en cours Variation des stocks de produits en cours Constatation des produits en cours de l exercice d Variation des stocks de produits Biens en cours Annulation des produits en cours de l exercice prcdent 3131 Biens en cours (5000) 3500 S.D : 3500(S.F) S.D : 1500 5000 7131 variations des stocks De produits en cours 5000 3500 3500
3131 7131
3500
7131 3131
5000 5000
Les contrats long terme
On appelle les contrats long terme, un contrat dans lequel la date de dmarrage des oprations et la date d'achvement se situent dans deux exercices diffrents. Ils peuvent poser des problmes d'homognit des comptes de rsultat puisque les bnfices enregistrs sur ces contrats n'apparaissent qu'pisodiquement, l'achvement de la production. Trois procdures sont possibles pour traiter ces contrats : * La mthode de l'achvement * La mthode de l'avancement * La mthode des produits nets partiels Les contrats qui risquent d'entra ner une perte subissent un traitement particulier conduisant crer des provisions. Traitement des contrats b n ficiaires 1. La mthode de l'achvement C est la mthode utilise pour toute production : les charges engages sont des lments du cot de production et mnent une valorisation des en-cours en fin de priode. Ces stocks d'en-cours sont limins la fin de l'exercice suivant. A l'achvement du contrat, le produit global est comptabilis en ventes, travaux ou prestations de services.
11
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
2. La mthode de l'avancement : Cette mthode est rserve aux entreprises de B.T.P et d'ingnierie : les en-cours ne sont pas enregistr en inventaire. Par contre, en fin de chaque exercice, on inscrit directement en compte de vente le CA prvu multipli par le coefficient d'avancement des travaux, par le dbit du sous compte "34271 Clients Facture tablir". 3. La mthode des produits nets partiels : Pouvoir constater des produits nets partiels, plusieurs conditions doivent tre runies : * L'opration doit tre accepte par le co-contractant * L'valuation des en-cours doit tre possible * Il doit exister des documents rvisionnels permettant de chiffrer les charges engager et les produits recevoir; * le bnfice de l'opration doit pouvoir tre apprci avec une scurit suffisante, Ce qui suppose que : . Le prix de vente doit tre connu avec suffisamment de certitude, . L'avancement des travaux doit tre suffisant pour que des prvisions puissent tre faites sur la totalit des cots venir, . Aucun risque ne doit exister quant l'aptitude de l'entreprise et du client remplir leurs obligations . Le produit net est obtenu en fin d'exercice par le calcul suivant :
Produit net partiel = Bnfice prvisionnel *
Cot des travaux raliss la clture de l'exercice Cot total estim du produit ou du service
* Le produit net partiel st constat par l'criture : A la clture de l'exercice : 34272 Crances sur travaux non encore facturables 7124(4) Produits nets partiels sur oprations en -cours * les en-cours sont constats dans les conditions habituelles A l'achvement des travaux : F Le produit global factur est enregistr en vente, travaux ou prestation de services F Les en-cours sont annuls (en fin d'exercice)
12
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
F Les produits nets partiels constats prcdemment sont annuls par l'criture : 71243 Vente de prestations de services 34272 Crances sur travaux non encore facturables Traitement des contrats dficitaires : En cas de dficit probable sur un contrat Long Terme, une provision, calcule sur la totalit de perte prvisible doit tre constitue : Provision = cot total du contrat - prix de vente Avec : cot total du contrat = Charges directes et indirectes de production + Cot hors production (y compris les charges de commercialisation) Une distinction est faite entre : * Les contrats "MARGINAUX" (lorsque les marges dgages sur les autres contrats en-cours couvrent les frais gnraux) pour lesquels la provision est limite la perte probable calcule cidessus. * Les contrats "NON MARGINAUX" (qui risquent d'affecter srieusement la rentabilit de l'entreprise) pour lesquels le cot calcul ci-dessus est major d'une quote-part de frais gnraux supporter par le contrat et qui ne pourront pas tre couvert par les autres produits. - La provision est divise en deux lments : F Une provision pour dprciation des travaux en cours correspondant la perte constate la clture de l'exercice (= perte totale * pourcentage d'avancement des travaux) F Une provision pour risque pour le complment de (perte totale provision pour dprciation) LE SAVOIR FAIRE T La dtermination des cot de production des en-cours est soumises aux mme rgles que celles utilises pour la valorisation des produits finis, en particulier pour l'inclusion des charges financires et des frais de recherche et dveloppement et pour l'exclusion des cot de la sous activit. T Avant toute comptabilisation, il faut s'assurer si le contrat est potentiellement bnficiaire ou dficitaire. Ds lors qu'une provision est constitue aucun produit net partiel ne peut tre constat. T Le pourcentage d'avancement des travaux se calcule toujours partir des cots de production. PARTIE II : L AUDIT DES STOCKS Les principaux Objectifs de l audit des stocks :
13
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Tous les mouvements de stock sont saisis et enregistrs Tous les stocks enregistrs sont protgs et appartiennent l entreprise Les stocks sont correctement valus
Les tapes fondamentales de la mission d audit des stocks : 1. l ordre de mission L ordre de la mission est l acte de naissance de la mission d audit. Il peut s agir d une lettre de mission qui est un document contractuel chang entre une entreprise et un intervenant extrieur, ou d un mandat donn par la Direction Gnrale l Audit Interne et rpond trois principes essentiels : 1. Premier princ ipe : l Audit interne ne peut se saisir lui-mme de ses missions. Il est l pour raliser les missions qui lui sont confies et dont la dcision ne lui appartient pas 2. Deuxime princ ipe : l ordre de mission doit maner d une autorit comptente, c est Le plus souvent la Direction Gnrale ou le Comit d Audit s il en existe un 3. Troisime princ ipe : l ordre de mission permet l information tous les responsables Concerns 2. la phase de la prparation Exige des auditeurs une capacit importante de lecture, d attention et d apprentissage, et une bonne connaissance de l entreprise car il faut savoir o trouver la bonne information et qui la demander. Elle peut se dfinir comme la priode au cours de laquelle vont tre raliss tous les travaux prparatoires avant de passer l action. i. La prise de c onnaissanc e : Sans conna tre ncessairement le mtier de l entit auditer, l auditeur doit au moins en avoir la culture pour tre en mesure de comprendre les explications qu il va chercher et solliciter, plus gnralement, pour se faire admettre aisment. L auditeur va donc planifier sa prise de connaissance en ayant soin de prvoir le ou les moyens les plus appropris pour acqurir le savoir ncessaire la ralisation de sa mission. Ces moyens sont : 1. Questionnaire de prise de connaissance : Il est labor partir les dossiers d audits, rapports d audits antrieurs, notes de services, les documents jour sur les mthodes et procdures de travail, les rapports et comptes rendus de service auditer, les notes relatives des modifications rcentes ou venir dans l organisation, les responsabilits ou les mthodes de travail. 2. Les interviews : 14
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Elles sont tout la fois un moyen de conna tre et un moyen de se faire conna tre. 3. Les grilles d analyse des tches pour bien comprendre les principaux acteurs 4. Flow Charts pour analyser le circuit des documents essentiels 5. Rapprochements statistiques divers En matire d audit des stocks, l auditeur doit avoir une connaissance de : 6. La nature des produits stocks 7. Les instructions de prise d inventaire 8. La nature des systmes comptable et de contrle interne utiliss en matire de stocks ; 9. Mthode d valuation et de valorisation des stocks ii. valuation des risques Il s agit d une identification des zones risques , on identifie les endroits o les risques les plus dommageables sont susceptibles de se produire, plutt que d analyser les risques eux-mmes. Le but est de construire de faon module un programme en fonction non seulement des menaces mais galement de ce qui a pu tre mis en place pour y faire face. -Il existe deux pratiques pour identifier les risques : - La premire consiste faire une impasse sur cet aspect en pensant avoir une bonne connaissance du sujet, dfinissant aussitt leur programme d audit. C est approuvable tant que le sujet est simple, dans le cas contraire, certaines entraves peuvent se prsenter tels que : a. L omission de certaines zones de risques essentiels, b. Une importance exagre accorde aux questions accessoires. - La seconde se focalise sur l identification des forces et des faiblesses en analysant en dtail les consquences, en calculant le degr de confiance, en assortissant le tout de commentaires. C est certes du bon audit, mais un peu trop excessif ce stade car on analyse l audit avant de l avoir commenc. Ces deux pratiques correspondent deux types d analyse, elles ont des incidences directes sur le contenu des phases ultrieures de la mission :
Une approche in abstracto :
Qui consiste dfinir les risques potentiels partir de considrations gnrales, ou de la connaissance pralable que l on peut avoir de la situation au sein de l entreprise. Par exemple : Risque de perte ultrieure d une mauvaise valuation des stocks ou un risque fiscal
15
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
suite une mauvaise valorisation de stock. Cette approche va entra ner, des observations ralises sur le terrain en grande quantit et de faon approfondie ; il y aura donc une phase de ralisation d autant plus importante que la phase prparatoire aura t brve.
Une approche in concreto
Qui consiste dfinir les risques rels en appliquant en sorte un audit avant audit travers des prises de contact, des observations. Cette approche va donc transformer la phase de ralisation en une validation rapide sur le terrain des observations antrieures. 3. La phase de ralisation Fait appel aux capacits d observation, de dialogue et de communication. C est ce stade que l auditeur va procder aux observations et constats qui vont lui permettre d laborer la thrapeutique. Certains aspects de contrle interne tant couverts dans les cycles achats ou ventes, nous n'examinerons ici que : 1. le contrle comptable, 2. l'identification et la protection des stocks, 3. l'imputation des cots de production, 4. la valorisation, 5. les contrles globaux de vraisemblance. 3.1. Contrle comptable Gnralement, un contrle interne sera caractris par :
L'utilisation et le contrle de pices prnumrotes et approuves pour mouvementer les stocks (bons de rception, bons de livraison, bons de sortie de production...), L'existence d'inventaire permanent ou de fiches de stock, de prfrence tenus par d'autres personnes que les gardiens des marchandises (qui souvent tiennent pour euxmmes un cahier des entres et sorties ou des fiches de magasin),
L'utilisation de pices comptables prnumrotes et approuves pour mouvementer les inventaires permanents comptables (gnralement les doubles des documents dcrits plus haut),
L'enregistrement correct des stocks l'extrieur (tenue de fiches spares par article, lieu d'entreposage...), 16
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
L'enregistrement correct des stocks n'appartenant pas l'entreprise (consignation, dpt, prts...) par la tenue de fiches par article et par bnficiaire, Les contrles rciproques entre services (Rception, Expdition, Magasin) et une analyse des carts, Un contrle adquat des mouvements par les services de production, d'expdition et les gestionnaires de stocks et une analyse des carts.
3.2. Identification et protection des stocks Les lments suivants sont en gnral indicatifs d'un bon contrle en la matire :
La responsabilit des stocks est confie une personne bien prcise, Les stocks sont physiquement protgs des risques naturels (assurances, btiment...) et des vols ou dtriorations (endroits clos, gardiens, extincteurs...), Des comptages physiques rguliers et un contrle sont assurs par une personne n'ayant pas la garde des stocks, Des procdures d'inventaire physique adquates permettant des comptages exacts ainsi que la description et l'identification des stocks endommags ou en quantit excessive, Un rapprochement entre quantits physiques et quantits thoriques est opr et une recherche des carts est ralise, Des feuilles de comptages prnumrotes sont utilises, Un contrle rciproque entre services (Rception, Expdition, Magasin) est effectu, Il existe un contrle adquat des mouvements par la production, l'expdition et les gestionnaires de stocks, Des procdures de sparation d'exercice appropries sont dfinies, tant pour les achats et les ventes que pour la production.
3.3. Imputation des cots de production Les principaux aspects positifs d'un bon contrle interne ce niveau sont les suivants :
Existence d'une comptabilit analytique rapproche de la comptabilit gnrale et comprenant entre autres :
* Une analyse correcte des consommations de matires grce des bons de production, fiches suiveuses, etc, et l'mission d'un document pour tout mouvement physique des magasins vers la cha ne, l'intrieur de la cha ne, et de la cha ne vers les magasins de produits finis, * Une prise en compte des pertes et dchets et leur contrle,
17
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
* Un traitement correct des temps morts, arrts de production, etc, * Une imputation correcte des frais gnraux de production, * La prise en compte de la sous-activit ( l'exclusion de la valorisation des stocks), * Analyse de l'importance des carts permettant de juger du caractre raisonnable du systme de cots dans le cas o un systme de cots standard est utilis. 3.4. Valorisation Un contrle interne satisfaisant ce niveau doit permettre :
De justifier tout moment la dcomposition des cots de revient et permettre leur rapprochement avec les cots rels dans le cas d'utilisation de cots standards, L'existence d'un inventaire permanent ou de fiches de stocks tenues en quantit et en valeur, L'existence de procdures permettant de dterminer le prix du march ou le prix de ralisation nette, Une revue rgulire des stocks obsoltes endommags ou faible rotation et la constitution de provisions adquates.
3.5. Contrles globaux de vraisemblance On citera entre autres :
La comparaison de prix unitaires entre exercices, La comparaison des marges brutes et taux de rotation, Les statistiques compares de production, consommation, dchets, etc, La revue finale des stocks et de leur valorisation par un responsable lev dans la hirarchie. 4. La phase de conclusion
Cette phase exige une grande facult de synthse et une aptitude certaine la rdaction. L auditeur va laborer et prsenter son produit aprs avoir rassembl les lments de sa rcolte. Dans cette phase, l auditeur informe l entreprise des erreurs et les corrections ventuelles de ces erreurs, il peut galement proposer des amliorations. Vu l importance de la prise de l inventaire dans la mission d audit des stocks, on a jug utile de prsenter en dtail son droulement.
18
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
METHODOLOGIE D AUDIT DE L INVENTAIRE PAR OBSERVATION PHYSIQUE L auditeur intervient :
Avant l inventaire physique Au cours de l inventaire Aprs l inventaire
Intervention avant la prise d inventaire : a. c onnaissanc e pralable de : 1. Stocks, lieux de stockage et processus de production ; 2. Le systme de contrle interne de fonction achat, vente, production (existence de bons d entre, de sortie, de transfert, de production pr numrots ou non, sparation des tches) ; 3. La gestion des stocks (existence de fiches de stocks, d un inventaire permanent informatiss ou non ); 4. Instructions de prise d inventaire ; ii. E valuation des instruc tions L auditeur s assure que les instructions comportent les informations ncessaires pour permettre la fiabilit de la saisie des quantits et des autres informations, il peut utiliser pour cette valuation : 1. la liste aide mmoire des principales procdures d inventaire physique 2. le questionnaire d inventaire physique L auditeur obtient des informations prcises sur les points suivants : 3. les dates et heures de dbut et de fin de la prise d inventaire 4. les modalits de la prise d inventaire (inventaire complet, partiel, tournant, ) 5. les lieux de stockage et les produits qui seront inventoris 6. les modalits de saisie et de recoupement des travaux en cours 7. l existence de stock en dpt ou en consignation dans l entreprise et appartenant des tiers ou de stocks appartenant a l entreprise et se trouvant chez des tiers Il est important d obtenir les procdures et de procder leur valuation suffisamment l avance, afin que l entreprise puisse effectuer les modifications qui s imposent, pour assurer la fiabilit des comptages et de leur centralisation. iii. V isite pralable sur les lieux
19
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Une visite des lieux de stockage avant l inventaire permet l auditeur de s assurer que les articles sont correctement rangs pour pouvoir tre recenss dans de bonnes conditions iv. Prog ramme et planning Les informations recueillies permettent l auditeur : De planifier son intervention 1. dans le temps, en fonction des dates prvues 2. dans l espace, en fonction des lieux o se droule l inventaire De prparer un programme de travail adapt tenant compte des particularits de l entreprise : 3. domaines sensibles 4. nature et volume des sondages et contrles effectuer 5. natures des informations collecter De prvoir les collaborateurs ncessaires compte tenu des travaux planifis Intervention pendant l inventaire a. A pplic ation des instruc tions de l inventaire
Les contrles portent essentiellement sur : La faon dont la prise d inventaire est effectue par le personnel de l entreprise et par consquent sur la faon dont les procdures sont appliques Il est important d assister au dbut et la fin de l inventaire.
au d but pour s assurer que : L inventaire va se drouler dans de bonnes conditions Les instructions ont t bien comprises et sont correctement suivies la fin pour : Contrler la procdure de centralisation des fiches et feuilles de comptage Pour prendre une copie de la feuille de suivi des fiches Les units de comptage sont correctement utilises Les appareils de mesure ou de comptage sont fiables Le contenu des cartons ou autre conteneurs correspond bien aux articles relevs Les piles ne comportent pas de manquants Toutes les zones o peuvent se trouver des stocks sont biens repres Les fiches de comptage sont correctement remplies par les quipes de comptage
L auditeur doit s assurer au moyen de sondages que :
20
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
b. Sondag es sur les quantits L auditeur effectue un certain nombre de comptage qu il consigne dans les dossiers pour contrle ultrieur avec l inventaire dfinitif :
Dsignation, rfrence et localisation de l article Unit de comptage Quantit compte par l auditeur, par le personnel de l entreprise, et celle figurant ventuellement sur les fiches de stocks de l inventaire permanent
Le volume de ces sondages est fix par l auditeur en fonction :
De sa connaissance de l entreprise Du contrle interne de la fonction stocks De la qualit de la procdure de prise d inventaire De la qualit de l application de cette procdure
L auditeur organise ces contrles pour s assurer que :
Tout lment existant physiquement est correctement recens Tout lment recens existe physiquement Sur les aires de stockages, et s assure qu ils sont ou seront correctement saisies sur les fiches de comptage Sur les fiches de comptage de l entreprise et s assure qu il existe bien physiquement.
Pour ce faire, il slectionne des lments :
Les sondages effectus, relevs sur ses feuilles de travail, lui permettront de s assurer que les fiches n ont pas t modifies Il peut galement faire un relev ou des copie d un certain nombre de fiches tablis par le personnel de l entreprise. c.
Indpendanc e des exerc ic es
Les informations releves dpendent du systme prvu par l entreprise, elles consistent relever : Lorsqu il existe des documents pr numrots :
Les derniers numros des documents utiliss jusqu la date d inventaire Bon de rception et de retours des clients Bon de livraison et de retours aux fournisseurs Les bons de transfert entre magasins ou du stock de matires premier vers les encours, Les derniers bons de production. 21
Lorsqu il existe un inventaire permanent :
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Intervention aprs l inventaire a. Contrle de la c entralisation des quantits
Aprs la prise d inventaire, l auditeur doit s assurer que :
Les comptages effectus par le personnel sont correctement centraliss Que les quantits dont l existence physique a t dmontre sont bien celles qui sont utilises pour valoriser l inventaire
Il s assure galement :
Du report de toutes les fiches sur l tat des stocks, par sondage partir des fiches, ou par contrle des squences numriques Que seules les fiches d inventaire ont t reprises sur l tat des stocks, par sondage partir de l tat des stocks, ou par contrle des squences numriques Que les rcapitulations sont arithmtiquement exactes, par des sondages sur les calculs effectus manuellement ou au moyen d outils informatique d aide l audit Que les informations ventuelles relatives la dprciation des stocks releves lors de l inventaire sont prises en compte b. Suivi des sondag es et informations releves
Ce suivi est effectus grce au :
Recoupement du rsultat des sondages effectus lors de l inventaire physique par l auditeur, et des informations collectes avec l tat d inventaire utilis pour la valorisation
Pointage des fiches de comptages photocopies avec l tat d inventaire valoris Pointage des numros et des fiches de comptage avec les fiches rendues utilises par les quipes et notes sur la feuille de suivi des fiches c. Sparation des exerc ic es
A partir des informations releves lors de l inventaire physique, les contrles suivants sont effectus : P riode qui pr c de l inventaire :
Comparaison des bons de rception dont les numros sont antrieurs au dernier numro relev lors de l inventaire avec les factures d achat correspondantes, en s assurant qu elles ont t comptabilises avant la date d inventaire.
22
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Comparaison des bons d expdition dont les numros sont antrieurs au dernier avec les factures de ventes correspondantes, en s assurant qu elles ont t comptabilises avant la date d inventaire.
P riode post rieure l inventaire ( l inverse)
Les bons d expdition, dont les numros sont postrieurs au dernier ne doivent pas avoir donn lieu l enregistrement d une facture de vente ou d un avoir au client avant la date d inventaire
Les bons de rception dont les numros sont postrieurs au dernier numro ne doivent pas donner lieu l enregistrement d une facture d achat avant la date d inventaire
CAS PARTICULIERS Lieux de stoc kag e multiples Lorsque l'inventaire se droule en plusieurs endroits, l'auditeur doit dterminer quel endroit il doit se rendre, compte tenu de l'importance relative des stocks et de l'valuation du risque de non contrle en ces diffrents endroits. Inventaires tournants Lorsque les quantits en stocks doivent tre dtermines l'issue d'un inventaire physique auquel assiste l'auditeur ou lorsque l'entit procde par inventaire tournant et que celui-ci y assiste une ou plusieurs fois au cours de l'anne, l'auditeur doit, en rgle gnrale, observer les procdures d'inventaire et effectuer des tests de comptage. Lorsque l'entit procde par inventaire tournant pour dterminer le stock de fin d'exercice, l'auditeur doit, travers la mise en oeuvre de procdures appropries, apprcier si les raisons l'origine des carts importants entre le comptage physique et les registres d'inventaire sont bien comprises et si les enregistrements sont correctement ajusts. Stoc ks dtenus par des tiers Lorsque les stocks sont sous la garde et le contrle d'un tiers, l'auditeur doit, en rgle gnrale, obtenir confirmation directe de ce tiers quant aux quantits et la qualit des stocks dtenus pour le compte de l'entit. L'auditeur doit envisager :
Tout dfaut apparent d'intgrit et d'indpendance du tiers concern ;
23
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
D'assister lui-mme, ou de s'arranger pour qu'un confrre puisse assister l'inventaire physique des stocks ; D'obtenir le rapport du confrre sur le caractre adquat des contrles internes en place chez le tiers afin de s'assurer que les stocks sont correctement compts et suffisamment protgs ;
D'examiner la documentation relative aux stocks dtenus par des tiers (par exemple, si des bons de rception en magasin sont donns en nantissement).
Estimation des quantits physiques : Lorsque l'entit a recours des procdures d'estimation de quantits physiques (pour valuer un stock de charbon, par exemple) l'auditeur doit s'assurer du caractre raisonnable de ces procdures.
Inventaire ralis une autre date que c elle de c lture Pour des raisons pratiques et lorsque le contrle interne est jug suffisant, l'inventaire physique des stocks peut avoir lieu une date diffrente de la date de clture de l'exercice. Dans de tels cas, l'auditeur doit, travers la mise en oeuvre de procdure appropries, apprcier si les variations de stocks intervenus entre ces dates sont correctement enregistres.
24
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
Bibliographie
La comptabilit gnrale entreprises marocaines, Tome II :les enregistrements comptables en fin d exercice, de FOUGUIG Brahim et FECHTALI Abderrazak, dition Edit Consulting. Bordas Management, les techniques de gestion des stocks, de L.KILLEEN, traduit par F.GUILLON, assistant HEC. La conduite d une mission d audit interne, d Olivier LEMANT de l Institut Franais des Auditeurs Consultants Internes, dition Clet et Dunod. Code Gnral de Normalisation Comptable. La gestion des approvisionnements et des matires, de LEENDERS, FEARON, NOLLET, dition Gatan & Morin. Thories et pratique d audit interne, dition des organisations. www.google.fr
25
Rsum de "L'audit "L'audit des stocks"
26
Vous aimerez peut-être aussi
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Lettre de Motivation PDFDocument25 pagesLettre de Motivation PDFElijah Ward100% (2)
- Cycle de vie des produits: Les phases-clés d'une stratégie marketing efficaceD'EverandCycle de vie des produits: Les phases-clés d'une stratégie marketing efficaceÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Finance InternationaleDocument40 pagesFinance InternationaleHossen Atifi100% (4)
- Le glossaire du trading online: Les termes à connaître et à approfondir pour se familiariser avec le domaine du trading au niveau opérationnelD'EverandLe glossaire du trading online: Les termes à connaître et à approfondir pour se familiariser avec le domaine du trading au niveau opérationnelPas encore d'évaluation
- Conception automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandConception automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Prospection CommercialeDocument31 pagesProspection CommercialeLaurent Bennani III100% (1)
- Gestion Des ApprovisionnementsDocument14 pagesGestion Des ApprovisionnementsAbdou Essa100% (2)
- Gestion Des Stocks 03032011Document61 pagesGestion Des Stocks 03032011Zozo Kh100% (4)
- 3, 2, 1... Investissez en bourse: Se lancer en toute autonomieD'Everand3, 2, 1... Investissez en bourse: Se lancer en toute autonomiePas encore d'évaluation
- COSODocument22 pagesCOSOElijah WardPas encore d'évaluation
- FORMATION SAGE PAIE RH SuiteDocument2 pagesFORMATION SAGE PAIE RH SuiteConstantin Coulibaly100% (1)
- Conduite Mission Audit InterneDocument34 pagesConduite Mission Audit InterneMadrid MadridPas encore d'évaluation
- Cours de MicroéconomieDocument56 pagesCours de Microéconomiemawulus100% (2)
- GL CHAPITRE 1 Gestion Des StocksDocument53 pagesGL CHAPITRE 1 Gestion Des StocksIkram El GhazouaniPas encore d'évaluation
- Le Bon Accord avec le Bon Fournisseur: Comment Mobiliser Toute la Puissance de vos Partenaires Commerciaux pour Réaliser vos ObjectifsD'EverandLe Bon Accord avec le Bon Fournisseur: Comment Mobiliser Toute la Puissance de vos Partenaires Commerciaux pour Réaliser vos ObjectifsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- La Gestion Des StocksDocument5 pagesLa Gestion Des StocksB.I100% (5)
- Code General Des Impots Du Cameroun-2013Document284 pagesCode General Des Impots Du Cameroun-2013Désiré Ted100% (1)
- Fonction Du StockDocument14 pagesFonction Du Stockfouad100% (1)
- Budget D InvestissementDocument35 pagesBudget D InvestissementHamid Boulahyaoui100% (1)
- Le Rapprochement Bancaire PDFDocument1 pageLe Rapprochement Bancaire PDFElijah Ward100% (2)
- Manuel de Dépenses Public PDFDocument27 pagesManuel de Dépenses Public PDFElijah Ward67% (3)
- Cours La Gestion Des Approvisionnements Et Des Stocks Au Sein deDocument11 pagesCours La Gestion Des Approvisionnements Et Des Stocks Au Sein denftl100% (1)
- Chapitre Iii La Gestion Des StocksDocument38 pagesChapitre Iii La Gestion Des StocksAG DEV100% (1)
- Audit StocksDocument27 pagesAudit StocksZahira JbiraPas encore d'évaluation
- Une Bonne Gestion Des Stocks Est Indispensable Pour Assurer La Pérennité de Votre EntrepriseDocument5 pagesUne Bonne Gestion Des Stocks Est Indispensable Pour Assurer La Pérennité de Votre Entreprisealex appiaPas encore d'évaluation
- 221475645-La-Fonction-d-Approvisionnement-Et-La-Gestion-Des-Stocks (Réparé)Document26 pages221475645-La-Fonction-d-Approvisionnement-Et-La-Gestion-Des-Stocks (Réparé)Edith OwensPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Stocks Et Des EncoursDocument21 pagesEvaluation Des Stocks Et Des Encoursmonirito1990Pas encore d'évaluation
- Achat-Fournisseur Et StockDocument22 pagesAchat-Fournisseur Et StockHamza ChPas encore d'évaluation
- Evaluation Des StocksDocument24 pagesEvaluation Des StocksencglandPas encore d'évaluation
- Evaluation Des StocksDocument24 pagesEvaluation Des StocksSoulaiman HarrakPas encore d'évaluation
- Rapport Compta StockDocument24 pagesRapport Compta StockSoufiane Abdalas100% (1)
- ExposéDocument11 pagesExposéDany SmithPas encore d'évaluation
- L'approvisionnement-Logistique-Stock 22Document5 pagesL'approvisionnement-Logistique-Stock 22manar ilhamiPas encore d'évaluation
- BIP 49 1995 Modalités D'évaluation Des Stocks Des BiensDocument13 pagesBIP 49 1995 Modalités D'évaluation Des Stocks Des BiensjuristologuePas encore d'évaluation
- StocksDocument6 pagesStocksatef benyoussefPas encore d'évaluation
- Ias 02 HecDocument5 pagesIas 02 HecGuers YanisPas encore d'évaluation
- Ias 2Document7 pagesIas 2mohamed JadPas encore d'évaluation
- Rôle Du Stock Dans Une Organisation: Le Niveau de Stock Qui Permet de Limiter Les Ruptures de Stock Dues Aux AléasDocument7 pagesRôle Du Stock Dans Une Organisation: Le Niveau de Stock Qui Permet de Limiter Les Ruptures de Stock Dues Aux AléassoukainaPas encore d'évaluation
- Comptabilité Approfondie 2ème Partie 2020-2021Document24 pagesComptabilité Approfondie 2ème Partie 2020-2021ismail boujeddainPas encore d'évaluation
- Gestion StocksDocument20 pagesGestion Stocksreda_ahrizPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Les Stocks NCT04 PDFDocument10 pagesChapitre 1 Les Stocks NCT04 PDFMehdi Ben RejebPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Les Stocks NCT04 PDFDocument10 pagesChapitre 1 Les Stocks NCT04 PDFMehdi Ben RejebPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Comportement Des Charges Et Construction Des Modèles de CoûtsDocument4 pagesChapitre 2 - Comportement Des Charges Et Construction Des Modèles de CoûtsReda MOUSSAIFPas encore d'évaluation
- Ias 2Document17 pagesIas 2Daisy KombilaPas encore d'évaluation
- Systeme de Gestion Des StocksDocument6 pagesSysteme de Gestion Des StocksAmir Ben AbadaPas encore d'évaluation
- Stock - PrésentationDocument22 pagesStock - Présentationhammouda25100% (1)
- La Norme IAS 2 StocksDocument4 pagesLa Norme IAS 2 StocksMeroua BehloulPas encore d'évaluation
- La Gestion de StocksDocument40 pagesLa Gestion de StocksMahmoud Sahi100% (1)
- Le StockDocument5 pagesLe StockAZIANKOU Ayaba MerveillePas encore d'évaluation
- PFE Eya AjiliDocument14 pagesPFE Eya AjiliKarim FarjallahPas encore d'évaluation
- Cours de Compta Anal ISTA-GFIDocument84 pagesCours de Compta Anal ISTA-GFIOG BrianPas encore d'évaluation
- Les Coûts Liés À La Gestion Des StocksDocument14 pagesLes Coûts Liés À La Gestion Des Stockssouloh omarPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document12 pagesChapitre 2Fatima HarkatiPas encore d'évaluation
- Les Stocks Et EncoursDocument50 pagesLes Stocks Et EncoursЯблочных Зернышек100% (1)
- Chapitre 2Document21 pagesChapitre 2Moussa Amadou AlmoustaphaPas encore d'évaluation
- 2 Procédures Inventaire PhysiqueDocument3 pages2 Procédures Inventaire PhysiqueUoni Haras100% (2)
- Compta Approffondie - Evaluation Des BiensDocument48 pagesCompta Approffondie - Evaluation Des Biensseka_dallePas encore d'évaluation
- 03 GestiondesstocksDocument36 pages03 GestiondesstocksYoussef LeSafioPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Les Principes Fondamentaux de La Gestion StockDocument8 pagesChapitre 1 Les Principes Fondamentaux de La Gestion Stockzak ariaPas encore d'évaluation
- Extraits Stock-SYCOHADADocument6 pagesExtraits Stock-SYCOHADAJacques GAGNONPas encore d'évaluation
- 1 Inv 1 LoisDocument60 pages1 Inv 1 LoisOTHMANI LazharPas encore d'évaluation
- Traitement Des Stocks Selon Le NSCF: Zegout Amar. Expert Comptable Charfi Nacer .Maître Assistant U. BLIDADocument18 pagesTraitement Des Stocks Selon Le NSCF: Zegout Amar. Expert Comptable Charfi Nacer .Maître Assistant U. BLIDAazzed753Pas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument19 pagesRapport de Stagebassir2010Pas encore d'évaluation
- Safia IstaDocument24 pagesSafia IstaربےآسألگرضآگوآلجنہPas encore d'évaluation
- CH 3 - Compt analytique-Stock-JAMÏ Jihad-En LigneDocument32 pagesCH 3 - Compt analytique-Stock-JAMÏ Jihad-En LigneOmar BeenPas encore d'évaluation
- Methode D Evaluation Et de Gestion Des Stocks PDFDocument8 pagesMethode D Evaluation Et de Gestion Des Stocks PDFhidouche2014Pas encore d'évaluation
- Les Opérations CourantesDocument16 pagesLes Opérations Courantesseka_dalle100% (1)
- Fiche Séquence N°3 CAEDocument7 pagesFiche Séquence N°3 CAEMouzoun ZakaryaPas encore d'évaluation
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement militaire: Du déploiement à la victoire, maîtriser la danse de la logistiqueD'EverandGestion de la chaîne d'approvisionnement militaire: Du déploiement à la victoire, maîtriser la danse de la logistiquePas encore d'évaluation
- Audit SocialDocument160 pagesAudit SocialNaoufal FouadPas encore d'évaluation
- Abandon de CréanceDocument4 pagesAbandon de CréanceElijah WardPas encore d'évaluation
- Son Budget PDFDocument2 pagesSon Budget PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- Cfa Partie 1 Controle Interne PDFDocument64 pagesCfa Partie 1 Controle Interne PDFImed ZouariPas encore d'évaluation
- Amortissement 7Document7 pagesAmortissement 7Elijah WardPas encore d'évaluation
- Massawer PDFDocument193 pagesMassawer PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- Mettre en Place Des Procédures Et Règles PDFDocument2 pagesMettre en Place Des Procédures Et Règles PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- TH Me 2 Cycle Paie Person PDFDocument23 pagesTH Me 2 Cycle Paie Person PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- EtatRapprochement PDFDocument49 pagesEtatRapprochement PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- TDR - Audit - Acquisitions - Du Projet XDocument8 pagesTDR - Audit - Acquisitions - Du Projet XElijah WardPas encore d'évaluation
- Module A Organisation de L Agence PDFDocument43 pagesModule A Organisation de L Agence PDFElijah Ward100% (1)
- M0003mbaip08 2 PDFDocument94 pagesM0003mbaip08 2 PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- Precis Budget PDFDocument40 pagesPrecis Budget PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- wkf17 PDFDocument223 pageswkf17 PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- Initiation A L Audit - Seance 2 PDFDocument45 pagesInitiation A L Audit - Seance 2 PDFElijah WardPas encore d'évaluation
- Fiche - D - Agrément - UE7 - DSCG - 2023 - VF - KANTE MariameDocument13 pagesFiche - D - Agrément - UE7 - DSCG - 2023 - VF - KANTE Mariameggtszww8fnPas encore d'évaluation
- Juste Valeur - ComptabilitéDocument22 pagesJuste Valeur - ComptabilitéAziz EabPas encore d'évaluation
- S5.M3. Marketing Relationnel CRM a.B.C 2022.2023Document64 pagesS5.M3. Marketing Relationnel CRM a.B.C 2022.2023Hourya AferyadPas encore d'évaluation
- P2-Chapitre 3 La Théorie Quantitative de La MonnaieDocument15 pagesP2-Chapitre 3 La Théorie Quantitative de La Monnaiemalaga04Pas encore d'évaluation
- Gestionnaire LogistiqueDocument2 pagesGestionnaire Logistiqueapi-743022922Pas encore d'évaluation
- SRM Rfa 2022Document116 pagesSRM Rfa 2022nader mansouriPas encore d'évaluation
- 2016 OrdinaireDocument7 pages2016 OrdinaireAhlam BahiaPas encore d'évaluation
- Marketing StratégiqueDocument52 pagesMarketing StratégiqueBouras NouraPas encore d'évaluation
- Exercice Sur Le Management Des CoutsDocument3 pagesExercice Sur Le Management Des CoutsCamelia TicherafiPas encore d'évaluation
- Cours Comptabilite Generale s2Document70 pagesCours Comptabilite Generale s2Rabiâ ZainePas encore d'évaluation
- 1 Introduction 17Document30 pages1 Introduction 17jdi wafaaPas encore d'évaluation
- Raddi PDFDocument43 pagesRaddi PDFMeryemPas encore d'évaluation
- BMCE2Document136 pagesBMCE2Fahd MejdoubiPas encore d'évaluation
- Ms Eln DOB+BoughabaDocument83 pagesMs Eln DOB+BoughabaAhmed KhaliPas encore d'évaluation
- Fina 20214 A23 - S2Document49 pagesFina 20214 A23 - S2William GrignonPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés 1 - Evaluation Du PatrimoineDocument6 pagesTravaux Dirigés 1 - Evaluation Du PatrimoineAYMAN HALALPas encore d'évaluation
- Chapitre 1: Les Fondements de La Gestion FinancièreDocument16 pagesChapitre 1: Les Fondements de La Gestion Financièrealaa eddine azzouzPas encore d'évaluation
- Discour Dinvestiture GicamDocument13 pagesDiscour Dinvestiture GicamHTMPas encore d'évaluation
- Audit Des Banques 1Document57 pagesAudit Des Banques 1Hassan AzirarPas encore d'évaluation
- La FidélisationDocument2 pagesLa Fidélisationjawad bennarPas encore d'évaluation
- Exercices Résolus 2Document10 pagesExercices Résolus 2ScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- UTC Formation 2009 Le SMED (Mode de Compatibilité) (Réparé)Document88 pagesUTC Formation 2009 Le SMED (Mode de Compatibilité) (Réparé)Mohamed ELmejriPas encore d'évaluation
- Chap2 - Entrepreneuriat PDFDocument10 pagesChap2 - Entrepreneuriat PDFGuesmi MariemPas encore d'évaluation