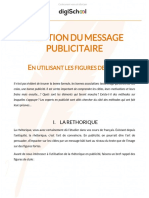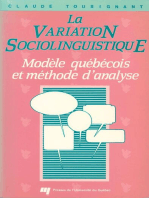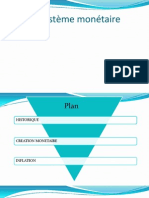Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Communication Cours
Communication Cours
Transféré par
rachid45Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Communication Cours
Communication Cours
Transféré par
rachid45Droits d'auteur :
Formats disponibles
Introduction
Dfnition et cadre thorique de la
communication
La communication dentreprise
(complmentarit interne-externe)
la dmarche stratgique de la
communication
La communication interne
conclusion
Le terme communiquer, tre en relation
a!ec, est apparu au cours du "#$me si$cle et
signifait % cette poque participer %& 'ette
expression est proche du terme latin
communicar, c(est-%-dire partager une
ide& '(est seulement au ")$me si$cle que le
terme partager a engendr la signifcation
*aire partager une nou!elle& +u *ur et %
mesure que le temps a pass, le terme
communiquer a commenc % signifer
transmettre & '(est seulement au cours du
,-$me si$cle que le terme communication
est apparu dans le !oca.ulaire scientifque&
le .ut poursui!i
Le r/le du rcepteur
Le t0pe de relation cre
Lin*ormation !a dans un seul sens, de
lmetteur au rcepteur 1 la
communication !a dans plusieurs sens,
chaque metteur de!ient rcepteur
rciproquement dans la mme
squence de communication&
La communication est % la *ois
acte
o.2et
mo0en
Lorigine de cette conception se trou!e
aux 3tats-4nis % La fn des anne #-
dans les tra!aux de 'laude shannon&
est purement linaire (transmission
unilatrale)
5intresse de *a6on quantitati!e % la
technique de transmission
La thorie mathmatique de la
communication a connu un tr$s grand
succ$s dans de nom.reuses disciplines
scientifques comme, par exemple la
linguistique&
7oute*ois, ce mod$le est critiqua.le
pour sa linarit, son ou.li du r/le de
contenu de lin*ormation, son a priori
sur la passi!it du rcepteur et la
neutralit du media
les recherche de 8or.ert de 9iener
apportent un concept essentiel % toute
thorie de la communication; la
rtroaction (*eed .ac<)&
3ntre rsultat s0st$me
Rtroactio
n
Les lments d(un s0st$me sont en
interaction rciproque& L(action d(un
lment sur un autre entra=ne en retour
une rponse (rtroaction ou
>*eed.ac<>) du second lment !ers le
premier& ?n dit alors que ces deux
lments sont relis par une .oucle de
*eed.ac< (ou .oucle de rtroaction)&
Lcole de palo +lto est une cole
in*ormelle qui tire son nom dune !ille
amricaine situe au sud de 5an
@rancisco, ou se sont retrou!s
plusieurs chercheurs dont les tra!aux
peu!ent tre unifs dans un mme
courant de pense&
Aregor0 Bateson (n le Cmai"C-# % Arantchester,
Do0aume-4ni E mort le #2uillet"CF- % 5an @rancisco)
est un anthropologue, ps0chologue, pistmologue
amricain
Gaul 9atHlaIic<, n le ,J2uillet"C," % Killach (
+utriche) et mort le L"mars,--M&Gs0chologue,
ps0chothrapeute, ps0chanal0ste et sociologue, ses
tra!aux ont port sur la thrapie *amiliale et la
ps0chothrapie gnrale&
Na0 Oale0 ("C 2uillet "C,L- "L *!rier ,--M) est un
pionnier amricain de la thrapie *amiliale
Donald Nac<son (,F 2an!ier "C,-, ?a<land, 'ali*ornie -
,C 2an!ier "C)F, @oster 'it0, 'ali*ornie) est un
ps0chiatre amricain, pionnier de la thrapie *amiliale
et de la thrapie .r$!e
re2et du mod$le de 5hannon considr
comme inadquat aux sciences sociales
introduit laxiome sui!ant; on ne peut
pas ne pas communiquer&
?n ne peut dissocier un message !er.ale
conscient de son contexte
la communication !er.ale et la
communication non !er.ale *orme un
ensem.le intgr
Charles Sanders Peirce (
"- septem.re "FLC - "C a!ril "C"#)
Ferdinand de Saussure (,)
no!em.re"FJM-,,*!rier"C"L)
dcompose le signe en deux termes, le
signifant et le signif, relis entre eux
par un mode de signifcation&
Le signifant est lexpression du signe
le signif est le contenu
mode de signifcation; accord entre
lmetteur du signe et le rcepteurP
con!ention essentielle pour une
comprhension du signif par le
rcepteur
Dans la.solu une communication sera
eQcace si % chaque signifant
correspond un seul signif et si,
in!ersement % chaque signif
correspond un seul signifant& ?n parle
alors de signe monosmique&
il arri!e tr$s sou!ent quun seul
signifant corresponde % plusieurs
signifs tout comme un seul signif
peut sexprimer % tra!ers plusieurs
signifant, on parle alors dun signe
pol0smique&
Lmetteur doit choisir son codeP ce
choix est li % la distinction entre
dnotation et connotation
Il 0 a dnotation lorsque le signif est
construit o.2ecti!ement alors que la
connotation exprime une !aleur
su.2ecti!e lie au signe du *ait de sa
*orme et de sa *onction&
Message
involont
aire
rcepte
ur
Transmissi
on du
message
Rcepti
on du
messag
e
Dcodag
e du
message
bruits
Codag
e du
messa
ge
Message
volontair
e
missio
n du
messag
e par un
support
Rcepti
on du
messag
e
Dcoda
ge du
messag
e
rtroacti
on
source
Les lments de lentreprise
communiquent entre eux
(communication interne) et a!ec
len!ironnement externe
(communication externe)
La communication externe de
lentreprise de lentreprise re!t
plusieurs dimensions;
La communication externe
oprationnelle des mem.res de
lentreprise a!ec leurs diRrents
partenaires ou interlocuteurs&
La communication externe
stratgique: celle-ci a deux aspects;
La communication externe % !ocation
anticipatrice de constitution de
rseaux
Lcoute externe (a!ec par*ois
rtroaction donc communication pour
lentretenir et la stimuler)
Lin*ormation externe de notorit;
Dans ce cas, ce ne sont plus les
mem.res de lentreprise qui
communiquent, mais linstitution E
entreprise qui in*orme, afn de *aire
connaitre ses produits, damliorer son
image gnrale ou de d!elopper sa
notorit&
Les modalits din*ormation
externe de notorit sont donc
multiples& Il en est une autre,
cependant, que les entreprises ont
sou!ent tendance ou.li; la
possi.ilit par chacun des salaris de
promou!oir son entreprisse au
quotidien, dans le cadre de tous ses
contacts externes, personnels ou
pro*essionnels&
cela suppose trois conditions de .ase;
Suil le sache (ce qui re!oie % la
communication interne)
quil en soit con!aincu,(ce qui
ncessite une cohrence entre les
discours et les actions concr$tes)
Suil ait en!ie den parler ( ce qui
repose sur une certaine moti!ation)
La communication de
lentreprise doit etre
globale et sinscrire dans
une stratgie densemble
Bien !idemment, tous les t0pes
dcart entre communication interne et
externe ne posent pas de pro.l$me, 4n
certain cart entre la ralit
quotidienne et les messages de
communication externes peut donc
etre considr comme ncessaire&
'eux qui le sont moins, en re!anche
rel$!ent des deux cas sui!ants;
+.ondance de communication
externe et a.sence de
communication interne&
Dichotomie excessi!e (!oire
mensong$re) entre image destine %
len!ironnement et la ralit interne
cessit de cohrence
3n mati$re de contenu
3n mati$re de processus
1
re
tape; anal0ser la situation et
diagnostic
,
$me
tape; choix dun positionnement
3
me
tape; choix des o.2ecti*s
#
$me
tape; Description des ci.les
J
$me
tape; choix du message
)
$me
tape; 'hoix des mo0ens de
communication
M
$me
tape; La planifcation des mo0ens
interne externe
5tratgie de
communicati
on
dentreprise
(interne)
5tratgie de
communicati
on
commerciale
5tratgie de
communicati
on
dentreprise
Gu.licit
Gromotion
Tercatique
directe
'ommunication
!nementielle&
'ommunicatio
n
institutionnelle
'ommunicatio
n de
recrutement
'ommunicatio
n fnanci$re
C!MM"#C$T#!
%&T%R%
C!MM"#C$T#! #T%R%
+nal0se du plan de
marchage; produit, prix,
distri.ution&
+nal0se de lattitude et du
comportement
+nal0se de l(en!ironnement ;
concurrence, march&
+nal0se de la communication
antrieure&
+8+LU53 +nal0se de lexistant;1 qui dit
quoiV Dans quel cadreV +!ec
quels eRetsV
Lanal0se porte sur;
Les in*ormations oprationnelles
Les in*ormations moti!antes
Le .arom$tre du climat social
50nth$se;
@orces1*ai.lesses
Tenaces1opportunits
diagnostic 50nth$se ;
@orces1*ai.lesses
Tenaces1opportunits
C!MM"#C$T#!
%&T%R%
C!MM"#C$T#! #T%R%
'omment
D!elopper la notoritP
construire une image
*orte P susciter un
intrt, fdliserW&
+lors que la concurrence
est !i!eP que la marque
ne prsente pas
da!antage
concurrentiel, que le
.udget est *ai.leW&
Gro.l$me %
rsoudre
'omment amliorer la
circulation de lin*ormation P
d!elopper lin*ormation
ascendanteP *drer le
personnelP intresser, moti!er,
mo.iliser le personnel&
+lors que la structure, le climat
social, la suspicion, la rumeur
Wconstituent des *reins
Suelle est limage des
produits, de la marque,
de linstitution que lon
souhaite d!elopper
dans lesprit du pu.licV
cette image doit etre
crdi.le, attracti!e et
spcifque&
positionnement Suelle est limage interne que
lon souhaite d!elopper dans
lesprit du personnelV 3lle doit
etre en adquation a!ec
limage externe, elle doit
exprimer la !ocation, la
mission, les !aleurs de
lentreprise, elle doit etre
crdi.le et attracti!e et
pourquoi pas spcifque& 3lle
est exprime dans le pro2et
dentreprise&
C!MM"#C$T#!
%&T%R%
C!MM"#C$T#! #T%R%
?.2ecti*s; *aire connaitre,
*aire aimer, *aire agir&
'i.les
'lients1consommateur
InXuenceurs1prescripteur
Teneurs dopinion1 relai
din*ormation
Distri.uteur1*orce de !ente
stratgie de
communication
?.2ecti*s; in*ormer, *drer,
moti!er&
'i.les;
7ous le personnelP
segmentation par entreprise,
par ta.lissementP
segmentation par *onction,
ser!ice, segmentation par
catgorie hirarchique
Tdias; 7K presse
aQchage radio cinma
internet slection des
supports
Oors-mdia promotion,
mar<eting directe,
parrainage1
mcnatP relations
pu.liques
mo0ens 70pes doutils; crits; note,
rapport, compte rendu,
aQchage, .ulletin
din*ormation, magaHine
interneW&
?raux; rencontres, runions,
tlphone
+udio!isuels; flms, diaporama,
!ido dentreprise, messagerie
lectronique, intranet W&
La connaissance de lentreprise
Limage de lentreprise
Lapprciation gnrale de lentreprise
Lapprciation des !aleur interne
La satis*action au tra!ail
Lapprciation de la communication
interne
La confance dans lentreprise
Les attentes personnelles
3tc&
Le cadre de rfrence qui garantit lunit
du personnel et stimule sa mobilisation.
Dappel de la !ocation
3xpression dune am.ition
+Qrmation des !aleurs
Dfnition des o.2ecti*s % atteindre
3xposition dun plan daction
5a nature;'est une action mais aussi un tat&
5a perception; 3lle est sou!ent considre
comme *ondamentale pour ceux qui la mettent
en Yu!re mais secondaire, inutile !oire
superfcielle pour les salaris&
5on o.2et; Le personnel est % la *ois destinataire
et acteur de communication interne, il *aut le
sduire, le persuader et le con!aincre&
Gersonnel am.assadeurs de lentreprise
5on action;+ long terme
5es contraintes;'e qui *orge du pou!oir cest la
dtention de lin*ormation
Les consquences seraient nom.reuses ;
La paix sociale se dgraderait asseH
rapidement
Les conXits latents exploseraient
Les salaris ne seraient pas eQcaces parce
que mal-in*orms et peu colla.orati*s
Les meilleurs lments iraient !oir ailleurs
Les messages !hiculs % lextrieur
seraient incohrents
UNE ORGANISATION SANS
COMMUNICATION INTERNE?
3Z ; Danone, qui tait une des marques
pr*re des @ran6ais
Des emplo0s mcontents ont *ait un site en
parall$le au site oQciel& La presse a eu !ent
de lexistence de ce site& Limage de la
marque est descendue, ses !entes aussi&
[\ 4ne excellente communication externeW
compl$tement rduite % nant pour une
carence en communication interne&
DES DEGATS COLLATERAUX
-
3n staR (structure spcialise ou intgre
-
Direction
-
Tixte (interne et externe E agence de communication)
-
3xterne pure
COMMUNICATION DANS
LORGANIGRAMME
] Les ^classiques_
- Sualit de rdaction (2ournalistique)
- 7echniques de recoupement (ne pas se fer % une seule source)
- Gratique de linter!ieI et du portrait
- DeIriting
- Ghotographie
- Araphisme
] Les ^modernes_
- Aestion de pro2et
- 'apacit stratgique % comprendre les en2eux
- 'apacit dcoute et do.ser!ation
- Tanagement, gestion dune quipe
- ?rganisation d!nements
- Grise de parole en pu.ic
- 'onnaissance des outils de gestion ditoriale (9e.)
LES QUALITES DUN COMMUNICATEUR
ES TEMPS DE COMMUNICATION
'ommunication descendante ou
hirarchique ; elle part du haut de la
p0ramide !ers le .as& 3lle a pour .ut de
diRuser les in*ormations r$glementaires,
din*ormer et expliquer un pro2et %
lensem.le du personnel&
Supports utiliss; 2ournal interne, notes de
ser!ice, panneaux daQchage, ser!eur
internet, runionsW&
La communication ascendante ou
salariale, elle part des salaris
pour remonter !ers la hirarchie ou
la direction&
3lle peut etre pro!oque et organise
par les s0ndicats ou tout autre
comit, comme elle peut etre
spontane&
3lle permet de !rifer et de dtecter
d!entuelles anomalies en mati$re de
communication interne et *aire remonter
les attentes et rclamations des salaris&
5upports; dialogue, .oite % ides, 2ournal
s0ndical, aQchage, lettre ou!ertes,
d.ats, runions dexpression,
sondagesW&
La communication horiHontale; elle
*a!orise lchange de lin*ormation
entre les diRrents acteurs de
lorganisation& 3lle a pour o.2ecti*, le
partage de connaissance entre ces
diRrents acteurs et lintgration de
ses connaissance dans la prise de
dcision&
8ous proposons da.ord de considrer quil existe
deux t0pes de communication in*ormelle;
Dune part la communication non !er.ale
anal0se par les chercheurs de palo-+lto , qui
reste indissocia.le du !er.al et se traduit dans
un comportement glo.alP
Dautre part la communication !er.ale
in*ormelle qui correspond aux changes non
structurs ou non pr!us % la!ance dans
lorganisation&
dimension in*ormelle de la
communication ne peut pas etre
nglige& Dans lentreprise elle se traduit
par les relations interpersonnelles et les
changes din*ormation en dehors des
cadres prta.lis de communication&
La communication *ormelle et la
communication in*ormelle doi!ent se
complter utilement, pour leQcacit et
la sant interne de lorganisation&
La communication interne na pas pour
mission din*antiliser, daliner, de
manipuler ou ser!ir la langue de .ois;
3lle met en place un langage commun
en organisant les relations entre
indi!idus et lentreprise
3lle ncarte pas de son champ daction
les dsaccords, les conXits et les crises
sachant quil n 0 a pas de pire crise que
la non-crise&
La communication interne est un outil
eQcace pour ren*orcer la cohsion du
groupe et stimuler la moti!ation
lenthousiasme leQcacit et la
capacit dinno!ation des salaris&
'elle-ci doit ncessairement sinscrire
dans une dmarche de communication
glo.ale en cohrence a!ec la
communication externe de lentreprise&
La communication dentreprise nest pas une
discipline fge, cest un domaine en !olution
constante& ?n assiste au2ourdhui % une remise en
cause de la communication dentreprise et de sa
lgitimit&
'est la parole mme de lentreprise qui est en d.at&
5ur des th$mes comme la communication sur le
risque ou sur len!ironnement, le discours de
lentreprise a une crdi.ilit quasi nulle& 7out ceci
plonge le communicant dans un srieux paradoxe o`
il est exig de lui de diRuser une in*ormation tou2ours
plus importante et transparente, et dans le mme
temps il lui est signif que sa parole nest pas
crdi.le et donc que sa diRusion din*ormation naura
aucun eRet pratique
B+D7?LI (+88I3) ; communication et organisation: pour une
politique gnrale corente!, les ditions dorganisation, "CC-&
Da'+4DI8 (N3+8-T+D') ; la communication mar"eting:
concepts# tecniques# stratgies, adition conomica, paris,
"CCC&
D3T?87-L?A?L (LILI+83), b3TG@ (+L+I8), D+GID3L( T+D7I83),
5'IB377377+ (T+D7I83) ; La communication des entreprise:
stratgies et pratique !# dition armandi colin, ,--)&
LIB+3D7 (7hierr0); $ommuniquer dans un monde incertain,
dition Gearson - Killage Tondial, paris, ,--F&
LIB+3D7 (7OI3DDU), D( +LT3ID+(8I'?L3%: La communication
interne de l&entreprise!, dition duno., ,--M&
T+L+K+L (Ghilippe) D3'+4DI8 (Nean-Tarc) B38+D?U+
('hristophe);'entacom : $ommunication : torie et
pratique!, Gearson 3ducation, paris, ,--J&
Vous aimerez peut-être aussi
- Chandeliers JaponaisDocument521 pagesChandeliers Japonaisnepascal94% (35)
- Cours de Techniques de CommunicationDocument63 pagesCours de Techniques de Communicationlezoul mohammed100% (1)
- La Semiologie de Limage PublicitaireDocument36 pagesLa Semiologie de Limage PublicitaireDounia Ti100% (2)
- Cours Communication EntrepriseDocument45 pagesCours Communication EntrepriseHØu ÇîNePas encore d'évaluation
- Techniques de CommunicationDocument14 pagesTechniques de CommunicationAicha100% (2)
- Les Formes de La CommunicationDocument3 pagesLes Formes de La CommunicationMohamed AghmirPas encore d'évaluation
- Cours D'auditDocument171 pagesCours D'auditrmahmoud94% (18)
- Technique de Communication Ecrite Et Orale DirectDocument9 pagesTechnique de Communication Ecrite Et Orale DirectTchelourougo CoulibalyPas encore d'évaluation
- La Communication OraleDocument3 pagesLa Communication OraleSoufiane SegPas encore d'évaluation
- Outil 5 Pratiquer Le Questionnement PhilosophiqueDocument3 pagesOutil 5 Pratiquer Le Questionnement PhilosophiquezerorezdoPas encore d'évaluation
- Communication D'entrepriseDocument45 pagesCommunication D'entrepriseBabi bch100% (1)
- COURS LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION-Enseignant Roger DALAM-L2 GRH MEC-UAMI20200616-105429-nxej3oDocument43 pagesCOURS LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION-Enseignant Roger DALAM-L2 GRH MEC-UAMI20200616-105429-nxej3oTay Ssir100% (1)
- COMMUNICATIONDocument21 pagesCOMMUNICATIONamirPas encore d'évaluation
- Support Communication InterpersonnelleDocument91 pagesSupport Communication InterpersonnelleAbderahmane Djebali100% (2)
- La Connaissance de Soi Est Le Commencement de La Sagesse Et de L'éducationDocument10 pagesLa Connaissance de Soi Est Le Commencement de La Sagesse Et de L'éducationJoop-le-philosophe0% (1)
- La Communication Écrite Bentahir NahlaDocument57 pagesLa Communication Écrite Bentahir NahlaBoutayna El KarchPas encore d'évaluation
- Manuelle Technique de L'auditDocument296 pagesManuelle Technique de L'auditfzelPas encore d'évaluation
- La Communication Verbale Non-VerbaleDocument19 pagesLa Communication Verbale Non-VerbaleseptimironPas encore d'évaluation
- Technique de Communication 2Document8 pagesTechnique de Communication 2SamyChemala100% (1)
- Obstacle CommunicationDocument4 pagesObstacle Communicationmamadouhihu100% (2)
- Dossier de Pratiques ProfessionnellesDocument17 pagesDossier de Pratiques ProfessionnellesMatthieu BlgPas encore d'évaluation
- Conduite de Projet Multimédia - Intro - 2020Document79 pagesConduite de Projet Multimédia - Intro - 2020setous100% (1)
- BNP Paribas Produits Derives Change Taux Et ActionsDocument179 pagesBNP Paribas Produits Derives Change Taux Et Actionsrachid452428Pas encore d'évaluation
- C1 Cycle StirlingDocument6 pagesC1 Cycle Stirlingعمر الفاروق صانع حضارةPas encore d'évaluation
- 2015-09 Formation Alize Niv1&2-Maroc CorrigesDocument33 pages2015-09 Formation Alize Niv1&2-Maroc CorrigesZeroual100% (3)
- Mo CNC Ours ProfDocument3 pagesMo CNC Ours Profqaadil0% (1)
- La Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesD'EverandLa Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cours de CommunicationDocument23 pagesCours de CommunicationKawtar ElPas encore d'évaluation
- Schéma de JakobsonDocument25 pagesSchéma de JakobsonBOBPas encore d'évaluation
- Cours CI-MRHDocument45 pagesCours CI-MRHNISSRINE BENTABETPas encore d'évaluation
- La Communication Interpersonnelle. SyntheseDocument9 pagesLa Communication Interpersonnelle. SyntheseNI CH100% (1)
- Cours Compte RenduDocument3 pagesCours Compte RenduAmen100% (1)
- La Communication de L'entreprise Et Le DigitalDocument50 pagesLa Communication de L'entreprise Et Le DigitalAmine Choraichi100% (1)
- CHAP 2 Techniques de Communication OraleDocument27 pagesCHAP 2 Techniques de Communication OraleHamouda AzzouzPas encore d'évaluation
- Communication Professionnelle Cours PDFDocument2 pagesCommunication Professionnelle Cours PDFJackie100% (2)
- Theme Iii La Communication Des OrganisationsDocument24 pagesTheme Iii La Communication Des OrganisationsARIF LO100% (1)
- Les Freins À La CommunicationDocument3 pagesLes Freins À La CommunicationmariemPas encore d'évaluation
- QCM CommunicationDocument6 pagesQCM CommunicationRigo SantyPas encore d'évaluation
- Le Schéma de La CommunicationDocument4 pagesLe Schéma de La CommunicationAdnan AlaouiPas encore d'évaluation
- La PersuasionDocument14 pagesLa PersuasionAkherraz AbirPas encore d'évaluation
- La CommunicationDocument24 pagesLa CommunicationmarouanePas encore d'évaluation
- 11 ELT Machines ElectriquesDocument76 pages11 ELT Machines ElectriquesFifi JojoPas encore d'évaluation
- TracabiliteDocument20 pagesTracabiliteJad Haydar Mohamed Bouangua100% (1)
- La Communication OraleDocument3 pagesLa Communication Oraleadam_3000100% (2)
- Futures PDFDocument23 pagesFutures PDFrachid45Pas encore d'évaluation
- Massart Victoria - L Entrepreneur Au Coeur de La Notion D Entrepreneuriat - MemoireDocument120 pagesMassart Victoria - L Entrepreneur Au Coeur de La Notion D Entrepreneuriat - MemoireKushinada100% (2)
- Sur La Notion de Communication Socio-PolitiqueDocument8 pagesSur La Notion de Communication Socio-PolitiqueAlainzhuPas encore d'évaluation
- Situations de Communication - OdtDocument4 pagesSituations de Communication - OdtInes NajjarPas encore d'évaluation
- Exposé AbderrahimDocument12 pagesExposé AbderrahimrahimPas encore d'évaluation
- Chapitre1 Communication InterpersonnelleDocument13 pagesChapitre1 Communication InterpersonnelleSamira HARRAT100% (1)
- La Sémiologie de La PublicitéDocument35 pagesLa Sémiologie de La Publicité14zachariPas encore d'évaluation
- Communication PublicitaireDocument11 pagesCommunication PublicitairePeter AlzoPas encore d'évaluation
- Cours Technique D'expression Et de CommunicationDocument2 pagesCours Technique D'expression Et de Communicationمريم عصامPas encore d'évaluation
- Analyse Sémiotique de Quelques Images Publicitaires de La Boutique Yves Rocher de BejaiaDocument83 pagesAnalyse Sémiotique de Quelques Images Publicitaires de La Boutique Yves Rocher de BejaiaNinPas encore d'évaluation
- La CommunicationDocument5 pagesLa CommunicationOverDoc100% (1)
- Le Schéma de CommunicationDocument8 pagesLe Schéma de Communicationmohamed laafifPas encore d'évaluation
- Greimas - L' Analyse Figurative, Thématique Et AxiologiqueDocument5 pagesGreimas - L' Analyse Figurative, Thématique Et AxiologiqueErimar Wanderson da C CruzPas encore d'évaluation
- chapitreII La CommunicationDocument16 pageschapitreII La CommunicationAMINE EL MEDPas encore d'évaluation
- Psychologie de La Communication Et de La Relation 17.09.2004Document7 pagesPsychologie de La Communication Et de La Relation 17.09.2004Anonymous RyHZ0ISas100% (1)
- Les Types de Communication 1Document8 pagesLes Types de Communication 1Roua HaddadPas encore d'évaluation
- Manuel de Cours de La Communication Appliquée: La PublicitéDocument44 pagesManuel de Cours de La Communication Appliquée: La Publicitéfpudva100% (3)
- Module de CommunicationDocument21 pagesModule de CommunicationattiamoPas encore d'évaluation
- Cours La Communication Soaciale PDFDocument31 pagesCours La Communication Soaciale PDFBadre ElogriPas encore d'évaluation
- Chapitre 2. Généralité Sur La CommunicationDocument6 pagesChapitre 2. Généralité Sur La Communicationmimitala70Pas encore d'évaluation
- SémiologieDocument10 pagesSémiologieCelyann Massengo0% (1)
- Chapitre 2 La Communication Interpersonnelle 1Document2 pagesChapitre 2 La Communication Interpersonnelle 1Abderrahman ChouhbiPas encore d'évaluation
- DR Kirioua 2022-2023 Cours Semiologie de L'image Licence 1 Production AudiovisuelleDocument36 pagesDR Kirioua 2022-2023 Cours Semiologie de L'image Licence 1 Production AudiovisuellekodjaPas encore d'évaluation
- Cours La CommunicationDocument24 pagesCours La CommunicationCH BtissamPas encore d'évaluation
- La Presse DP1 SA-SCDocument59 pagesLa Presse DP1 SA-SCGeneral Game15Pas encore d'évaluation
- Generalite CommunicationDocument7 pagesGeneralite Communicationbenabdallahemna95Pas encore d'évaluation
- Modèles-Avantage Et LimitesDocument4 pagesModèles-Avantage Et LimitesFatima OuammiPas encore d'évaluation
- Cours CommunicationDocument17 pagesCours CommunicationSoukaina Amine0% (1)
- Communication Creation Du Message PublicitaireDocument11 pagesCommunication Creation Du Message PublicitaireSoufiane SegPas encore d'évaluation
- La Variation sociolinguistique: Modèle québécois et méthode d'analyseD'EverandLa Variation sociolinguistique: Modèle québécois et méthode d'analysePas encore d'évaluation
- Syseme-MonetaireDocument31 pagesSyseme-Monetairerachid45Pas encore d'évaluation
- 1 - Le Cycle EconomiqueDocument32 pages1 - Le Cycle Economiquerachid45100% (3)
- Exercices Sur Les Produits Derives PDFDocument3 pagesExercices Sur Les Produits Derives PDFrachid45Pas encore d'évaluation
- Comptes Et Indicateurs - Les Comptes TrimestrielsDocument25 pagesComptes Et Indicateurs - Les Comptes Trimestrielsrachid45Pas encore d'évaluation
- Cour Economie MonetaireDocument83 pagesCour Economie Monetairemarecna67% (3)
- Cfa230 Boisselier Evaluation 1Document10 pagesCfa230 Boisselier Evaluation 1rachid45Pas encore d'évaluation
- Avis Min IndDocument5 pagesAvis Min IndOthman KingPas encore d'évaluation
- Synthèse Des Corrections de BTS Session 2009Document4 pagesSynthèse Des Corrections de BTS Session 2009Albert GrosperrinPas encore d'évaluation
- Catalogue Cuisine SchmidtDocument170 pagesCatalogue Cuisine SchmidtRafik BenhendaPas encore d'évaluation
- Ingenieurs Specialistes Pour Le Metro D Abidjan 1680865230Document2 pagesIngenieurs Specialistes Pour Le Metro D Abidjan 1680865230BAHOUE CédricPas encore d'évaluation
- Cours - Active Directory V1Document16 pagesCours - Active Directory V1Filipe ArriPas encore d'évaluation
- ISO 2409 - Essai QaudrillageDocument11 pagesISO 2409 - Essai QaudrillagePOLY DavidPas encore d'évaluation
- Poly Num PDFDocument117 pagesPoly Num PDFVy TrieuPas encore d'évaluation
- العدد 42 مكرر أ مؤمنDocument8 pagesالعدد 42 مكرر أ مؤمنAsmaa Amin0% (1)
- Ad Acp3Document5 pagesAd Acp3SioudaPas encore d'évaluation
- Section Consulaire de L'ambassade Du Portugal À Alger - AlgérieDocument8 pagesSection Consulaire de L'ambassade Du Portugal À Alger - Algériebelil206Pas encore d'évaluation
- Planning Cours Neoness Batignolles 1513602184Document1 pagePlanning Cours Neoness Batignolles 1513602184TsipkotsPas encore d'évaluation
- Oeuvres Complètes de Buffon V 27 PDFDocument543 pagesOeuvres Complètes de Buffon V 27 PDFEmile MardacanyPas encore d'évaluation
- FIC E: La GrammaireDocument8 pagesFIC E: La GrammaireAurelius Samuel Sumuni d'AlfredPas encore d'évaluation
- Munca Manual-Franceza-A1Document4 pagesMunca Manual-Franceza-A1Ioana BratuPas encore d'évaluation
- Contrat Assistance TechniqueDocument9 pagesContrat Assistance TechniqueKp SoroPas encore d'évaluation
- La Néologie en TamazightDocument10 pagesLa Néologie en TamazightTasedlist100% (3)