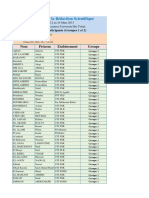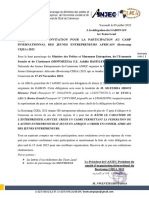Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rapport CID Final
Rapport CID Final
Transféré par
Benhmaida HananTitre original
Copyright
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentRapport CID Final
Rapport CID Final
Transféré par
Benhmaida HananSommaire………………………………………………………………………………...
……1
Remerciements …………………………………………..……………………………….…..2
Liste des figures………………………………………………………………………………3
Introduction …………………………………………………………………………………..6
Chapitre1 : Présentation de l’organisme d’accueil .…………………………………….…7
Chapitre2 : Présentation du projet ………………………………………………………..10
-Contexte général du projet ……..……………………………………….………...10
-Les contraintes du projet…………………………..……………………….………11
-Le problème d’ensablement……………………………………………….………14
Chapitre3 : Aperçu sur l’ICTAAL (Instructions sur les conditions techniques
d’aménagement des autoroutes de liaison) ……………………………………...………18
Chapitre4 : Etude de définition du tronçon autoroutier « Laayoune – Dakhla » ……20
-Choix du couloir de passage ……..………………………………………………20
-Modèle numérique de terrain (Logiciel Global Mapper) ……….……..20
-Tracé en plan ……………………………………………………………….22
-Profil en long ……………………………………………………………….24
-Profil en travers (Choix du profil en travers type)……….…….……….27
-Modélisation avec logiciel Autocad Civil 3D ……………………………………30
-Modélisation avec logiciel Piste …..………………………………………………38
-Choix de la structure du chaussée ………………………………………………..52
-Calcul hydrologique ……………………………………………………………….56
Chapitre5 : Solutions proposées pour le problème d’ensablement ………….…………72
Difficultés rencontrés durant le stage ………………………………………….…………89
Apport technique du stage ………………………………………………….……………..90
Conclusion…………………………………………………………………………………...91
Références Bibliographique……………………………………………………………......92
Annexes………………………………………………………………………...…………....93
1
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il
apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à
ceux qui nous ont beaucoup aidés au cours de ce stage, et même à ceux qui ont
eu la gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable.
Nous tenons à exprimer notre respectueuse reconnaissance à M. ATTOU chef
de département autoroutes pour son accueil au sein de CID, et nous accorder
l’opportunité d’effectuer un stage dans le domaine qui nous inspire le plus.
Nous tenons aussi à exprimer nos profondes gratitudes à monsieur
OUAJJOU Mohammed Amine, l’ingénieur spécialisé dans ce domaine pour son
encadrement tout au long de cette période de stage, ses conseils, et l’expérience
enrichissante qu’il nous a transmis.
Nous remercions également tous les ingénieurs et les techniciens de CID qui
nous ont accueillis dans leur bureau durant la période de notre stage.
2
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -1- Organigramme de l’organisme d’accueil……………………………...8
Figure -2- Réseau routier des provinces sahariennes 1988 …………………..…10
Figure -3- Cartes des contraintes .............................................................................11
Figure -4- Contraintes physiques ............................................................................11
Figure -5- Contraintes naturelles ............................................................................12
Figure -6- Contraintes humaines ............................................................................12
Figure -7- Légende de la carte des contraintes......................................................13
Figure -8- Exemples d’ensablement……………………………...……………….14
Figure -9- Exemple d’ensablement………………………………………………..15
Figure -10- Cartes de répartition des sites sensibles à l’ensablement en Afrique
du nord (d’après Caudé Gaussen, 1994)……………………………………..…..15
Figure -11- Cartes des zones d’ensablement au Maroc…………………………16
Figure -12- La norme française I.C.T.A.A.L……………………….……………..19
Figure -13- Interface du logiciel « Global Mapper » ……………………………20
Figure -14- L’air d’étude exporte vers Global Mapper…….…….…….….….....21
Figure -15- Choix du couloir de passage à l’aide des courbes de niveau fournis
par Global Mapper……………………………………………………………….…21
Tableau 1 – Les rayons de la norme I.C.T.A.A.L……………………………..….22
Figure -16- Zone d’ensablement proche de Laayoune………….………………23
Figure -17- Sens des vents dominants d’après le site « fr.windfinder.com »….23
Tableau 2 – Le profil en long dans la norme I.C.T.A.A.L……………………….25
Tableau 3 – Le profil en long dans RMDEM……………………………………..25
3
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Tableau 4 – Changement de déclivités et rayon de visibilité………….………..26
Figure -18- Eléments d’un profil en travers d’une section courante…….…….27
Figure -19- Interface global du Civil 3D ……………………………...…………..30
Figure -20- Couloir de passage avec courbe de niveau Tronçon Laayoune-
Boujdour…………………………………………………………...……………….31
Figures -21,22 et 23 - Etapes de création de l’axe ……………………...…32 et 33
Figure -24- L’axe du l’autoroute (En couleur rose)………………………..……33
Figure -25- Création du profil en long terrain naturel ………………………...34
Figure -26- Création du profil en long projet …………………………..………34
Figure -27- Création du profil en long projet………………………………..….35
Figure -28- Saisi des données pour profil en long……………….……………..36
Figure -29- Cartouche du profil en long ………………………………………..36
Figure -30- Création du profil en travers type…………………………...……..37
Figure -31- Le profil en travers type sur Civil 3D……………………………...37
Figure -32- Logiciel Piste 5……………………………………………………….38
Figure -33- Interface logiciel Piste 5…………………...………………….……..39
Figure -34, 35- Lecture des données topographiques sur Piste……………….41
Figure- 36-37- Triangulation et édition des courbes de niveau ........................42
Figure -38- Conception plane…………………………………………………….43
Figure -39- Création des points et des droites………………………………….43
Figure -40-41- Création des cercles et des colthoides…………………………44
Figure -42-43-44- Création du fichier .PIS……………………………………...45
Figure -45-46- calcul du terrain naturel………………………………………...46
Figure -47-48- calcul des dévers…………………………………………………47
Figure -49-50- réalisation du profil en long……………………………………48
4
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -51-52- saisie des caractéristiques de la plateforme, déblai …………49
Figure -53-54-55- création des profils en travers courant…………………50-51
Tableau -5- Statistique des comptages 2013 et 2014 ………………….………..53
Figure -56- Fiche de dimensionnement de chaussée GB3……………………..55
Figure -57-58- Interface de Global Mapper…………………………………….56
Figure -59-60- génération des bassins versants………………………………..57
Figure -61-62- choix des bassins versants dont le cours d’eau principale coupe
l’axe de l’autoroute………………………………………………………………..57
Figure -63-64- affichage des caractéristiques du bassin……………………….58
Figure -65- détermination de la longueur du talweg principal………………59
Figure -66- Calcul de la pente du talweg à travers le PL………..…………….64
Figure -67- Typologie de dune littorale…...………………………………….…79
Figure -68- Travaux de déblayage du sable de la chaussée……………………80
Figure -69- Impact des remblais accumulés près de la chaussée sur
l’ensablement de la route………………………………………………….............81
Figure -70- Rehaussement de la chaussée pour faciliter le transit des sables..81
Figure -71- Les techniques utilisées à Tarfaya……………………………….......82
5
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
L’ingénierie civile est une panoplie d’activités qui contribue au
développement du pays en édifiant des infrastructures et des superstructures
selon les règles d’art.
Ainsi ce secteur requiert des acteurs ayant acquis les connaissances, les
compétences et les outils nécessaires pour faire un travail fructueux et aboutir à
des constructions et des édifices de bonne qualité et de long rendement, c’est la
mission des ingénieurs génie civil.
Pour ceci l’Ecole Hassania des Travaux Publics a prévu un parcours
estudiantin où l’élève ingénieur est amené à passer un stage estival lui
permettant d’intégrer le milieu professionnel et de concrétiser ses connaissances
théoriques. Après un stage d’initiation professionnelle l’an dernier, le stage
ingénieur prévu à la fin de la deuxième année vient renforcer ceci. Pendant six
semaines, l’élève ingénieur doit participer à l’élaboration d’un projet réel de
génie civil.
Dans ce cadre, nous avons eu l’opportunité de passer notre stage
ingénieur au sein du bureau d’étude «Conseil, Ingénierie, Développement
(CID) », et durant lequel on nous a confié la tâche de participer à l’étude de
définition d’une autoroute qui va relier la ville de Laayoune et la ville de
Dakhla. Les objectifs de ce stage sont :
Intégrer le milieu de travail des ingénieurs en respectant les
contraintes.
La mise en exerce des acquis théoriques que nous avons appris
durant les deux années d’étude.
6
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
CHAPITRE 1 :
PRESENTATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL
CID : Conseil, ingénierie et Développement
1- Présentation de l’organisme d’accueil : "C.I.D."
Créée en 1981, la CID -Conseil Ingénierie Développement- est une société
d'ingénierie pluridisciplinaire intervenant dans les projets de génie civil, de
bâtiment, de transport et d'hydraulique. L’un des pionniers dans le domaine
de l‘ingénierie au Maroc, la C.I.D. se dote d’une équipe qui compte plus de 350
ingénieurs et techniciens et assure :
Les prestations de maîtrise d'œuvre : études techniques, études
économiques, analyses environnementales, suivi des travaux de
réalisation, ordonnancement.
Pilotage et coordination (OPC), management de la qualité, assistance à
l'exploitation et à la maintenance.
Planification des projets, préparation des termes de références,
assistance pour l'évaluation des offres et la sélection des entreprises,
suivi et pilotage des études et des investigations, assistance sur les plans
juridique et institutionnel...
2- Personnels de CID :
A chaque intervention, CID met en place une équipe pluridisciplinaire
d’ingénieurs et de techniciens, choisis en fonction de leurs compétences et de
la nature du problème posé.
Cette équipe travaille de façon intégrée sous la direction d’un chef de
projet, ingénieur de haut niveau, qui reste l’interlocuteur privilégié du client et
qui appuie son intervention sur une étroite concertation avec tous les
intervenants impliqués dans le projet, de sorte à aboutir à des solutions
optimales.
7
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3- Compétences techniques :
Pour améliorer le niveau de compétence et suivre l’évolution des
techniques et des procédés, CID réalise chaque année, pour l’ensemble de son
personnel, un programme de formation continue dans les différentes
disciplines de son activité.
4- Activités de CID :
Dans ses principaux domaines d’activités, le bureau d’études CID peut
intervenir dans toutes les phases de la vie d’un projet ou d’un ensemble de
projets :
Etudes d’identification et d’évaluation ;
Plans directeurs ;
Etudes de factibilité ;
Etudes préliminaires et d’avant-projet ;
5- Organisation de CID
Figure -1- Organigramme de l’organisme d’accueil
8
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
6- Fiche sommaire de présentation du CID
Raison sociale Conseil, Ingénierie et
Développement
Année de fondation 1982
Statut juridique Société Anonyme
Capital social 18.772.400,00 Dirhams
Effectif 250 employés dont 110 ingénieurs
Registre de commerce Rabat, n° 26.393
C.N.S.S. n° 108.4467
Identification fiscal n° 03331267
Adresse Technopolis Salé Jadida – Rabat
Boîte postale N° 1340 RP Rabat
Téléphone (0537) 57 95 00 (30 LG)
Télécopie (0537) 71 10 87
E-mail cid@cid.co.ma
Site internet www.cid.co.ma
9
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
CHAPITRE 2 :
PRESENTATION DU PROJET
1- Contexte général du projet :
Ce projet autoroutier unique de son genre, vise le renforcement des
infrastructures dans la zone Saharienne, vu que les principales villes de cette
région connaissent une croissance démographique importante, ainsi qu’un
intérêt politique très important.
Le projet en question est divisé en 3 tronçons : Guelemim-Laayoune,
Laayoune –Dakhla et Dakhla-Guerguarat, chacun d’eux a des spécificités en ce
qui concerne les contraintes, les solutions d’ensablement, et les couloirs de
passage.
Par suite, nous allons-nous intéresser à la partie que nous avons traité lors
du stage : Laayoune-Dakhla.
Figure -2- Réseau routier des provinces sahariennes 1988
10
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
2- Les contraintes du projet
Lors de l’identification du couloir de passage, on doit localiser les différentes
contraintes de l’aire de l’étude.
Figure -3- Cartes des contraintes
Ces contraintes peuvent être classées en 3 catégories :
2.1- Les contraintes physiques
Figure -4- Contraintes physiques
11
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
2.2- Les contraintes naturelles
Figure -5- Contraintes naturelles
2.3- Les contraintes humaines
Figure -6- Contraintes humaines
12
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -7- Légende de la carte des contraintes
13
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3- Le Problème d’ensablement
La mise en mouvement de sable est devenue très importante et très
menaçante au cours de ces dernières décades dans cette zone du Sahara
atlantique marocain.
L’ensablement qui se traduit en particulier par des répercussions
négatives à la fois sur les infrastructures routières, portuaires, industrielles et
agricoles et sur le développement des agglomérations urbaines et rurales, porte
un coup dur à la politique de développement économique et d'aménagement
entamée par le gouvernement dans ces régions.
Figure -8- Exemples d’ensablement
14
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -9- Exemple d’ensablement
L’ensablement qui touche la zone d’étude fait partie de l’ensablement
général qui affecte toutes les zones littorales et continentales situées en dessous
d’une ligne Agadir-Ouarzazate –Errachidia, où la dynamique éolienne est la
plus active de tout le Maroc.
La compréhension de cette dynamique est primordiale pour la
formulation d’un plan de gestion du futur Parc national.
Figure -10-
15
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -11- Cartes des zones d’ensablement au maroc
Il faut noter que les dunes sont omniprésentes sur ce secteur et ce depuis
le début du Quaternaire (2 millions d’années). Elles ont investi cette région et
ne l’ont plus jamais quitté. Les premières dunes ont modelé le paysage qui sert
actuellement de réceptacle aux dunes actuelles.
La ténacité de cette morphogenèse à travers le temps et en dépit des
variations climatiques enregistrées n’a abouti qu’à des fluctuations mineures au
niveau de l’extension, de la taille et de l’orientation des champs dunaires,
plusieurs fois millénaires dans la zone d’étude.
Expliquer une telle constance à travers le temps et comprendre quels sont
les éléments qui influent sur ce développement dunaire pour pouvoir le
contrecarrer exige que l’on connaisse les vecteurs principaux de propagation du
matériel sableux, à savoir l’océan, le relief et le vent. La combinaison particulière
16
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
réalisée dans ce secteur entre ces trois éléments est telle que le phénomène de
l’ensablement sur ce tronçon de la côte atlantique est porté à ses paroxysmes.
La mobilisation et répartition des sables dans la zone d’étude étant sous
l’emprise d’une dynamique éolienne, cette dernière exige pour son étude un
emboîtement des échelles de travail qui va de l’échelle régionale (images
satellites Landsat TM et ETM+) à l’échelle locale (photographies aériennes) et
enfin à celle du terrain et du Laboratoire.
La lutte contre l’ensablement des routes était une activité quotidienne des
services routiers de la zone saharienne, dans les couloirs soumis à ce
phénomène. Cette activité était particulièrement intense d’avril à novembre
lorsque les vents dominants viennent du nord mettant en mouvement les dunes
vives.
17
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
CHAPITRE 3 :
APERÇU GENERALE SUR L’ICTAAL
1- Objet du document et domaine d’application :
L’ICTAAL traite de la conception des autoroutes interurbaines, qu’il
s’agisse de la réalisation d’infrastructures nouvelles ou de l’aménagement du
réseau existant.
Dans cette instruction, le terme autoroute désigne une route à chaussées
séparées comportant chacune au moins deux voies en section courante, isolée
de son environnement et dont les carrefours sont dénivelés.
Il contient les principes généraux et les règles techniques fondamentales
sur ce sujet. Les études préalables, les règles et recommandations techniques de
détail sont traitées dans les documents spécialisés.
Elle ne s’applique pas :
Aux autres types de routes principales – les routes express à une
chaussée, les artères interurbaines et les "routes" – qui font l’objet du
guide Aménagement des Routes Principales (A.R.P.)
Aux routes à chaussées séparées comportant chacune une seule voie de
circulation et des créneaux de dépassement, qui feront l’objet d’une
instruction ultérieure
Aux autoroutes situées en milieu urbain, considérées comme des voies
rapides urbaines, et relevant de l’Instruction sur les Conditions
Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines
(I.C.T.A.V.R.U.), y compris lorsqu’elles assurent la continuité ou
l’aboutissement d’une autoroute interurbaine. Il est toutefois
recommandé en milieu périurbain, lorsque le caractère urbain actuel ou
futur de la voie est faible, d’appliquer les règles de l’ICTAAL.
18
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
2- Structure du document :
Ce document comprend neuf chapitres.
Le chapitre 1 : relatif à la conception générale, décrit la démarche qui
permet d’adapter le projet au contexte dans lequel il s’inscrit.
Le chapitre 2 : énonce les règles de visibilité concernant tous les aspects
de la conception.
Les trois chapitres suivants décrivent les principales caractéristiques
géométriques de l’autoroute : le tracé (3), le profil en travers (4), les
échangeurs (5).
Les chapitres 6 et 7 donnent les principes de mise en œuvre des
rétablissements d’une part, des équipements et des services à l’usager
d’autre part.
Les chapitres 8 et 9 indiquent les dispositions spécifiques s’appliquant
aux sections d’autoroute en relief difficile et à la transformation d’une
route en autoroute.
Figure -12- La norme française I.C.T.A.A.L
19
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
CHAPITRE 4 :
ETUDE DE DEFINITION DU TRONCON
AUTOROUTIER LAAYOUNE-DAKHLA
1- Choix du couloir du passage :
1.1- Le modèle numérique de terrain (Logiciel Global Mapper)
La topographie : une donnée d’entrée :
Puisqu’il s’agit d’une étude de définition, notre encadrant nous a fourni une
aire d’étude ou on peut passer notre autoroute pour avoir les cordonnées des
points constituent notre couloir de passage, on a utilisé le modèle numérique
du terrain (MNT) à l’aide d’un logiciel qui s’appelle « Global mapper ».
Figure -13- Interface du logiciel « Global Mapper »
Ce logiciel contient plusieurs fonctionnalités à savoir le téléchargement
de l’MNT à partir des serveurs de world imagery la manipulation des fichiers
Autocad sur le logiciel, la création des courbes de niveau et le profil en long du
terrain naturel.
20
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Pour obtenir le MNT de la zone désiré, on insère notre aire d’étude dans
global mapper et on délimite la zone de notre étude on la télécharge le MNT.
Après, on dessine les courbes de niveau à ce stade on peut choisir un
couloir de passage qui respecte la topographie de la zone on exporte donc tous
ses informations sur un fichier Autocad .DWG et on télécharge le MNT de notre
couloir sous forme de fichier .DEM qui est lisible par le logiciel Civil 3D.
Figure -14- L’air d’étude exportée vers Global Mapper
Figure -15- Choix du couloir de passage à l’aide des courbes de niveau
On insère après le MNT sous forme de fichier .DEM dans Civil 3D et on colle le
couloir qu’on a déjà choisi pour démarrer le tracé en plan de notre autoroute.
21
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
1.2- Le tracé en plan :
La première étape dans un projet de conception de route est de
déterminer le couloir de passage pour la route dans cet optique on a démarré
notre travail par la collection des modèles numérique de train à l’aide du logiciel
« Global Mapper » afin de prendre une idée sur la topographie du terrain.
Lorsqu’on détermine le couloir de passage (100 m) en évitant les
contraintes (humaines – naturels et topographiques), on procède donc à
l’élaboration du tracé en plan toute en respectant la norme française
« I.C.T.A.A.L ».
Pour la catégorie de l’autoroute le maitre d’ouvrage a choisi une catégorie
L1 qui correspond à une vitesse de base de 130 km/h mais au Maroc en se limite
à 120 km/h. Dans ce sens la norme ICTAAL exige pour le rayon minimal non
déversé 1000 m. Mais l’ICTAAL conseille d’utiliser un rayon de 1,5Rnd ce qui
fait 1500 m.
Tableau 1 – Les rayons de la norme I.C.T.A.A.L
Et puisque c’est une étude de définition, notre encadrant nous a
recommandé de faire des rayons de 3000 m afin de pouvoir faire des
modifications futur dans les étapes qui suivent l’étude de définition.
22
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Parmi les contraintes rencontrées lors de l’élaboration du tracé en plan
c’est l’ensablement dans la région de Laayoune, donc on est obligé de traverser
une zone d’ensablement (Cf. figure).
Figure -16- Zone d’ensablement proche de Laayoune
Pour diminuer l’ensablement sur notre autoroute, nous avons choisi le
plus petit passage dans cette zone mais toute en respectant le fait que le tracé
doit être dans le sens des vents dominants. Pour déterminer le sens des vents
dominants, nous avons utilisé un site sur internet spécialisé dans les statistiques
sur le vent dans les aéroports (fr.windfinder.com). Nous avons trouvé que le
vent dominant vient du nord-est comme il est indiqué dans la figure au-
dessous.
Figure -17- Sens des vents dominants d’après le site « fr.windfinder.com »
23
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
En conclusion pour le TP nous avons respecté les instructions suivantes
suivant :
Autoroute de type L1.
Pour les raccordements nous avons utilisé des raccordements circulaires
(Etude de définition).
Rayons non déversé de 3000 m.
Les alignements droits ne dépassent pas 5 Km.
Eviter dès que possible les zones d’ensablement.
Traverser les zones d’ensablement dans le sens des vents dominants
(Nord-Est).
Les règles de continuités sont vérifiées puisque tous les rayons sont
supérieurs au Rmn (3*Rmn).
1.3- Le profil en long :
Le profil en long est le développement du cylindre vertical sur lequel est
tracé l’axe de la route, il est constitué de segments de droite raccordés par des
arcs de cercle caractérisés par leurs rayons (particulièrement des paraboles).
L’autoroute en question correspond à la catégorie L1 (130-120km/h),
donc selon l’ICTAAL le profil en long doit respecter les conditions suivantes :
La déclivité maximale est de 5%
Le rayon minimal en angle saillant est : 12500 m, et en rentrant est : 4200 m.
24
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Tableau 2 – Le profil en long dans la norme I.C.T.A.A.L
Et d’après les directives du METL, on doit essayer de respecter certaines
règles afin de lutter contre l’ensablement de la route, à savoir :
Les déblais sont interdits
La route est construite en léger remblai : 0.5m-1m
La déclivité maximale est de 4%
Le rayon minimal en angle saillant est : 9000 m, et en angle rentrant est :
4000 m
Tableau 3 – Le profil en long dans RMDEM
25
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Dans le cas de changement de déclivité q inférieur aux valeurs définies
dans le tableau ci-dessous, par catégorie, et donnant lieu à un angle saillant du
profil en long, les projeteurs s’efforceront de placer un rayon de raccordement
dit « rayon de visibilité » assurant la visibilité de 500 mètres entre points à 1,10
mètres au-dessus du sol .
La présente prescription ne sera toutefois appliquée que si elle ne rend
pas inévitable des terrassements en déblai ou des terrassements en remblai de 1
m de hauteur (q = Ip1 – p2I, p1 et p2 étant les pentes exprimées en pourcentage
et en valeur algébrique de part et d’autre du raccordement.
Tableau 4 – Changement de déclivités et rayon de visibilité
Finalement, pour des raisons d’assainissement routier longitudinal, la
déclivité minimale est de 0.2-0.3% en profil courant, et de 0.5% sur les
ouvrages d’art.
Lorsque le tracé coupe une route classée la ligne rouge doit être calé d’au
moins 5.1+0.5+1=6.6m sur une largeur de 200m et de 5m s’il s’agit d’une
piste.
26
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Autres les règles citées la haut, il faut assurer une coordination entre le tracé
en plan et le profil en long, ceci dit, un raccordement en angle saillant du profil
en long ne peut pas avoir pour effet que les usagers soient surpris par un visage
les suivant immédiatement.
On y parviendra :
Soit en séparant nettement les courbes en plan et changement de déclivité
en angle saillant.
Soit en rapprochant autant que possible sommet de courbe et sommet de
raccordement en profil en long.
1.4- Le profil en travers :
Eléments d’un profil en travers autoroutier :
Figure -18- Eléments d’un profil en travers d’une section courante
Pour la chaussée :
Chaque chaussée comporte de 2 à 4 voies de circulation larges de 3,50 m.
27
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Pour le TPC :
Le T.P.C. assure la séparation matérielle des deux sens de circulation. Sa
largeur résulte de celle de ses constituants : les deux bandes dérasées de
gauche et la bande médiane.
Bande dérasée de gauche (B.D.G.)
Elle est destinée à permettre de légers écarts de trajectoire et à éviter un
effet de paroi lié aux barrières de sécurité. Elle contribue dans les courbes à
gauche au respect des règles de visibilité. Elle est dégagée de tout obstacle,
revêtue et se raccorde à la chaussée sans dénivellation. Sa largeur est de 1,00 m.
Bande médiane
Elle sert à séparer physiquement les deux sens de circulation, à implanter
certains équipements (barrières de sécurité, supports de signalisation, ouvrages
de collecte et d’évacuation des eaux) et, le cas échéant, des piles d’ouvrages et
des aménagements paysagers.
Sa largeur dépend, pour le minimum, des éléments qui y sont implantés.
Si elle est inférieure ou égale à 3 m, elle est stabilisée et revêtue pour en faciliter
l’entretien. Sinon, elle peut être engazonnée et plantée d’arbustes, à moins que
sa largeur et la topographie du site ne permettent la conservation du terrain
naturel et de la végétation existante ; dans ce cas, une berme de 1,00 m est
maintenue en bordure de la B.D.G.
Pour l’accotement :
L’accotement comprend une bande d’arrêt d’urgence (B.A.U.) bordée à
l’extérieur d’une berme.
La bande d’arrêt d’urgence (B.A.U.)
La B.A.U. facilite l’arrêt d’urgence hors chaussée d’un véhicule, la
récupération d’un véhicule déviant de sa trajectoire, l’évitement d’un obstacle
sur la chaussée, l’intervention des services de secours, d’entretien et
d’exploitation.
Elle est constituée à partir du bord géométrique de la chaussée d’une sur-
largeur de chaussée qui porte le marquage en rive, puis d’une partie dégagée
28
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
de tout obstacle, revêtue et apte à accueillir un véhicule lourd en stationnement.
Aucune dénivellation ne doit exister entre la chaussée et la B.A.U.
Sa largeur est de 2,50 m, ou de 3,00 m lorsque le trafic poids lourd excède 2 000
v/j (deux sens confondus).
La berme
Elle participe aux dégagements visuels et supporte des équipements :
barrières de sécurité, signalisation verticale…
Sa largeur qui dépend surtout de l’espace nécessaire au fonctionnement
du type de barrière de sécurité à mettre en place est de 1,00 m minimum ; mais
elle peut être intégrée à un dispositif d’assainissement dont la pente ne dépasse
pas 25 %.
En conclusion pour notre profil en travers, nous avons choisi :
Largeur de la chaussée : 2 x 3.50 m
TPC : 3.00 m dont la BDG 2 x 1.00 m.
BAU : 2.50 m
Berme : 1,00 m
Arrondi : 1,00 m
29
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
2- Modélisation avec le logiciel Autocad Civil 3D :
2.1- Présentation d’AutoCad Civil 3D :
AutoCAD Civil 3D est un produit de la société Autodesk, il est destiné
aux ingénieurs civil et topographe puisqu’il ajoute à l'ensemble de commandes
AutoCAD des commandes uniques applicables au génie civil et à la
topographie.
Ce logiciel est utilisé dans la plupart des bureaux d’études, car il permet
d’entamer un projet multi axes contrairement au Piste qui peut faire juste des
projets mono axes.
Ce logiciel est utilisé aussi en assainissement pour générer le profil en
long des canalisations.
Figure -19- Interface global du Civil 3D
2.2- Modèle numérique de terrain :
Après la détermination du couloir de passage, nous avons téléchargé le
modèle numérique de ce couloir en extension .dem afin de déterminer les
courbes de niveau.
30
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -20- Couloir de passage avec courbe de niveau Tronçon Laayoune-
Boujdour.
2.3- Tracé en plan :
Après l’obtention de la courbe de niveau on procède au tracé en plan
selon les caractéristiques précisées dans la partie tracé en plan.
On trace une polyligne sans raccordement et on fait crée axe à partir
d’un objet.
31
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -21-
Puis une fenêtre s’ouvre pour insérer les caractéristiques géométriques
de notre autoroute.
Figure -22-
32
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figures -21,22 et23 - Etapes de création de l’axe
On clique sur OK, on aura donc notre tracé en plan, il reste de le revérifier
avec la carte des contraintes et de le rectifier si nécessaire.
Figure -24- L’axe du l’autoroute (En couleur rose)
33
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
2.4- Profil en long :
On clique sur Lg profil long Créer une ligne de profil en long de surface
Figure -25- Création du profil en long terrain naturel
On aura comme résultats le profil en long du terrain naturel.
Pour crée le profil en long du projet on clique sur Lg profil long
Outils de création de ligne de profil en long.
Figure -26- Création du profil en long projet
34
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Lorsque on choisit le profil en long du terrain naturel une boite de
dialogue s’ouvre pour crée le profil en long du projet.
Figure -27- Création du profil en long projet
Et un outil de modification de la ligne de profil en long apparait pour
déterminer les caractéristiques géométriques du profil en long.
35
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -28- Saisi des données pour profil en long
Lorsque on termine on vérifie la conformité du profil en long avec les
caractéristiques déjà indiqué dans la partie « Profil en long ».
Et enfin on ajoute les cartouches pour finaliser notre profil en long.
Figure -29- Cartouche du profil en long
36
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
2.5- Profil en travers :
Pour crée le profil en travers type, on clique créer un profil type.
Figure -30- Création du profil en travers type
Et puis on ouvre la palette des outils pour constituer notre profil en
travers type, à la fin on aura notre profil en travers sous la forme suivante :
Figure -31- Le profil en travers type sur Civil 3D
37
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3- Modélisation avec le logiciel Piste :
3.1- Introduction
Piste est l'outil de base pour les bureaux d'études devant concevoir des
projets linéaires de génie civil depuis le simple chemin de remembrement
jusqu'au projet autoroutier en passant par les projets de renforcement de
chaussée existante. Sa souplesse lui permet en outre de pouvoir traiter toutes
les études modélisables par profils en travers (canaux, digues, barrages, voies
ferrées, travaux aéroportuaires, tranchées,…).
Figure -32- Logiciel Piste 5
3.2- Organisation du logiciel :
Un projet routier sur le logiciel PISTE 5.0.6 comporte quatre fichiers
principaux chaque fichier résume un élément du tracé routier :
Fond de plan du module TPL (.seg) : Terrain naturel
Conception plane (.dap) : Axe en plan
Conception longitudinale (.dpl) : Profil en long
Profil type (.typ) : Profils en travers type
Conception transversale (.pis) : Regroupe l’ensemble des fonctions liées à
l’utilisation d’un fichier Piste.
38
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Méthodologie générale à suivre pour l’élaboration d’un projet routier
sur PISTE
39
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3.3- Réalisation du fond du plan :
Création d’un fichier semi de points :
C’est un fichier d’extension xyz, obtenu en levant le terrain par un levé
topographique qui doit contenir tous les détails de la zones y compris les
constructions, les poteaux électriques, les ouvrages hydrauliques…
Création d’un fichier .seg :
C’est un fichier d’extension seg, crée en ouvrant un nouveau fichier fond de
plan TPL, puis en cherchant le chemin d’accès au fichier semis de points
d’extension xyz.
Figure -33- Interface logiciel Piste
40
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Après la lecture du fichier points topo, un histogramme de répartition des cotes
lues apparaît.
Figure -34,35, - Lecture des données topographiques sur Piste
41
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Création des courbes de niveaux :
On fait appel au fichier enregistré sous l’extension seg, afin d’établir le
calcul de triangulation, des courbes de niveaux, des points bas et des points
haut. A partir des points top, la triangulation permet de construire un modèle
surfacique du terrain composé de triangles.
Puis, on calcul les courbes de niveau, et on peut également supprimer la
triangulation par la commande « RAZ Triangles » dans le menu Calcul.
Figure -36-37- Triangulation et calcul des courbes de niveau
42
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3.4- Réalisation du tracé en plan :
Avec l’outil informatique PISTE On ouvre le fond de plan puis on cré un
fichier de conception plane (.dap)
Figure -38- Conception plane
Apres, on passe à la saisie des différents éléments comme suit :
Point Pi : POI Pi Xi Yi
Droite Di : DRO Di Pi Pi+1
Figure -39- Création des points et des droites
43
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Rayon Ri de longueur Vi : DIS Ri Vi (avec un signe(-) si la courbe dans
le sens horaire sinon un Signe (+))
Paramètre du clothoide PARAi de valeur VPi : DIS PARAi VPi
Cercle Ci : CER Ci Di Di+1 Ri
Liaison arc de clothoide Li : LIA Li Di Di+1 PARA PARAi Ri
Figure -40-41- Création des cercles et des colthoides
44
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Axe : AXE AXE1 P1 AUTO
Ensuite, on crée le fichier .pis
Figure -42-43-44- Création du fichier .PIS
Ainsi on établit le poly ligne qui donne cheminement de la route tout en
essayant de trouver un axe projeté proche de l’axe existant pour éviter
l’expropriation.
45
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3.5- Réalisation des profils en travers :
Ce profil illustre essentiellement la largeur de la chaussée et des
accotements ainsi que les devers. Pour le réaliser on ouvre la conception
transversale (.pis),
Puis on procède au calcul du terrain par interpolation :
Figure -45-46- calcul du terrain naturel
46
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Puis, on calcul les dévers comme suit : Calcul Dévers
Pour choisir le devers selon les normes intégrer dans piste, on choisit :
Calcul, puis recherche auto.
Figure -47-48- calcul des dévers
47
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3.6- Réalisation du profil en long :
Ce profil indique la valeur des pentes et des rampes, ainsi que les rayons
des sommets des côtes et des points bas. Pour l’établir il suffit d’ouvrir une
nouvelle conception longitudinale (.dpl),
Puis on passe à la création des points, des droites, des axes et la
tabulation des axes.
Figure -49-50- réalisation du profil en long
48
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
3.7- Choix d’un profil en travers type :
On crée un profil en travers type, et selon les donnée de la plateforme, le
corps de chaussée les accotements, on procède au remplissage des informations
concernant la plate-forme, le déblai, le remblai, la couche d’assise, la couche de
forme et la couche de base.
Figure -51-52- saisie des caractéristiques de la plateforme,
déblai, remblai, et assise.
49
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Puis en ouvre le fichier de la conception transversale et on crée les profils
en travers du projet qui sont composés des deux demi profils type de part et
d’autre de l’axe.
50
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -53-54-55- création des profils en travers courant
3.8- Dessin et édition des pièces :
Enfin on procède au dessin et à l’édition du tracé en plan, du profil en long
et du profil en travers, puis on réalise la tabulation et on indique le volume des
terrassements. Chose qu’on n’a pas fait puisqu’il s’agit justement de l’étude de
définition du projet.
51
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
4- Choix de la structure de la chaussée :
En absence de norme marocaine pour le dimensionnement de la structure de
chaussée d’une autoroute nous nous sommes référées au catalogue des
structures types de chaussées neuves. Pour ce catalogue les données d’entée
pour dimensionner une structure de chaussée sont :
- Durée de dimensionnement initiale de la chaussée et risque de calcul (30 ans
pour les VRS et 20 ans pour les VRNS).
- Données climatiques ;
- Trafic ;
- Plate-forme support de chaussée ;
- Caractéristiques mécaniques des matériaux prises en compte.
Pour la durée de dimensionnement :
Nous avons une autoroute donc c’est une voie de réseau structurant alors la
durée de dimensionnement est de 30 ans.
Pour les données climatiques :
Nous sommes en plein désert donc le climat est sec.
Pour le trafic :
Le calcul du nombre de poids lourds cumulé TCi30ans se fait à l'aide de la
relation suivante :
TCi30ans = 365 x T x C
Avec T : trafic poids lourd MJA a l'année de mise en service sur la voie la plus
chargée
C=d + t x d x (d-1)/2
Avec : d durée de dimensionnement initiale de la chaussée.
t taux de croissance linéaire annuelle du trafic lourd/100.
52
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Pour avoir la valeur de T, on se réfère au dix dernier recueil de trafic
établit par le ministère de l’équipement et de transport et de la logistique et
après on fait un ajustement statistique afin de trouver la valeur de T à l’année
de mise en service. Pour notre stage nous nous somme référées à deux valeurs
de T pour estimer la valeur de T futur.
En 2013 on a TMJA = 1191 et en 2014 on a TMJA = 966 on remarque une
diminution de 18.89%, pour cela notre encadrant nous a recommandé de travail
avec celle de 2013.
Tableau -5- Statistique des comptages 2013 et 2014
D’après « l’expérience marocaine des routes en milieu désertiques », le
pourcentage des poids lourds est de 50% alors nous avons pris T = 1191 x 50%
= 596 PL. Pour le taux de croissance t nous pris 6% (l’expérience marocaine des
routes en milieu désertiques), et donc c= 56,1.
Extrait - de « l’expérience marocaine dans les routes désertiques ».
Pour le taux de croissance :
Extrait de l’expérience marocaine dans les routes désertiques.
En conclusion TCi30ans = 365 x 596 x 56,1 = 12203994, on prend 12,5 millions.
53
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
D’après le catalogue des structures types de chaussées neuves, nous
avons les classes de trafics suivants :
Alors pour notre autoroute nous avons TC530.
Pour la portance de la plate-forme support de chaussée :
D’après « l’expérience marocaine des routes en milieu désertiques », la
portance dans cette région est généralement bonne.
Nous avons estimé cette portance à PF3.
54
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
La structure de chaussée proposée :
Nous avons choisi de travailler avec le grave-bitume de classe 3 (GB3) en
couche de base ainsi qu’en couche de fondation (Voir fiche au-dessous).
Figure -56- Fiche de dimensionnement de chaussée GB3
Donc on peut choisir la structure suivante :
Pour la couche de surface on peut choisir l’un de ses couches proposées :
55
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
5- Calcul hydrologique :
Une partie du stage s’est articulée autour du calcul hydrologique, dans le
but de dimensionner les ouvrages hydrauliques qui vont servir à évacuer les
eaux ruisseler vers la chaussée, mais aussi, pour déterminer le niveau des plus
hautes eaux pour le calage de la ligne rouge.
Pour ce faire, en utilisant global mapper, on va d’abord délimiter les
bassins versants qui contribuent à des écoulements qui coupent l’axe de la route.
Figure -57-58- Interface de Global Mapper
Pour générer les bassins versants on sélectionne la zone d’étude, puis on
clique sur analysis--- generate watershed
56
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -59-60- génération des bassins versants
Après, les bassins versants et les cours d’eau principales vont s’afficher comme
suite :
Figure -61-62- choix des bassins versants dont le cours d’eau
principale coupe l’axe de l’autoroute
57
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Ensuite, on affiche les caractéristiques des bassins versants, qui vont nous
permettre de calculer le débit de crue et le NPHE, en faisant un clic droit sur le
BV, puis Analysis/Measurement et MEASURE.
Figure -63-64- affichage des caractéristiques du bassin
58
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Pour déterminer la longueur du talweg le plus long, on utilise l’outil de
mesure, on suit le cours d’eau, et on lit la longueur dans la barre en bas.
Figure -65- détermination de la longueur du talweg principal
On résume les caractéristiques utiles du BV qu’on va étudier dans le
tableau suivant :
PK Surface (Km^2) Perimetre(Km) Longeur talweg (Km) Pente moyenne (%) Altitude moyenne (m)
9+102 6,144 18,506 2,69 1,16 77,6
On distingue trois groupes de paramètres caractérisant un bassin versant
et influençant son temps et la forme de sa réponse, c.-à-d. comment (en termes
de forme, volume et rapidité) le bassin transforme les pluies reçues en
écoulement vers son exutoire :
- Les caractéristiques physiques de forme, de relief et de pente
- Les caractéristiques du réseau de drainage
- Les caractéristiques du sol et de végétation
59
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Les caractéristiques physiques de forme, de relief, de pente, et
d’écoulement :
Les premières caractéristiques physiques du bassin qu’on doit mesurer
sont sa surface et son périmètre. Pour le bassin versant qu’on a choisi, ces
paramètres sont :
S=6.144 Km2 et P=18.506 Km.
Les caractéristiques de forme :
Permettent de déterminer la configuration géométrique et la forme du
bassin telle que projetée sur un plan horizontal. On peut utiliser deux indices :
Indice de compacité de Gravelius :
Il est défini par le rapport de périmètre du bassin au périmètre du cercle
ayant même superficie :
Pour notre bassin : KG=2.09
Indice de forme de Horton :
Il exprime le rapport de la largeur moyenne du bassin versant à la
longueur du cours d'eau principal.
- 1.5 < KG < 1. 8 et KH < 1 si la forme du
bassin est allongée : Bassin A
- 1.0 < KG < 1.15 et KH > 1 si la forme du
bassin est ramassée : Bassin C
Dans notre cas KH=0.018, notre bassin est
allongé (type A) ce qui était prévisible.
60
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Le rectangle équivalent :
Cette notion a été introduite par Roche et elle est utilisée pour pouvoir
comparer le comportement hydrologique de deux bassins.
Il s'agit d'une transformation purement géométrique en vertu de laquelle on
assimile le bassin à un rectangle ayant le même périmètre et la même superficie.
De cette façon les courbes de niveau deviennent des droites parallèles aux petits
côtés du rectangle. L'exutoire se situe à l'un de ses petits côtés.
Les dimensions du rectangle équivalent se calculent à partir des relations
suivantes :
Lorsque KG ≤ 1.12, le bassin a une forme circulaire et la transformation
géométrique en rectangle équivalent n'est plus réalisable, le bassin sera assimilé
à un carré.
Dans notre cas Leq=8.533 Km et leq= 0.72 Km
Les caractéristiques de relief :
De nombreux paramètres hydrologiques comme par exemple les
températures, les précipitations varient en fonction de l'altitude.
Il est donc du plus grand intérêt, pour l'hydrologue, de connaître la
répartition des surfaces d'un bassin versant, en fonction de l'altitude.
61
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
La courbe hypsométrique :
C’est une courbe où l’on représente l’altitude en fonction de la superficie.
Celle–ci est obtenue en mesurant les surfaces comprises entre certaines tranches
d'altitude ou courbes de niveaux.
La courbe hypsométrique se trace en représentant en abscisse le
pourcentage de la surface totale du bassin qui se trouve au-dessus des altitudes
portées en ordonnées.
L'altitude moyenne du bassin versant :
Elle permet d'analyser les lois réglant les précipitations et le ruissellement
superficiel, elle se définit comme l'ordonnée moyenne de la courbe
hypsométrique et correspond au rapport de l'aire sous la courbe hypsométrique
à la surface totale du bassin
L’altitude moyenne de notre bassin est donnée par Global mapper,
hmoy=77.6 m
l'altitude médiane :
Elle correspond au point d'abscisse 50 % sur la courbe hypsométrique.
L’altitude minimale :
Se situe à l'exutoire du bassin qui représente son point de contrôle : hmin
Pour notre bassin hmin= 70 m.
l'altitude maximale :
C'est l'altitude la plus forte relevée au cours de la limitation du bassin,
hmax. C’est le point culminant du bassin.
Pour notre bassin, hmax = 87 m.
le mode ou l'altitude la plus fréquente :
Elle est relevée sur le diagramme hypsométrique et correspond au milieu de
la tranche d'altitude à laquelle correspond le maximum de superficie.
Pour notre bassin, hmode = 78 m.
62
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Les caractéristiques de pente du bassin :
Leur connaissance est d'une grande importance car il est évident que les
eaux ruissellent d'autant plus que la pente des versants est grande, c'est ainsi
qu'en montagne on rencontre, pour une averse donnée, des crues plus
importantes qu'en plaine où les pentes sont beaucoup plus faibles.
Le calcul de la pente moyenne du bassin tient compte de la dénivellation et
de la longueur L mais non de la position relative des différentes courbes de
niveau. Le temps et l'amplitude du ruissellement dans les bassins sont très
influencés par la répartition de la superficie en fonction du relief. C'est pour cela
que les hydrologues calculent d'autres indices de pente pour mieux analyser le
ruissellement dans un bassin donné.
La pente moyenne du bassin :
Elle joue un rôle important dans le ruissellement. Des pentes raides
accélèrent le temps de réponse d'un bassin. On estime la pente moyenne d'un
bassin à partir de la courbe hypsométrique du bassin.
Dans notre cas, Global mapper donne : Pmoy= 1.16%
Les indices de pente influencent la réponse du bassin au niveau du volume
écoulé, de la forme de l’hydro gramme de débit écoulé, et très particulièrement
au niveau de la durée de l’écoulement et de l’enregistrement du débit max
63
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
La pente moyenne du cours d'eau principal :
C'est le facteur moteur qui détermine la vitesse avec laquelle l'eau va
s'écouler pour se rendre à l’exutoire. Parmi les méthodes que l'on rencontre,
nous citerons les suivantes
Où Hmax et Hmin sont les altitudes extrêmes relevées sur le cours d’eau.
Dans notre cas, Pmoy= (77-71)/2.69 = 0.223%, nous l’avons calculée à
partir du profil en long du talweg principal visualisé dans global mapper
comme suivant :
Figure -66- Calcul de la pente du talwegs à travers le PL
La pente moyenne se calcule par la moyenne arithmétique des pentes
relevées sur chaque tronçon du profil en long du cours d’eau.
Un calcul s'effectue aussi à partir du profil en long en déterminant une
hauteur moyenne, Hmoy, qui correspond à la surface sous la courbe du
profil en long du cours d'eau divisée par sa longueur totale L.
64
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Paramètres en relation avec les écoulements :
La connaissance de l’écoulement de surface dépend essentiellement des
facteurs morphologiques, de l'état et nature du sol ainsi que de la taille du bassin
versant.
Deux paramètres importants caractérisent la capacité et la rapidité de
l’écoulement et permettent de mettre en relation les précipitations et les débits
dans un bassin versant.
Le coefficient de ruissellement :
Le coefficient de ruissellement est l’un des paramètres clés qui caractérise le
comportement hydrologique global du bassin versant.
Il est souvent considéré comme un paramètre constant. Cependant il est plus
réaliste de préconiser sa variation dans le temps au cours d’une pluie, le sol se
saturant progressivement au fur et à mesure que la pluie tombe. Dans des
conditions de non humidité après une longue période de sécheresse, il est faible
puis croit pour atteindre une valeur limite une fois le sol saturé d’eau. Les
valeurs du coefficient de ruissellement dépendent donc de l’état d’humidité
antérieure des sols du bassin.
Le coefficient de ruissellement noté Cr est un indice très utilisé en
hydrologie de surface. Il permet de quantifier la part de la pluie qui s’est écoulée
au niveau de l’exutoire par rapport à la pluie moyenne qui est reçue par le
bassin. Il est défini par :
Le coefficient de ruissellement est alors un coefficient déductif des pertes.
La littérature propose quelques valeurs indicatives de ce coefficient pour
chaque type de sol et très souvent, en rapport avec d'autres facteurs tels que la
taille du bassin, la couverture végétale et la pente et utilisation du terrain.
Des conditions expérimentales tenant compte de l’état de saturation
préalable des sols sont souvent recommandées. Une synthèse est donnée dans
les tableaux ci-dessous :
65
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Comme on peut le voir sur le tableau 2-4, les valeurs reflètent la capacité
des sols à ruisseler en fonction uniquement de la couverture du sol. On
remarque notamment le très fort taux du coefficient de ruissellement donné
pour les routes et toitures car ces surfaces sont pratiquement imperméables
66
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Son calcul et son emploi sont simples, mais il conduit à faire des calculs
approximatifs quant tenu des incertitudes commises lors de sa détermination,
en particulier lorsque le bassin est de taille importante et comporte de grandes
hétérogénéités par rapport aux paramètres qui influencent le ruissellement de
surface. Un découpage du bassin en zones homogènes, chacune ayant un
coefficient Cr,i et une superficie ai , est nécessaire . On calculera alors un
coefficient de ruissellement moyen par :
Le tableau 2-6 donne le coefficient de ruissellement pour la méthode
rationnelle de calcul d’un débit max généré par une pluie uniforme de durée au
moins égale au temps de concentration, ainsi nous avons pris pour notre bassin
un Cr= 0.50
Le temps de concentration
On définit le temps de concentration, tc, comme le temps au bout duquel
la particule d’eau tombée dans la zone la plus éloignée de l’exutoire va atteindre
celui-ci. En fait si on suppose une pluie uniforme de durée illimitée qui tombe
sur un bassin, le débit rapporté à la surface du bassin (ou débit spécifique) va
atteindre un palier de valeur max au bout du temps de concentration tc .
67
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
La pluie théoriquement la plus pénalisante pour un bassin versant est
donc celle dont la durée est égale ou dépasse son temps de concentration. En
effet, si la durée de la pluie est courte, la totalité de bassin versant ne contribue
pas en même temps au débit de l'exutoire.
Le temps de concentration est une caractéristique du bassin qui dépend
essentiellement de la superficie du bassin, des pentes, de la longueur et de la
densité du réseau hydrographique.
La littérature propose plusieurs formules empiriques pour le calcul du
temps de concentration. Certaines sont plus répandues au Maroc. On citera :
68
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Les formules peuvent donner des valeurs très différentes On peut
prendre comme tc la moyenne arrondie entre les valeurs calculées qui se
rapprochent. De préférence et dans la mesure du possible, on conseille de
vérifier régionalement la validité de ces formules sur la base de données hydro
pluviométriques disponibles.
Dans notre cas, nous avons trouvé les temps de concentrations suivants :
Temps de concentration
Van te Chow (h) Espagnol (h) Dujardin (h) SOGREAH(h)
1,403884025 1,515731748 2,302700629 1,74638478
Giandotti (h) Turazza (h) Kirpich (h) Ventura(h)
6,590678661 2,554245223 1,400983262 2,927411134
69
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Autrefois, on faisait la moyenne des temps de concentration proche,
obtenus par les différentes formules, mais maintenant, on utilise seulement la
formule de Kirpich et Van te Chow, et on fait la moyenne de ces deux, ce qui
donne en général un temps de concentration petit, autrement dit, la réponse
du bassin sera grande, et plus contraignante, ce qui va dans le sens de la
sécurité, même s’il engendre un surdimensionnement des ouvrages de
franchissement.
Donc tc = (1.40388+1.40098)/2
=1.40243 h
Donc le temps de concentration de notre bassin versant est 1 heure 24 minutes.
Le calcul du débit du projet au PK 9+102 :
Le calcul du débit d’une période de retour donnée implique la
connaissance d’un certain nombre d’information hydrologique qui restent mal
connus surtout pour les bassins versant de faible superficie et dans des régions
abandonnée.
Dans ce cas, l’ingénieur est amené à utiliser certaines formules, qu’il s’agit
de formules empirique, analogiques, ou des formules qui utilisent la variable
pluviométrie.
Il faut noter que chaque méthode a un domaine de validité, ainsi pour un
bassin versant moyen comme le nôtre, et en absence de séries de pluviométrie,
on peut demander de la direction de météo de nous fournir les coefficients a et
b de Montana pour calculer le débit avec la méthode rationnelle, sinon on peut
utiliser de préférence les formules de M Hazen et Lazarevic.
En effet, elles sont déterminées particulièrement dans des zones du Maroc
comme le montre le tableau suivant :
70
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Notre bassin versant se situe dans le haut atlas saharien, donc on trouve
un débit millénaire :
Q1000 = 9.38*(6.144)0.742 = 36.077 m3/s
Cependant, pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques qui
seront introduit le long du tracé, on utilise le débit centennal, donc on doit
transformer le débit calculer en un débit centennal, ceci est possible, grâce à la
formule de Fuller 1,
QT’=QT*[(1+a*log T’)*(1+2.66/S0.3)] / [(1+a*log T)*(1+2.66/S0.3)]
On a S=6.144 Km2 , a=3.2, T=1000, T’=100
Donc : Q100 = 25.186 m3/s
Puisque le projet était juste en phase de l’étude de définition, nous
n’avons pas pu compléter l’étude hydrologique, faute de manque de données
pour calculer les débits avec des méthodes plus précises telles que la méthode
rationnelle, Fuller 2, Gradex,…
71
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
CHAPITRE 5 :
LES SOLUTIONS PROPOSEES POUR LE PROBLEME
D’ENSABLEMENT
Le souci de lutte contre l’ensablement s’était traduit par plusieurs
‘’règles’’ de construction :
Les déblais sont interdits
La route est construite en léger remblai : 1m
Les zones de sifs sont franchies par un tracé parallèle à leur direction
générale.
La chassée est élargie (jusqu’à 10m parfois) dans les zones vulnérables.
Le revêtement doit être le plus lisse possible.
Les dunes vives sont stabilisées au bitume sur une profondeur de 40 à 50mm
Par ailleurs l’enlèvement du sable au bulldozer sur une dizaine de mètres
de chaque côté de la plate-forme était un moyen de prévenir l’ensablement de
la chaussée pendant les périodes d’intense activité éolienne.
Nombreuses sont les techniques de lutte contre l’ensablement, nous
allons citer les plus connues, et par suite nous allons proposer les solutions
envisageables dans notre cas.
1. Les palissades :
Cette technique a montré son efficacité au Maroc et partout ailleurs. Ses
résultats étant la formation d’une dune artificielle, « dune d’arrêt ». La palissade
oppose à la force du vent dominant un obstacle linéaire qui diminue la vitesse
du vent, engendre une réduction de la capacité de charge et donc un dépôt du
sable à son niveau.
L’efficacité de cette technique tient compte de l’orientation perpendiculaire
au vent des palissades, leur perméabilité, leur profil, maillage, densité et
principalement l’approvisionnement et le prix des matériaux utilisés pour la
confection des palissades. Les palissades sont édifiées dans les différentes
expériences soit par du matériel végétal ou du matériel synthétique.
72
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Plusieurs expériences ont démontré que les palissades édifiées par du
matériel végétal peuvent assurer une fixation durable si la pose est faite de
manière professionnelle et est suivie d’un entretien assidu.
73
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
En Chine par exemple (dunes de Shapoutou) les chercheurs du centre de
recherche sur les zones arides ont montré qu’un maillage de palissades
végétales (paille du blé, du riz, des roseaux, et d'autres résidus de cultures) sous
forme de damiers bas (20 à 30 cm) et de 1m2 de superficie est une solution
efficace de fixation de sable.
Par ailleurs d’autres expériences au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, par
l’utilisation de palmes, de branches de Tamarix, du Retam ou encore du
Leptadonia, ont donné de bons résultats...
2. La technique de Mulch :
Elle consiste à couvrir le sable par des produits naturels ou artificiels et
former une couche protectrice pour atténuer la prise en charge éolienne au
niveau du sol, empêcher le mécanisme de saltation, et conserver l’humidité en
augmentant la cohésion du sol. Quand, les conditions écologiques le permettent
la reprise ou la re-végétalisation de la surface a lieu.
Les produits qui ont été utilisés dans de nombreuses expériences sont de
nature végétale, minérale, chimique ou de synthèse.
Le mulch végétal : consiste à répandre du matériel végétal tel les résidus de
cultures en général ou des branchages. Il a été testé au Rajarstan en Inde, au
Niger, au Maroc (Essaouira). Son efficacité réside dans sa nature, de la
disponibilité du matériel végétal en bonne quantité, de la force du vent et de la
texture des dépôts sableux à fixer. Les résultats obtenus diffèrent d’un cas à un
autre et restent aléatoires.
74
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Le mulch minéral : testé est celui des argiles. Cette méthode a été testée au
Maroc, en Tunisie, Somalie, Afghanistan et en Sibérie, mais les résultats sont
peu concluants à cause d’une part du problème de l’érosion hydrique sur les
argiles répandues, de la disponibilité ou non des matériaux sur place et du coût
de ces matériaux.
Le mulch synthétique ou chimique : consiste à répandre soit des
amendements chimiques non phytotoxiques tels que Unosol 096, Helsel 801,
Agrofix 614, Shell Sandfix, Hydromal, Agrosel, Polyacrilamide ou Petroset SP
qui sont pulvérisés pour fixer les sables mobiles et permettre la réinstallation de
la végétation, soit des émulsions de latex ou de résine vinyliques synthétiques
obtenues à partir d’acétylène. La stabilisation des sables avec de tels produits
chimiques n’en est qu’à ses débuts. Aussi ce type de mulch consiste à utiliser
des produits synthétiques comme les agents structurants polymères, films
plastiques fixés sur le sol ou des mèches acryliques constituées d’un assemblage
de filaments plastiques ou encore de fibres textiles disposées parallèlement les
unes aux autres.
Autres produits : telles les émulsions de résine, les produits pétroliers et
les huiles minérales ont été utilisés dès les années 1960, l’asphalte et le bitume,
pulvérisés en une couche de faible épaisseur, les huiles lourdes ou de graissage,
les liants chimiques, comme la nérosine. Ces produits ont été utilisés en
couverture continue ou en bandes alternant avec des bandes végétales dans
différents pays et dans différentes situations, mais dans un seul objectif qui est
la fixation des sables (en Libye, en Iran, en Algérie, en Arabie Saoudite, Tunisie,
Maroc, Iran, Égypte, ex-URSS, en Chine et en Ouzbékistan.
Les résultats de ces épandages restent cependant très discutables, le sable
recouvrant très rapidement la pellicule qu’ils forment et la technique ne
présente alors qu’une durabilité à moyen terme.
On peut résumer les principaux inconvénients des uns et des autres de
ces différents mulch comme suit :
75
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Des besoins parfois énormes en eau pour la dilution des substances ;
Le coût exagéré de certaines substances ;
L’altération paysagère des sites traités ;
L’exigence d’une surveillance permanente des sites ;
La toxicité de certaines émulsions.
3. Les méthodes aérodynamiques pour l’évacuation du sable
Il s’agit de techniques qui utilisent le vent lui-même pour évacuer le sable
grâce à sa force et à sa vitesse. Le déblayage du sable repose sur l’effet
aérodynamique des modifications de la vitesse et de la direction du vent, sur
des regains de vitesse ou des turbulences qui permettent au vent de reprendre
les accumulations par augmentation de sa capacité de charge.
Le profilage des obstacles et l’utilisation de la technique du Venturi en sont
de deux exemples. Ces méthodes consistent respectivement à éviter les dépôts
sableux par la réalisation de profilage des obstacles rencontrés ou création d’un
phénomène de compression, tel que la vitesse du vent ne soit pas décélérée au
contact de la contre-pente des obstacles.
La technique du Venturi est testée dans la zone de Laâyoune (T. OULEHRI,
1996) aux abords immédiats de la chaussée comme à Shapotou en Chine pour
la protection de la voie ferrée.
Une autre technique aérodynamique est utilisée au Maroc (Laâyoune et
Tarfaya par exemple) et en Mauritanie, elle consiste en la création de dunes
artificielles au vent de l’infrastructure à protéger. Cependant, si la source de
sable est trop riche cette technique se révèle inefficace.
Une nouvelle méthode expérimentée en Mauritanie il y a une dizaine
d’année, est la méthode BOFIX, utilisant la force du vent pour détruire les dunes
76
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
longitudinales. Dans un premier temps, la dune est sectionnée au niveau de ses
points d’inflexion et son extrémité est effacée par simple déflation.
Puis les portions restantes sont remaniées au niveau des crêtes et sur les
flancs pour accroître leur volume dans le but de stocker le sable encore mobile
et d’accroître le réservoir d’humidité, nécessaire ensuite au boisement de la
dune. Cette technique regroupe la technique aérodynamique et la technique
biologique et se base sur le principe de création de couloirs de passage au sable.
4. Techniques biologiques de lutte contre l’ensablement :
Les techniques biologiques regroupent toutes les techniques qui consistent à
développer sur les massifs sableux un couvert végétal en utilisant des espèces
végétales herbacées, buissonnantes, arbustives ou arborées, jouant un rôle de
fixateur de sables.
Elles font suite aux techniques mécaniques de stabilisation et de fixation des
sables et des dunes. Ces techniques sont mise en œuvre avec succès dans
différents pays, le Maroc, Mexique, Burkina Faso, Sud tunisien, Sénégal,
Somalie, ex-URSS, Proche-Orient, Chine centrale, le Pakistan et en Mauritanie.
Le choix des espèces végétales pour l’amélioration biologique dépend de
leur résistance aux facteurs environnementaux (climat, sol, action anthropique),
de leur mode de reproduction et de leur productivité en biomasse et leur
croissance rapide. On cite en ce qui suit les espèces qui sont utilisées dans ces
pays où la fixation biologique des sables commence à se perfectionner :
Prosopis juliflora, Casuarina spp., Acacia albida, A. Senegal, A. raddiana, A.
Cyanophylla, A.cyclops, A .cacia salicinia, A. ligulata, A. horrida et A.
adansonia., Aristida pungens , Aristida coerulescens, Salsola vermiculata,
Astragalus gyzensis, Retama retam, Haloxylon schmittianum, Euphorbia
paralias, Calligonum comosum, Lycium arabicum, Rhus tripartium,
Calligonum azel, Prosopis dulcis, Parkinsonia aculeata, Eucalyptus, Atriplex
halimus, Tamarix aphylla, Tamarix spp., Salix psammophila, Hedysarum
scoparium, Hedysarum laeve, Artemisia sphaerocephala, Saccharum
aegyptiacum, Tamarix articulata, Ammophila arenaria, Artemisia spp, Cassia
siamea, Andropogon gayanus, Oxytenanthera (graminées pérennes).
77
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Ce sont des réalisations importantes qui démontrent que la plantation
permet de protéger les infrastructures et donne d'excellents résultats.
Ces nombreuses expériences ont montré que pour une fixation durable
des sables mobiles et des édifices dunaires à court et moyen terme, la
stabilisation mécanique est indispensable et pour le long terme celle-ci doit être
suivie d’une stabilisation biologique. Cette approche est préconisée par les
spécialistes lorsque les zones à protéger ont des sols salés et où les précipitations
sont inférieures à 60 millimètres par an, tel est le cas pour la zone Akhfennir-
Tarfaya.
5. Création et fixation d’un cordon dunaire :
La houle et le vent sont à l’origine de l’édification des dunes littorales : les
matériaux déposés sur la plage par la houle sont repris par les vents de mer
pour constituer des dunes.
Au niveau de la ville de Tarfaya et contrairement à la typologie de la
morphologie dunaire littorale (Fig.I-2) on note l’absence d’avant-dunes et de
dunes semi-fixées qui forment le cordon dunaire littoral et qui sont solidaires
des plages avec lesquelles elles sont en contact par des échanges réciproques de
sédiments. À ce titre, ces dunes contribuent à l’équilibre dynamique des plages.
Dans notre cas, l’aridité du climat de l’avant dune se résout alors en un
groupement de nebkas et barkhanes isolées les unes des autres, comme on peut
en voir dans d’autres sites sur la côte atlantique sud du Maroc. Sur les littoraux
désertiques, l’absence totale de plantes, fait que l’avant dune n’existe pas. En
arrière des plages se forment directement des barkhanes qui s’avancent vers
l’intérieur des terres pour former éventuellement des champs de dunes mobiles.
78
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -67- Typologie de dune littorale
Au niveau de Foum Agoutir, ces avant-dunes qui sont des dunes blanches
transverses sont dénudées de toute végétation qui permettrait leur fixation et
leur fossilisation. La fixation de ces masses sableuses ne peut être qu’un facteur
favorable d’équilibre pour assurer le bon fonctionnement de la lagune en
maintenant les échanges entre elle et le milieu marin, échanges qui sont vitaux
pour la survie de la lagune.
6. Les expériences en matière de lutte contre l’ensablement dans la zone
d’étude
Au Maroc, l’expérience dans le domaine de la lutte contre l’ensablement
et la stabilisation des dunes a débuté en 1915 à Essaouira pour les dunes
littorales, par contre la stabilisation des dunes continentales n’a pris de
l’importance que depuis 1979 dans la région du Drâa, Ziz et Tafilalet.
79
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Dans la zone d’étude on peut dire que les opérations de lutte contre
l’ensablement sont très limitées dans le temps et dans l’espace. Mis à part les
opérations curatives de désensablement de certains points sur la route nationale
R 1 et les opérations de dragage de sables au niveau du port de Tarfaya. Il
n’existe pas d’action concrète, contrairement à la zone de Laâyoune où plusieurs
tentatives de fixation ont été entreprises.
Les actions menées au niveau du réseau routier : elles restent comme
actions curatives qui se font, comme on l’a observé sur le terrain d’une manière
inadéquate, étant donné que le sable enlevé de la rive droite de la chaussée est
déversé juste immédiatement sur la rive gauche et par temps de vent d’Est, ce
sable et renvoyé de nouveau sur la chaussée.
Figure -68-
L’autre action est la formation de dunes artificielles par des remblais pour
empêcher les sables de se déposer sur la route. Le résultat est que l’ensablement
arrêté par la dune artificiel se diverse souvent sur la route après avoir dépassé
l’obstacle artificiellement créé.
80
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -69-
Une troisième action qui s’avère intéressante mais n’est
malheureusement pas généralisée dans la zone, il s’agit de la surélévation de la
chaussée pour faciliter le transit des sables.
Ainsi, dans certains tronçons de la route, il suffirait de faire des profilages
de part et d’autres de la chaussée sur une largeur satisfaisante pour laisser
passer les sables sans provoquer leur dépôt sur le tronçon de la route en
question. Ces actions curatives ne résoudront en aucun cas le problème et
demande des investissements humains et matériels d’une manière perpétuelle.
Figure -70-
Au niveau du littoral de Tarfaya, les quelques opérations menées sont très
anciennes, Il s’agit de la construction d’un mur de 5m (Fig.I-7) ; celui-ci est mal
orienté et est actuellement débordé par les sables de l’autre côté. Il est aussi dans
un état de dégradation très poussée.
81
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Figure -71-
7. La stratégie de lutte contre l’ensablement proposée dans la zone
d’étude
L’analyse de plusieurs expériences de lutte contre l’ensablement à l’échelle
mondiale nous a permis de définir les critères clé pour la réussite d’un tel exploit
à savoir :
(i) l’échelle de l’analyse de la dynamique éolienne, en effet les opérations
qui ne tiennent pas compte des unités du système éolien déjà précitées
ne réussissent pas ;
(ii) la connaissance des conditions écologiques de la zone est
indispensable,
(iii) la lutte mécanique et la lutte biologique sont indissociables.
(iv) le rapport coût/efficacité est à évaluer avant la mise en place d’une
opération de lutte contre l’ensablement et la réussite des programmes
de lutte suppose l’utilisation et la valorisation des spécificités
écologiques et humaines locales pour minimiser les coûts et rendre les
solutions viables pour les communautés. L’entretient et le suivi
scientifique et technique sont obligatoires.
82
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
(v) Et enfin, une lutte efficace exige de prendre en compte, dans les
aménagements, les risques liés aux mécanismes éoliens consécutifs
aux activités humaines et aux aménagements eux-mêmes, afin de les
intégrer dans un programme de protection.
Pour des raisons logistiques et économiques, la stratégie adoptée jusqu’à
présent consiste en des interventions très ponctuelles et portant sur des cas «
d’urgence » sans véritable plan de protection globale, à l’endroit même où se
manifestent les dégâts ou à proximité immédiate de l’objectif à protéger et
rarement au lieu d’amorce de la problématique (origine) ou le long des
trajectoires de transport de sable. Au lieu de traiter le mal à sa source, les
interventions sont concentrées uniquement sur des bandes étroites d’ouvrages
intensifs interposés entre les champs sableux et l’objectif à protéger. Cette
approche est dictée par le souci de minimiser le coût et rendre l’opération
socialement réalisable en réduisant au maximum les terrains occupés par les
travaux.
Dans la région de Laâyoune, des efforts ont été déployés en matière de lutte
contre l’ensablement par la Direction Régionale des Eaux et Forêts (DREF-Sud),
la Direction Régionale de l’Equipement (DRE), l’ODEP, l’OCP et l’ONEP.
D’après la DRE, une moyenne de 3,5 millions de Dirhams par an est consacrée
aux actions de lutte par entreprise et une moyenne de 2 millions de Dirhams en
régie est dépensée chaque année pour résoudre ce problème. Cependant, il
s’agit toujours d’actions localisées.
Or la lutte contre l’ensablement doit tenir compte de la dynamique globale
de l’ensablement dont les origines se situent sur la frange littorale Khenifiss-
Tarfaya mais dont les effets les plus néfastes se trouvent à Laâyoune.
Elle doit donc se placer dans un Système Régional d’Action Éolienne
(SRAE) et nécessite la mise en place d’une stratégie de lutte où les efforts de
différents intervenants sont coordonnés avec une fédération des moyens
humains et logistiques.
83
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
8. Les solutions proposées pour la lutte contre l’ensablement
L’analyse d’expériences de lutte contre l’ensablement à l’échelle
internationale a montré que les techniques de mulching ne sont que des
techniques curatives et de courte durée, par contre les méthodes les plus
durables sont les méthodes qui conjuguent la fixation mécanique et la fixation
biologique.
Pour ces dernières, certains privilégient les techniques les plus modernes,
d'autres envisagent des approches à la fois plus économiques et plus
écologiques valorisant la main-d’œuvre et matériaux locaux.
En tenant compte de l’approche stratégique de lutte précédemment citée, des
spécificités biophysiques, écologiques et socio-économiques de la zone d’étude,
les techniques qui vont être développées doivent auparavant se faire sous forme
d’actions pilotes, pour les élargir à moyen et long terme.
Dans la zone d’étude, il faut faire la part entre les impératifs de protection
des caractéristiques paysagères du site et la nécessité de fixation des sables. On
peut mener à bien des opérations de fixation de dunes en préservant les qualités
du site et sa richesse spécifique floristique et faunistique.
Les techniques retenues pour les différents sites identifiés en fonction de la
typologie de l’ensablement et de l’objectif de la lutte, sont données ci-après :
8.1- Le profilage et le mulching chimique :
Le profilage des ensablements au niveau des axes routiers menacés : cette
opération découle des observations de terrain, qui montrent que les monticules
naturels et les remblais sont des obstacles qui font que le sable s’accumule au
bord et sur les tronçons de la route.
On préconise une stabilisation des sables profilés par la pulvérisation de
solution saline : c’est une technique déjà testée dans des conditions similaires et
son efficacité est certaine.
84
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Notons que dans les nombreuses sebkhas la zone d’étude, à fond plat tapissé
de grumeaux de sels, les sables mus ne font que passer à grande vitesse, sans se
déposer car la saltation des particules est très fluide.
L’opération consiste à aplanir systématiquement la topographie des dunes
en faisant avancer des rangées de bulldozers. Ensuite, à l’aide de citernes,
remplies d'eau de mer, on recouvre toute la surface d'un mulch continu, épais
de 10 à 20 centimètres. Etant donné la proximité des salines, l’eau de mer des
citernes peut être concentrée avec un apport de sel. Ce mulch a une double
fonction : il fixe efficacement le sable, laisse passer les particules en saltation et
retient l'humidité à proximité de la surface.
Cette opération doit se faire deux fois si nécessaire. Par ailleurs, étant
donné que la moyenne annuelle de l’humidité dans la zone est de l’ordre de
80%, ce qui empêche la remontée des sels et la dessiccation, cependant si
l’humidité descend à moins de 30% on doit pulvériser de nouveau la surface
avec l’eau de mer concentrée en sels.
Le mulching chimique fait par certains produits non toxiques n’altère pas
le paysage mais cette technique n’en est qu’à ses débuts. Cependant l’utilisation
de produits comme les émulsions de résine, les produits pétroliers et les huiles
minérales, déjà testés, n’a donné des résultats qu’a courts termes et altère le
paysage.
La combinaison de profilage et du mulching chimique proposée dans
cette étude en utilisant du sel n’a certes pas encore fait ses preuves mais elle sera
une des techniques les plus appropriées à être testée dans la zone.
Les conditions telles la proximité du littoral (pour la question
d’approvisionnement en eau), le taux d’humidité, l’existence d’un grand
gisement de sel et les observations sur le terrain (nécessité de profilage à cause
des obstacles qui accentuent le dépôt), sont favorables à la mise en œuvre d’une
telle technique à moindre coût et à résultats escomptés positifs. Cette technique
sera sans doute moins onéreuse que le travail mécanique effectué par les
brigades de désensablement.
85
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
8.2- La fixation mécanique :
Même si les vents sont monodirectionnels dans la zone d’étude, la fixation
mécanique par confection de palissade en quadrillage est préconisée en utilisant
surtout du matériel végétal (les palmes ou le retam ou des pieux en bois), afin
de ne pas altérer le paysage.
Cependant cette technique est conditionnée par l’approvisionnement en
matériaux et les prix de revient, incluant le transport et la maintenance. Les
palissades peuvent être un grillage synthétique résistant aux rayons solaires,
avec des mailles de 4 x 4 à 6 x 6 millimètres.
De point de vue coût, dans l’expérience marocaine l’utilisation du
matériel végétal est de l’ordre de 70 000 DH par hectare, contre 80 000 DH en
utilisant le grillage en plastique (plantation y compris).
Cependant pour la zone de Khenifiss classée comme zone SIBE, il est
préférable d’utiliser des techniques douces comme celle des palissades en
matière végétale et la méthode chinoise qui consiste en la réalisation de damiers
de 1m2, de 20 à 30 cm de hauteur. Les études ont montré que 90 % de grains de
sables en saltation ne dépassent pas cette hauteur.
8.3- La fixation biologique :
La méthode la plus efficace et la plus durable pour la fixation des dunes est
la fixation biologique. Tous les travaux de recherche scientifique et rapports
consultés traitant des projets réalisés sont unanimes sur cette question.
La fixation biologique doit suivre la fixation mécanique dans toute action de
lutte contre l’ensablement. Les mauvais résultats enregistrés dans les parcelles
non fixées mécaniquement, montrent que la fixation mécanique demeure une
opération clé et prioritaire dans les techniques de fixation des dunes, car sans
clayonnage les plants restent à la merci des vents et se trouvent de ce fait très
vite ensevelis sous les sables.
86
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Pour les dunes vives, très dynamiques telles que les barkhanes, les cordons
dunaires et les trains barkhaniques, la fixation mécanique doit précéder donc la
plantation.
Le choix des espèces végétales les plus adaptées quant à la stabilisation des
accumulations sableuses est une opération délicate compte tenu des
interférences des actions de l’ensablement et de la sécheresse.
Au Maroc, une gamme d’espèces est utilisée pour la fixation des dunes :
Tamarix aphylla, Calligonum azel, Calligonum comosum, Cornulaca
monacantha ; Nitraria retusa ; Stipagrostis pungens, Tamarix sp, Retma retam,
Eucalyptus camaldulensis, Prosopis juliflor, Acacia cyclops, cornulaca
monacantha, Arisitida pungens, Pannicum turgidum etc…Les résultats diffères
d’une situation à une autre.
Cependant le trait commun de ces expériences est le manque d’un suivi
scientifique rigoureux pour tirer des conclusions sur la réussite ou non d’une
espèce, son taux de croissance et sa résistance. Il n’existe pas non plus de
données sur les besoins réels en eau d’une opération de fixation biologique et
sur les techniques d’irrigation adaptées pour une économie de l’eau.
Par ailleurs, dans la plupart des cas, on a recours aux espèces exotiques
étant donné l’absence de semences et de données scientifiques sur les modes de
multiplication des espèces locales. En effet, les milieux sahariens présentent des
conditions écologiques dures, il n’est pas alors conseillé d’utiliser des espèces
spontanées ou exotiques sans avoir entrepris auparavant une bonne
expérimentation de ces dernières.
A court terme, pour le programme de fixation des dunes, un travail à
l’amont doit être réalisé pour la préparation du matériel végétal nécessaire.
L’importance doit être donnée aux espèces autochtones. Ces dernières seront
moins exigeantes, assureront un recouvrement durable, et éviteront
l’introduction d’espèces invasives qui risquent de rentrer en compétition pour
la lumière et l’eau avec la flore locale. Elles peuvent aussi compromettre la
survie d’espèces endémiques, rares ou protégées.
87
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Dans des cas d’étude sur la fixation des dunes, des propositions
d’utilisation d’espèces végétales sont parfois proposées sans tenir compte de
l’écologie et de la biologie de ces espèces. Par exemple en Tunisie, Calligonum
azel, arbre des milieux steppiques sahariens offre un taux d’installation faible
dû en partie à sa stratégie germinative lente, Aristida pungens, de par sa taille
de croissance juvénile trop lente ne s’est pas adaptée au milieu dunaire qui exige
des espèces à développement radiculaire rapide, alors que Retama retam a
donné d’excellents résultats.
Le chantier de lutte biologique contre l’ensablement exige des
investissements en termes de recherche en biotechnologie végétale au niveau
écosystèmes spéciaux comme celui des milieux dunaires.
Au niveau de la zone d’étude, malgré les conditions climatiques
défavorables (manque de pluviométrie, conditions édaphiques
compromettantes), le couvert végétal est relativement développé par rapport à
certaines zones sahariennes du Maroc.
Cependant cette végétation n’est pas assez puissante pour arrêter la
progression des barkhanes. A ceci, s’ajoute le problème du niveau de
dégradation de certaines espèces qui peuvent jouer ce rôle telles le Tamarix,
Nitraria et Hedysarum.
88
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Durant notre stage nous avons rencontré certaines difficultés, il s’agit :
- Des problèmes d’utilisation du logiciel Civil 3D, puisque c’est un
nouveau logiciel pour nous.
- Des problèmes de blocage de logiciel vu que la longueur du TP est
important près de 450 Km. On a remédié partiellement à ce problème et
on a devisé le tracé en deux parties (Laayoune – Boujdour) et (Boujdour
– Dakhla).
- Des problèmes de documentation sur l’ensablement dans les routes, nous
avons trouvé juste des références en anglais (Australie).
- Problèmes avec le transport vers le lieu de stage puisque il est à
Technopolis (Nouvelle – salé).
Enfin nous avons pu soulever ces difficultés pour sortir un travail au
niveau d’un élève ingénieur de l’Ecole Hassania des Travaux Publics.
89
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Ainsi, nous avons effectué notre stage ingénieur au sein de la division
autoroutes et rails à CID, Lors de ce stage de 6 semaines, nous avons pu mettre
en pratique certaines de nos connaissances théoriques acquises durant notre
formation, de plus, nous nous sommes confrontés aux difficultés réelles du
monde du travail et du management d’équipes.
Après notre rapide intégration dans l’équipe, nous avons eu l’occasion de
suivre de près la réalisation de plusieurs tâches effectuées par le personnel du
service.
Nous pensons que cette expérience en entreprise nous a offert une bonne
préparation à notre insertion en milieu professionnel car elle fut pour nous une
expérience enrichissante et complète qui conforte notre désir d’exercer notre
futur métier de d’ingénieur dans le domaine du génie civil.
90
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Pour conclure, nous tenons à remercier encore une fois toutes les
personnes qui ont participé à la réussite de ce stage qui s’est avéré très instructif.
Nous avons pu tester nos capacités à gérer les projets, le temps, et le stress,
ainsi nous familiariser avec l’ambiance et le cadre de notre futur emploi.
Sans oublier l’opportunité incontournable qui nous a été offerte pour
l’application des savoirs acquis à l’EHTP ainsi que le développement et
l’épanouissement de nos atouts en matière de communication et de contact
humain qui demeurent désormais aussi décisifs que les compétences techniques
pour la réussite de tout parcours professionnel.
Enfin, nous pensons que ce stage a pu remplir son but, à savoir la
découverte du milieu professionnel auquel est destiné l’ingénieur. Nous avons
aussi compris que le Maroc a besoin d’ingénieurs compétents qui seront à la
hauteur des taches qu’elles leur attendent.
91
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Routes en milieu désertique « l’expérience marocaine », Direction des
routes et de la circulation routière.
Atlas routier du Maroc, Direction des routes et de la circulation routière,
2004.
Cartes du Maroc 1/250 000 des régions sud, Direction de la conservation
foncière, du cadastre, et de la cartographie, 1992-1994.
Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes
de liaison (ICTAAL), SETRA, 2000.
Observations et prévisions de vent et météo : http://fr.windfinder.com/
Guide d’utilisation civil 3D 2016, Autodesk, 2015.
Manuel d’utilisation de Piste 5.0.6, 2004.
Catalogue des structures types de chaussées neuves, SETRA, 1998.
Hydraulique Routière, rapport de J.L BONNENFANT et R.PELTIER -
Publication BCEOM - Mai, Juin 1950.
Hydraulique routière, NGUYEN VAN TUU, Ministère de la coopération
et du développement Français, Ed BCEOM, 1981.
Estimating hydraulic roughness coefficients, Cowan W.L, Agr. Engr. Vol.
37, No 7, Juillet 1956
Le point sur les méthodes de calcul des débits de crues décennales en
Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, RODIER.J, MEUMIER.M,
PUECH.C, Bulletin de liaison au CIEH, n058 octobre 1984.
Etude d’impact et propositions de lutte contre l’ensablement dans la zone
du sibe de khnifiss, projet GEF de gestion des aires protégées TF-023494-
MOR (contrat n° 03/2005), I-MAGE consult, 2008
92
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
93
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
94
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
95
2015-2016
Rapport de stage ingénieur
Juillet – août 2015
ABBADI – BAKKALI
Vous aimerez peut-être aussi
- Mémoire Projet RoutierDocument41 pagesMémoire Projet RoutierHoussem BassalahPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage CidDocument55 pagesRapport de Stage CidADNANE HANOUNPas encore d'évaluation
- Rapport Pfe Larhzal YounesDocument123 pagesRapport Pfe Larhzal Younessomaya ehPas encore d'évaluation
- Rapport Stage Ip Dret - Ehtp 12Document49 pagesRapport Stage Ip Dret - Ehtp 12khoudix100% (4)
- Pont DalleDocument48 pagesPont DalleSlimAyediPas encore d'évaluation
- 2.01 Entretien Courant Au MarocDocument17 pages2.01 Entretien Courant Au MarocAziz Elkhayari100% (1)
- Etude D'un Pont Sur Oued Moulouya Au PK 96+000 de La RNDocument254 pagesEtude D'un Pont Sur Oued Moulouya Au PK 96+000 de La RNAdilOuchen100% (1)
- Specifites Du Dimensionnement Des Ponts FerroviairesDocument2 pagesSpecifites Du Dimensionnement Des Ponts FerroviairesAbdelali MerouanePas encore d'évaluation
- Etude de Reconstruction de L'ouvrage D'art Sur Oued ISLY Au PK 23+500 de La RN17 Situé À 2km de GuenfoudaDocument62 pagesEtude de Reconstruction de L'ouvrage D'art Sur Oued ISLY Au PK 23+500 de La RN17 Situé À 2km de GuenfoudaAymenPas encore d'évaluation
- Rapport PROJET BETON PRECONTRAINT N9Document29 pagesRapport PROJET BETON PRECONTRAINT N9Jihene Ben KacemPas encore d'évaluation
- Pfe Final 2020Document243 pagesPfe Final 2020anis boualiPas encore d'évaluation
- Pfe FinalDocument86 pagesPfe FinalBrahim MohtaremPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage A&bDocument38 pagesRapport de Stage A&bjihan100% (1)
- BARRAGE Rapport Pfe FinalDocument161 pagesBARRAGE Rapport Pfe Finalmed100% (3)
- Rapport Pfe El OmraniDocument212 pagesRapport Pfe El OmraniAdilOuchenPas encore d'évaluation
- Benabdallah Khaoula Rapport Pfe Version FinaleDocument127 pagesBenabdallah Khaoula Rapport Pfe Version Finalewafa LouatiPas encore d'évaluation
- Renforcement D'un Ouvrage D'art PONT-RAIL MÉTALLIQUE SUR OUED MOULOUYADocument103 pagesRenforcement D'un Ouvrage D'art PONT-RAIL MÉTALLIQUE SUR OUED MOULOUYAAmada TarekPas encore d'évaluation
- Rapport PFE MANAF CUISTO Et SALSABILE LAGOUILLY PDFDocument145 pagesRapport PFE MANAF CUISTO Et SALSABILE LAGOUILLY PDFmaroutaPas encore d'évaluation
- Recueil Trafic Routier 2013Document259 pagesRecueil Trafic Routier 2013Hassan BaddiPas encore d'évaluation
- Les Appareil D'appuiDocument46 pagesLes Appareil D'appuiBekkai Ahmed Othmane100% (2)
- Rapport PfeDocument121 pagesRapport PfeHajer Khiari0% (1)
- Rapport Pfe Version Finale 2020Document134 pagesRapport Pfe Version Finale 2020Walid SahmoudPas encore d'évaluation
- Pfe NovecDocument62 pagesPfe NovecFatima ZahraPas encore d'évaluation
- Pfe - A2Document116 pagesPfe - A2Hanane FathiPas encore d'évaluation
- Book Des PFE 2020-2021 PDFDocument52 pagesBook Des PFE 2020-2021 PDFGabriel CaraveteanuPas encore d'évaluation
- Etude D'un Ouvrage D'art en Beton PrecontraintDocument134 pagesEtude D'un Ouvrage D'art en Beton Precontraintmoussa0% (1)
- Rapport Pfa Fin PDFDocument60 pagesRapport Pfa Fin PDFHind TananiPas encore d'évaluation
- Pfe Emsi OaDocument124 pagesPfe Emsi Oasoufiane goufalePas encore d'évaluation
- Exam2 CDFDocument6 pagesExam2 CDFMorad EL MrabetPas encore d'évaluation
- Beton Precontraint - Cours Et ExerciceDocument91 pagesBeton Precontraint - Cours Et Exercicebaddi_hPas encore d'évaluation
- Pfe Ponts1Document214 pagesPfe Ponts1Ikram Khalyl50% (2)
- Table Des Matières: I. Techniques de Confortement Des Chaussees DegradeesDocument5 pagesTable Des Matières: I. Techniques de Confortement Des Chaussees DegradeesmohamedPas encore d'évaluation
- Repertoire de Memoires - Genie CivilDocument108 pagesRepertoire de Memoires - Genie CivilCédric Bruel BahouePas encore d'évaluation
- Etude ComparativeDocument6 pagesEtude ComparativeYa Diawara100% (1)
- Rapport PFE Étude de PontDocument110 pagesRapport PFE Étude de PontYassine Houmadine100% (1)
- Revue 4 C1 Rapport D'anticipation - L - B - STADES - 2019 Avec OS Demarrage REVU LE 26052018Document57 pagesRevue 4 C1 Rapport D'anticipation - L - B - STADES - 2019 Avec OS Demarrage REVU LE 26052018Pascal NzomoPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage AgadirDocument37 pagesRapport de Stage AgadirABDELILAH ERRAHALIPas encore d'évaluation
- NovecDocument2 pagesNovecIlyas HabibiPas encore d'évaluation
- AO - 44 CPS - Etudes & Suiv - VRD Al Andalous PDFDocument30 pagesAO - 44 CPS - Etudes & Suiv - VRD Al Andalous PDFlay thPas encore d'évaluation
- Pfa PDFDocument74 pagesPfa PDFHicham Chabbouba100% (2)
- Rapport de Projet de Fin D'année 2 Modélisation D'un Pont À Poutres Par Le Logiciel ROBOTDocument70 pagesRapport de Projet de Fin D'année 2 Modélisation D'un Pont À Poutres Par Le Logiciel ROBOTIheb Derwich100% (1)
- Rapport Ouvrage MaritimeDocument77 pagesRapport Ouvrage MaritimelouatiPas encore d'évaluation
- Exam PontsDocument4 pagesExam PontsBilal El HamdaouiPas encore d'évaluation
- PFE EL Assri Loudiyi ENSAM PDFDocument124 pagesPFE EL Assri Loudiyi ENSAM PDFAsma SalmaPas encore d'évaluation
- Rapport Pfe LoukouDocument202 pagesRapport Pfe LoukouLYMIPas encore d'évaluation
- Rapport PrincipalDocument126 pagesRapport Principalfoksou tchilia manassee100% (1)
- Rapport - PFE - SEGHIOUAR & BENNOUNA PDFDocument154 pagesRapport - PFE - SEGHIOUAR & BENNOUNA PDFkhalil momenPas encore d'évaluation
- Cps Travaux Station de PompageDocument71 pagesCps Travaux Station de PompageingPas encore d'évaluation
- Mini Projet Beton Pont PrecontrainteDocument13 pagesMini Projet Beton Pont Precontraintejihad1568Pas encore d'évaluation
- Conception Des Giratoire2Document4 pagesConception Des Giratoire2mimlaplayaPas encore d'évaluation
- Capacité D'un Giratoire 10.04.2013Document37 pagesCapacité D'un Giratoire 10.04.2013Hana Ladhari75% (4)
- Rguig FDocument28 pagesRguig Fsoumaya mehdaouiPas encore d'évaluation
- Etude de La Tremie - La ConcordeDocument121 pagesEtude de La Tremie - La Concordes.savoir4557100% (1)
- Etude D'une Unité Industrielle de Production Et Fabrication Des Produits AlimentairesDocument138 pagesEtude D'une Unité Industrielle de Production Et Fabrication Des Produits AlimentairesMouad MansorPas encore d'évaluation
- Mémoire Sur L'optimisation Des CoutsDocument51 pagesMémoire Sur L'optimisation Des CoutsBLANC125Pas encore d'évaluation
- Exercice 1 TYMOLDocument81 pagesExercice 1 TYMOLJopeth YoussefPas encore d'évaluation
- Sommaire: Historique Du Compteur PrépayéDocument78 pagesSommaire: Historique Du Compteur Prépayéfokeing yann100% (3)
- Introduction à l’analyse des données de sondage avec SPSS : Guide d’auto-apprentissageD'EverandIntroduction à l’analyse des données de sondage avec SPSS : Guide d’auto-apprentissagePas encore d'évaluation
- Trafic Routier 2014 MarocDocument271 pagesTrafic Routier 2014 MarocIsmail ouahiPas encore d'évaluation
- Manuel de Degradation Des Chaussees - Interessant PDFDocument58 pagesManuel de Degradation Des Chaussees - Interessant PDFAbdlghafour Laamarti100% (1)
- NF en 10027Document6 pagesNF en 10027Bouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- 12-Ferraillage Des CuléesDocument1 page12-Ferraillage Des CuléesBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- CC BetonDocument4 pagesCC BetonBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Pgcsps OneeDocument29 pagesPgcsps OneeBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- CimentDocument48 pagesCimentBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Présentation Journée LaTeX Par La PratiqueDocument161 pagesPrésentation Journée LaTeX Par La PratiqueBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Pgcsps OneeDocument29 pagesPgcsps OneeBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Guide Eurocodes Et Annexes NationalesDocument7 pagesGuide Eurocodes Et Annexes NationalesBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Cours CarrièresDocument37 pagesCours CarrièresBouraida El Yamouni100% (3)
- Formation Rédact Sci UIT PDFDocument9 pagesFormation Rédact Sci UIT PDFBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Exercices de Révision Béton PDFDocument10 pagesExercices de Révision Béton PDFBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Demande DérogatoireDocument1 pageDemande DérogatoireBouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Murs-Rideaux - Définitions - Terminologie - Normes Produit Et DTU - TIPesp-c3600Document5 pagesMurs-Rideaux - Définitions - Terminologie - Normes Produit Et DTU - TIPesp-c3600Bouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Ascenseurs - Une Réglementation Pour La Sécurité - TIPesp-c3710Document2 pagesAscenseurs - Une Réglementation Pour La Sécurité - TIPesp-c3710Bouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Restauration Des Bâtiments en Béton Armé - TIPesp-c2350Document1 pageRestauration Des Bâtiments en Béton Armé - TIPesp-c2350Bouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Restauration Des Bâtiments en Béton Armé - TIPesp-c2350Document1 pageRestauration Des Bâtiments en Béton Armé - TIPesp-c2350Bouraida El YamouniPas encore d'évaluation
- Dossier A RendreDocument6 pagesDossier A Rendremarwis alvarezPas encore d'évaluation
- Lab Gta 10 PDFDocument64 pagesLab Gta 10 PDFFarah HadjaliPas encore d'évaluation
- APRIMATICDocument233 pagesAPRIMATICAndrás TóthPas encore d'évaluation
- Kettani Hassani - Partage D'infoDocument24 pagesKettani Hassani - Partage D'infohasnaPas encore d'évaluation
- Poka YokeDocument14 pagesPoka YokeRahma BarkitPas encore d'évaluation
- Module 3 CCNPDocument14 pagesModule 3 CCNPLipouki TindamePas encore d'évaluation
- Progression Projet 01 3APDocument2 pagesProgression Projet 01 3APamine.ghoumari97Pas encore d'évaluation
- Exercices Chap10Document5 pagesExercices Chap10Arnold KpovihouanouPas encore d'évaluation
- Invitation GabonDocument1 pageInvitation GabonJordy SincéPas encore d'évaluation
- Créer CVPaw, Choisir Université, Trouver Emploi, Stage, Séminaire, Opportunités JobPaw - Com-1Document7 pagesCréer CVPaw, Choisir Université, Trouver Emploi, Stage, Séminaire, Opportunités JobPaw - Com-1Stael ToussaintPas encore d'évaluation
- Physiologie Et Exploration Fonctionnelle GastriqueDocument31 pagesPhysiologie Et Exploration Fonctionnelle GastriqueMerou Koubi100% (1)
- Quiz Sur La SignalisationDocument21 pagesQuiz Sur La SignalisationAziz H-m100% (1)
- Rapport de Stage PrevDocument4 pagesRapport de Stage Prevayarinour11100Pas encore d'évaluation
- Le Rapport Intelligence Économique Et Stratégies Des Entreprises.Document31 pagesLe Rapport Intelligence Économique Et Stratégies Des Entreprises.mohammedi asmaaPas encore d'évaluation
- Chaignet - Commentaire Sur Le Parmenide, (FR), t.1, 1900Document352 pagesChaignet - Commentaire Sur Le Parmenide, (FR), t.1, 1900JeanPas encore d'évaluation
- CEJM - Th02 Chap11 Cours Synthese CorrigéDocument12 pagesCEJM - Th02 Chap11 Cours Synthese CorrigéNarjès Bouzouita100% (1)
- Fiche de Poste - Stage Industrie Chez France Energie EolienneDocument1 pageFiche de Poste - Stage Industrie Chez France Energie EolienneFrance Energie EoliennePas encore d'évaluation
- Rapport-general-Cosumar-2020 CACDocument4 pagesRapport-general-Cosumar-2020 CACRouas SoundoussPas encore d'évaluation
- La Comptabilité Analytique: Introduction & FondementsDocument107 pagesLa Comptabilité Analytique: Introduction & FondementsMounia El Hassbi100% (1)
- Chaine D'énergieDocument11 pagesChaine D'énergieMehdi BKPas encore d'évaluation
- 2007 - Pendaison - EMCDocument6 pages2007 - Pendaison - EMCluciebezauPas encore d'évaluation
- 426-Blenders Et CentrifugeusesDocument6 pages426-Blenders Et CentrifugeusesK19CPas encore d'évaluation
- Gestion Stratégique Du Capital HumainDocument34 pagesGestion Stratégique Du Capital Humainyoussef Ait-omarPas encore d'évaluation
- Série Vecteurs Et BarycentresDocument3 pagesSérie Vecteurs Et BarycentresacolbaPas encore d'évaluation
- Soleil Royal French - Pack 04 - Phases 30 A 42Document54 pagesSoleil Royal French - Pack 04 - Phases 30 A 42Alain GayetPas encore d'évaluation
- Fabrication Du Vin (2Document4 pagesFabrication Du Vin (2Rachid ben100% (1)
- Guide de L'usinageDocument496 pagesGuide de L'usinageZizou Zidane43% (14)
- Formulation de Béton Hydraulique - Indice 0Document44 pagesFormulation de Béton Hydraulique - Indice 0laroussi aymenPas encore d'évaluation
- 4 - Les Opérations en Devises - EtudiantDocument8 pages4 - Les Opérations en Devises - EtudiantOmar Hayan100% (1)
- F1 Fiche 2 DexercicesDocument2 pagesF1 Fiche 2 Dexercicestoscane.gianlupi.tenouxPas encore d'évaluation