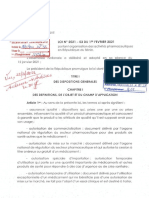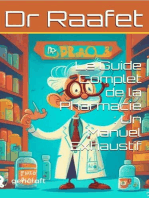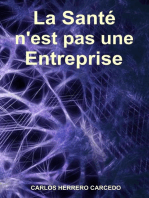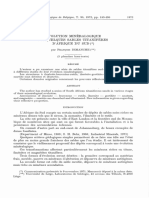Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Definition Classification Juridique Et Regime Des Medicaments
Definition Classification Juridique Et Regime Des Medicaments
Transféré par
fifi fifiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- SukukDocument82 pagesSukukChaimae AfifPas encore d'évaluation
- Gestion Des Psychotropes Au Niveau Des Établissements Hospitaliers Publics Et Privés-Converti PDFDocument8 pagesGestion Des Psychotropes Au Niveau Des Établissements Hospitaliers Publics Et Privés-Converti PDFSamir Derri100% (2)
- Pharmacologie Generale PDFDocument71 pagesPharmacologie Generale PDFOusmane100% (1)
- Exploration Biochimique Du LCR Et Des Liquides DDocument7 pagesExploration Biochimique Du LCR Et Des Liquides Dfifi fifi100% (1)
- Questionnaire SicadDocument20 pagesQuestionnaire SicadScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Loi Pharmaceutique NigerDocument26 pagesLoi Pharmaceutique NigerAlberto GeorgePas encore d'évaluation
- Questionnaire SICADDocument4 pagesQuestionnaire SICADScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Loi N° 17-04 (FR) PDFDocument43 pagesLoi N° 17-04 (FR) PDFFati FollaPas encore d'évaluation
- Ordonnance Portant Législation Pharmaceutique Au NigerDocument26 pagesOrdonnance Portant Législation Pharmaceutique Au Nigeralix.bossonPas encore d'évaluation
- CONNAISSANCE DU MEDICAMENT Partie 2Document45 pagesCONNAISSANCE DU MEDICAMENT Partie 2Estelle MkoungaPas encore d'évaluation
- UE4-LégisPharmaChap2 - 150922-1Document5 pagesUE4-LégisPharmaChap2 - 150922-1Abir ZouchPas encore d'évaluation
- Code Du Medicament Et de Pharmacie PDFDocument28 pagesCode Du Medicament Et de Pharmacie PDFAmelNesrinePas encore d'évaluation
- Dahir N° 1-06-151 Du 30 Chaoual 1427 Portant Promulgation de La Loi N° 17-04 Portant Code Du Médicament Et de La PharmacieDocument26 pagesDahir N° 1-06-151 Du 30 Chaoual 1427 Portant Promulgation de La Loi N° 17-04 Portant Code Du Médicament Et de La PharmacieManar HikkiPas encore d'évaluation
- Définition FinaleDocument10 pagesDéfinition FinaleAwa BakhoumPas encore d'évaluation
- OrdonnanceDocument4 pagesOrdonnanceamira PharmaciennePas encore d'évaluation
- Les Substances VénéneusesDocument20 pagesLes Substances Vénéneusesrahamamaiga808Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2-Regles de Prescription de MedicamentsDocument3 pagesChapitre 2-Regles de Prescription de MedicamentsJoyce DouanlaPas encore d'évaluation
- La Reglementation Des Produits Pharmaceutiques 2020-2021 Dr. Amiar PolycopiéDocument7 pagesLa Reglementation Des Produits Pharmaceutiques 2020-2021 Dr. Amiar PolycopiéBenaziez FoullaPas encore d'évaluation
- Les Produits PharmaceutiquesDocument3 pagesLes Produits PharmaceutiquesAdamPas encore d'évaluation
- Code de La PharmacieDocument39 pagesCode de La PharmacieLarbi Fsjes KenitraPas encore d'évaluation
- Arrêté Ministériel n°1250-CABMIN-SP-008-CPH-OBF-2015 Du 28 Septembre 2015 Portant Reglementation Du Commerce Des Produits Pharmaceutiques en RDCDocument9 pagesArrêté Ministériel n°1250-CABMIN-SP-008-CPH-OBF-2015 Du 28 Septembre 2015 Portant Reglementation Du Commerce Des Produits Pharmaceutiques en RDCDiane BanzePas encore d'évaluation
- Recueil de Textesmedicamen2016 Ould KaddaDocument402 pagesRecueil de Textesmedicamen2016 Ould Kaddahadeel hsnPas encore d'évaluation
- Analyse Technique D'une Ordonnance MedicamenteuseDocument12 pagesAnalyse Technique D'une Ordonnance MedicamenteuseKamel AdnanePas encore d'évaluation
- Legislation PharmaceutiqueDocument9 pagesLegislation PharmaceutiqueOusmane SambouPas encore d'évaluation
- Tchad Loi 2000 24 PharmacieDocument23 pagesTchad Loi 2000 24 Pharmaciepabameizoune0Pas encore d'évaluation
- Loi N 2021-03Document22 pagesLoi N 2021-03bienvenu FAGBOHOUNPas encore d'évaluation
- DS 016-2011-Sa - OkDocument104 pagesDS 016-2011-Sa - OkMiriam100% (1)
- 12 - Recevabilité D'une OrdannanceDocument6 pages12 - Recevabilité D'une OrdannanceMelissa MenasriaPas encore d'évaluation
- Fiche Legislation PharmaceutiqueDocument8 pagesFiche Legislation PharmaceutiquewadePas encore d'évaluation
- Publicité Et Produits Pharmaceutiques - OralDocument36 pagesPublicité Et Produits Pharmaceutiques - OralhubvuPas encore d'évaluation
- Pharmacologie - Vie Du MédicamentDocument16 pagesPharmacologie - Vie Du MédicamentPaul fatheadPas encore d'évaluation
- 2 - Le MédicamentDocument3 pages2 - Le Médicamentsamir hamadPas encore d'évaluation
- 01 - Développement de MédicamentsDocument57 pages01 - Développement de MédicamentsMelissa MenasriaPas encore d'évaluation
- Vente Directe PPAM Synthese Avril 2019Document1 pageVente Directe PPAM Synthese Avril 2019SackoPas encore d'évaluation
- Pharmacotoxicologie Guergour HDocument14 pagesPharmacotoxicologie Guergour HArchippe Abia TchangpinaPas encore d'évaluation
- Pharmacie VeterinaireDocument10 pagesPharmacie VeterinaireMelanie DeschampsPas encore d'évaluation
- Pharmacie VétérinaireDocument8 pagesPharmacie VétérinaireLina SpPas encore d'évaluation
- Definition Et Statut Des Medicaments L1 L0Document13 pagesDefinition Et Statut Des Medicaments L1 L0Lilia SouiadePas encore d'évaluation
- Chapitre I Intro Et Generatlite Sur Les Med - 240128 - 220615Document16 pagesChapitre I Intro Et Generatlite Sur Les Med - 240128 - 220615darraginetPas encore d'évaluation
- 1 GénéralitésDocument4 pages1 Généralitéscora.zone010120Pas encore d'évaluation
- ANNEXE 2 MoustaphaDocument2 pagesANNEXE 2 Moustaphachristian nziPas encore d'évaluation
- 1-2-3 - Pharmacologie 2021Document46 pages1-2-3 - Pharmacologie 2021Rania MaddahPas encore d'évaluation
- La Réglementation Des Substances Vénéneuses Au MarocDocument21 pagesLa Réglementation Des Substances Vénéneuses Au MarocHamada WwePas encore d'évaluation
- 02les Différentes Classes de Médicaments (2eme Cours)Document6 pages02les Différentes Classes de Médicaments (2eme Cours)abbou chaifaaPas encore d'évaluation
- Zalim Stupefiants Et PsychotropesDocument45 pagesZalim Stupefiants Et PsychotropesBouhraoua Mohamed AminePas encore d'évaluation
- (BO N°7048 Du 16/12/2021, Page 2549) : Rticle PremierDocument23 pages(BO N°7048 Du 16/12/2021, Page 2549) : Rticle PremierBouchra RadiPas encore d'évaluation
- CVDocument3 pagesCVkhenguiPas encore d'évaluation
- Pharmacologie Generale 1ere PartieDocument7 pagesPharmacologie Generale 1ere PartieMeryem ZouarhiPas encore d'évaluation
- Pharmaco 2Document105 pagesPharmaco 2Patrick NoaPas encore d'évaluation
- Power Point FormationDocument114 pagesPower Point FormationYves BayengaPas encore d'évaluation
- MorphinomimetiquesDocument2 pagesMorphinomimetiquesChrys DesozaPas encore d'évaluation
- Aspects Médico Légaux de Médicaments Et Pharmacodépendance 2023Document34 pagesAspects Médico Légaux de Médicaments Et Pharmacodépendance 2023mi maPas encore d'évaluation
- Pharmacie VeterinaireDocument6 pagesPharmacie VeterinaireParfaite ChiokoPas encore d'évaluation
- Règle de Prescription D'un MédicamentDocument3 pagesRègle de Prescription D'un MédicamentDidier NodjirePas encore d'évaluation
- Chapitre 1: Initiation A La Conaissance Du MedicamentDocument21 pagesChapitre 1: Initiation A La Conaissance Du Medicamentjeanbaptiste fomenaPas encore d'évaluation
- Module Droit Pharmaceutique 2023-2024Document21 pagesModule Droit Pharmaceutique 2023-2024Souhila BennakhlaPas encore d'évaluation
- 1 Introduction G À La Pharmacologie S1Document6 pages1 Introduction G À La Pharmacologie S1Asmaa HrPas encore d'évaluation
- Decret Homologation Medicaments PDFDocument10 pagesDecret Homologation Medicaments PDFMaximiliano ThiagoPas encore d'évaluation
- LA PHARMACIE HOSPITALIERE Gestion Cours 05Document43 pagesLA PHARMACIE HOSPITALIERE Gestion Cours 05Wassila Wissam100% (1)
- Chapitre 2 Specialité PharmaceutiqueDocument14 pagesChapitre 2 Specialité PharmaceutiqueignanonelidjandeuhdelaviePas encore d'évaluation
- Les Troubles Du Transit IntestinalDocument25 pagesLes Troubles Du Transit Intestinalfifi fifiPas encore d'évaluation
- Page de Garde Polycope TP ÉtudiantsDocument1 pagePage de Garde Polycope TP Étudiantsfifi fifiPas encore d'évaluation
- Mélange Homogène Rupture de PhaseDocument5 pagesMélange Homogène Rupture de Phasefifi fifi100% (1)
- Les BPFDocument8 pagesLes BPFfifi fifiPas encore d'évaluation
- TD 5 Extraction Liquide Liquide 2016 2017Document2 pagesTD 5 Extraction Liquide Liquide 2016 2017fifi fifi89% (9)
- AnulationDocument7 pagesAnulationfifi fifiPas encore d'évaluation
- Méthodes de Séparation2016Document5 pagesMéthodes de Séparation2016fifi fifiPas encore d'évaluation
- Formes Semi-Solides Imp +Document8 pagesFormes Semi-Solides Imp +fifi fifiPas encore d'évaluation
- Extraction À Contre CourantDocument6 pagesExtraction À Contre Courantfifi fifiPas encore d'évaluation
- Melange Homogene SuiteDocument7 pagesMelange Homogene Suitefifi fifiPas encore d'évaluation
- Validation Des ProcédésDocument7 pagesValidation Des Procédésfifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Altérations AlimentairesDocument6 pagesLes Altérations Alimentairesfifi fifi100% (1)
- Traitements Thermiques Du Lait+les Produits LaitiersDocument6 pagesTraitements Thermiques Du Lait+les Produits Laitiersfifi fifi100% (1)
- Biochimie de L'hemolyseDocument8 pagesBiochimie de L'hemolysefifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Éléments Toxiques Dans L'eauDocument5 pagesLes Éléments Toxiques Dans L'eaufifi fifiPas encore d'évaluation
- Secret MédicalDocument16 pagesSecret Médicalfifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Methodes de Conservation 2019Document2 pagesLes Methodes de Conservation 2019fifi fifiPas encore d'évaluation
- Alimentation, Nutrition Et Santé - DocxDocument10 pagesAlimentation, Nutrition Et Santé - Docxfifi fifi100% (1)
- EnzymeDocument8 pagesEnzymefifi fifiPas encore d'évaluation
- Hemostase Primaire 2018Document26 pagesHemostase Primaire 2018fifi fifiPas encore d'évaluation
- 11 Pancytopenies Et AplasiesDocument26 pages11 Pancytopenies Et Aplasiesfifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Organes HematopoietiquesDocument3 pagesLes Organes Hematopoietiquesfifi fifi100% (1)
- CIVDDocument27 pagesCIVDfifi fifiPas encore d'évaluation
- Exploration Du Metabolisme Des Bases Pur Et PyrDocument47 pagesExploration Du Metabolisme Des Bases Pur Et Pyrfifi fifi100% (3)
- CoccidioidomycoseDocument4 pagesCoccidioidomycosefifi fifiPas encore d'évaluation
- HistoplasmosesDocument6 pagesHistoplasmosesfifi fifiPas encore d'évaluation
- BlastomycosesDocument2 pagesBlastomycosesfifi fifiPas encore d'évaluation
- Polycope MalasseziosesDocument3 pagesPolycope Malasseziosesfifi fifiPas encore d'évaluation
- Equilibre PhosphocalciqueDocument12 pagesEquilibre Phosphocalciquefifi fifi100% (1)
- Les Interventores Du Protectorat EspagnoDocument30 pagesLes Interventores Du Protectorat EspagnoYolotl Valadez BetancourtPas encore d'évaluation
- Rapport SFE - Conseils RedactionDocument14 pagesRapport SFE - Conseils RedactionFiras NjéhiPas encore d'évaluation
- GnosesDocument42 pagesGnosesars507Pas encore d'évaluation
- Cryptographie TPDocument737 pagesCryptographie TPsnoupi2100% (4)
- 703 Em10072012Document20 pages703 Em10072012elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- La Vie Des Pierres, Rick BassDocument1 pageLa Vie Des Pierres, Rick BasseditionsdusnarkPas encore d'évaluation
- Brochure BMW x3 FRDocument3 pagesBrochure BMW x3 FRlebesguesPas encore d'évaluation
- Ementa - Conception Des Structures ThéoriqueDocument1 pageEmenta - Conception Des Structures ThéoriqueMarina BorgesPas encore d'évaluation
- Note de Calcul Des AtalusDocument16 pagesNote de Calcul Des AtalusSelma OfficePas encore d'évaluation
- 1bex 01 Logique Sr1Fr AmmariDocument1 page1bex 01 Logique Sr1Fr AmmariMed Amine HattakiPas encore d'évaluation
- Communiquer en Francais PDFDocument2 pagesCommuniquer en Francais PDFRyanPas encore d'évaluation
- Empire RusseDocument2 pagesEmpire Russeaurelien 270Pas encore d'évaluation
- PelvimétrieDocument11 pagesPelvimétrieyassin temoPas encore d'évaluation
- Aide Multicritère A La DécisionDocument20 pagesAide Multicritère A La DécisionpierrePas encore d'évaluation
- Migne. Patrologia Latina Tomus XCIX.Document639 pagesMigne. Patrologia Latina Tomus XCIX.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Cause PDFDocument4 pagesCause PDFAlex CourtoisPas encore d'évaluation
- Recette# @Document2 pagesRecette# @kouadiosamuelkouame7Pas encore d'évaluation
- Eei Controle 1Document1 pageEei Controle 1mohamed ikenPas encore d'évaluation
- Cours Protections Des Vegetaux Et Lutte Integree - 073353Document28 pagesCours Protections Des Vegetaux Et Lutte Integree - 073353Jean noel Djeme BoyketePas encore d'évaluation
- Asgb 95 183Document14 pagesAsgb 95 183risasi kahengaPas encore d'évaluation
- La Théorie Du ChaosDocument12 pagesLa Théorie Du ChaosAhmed RomdhaniPas encore d'évaluation
- de Présentation Marketing Territorial en 10 ÉtapesDocument23 pagesde Présentation Marketing Territorial en 10 ÉtapesVincent Gollain82% (11)
- Analyse Microbiologique Des Produits LaitiersDocument8 pagesAnalyse Microbiologique Des Produits Laitiersmeriem wafaa tabtiPas encore d'évaluation
- Mondialisation Normalisation ISO Et Effets de La Certification ISO 9001 Sur Les Entreprises AlgériennesDocument25 pagesMondialisation Normalisation ISO Et Effets de La Certification ISO 9001 Sur Les Entreprises AlgériennesBourahla mariaPas encore d'évaluation
- MHMTDocument127 pagesMHMTabou9othoum100% (1)
- Marché AgricoleDocument17 pagesMarché AgricoleakoiPas encore d'évaluation
- Spinner Des Figures de L'analogieDocument6 pagesSpinner Des Figures de L'analogieSibonyPas encore d'évaluation
- Memoire DU Alassane Alfouséni DoumbiaDocument41 pagesMemoire DU Alassane Alfouséni DoumbiaSalma benPas encore d'évaluation
- Questionnaire EXPERTDocument5 pagesQuestionnaire EXPERTBNZ FRSPas encore d'évaluation
Definition Classification Juridique Et Regime Des Medicaments
Definition Classification Juridique Et Regime Des Medicaments
Transféré par
fifi fifiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Definition Classification Juridique Et Regime Des Medicaments
Definition Classification Juridique Et Regime Des Medicaments
Transféré par
fifi fifiDroits d'auteur :
Formats disponibles
CLASSIFICATION ET REGIME DE PRESCRIPTION
I. DEFINITION LEGALE DU MEDICAMENT
Elle est donnée par Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2 juillet 2018 relative à la santé en ses art.208 et 209
« Le médicament, au sens de la présente loi, est toute substance ou
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, et tous
produits pouvant être administrés à l’homme ou à l’animal en vue
d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger et de
modifier ses fonctions physiologiques » Art.208 de la L.P.P.S.
Au sens de l’art.208 le médicament est définit de deux manières :
Par la COMPOSITION (Propriétés curatives ou préventives)
Par la FONCTION (Etablir un diagnostic ou de restaurer,
corriger, modifier leurs fonctions organiques)
Sont également assimilés à des médicaments :
— les produits diététiques qui renferment des substances non
alimentaires leur conférant des propriétés utiles à la santé humaine ;
— les produits stables dérivés du sang ;
— les concentrés d’hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale ;
— les gaz médicaux. » Art.209 de la L.S
Sont assimilés à des médicaments, notamment :
— les produits d'hygiène corporelle et produits cosmétiques
contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations
supérieures à celles fixées par voie réglementaire.
Au sens de l’art.209 le médicament est définit par
sa COMPOSITION (Produit d’hygiène ou diététique)
II. LA CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS :
Les médicaments se distinguent principalement en deux grandes classes :
II.1 LES MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES :
Ce sont des substances qui provoquent chez un individu sain des symptômes
retrouvés chez un malade à qui ils peuvent donner la guérison.
II.2 LES MEDICAMENTS ALLOPATHIQUES :
Ce sont des produits dont l’action sur l’homme sain occasionne des
phénomènes morbides autres que ceux qu’on observe chez le malade. Ils
constituent le traitement habituel des maladies.
Les médicaments allopathiques comprennent ceux destinés à la médecine
vétérinaire et ceux destinés à la médecine humaine.
Parmi les médicaments allopathiques destinés à la médecine humaine, la
législation distingue:
A. Les Médicaments Magistraux :
Il s’agit de médicaments préparés extemporanément à l’officine, à l’agence
PHARM ou à l’hôpital et ce conformément à l’ordonnance du Médecin, voire
du Chirurgien dentiste ou de la sage femme et qui en précise la formule
détaillée.
C’est un médicament adapté et destiné, naturellement à un seul malade.
Ces produits ne sont pas soumis à la procédure d’autorisation de mise sur
le marché mais appellent à la procédure suivante :
Transcription sur numéro d’ordre.
Le nom du prescripteur.
Le nom du client et son adresse.
La date d’exécution de la dite préparation.
Apposition sur le récipient, la boite ou le paquet qui contient ladite
préparation : « Son nom, son adresse et la désignation du produit »
La Responsabilité du pharmacien dans ce cadre là est engagée concurremment
avec celle du praticien médical prescripteur.
B. Les Médicaments Officinaux :
Il s’agit de produits naturels utilisés tel quel ou à partir desquels sont extrait
des médicaments (Emétine, pénicilline, codéine, teinture de belladone….)
En principe ces médicaments doivent figurer à la nomenclature nationale et
être détenus constamment à la disposition par les pharmaciens.
Ces produits souvent fabriqués par les industries et livrés en vrac au
pharmacien qui en assure la division et le conditionnement dans son officine.
Ces médicaments bien que fabriquées industriellement, conserve leur
statut officinal et échappent à l’autorisation de mise sur le marché.
Mais, doivent répondre à la procédure suivante :
Etiquetage de ces médicaments officinaux par le pharmacien.
Doit porter l’appellation d’origine (selon la Nomenclature Nationale)
Le nom et l’adresse du pharmacien.
C. Les Médicaments Spécialisés
Les médicaments spécialisés comprennent deux (02) catégories :
Les médicaments spécialisés de l’officine :
Appelés « Produits maison » ou « Produits conseils » qui est une catégorie
de médicament préparé à l’avance dans l’officine du pharmacien, suivant une
formule conseillée par lui et destinée à sa propre clientèle.
Ces médicaments ne sont pas assujettis à la procédure de l’autorisation de
mise sur le marché.
Les spécialités pharmaceutiques :
Est qualifié de spécialité pharmaceutique au sens de l’art.210 de la L.P.P.S
« Tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement
particulier et caractérisé par une dénomination spéciale »
Il s’agit de médicaments préparés à l’avance selon une formule proposée par le
laboratoire qui les fabriques et fixe leur dénomination. Et qui représentent la
majorité des médicaments vendus aujourd’hui.
Ces médicaments sont enregistrés soit:
Sous Dénomination Commerciale ;
Ou sous Dénomination Commune Internationale (D.C.I) tel retenu par
l’O.M.S.
D. Les médicaments génériques
Ce sont des spécialités pharmaceutiques dont la formule est tombée dans le
domaine public, au terme de leur brevet et qui sont vendus sous leur
dénomination commune.
Ces médicaments peuvent dès lors, être fabriqués par n’importe quel
producteur.
III. REGIME DE PRESCRIPTION : REGIME DES SUBSTANCES
VENENEUSES
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet
2018 relative à la santé.
Chapitre 8
Substances et préparations vénéneuses
Art. 244. — Les substances vénéneuses, au sens de la
présente loi, comprennent notamment :
— les substances stupéfiantes ;
— les substances psychotropes ;
— les substances inscrites sur la liste I et la liste II des
substances, préparations et produits présentant des risques
pour la santé, conformément à la classification
internationale.
Art. 245. — Sont soumis à un contrôle spécifique
administratif, technique et de sécurité :
— la production, la fabrication, le conditionnement, la
transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la
distribution, la cession, la remise, l’acquisition, la détention
de substances, médicaments ayant des propriétés
stupéfiantes et/ou psychotropes ;
— l’emploi de plantes ou parties de plantes dotées de
propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par
voie réglementaire
Les substances vénéneuses sont régies par le Décret n° 76-140 du 23
octobre 1976 portant réglementation des substances vénéneuses.
Ces substances sont classées en trois (03) tableaux :
Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections.
Les substances vénéneuses destinées au commerce, à l’industrie ou à
l’agriculture sont inscrites dans la section I des tableaux A. B et C.
Cette section comprend, outre les substances inscrites dans la section
II, celles désignées par arrêté pris conjointement par le ministre
chargé de l’industrie et de l’énergie, le ministre chargé du commerce,
le ministre chargé de l’agriculture et de la réforme agraire et le
ministre chargé de la santé publique.
Les substances vénéneuses destinées à la médecine sont inscrites
dans la section II des tableaux A, B et C par arrêté du ministre chargé
de la santé publique.
·Tableau A : Produits Toxiques :
Sont ceux qui présentent une forte toxicité à une faible dose comme l’arsenic,
le mercure et la nicotine.
Tableau B : Produits Stupéfiants :
Comprend les produits dont l’usage peut engendrer une accoutumance
pouvant conduire à une dépendance physique ou psychique et donc à la
Toxicomanie.
·Tableau C : Produits Dangereux :
Comprend les substances relativement moins toxiques dont la manipulation
peut être dangereuse et dont l’emploi sans surveillance médicale pourrait
devenir néfaste.
La substance vénéneuse est une substance qui contient un poison et dont
l’administration peut engendrer des effets nocifs pour l’organisme.
Les médicaments contenant ces substances vénéneuses peuvent être cause
d’accidents thérapeutiques, d’intoxications accidentelles, suicidaires voire
criminelles.
Les médicaments qui contiennent des substances vénéneuses sont soumis au
régime des dites substances, notamment en matière d’approvisionnement,
d’étiquetage, de détention, de délivrance, de renouvellement, etc.
III.1 L’APPROVISIONNEMENT
L’approvisionnement par les pharmaciens pour les médicaments du
tableau A et C s’effectue librement auprès des entreprises PHARM ou
des grossistes répartiteurs.
En revanche, l’approvisionnement en médicament du tableau B ne
peut s’effectuer qu’auprès des établissements agrées en utilisant des
volets foliotés extraits d’un CARNET A SOUCHE délivré par les
autorités sanitaires. Dont la procédure pratique est la suivante :
L’un des volets porte :
· Le nom, m’adresse et la signature du pharmacien acheteur
· La date de demande et le timbre de la pharmacie
· Mentionne en toutes lettres le nom du produit et la quantité
demandée.
Le second volet ne porte que:
Le nom et l’adresse du pharmacien acheteur
La nature du médicament.
Qui sera renvoyé par le vendeur à l’acheteur avec les indications suivantes :
Le numéro de sortie de son registre ;
Les quantités réellement livrées ;
La date de livraison ;
Le timbre et la signature du vendeur.
Dès réception par le pharmacien des médicaments classés au tableau répond à
la procédure suivante :
Les inscrire sans blanc, ni rature et ni surcharge sur un REGISTRE
SPECIAL coté et paraphé par le commissaire de police (chef de la Sûreté de
WILAYA) et le président près le Tribunal territorialement compétente.
Date, et nom du fournisseur
Désignation du produit et des quantités reçues.
Ce registre doit être conservé pendant dix (10) années au moins, pour
être présenté à toutes réquisitions de l’autorité compétente.
III.2 L’ETIQUETAGE :
A. Etiquetage pour la détention à l’officine des substances en nature et des
préparations officinales non délivré au public :
Tableau A et B : (Toxique et Stupéfiants)
L’étiquette est rouge-orangé dans tous les cas, portant le nom du produit
en noir et le poids brut et net pour les stupéfiants
Tableau C : (Dangereux)
Ces produits sont tenus hors de portée du public.
B. Etiquetage pour la délivrance au public :
B.1 Substances en nature :
Tableau A et C :
Les règles sont identiques à celles appliquées pour les produits détenus à
l’officine.
Tableau B :
La prescription et la délivrance sont interdites.
B.2 Préparations officinales et magistrales destinées à la médecine
humaine :
L’étiquetage doit obligatoirement porter le nom et l’adresse du pharmacien, le
numéro d’inscription à l’ordonnancier et le mode d’emploi.
La couleur de l’étiquette diffère selon la voie d’administration du médicament :
Administration par voie orale, perlinguale, rectale, transcutanée,
urétrale, vaginale :
-Etiquette est blanche et porte les mentions sus cités.
-Si la préparation contient une substance vénéneuse à dose non exonérée, un
contre étiquette rouge-orangé portant en noir la mention « RESPECTER LES
DOSES PRESCITES » est apposée.
Administration par d’autres voies :
-Etiquette est blanche et porte les mentions sus citées.
-Si la préparation contient une substance vénéneuse à dose non exonérée,
l’étiquette rouge-orangé portant en noir la mention « NE PAS AVALER »
Cette étiquette peut comporter un espace blanc pour permettre l’inscription
en noir du mode d’emploi.
B.3 Préparations officinales et magistrales destinées à la médecine
vétérinaire :
L’étiquetage est identique à celui des préparations destinées à la médecine
humaine, avec en plus une contre-étiquette rouge-orangé portant en noir la
mention « USAGE VETERINAIRE »
B.4 Médicaments spécialisés destinés à la médecine humaine :
Sur les étiquettes extérieure et intérieure doivent figurer des mentions
obligatoires :
Nom et adresse du fabricant
Dénomination exacte du produit
Formule centésimale
Quantité de substance vénéneuse contenue dans la boite (si c’est le cas)
Concentration de cette substance (Indiquée en toutes lettres si elle est
inscrite sur le tableau A ou B)
Le N° de lot de fabrication
Date de péremption en clair
Prix et vignette (Pour les médicaments remboursables)
Indications thérapeutiques
Posologie.
Si la spécialité renferme une substance vénéneuse à dose non exonéré, son
conditionnement comporte un cadre de couleur rouge pour le tableau A et B et
cadre vert pour le tableau C et dans lequel le pharmacien inscrira le numéro
d’ordre à l’ordonnancier, le mode d’emploi indiqué par le prescripteur et
apposera son cachet.
De plus, une mention en noir sur fond rouge « RESPECTER LES DOSES
PRESCRITES » est apposée sur le conditionnement des médicaments destinés à
la voie orale, perlinguale, rectale, transcutanée, urétrale et vaginale.
Pour toute autre voie, la mention en noir sur fond rouge « NE PAS AVALER »
B.5 Médicaments spécialisés destinés à la médecine vétérinaire :
L’étiquetage est le même que celui des spécialités destinées à la médecine
humaine avec en plus la mention « USAGE VETERINAIRE » écrite en noir sur
fond rouge.
III.3 LA DETENTION :
Les médicaments inscrits au tableau A et B doivent être tenus enfermés dans
des armoires ou des locaux fermants à clé.
Seules les spécialités pharmaceutiques appartenant au tableau A peuvent être
maintenues sur les rayonnages des pharmaciens.
Les médicaments inscrits au tableau C doivent être conservés dans un endroit
où n’ont pas accès les personnes étrangères à l’établissement, sans pour autant
être un local fermant à clé.
III.4 LA DELIVRANCE :
Pour la délivrance au public, les médicaments inscrits sur une liste suivront
certaines règles :
Pour le tableau C :
La prescription médicale est obligatoire, elle précise le mode d’emploi ;
Le médicament est inscrit à l’ordonnancier (livre – registre)
Le numéro d’ordre et le cachet du pharmacien dans le cadre vert pour
les spécialités ou sur l’étiquette pour les autres formes.
Sur l’ordonnance on reporte le numéro d’ordre, la date et le cachet.
Les spécialités et préparations du tableau C sont renouvelables lorsque le
délai d’emploi par le prescripteur est révolu. Il faut par ailleurs, effectuer une
nouvelle inscription à l’ordonnancier sous un nouveau numéro qui sera
reporté comme précédemment.
Pour le tableau A :
Aucun des médicaments n’est renouvelable.
Pour le tableau A : il devient obligatoire de mentionner sur
l’ordonnance l’âge et le sexe du malade.
Pour la première délivrance, l’ordonnance devra dater de moins de trois
(03) mois et la durée de traitement ne peut dépasser douze (12) mois.
Pour le tableau B : Réglementation plus complexe.
On ne peut prescrire des produits en nature mais seulement des
préparations ou spécialités ;
La prescription doit être rédigée sur une ordonnance extraite
d’un CARNET A SOUCHE que le médecin obtient auprès des Directions de
Santé et Protection Sociale de Wilaya.
Le nom et l’adresse du prescripteur et du malade y sont inscrits.
La prescription mentionne le nom du médicament ou la formule de la
préparation ;
Les quantités et les posologies écrites en toutes lettres ;
Cette prescription doit respecter la règle des sept (07) jours ;
Dans le cas des spécialités cela amène le pharmacien à déconditionner le
médicament lorsque cela est nécessaire pour délivrer le nombre exact de prise
correspondant à la prescription et pas plus ;
Sur cette ordonnance, on porte le numéro d’inscription
l’ORDONNANCIER s’effectue en rouge et le numéro là est encore reporté sur
le conditionnement du médicament et l’ordonnance ainsi que sur
le REGISTRE DES STUPEFIANTS colonnes sorties ;
En aucun cas une prescription ne peut être renouvelée ;
Une nouvelle ordonnance prescrivant le même produit ne peut
intervenir avant que le délai de la première prescription ne soit écoulé, sauf
mention formelle du prescripteur qui affirme avoir connaissance de la
précédente ordonnance.
On la garde dix (10) ans dans l’officine et on donne une copie au malade
IV. CONCLUSION
Toutes ces règles peuvent être draconiennes, et le malade s’en plaint parfois.
Il ne faut jamais oublier qu’elles sont établies dans son intérêt, afin d’éviter les
éventuels accidents thérapeutiques qui découleraient d’une mauvaise
utilisation des médicaments.
Il faut résister à la tentation de « dépanner » ou de faire plaisir à un client trop
pressant, car ce service rendu peut fort bien se retourner contre lui.
Il s’agit d’un aspect du travail où la responsabilité du pharmacien et de ses
collaborateurs est là encore hautement engagée. Et l’image de marque d’une
officine ne peut qu’être renforcée par l’attitude consciencieuse de son
personnel.
Le respect de ces règles d’étiquetage revêt une grande importance car la
responsabilité du pharmacien est engagée tant au niveau de la préparation
qu’à celui de la délivrance des médicaments
Vous aimerez peut-être aussi
- SukukDocument82 pagesSukukChaimae AfifPas encore d'évaluation
- Gestion Des Psychotropes Au Niveau Des Établissements Hospitaliers Publics Et Privés-Converti PDFDocument8 pagesGestion Des Psychotropes Au Niveau Des Établissements Hospitaliers Publics Et Privés-Converti PDFSamir Derri100% (2)
- Pharmacologie Generale PDFDocument71 pagesPharmacologie Generale PDFOusmane100% (1)
- Exploration Biochimique Du LCR Et Des Liquides DDocument7 pagesExploration Biochimique Du LCR Et Des Liquides Dfifi fifi100% (1)
- Questionnaire SicadDocument20 pagesQuestionnaire SicadScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Loi Pharmaceutique NigerDocument26 pagesLoi Pharmaceutique NigerAlberto GeorgePas encore d'évaluation
- Questionnaire SICADDocument4 pagesQuestionnaire SICADScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Loi N° 17-04 (FR) PDFDocument43 pagesLoi N° 17-04 (FR) PDFFati FollaPas encore d'évaluation
- Ordonnance Portant Législation Pharmaceutique Au NigerDocument26 pagesOrdonnance Portant Législation Pharmaceutique Au Nigeralix.bossonPas encore d'évaluation
- CONNAISSANCE DU MEDICAMENT Partie 2Document45 pagesCONNAISSANCE DU MEDICAMENT Partie 2Estelle MkoungaPas encore d'évaluation
- UE4-LégisPharmaChap2 - 150922-1Document5 pagesUE4-LégisPharmaChap2 - 150922-1Abir ZouchPas encore d'évaluation
- Code Du Medicament Et de Pharmacie PDFDocument28 pagesCode Du Medicament Et de Pharmacie PDFAmelNesrinePas encore d'évaluation
- Dahir N° 1-06-151 Du 30 Chaoual 1427 Portant Promulgation de La Loi N° 17-04 Portant Code Du Médicament Et de La PharmacieDocument26 pagesDahir N° 1-06-151 Du 30 Chaoual 1427 Portant Promulgation de La Loi N° 17-04 Portant Code Du Médicament Et de La PharmacieManar HikkiPas encore d'évaluation
- Définition FinaleDocument10 pagesDéfinition FinaleAwa BakhoumPas encore d'évaluation
- OrdonnanceDocument4 pagesOrdonnanceamira PharmaciennePas encore d'évaluation
- Les Substances VénéneusesDocument20 pagesLes Substances Vénéneusesrahamamaiga808Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2-Regles de Prescription de MedicamentsDocument3 pagesChapitre 2-Regles de Prescription de MedicamentsJoyce DouanlaPas encore d'évaluation
- La Reglementation Des Produits Pharmaceutiques 2020-2021 Dr. Amiar PolycopiéDocument7 pagesLa Reglementation Des Produits Pharmaceutiques 2020-2021 Dr. Amiar PolycopiéBenaziez FoullaPas encore d'évaluation
- Les Produits PharmaceutiquesDocument3 pagesLes Produits PharmaceutiquesAdamPas encore d'évaluation
- Code de La PharmacieDocument39 pagesCode de La PharmacieLarbi Fsjes KenitraPas encore d'évaluation
- Arrêté Ministériel n°1250-CABMIN-SP-008-CPH-OBF-2015 Du 28 Septembre 2015 Portant Reglementation Du Commerce Des Produits Pharmaceutiques en RDCDocument9 pagesArrêté Ministériel n°1250-CABMIN-SP-008-CPH-OBF-2015 Du 28 Septembre 2015 Portant Reglementation Du Commerce Des Produits Pharmaceutiques en RDCDiane BanzePas encore d'évaluation
- Recueil de Textesmedicamen2016 Ould KaddaDocument402 pagesRecueil de Textesmedicamen2016 Ould Kaddahadeel hsnPas encore d'évaluation
- Analyse Technique D'une Ordonnance MedicamenteuseDocument12 pagesAnalyse Technique D'une Ordonnance MedicamenteuseKamel AdnanePas encore d'évaluation
- Legislation PharmaceutiqueDocument9 pagesLegislation PharmaceutiqueOusmane SambouPas encore d'évaluation
- Tchad Loi 2000 24 PharmacieDocument23 pagesTchad Loi 2000 24 Pharmaciepabameizoune0Pas encore d'évaluation
- Loi N 2021-03Document22 pagesLoi N 2021-03bienvenu FAGBOHOUNPas encore d'évaluation
- DS 016-2011-Sa - OkDocument104 pagesDS 016-2011-Sa - OkMiriam100% (1)
- 12 - Recevabilité D'une OrdannanceDocument6 pages12 - Recevabilité D'une OrdannanceMelissa MenasriaPas encore d'évaluation
- Fiche Legislation PharmaceutiqueDocument8 pagesFiche Legislation PharmaceutiquewadePas encore d'évaluation
- Publicité Et Produits Pharmaceutiques - OralDocument36 pagesPublicité Et Produits Pharmaceutiques - OralhubvuPas encore d'évaluation
- Pharmacologie - Vie Du MédicamentDocument16 pagesPharmacologie - Vie Du MédicamentPaul fatheadPas encore d'évaluation
- 2 - Le MédicamentDocument3 pages2 - Le Médicamentsamir hamadPas encore d'évaluation
- 01 - Développement de MédicamentsDocument57 pages01 - Développement de MédicamentsMelissa MenasriaPas encore d'évaluation
- Vente Directe PPAM Synthese Avril 2019Document1 pageVente Directe PPAM Synthese Avril 2019SackoPas encore d'évaluation
- Pharmacotoxicologie Guergour HDocument14 pagesPharmacotoxicologie Guergour HArchippe Abia TchangpinaPas encore d'évaluation
- Pharmacie VeterinaireDocument10 pagesPharmacie VeterinaireMelanie DeschampsPas encore d'évaluation
- Pharmacie VétérinaireDocument8 pagesPharmacie VétérinaireLina SpPas encore d'évaluation
- Definition Et Statut Des Medicaments L1 L0Document13 pagesDefinition Et Statut Des Medicaments L1 L0Lilia SouiadePas encore d'évaluation
- Chapitre I Intro Et Generatlite Sur Les Med - 240128 - 220615Document16 pagesChapitre I Intro Et Generatlite Sur Les Med - 240128 - 220615darraginetPas encore d'évaluation
- 1 GénéralitésDocument4 pages1 Généralitéscora.zone010120Pas encore d'évaluation
- ANNEXE 2 MoustaphaDocument2 pagesANNEXE 2 Moustaphachristian nziPas encore d'évaluation
- 1-2-3 - Pharmacologie 2021Document46 pages1-2-3 - Pharmacologie 2021Rania MaddahPas encore d'évaluation
- La Réglementation Des Substances Vénéneuses Au MarocDocument21 pagesLa Réglementation Des Substances Vénéneuses Au MarocHamada WwePas encore d'évaluation
- 02les Différentes Classes de Médicaments (2eme Cours)Document6 pages02les Différentes Classes de Médicaments (2eme Cours)abbou chaifaaPas encore d'évaluation
- Zalim Stupefiants Et PsychotropesDocument45 pagesZalim Stupefiants Et PsychotropesBouhraoua Mohamed AminePas encore d'évaluation
- (BO N°7048 Du 16/12/2021, Page 2549) : Rticle PremierDocument23 pages(BO N°7048 Du 16/12/2021, Page 2549) : Rticle PremierBouchra RadiPas encore d'évaluation
- CVDocument3 pagesCVkhenguiPas encore d'évaluation
- Pharmacologie Generale 1ere PartieDocument7 pagesPharmacologie Generale 1ere PartieMeryem ZouarhiPas encore d'évaluation
- Pharmaco 2Document105 pagesPharmaco 2Patrick NoaPas encore d'évaluation
- Power Point FormationDocument114 pagesPower Point FormationYves BayengaPas encore d'évaluation
- MorphinomimetiquesDocument2 pagesMorphinomimetiquesChrys DesozaPas encore d'évaluation
- Aspects Médico Légaux de Médicaments Et Pharmacodépendance 2023Document34 pagesAspects Médico Légaux de Médicaments Et Pharmacodépendance 2023mi maPas encore d'évaluation
- Pharmacie VeterinaireDocument6 pagesPharmacie VeterinaireParfaite ChiokoPas encore d'évaluation
- Règle de Prescription D'un MédicamentDocument3 pagesRègle de Prescription D'un MédicamentDidier NodjirePas encore d'évaluation
- Chapitre 1: Initiation A La Conaissance Du MedicamentDocument21 pagesChapitre 1: Initiation A La Conaissance Du Medicamentjeanbaptiste fomenaPas encore d'évaluation
- Module Droit Pharmaceutique 2023-2024Document21 pagesModule Droit Pharmaceutique 2023-2024Souhila BennakhlaPas encore d'évaluation
- 1 Introduction G À La Pharmacologie S1Document6 pages1 Introduction G À La Pharmacologie S1Asmaa HrPas encore d'évaluation
- Decret Homologation Medicaments PDFDocument10 pagesDecret Homologation Medicaments PDFMaximiliano ThiagoPas encore d'évaluation
- LA PHARMACIE HOSPITALIERE Gestion Cours 05Document43 pagesLA PHARMACIE HOSPITALIERE Gestion Cours 05Wassila Wissam100% (1)
- Chapitre 2 Specialité PharmaceutiqueDocument14 pagesChapitre 2 Specialité PharmaceutiqueignanonelidjandeuhdelaviePas encore d'évaluation
- Les Troubles Du Transit IntestinalDocument25 pagesLes Troubles Du Transit Intestinalfifi fifiPas encore d'évaluation
- Page de Garde Polycope TP ÉtudiantsDocument1 pagePage de Garde Polycope TP Étudiantsfifi fifiPas encore d'évaluation
- Mélange Homogène Rupture de PhaseDocument5 pagesMélange Homogène Rupture de Phasefifi fifi100% (1)
- Les BPFDocument8 pagesLes BPFfifi fifiPas encore d'évaluation
- TD 5 Extraction Liquide Liquide 2016 2017Document2 pagesTD 5 Extraction Liquide Liquide 2016 2017fifi fifi89% (9)
- AnulationDocument7 pagesAnulationfifi fifiPas encore d'évaluation
- Méthodes de Séparation2016Document5 pagesMéthodes de Séparation2016fifi fifiPas encore d'évaluation
- Formes Semi-Solides Imp +Document8 pagesFormes Semi-Solides Imp +fifi fifiPas encore d'évaluation
- Extraction À Contre CourantDocument6 pagesExtraction À Contre Courantfifi fifiPas encore d'évaluation
- Melange Homogene SuiteDocument7 pagesMelange Homogene Suitefifi fifiPas encore d'évaluation
- Validation Des ProcédésDocument7 pagesValidation Des Procédésfifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Altérations AlimentairesDocument6 pagesLes Altérations Alimentairesfifi fifi100% (1)
- Traitements Thermiques Du Lait+les Produits LaitiersDocument6 pagesTraitements Thermiques Du Lait+les Produits Laitiersfifi fifi100% (1)
- Biochimie de L'hemolyseDocument8 pagesBiochimie de L'hemolysefifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Éléments Toxiques Dans L'eauDocument5 pagesLes Éléments Toxiques Dans L'eaufifi fifiPas encore d'évaluation
- Secret MédicalDocument16 pagesSecret Médicalfifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Methodes de Conservation 2019Document2 pagesLes Methodes de Conservation 2019fifi fifiPas encore d'évaluation
- Alimentation, Nutrition Et Santé - DocxDocument10 pagesAlimentation, Nutrition Et Santé - Docxfifi fifi100% (1)
- EnzymeDocument8 pagesEnzymefifi fifiPas encore d'évaluation
- Hemostase Primaire 2018Document26 pagesHemostase Primaire 2018fifi fifiPas encore d'évaluation
- 11 Pancytopenies Et AplasiesDocument26 pages11 Pancytopenies Et Aplasiesfifi fifiPas encore d'évaluation
- Les Organes HematopoietiquesDocument3 pagesLes Organes Hematopoietiquesfifi fifi100% (1)
- CIVDDocument27 pagesCIVDfifi fifiPas encore d'évaluation
- Exploration Du Metabolisme Des Bases Pur Et PyrDocument47 pagesExploration Du Metabolisme Des Bases Pur Et Pyrfifi fifi100% (3)
- CoccidioidomycoseDocument4 pagesCoccidioidomycosefifi fifiPas encore d'évaluation
- HistoplasmosesDocument6 pagesHistoplasmosesfifi fifiPas encore d'évaluation
- BlastomycosesDocument2 pagesBlastomycosesfifi fifiPas encore d'évaluation
- Polycope MalasseziosesDocument3 pagesPolycope Malasseziosesfifi fifiPas encore d'évaluation
- Equilibre PhosphocalciqueDocument12 pagesEquilibre Phosphocalciquefifi fifi100% (1)
- Les Interventores Du Protectorat EspagnoDocument30 pagesLes Interventores Du Protectorat EspagnoYolotl Valadez BetancourtPas encore d'évaluation
- Rapport SFE - Conseils RedactionDocument14 pagesRapport SFE - Conseils RedactionFiras NjéhiPas encore d'évaluation
- GnosesDocument42 pagesGnosesars507Pas encore d'évaluation
- Cryptographie TPDocument737 pagesCryptographie TPsnoupi2100% (4)
- 703 Em10072012Document20 pages703 Em10072012elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- La Vie Des Pierres, Rick BassDocument1 pageLa Vie Des Pierres, Rick BasseditionsdusnarkPas encore d'évaluation
- Brochure BMW x3 FRDocument3 pagesBrochure BMW x3 FRlebesguesPas encore d'évaluation
- Ementa - Conception Des Structures ThéoriqueDocument1 pageEmenta - Conception Des Structures ThéoriqueMarina BorgesPas encore d'évaluation
- Note de Calcul Des AtalusDocument16 pagesNote de Calcul Des AtalusSelma OfficePas encore d'évaluation
- 1bex 01 Logique Sr1Fr AmmariDocument1 page1bex 01 Logique Sr1Fr AmmariMed Amine HattakiPas encore d'évaluation
- Communiquer en Francais PDFDocument2 pagesCommuniquer en Francais PDFRyanPas encore d'évaluation
- Empire RusseDocument2 pagesEmpire Russeaurelien 270Pas encore d'évaluation
- PelvimétrieDocument11 pagesPelvimétrieyassin temoPas encore d'évaluation
- Aide Multicritère A La DécisionDocument20 pagesAide Multicritère A La DécisionpierrePas encore d'évaluation
- Migne. Patrologia Latina Tomus XCIX.Document639 pagesMigne. Patrologia Latina Tomus XCIX.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Cause PDFDocument4 pagesCause PDFAlex CourtoisPas encore d'évaluation
- Recette# @Document2 pagesRecette# @kouadiosamuelkouame7Pas encore d'évaluation
- Eei Controle 1Document1 pageEei Controle 1mohamed ikenPas encore d'évaluation
- Cours Protections Des Vegetaux Et Lutte Integree - 073353Document28 pagesCours Protections Des Vegetaux Et Lutte Integree - 073353Jean noel Djeme BoyketePas encore d'évaluation
- Asgb 95 183Document14 pagesAsgb 95 183risasi kahengaPas encore d'évaluation
- La Théorie Du ChaosDocument12 pagesLa Théorie Du ChaosAhmed RomdhaniPas encore d'évaluation
- de Présentation Marketing Territorial en 10 ÉtapesDocument23 pagesde Présentation Marketing Territorial en 10 ÉtapesVincent Gollain82% (11)
- Analyse Microbiologique Des Produits LaitiersDocument8 pagesAnalyse Microbiologique Des Produits Laitiersmeriem wafaa tabtiPas encore d'évaluation
- Mondialisation Normalisation ISO Et Effets de La Certification ISO 9001 Sur Les Entreprises AlgériennesDocument25 pagesMondialisation Normalisation ISO Et Effets de La Certification ISO 9001 Sur Les Entreprises AlgériennesBourahla mariaPas encore d'évaluation
- MHMTDocument127 pagesMHMTabou9othoum100% (1)
- Marché AgricoleDocument17 pagesMarché AgricoleakoiPas encore d'évaluation
- Spinner Des Figures de L'analogieDocument6 pagesSpinner Des Figures de L'analogieSibonyPas encore d'évaluation
- Memoire DU Alassane Alfouséni DoumbiaDocument41 pagesMemoire DU Alassane Alfouséni DoumbiaSalma benPas encore d'évaluation
- Questionnaire EXPERTDocument5 pagesQuestionnaire EXPERTBNZ FRSPas encore d'évaluation