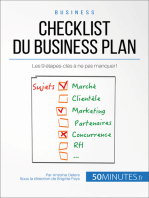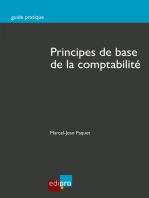Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Manuel Comptabilite 1er Cycle
Manuel Comptabilite 1er Cycle
Transféré par
Karl-HeinzCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Manuel Comptabilite 1er Cycle
Manuel Comptabilite 1er Cycle
Transféré par
Karl-HeinzDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours
de Comptabilité Générale I.
Principes et applications : Entreprises de services
Plan des chapitres
CHAPITRE I
• CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITE ET LE BILAN
• QU’EST‐CE QUE LA COMPTABILITE
• LES UTILISATEURS DE L’INFORMATION COMPTABLES ET LEURS BESOINS.
• LA PROFESSION COMPTABLE DANS LE MONDE ET EN HAITI.
• LES PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS (PCGR)
• L’OBJECTIF DES ETATS FINANCIERS
• LES ELEMENTS DES ETATS FINANCIERS
• L’EQUATION COMPTABLE FONDAMENTALE
• LES EFFETS DE DIVERSES OPERATIONS SUR L’EQUATION COMPTABLE.
• LE BILAN
• LES FORMES D’ENTREPRISES
• LE BILAN DES QUATRES FORMES D’ENTREPRISES
• QUESTIONS, EXERCICES ET PROBLEMES DE REVISION.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 1
HISTORIQUE DE LA COMPTABILITE
Les historiens estiment que l’apparition de la comptabilité est liée au développement du
commerce, de l’artisanat et plus récemment de l’industrie et des besoins qui sont apparus
successivement. Les hommes ont toujours voulu conserver la mémoire de ce qu’ils font. On
peut penser que la comptabilité est née de ce besoin de connaître les mouvements des biens que
les hommes échangeaient entre eux. Les archéologues ont trouve la trace de formes
d’enregistrements comptables dans les civilisations indiennes d’Amérique du Sud. L’Egypte de
Pharaon, les Grecs, puis les romains utilisèrent des procédés d’enregistrement des mouvements
de biens.
Des le troisième millénaire avant J‐C, on distingue nettement dans les tablettes d’argile les
éléments essentiels d’un compte. Les Romains perfectionnèrent la comptabilité et l’utilisation de
la monnaie semble avoir été déterminante dans l’évolution de la comptabilité. Le Moyen‐Âge
nous apporta la notion de capital productif, selon laquelle l’activité commerciale pouvait
permettre la création d’un capital complémentaire, favorisant ainsi l’enregistrement progressif
de son propriétaire .C’est ainsi que la comptabilité des valeurs s’est considérablement
développé, faisant appel à des notions de résultats.
Le premier traité comptable fit son apparition au XVe siècle sous la plume de Luca Pacioli qui
en 1494 énonça les principes fondamentaux de la comptabilité en partie double. Sous
l’impulsion de Colbert en 1673 la tenue des livres de commerce devint obligatoire. L’octroi du
crédit rendit nécessaire la tenue de comptes de personnes qui s’ajoutèrent á ceux des comptes
de patrimoine. Ainsi se développa une comptabilité qui, dans ses principes fondamentaux n’a
pas véritablement changé. Il faudra attendre le second quart du XXe siècle pour voir se dégager
la comptabilité telle qu’on le connaît aujourd’hui.
QU’EST‐CE QUE LA COMPTABILITE ?
Etant que système d’information financière,la comptabilité permet d’identifier,de
mesurer,d’enregistrer,de communiquer et d’interpréter des informations financières sur le
fonctionnement d’une entité économique. L’expression d’entité économique désigne le plus
souvent une entreprise à but lucratif.
Tout propriétaire ou dirigeant a besoin de l’information financière fournie par le système
comptable afin de mieux contrôler les opérations quotidiennes et planifier les activités et la
croissance de leur entreprise.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 2
Ils s’intéressent notamment à l’évolution de leur chiffre d’affaires (montant des ventes), à la
capacité de leur entreprise de rembourser ses dettes à l’échéance et à la tendance des bénéfices
nets.
Les Tiers (Etat, Investisseurs, Créanciers, Actionnaires, le Public en général qui ne participent
pas à la gestion) ont aussi besoin d’informations sur la situation financière des entreprises et sur
les résultats de leur exploitation.
En plus des opérations et des événements quantifiables en devises, le système comptable peut
permettre d’amasser une foule de renseignements utiles à la prise de décision, qui ne sont pas
de nature financière.
DEFINITION DE LA COMPTABILITE
La comptabilité se définit premièrement comme une science. Elle constitue en ce sens un moyen
systématique de fournir des renseignements sur la situation financière d’un organisme
quelconque. Il s’agit donc d’une technique, selon laquelle, dans des situations identiques, les
individus doivent traiter une information de la même manière.
Deuxièmement, la comptabilité peut se définir comme un art. C’est l’art d’inscrire, de mesurer
et de communiquer les données financières se rapportant à l’organisme. Pour communiquer des
données financières, il faut, en premier lieu, les inscrire, les enregistrer selon un ordre
chronologique. Par la suite, le comptable procède à leur mesure en les groupant par nature afin
d’évaluer leur effet .Enfin, la dernière étape de processus de comptabilisation consiste à
communiquer les informations financières sous une forme présentable au public, soit les états
financiers.
DIFFERENTS TYPES DE COMPTABILITE
DISTINCTION ENTRE TENUE DES COMPTES ET COMPTABILITE.
L’expression : Tenue des comptes a remplacé l’expression Tenue des livres. Ce changement
terminologique récent découle de la pénétration de plus en plus grande de l’ordinateur.
La comptabilité ne se limite pas à la simple tenue des comptes. On entend par Tenue des
comptes le travail qui consiste à journaliser, classer et résumer les opérations d’une entreprise.
Ce travail est plus mécanique et routinier. Il ne couvre qu’une des cinq fonctions de la
comptabilité. Cependant avec un maximum de formation pratique, on peut devenir un commis
comptable ou un expert‐comptable en poursuivant des études universitaires.
L’information doit être transmise en tenant compte des besoins particuliers de ceux auxquels
elle est destinée. Il importe d’identifier les principaux utilisateurs et de comprendre les motifs
de leur intérêt.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 3
LES UTILISATEURS DE L’INFORMATION COMPTABLE ET LEURS BESOINS.
La comptabilité par sa fonction de communiquer de l’information financière d’une entreprise,
est désignée comme le langage des affaires. Les utilisateurs peuvent être repartis en deux
groupes principaux, soit :
• Les utilisateurs internes
• Les utilisateurs externes
LES UTILISATEURS INTERNES
Ce sont les dirigeants et les gestionnaires d’une entreprise. Ils sont privilégiés parce qu’ils
disposent de toute l’information disponible dans l’entreprise au sein de l’entreprise. Ils utilisent
une information comptable plus détaillée afin de planifier, de contrôler et d’évaluer les
opérations de l’entreprise, car ils doivent prendre des décisions quotidiennes en ce qui concerne
l’approvisionnement, la fabrication, la vente, le crédit, l’évaluation de projets d’investissement
et de financement. Pour eux, l’information comptable doit être disponible rapidement et prend
souvent la forme de rapports comptables internes.
Les utilisateurs internes sont habituellement mieux servis par la comptabilité de management
(de gestion ou administrative), correspondant davantage à un système d’information conçu
pour aider la direction à exploiter et à gérer une entreprise au quotidien. Ils utilisent les états
financiers afin d’évaluer la rentabilité de l’entreprise, c’est‐à‐dire la capacité de générer des
bénéfices et en plus sa solvabilité (capacité de rembourser ses dettes à l’échéance).
LES UTILISATEURS EXTERNES
Tandis les besoins d’information des utilisateurs internes sont assez homogènes, il en va tout
autrement des besoins de l’ensemble des autres utilisateurs de l’information comptable. Les
utilisateurs externes peuvent être repartis en deux catégories :
• Ceux ayant un intérêt direct dans l’entreprise
• Ceux ayant un intérêt indirect.
Pour prendre des décisions, ceux ayant un intérêt direct ont besoin d’une information sommaire
portant sur la situation financière de l’entreprise et sur ses résultats d’exploitation. Ils sont
particulièrement :
• Les Investisseurs, soit les futurs propriétaires de l’entreprise, évaluent la pertinence
d’acheter, de conserver ou de vendre leurs intérêts financiers dans l’entreprise à la
lumière du rendement qu’elle génère. Ils portent une attention particulière sur la
rentabilité de l’entité.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 4
• Les Créanciers, c’est‐à‐dire les banquiers et les fournisseurs, évaluent les risques
inhérents à accorder un prêt à l’entreprise, à lui livrer des marchandises et à lui accorder
du crédit. Ils portent une attention particulière à la solvabilité de l’entreprise. En règle
générale, un créancier n’entretiendra des relations d’affaires avec une entreprise que si
son bilan et d’autres informations démontrent qu’elle pourra rembourser sans difficulté
ses dettes à l’échéance.
Les besoins des utilisateurs externes n’ayant pas un intérêt direct dans l’entreprise peuvent
varier considérablement. Ils sont :
• L’Administration fiscale et les Pouvoirs publics jouent un rôle de surveillance des
marchés, en s’assurant que l’entreprise se conforme aux diverses lois la régissant et
répond en tout temps à ses exigences fiscales.
• Les Clients s’intéressent à la capacité de l’entreprise de fournir de façon continue des
biens et services de qualité.
• Les Employés et les Syndicats désirent savoir si l’entreprise est en mesure d’augmenter
les rémunérations (salaires).
• Les Groupes de pression scrutent plus particulièrement les faits et gestes des grandes
entreprises pour s’assurer que leur exploitation ne nuit pas à l’environnement.
En définitive,la comptabilité générale vise à répondre aux besoins de ces utilisateurs externes en
leur fournissant des états financiers dressés conformément à un ensemble de normes de
comptabilisation et de présentation de l’information que l’on désigne sous l’appellation : PCGR.
LES PRINCIPES COMPTABLES GENERALEMENT RECONNUS
La comptabilité étant une technique doit être régie par des règles précises qui gouvernent
l’application. Les principes comptables généralement reconnus ne sont pas vérifiables
expérimentalement. Seules leur logique et leur utilité font que les comptables les adoptent.
Lorsqu’on parle de PCGR, on fait référence à un concept qui, en fait, se décompose en quatre
catégories :
1. Les postulats comptables sont des hypothèses fondamentales concernant
l’environnement économique, politique et sociologique dans lequel s’exerce la
comptabilité. Ces hypothèses sont considérées comme incontestables même si elles ne
peuvent pas être démontrées. Nous parlons de la Personnalité de l’entreprise,de la
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 5
Continuité de l’exploitation,de l’indépendance de l’exercice,de l’Unité de mesure
monétaire,et de l’Unité de mesure stable.
2. Les principes comptables proprement dits constituent les règles fondamentales portant
sur la mesure,le classement et la synthèse des informations d’ordre économique de
même que sur la présentation de ces informations dans les états financiers. Nous parlons
du Principe du coût d’acquisition, du Principe de rapprochement des produits et des
charges, de la Constatation des produits, de la Bonne information et de la
Présentation fidèle et complète des états financiers.
3. Les normes comptables représentent les règles précises sur la façon d’enregistrer, de
classifier et de présenter l’information financière. Elles traitent de cas particuliers et se
rapportant à des opérations quotidiennes,ce qui fait qu’elles évoluent rapidement.
4. Les caractéristiques de l’information comptable précisent les qualités que doit avoir
l’information comptable pour être utile à la prise de décision des utilisateurs d’états
financiers. Les principales caractéristiques sont : Objectivité, Prudence, Continuité des
méthodes et Importance relative des postes et des sommes.
LA PROFESSION COMPTABLE
De part le monde, des organismes décrivent les diverses perspectives de carrière qui
existent au sein de la profession comptable. On peut citer :
ICCA, CGA, CNC, IFAC, AIC, CONACO, OCPAH etc.
LES FORMES D’ENTREPRISES
Dans notre société, il existe quatre principales formes d’entreprises :
L’entreprise individuelle, propriété d’une seule personne. Habituellement, celui‐ci en est le
principal employé et c’est elle qui gère l’entreprise directement. C’est la forme d’entreprise
la plus simple parce qu’elle ne requiert aucune formalité juridique.
Du point de vue légal, l’entreprise individuelle n’est pas une entité distincte de son
propriétaire. Celui‐ci sera donc responsable de toutes les dettes contractées par son
entreprise. En contrepartie,le propriétaire ne partage les bénéfices avec personne.
Du point de vue fiscal, l’entreprise individuelle ne paie pas d’impôt sur les bénéfices. Le
bénéfice réalisé par l’entreprise s’ajoute aux autres revenus du propriétaire.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 6
Du point de vue comptable, il est question de deux entités distinctes : le propriétaire et son
entreprise.
La société de personnes, communément appelée : Société en nom collectif se distingue de
très peu de choses d’une entreprise individuelle. C’est la propriété de plusieurs individus.
La société aura besoin de l’accord de tous ses partenaires avant d’accomplir une action. La
société,en effet, résulte d’un contrat en vertu duquel deux ou plus personnes mettent en
commun un capital dans le but à la fois d’exercer une activité rentable et de partager les
bénéfices qui en découlent. Idéalement, il faut rédiger un contrat afin de réduire les
possibilités de conflits entre les associés,mais un contrat qui pourrait tout aussi bien n’être
que verbal.
La société de personne n’est pas une entité juridique distincte, et les associés sont
responsables conjointement et solidairement des dettes de la société.
Du point de vue fiscal, les sociétés de personnes ne paient d’impôt sur les bénéfices. La part
des bénéfices appartenant à un associé doit s’ajouter à ses gains lorsqu’il prépare sa
déclaration de revenus.
La société par actions possède une entité juridique distincte et indépendante de ses
propriétaires, qu’on appelle Actionnaires. Au sens de la loi, elle constitue une personne
morale qui détient sensiblement les mêmes droits et qui assument les mêmes obligations
qu’une personne physique.
Son fonctionnement est régi par une loi et, pour en déposer les statuts, les futurs
actionnaires doivent remplir certaines formalités. En investissant, ils reçoivent en
contrepartie une ou des actions.
Chaque action confère une vote à l’actionnaire qui le détient, lors des assemblées générales.
Les actionnaires nomment un Conseil d’administration qui procédera à la gestion de
l’entreprise.
Les principaux avantages de la société par actions réside dans le fait qu’elle permet
d’accumuler de nombreux capitaux, que les actions sont facilement transférables à un autre
actionnaire et que la responsabilité de chaque actionnaire n’est pas illimitée, comme dans le
cas de l’entreprise individuelle et de la société de personnes. La responsabilité des
actionnaires se limite à leur mise de fonds.
La société par actions, étant que personne morale, règle elle‐même ses impôts sur les
bénéfices. Quant à l’actionnaire, il n’est imposé que sur les dividendes versés par la société.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 7
La coopérative a pour but de réunir un groupe de personnes qui utilisent un produit
commun,afin d’en réduire le prix d’achat ou le coût d’utilisation.
Chaque membre n’a droit qu’à un vote lors de l’assemblée des membres, contrairement aux
actionnaires d’une société par actions qui ont droit à une vote pour chaque action détenue.
La responsabilité de chaque membre se limite au montant versé pour l’acquisition de sa ou
de ses parts sociales. La coopérative ne distribue pas de dividende. Les membres sont
groupés en association pour satisfaire des besoins communs.
L’ENTREPRISE ET L’EQUATION COMPTABLE.
NOTION DE FLUX
L’entreprise pour exister à besoins de capitaux : ces capitaux lui seront fournis soient par
les propriétaires de l’entreprise, c’est à dire les actionnaires, soient par des agents
économiques qui vont lui accorder des prêts.
L’entreprise bénéficie par ailleurs des services non marchands fournis par les administrations
publiques (Etat, collectivités locales…).
Pour produire, l’entreprise va par ailleurs devoir utiliser une main d’œuvre qu’elle va devoir
rémunérer, ce sont les salariés de l’entreprise.
De par son activité courante, l’entreprise va aussi devoir acquérir les matières premières et
autres produits de consommation courante indispensables à son activité (électricité …) auprès
d’autres entreprises appelées alors « fournisseurs ». Les produits ou services ainsi produits
seront alors cédés à des agents économiques appelés« clients ».
Enfin, d’après la loi, l’entreprise va devoir entretenir des relations avec des agents économiques
particuliers tels les Organismes de Sécurité Sociale.
L’ensemble des relations qui lient une entreprise à ces partenaires économiques se matérialise
d’un point de vue économique et comptable par l’existence d’un flux.
Exemples de flux :
1 ‐ Une entreprise paye à la fin du mois les salaires de ses salariés
2 ‐ Une entreprise achète des matières premières à son fournisseur
3 ‐ Pour financer cet achat, l’entreprise est obligée de contracter un crédit à sa banque
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 8
On peut définir un flux comme un mouvement affectant une variable économique sur une
période donnée.
On distingue alors :
les flux physiques (réels) portant sur les biens et services
les flux monétaires constituant la contrepartie des flux physiques
les flux financiers affectant les créances et les dettes de l’entreprise.
Du point de vue de l’entreprise, il est important de noter que ces flux peuvent de plus être de
deux ordres :
flux internes : quand le flux matérialise une relation entre deux sous‐ensemble de l’entreprise,
sans faire intervenir une entité autre que l’entreprise elle‐même.
flux externes : quand le flux matérialise une relation établie entre l’entreprise et l’un de ces
partenaires.
Le rôle premier de la comptabilité est alors d’enregistrer l’ensemble des flux impliquant
l’entreprise (soient qu’ils en sont à l’origine, soient qu’ils en sont la destination), c’est à dire
ayant une incidence sur l’un des éléments de son patrimoine.
Cela revient alors à dire que la comptabilité générale se doit de saisir, classer et enregistrer
l’ensemble des flux relatifs à une entreprise afin de pouvoir fournir, après traitement, un
ensemble de données exploitables par les agents économiques intéressés.
Il est rapidement apparu nécessaire de définir des règles homogènes d’enregistrement
des flux de manière à faciliter l’exploitation des informations ainsi fournies.
LES GENRES D’OPERATIONS COMMERCIALES.
Du point de vue commercial,il existe trois principaux genres d’opérations ;
• La prestation de services. Les entreprises de services offrent à la population des services
plutôt que des marchandises. Ce sont des entreprises telles : Firmes d’avocats,de
comptables et de consultants et autres.
• Le commerce ou négoce. Les entreprises commerciales vendent principalement des
marchandises dans l’état qu’elles avaient achetées. Elles procurent ces marchandises du
fabricant ou du grossiste. Elles ne fabriquent ni transforment pas ces marchandises.
• La fabrication ou industrie. Une entreprise industrielle ou de production détient
habituelle un capital important, parce qu’elle doit se procurer de la machinerie et de
l’équipement coûteux. Elle doit également acquérir des matières premières sous une
forme brute ou non traitée. Transformées par la main‐d’oeuvre, ces matières premières
serviront à fabriquer un ou des produits finis. Une entreprise manufacturière peut
vendre directement au public ou à un distributeur,qui à son tour vendra au public.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 9
LES ETATS FINANCIERS
Une entreprise est un ensemble d’actifs soumis à un contrôle commun , utilisés dans le but
de réaliser un bénéfice.
Les états financiers sont au nombre de trois principalement :
• Le bilan
• L’état des résultats ou Compte de résultats
• L’annexe
LE BILAN
Le bilan comprend trois catégories de comptes ou postes :
1. L’ACTIF est constitué de tout élément qui a une valeur positive et qui appartient à
l’entreprise. Ces éléments sont enregistrés au coût historique (coût réel) dans les livres
comptables de l’entreprise qui les acquiert. Ils sont : Encaisse Clients, Frais payés
d’avance, Terrain, Bâtiments, Matériel, Mobilier, Equipements, Fournitures et Brevets,
etc.
2. Le PASIF est constitué de tout élément qui une valeur négative et qu’un créancier
détient un droit. Le passif est synonyme de dettes, c’est‐à‐dire les sommes dues par
l’entreprise .Les éléments de passif sont enregistrés au montant qui devra être versés. Ils
sont : Fournisseurs, Salaires à payer, Billets à payer, Obligations à payer, dettes bancaires,
etc.
3. L’AVOIR DU PROPRIETAIRE ou le Capital est le droit que possède le propriétaire,
après les droits des créanciers, sur les éléments d’actif de l’entreprise. Ce droit
représente l’investissement initial du propriétaire, tous ses investissements additionnels
(apports) dans l’entreprise de même que les résultats des opérations. Si le propriétaire
retire des éléments d’actif de l’entreprise (prélèvements), son avoir diminue. Plus
simplement, l’avoir du propriétaire représente l’actif moins le passif. L’expression
Capitaux propres sert aussi à designer l’Avoir du propriétaire ou le capital.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 10
PRINCIPES & APPLICATIONS COMPTABLES I
Exercices et Problèmes sur le chapitre I
I.‐
Voici les neuf premières opérations de Domino Pizza :
1. Somme d’argent investie par le propriétaire dans son entreprise
2. Achat au comptant d’un four à pizza
3. Achat d’un camion de livraison au prix de $12000, payable $1500 comptant et le
solde en 24 versements mensuels égaux.
4. Règlement d’une dette
5. Emprunt contracté auprès d’une banque
6. Vente au comptant d’un terrain au prix égal à son coût d’acquisition.
7. Vente au comptant d’un terrain à un prix supérieur à son coût d’acquisition.
8. Vente au comptant d’un terrain à un prix inférieur à son coût d’acquisition.
9. Recouvrement d’une créance.
Dressez un tableau à quatre colonnes portant les intitulés suivants :
Opération Total de l’actif Total du passif Total des capitaux propres
Classez sans ce tableau les opérations effectuées par Domino pizza et indiquez dans la colonne
appropriée les effets des opérations au moyen des symboles (+) pour une augmentation, (‐) pour
une diminution et (0) pour aucun changement.
II.‐
Vous trouverez ci‐après, présentés pêle‐mêle, les postes du bilan de l’entreprise Domino
pizza au 31 octobre 2005. Dressez le bilan en bonne et due forme.
Terrain 45000 Matériel de bureau 3400
Fournisseurs 14600 Bâtiment 170000
Clients 16900 Caisse 1700
Lemaire‐Capital ? Emprunt hypothécaire 140000
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 11
III.‐
Jean Abélard, spécialiste des arts martiaux, décide de fonder son école de karaté. Voici
les opérations survenues au cours de la première semaine d’activité de création.
• 25 août, Son père lui consent un prêt personnel de $20000 qui prend la forme
d’un billet remboursable en cinq versements annuels égaux de $4000.
• 25 août, De cette somme, Jean dépose $18000 dans un compte en banque ouvert
au nom de son entreprise Karaté J.
• 26 août, La sogebank consent un prêt hypothécaire à l’entreprise pour l’achat
d’un bâtiment. Il dépose la de $75000 dans le compte banque de l’entreprise. Au
cours des 12 prochains mois, Jean devra rembourser $5000 plus les intérêts.
• 27 août, achat au comptant d’une propriété au prix de $90000.L’acte notarié
stipule que les valeurs du terrain et du bâtiment sont respectivement de $18000
et de $72000.
• Le même jour, achat de matériel d’entraînement au prix de $5000 moyennant le
versement d’une somme de $2500, la signature d’un billet de $1500 remboursable
en 12 versements mensuels égaux et un versement de $1000 provenant du
compte en banque personnel de Jean Abélard.
• 28 août, Achat de vêtements d’entraînement (Stock de marchandises) au prix de
$1200 moyennant un versement comptant de $200, le solde étant dû dans 30
jours.
• 29 août, Retour de marchandises défectueuses d’une valeur de $100.Le
fournisseur accepte de réduire le montant dû par Jean d’un montant identique.
• 30 août, pour son anniversaire, Jean offre à son petit frère des vêtements
d’entraînement ayant une valeur marchande de $150.Ceux‐ci avaient coûté $100.
Analysez les opérations précédentes dans un tableau .Identifiez les opérations au moyen de leur
date et calculez le solde après chacune des opérations.
Dressez, en bonne et due forme, le bilan de l’entreprise au 31 août 2005.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 12
CHAPITRE II
ENREGISTREMENT DES OPERATIONS RELATIVES AUX COMPTES DU BILAN.
1. Le cycle comptable
• Collecte et l’analyse de l’information
• Enregistrement des opérations
• Report dans le grand livre
• Etablissement de la balance de vérification
• Régularisation et correction des comptes
• Etablissement des états financiers
• Clôture des comptes
• Etablissement de la balance de vérification après clôture
• Passation facultative des écritures de contrepassation.
2. Les comptes
• Définition
• Nature des comptes et modes présentation
• Structure et fonctionnement des comptes.
3. Les notions de débit et de crédit
• Les règles relatives au débit et au crédit des comptes de bilan
• La comptabilité en partie double
• L’enregistrement des opérations directement dans les comptes
4. Le journal général et le grand livre général
• Définition
• Le processus d’enregistrement des écritures de journal (article de journal
comptable)
• Définition du grand livre général
• L’utilité du journal général et du grand livre général
• Les comptes avec solde après chaque opération
• Le Plan comptable ou charte de comptes.
• Modèles de Journal général, Grand livre général et Plan comptable.
5. Le report des écritures de journal dans le grand livre
• Les étapes du report dans le grand livre
• Les comptes du grand livre après le report des écritures du journal.
6. La balance de vérification
• Définition et nature de la balance de vérification
• Utilité de la balance de vérification
• Modes de présentation.
7. Exercices et problèmes de compréhension.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 13
Le cycle comptable
On entend par cycle comptable la séquence des procédures comptables utilisées pour
enregistrer, classer et résumer l’information comptable au cours de l’exercice. Ce cycle comporte
9 étapes fondamentales :
1. La collecte et l’analyse de l’information
2. L’enregistrement des opérations
3. Le report dans les grands livres
4. L’établissement de la balance de vérification des comptes
5. La régularisation et la correction des comptes
6. L’établissement des états financiers
7. La clôture des comptes
8. L’établissement de la balance après clôture
9. La passation facultative des écritures de contrepassion.
La nature des comptes
Les opérations d’une entreprise entraînent une augmentation ou une diminution des éléments
de l’actif, du passif ou des capitaux propres, des charges et des produits.
Il est nécessaire d’utiliser un instrument (le plus petit élément comptable) afin de suivre
l’évolution, à la hausse ou à la baisse, de chacun des éléments formant les états financiers. Cet
instrument s’appelle : COMPTE. Le compte a un nom, un numéro correspond à sa classe
Un compte a deux présentations :
1. Une présentation schématique, couramment appelée : Compte en T. C’est la forme la
plus simple.
2. Une présentation normalisée, qui est plus complexe, mais plus explicite à cause des
informations qu’elle fournit en temps réel, c’est‐à‐dire pouvoir déterminer le solde du
compte après chaque opération, avantage que la présentation schématique ne donne
pas.
Notions de débit et de crédit.
On entend par Débit, une écriture qui consiste à enregistrer un montant du coté gauche (1ere
groupe) d’un compte.
On entend par Crédit, une écriture qui consiste à enregistrer un montant du coté droit (2e
groupe) d’un compte.
En effet on utilise les expressions suivantes pour enregistrer les opérations de l’entreprise :
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 14
Débiter un compte et créditer un compte.
Tout compte, en finalité, doit être balancé, en faisant la synthèse entre le Débit et le Crédit de ce
compte.
En général, les mouvements des comptes traduisent par leurs balances ou leurs soldes.
• Les débits augmentent (+) les comptes d’actif et de charges et diminuent (‐) les comptes
de passif et de l’avoir et des produits.
• Les crédits diminuent (‐) les comptes d’actif et charges et augmentent (+) les comptes de
passif, de l’avoir et des produits
Les règles à suivre dans l’utilisation de la présentation schématique sont différentes de celles
utilisées dans la présentation normalisée. Seulement, elles se résument pour les deux en ces
points :
1. Analyser l’opération et déterminer les comptes à utiliser
2. Inscrire d’abord les montants à débiter
3. Inscrire ensuite les montants à créditer
4. S’assurer que le total des montants débités dans l’opération soit égal au total des
montants crédités. (D=C)
Solder un compte signifie comparer le débit et le crédit de compte.
D = C (solde nul)
D > C (solde débiteur)
D < C (solde créditeur)
La comptabilité en partie double.
L’expression signifie que chaque opération traduite par une écriture comptable, appelée :
Article de journal, influe au moins deux comptes distincts. En d’autres termes, le principe de la
comptabilité en partie double veut qu’il y a toujours égalité entre les montants débités et les
montants crédités lors de la passation d’une écriture.
Le Journal général et le Grand livre général.
L’enregistrement des opérations en inscrivant directement les montants dans les comptes pose
un problème,à savoir,si l’entreprise a beaucoup d’opérations à enregistrer,le repérage rapide de
tous les composantes d’une opération s’avère parfois très complexe.
Pour parer à cette difficulté, les opérations d’une entreprise sont inscrites d’abord
chronologiquement dans un document (un livre comptable) appelé Livre Journal. Ce livre
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 15
renferme toutes les informations permettant d’établir un lien entre les débits et les crédits
auxquels chaque opérations donne lieu.
Le Journal général constitue la forme la plus simple d’un journal comptable et probablement
celle qui offre la plus grande flexibilité puisque toutes les opérations peuvent y être
enregistrées.
Le journal général renferme sous diverses colonnes :
1. La date de l’opération
2. Une identification et le montant à débiter
3. Une identification et le montant à créditer
4. Une brève description de l’opération analysée (Nature, libellée).
L’expression : Passer une écriture signifie Journaliser ou Enregistrer ou Imputer. Elle sert à
designer le travail d’enregistrement d’une opération financière dans le livre journal.
Quand une écriture comptable comporte plus de deux comptes,on dit c’est une écriture
composée. Dans une telle écriture, il faut d’abord inscrire tous les comptes à débiter, puis tous
les comptes à créditer. De plus, il faut s’assurer immédiatement que le total des comptes débités
correspond au total des comptes crédités.
Le Grand livre contient l’ensembles des comptes dans lesquels on enregistre toutes les
opérations effectuées par une entreprise..
L’utilité du Journal général et du Grand livre général.
L’utilisation d’un grand livre général permet de repérer à un seul endroit tous les changements
survenus d’un compte précis. Dans le grand livre,on retrouve l’historique de chaque compte
pris individuellement,Tenir un Journal général et un Grand livre général procure trois
avantages :
1. Le journal général renferme à un même endroit toute l’information relative à une
opération.
2. Toutes les opérations sont classées par ordre chronologique dans le journal général.
Donc il est plus facile de repérer les détails d’une opération effectuée à une date précise.
3. L’utilisation d’un journal général permet de réduire le risque d’erreurs. En effet le
journal général permet de vérifier dans l’immédiat l’équilibre entre le total des débits et
le total des crédits.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 16
Le Plan comptable
On lui donne aussi le nom de Charte des comptes. C’est un document indispensable pour une
pratique comptable organisée, harmonieuse et rationnelle. Il comprend cinq titres :
1. Définir l’objectif et les principes comptables généralement reconnus
2. Définir les éléments des états financiers
3. Etablir les règles d’évaluation et de comptabilisation
4. Expliquer comment Tenir, structurer et fonctionner les comptes de l’entreprise
5. Présenter les documents de synthèses (Bilan, Etat des résultats et annexe)
Le nombre de comptes qu’utilise une entreprise varie selon :
• Sa taille
• La nature de son exploitation
• Le degré de précision des informations que souhaitent la direction et les pouvoirs
publics.
On entend par Plan Comptable, la liste codifiée des comptes utilisés par une entreprise. Cette
codification est numérique et suive l’ordre des comptes faisant référence aux éléments des états
financiers (Actif, Passif, Capitaux propres, Produits et charges).Le plan comptable comprend 9
classes de comptes. Les plus utilisés sont :
1.‐Comptes d’actif (classe 1)
2.‐ Comptes de passif (classe 2)
3.‐Comptes de l’avoir (classe 3)
4.‐Comptes de produits (classe 4)
5.‐Comptes de coût des marchandises vendues (classe 5)
6.‐Comptes de charges d’exploitation (classe 6)
Les comptes des clases 1,2 et 3 concernent le Bilan et ceux des classes 4,5 et 6 se rapportent aux
opérations découlant de l’activité de l’entreprise (état des résultats)
Les étapes du report des écritures du journal au grand livre sont au nombre de 8 (huit).
(Explication et schéma en classe)
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 17
La balance de vérification
La balance de vérification est une liste de tous les comptes du grand livre contenant leurs
montants et leurs soldes débiteurs et créditeurs dans leur colonne respective. Elle est établie en
vue de vérifier l’exactitude arithmétique des écritures comptables du Journal général et de leurs
reports au Grand livre général. Elle comprend donc la liste de tous les comptes du grand livre
général par ordre de classe et de numéro.
La balance de vérification jouit de trois propriétés :
1. Montant débit des mouvements = Montant crédit des mouvements
2. Montant des soldes débiteurs = Montant des soldes créditeurs
3. Montant débit du Journal général = Montant débit des mouvements
4. Montant crédit du Journal général = Montant crédit des mouvements.
La balance de vérification ne constitue pas un Etat financier en soi,mais seulement un outil de
travail important.
Les signes de monnaie ne doivent pas figurer dans les livres comptables d’une entreprise,
uniquement dans les états financiers (seulement en Regard des totaux).
Les erreurs les plus fréquentes rencontrées :
1. Inversion d’une écriture
2. Inversion de chiffres et erreur de décalage
3. Utilisation d’un mauvais compte
Les méthodes de correction seront appliquées en classe.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 18
Modèles de Journal Général, Grand livre Général, Balance de vérification et Etats financiers
à réclamer du professeur.
Exercices et Problèmes
I
Gracia Jean vient de terminer son stage de mécanicien. Il décide de fonder son propre entreprise
dont voici les premières opérations :
1e juillet, il dépose la somme $40,000 dans un compte en banque (BUH) au nom de la nouvelle
entreprise, Mécanique Gracia enr.
2 juillet, il obtient d’un vieil oncle la somme de $200,000 qu’il dépose dans le compte de
l’entreprise. Le prêt consenti à l’entreprise prend la forme d’un billet remboursable sur une
période de 20 ans. Gracia se porte personnellement garant de cet emprunt.
3 juillet, acquisition au comptant d’un terrain, d’un garage et d’un stock de marchandises au
prix de $200,000 dont $ 15,000 pour le terrain et $ 165,000 pour le garage
4 juillet, acquisition d’une dépanneuse usage au prix de $25,000.Mecanique Gracia verse 80% de
cette somme au comptant,le solde étant dû au début d’août.
5 juillet, acquisition à crédit de matériel de bureau au prix de $1,500
6 juillet, versement d’une somme de $1,000 en règlement partiel de la dette contractée le 5
juillet.
Inscrivez les opérations ci‐dessus en utilisant les comptes suivants : Terrain, BUH, Stock de
marchandises, Garage, Dépanneuse, Matériel de bureau, Fournisseurs, Effet payer et Gracia Jean‐Capital.
II
Inscrivez les opérations ci‐dessous au journal général et faites suivre chaque écriture de journal
d’une brève explication.
3 août, Gracia Jean dépose la somme de $16,000 dans un compte en banque (BNC) ouvert au
nom de sa nouvelle entreprise : Centre de Karaté.
5 août, acquisition d’un terrain et d’un bâtiment au prix de $90,000 dont $10,000 pour le terrain.
L’entreprise verse la somme de $15,000 au comptant et obtient un emprunt hypothécaire afin de
financer le solde de l’achat.
8 août, acquisition à crédit d’équipement au prix de $5,000
10 août, dépôt d’une somme de $400 reçue du premier client à titre d’abonnement annuel au
centre de karaté. (Utilisez le compte Produits reçus d’avance)
11 août, versement d’une somme de $1,000 en règlement partiel de la dette contractée le 8 août.
L’entreprise a adopté le plan comptable suivant :
BNC (10), Terrain (11), Bâtiment (21), Equipements (31), Fournisseurs (21), Produits reçus
d’avance (22), Emprunt hypothécaire (28) et Gracia Jean‐Capital (31)
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 19
Pour des raisons de contrôle et de vérification, Gracia vous demande de reporter les écritures de journal
dans le grand livre de l’entreprise et dresser une balance de vérification à la date du 11 août. Etablissez en
bonne et due forme le Bilan de l’entreprise.
III
Voici les comptes du bilan d’une entreprise au 31 mai 2005,propriété de Georges Reynold :
BNC 6500
Fournitures de bureau 1300
Equipements 25250
Mobilier de bureau 12500
Comptes fournisseurs 4050
Effet à payer 5000
Georges Reynold ‐capital 36500
Les opérations suivantes ont eu lieu au cours du mois de juin 2005.
02‐06, Paiement complet de l’effet à payer par cheque # 215
04‐06, Le propriétaire retire $10,000 de son compte de banque personnel et le dépose dans le
compte de l’entreprise.
06‐06, Paiement par cheque de la police d’assurance pour la période du 1e juillet 2005 au 30 juin
2005 : $4,500, cheque # 216
08‐06, Achat à crédit d’équipement au centre d’équipement pour une valeur de $5,000
10‐06, Emission d’un cheque de $1,000pour le paiement partiel des comptes fournisseurs
(chèque #217)
14‐06, Paiement de la moitie de la somme due au Centre d’équipements, soit $2,500, (cheque
#218)
18‐06, Vente à crédit de mobilier de bureau au prix coûtant de $ 3,000 et réception d’un effet à
recevoir de Gérard Philippe.
23‐06, Cheque de $1,000 émis à l’ordre de Georges pour ses dépenses personnelles, cheque #219.
30-06, Paiement au comptant de comptes fournisseurs : $2,000 par cheque # 220.
1. Ouvrir les comptes de l’entreprise au 31 mai 2005
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 20
2. Comptabiliser les opérations directement dans les comptes normalisés
3. Dresser la balance de vérification de l’entreprise au 30 juin 2005.
4. Dresser le bilan de la société pour la même période.
CHAPITRE III
LES RESULTATS ET LES CAPITAUX PROPRES
PLAN DU CHAPITRE
• Décrire les principaux éléments de l’état des résultats et de l’état des capitaux
propres.
• Expliquer les règles relatives au débit et au crédit des comptes de résultats.
• Passer les écritures de journal pour enregistrer les opérations relatives aux
comptes de résultats et de capitaux propres.
• Effectuer le report des ces opérations dans le grand livre général.
• Décrire les liens qui existent entre les trois états financiers : BILAN – ETAT DES
RESULTATS – ETAT DE L’AVOIR DU PROPRIETAIRE OU CAPITAUX PROPRES
En effet le fonctionnement d’une entreprise ne se limite pas aux seules opérations de
financement par les créanciers ou le propriétaire et d’investissement en actifs. Pour assurer sa
survie, elle doit financer ses activités propres par des opérations commerciales, c’est‐à‐dire
vendre des marchandises et rendre des services,et en contrepartie,payer son loyer,ses employés.
Par ailleurs,le propriétaire peut investir de nouveau de l’argent ou des biens dans son
entreprise,ce qui constitue un APPORT ou,au contraire retirer de l’argent ou des biens de son
entreprise,ce qui constitue un RETRAIT ou PRELEVEMENT qui diminue sa part de propriété
dans l’entreprise.
Ces diverses opérations nécessitent l’établissement d’une équation comptable approfondie :
Actif = Passif + Avoir du propriétaire au début +(produits ‐ charges) + (apports – prélèvement)
L’Equation comptable approfondie fonctionne de la même façon que l’équation comptable
simple. La seule différence réside dans le fait que les produits et les apports sont des moyens de
financement considérés comme des augmentations de l’avoir du propriétaire et que les charges
et les retraits sont traités comme des diminutions de l’avoir du propriétaire.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 21
Qu’est‐ce que l’état des résultats ?
L’état des résultats traduit l’activité, l’exploitation.la gestion en général de l’entreprise. ll met en
évidence la rentabilité de l’entité, puisque l’un des objectifs des entreprises à but lucratif est
d’être rentable.
Une entreprise pour fonctionner doit vendre ou rendre des services et aussi engager des coûts
pour réaliser ces ventes. Ces opérations ne sont pas des investissements ou des financements,
elles sont plutôt reliées à l’exploitation des affaires de l’entreprise. L’état des résultats reflète
donc toutes ces opérations.
Ainsi à la fin de chaque exercice financier ou période comptable .l’entreprise détermine le
résultat net réalisé qui se traduit par bénéfice ou perte.
Produits – Charges = Résultat net
Produits > Charges = Résultat positif ou Bénéfice net
Produits < Charges = Résultat négatif ou Perte nette
Le bénéfice net réalisé par une entreprise se traduit par une augmentation de la valeur de
l’entreprise (avoir de son propriétaire) entre le début et la fin de son exercice financier. Tandis
que une perte nette amène une diminution de l’avoir du propriétaire.
Pour calculer le résultat net d’une entreprise,il est donc indispensable d’établir les sommes
qu’elle a reçues ou qui sont à recevoir pour les services rendus ou pour les biens vendus.
Ces services rendus et ces biens vendus se nomment PRODUITS D’EXPLOITATION Par
ailleurs on doit soustraire de ces produits les coûts engagés pour les gagner. Ces coûts représentent
les CHARGES D’EXPLOITATION.
Un produit est une somme reçue ou à recevoir au titre de l’exploitation courante en contrepartie
des marchandises livrées,des travaux exécutés,des services rendus ou d’avantages que fournit
l’entreprise.
Les produits entraînent une augmentation des ressources économiques, sous forme d’entrées ou
d’accroissements d’éléments d’actif (Caisse ou Clients) ou une diminution d’éléments de passif
résultant des activités courantes.
Une charge correspond au coût lié à l’exploitation courante d’une entreprise,c’est‐à‐dire à
l’ensemble des sommes versés ou à payer dans le but de gagner un produit.
Les charges entraînent une diminution des ressources économiques, sous forme de sorties de
fonds ou de diminution d’éléments d’actif ou de constitutions d’éléments de passif qui
résultent des activités courantes de l’entreprise.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 22
Les principaux produits d’exploitation
• Chiffre d’affaires
• Commissions gagnées
• Honoraires gagnés
• Produit de location
• Produit de financement
• Produits de dividendes
Les principaux charges d’exploitation
• Assurances
• Avantages sociaux
• Charges sociales
• Salaires et rémunérations
• Créances douteuses.
• Electricité, Téléphone, eau
• Entretien et réparation
• Publicité et promotion
• Frais de garantie
• Fournitures de bureau utilisées
• Honoraires versés
• Impôts fonciers
• Intérêts et frais bancaires
• Intérêts sur dette long terme
• Loyer
• Amortissement des biens
Les Gains
Ils sont les augmentations des capitaux provenant d’opérations et de faits périphériques ou
accessoires.
Les Pertes.
Elles sont les diminutions des capitaux propres provenant des opérations et de faits
périphériques ou accessoires..
Ainsi le résultat net d’une entreprise pour une période donnée peut être déterminé au moyen de
l’équation suivante :
Produits – Charges + Gains – Pertes = Bénéfice net ou Perte nette
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 23
Exercice sur l’équation comptable approfondie.
Renaud Julien a ouvert son cabinet d’expertise comptable le 1e octobre 2004.Voici les opérations
effectuées au cours de ce mois :
1e octobre ‐ Renaud Julien dépose la somme de $150,000 dans un compte ouvert à la Socabank
au nom de son cabinet.
1e octobre ‐ Paiement du loyer d’octobre de $9,500
2 octobre ‐ Achat au comptant de matériel de bureau au prix de $67,000
3 octobre ‐ Signature d’un contrat en vertu du quel Julien s’engage, moyennant des honoraires
mensuels de $5, 000, à rendre des services à Sodimex.
3 octobre ‐ Encaissement des honoraires de Sodimex pour le mois d’octobre.
15 octobre – Honoraires des 15 premiers jours d’octobre (à l’exception de la somme reçue de
Sodimex) : $20,000 dont $ 7,500 reçus comptant et le reste recouvrable plus tard.
15 octobre – Somme de $10,000 versé à Mie Ange à titre de salaire pour la première moitié du
mois d’octobre.
16 octobre – Prélèvement de $9,750 effectué par Julien pour son usage personnel.
19 octobre – Travaux effectués pour le compte de Sodimex totalisant $5,000.
27 octobre – Travaux effectués pour Mme Claire Léger qui a versé la somme de $250.Elle s’est
aussi engagée à verser $750 le 1e novembre pour payer le solde des honoraires demandés.
31 octobre – Honoraires des deux derniers semaines du mois (à l’exception des sommes reçues
ou à recevoir de Mme Léger) : $42,000 dont $20,000 reçus comptant et le reste recouvrable plus
tard.
31 octobre – Facture de $4,500 reçue pour les fournitures de bureau utilisées durant le mois.
31 octobre – Paiement des comptes d’électricité et de téléphone du mois s’élevant
respectivement à $3,500 et $950
31 octobre – Somme de $10,000 versée à Mie Ange à titre de salaire pour la seconde moitie du
mois d’octobre.
31 octobre – Retrait de $14,000 effectué par Julien pour son usage personnel.
TRAVAIL A FAIRE
Etablir à partir des informations obtenues le cycle comptable complet
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 24
Exercices
Dites si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux. Justifiez votre réponse et donnez un
exemple dans chacun des cas.
1. Toute opération qui influe sur un poste du bilan influe aussi sur un poste de l’état des
résultats.
2. Toute opération qui influe sur un poste de l’état des résultats influe aussi sur un poste
du bilan.
3. Toute opération qui influe sur un compte de charge influe aussi sur un compte d’actif.
4. Toute opération qui influe sur un compte de produits influe aussi sur un autre compte
de résultats.
5. Toute opération qui influe sur un compte de charge influe aussi sur un compte de
produits.
Exercice II
Calculez les soldes identifiés par les lettres :
2003 2004 2005
Actif 71000 h 90140
Passif d 45910 37540
Capitaux propres au début b e 43240
Retraits 6000 4300 5000
Bénéfice net de l’exercice 8300 f j
Capitaux propres à la fin 38500 43240 k
Total du passif et des capitaux propres a i l
Produits d’exploitation 21500 g 27560
Charges d’exploitation c 11775 13200
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 25
Problème
Voici dans un ordre quelconque,la liste de tous les comptes d’une entreprise de
service :Bucoverex, firme de consultations en tous genres.
Taxes à payer 8300
BNC 8000
Matériel de bureau 11000
Fournisseurs ?
Gérard Dorsainvil‐ Capital au 1 décembre 2004
e 65900
Bâtiments 48000
Intérêts sur la dette ӑ long terme 3000
Gérard Dorsainvil – Retraits 13000
Honoraires de consultation en marketing 62000
Publicité 15500
Terrain 20000
Placements temporaires 25000
Intérêts à payer 500
Emprunt hypothécaire 40000
Clients 14000
Honoraires de consultation en comptabilité 51000
Honoraires de consultation en gestion financière 43000
Téléphone 1000
Effet à payer à court terme 9000
Effet à recevoir à court terme 19000
Fournitures de bureau 2500
Certificats de dépôt, échéant dans 60 jours 25000
Frais divers 19500
Matériel informatique 27000
Salaires des employés 64000
Intérêts et frais bancaires 1200
Etablissez les états financiers de l’entreprise Bucoverex pour l’exercice financier
terminé le 30 novembre 2005.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 26
CHAPITRE IV
PLAN DU CHAPITRE
LA REGULARISATION DES COMPTES
1. Expliquer pourquoi le découpage de la durée de vie totale d’une entreprise
en exercice d’une durée uniforme est utile lors de l’évaluation du
rendement de l’entreprise.
2. Comprendre la relation qui existe entre les Principes de réalisation et du
Rapprochement des produits et des charges.
3. Saisir la pertinence de la régularisation des comptes.
4. Reconnaître les principales sortes d’écritures de régularisation et les
journaliser de façon appropriée.
Le principe d’indépendance tire son origine du fait que les créanciers, les investisseurs
et les utilisateurs doivent constamment prendre des décisions d’affaires. Il s’agit
d’imputer à chaque exercice de 12 mois toutes les opérations et tous les faits ou
événements qui s’y rattachent. Ce découpage permet de comparer les résultats d’un
exercice avec ceux de l’exercice précédent ainsi qu’avec ceux d’une autre entreprise.
Le principe d’indépendance des exercices donne naissance à deux autres principes non
identiques, mais intimement liés :
• Le principe de réalisation
• Le principe du rapprochement des produits et des charges.
L’objet du principe de réalisation appelé aussi Principe de constatation des produits est
de préciser le moment ou un produit doit être comptabilisé.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 27
Le respect du principe du rapprochement des produits et des charges nécessite que les
produits constatés au cours d’un exercice et les charges occasionnées pour générer ces
produits soient inclus dans le même état des résultats.
La pertinence de la régularisation des comptes.
Certaines opérations enregistrées peuvent avoir une incidence sur plus d’un exercice
financier. En effet, les écritures de régularisations ont pour objet de s’assurer de la
constatation des produits lorsqu’ils sont effectivement gagnés et des charges
correspondantes engagées pour gagner ces produits.
Afin d’être utiles, les etats financiers doivent être aussi précis que possible. Il importe de
présenter dans le bilan tous les éléments d’actif et de passif existant à la date clôture. De
même, l’Etat des résultats doit faire mention de tous les produits et de toutes les charges
d’exploitation de l’exercice, et il faut éviter d’y inclure des éléments qui se rapportent à
l’exercice suivant. Il importe à cet effet d’établir correctement le Temps d’arrêt des
comptes.
Les principales sortes d’écritures de régularisation.
1. La ventilations des charges sur plus d’un exercice : Charges payées d’avance
2. La ventilation des produits sur plus d’un exercice : Produits perçus d’avance
3. La comptabilisation des Charges à payer
4. La comptabilisation des Produits à recevoir
5. La comptabilisation des Charges estimatives : Amortissement des
immobilisations et la Provision pour créances douteuses.
6. Le redressement des Stocks (Comptabilité des entreprises commerciales).
Les écritures de régularisation ont deux principales caractéristiques :
1. Chacune des écriture de régularisation touche à la fois un compte de résultats
(produit ou charge) et un compte du bilan (actif ou passif).
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 28
2. Les écritures de régularisation demande une bonne compréhension des principes
comptables et leur application dans le contexte du temps d’arrêt des comptes.
Cette dernière caractéristique est illustrée en trois étapes :
• L’indentification de ce qui a déjà été fait (situation actuelle).
• L’analyse de la situation à la date de l’établissement des états financiers
(situation désirée).
• La passation des écritures de régularisation (ce qu’il faut faire), s’il y a
lieu.
La durée de vie d’une immobilisation correspond à la période au cours de laquelle elle
est techniquement utilisable. Sa durée de vie utile correspond à la période au cours de
laquelle le bien amortissable sera effectivement utilisé.
Exercices
I
Dites chacun des énoncés suivants est vrai ou faux. Justifiez votre réponse le cas
échéant.
1. L’amortissement représente une somme versée durant l’exercice. Cette
somme est imputée aux résultats de manière à repartir systématique le coût d’un
bien sur sa durée de vie ou sur sa durée de vie utile.
2. Le découpage de l’activité d’une entreprise en exercices comptables et la
détermination du bénéfice tiré d’un ensemble d’opérations pour chaque
exercice sont intimement liés à l’application du Principes de l’indépendance
des exercices.
3. La fin de l’exercice financier d’une entreprise individuelle doit coïncider avec
la fin de l’année civile.
4. La durée de vie utile d’une immobilisation correspond à la période au cours
de laquelle elle est techniquement utilisable.
II
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 29
Immobilex entreprise possède plusieurs immobilisations acquises à différentes dates.
L’entreprise, dont l’exercice financier se termine le 31 décembre, utilise la méthode de
l’amortissement linéaire. Passez les écritures de régularisation requise le 31 décembre
2005.
Bâtiment Matériel Ordinateur Camionnette
de bureau
Date d’acquisition 1/1/98 1/1/98 1/6/2004 30/6/2005
Coût d’acquisition 100000 9000 3000 15000
Durée de vie 40 ans 10 ans 4 ans 5 ans
Durée de vie utile 40 ans 8 ans 2 ans 3 ans
Valeur de récupération Aucune Aucune 200 2500
Valeur résiduelle Aucune 1000 1000 5250
III
L’exercice financier de l’Auberge Hôtel se termine le 31 décembre. La plupart des clients
règlent leur note au moment de leur départ, et les sommes reçues sont portées au crédit
du Location des chambres.
Lorsque des clients paient leur chambre à l’avance, on crédit plutôt le compte Locations
perçues d’avance.
Les données suivantes doivent servir à régulariser les comptes le 31 décembre 2005 :
1. Le 1e novembre, l’entreprise a contacté un emprunt bancaire de $80,000. Celui‐ci
porte intérêt ӑ un taux annuel de 6%.Le premier versement ne sera exigible que
le 1e février 2006.
2. Le 16 décembre, on a loué des chambres à une société de téléphone pour six
mois moyennant un loyer mensuel de $2,400. L’auberge a reçu la somme entière
dès la signature du contrat.
3. Le 31 décembre, la location des chambres des derniers jours,mais seulement
recouvrable lors du départ des clients s’élève à $9,750.
4. Les salaires à payer non encore comptabiliser se chiffrent à $1,460.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 30
5. La construction de l’Auberge a été complétée au coût de $360,000 le 18 avril
2001. Le propriétaire a alors affirmé que le bâtiment serait utilisé tout au long de
sa durée de vie, estimé à 40 ans. Aucune valeur de récupération n’est anticipée.
6. L’Auberge Hôtel possède également une camionnette ayant coûté $12,600. On l’a
acheté le 1e septembre 2005 et on a alors estimé que sa durée serait de quatre ans
même si sa durée de vie est établie à cinq ans. La valeur résiduelle et la valeur de
récupération sont estimées respectivement à $2,700 et à $600.
7. Le 31 décembre, L’Auberge Hôtel a signé un contrat en vertu duquel une
association de constructeurs pourra tenir son congres annuel à l’auberge. On
s’attend à ce que le produit de cette location se chiffre à au moins $30,000.
Passez les écritures de régularisations requises au 31 décembre et donnez toutes les explications
appropriées. Si aucune régularisation n’est nécessaire, justifiez votre décision.
IV
Lors de votre révision des registres comptables et les documents pertinents des
Entreprises Boucart à la fin de l’exercice terminé le jeudi 31 décembre 2005, les éléments
suivants ont attiré votre attention.
• La première semaine de travail de 40 heures reparties sur 5 jours, et les employés
reçoivent leur paye hebdomadaire le mercredi de la semaine suivante.
L’entreprise emploie 10 personnes dont le salaire horaire respecte la convention
collective.
Classe salariale Taux horaire Nombre d’employés
I 12,50 5
II 14,00 3
III 16,00 1
IV 19,00 1
• Le 15 octobre, l’entreprise a versé la somme de $900 pour la publication d’une
annonce publicitaire dans une revue mensuelle spécialisée dans la rénovation.
L’annonce paraîtra pendant un période de cinq mois à compter du numéro de
novembre. Le paiement a été porté au compte Publicité.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 31
• Le compte Loyer a un solde de $13,300 au 31 décembre tandis que le bail prévoit
un loyer mensuel de $950.
• Depuis le 1e avril, l’entreprise loue une partie de son entrepôt à une petite
pépinière pour un loyer mensuel de $250. Relativement à cette sous-location, le grand
livre ne renferme que le compte Produits de location dont le solde est de $2,250.
• Voici les renseignements relatifs aux immobilisations de l’entreprise :
Equipements Camion
Date d’acquisition 2 janvier 2004 1 mai 2005
e
Coût d’acquisition $25,500 $20,000
Durée de vie 10 ans 6 ans
Durée de vie utile 10 ans 4 ans
Valeur de récupération Aucune $2,000
Valeur résiduelle Aucune $4,100
• Le compte Assurances payées d’avance affiche un solde de $2,800 en raison des primes
d’assurance suivantes versées en 2005 :
Date d’entrée en
No de la police vigueur Période couverte Prime versée
AV1351-1 1e janvier 12 mois $250
BD978521 1e mai 12 mois $1200
e
RC323329 1 septembre 18 mois $1350
• Au cours de l’exercice,tous les achats de fournitures de bureau ont été passés en charges.
Au grand livre, le compte Fournitures de bureau a un solde de $275. Pourtant, le 31
décembre 2005, le coût des fournitures de bureau en mains s’élève effectivement à $125.
• Le 21 décembre 2005, l’entreprise a reçu le compte de taxes municipales pour l’année
civile 2006. Celui-ci s’élève à $4,500 et n’a pas encore fait l’objet d’une écriture
comptable.
Passez les écritures requises au 31 décembre 2005 et donnez toutes les explications appropriées.
Si aucune régularisation n’est nécessaire, justifiez votre décision.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 32
CHAPITRE V
• LE CHIFFRIER
• LES ECRITURES DE CLOTURE
• LES ECRITURES DE CONTREPASSATION
PLAN DU CHAPITRE
1. Etablir un chiffrier et maîtriser les écritures de régularisation.
2. Comprendre l’utilité du chiffrier.
3. Saisir l’importance des écritures de clôtures.
4. Passer les écritures de clôture.
5. Décrire le contenu et l’utilité de la balance de vérification régularisée.
6. Décrire la nature des écritures de contrepassation.
7. Expliquer comment passer ces écritures et en justifier l’utilité.
8. Résumer l’étape du cycle comptable.
Les écritures de régularisation se font en fin d’exercice et servent à régulariser les
livres comptables, de plusieurs façons :
• En corrigeant les erreurs qui ont pu se produire
• En enregistrant les transactions qui ne le sont pas encore
• En dénombrant les stocks
• En constituant des provisions
• En s’assurant que les transactions inscrites s’appliquent bien à l’exercice
courant et non à l’exercice précédent ou à l’exercice suivant.
En règle générale, une fois toutes les régularisations inscrites aux livres comptables,
l’entreprise se trouve prête à dresser la balance de vérification régularisée afin de bâtir
le chiffrier et faire les états financiers de fin d’exercice.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 33
A la fin de l’exercice financier, le travail du comptable consiste à procéder à plusieurs
opérations :
• L’établissement d’un chiffrier
• Les écritures de régularisation,
• Le report des régularisations au grand livre dans leurs comptes
individuels.
• La rédaction des états financiers : Etat des résultats, Etat de l’avoir et
Bilan.
• Les écritures de clôture et leur report au grand livre
• La passation des écritures de clôture ou de fermeture des comptes charges,
produits, apport et prélèvement.
• La préparation de la balance de vérification après clôture.
Le chiffrier est un instrument de travail pour le comptable, et non un état financier, ni
un document disponible pour le public. Il s’agit d’un brouillon qui permet d’accumuler
de façon ordonnée toutes les informations dont le comptable a besoin pour :
1. régulariser les comptes,
2. fermer les comptes de résultats
3. dresser les états financiers régularisés.
Le CHIFFRIER peut se décrire comme suit :
• Il permet d’évaluer l’effet des écritures de régularisations avant leur
report au grand livre. Il ne faut pas oublier qu’avant d’être reportées au
grand livre, les écritures de régularisation doivent êtres enregistrées dans
le journal général. Le report se fait à partir du journal et non à partir du
chiffrier qui n’est pas un journal comptable mais seulement une feuille de
travail.
• Le chiffrier facilite le classement des comptes qui font partie du bilan, de
l’avoir du propriétaire et de l’état des résultats en les présentant dans
différentes sections.
• Le chiffrier aide à déterminer le bénéfice net de l’exercice et à en vérifier
l’exactitude arithmétique.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 34
• Le chiffrier rend plus facile la préparation des écritures de clôture.
Le chiffrier comprend :
1. Un en‐tête
2. Colonne de classe des comptes
3. Colonne de noms des comptes
4. Colonnes de la balance de vérification non régularisée par solde
5. Colonnes de régularisation débit et crédit
6. Colonnes de la balance de vérification régularisée par solde
7. Colonnes de l’état des résultats
8. Colonnes de l’Etat de l’avoir du propriétaire
9. Colonnes du bilan
ECRITURES DE CLOTURE ou DE FERMETURE.‐
Pour être en mesure de déterminer le bénéfice net de l’exercice d’un exercice financier, il
faut que le solde des comptes de résultat soit égal à zéro .En effet , le principe du
rapprochement des charges et des produits implique que, pour un exercice donné, on
doit determiné, on doit determiner tous les produits et seulements les produits de cet
exercice, puis appliquer à ces produits toutes charges et seulements toutes les charges
engagees pour les gagner.
Il s’agit donc de fermer les comptes de resultats à la fin chaque exercice pour
commencer tout nouvel exercice sans qu’aucun montant soit inscrit dans ces comptes.
En plus de fermer les comptes de resultats permettent de virer l’execent des produits
sur les charges au compte de l’Avoir du proprietaire ou l’excedent des charges sur les
produits lorsque l’entreprise a subi une d’exploitation. Elles permettent aussi de trans
ferer les Apports et les Retraits de l’exercice dans le compte de l’Avoir du proprietaire
de facon à en obtenir le nouveau solde (C2).
Il est plus facile de proceder à la fermeture des comptes de resultats à partir du
chiffrier, ce pour eviter des risques d’erreur, puisque les comptes de produits et de
charges y sont classés par classe et par groupe, soit une colonne pour les produits et une
colonne pour les chrages. De plus les produits et les charges sont additionnés et le
resultat net est determiné.
Ces ecritures nous obligent à utiliser un nouveau compte de grand livre : le COMPTE
SOMMAIRE DES RESULTATS. On y reporte, en total, les produits et les charges. La
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 35
difference entre les deux est alors transferée dans la colonne de l’Avoir du proprietaire.
Le compte Sommaire des resultats est qualifié de compte transitoire parce qu’il ne
contient des montants que durant une courte periode, le temps que dure l’operation qui
vise à fermer les comptes de resultats. Durant le reste de l’exercice, ce compte a un solde
nul.
On doit habituellement se conformer aux cinq etapes suivantes pour rediger les
ecritures de cloture. Ces ecritures seront legerement differentes dans le cas d’une
entreprise commerciale.
1. On debite individuellement chacun des comptes de produits et on credite en
total le compte Sommaire des resultats.
2. On debite individuellement chacun des comptes de charges et on debite le
compte Sommaire des resultats.
3. Si le solde est crediteur, on a un Benefice net et si, au contraire le solde est
debiteur l’entreprise subit une perte nette.
4. Pour solder, le compte Sommaire des resultats est viré au compte Avoir du
proprietaire.
5. Les comptes Retrait et Apport sont aussi virés dans le compte de l’Avoir du
proprietaire. Ils sont ainsi accumulés dans un compte de contrepartie du compte
de l’avoir du prorprietaire de facon à montrer pour chaque annee (exercice) le
total des retraits et des apports effectués. A la fin de chaque exercice, il faut aussi
les ramener à zero.
Modeles d’ecritures de fermeture : (Exemple en classe par le professeur)
Lorsque le comptable effectue des reports au grand livre, il s’assure toujours que le total
des debits est egal au total des credits. Ainsi, apres toutes ecritures comptable, l’on doit
s’assurer que l’egalite persiste. Les comptes de charges et produits etant fermés, la
balance de fermeture ou communement appelée Balance d’inventaire ne contient donc
que des comptes de valeurs :
• Les actifs
• Les passifs
• L’avoir du proprietaire à la fin de l’exercice (C2).
ECRITURES DE REOUVERTURE
Ces types d’écritures s’appellent Ecritures de contrepassation. C’est la fermeture des
comptes à recevoir ou à payer, comptes payés d’avance ou perçus d’avance.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 36
Les écritures de contrepassation ou de réouverture ne sont pas obligatoires, mais elles
facilitent grandement le travail du comptable.
Exercice en classe
Voici la balance de vérification au 30 avril 2004 d’une Agence de voyage.
Balance de vérification
Débit Crédit
Petite caisse 400
Banque nationale de crédit 8250
Assurances payées d’avance 20000
Fournitures diverses 13315
Bateaux pneumatiques 175000
Amort‐cumules ‐ Bat pneumatiques 60000
Equipements 25000
Amort‐cumulés – Equipements 6000
Matériel de bureau 1800
Amort‐cumulés – Mat de bureau 360
Fournisseurs 12765
Emprunt hypothécaire 95000
Yvon Jacques – Capital 55140
Yvon Jacques – Retraits 24000
Ventes de billets 193250
Assurances 7200
Fournitures utilisées 4500
Frais de transport 42755
Intérêts sur emprunt hypothécaire 2625
Publicité 15000
Salaires 75425
Taxes et permis 4800
Téléphone 2445
Total 422515 422515
1. Le solde du compte Fournitures diverses est celui du 30 avril 2003. Au cours de
l’exercice, l’entreprise a acheté des fournitures d’une valeur totale de $4500, et ces achats
ont ete porté au compte Fournitures utilisées. Le cout des fournitures non utilisées
dénombrées le 30 avril 2004 s’élève à $9400.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 37
2. Le 28 février 2004, l’entreprise a renouvelé, pour un an (28 février 2004 au 28 février
2005), une police d’assurance responsabilité dont la prime est de $12000. L’année
précédente, la prime était seulement $9600. Le 31 juillet 2004, une nouvelle police d’une
durée de un an est entrée en vigueur. La prime de $7200 qu’a versée l’entreprise pour
cette police est la seule opération portée au compte Assurance en 2004‐2005.
3. Les bateaux pneumatiques ont été acquis le 2 mai 2001, et on estimait alors que leur
durée d’utilisation serait de 5 ans et leur durée de vie totale d’environ 10 ans. Yvon
Jacques a fixé à $25000 la valeur résiduelle de ces bateaux et il estime qu’ils n’auront
aucune valeur de récupération.
4. Voici les renseignements disponibles en ce qui a trait aux équipements :
Matériel de rangement Matériel d’entretien
Date d’acquisition 1 mai 2003
e 1e aout 2003
Cout d’acquisition 16000 9000
Durée de vie 10 ans 3 ans
Durée de vie utile 5 ans 2 ans
Valeur de récupération aucune aucune
Valeur résiduelle 1000 1200
5. Le matériel de bureau a été acheté le 2 mai 2001, et on estimait alors que sa durée
d’utilisation serait de 10 ans, ce qui correspond à durée de vie totale. Aucune valeur de
récupération n’est prévue.
6. Des frais de transport engagés le 30 avril 2004 et totalisant $250 ne sont pas encore
comptabilisés.
7. Le 15 avril 2004, l’entreprise a reçu un cheque de $4500 pour des services récréatifs à
rendre à trois groupes d’employés d’une société. L e dernier groupe doit entreprendre la
descente d’une rivière le 5 mai 2004.
Travail à faire
Etablissez le chiffrier de l’entreprise pour l’exercice terminé le 30 2004. Fournissez tous vos calculs et
toutes les explications pertinentes. Malgré les inconvénients que cela suscite, l’entreprise a décidé que la
fin de l’exercice financier ne coïncide pas avec la fin de l’année civile.
Dressez l’état des résultats et des capitaux propres ainsi que le bilan de l’entreprise.
Passez les écritures de régularisations et de clôture au 30 avril 2004.
Passez les écritures de contrepassation requises le 1e mai 2004
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 38
Questions et exercices
Dites si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux.
• L’amortissement ne doit pas l’objet d’une écriture de contrepassion.
• Le total de la conne Crédit de la section bilan du chiffrier correspond toujours au
total du passif et des capitaux propres figurant au bilan d’une entreprise.
• Les écritures de régularisation sont d’abord enregistrées dans le journal général,
puis inscrites dans le chiffrier.
• Il peut être utile de passer une écriture de contrepassion pour les sommes reçues
d’avance qui ont été enregistrées initialement dans des comptes passifs.
• Il peut être utile de passer une écriture de contrepassation pour les sommes
payées d’avance qui ont été enregistrées initialement dans des comptes de
charges.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 39
Marie Denise est propriétaire d’un centre de sante. L’exercice financier de son entreprise se
termine le 31 décembre de chaque année. Voici la balance de vérification établie à partir des du
grand livre de l’entreprise au 31 décembre 2005.
En révisant les registres comptables et des documents pertinents de l’entreprise à la fin de
l’exercice, les éléments suivant ont attiré votre attention :
Centre de sante Marie Denise
Balance de vérification
Au 31 décembre 2005
Comptes Débit Crédit
Petite caisse 150
Unibank 942
Clients 2380
Assurances payées d’avance 2100
Fournitures 384
Terrain 15000
Bâtiment 93060
Amort‐cumulé Bâtiment 7500
Equipements 18540
Amort‐cumulé Equipements 4200
Fournisseurs 272
Produits reçus d’avance 2840
Emprunt hypothécaire 95000
Marie Denise – capital 10000
Marie Denise – retrait 6000
Honoraires professionnels 65746
Cotisations professionnels 700
Frais de représentation 1304
Intérêts sur emprunt hypothécaire 11300
Publicité 3220
Salaires 30140
Taxes 2274
Téléphone 514
188008 188008
1. Au 1e janvier 2005, l’entreprise n’avait qu’une seule police d’assurance dont la durée non
écoulée était de 15 mois.
2. Le cout des fournitures en main au 31 décembre 2005 s’élève à $ 100.
3. La dotation annuelle à l’amortissement du bâtiment et des équipements s’élève
respectivement à $ 3750 et à $ 2100.
4. Une analyse des produits perçus d’avance révèle que 60% d’entre eux ont été
effectivement gagnés au cour de l’exercice.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 40
5. Les salaires à payer non encore comptabilisés au 31 décembre 2005 sont de $ 740.
6. L’emprunt hypothécaire porte intérêt au taux de 12%. Le dernier versement a été
effectué le 30 novembre 2005. La portion échéant au cours du prochain exercice s’élève à
$ 3200.
7. Des services rendus à un client totalisant $150 n’ont pas encore été facturés.
Etablissez le chiffrier de l’entreprise et dressez les états financiers en bonne et du forme.
La Bucoverex offre des services de gestion comptable pour le bénéfice de moyennes et grandes
entreprises. L’entreprise régularise ses livres mensuellement. Voici les soldes des comptes au 31
mars 2005.
Effets à payer 96000
Fournitures de bureau 16800
Caisse 287040
Honoraires de gestion reçues d’avance 458400
Téléphone 10560
Fournisseurs 35040
Loyer payé d’avance 115200
Amortissement cumulé‐matériel de bureau 2400
Yolène Dorsainvil – Retraits 9600
Honoraires de gestions gagnés 64800
Matériel de bureau 100800
Salaires des employés de gestion 233280
Location d’un ordinateur payée d’avance 171840
Yolène Dorsainvil – Capital 355280
Salaires des préposés à l’entretien 20160
Frais de représentation 26640
En révisant les registres et les pièces justificatives de l’entreprise, vous avez amassé les
renseignements suivants :
1. Les intérêts courus au 31 mars sur les effets à payer s’élèvent à $690.
2. Une analyse des contrats de gestion montre que le solde reçu d’avance au 31 mars
s’élève effectivement à 152640. L’écart provient d’honoraires afférents aux services
rendus en mars.
3. Le contrat de location de l’ordinateur prévoit un taux horaire de $ 80. En mars,
l’ordinateur a été utilisé pendant 1980 heures.
4. Des honoraires non facturés en mars se chiffrent à $ 141120.
5. Le solde du compte loyer d’avance représente le loyer du bureau payé pour six mois le
mars 2005.
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 41
6. Le dénombrement des fournitures de bureau non utilisées au 31 mars 2005 montre un
cout de $ 3360.
7. Vous avez en main une facture de fournitures de bureau s’élevant à $ 20640 qui n’a pas
été enregistrée et qui est impayée. Ces fournitures ont toutes été utilisées au cours de
l’exercice.
8. La dotation à l’amortissement du matériel de bureau est $14400 par année.
Etablissez le chiffrier pour les mois terminé le 31 mars 2005.
Le cycle comptable complet d’une entreprise se résume en ces points :
1. L’enregistrement des opérations au Journal général
2. Le report aux comptes du Grand livre
3. Le Chiffrier :
• La balance de vérification non régularisée (4 colonnes)
• Les régularisations
• La balance de vérification régularisée
• L’état des résultats
• L’état de l’avoir du propriétaire
• Le bilan
4. L’enregistrement des régularisations au journal général
5. Le report des écritures de régularisations au grand livre
6. L’état des résultats
7. L’état de l’avoir du propriétaire
8. Le bilan
9. L’enregistrement des écritures de clôture au journal général
10. Le report des écritures de clôture au grand livre
11. La préparation de la balance de vérification après clôture
12. Les écritures de réouverture ou de contrepassation (facultatives)
13. Le report des écritures de réouverture au grand livre (facultatives).
Titulaire : GERARD D. DORSAINVIL, © CREFIMA 2007 , www.crefima.net 42
Vous aimerez peut-être aussi
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Cours Comptabilité GénéraleDocument152 pagesCours Comptabilité GénéraleAnonymous MbYmehoZgx100% (2)
- Checklist du business plan: Les 9 étapes-clés à ne pas manquer !D'EverandChecklist du business plan: Les 9 étapes-clés à ne pas manquer !Pas encore d'évaluation
- 12 Cas de FinanceDocument269 pages12 Cas de FinanceJilani Bejaoui100% (5)
- Comprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgeD'EverandComprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgePas encore d'évaluation
- Comptabilite Et Audit Manuel Et Applications 2edDocument639 pagesComptabilite Et Audit Manuel Et Applications 2edYassine AIT OUAZZANE100% (3)
- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation
- Les Fondement de La ComptabilitéDocument25 pagesLes Fondement de La ComptabilitéSaid Mrf100% (1)
- Exercices AmortissementDocument2 pagesExercices AmortissementJilani Bejaoui100% (12)
- Comptabilite Des EntreprisesDocument152 pagesComptabilite Des EntreprisesFli100% (1)
- 10 Exercices en Comptabilit Analytique EFM Et Corrig PDFDocument47 pages10 Exercices en Comptabilit Analytique EFM Et Corrig PDFAhmed Abdourabihi53% (15)
- Cours Du Droit Comptable M1Document31 pagesCours Du Droit Comptable M1Hassan Mht88% (8)
- Comptabilité Financière Pour GestionnairesDocument482 pagesComptabilité Financière Pour GestionnairesMaharat Center100% (2)
- Rapport Final-Audit Des AssociationsDocument112 pagesRapport Final-Audit Des Associationshammouda25Pas encore d'évaluation
- Cours Af 2013Document126 pagesCours Af 2013Reda LaksaiPas encore d'évaluation
- Cadre ConceptuelDocument14 pagesCadre Conceptuellara iplikjePas encore d'évaluation
- CF Rapport FinalDocument20 pagesCF Rapport Finaloualidedd100% (1)
- IFRS Parcours Audit 2021 2022 - Partie I - Etudiants Extraits 2Document68 pagesIFRS Parcours Audit 2021 2022 - Partie I - Etudiants Extraits 2Fatine Rhazi100% (1)
- Chapitre 3 - Les Étapes de La ConsolidationDocument21 pagesChapitre 3 - Les Étapes de La ConsolidationJilani Bejaoui100% (1)
- Compta PDFDocument67 pagesCompta PDFHamza ChPas encore d'évaluation
- Cours Comptabilité Générale Suite (Supports Comptables Et Facturation)Document115 pagesCours Comptabilité Générale Suite (Supports Comptables Et Facturation)Anonymous MbYmehoZgxPas encore d'évaluation
- Tâches: Fin D'AnnéeDocument78 pagesTâches: Fin D'AnnéeJilani BejaouiPas encore d'évaluation
- L'image Fidèle Et La Transparence Financière de L'entrepriseDocument7 pagesL'image Fidèle Et La Transparence Financière de L'entrepriseAnonymous hnfl6DJX100% (1)
- Compta Generale S1Document57 pagesCompta Generale S1Ali Hachimi Kamali100% (1)
- Pre LocationDocument1 pagePre LocationAdrian TudorPas encore d'évaluation
- Cours de Presentation de L'Information Comptable: Yaounde Higher School of Economics and ManagementDocument131 pagesCours de Presentation de L'Information Comptable: Yaounde Higher School of Economics and ManagementStessy CutieeePas encore d'évaluation
- S1-Cours N°4-Opération A-VDocument50 pagesS1-Cours N°4-Opération A-VJilani Bejaoui100% (1)
- Ciudadanos Del Cielo PDFDocument3 pagesCiudadanos Del Cielo PDFRuben Pinto100% (1)
- Présentation Tenue de La Comptabilité MPMEDocument11 pagesPrésentation Tenue de La Comptabilité MPMEMoïse KUNGULAPas encore d'évaluation
- Cours de La Comptabilité Générale S1 2018 - 2019-1 PDFDocument112 pagesCours de La Comptabilité Générale S1 2018 - 2019-1 PDFchaimaPas encore d'évaluation
- Support de Cours Audit GénéralDocument32 pagesSupport de Cours Audit GénéralSteven Mills40% (5)
- Comptabilite Et FinanceéDocument26 pagesComptabilite Et FinanceéHayat HassanPas encore d'évaluation
- Cours de Comptabilité Générale (3) JNKJNKSDDocument115 pagesCours de Comptabilité Générale (3) JNKJNKSDMehdi Jabrane IIPas encore d'évaluation
- Compta GEC1Document57 pagesCompta GEC1Dara sekou SekouPas encore d'évaluation
- CH1 PcgaDocument23 pagesCH1 PcgaAminePas encore d'évaluation
- Cours de La Comptabilité Générale 1Document44 pagesCours de La Comptabilité Générale 1jaouad el ghaniPas encore d'évaluation
- Code General de Normalisation ComptablcgncDocument241 pagesCode General de Normalisation ComptablcgncOussamaAitTahriaPas encore d'évaluation
- Décret N° 96-2459 Du 30 Décembre 1996, Portant Approbation Du Cadre Conceptuel de La Comptabilité.Document14 pagesDécret N° 96-2459 Du 30 Décembre 1996, Portant Approbation Du Cadre Conceptuel de La Comptabilité.رمزي العونيPas encore d'évaluation
- Gestion ContableDocument54 pagesGestion ContableSteven Jose Arellano OrePas encore d'évaluation
- 1ere Partie Comptabilité GeneraleDocument28 pages1ere Partie Comptabilité GeneraleStephane Nya'abe100% (1)
- Rapport Du Stage NADADocument30 pagesRapport Du Stage NADANada LePas encore d'évaluation
- Comptabilite de L'entreprise FSJPDocument87 pagesComptabilite de L'entreprise FSJPbxsr8w5yz2Pas encore d'évaluation
- Compta FinancièreDocument195 pagesCompta Financièreiaro razaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Et 2 Comptabilité FinancièreDocument24 pagesChapitre 1 Et 2 Comptabilité FinancièreAloes N'dofulaPas encore d'évaluation
- Ingénierie Financière Et Comptable MAF - 231205 - 131611Document122 pagesIngénierie Financière Et Comptable MAF - 231205 - 131611Haifa BouabidPas encore d'évaluation
- Cours de Comptabilité Générale (4) SDJNSKJNKDDocument85 pagesCours de Comptabilité Générale (4) SDJNSKJNKDMehdi Jabrane II100% (1)
- Cours de Comptabilité Générale (2) JndkjnsDocument52 pagesCours de Comptabilité Générale (2) JndkjnsMehdi Jabrane II100% (1)
- Belkahia LA COMMUNICATION FINANCIERE DES SOCIETES COTEES A LA BOURSE DES VALEURS DE CASABLANCA - ETAT DE L'ART PDFDocument32 pagesBelkahia LA COMMUNICATION FINANCIERE DES SOCIETES COTEES A LA BOURSE DES VALEURS DE CASABLANCA - ETAT DE L'ART PDFRACHIDPas encore d'évaluation
- CGNCDocument241 pagesCGNCSona AouzaPas encore d'évaluation
- Notions Fondamentaless de ComptabilitéDocument6 pagesNotions Fondamentaless de Comptabilitéabederina9Pas encore d'évaluation
- Intelligence Finciere 2Document7 pagesIntelligence Finciere 2cfbouzeguenePas encore d'évaluation
- 2_chap 2 Cadre conceptuelDocument7 pages2_chap 2 Cadre conceptuelAsma JemaaPas encore d'évaluation
- Cours D'initiation A L'auditDocument66 pagesCours D'initiation A L'auditCosme AkpoviPas encore d'évaluation
- All Document Reader 1715238822583Document56 pagesAll Document Reader 1715238822583alexmazela60Pas encore d'évaluation
- Exp Guide Financement2010 1297250212894 PDFDocument207 pagesExp Guide Financement2010 1297250212894 PDFRiadh Assouak100% (1)
- Pfe Section1Document25 pagesPfe Section1Karim FarjallahPas encore d'évaluation
- La Théorie ComptableDocument11 pagesLa Théorie ComptableBillah AbdallahPas encore d'évaluation
- Comptabilité Générale Cours Du SoirDocument66 pagesComptabilité Générale Cours Du SoirMario Stifler100% (1)
- Comptabilite NationaleDocument36 pagesComptabilite NationaleRonald MardyPas encore d'évaluation
- Parie II - Finance Pour IngénieursDocument105 pagesParie II - Finance Pour IngénieursAssane SYLLAPas encore d'évaluation
- P. Ouchekkir Ali - Management I - S1 - 20 - 21 (I - II - III)Document102 pagesP. Ouchekkir Ali - Management I - S1 - 20 - 21 (I - II - III)YOUNESS Ait oumgharPas encore d'évaluation
- Chapitre - 1Document26 pagesChapitre - 1Seif Allah AmouriPas encore d'évaluation
- Syllabus de Finances - Comptabilité - Gestion - Des - Entreprises - HSD-LUCIEN-21 08 2023Document89 pagesSyllabus de Finances - Comptabilité - Gestion - Des - Entreprises - HSD-LUCIEN-21 08 2023Lucien YOUBIPas encore d'évaluation
- Compta 2Document17 pagesCompta 2Alexis NdeyePas encore d'évaluation
- Cours de Comptabilite GeneraleDocument128 pagesCours de Comptabilite GeneraleEric DjagamPas encore d'évaluation
- Syllabus de Finance D'entreprises - IPHF-LUCIEN-22 08 2023Document83 pagesSyllabus de Finance D'entreprises - IPHF-LUCIEN-22 08 2023Lucien YOUBIPas encore d'évaluation
- 1.cours Comptabilité PDFDocument22 pages1.cours Comptabilité PDFsandysaryonoPas encore d'évaluation
- CGNCDocument250 pagesCGNCHanan ErgPas encore d'évaluation
- Développement ExposéDocument5 pagesDéveloppement ExposéjesusnickarielllPas encore d'évaluation
- A0314De l'Ing..Au Man...Document385 pagesA0314De l'Ing..Au Man...Jilani BejaouiPas encore d'évaluation
- Micro É Con OmieDocument367 pagesMicro É Con OmieKing BrainPas encore d'évaluation
- Aetech 2020Document2 pagesAetech 2020Jilani BejaouiPas encore d'évaluation
- Systeme de Gouvernance D'Entreprise Et Presence D'Actionnaires de Contrôle: Le Cas SuisseDocument199 pagesSysteme de Gouvernance D'Entreprise Et Presence D'Actionnaires de Contrôle: Le Cas SuisseJilani BejaouiPas encore d'évaluation
- Comptabilite Analytique PDFDocument245 pagesComptabilite Analytique PDFmina nounou50% (2)
- Chap. 4 - La ConsolidationDocument8 pagesChap. 4 - La ConsolidationJilani Bejaoui100% (1)
- LECGE1219Document124 pagesLECGE1219Jilani BejaouiPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Liquidation TVA Assj Obli S2 s3Document10 pagesChapitre 2 Liquidation TVA Assj Obli S2 s3Emna GharsallahPas encore d'évaluation
- Regroupents MPIF12022Document10 pagesRegroupents MPIF12022Jilani BejaouiPas encore d'évaluation
- S1-Cours N°3-La Taxe Sur La Valeur AjoutéeDocument15 pagesS1-Cours N°3-La Taxe Sur La Valeur AjoutéeJilani BejaouiPas encore d'évaluation
- Stip Efc311213Document32 pagesStip Efc311213Jilani BejaouiPas encore d'évaluation
- Article K.GHEDIRA IA - RéalitésDocument2 pagesArticle K.GHEDIRA IA - RéalitésJilani Bejaoui100% (1)
- Droit Bancaire AlgerienDocument277 pagesDroit Bancaire AlgerienDoudja RADJIPas encore d'évaluation
- Boulanger Fevrier 264Document28 pagesBoulanger Fevrier 264Philippe BaureisPas encore d'évaluation
- Décret 05.11Document4 pagesDécret 05.11Norr MalPas encore d'évaluation
- DP 2021 Balt 14595Document1 pageDP 2021 Balt 14595Soulayma GazzehPas encore d'évaluation
- Reglement Interieure Coopérative LogementDocument8 pagesReglement Interieure Coopérative LogementRatamasGuellehPas encore d'évaluation
- LPHYS1111Document9 pagesLPHYS1111itsamePas encore d'évaluation
- Droit de La Famille 3Document12 pagesDroit de La Famille 3Man GtklPas encore d'évaluation
- Green Daniel E PHD 1996Document342 pagesGreen Daniel E PHD 1996Nour ouzeriPas encore d'évaluation
- WEBER Causes Sociales Du Declin de La Civilisation Antique A BihrDocument3 pagesWEBER Causes Sociales Du Declin de La Civilisation Antique A BihrSierra AlgizaPas encore d'évaluation
- Focus 93 La Garantie de Paiement Des EntreprisesDocument4 pagesFocus 93 La Garantie de Paiement Des EntreprisesNICOLAS HOUPERTPas encore d'évaluation
- Preconfig Titan EuklesDocument1 pagePreconfig Titan EuklesRaz AlgulPas encore d'évaluation
- Cours D'Economie D'Entreprise: Classes de Premieres CG, Acc, Aca, FigDocument75 pagesCours D'Economie D'Entreprise: Classes de Premieres CG, Acc, Aca, FigAndré FokouPas encore d'évaluation
- Analyse Du FluxDocument2 pagesAnalyse Du FluxSouleymane YoumanliPas encore d'évaluation
- Les Droits Et Devoirs de LétudiantDocument2 pagesLes Droits Et Devoirs de Létudiantleilalilyana950Pas encore d'évaluation
- PCQ 1ere AnneeDocument27 pagesPCQ 1ere Anneerita tamohPas encore d'évaluation
- Undp Ga SNLCCBC 2013 PDFDocument231 pagesUndp Ga SNLCCBC 2013 PDFDootch Bolossima100% (1)
- Declaration Accident Du TravailDocument2 pagesDeclaration Accident Du TravailAbdou SebtiPas encore d'évaluation
- Sources Et Techniques de Financement - 2BDocument2 pagesSources Et Techniques de Financement - 2Bpandreas.sergeantPas encore d'évaluation
- Première PartieDocument14 pagesPremière PartieHamada HijariPas encore d'évaluation
- 1188 PDFDocument24 pages1188 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Expose Algebres5 Chap1Document162 pagesExpose Algebres5 Chap1anon_441994392Pas encore d'évaluation
- Chapitre 4 - Organisation Et Enregistrement Comptable Des OperationsDocument31 pagesChapitre 4 - Organisation Et Enregistrement Comptable Des OperationsLacine SIDIBEPas encore d'évaluation
- Action AssociativeDocument6 pagesAction Associativelazmi SaraPas encore d'évaluation
- Lecture linéaire Les Fausses Confidences, Marivaux, Acte II, scène 15, 1737, extrait.Document2 pagesLecture linéaire Les Fausses Confidences, Marivaux, Acte II, scène 15, 1737, extrait.teulierlaurianePas encore d'évaluation
- Autorisation Du TravailDocument4 pagesAutorisation Du TravailCoco Cinéma100% (1)
- 1 SMDocument24 pages1 SMKpapile issaPas encore d'évaluation
- Arrêt PoussinDocument2 pagesArrêt Poussinsoufiane Safouan0% (2)