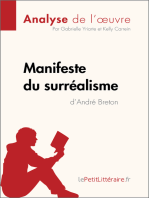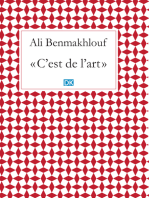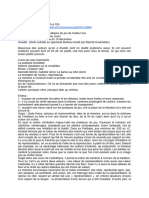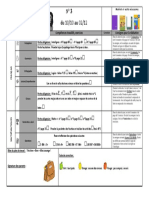Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
DM-ArtEvasion L'art N'est-Il Qu'un Moyen D'évasion ?
Transféré par
lapi fabiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
DM-ArtEvasion L'art N'est-Il Qu'un Moyen D'évasion ?
Transféré par
lapi fabiDroits d'auteur :
Formats disponibles
« L’art n’est-il qu’un moyen d’évasion ?
Daniel Mercier
I - Quelle évasion ? Quelle réalité ou « vie réelle » ? Lorsque
nous parlons « d’Art », que disons-nous au juste ?
E vasion, du latin evaderer : sortir de. Sortir de quoi ? Les pratiques
artistiques, du côté du créateur comme de celui de « l’usager », auraient
comme effet de les faire sortir de la « prison » (on s’évade généralement d’une
prison…) de la « vie réelle » ? Nous ne préjugeons d’ailleurs pas explicitement si
cette évasion est une bonne ou une mauvaise chose, mais nous pouvons tout de
même subodorer que le jugement est plutôt négatif… La référence à la « réalité »
est ici problématique : nous savons que par-delà son apparente simplicité, ce
concept est un des plus énigmatiques de la philosophie ! Contentons-nous – au
moins provisoirement – de la définition trouvée dans tous les dictionnaires : la
réalité ou le réel (nous ne reprendrons pas ici la distinction lacanienne) désigne ce
qui existe effectivement, ce qui est du côté de la « chose » (res en latin) ; nous
pouvons ajouter ce qui est « donné » à notre esprit et peut éventuellement devenir
matière de connaissance (c’est en ce sens que Claude Bernard disait que « seuls
les faits étaient réels »). Les synonymes de ce terme sont effectif, existant,
authentique, palpable ou tangible, véritable, et s’opposent à ce qui relèvent de
l’imagination : c’est-à-dire à irréel, fictif, illusoire, apparent, chimérique, mais
aussi à mythique, légendaire, ou virtuel. Qu’il s’agisse d’une imagination
reproductrice (les Anciens définissaient la fonction de l’Art comme une imitation
de la Nature) ou d’invention et de création, l’art apparaît effectivement comme
une « échappée », sinon un échappatoire, par rapport à une « réalité » souvent
associée à une réalité pratique, utilitaire, matérielle, qui se manifesterait en
particulier par une série de contraintes, de possibles mais aussi d’impossibles, sur
laquelle nous pourrions certes agir, mais qui nous soumettrait à ses propres limites
indépassables. L’art, associé au rêve et à l’imaginaire, serait ainsi le moyen
d’échapper à ce monde-ci, trop « prosaïque » et contraignant, au profit d’un
monde certes fictif, mais beaucoup plus agréable… Nous examinerons donc cette
thèse, en évitant de prendre à la lettre la formule restrictive « n’est QU’un moyen
d’évasion » : il n’est pas raisonnable de réduire toutes les fonctions de l’art à
www.dogma.lu
celle-ci ; quelque soit la vérité du sens accordé ici à l’art (l’art comme fonction
d’évasion), cette dernière n’est pas à ce point prédominante qu’elle puisse éclipser
toutes les autres…
L’Art ?
Quelques mots enfin sur cette notion d’art, que l’on peut facultativement écrire
« Art » : elle date du XVIIIème siècle, correspondant à une acception moderne de
l’art comme regroupant l’ensemble des beaux-arts – l’architecture, la peinture, la
sculpture, la musique, les arts littéraires… Sans entrer dans les polémiques
relatives à l’art contemporain (certains artistes font mêmes « hara-kiri » en
déclarant « la mort de l’art »), il faut ajouter tous les objets ou installations qui
prennent place dans les musées ou d’autres environnements naturels ou urbains,
dont les auteurs sont souvent qualifiés de « plasticiens ». Et bien sûr également les
œuvres du cinéma et de l’audiovisuel en général. Cette définition de l’art « en
extension » est trompeuse : nous avons utilisé l’art au singulier non pas tant pour
désigner cette addition, qu’au moment où nous nous sommes intéressés à son
essence (dimension « compréhensive » du concept) ; A partir du XVIII en effet,
nous avons délaissé la valeur de culte de l’art au profit de sa valeur d’exposition,
avec l’apparition du musée. Dans cette période de laïcisation générale de
l’expérience, l’œuvre d’art devient autonome, objet esthétique propre au jugement
de goût. Il ne s’intègre plus dans une fonction sociale et religieuse comme
incarnation de la présence du divin, propre aux sociétés traditionnelles. Il perd
ainsi son efficace au profit de la seule jouissance perceptive. Comme le dit André
Malraux dans ses « Voies du silence », « Un crucifix roman n’était pas d’abord
une sculpture, la Madone de Cimabue n’était pas d’abord un tableau, même la
Pallas Athéné de Phidias n’était pas d’abord une statue. ». Ceci dit, la définition
de l’art, qui semblait à partir de ce moment être référée à la question du beau, elle-
même associée à des notions ancestrales comme celles du génie, du savoir-faire,
de l’originalité, du style, de l’habileté, est loin d’être réglée : avec l’art
contemporain, les limites de l’art semblent bien bousculées et reculées à l’infini.
Le geste véritablement inaugural à ce sujet ayant été celui de Duchamp avec son
urinoir : désormais, la considération esthétique « est ramené à un choix mental et
non pas à la capacité ou à l’intelligence de la main ». C’est ainsi que le « ready-
made », le « body art », le « land art », le « mail art », le « non-art » …entre
autres, vont voir le jour… Cette question « qu’est-ce que l’art ? » ou « quand y a-
t-il art ? » n’est évidemment pas celle qui est posée ce soir… mais quoiqu’il en
soit, l’apparition d’une nouveau sens de l’art au XVIII, lié à son « extraction » du
contexte socio-religieux où il avait pris naissance (pensons aux grottes de
Lascaux…), désormais objet d’exposition, solidaire d’une pratique culturelle
relativement indépendante des autres pratiques sociales, n’est pas indifférente,
loin s’en faut, à notre sujet. Nous y reviendrons.
II - Imaginaire humain et « réalité »
Que penser maintenant de cette idée d’une expérience esthétique qui serait ainsi
« déconnectée » de la « vraie vie », entendue aussi bien dans sa dimension
individuelle que collective (historique et sociale) ? Une première réflexion sur
cette expérience nous conduit immédiatement à penser que l’expérience en
décembre 2011 Page | 2
www.dogma.lu
question est aussi « une réalité » ! Si nous envisageons le problème sous l’angle
habituel du sujet et de l’objet, nous pouvons alors distinguer une réalité extérieure
et une réalité interne ou intérieure qui est celle qui est éprouvée par le bénéficiaire
de cette expérience esthétique… Réciproquement, l’artiste qui exprime à travers
son œuvre quelque chose d’éminemment subjectif concernant son propre moi,
exprime également une « réalité », la sienne…
Le registre de réalité qui est ici privilégié, sous-jacent à la question posée, est
plutôt celui d’un monde extérieur, en quelque sorte « matériel », en tout cas
marqué du sceau de l’utilité, de l’efficacité, de la performance, de la rationalité
instrumentale. Mais comment tracer une frontière étanche entre ce monde et celui
de l’imaginaire ? Où placer alors l’image que j’ai de moi ? Mes pensées ici-
maintenant ou ce que j’écris ? Et l’amour, où doit-on le loger ? La Rochefoucauld
disait qu’il n’y aurait pas d’amour sans les romans d’amour… Et mes rêves ?
Mais de façon beaucoup plus générale, l’ensemble des productions humaines (et
pas seulement les productions culturelles), à partir du moment où elles empruntent
les voies de la pensée et de l’imagination. Le monde, en tant qu’il est humain, ne
peut se limiter à ce qui nous est extérieur. Et d’ailleurs, quelle serait cette limite
entre l’intérieur et l’extérieur ? Dans ce monde que nous habitons, chaque objet
nous appartient en quelque façon, comme le dit fort justement Levinas, l’autre est
annexé au même… Comment faire le tri en lui entre l’imaginaire humain solidifié
et le réel originaire qui désignerait les choses purement « extérieures » à lui ?
Nous sommes à la fois partie de la nature et ce pourquoi il y a nature ; l’idée
même d’un monde comme totalité et horizon potentiel de nos actions, auxquels
nous attribuons du sens, des significations (ce qui convoque par conséquent les
différents langages, et par conséquent la fonction symbolique…) incluant nos
représentations sociales, religieuses, philosophiques, mythologiques, artistiques,
caractérise précisément le monde « humain ». L’antique nature cosmique grecque
doit aujourd’hui englober le monde de la culture et de l’histoire humaine…
Partant, nous voyons bien que l’imaginaire est partie intégrante de la « vie
réelle ». Edgar Morin (in « Amour, sagesse, poésie ») parle à ce sujet d’un état
prosaïque et d’un état poétique toujours présents dans nos vies, reflets des
polarités de « l’homo sapiens/demens », qui seraient fortement imbriqués dans les
sociétés archaïques (difficile de séparer dans celles-ci l’acte quotidien et utilitaire
du rite et/ou du mythe qui l’accompagne), alors que nos sociétés contemporaines
auraient au contraire une forte tendance au clivage entre ces deux états. Une telle
hypothèse est intéressante car elle peut expliquer en partie en quel sens l’art, en
tant que pratique culturelle, peut être pensé comme « moyen d’évasion » : il
faudrait alors tout simplement comprendre qu’une telle pratique se déploierait
dans une sphère relativement indépendante, traduisant alors un certain
cloisonnement social entre « la vie en prose » et la « vie poétique ». Edgar Morin
préconise au contraire que l’on puisse tisser ensemble ces deux dimensions (nous
emprunterons plus loin le chemin tracé par une telle réflexion). Breton dans son
« Manifeste », devançant Morin) et son « état poétique », fait une critique de la
réalité au nom de la « surréalité » : c’est grâce à l’imagination, à la liberté, au
merveilleux, au rêve, à la folie, que nous pouvons atteindre, au-delà d’un réalisme
vulgaire qui n’admet que ce que ce qui se pense clairement, une réalité en quelque
sorte absolue. Le monde de la vie ordinaire est un monde mutilé : abolissons donc
les barrières entre le rêve et la réalité. Comme l’affirme Edgar Morin, nous
décembre 2011 Page | 3
www.dogma.lu
devons faire en sorte qu’état prosaïque et état poétique puissent constituer une
seule et même réalité.
III – Quelle relation de l’art avec la réalité ?
Il s’agit maintenant, en dehors d’un tel regard anthropologique, de revenir à ce qui
fait le sens de l’œuvre d’art, en particulier à partir des relations qu’elle entretient
avec le réel ? En quel sens serait-elle effectivement « irréelle » ? Quelle est la
nature profonde de ce rapport à « la vie réelle ? ». Peut-on dire qu’il est dans la
nature intrinsèque de l’art de nous proposer « un autre monde » dans lequel
s’évader ?
A la fois objet irréel et réalité additionnelle
Il est indéniable que l’œuvre d’art appartient au champ de l’imaginaire ; même si
le cadre, la toile, les pinceaux, les couleurs sont bien réels (dans le cadre de la
peinture par exemple), l’intentionnalité de conscience de l’artiste, comme le dit
bien Sartre, peut être qualifiée d’ « imaginante », au sens où l’objet représentée
sur la toile « est visé comme irréel » par l’artiste ; il y a une irréalité inhérente à
l’œuvre d’art. L’objet représenté par la toile est au-delà de « l’analogon » (l’objet
réel qui lui sert de support, lorsqu’il y en a un…). L’objet esthétique est une
« irréel », une chose « irréelle », c'est-à-dire hors du réel, hors de l’existence
(contrairement bien sûr à son analogon). « La contemplation esthétique, dit encore
Sartre, est un rêve provoqué et le passage au réel est un authentique réveil ». Mais
en même temps, comme nous l’avons déjà montré, la matérialité de l’objet,
l’activité de production nécessaire à sa réalisation, sa rencontre avec le public
(visite pour le monument, concert pour la musique, musée pour la peinture…),
tout cela est bien réel, « fait partie du monde ». L’objet d’art peut être considéré à
ce titre comme une « réalité additionnelle » par rapport à d’autres objets, naturels,
techniques, scientifiques. Quelle est sa particularité ?
Un « objet-représentation »
Il réfléchit quelque chose de la réalité dans laquelle il se trouve (est-ce toujours
vrai pour certaines œuvres contemporaines ?). Quelles que soit les théories de l’art
à ce sujet – art comme « mimesis » par rapport à la nature, représentation sensible
de l’idée, expression la plus adéquate des forces de vie, contemplation des
essences, monstration de l’invisible, langage de l’être…etc., la fonction
représentative est toujours affirmée… En tant que représentation, elle signifie
quelque chose de l’objet qu’elle représente. Celle-ci ne doit pas être confondue
avec l’idée de l’œuvre comme fac-similé ou copie conforme de la réalité ; même
si l’idée de la reproduction ou d’une copie du réel a longtemps été véhiculée par le
discours de l’art, elle est nécessairement autre chose que cela. Sinon, Pascal aurait
raison de se moquer de ceux qui admirent des tableaux n’étant que de pâles copies
de la réalité, alors qu’ils ne prêtent aucune attention aux objets qui ont servi de
modèles. Même l’idéal classique comme « imitation de la nature » ne correspond
pas à cette idée de copie du réel. Il s’agit toujours d’une traduction du vrai, ou de
l’intelligible, d’une transposition visant à saisir ou percevoir l’eidos (l’Idée).
décembre 2011 Page | 4
www.dogma.lu
Hegel, qui s’inscrit finalement dans cet idéal en l’historicisant, explique ainsi cette
part projective et interprétative de l’esprit humain dans l’art : « L’universalité du
besoin d’art ne tient pas à autre chose qu’au fait que l’homme est un être pensant
et doué de conscience. En tant que doué de conscience, l’homme doit se placer en
face de ce qu’il est, et en faire un objet pour soi. Les choses de la nature se
contente d’être, elles sont simples, ne sont qu’une fois ; mais l’homme, en tant que
conscience, se dédouble : il est une fois, mais il est pour lui-même….l’œuvre d’art
est un moyen à l’aide duquel il extériorise ce qu’il est… A travers les objets
extérieurs, il cherche à se retrouver lui-même. ». L’art est ainsi « une pénétration
du sensible par l’esprit », fruit de la réflexivité humaine. Car l’homme n’est pas
seulement « en soi » comme un simple morceau de la nature, mais « pour soi »,
c’est-à-dire conscience de lui-même. L’art est ainsi le miroir de l’humanité. Elle a
donc toujours une fonction de témoignage, et fait partie d’un héritage commun.
L’histoire de l’art (à travers ses différentes formes, architecture, peinture,
musique… etc.) est ainsi l’histoire des différentes formes de présentation sensible
de l’esprit. Cette conception de l’art relié à l’histoire de l’humanité et de l’esprit
humain à travers elle, montre à quel point, bien loin d’être une fuite hors du
monde, il s’enracine dans le réel historique et social dans lequel il émerge (nous
reviendrons sur cette idée).
L’art comme langage
Si, comme nous le disions, « objet-représentation », l’objet d’art « signifie »
quelque chose, nous pouvons qualifier l’art de langage (toute signification a un
langage comme support ou véhicule), ce qui nous permet d’utiliser les termes qui
lui sont propres : l’objet artistique serait alors le « signifiant » de l’objet qu’il
représente (ou signifié). Mais aussitôt nous pouvons remarquer que du point de
vue de la linguistique, le signifié ne peut être confondu avec la chose (que certains
linguistes nomment, je crois, le « référent »). Cela nous permet de libérer l’objet
artistique d’un attachement trop servile à l’objet matériel, qu’une peinture (ou
sculpture) qui s’est inscrit très longtemps dans une perspective de figuration (et
d’imitation feinte) nous a inconsciemment conduit à considérer comme norme.
Mais alors qu’en serait-il de la musique ? L’objet sonore et temporel qu’est la
musique n’est fondamentalement pas référé à des « choses du monde »
particulières qui seraient dans un strict rapport de correspondance avec elle…
Même si certaines musiques à thèmes s’amusent à créer de telles correspondances
(cf. Pierre et le Loup), au demeurant fort arbitraires ou conventionnelles. Cette
remarque est d’importance car elle permet notamment de rendre compte de la
plupart des œuvres contemporaines pour lesquelles il serait difficile, et même
impossible, d’y raccrocher le moindre « analogon », pour reprendre l’expression
de Sartre (ce sont de « nouveaux objets », qui n’ont pas leur équivalent ailleurs).
Quel est donc le rapport qu’entretient le signifiant avec son signifié dans l’œuvre
d’art, et en quoi sa spécificité l’en distingue d’autres discours ? Car après tout,
tous les discours, et en particulier le discours philosophique et le discours
scientifique, relèvent de ce rapport signifié/signifiant. A la différence des sciences
ou de la philosophie où le signifiant (les mots) a une valeur instrumentale précise
et se trouve clairement séparé de ce qu’il signifie (le signifié), dans l’art, le signe
signifie aussi autre chose que lui-même et renvoie à un « monde », mais le
décembre 2011 Page | 5
www.dogma.lu
signifiant porte en lui le signifié, le discours n’est pas séparé de son objet. Le
monde auquel il renvoie est en quelque sorte « l’être même du signe en tant qu’il
s’illimite ». Dire que l’œuvre, c’est ce qui se glisse entre l’œil et la réalité
extérieure, nous propose une image qui rend assez bien compte de ce rapport
particulier avec cette réalité. Le sens et la signification de l’objet d’art n’est pas
« ailleurs », indépendant des signes qui l’expriment : signifiant et signifié sont
dans l’objet. L’objet n’est pas le seul véhicule de l’idée (c’est un peu le sens de ce
que dit Hegel), il est dans son apparaître même. Il prend désormais la place d’une
réalité incontournable, sans laquelle il « manquerait » véritablement quelque
chose à la réalité. L’objet d’art propose un « monde », celui de l’artiste, et
s’impose dans son « impérieuse présence ». L’expression de « réalité
additionnelle » prend tout son sens : non seulement l’objet d’art est représentation
de la réalité (il dit quelque chose à ce sujet), mais il devient une nouvelle partie de
la réalité : quelque chose « manquerait » si Van Gogh, Rembrandt ou Mozart
n’avaient pas existé… La question posé ce soir, à partir de cette analyse, peut
avoir deux réponses de sens très différent : oui, nous pouvons évoquer la valeur
substitutive ou compensatrice de telles œuvres, en tant qu’elles enrichissent ou
embellissent imaginairement la réalité, et peuvent être considérées à ce titre
comme des moyens d’évasion ; non, en tant que réalités additionnelles, elles
participent d’une réalité qu’elles contribuent pour leurs parts à créer…
IV - Apparence et réalité
S’évader de quoi ? La « vie réelle » ou « la vraie vie », c’est quoi ? Quelle est
l’apparence et quelle est la réalité ?
L’évasion évoque la prison ; mais que peut signifier être prisonnier d’une certaine
réalité et désirer sans échapper ? Quel est le véritable statut ontologique de cette
réalité dont on parle ? Trois exemples de théories ou philosophies de l’art peuvent
nous aider à mieux comprendre les enjeux philosophiques de ces questions : celles
de Platon, Schopenhauer, et Nietzsche. Nous développerons davantage la vision
de Nietzsche car elle bouscule radicalement l’opposition traditionnelle de la
réalité et de l’apparence.
Tout d’abord, la théorie de l’art comme mimesis chez Platon. On sait en effet
que ce philosophe va condamner sévèrement la production artistique,
essentiellement sous forme de fables, récits et poèmes, à l’exemple de la célèbre
épopée de l’Iliade et l’Odyssée de Homère. Pourquoi ? L’art est le domaine de
l’apparence et du sensible, opposé à celui des essences et de l’intelligible. Par leur
habileté sophistique, les œuvres attirent et fascinent, abusent les esprits et les
mènent à confondre l’être véritable des choses avec leur apparaître (là encore
opposition logique entre la surface des choses - le paraître - et la profondeur qui
seule permet d’accéder à la vérité). L’art ne fait qu’imiter et glorifier la folie des
hommes, leurs passions et leurs effets dévastateurs (pensons aux tragédies
antiques), incapable de figurer ce qui est précisément infigurable, invisible aux
yeux du corps, et qui ne peut être saisi que par un raisonnement de l’esprit (à
savoir les Idées). (cf. La République, livre X). Mêmes les dieux sont affectés des
mêmes petitesses de celles des humains (par exemple chez Homère ou Hésiode).
décembre 2011 Page | 6
www.dogma.lu
Cette critique radicale doit être resituée dans le cadre de la réflexion platonicienne
sur l’institution de la société bonne (la République platonicienne) et des
conditions sociales de l’éducation de l’homme à la vertu, et Platon était d’ailleurs
favorable à l’exil de la plupart des poètes. L’art produit donc des images
trompeuses, très éloignées de la véritable réalité - la peinture d’un lit est
l’imitation (donc copie affaiblie) du lit fabriqué par l’artisan, qui est lui-même
qu’une imitation (copie dégradée) de l’Idée de lit, donc apparence d’une
apparence -, et par son pouvoir séducteur, détourne les hommes de la vérité. L’art
relève donc de la Caverne, et ne fait que renforcer les chaînes des prisonniers. Il
favorise une fuite ou un détournement de la « vraie vie » (celle à laquelle seule la
raison platonicienne donne accès), et l’enlisement dans le monde des apparences.
Remarquons au passage que Platon inaugure un mode de pensée qui ne va pas
cesser d’opposer à la vie sensible et de quelque façon « ordinaire »,
empiriquement attestée, une « autre vie », un « autre » monde, que l’humanité n’a
jusqu’à présent pas méritée, ou du moins auquel elle n’a pas eu accès. Nous y
reviendrons à propos de Nietzsche.
Chez Schopenhauer, le point de vue est radicalement différent : se référant
toujours à une « réalité véritable » comme Platon – l’Idée, qui désigne la « chose
en soi » (terme hérité de Kant) ou « substratum des phénomènes » - le philosophe
affirme à l’inverse de Platon que seule l’art et la contemplation esthétique sont en
mesure d’y avoir accès. La seule connaissance métaphysique, contrairement à la
raison qui n’accède qu’aux « représentations », permet d’accéder au « noyau » ou
à l’essence du monde, et celle-ci est le domaine de l’art. La raison ne concerne en
effet que « le petit théâtre de notre esprit », comme la couleur dépend de l’œil de
celui qui la voit, et ne se trouve pas « dans » l’objet. Contrairement à la pensée
platonicienne, les apparences sont du côté de la raison et de la conscience. Seul un
rapport direct avec le monde, par la médiation de mon corps et de la sensation,
permet d’aller au-delà des représentations de mon esprit, et de contempler
l’essence intime du monde. C’est une approche de l’intuition pure, qui va
permettre au « génie » de s’oublier pour s’absorber complètement dans la chose.
La métaphysique n’est plus cette « science suprême » en tant que système de
concepts, consacrée par les philosophes, mais un ensemble d’œuvres d’art. La
musique occupe à ce sujet une place privilégiée : son rythme, sa mélodie, sa
tonalité manifesteraient la réalité intime du monde sans intermédiaires. Cette idée
de la musique comme langage de l’être va profondément influencer des
compositeurs comme Wagner, ou des philosophes comme Nietzsche (cf. plus
loin). L’œuvre est ainsi « un clair miroir du monde ». Si nous prenons l’exemple
de la théorie de l’art chez Schopenhauer, après celle de Platon, ce n’est pas pour
discuter de leur pertinence, mais pour montrer comment, à partir d’une thèse
identiquement dualiste sur l’opposition apparence/réalité, Schopenhauer peut
développer une conception de l’art radicalement antagoniste de celle de Platon.
Nous voyons également à partir de ces exemples l’ampleur des variations
d’interprétation concernant les relations de l’œuvre d’art avec la réalité.
Le « oui » à la vie
Un rappel de la philosophie nietzschéenne est nécessaire pour mieux
comprendre la place qu’il accorde à l’art. Avec Nietzsche, c’est l’idée même
décembre 2011 Page | 7
www.dogma.lu
d’opposition entre apparence et réalité qui est radicalement remise en cause, à
partir de la critique de Platon et de ses « arrières-mondes » : celui-ci inaugure la
pensée de tous ceux qui vont faire l’hypothèse d’un monde invisible réputé
« vrai », qui serait opposé aux apparences sensibles. Mais si la « vapeur » d’un tel
monde « vrai » se dissipe, alors celle des apparences se dissipe aussi… Pour
Nietzsche, ce mode de pensée est en réalité la manifestation d’une forme de
nihilisme et de trahison face à la vie et au réel (il n’y a qu’un réel, « unique »,
comme le dit Clément Rosset). Le dualisme platonicien est interprété comme
dépréciation de la vie qui annonce le moment chrétien au nom de l’au-delà. Il
révèle une erreur qui lui est consubstantielle : croire que l’on peut juger la vie
d’un point de vue extérieur à elle, alors que tous nos jugements n’en sont que des
expressions. Nul énoncé philosophique ne saurait, en ce sens, échappait à
l’histoire. Ce parti pris doit être interprété, du point de vue de la généalogie
nietzschéenne, comme une démission et une ignorance pour cause de détresse
face à la vie (la seule qui existe), le refoulement de ce qu’on ne doit pas savoir
pour garder le courage de vivre. Comme le dit N. remarquablement : « Une
condamnation de la vie de la part du vivant n’est jamais que le symptôme d’une
espèce de vie déterminée ». Au contraire l’artiste tragique, à l’instar du héros de la
tragédie grecque (La Naissance de la Tragédie), est celui qui dit « oui » à la vie,
tout en sachant son caractère chaotique et terrible (pour ceux qui ont vu le film
« La guerre est déclarée », la manière dont cette femme et cet homme affronte la
terrible réalité de la maladie de leur petit enfant peut sans doute illustrer
cela).L’artiste tragique est dionysien ; il sait que la vie est affaire tout à la fois de
hasard et de nécessité, qu’elle est chaotique. Contrairement à la réputation
d’irrationaliste souvent attribuée à Nietzsche, l’exigence dans la probité de la
connaissance, la lucidité du savoir sont en quelque sorte sa marque de fabrique ;
(« Le Gai Savoir »). Ce n’est pas au nom de l’irrationalisme que Nietzsche
critique le rationalisme platonicien, mais au nom du véritable savoir, qui est celui
du non-sens et de l’insignifiance de tout ce qui existe, de l’immanence radicale
d’une vie dans son développement (refus de toute explication ou justification
transcendante). Le réel est à la fois absolument nécessaire et absolument fortuit
(thèse développée en particulier dans les ouvrages de Clément Rosset).
Surface et profondeur
L’illusion par excellence selon Nietzsche, c’est l’idée d’un « monde-vérité » qu’il
faudrait opposer au « monde-apparence », comme le monde intelligible s’oppose
au monde sensible. Supprimer cette opposition conduit non pas à revaloriser
l’apparence et l’illusoire (thèse pourtant souvent avancée concernant la pensée de
Nietzsche, mais que Clément Rosset refuse : cf. Notes sur Nietzsche, in « La Joie.
Force majeure »), mais à supprimer l’idée selon laquelle il existerait quelque
chose comme de l’apparence (cette notion ne peut en effet survivre sans ses
opposés, l’invisible et l’essentiel). Désormais, la libération du sensible et de
l’apparence peuvent opérer à travers la libération de l’art ; mais « apparence » ne
signifie plus alors la même chose : l’être est maintenant tout entier dans son
apparaître (souvenons-nous que nous disions la même chose à propos du langage
de l’oeuvre d’art…). Cette question revient à s’interroger sur l’opposition entre
surface et profondeur ; une certaine interprétation de Nietzsche consiste à dire
qu’il s’est efforcé de brouiller les pistes du vrai, perdre tout contact avec la réalité,
décembre 2011 Page | 8
www.dogma.lu
pour donner ses préférences à la surface (aux apparences) plutôt qu’à la
profondeur ; en réalité, s’il privilégie en effet la surface et les apparences, ce n’est
pas contre la profondeur du réel, mais contre la profondeur illusoire et
mensongère de la métaphysique traditionnelle, attachée au « monde vrai » en tant
qu’il s’oppose à l’expérience immédiate. La surface n’est pas opposée à la
profondeur ; elle est au contraire ce qui permet à la profondeur d’être visible
(puisque l’apparaître est le seul mode de présentation de l’être, même si pour
Nietzsche, l’ « être » n’a rien de permanent mais peut prendre une multiplicité de
formes qui relèvent toutes de la volonté de puissance…). Il ne s’agit pas de faire
l’éloge du semblant par rapport au réel, mais de faire l’éloge du réel en tant que
tel. Le rapport de la surface à la profondeur est le même que celui du masque à la
personne masquée (« persona » du verbe latin personare, parler à travers ; le
thème du masque est récurrent dans l’œuvre de Nietzsche). La pensée
philosophique elle-même, mais l’art également, peuvent être interprétés comme
un jeu de masques ; dans « Par-delà Bien et Mal », Nietzsche dit : « Le philosophe
ne peut avoir des opinions ultimes et véritables…. Derrière toute caverne s’ouvre une
caverne plus profonde…. Un « tréfonds » se creuse sous chaque fond, chaque
« fondement » de la pensée. Toute philosophie est une philosophie de façade … Il y a
quelque chose d’arbitraire dans le fait qu’il se soit arrêter ici pour regarder en arrière et
autour de lui, dans le fait qu’il ait cessé ici de creuser plus avant et déposé sa pioche ».
Il n’y a que des interprétations…
Nulle chance en effet pour que nous trouvions un fantomatique « être véritable »
qui serait, conformément aux règles de la raison, transcendant, monde intelligible,
identique à soi (principe d’identité), permanent, éternel, qui ignorerait donc le
changement, la destruction, la lutte, la douleur. Le monde est un chaos et sa réalité
sans fond ; il n’y a pas de connaissance désintéressée d’une réalité objective
placée devant le regard neutre de l’esprit (qui va en restituer la « représentation »
la plus fidèle possible). Toute connaissance est au contraire interprétative et relève
de la volonté de puissance ; cela signifie en particulier une tentative de
domination, « un effort pour s’approprier le chaos d’une réalité qui ne constitue
pas un monde avant que le travail démiurgique de la volonté de puissance ne l’ait
intégré à un ordre, à des structures… ». Il s’agit d’un aménagement suivant le
plan de ses valeurs. Deleuze, profondément influencé par Nietzsche, définit la
tâche de l’art, la science et la philosophie (« Qu’est-ce que la philosophie ? »)
comme tentative « de tirer des plans sur le chaos », non pas refuser ce chaos mais
au contraire y plonger pour y rapporter une « coupe », un « plan », une
« composition » chacune à sa manière, qui est différente. Dans cette perspective,
l’art est l’expression la plus transparente de la vie, de cette volonté de puissance
qui est chez N., nous venons de l’évoquer, « l’essence la plus intime de l’être ».
« Seule vie possible : dans l’Art… »
Les formules de N. ne manquent pas pour dire le rapport de l’art à la vie : « Seule
vie possible : dans l’art. Autrement, on se détourne de la vie. ». Il faut « vivre sa
vie comme une œuvre d’art », « danser » sa vie, « la vie sans la musique serait
une erreur »…etc. Que veut dire N. ? Au moins deux choses importantes :
La première, c’est que l’œuvre d’art est comme l’archétype ou la métaphore de la
vie. Si « derrière nos interprétations, il n’y a pas de fond, mais une abîme »
(Clément Rosset), la création artistique est sans doute le meilleur moyen pour
décembre 2011 Page | 9
www.dogma.lu
créer ainsi des univers qui expriment la multiplicité de ces forces de vie. Libéré
d’un point de vue unique qui serait celui de la vérité, N. nous exhorte à voir le
monde « avec le plus d’yeux possibles ».D’où le caractère vital de l’œuvre d’art,
pour son créateur mais aussi secondairement pour celui qui en jouit. « L’art… est
une augmentation du sentiment de la vie, un stimulant de la vie. » ; N. fait
d’ailleurs souvent le rapprochement entre l’activité de création artistique et
l’activité sexuelle. Il semblerait que pour lui, l’énergie dépensée est la même dans
les deux cas…
La deuxième chose, sans doute la plus importante pour N., c’est que la vie est une
œuvre d’art. Autrement dit, il faut plutôt faire entrer l’art dans la vie, plutôt que de
faire de l’Art « un refuge ultime de la vie ». N. critiquera par exemple l’art comme
catharsis, c’est-à-dire lieu ultime où les pulsions et les émotions vitales viennent
se purger ou se purifier (selon le modèle de la catharsis développée par Aristote) :
il devient alors un refuge ou remplit une fonction de compensation vis-à-vis des
renoncements de la vie, au lieu d’être le prototype de la vie (en réalité, N. ne
semble pas bien connaître l’explication d’Aristote ; nous l’évoquerons
prochainement). Cependant, Nietzsche reprend à son compte la notion de
sublimation : la théorie freudienne qui fait de l’art un moyen de satisfactions
substitutives « en compensation des plus anciennes renonciations culturelles » (in
« Avenir d’une Illusion ») pourrait sans aucun doute avoir l’assentiment de N.
C’est la sublimation qui permet l’orientation de la libido sur des voies détournées,
qui, lorsqu’elle est réussie, est responsable des créations de culture, notamment de
l’Art. Il est le premier à revendiquer ce qu’il appelle « le grand style », qui
implique une hiérarchisation des instincts, et donc aussi certains renoncements (cf.
texte en italique plus loin). Mais retournons à cette pensée centrale chez N. :
« Danser sa vie », « la mettre en musique », jouer sa vie à l’instar de ces héros
tragiques de la tragédie grecque. Puisqu’il n’y a plus de vie meilleure et plus
réelle que cette vie ci, puisqu’il n’y a plus de distinction entre un monde vrai et un
monde faux ou d’apparences, mais que tout est interprétation, l’homme comme
artiste créer ses propres valeurs et sa vie (à condition de ne pas supposer un sujet
libre et autonome derrière ce procès, puisque N. a également développé une
critique radicale de cette idée…). L’absence de vérité transcendante à
l’immanence du plan de vie ne signifie pas que « tout se vaut ». La « belle
forme » doit ici s’imposer, être choisie : l’harmonie, l’équilibre, la cohérence, la
hauteur, sont autant de valeurs qui ont sa préférence (d’où par exemple ces choix
artistiques et musicaux). De ce point de vue la beauté chez Nietzsche est
l’expression « d’une volonté victorieuse, d’une coordination plus intense, d’une
mise en harmonie de tous les désirs violents, d’un infaillible équilibre
perpendiculaire. La simplification logique et géométrique est une conséquence de
l’augmentation de la force. » (La Volonté de Puissance »). Les préconisations
nietzschéennes sont du côté de ce que nous pourrions appeler la « grandeur
morale » qui, bien loin d’aller dans le sens d’un déferlement sans frein des
passions, réside dans une forme d’intensité existentielle rendue possible par cette
hiérarchisation et cette harmonisation des forces vitales. Ce qui conduit, pour
employer une métaphore, à l’élégance, la légèreté, et l’apparente facilité du geste
parfait (par exemple celui du danseur ou du champion de tennis) qui intègre en un
tout harmonieux les différents mouvements et forces requis. Le « grand » homme
est celui qui autorise le déploiement de ses passions sans se laisser dominer par
décembre 2011 Page | 10
www.dogma.lu
elles. Il les domine au contraire, les hiérarchise, mais sans les étouffer. Il est grand
à la fois par l’ampleur du jeu qu’il accorde à ses passions, et par sa capacité à les
dominer. Peut-être une autre image évocatrice pourrait être celle du cavalier et de
sa monture (cf. à ce sujet « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? », «le moment
nietzschéen », de L. Ferry)
« Le monde sans la musique serait une erreur »
Pour mieux faire comprendre ce rapport vital de l’œuvre d’art à l’existence,
examinons avec Clément Rosset la pensée nietzschéenne sur la musique : « Le
monde sans la musique serait une erreur », (in « Crépuscule des Idoles »). Cette
formule est ambiguë car elle pourrait laisser penser qu’elle est « une alternative
offerte au monde en guise de salut ». En réalité, elle signifie tout autre chose : la
musique fait office de témoin du monde ; elle invite à l’approbation de la vie. Il ne
s’agit pas, avec la musique, d’un autre monde pour justifier de ce monde ci. Mais
c’est au sens où la philosophie traditionnelle, de Platon à Kant, n’a cessé de « se
boucher les oreilles » : elle n’a jamais voulu entendre la véritable musique de la
vie ; elle n’a jamais voulu entendre parler, en fin de compte, du réel. La musique
représente l’exemple privilégié du sentiment éprouvé de jubilation vitale,
jouissance comparable et supérieure à tout autre type de jouissance. Non pas
musique-remède, musique-compensation, musique-répit, musique-apaisement par
rapport à l’insuffisance ou à la cruauté du réel (« un peu de musique en plus, un
peu de réalité en moins »). En ce sens en effet, elle serait bien, dans une certaine
mesure, « évasion » ; c’est selon N. l’essence du romantisme. Au contraire, le
classicisme (et N. et de ce point de vue est un « classique ») est au service d’un
sentiment de plénitude face à la vie. La fin véritable de la musique pour N. réside
dans son pouvoir de dire « oui » au monde, dans son « sens du réel ». D’où ses
choix musicaux : l’allégresse inconditionnelle d’un Mozart ou d’un Bizet
(Carmen). Dans un texte remarquable, N. nous explique comment
l’apprivoisement de la vie et l’apprentissage de son approbation ressemble en tous
points à l’apprentissage du goût musical à travers « l’acclimatation » d’une
mélodie : lecture p 50, in « La force majeure ». Apprendre à aimer le monde,
jusqu’à souffrir de son absence, c’est la même chose que de s’habituer
progressivement à une mélodie au départ étrange, mais qui finit par devenir
indispensable. A l’issue de ce développement sur la façon dont la philosophie de
l’art envisage les relations de l’œuvre d’art avec la réalité du monde, nous voyons
bien le caractère très relatif de ce que nous pouvons entendre par « évasion » ou
« réalité vraie » : chez Platon par exemple, l’évasion salutaire ou le
« désengluement » des apparences sensibles au profit d’un mouvement
dialectique ascendant vers les Idées est le contraire d’une évasion coupable de la
vie réelle (entendu comme la vie empirique du quotidien). Mais quelque soit le
jugement porté sur l’art, celui-ci apparaît toujours comme connecté avec une
réalité, indépendamment du statut ontologique de cette dernière. Avec Nietzsche,
l’art apparaît comme archétype de la vie même : même s’il peut être parfois un
refuge ultime par rapport à la vie, il est avant tout, et doit être, l’expression de la
vie dans ce qu’elle a de plus essentiel. En ce sens, l’art comme évasion ou
détournement de la vie ne pourrait être que sévèrement condamné par lui.
décembre 2011 Page | 11
www.dogma.lu
V - L’art comme consommation culturelle et l’ambiguïté de
l’appel aux affects
Terminons sur un retour à une considération plus « sociologique » sur le statut ou
la place de l’art et des pratiques artistiques dans la société contemporaine. Si,
comme le dit E. Morin, le clivage est profond entre état prosaïque et état poétique,
nous pouvons faire l’hypothèse qu’un tel cloisonnement, qui fait de la
consommation artistique une pratique culturelle de masse à part entière dans le
cadre du temps libre et des loisirs (à travers en particulier les expositions),
relativement isolée des autres pratiques sociales, favorise dans une certaine
mesure une expérience esthétique comme divertissement. Si nous considérons à
nouveau l’apparition du musée, nous avons précédemment constaté qu’il a en
quelque sorte arraché les objets d’art à leurs traditions, ceux-ci ne s’intégrant plus
désormais naturellement dans le réseau de relations où leur sens a surgi. La
naissance de cette nouvelle discipline, l’esthétique, et de l’idée de « beau » qui lui
est associé, est tout simplement contemporaine de ce souci moderne qui retranche
de l’expérience des œuvres tout ce qui revêtait une dimension morale, sociale,
religieuse et politique ; le musée dénude en quelque sorte les œuvres, en isolant
cette seule dimension du goût (lire à ce sujet le texte « Art et poésie » in Notions
de Philosophie III, Claire Brunet). Objet de la délectation esthète, l’œuvre d’art
risque d’en perdre sa dimension civilisationnelle. L’art en réalité, comme le dit
Walter Benjamin, modèle l’ensemble de notre expérience au cours du temps, et ne
peut se réduire à un simple vécu individuel et ponctuel. Les œuvres ne seraient
être simplement les stimuli de nos émotions égotistes, fussent-elles d’une grande
puissance affective. L’art réduit à la production d’une effervescence psychique,
d’une satisfaction psychologique de ses destinataires, représenterait pour
Nietzsche la « perversion esthétique » type de la question de l’Art (c’est Wagner
qui est ici particulièrement visé). Nous retrouvons ici la critique de la conception
cathartique de l’art qui peut s’accommoder fort bien de cette « art-refuge » ou
« art-évasion » (nous allons voir néanmoins que c’est au prix d’une distorsion de
la théorie initiale). Les œuvres incarnent une dimension plus ample que cette
dimension cathartique personnelle : celle des civilisations ; leur espace n’est pas
seulement le moi et son égoïsme perceptif, mais plus fondamentalement l’espace
du monde, de l’histoire. La seule manière d’arracher la contemplation des œuvres
aux seuls miroitements du moi est de rappeler leur sens de tradition. C’est en
reportant les coordonnées de la subjectivité sur l’axe de l’histoire, en resituant
l’œuvre comme œuvre et témoin de civilisation où l’humanité s’interroge sur le
monde et sur elle-même (il n’y a pas de différence sensible ici entre l’art et la
philosophie) que nous pouvons retrouver les liens indéfectibles qui la rattache à
nos vies communes. Mais nous ne pouvons-nous empêcher de penser qu’avec
l’atténuation des frontières entre les œuvres de « grande culture » et les
productions de la culture de masse, avec la prolifération des images de cette
« culture-écran » qui caractérise notre culture-monde (cf. notre précédent texte sur
la culture mondialisée), dans une société marquée de l’empreinte de l’hyper-
individualisme et l’hyperconsommation, fuir et se distraire, par l’intermédiaire en
particulier de l’immense production cinématographique de « block-masters » ou
autres jeu-vidéos qui nous font vivre par procuration de puissantes émotions liées
souvent aux désirs de toute-puissance les plus fous, relèvent de logiques où
l’imaginaire entretient des liens de plus en plus ténus avec nos existences
décembre 2011 Page | 12
www.dogma.lu
réelles… C’est parce que le processus de catharsis (purgation ou purification des
sentiments), tel qu’il est décrit par Aristote, fonctionne précisément en instaurant
une distance entre les affects qui traversent l’histoire de ma vie, et leur
représentation scénique (pour Aristote, il s’agissait essentiellement du théâtre et
de la tragédie), qu’elle permet une conversion en moi de la confusion en une plus
grande lucidité, d’une ignorance en connaissance. Rien de tout cela ici, tant nous
sommes projetés dans des mondes virtuels où tout est possible, qui laissent libre
cours au torrent pulsionnel. Mais cette tendance actuelle des grandes productions
américaines ou de la publicité peut-elle être encore rattachée à l’art ?
Probablement que non. D’autant qu’il ne s’agit pas, dans la plupart des cas, de
jouissance esthétique, quelle que soit par ailleurs la puissance affective d’un tel
« déversement ».
décembre 2011 Page | 13
Vous aimerez peut-être aussi
- Adobe Illustrator CC Le Support de Cours OfficielDocument479 pagesAdobe Illustrator CC Le Support de Cours OfficielAly Bernard Ndiaye86% (7)
- Le Regard de La Pensée. Philosophie de La Représentation by Pierre Guenancia - Z Lib - OrgDocument427 pagesLe Regard de La Pensée. Philosophie de La Représentation by Pierre Guenancia - Z Lib - Orgsandrosnogueira100% (1)
- Mimesis Et CatharsisDocument5 pagesMimesis Et CatharsisGermano CesarPas encore d'évaluation
- Les Théoriciens de Lart (Talon-Hugon, Carole)Document757 pagesLes Théoriciens de Lart (Talon-Hugon, Carole)Dieune LouisPas encore d'évaluation
- Impressionnisme Et LittératureDocument236 pagesImpressionnisme Et LittératureMohamed Lehdahda0% (1)
- Cours Art PDFDocument16 pagesCours Art PDFAhmedCommunistePas encore d'évaluation
- L'art Et La RéalitéDocument15 pagesL'art Et La RéalitéNakch MecheriaPas encore d'évaluation
- Jean Onimus - Etrangeté de Lart - JerichoDocument143 pagesJean Onimus - Etrangeté de Lart - JerichoMohammed LakhalPas encore d'évaluation
- ELLUL Jacques - 1980 - L'empire Du Non-Sens PDFDocument285 pagesELLUL Jacques - 1980 - L'empire Du Non-Sens PDFEric Ellul100% (1)
- Cours Sur L'art - DBDocument9 pagesCours Sur L'art - DBCharlotte BressandPas encore d'évaluation
- MALDINEY, Henri. L'Imagination.Document26 pagesMALDINEY, Henri. L'Imagination.Renato MenezesPas encore d'évaluation
- Esthétique de La Rencontre Lénigme de Lart Contemporain - Baptiste Morizot Estelle Zhong Mengual - ZDocument147 pagesEsthétique de La Rencontre Lénigme de Lart Contemporain - Baptiste Morizot Estelle Zhong Mengual - ZSânziana Cristina Dobrovicescu100% (1)
- Manifeste du surréalisme d'André Breton (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandManifeste du surréalisme d'André Breton (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Ue201718 213 S3 PDFDocument120 pagesUe201718 213 S3 PDFIman FalahPas encore d'évaluation
- Immunite CoursDocument14 pagesImmunite CoursJulien GhandourPas encore d'évaluation
- ESCOUBAS - Le Phenomene Et Le Rythme - L'esthetique D'henri MaldineyDocument9 pagesESCOUBAS - Le Phenomene Et Le Rythme - L'esthetique D'henri MaldineyJacky TaiPas encore d'évaluation
- PNL - SubmodalitesDocument7 pagesPNL - SubmodalitessoriboPas encore d'évaluation
- DEOTTE Jean Louis L Epoque Des AppareilsDocument181 pagesDEOTTE Jean Louis L Epoque Des AppareilsMarcela Rivera Hutinel100% (1)
- Sup Deco Institut Mercure Cours Compta AnalytiqueDocument57 pagesSup Deco Institut Mercure Cours Compta AnalytiqueCheikhou Dia100% (1)
- Art-Pie 1er Régiment d'Artillerie-à-Pied (Dunkerque, Calais, Boulogne)Document22 pagesArt-Pie 1er Régiment d'Artillerie-à-Pied (Dunkerque, Calais, Boulogne)DUCHAUSSOYPas encore d'évaluation
- Éléments D'une Théorie Sociologique de La Perception ArtistiqueDocument26 pagesÉléments D'une Théorie Sociologique de La Perception ArtistiqueKarla Schmidt100% (1)
- Ernest Ansermet - La Condition de L'oeuvre D'artDocument31 pagesErnest Ansermet - La Condition de L'oeuvre D'artcorujinha11Pas encore d'évaluation
- Art Et Mésologie / Didier Rousseau-NavarreDocument10 pagesArt Et Mésologie / Didier Rousseau-NavarreYoann MoreauPas encore d'évaluation
- AxesDocument6 pagesAxesAnne TranchandPas encore d'évaluation
- Dissertation PHILODocument3 pagesDissertation PHILOlolotte bunelPas encore d'évaluation
- Forum de L e Ducation Artistique Et Culturelle - Art de L Image - Image de L ArtDocument8 pagesForum de L e Ducation Artistique Et Culturelle - Art de L Image - Image de L ArtSamia GallahPas encore d'évaluation
- Synthese Cours ArtDocument8 pagesSynthese Cours Artmavrinissue4Pas encore d'évaluation
- Fonctions de L'artDocument3 pagesFonctions de L'artJean Grumbach100% (2)
- DantoDocument3 pagesDantosabinaantoniaPas encore d'évaluation
- MALDINEY ESCOUBAS L'Esthétique D'henry Maldiney. Le Phénomène Et Le Rythme (Phainomenon)Document10 pagesMALDINEY ESCOUBAS L'Esthétique D'henry Maldiney. Le Phénomène Et Le Rythme (Phainomenon)lectordigitalisPas encore d'évaluation
- 1 - Théories Et Esthétique Des Arts !Document16 pages1 - Théories Et Esthétique Des Arts !DAFSGHJPas encore d'évaluation
- L'Art Comme Fait Social Total - Dominique ChateauDocument25 pagesL'Art Comme Fait Social Total - Dominique ChateauAcohenPas encore d'évaluation
- Le Spectateur Émancipé de Jacques Rancière : Comptes - RendusDocument6 pagesLe Spectateur Émancipé de Jacques Rancière : Comptes - RendusDora MaarPas encore d'évaluation
- Dans Quel Monde Vît L'artiste (Dissertation de Philo)Document7 pagesDans Quel Monde Vît L'artiste (Dissertation de Philo)hooehoPas encore d'évaluation
- L'Art Est-Il Une Reproduction de La Nature Ou Une InventionDocument8 pagesL'Art Est-Il Une Reproduction de La Nature Ou Une InventionΑντριάννα ΚαραβασίληPas encore d'évaluation
- L'Art Doit-Il Être Forcément EngagéDocument3 pagesL'Art Doit-Il Être Forcément EngagéJulien SorelPas encore d'évaluation
- Dissert PhiloDocument5 pagesDissert Philodorsara6Pas encore d'évaluation
- I - Nature Et Sens de L'art: SéquencesDocument4 pagesI - Nature Et Sens de L'art: SéquencesFatima ElPas encore d'évaluation
- Art Et Politique - Ce Que Change L'art - Contextuel - Paul - ArdenneDocument10 pagesArt Et Politique - Ce Que Change L'art - Contextuel - Paul - ArdenneLauraTortosaIbañezPas encore d'évaluation
- JL. Marion, La Beauté, Article Communio Août 2020 BISDocument12 pagesJL. Marion, La Beauté, Article Communio Août 2020 BISJean-marcRouvièrePas encore d'évaluation
- ART Cours Prise de NotesDocument9 pagesART Cours Prise de NotesJade BouteillerPas encore d'évaluation
- Anthologie de Sujets Et de Textes Sur L'artDocument11 pagesAnthologie de Sujets Et de Textes Sur L'artFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- L'art Se Doit Il D'être Moral Et ÉthiqueDocument5 pagesL'art Se Doit Il D'être Moral Et Éthiquezayzia8Pas encore d'évaluation
- Introduction - Baillet-RegnaultDocument7 pagesIntroduction - Baillet-RegnaultEye Line BrnPas encore d'évaluation
- Ji-Yoon Han - "Résistance Des Lucioles Review of Survivance Des Lucioles de Georges Didi-Huberman"Document3 pagesJi-Yoon Han - "Résistance Des Lucioles Review of Survivance Des Lucioles de Georges Didi-Huberman"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Le Surréalisme Et L'extraordinaireDocument10 pagesLe Surréalisme Et L'extraordinaireSarah LourmePas encore d'évaluation
- Art ImitationDocument6 pagesArt ImitationFady ABDELNOURPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de FranceDocument5 pagesPresses Universitaires de FranceAhmed NabilPas encore d'évaluation
- Phénoménologie de L'expérience Esthétique - Dufrenne, Mikel - Volume 1, 1967 - Paris, Presses Universitaires de FranceDocument432 pagesPhénoménologie de L'expérience Esthétique - Dufrenne, Mikel - Volume 1, 1967 - Paris, Presses Universitaires de FranceGuilhem PoussonPas encore d'évaluation
- L'art, La Science, La Technique: L'image Photographique Comme Objet Anxieux de La Modernité EsthétiqueDocument20 pagesL'art, La Science, La Technique: L'image Photographique Comme Objet Anxieux de La Modernité Esthétiquelapi fabiPas encore d'évaluation
- DeDocument2 pagesDeDiary BaPas encore d'évaluation
- Crise RpztationDocument10 pagesCrise RpztationMelissa OrtegaPas encore d'évaluation
- Philo Quand Y'a T'il Art ?Document2 pagesPhilo Quand Y'a T'il Art ?kaoutar3377Pas encore d'évaluation
- 1 - M25, Gr1-2, S04, Histoire Des Idées Et Des Arts, PR - FarqzaidDocument45 pages1 - M25, Gr1-2, S04, Histoire Des Idées Et Des Arts, PR - FarqzaidTar OuadPas encore d'évaluation
- Bibliographie - Théorie de L'art ComtemporainDocument23 pagesBibliographie - Théorie de L'art ComtemporainAhmed KabilPas encore d'évaluation
- Romain Bernini - Sortir de SoiDocument4 pagesRomain Bernini - Sortir de Soijuangarciaporrero1973Pas encore d'évaluation
- Bac S Sujets de Philosophie PDFDocument4 pagesBac S Sujets de Philosophie PDFFamara DiedhiouPas encore d'évaluation
- Devant:Dedans: Déborder La Vue Daniel BougnouxDocument3 pagesDevant:Dedans: Déborder La Vue Daniel BougnouxSimon Le Roux GödelPas encore d'évaluation
- 2 Cours EsthétiqueDocument15 pages2 Cours EsthétiqueIzaquiel SoaresPas encore d'évaluation
- Parcours Pédagogique - Roland BarthesDocument12 pagesParcours Pédagogique - Roland BarthesWriterIncPas encore d'évaluation
- Poly Art CoursDocument13 pagesPoly Art CoursMoustapha SarrPas encore d'évaluation
- Denis LevyDocument251 pagesDenis LevyLuís BernardoPas encore d'évaluation
- CM - Philosophie de L - Art (Maubert)Document19 pagesCM - Philosophie de L - Art (Maubert)cecilie.poirot05Pas encore d'évaluation
- Les Arts Se Font Les Uns Contre Les Autres Jean-Luc NancyDocument8 pagesLes Arts Se Font Les Uns Contre Les Autres Jean-Luc NancyAna CancelaPas encore d'évaluation
- Orca Share Media1665893076510 6987261994381431194Document7 pagesOrca Share Media1665893076510 6987261994381431194Yosr MahmoudPas encore d'évaluation
- JACQUES MORIZOT L Art de La SymbolisationDocument19 pagesJACQUES MORIZOT L Art de La Symbolisationlapi fabiPas encore d'évaluation
- L'objet de L'artDocument1 pageL'objet de L'artlapi fabiPas encore d'évaluation
- Comprendre Art Les Arts Le Monde de ArtDocument1 pageComprendre Art Les Arts Le Monde de Artlapi fabiPas encore d'évaluation
- John Dewey, L'existence Incertaine Des Publics Et L'art Comme Critique de La VieDocument15 pagesJohn Dewey, L'existence Incertaine Des Publics Et L'art Comme Critique de La Vielapi fabiPas encore d'évaluation
- Comprendre Évaluer Prévenir Pratique Enseignement Et Recherche Face À L'erreur Et À La Faute en TraductionDocument21 pagesComprendre Évaluer Prévenir Pratique Enseignement Et Recherche Face À L'erreur Et À La Faute en Traductionlapi fabiPas encore d'évaluation
- Le Tournant Esthétique de La PhilosophieDocument5 pagesLe Tournant Esthétique de La Philosophielapi fabiPas encore d'évaluation
- La Place Objective de La Beauté ArtisitiqueDocument22 pagesLa Place Objective de La Beauté Artisitiquelapi fabiPas encore d'évaluation
- La Philosophie de L'artDocument5 pagesLa Philosophie de L'artlapi fabiPas encore d'évaluation
- Art Cours TextesDocument12 pagesArt Cours Texteslapi fabiPas encore d'évaluation
- Philosophie Art Et Litterature A La Fin Du Xix Siecle - CompressDocument25 pagesPhilosophie Art Et Litterature A La Fin Du Xix Siecle - Compresslapi fabiPas encore d'évaluation
- Art Musical Et Philosophie Dans Le Grand Traité de La Musique d'Al-Fārābī (IXe-Xe Siècles), Traduit Du Kitābu L-Mūsīqī Al - KabīrDocument85 pagesArt Musical Et Philosophie Dans Le Grand Traité de La Musique d'Al-Fārābī (IXe-Xe Siècles), Traduit Du Kitābu L-Mūsīqī Al - Kabīrlapi fabiPas encore d'évaluation
- Enoncé de Philosophie Pour L'enseignementDocument24 pagesEnoncé de Philosophie Pour L'enseignementlapi fabiPas encore d'évaluation
- Corrige Sujets Philosophie Bac 2021 Amerique Nord 2Document13 pagesCorrige Sujets Philosophie Bac 2021 Amerique Nord 2lapi fabiPas encore d'évaluation
- Les Stratégies de Traduction Dans Les Cultures Positions Théoriques Et Travaux RécentsDocument10 pagesLes Stratégies de Traduction Dans Les Cultures Positions Théoriques Et Travaux Récentslapi fabiPas encore d'évaluation
- Le Management: Un Art Ou Une Science?Document15 pagesLe Management: Un Art Ou Une Science?lapi fabiPas encore d'évaluation
- Philosophie Et Art D'écrireDocument14 pagesPhilosophie Et Art D'écrirelapi fabiPas encore d'évaluation
- La Philosophie de L"artDocument12 pagesLa Philosophie de L"artlapi fabiPas encore d'évaluation
- L'art Après La PhilosophieDocument16 pagesL'art Après La Philosophielapi fabiPas encore d'évaluation
- L'enseignement: Art Ou Science ?Document3 pagesL'enseignement: Art Ou Science ?lapi fabiPas encore d'évaluation
- Philo Commun ÉcritDocument4 pagesPhilo Commun Écritlapi fabiPas encore d'évaluation
- L'art, La Science, La Technique: L'image Photographique Comme Objet Anxieux de La Modernité EsthétiqueDocument20 pagesL'art, La Science, La Technique: L'image Photographique Comme Objet Anxieux de La Modernité Esthétiquelapi fabiPas encore d'évaluation
- L'ArtDocument18 pagesL'Artlapi fabiPas encore d'évaluation
- Marius 2Document92 pagesMarius 2lapi fabiPas encore d'évaluation
- Art Et Science, Deux Façons de Percevoir Le Monde.Document10 pagesArt Et Science, Deux Façons de Percevoir Le Monde.lapi fabiPas encore d'évaluation
- Un Projet Art Et Science Article Site AcademiqueDocument10 pagesUn Projet Art Et Science Article Site Academiquelapi fabiPas encore d'évaluation
- Art Et ScienceDocument10 pagesArt Et Sciencelapi fabiPas encore d'évaluation
- La Connaissance Scientifique Aux Frontières Du Bio-Art: Le Vivant À L'ère Du Post-NaturelDocument25 pagesLa Connaissance Scientifique Aux Frontières Du Bio-Art: Le Vivant À L'ère Du Post-Naturellapi fabiPas encore d'évaluation
- À L'intersection de L'art, La Science Et La TechnologieDocument6 pagesÀ L'intersection de L'art, La Science Et La Technologielapi fabiPas encore d'évaluation
- ART and SCIENCEDocument44 pagesART and SCIENCElapi fabiPas encore d'évaluation
- Le Soleil Et MoiDocument16 pagesLe Soleil Et Moilapi fabiPas encore d'évaluation
- DS1 4si2 2015-2016Document2 pagesDS1 4si2 2015-2016PROF PROFPas encore d'évaluation
- 2008 Position de L'exiléDocument25 pages2008 Position de L'exilé1234Pas encore d'évaluation
- 37 Denombrements CorrigeDocument10 pages37 Denombrements CorrigeYassine BenabdellahPas encore d'évaluation
- E Vocabulaire GeometriqueDocument23 pagesE Vocabulaire Geometriqueadel kaisPas encore d'évaluation
- Dwnload Full Analog Circuit Design Discrete and Integrated 1st Edition Franco Solutions Manual PDFDocument36 pagesDwnload Full Analog Circuit Design Discrete and Integrated 1st Edition Franco Solutions Manual PDFlincolnrod80100% (16)
- 10 29000-Rumelide 817008-1366091Document19 pages10 29000-Rumelide 817008-1366091gnouna12Pas encore d'évaluation
- COUR DE COMPTES TOGO AUDIT Thème 1Document42 pagesCOUR DE COMPTES TOGO AUDIT Thème 1Pascal SindiePas encore d'évaluation
- L'impact Du Choix Des FournisseursDocument9 pagesL'impact Du Choix Des FournisseursMamadou SYPas encore d'évaluation
- Le Management de La Force de Vente Support 2Document73 pagesLe Management de La Force de Vente Support 2Soufiane Cherif100% (1)
- 20 Pages Part 3 - Trajectoire Decarbonation Du MarocDocument20 pages20 Pages Part 3 - Trajectoire Decarbonation Du MarocIsmail LamriniPas encore d'évaluation
- Examen Eoae 2 Bac Eco 2012 Session Rattrapage CorrigeDocument4 pagesExamen Eoae 2 Bac Eco 2012 Session Rattrapage CorrigeAhmed Hassan SkifaPas encore d'évaluation
- Cordiérite-Mullite 1 PDFDocument10 pagesCordiérite-Mullite 1 PDFkhalidPas encore d'évaluation
- BUDAI Erika - Les SirenesDocument9 pagesBUDAI Erika - Les SirenesHélène RichardeauPas encore d'évaluation
- 11 Technique D'expression3Document17 pages11 Technique D'expression3Imene BrbPas encore d'évaluation
- Passerelle Primaire Admis 2023-2024Document6 pagesPasserelle Primaire Admis 2023-2024Chaymah ChoubouPas encore d'évaluation
- Architecture J2 EEDocument27 pagesArchitecture J2 EEFaiçal YahiaPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu Diagnostic Et ExpertiseDocument23 pagesCompte-Rendu Diagnostic Et ExpertiseM'hamdi EzdiharPas encore d'évaluation
- MONS Rue de Nimy (TEC) MONS Grands Prés (TEC) : Votre Trajet en Quelques ChiffresDocument1 pageMONS Rue de Nimy (TEC) MONS Grands Prés (TEC) : Votre Trajet en Quelques ChiffresPernelle DPas encore d'évaluation
- Dossier Technique RéviséDocument10 pagesDossier Technique RéviséJalal Ke100% (2)
- Plan de Travail 3Document1 pagePlan de Travail 3Fabienne GillardPas encore d'évaluation
- Dossier Complet Belles Plantes Scolaires Textes Fiches PedagogiquesDocument59 pagesDossier Complet Belles Plantes Scolaires Textes Fiches Pedagogiquesjosdiakiese950Pas encore d'évaluation
- Calendrier Previsionnel These 1.2Document5 pagesCalendrier Previsionnel These 1.2Wassim CharmantPas encore d'évaluation
- Ces Aliments Que L'on Peut Consommer Après La Date de Péremption - Santé MagazineDocument3 pagesCes Aliments Que L'on Peut Consommer Après La Date de Péremption - Santé MagazinekiamgoPas encore d'évaluation
- Du de La Des de de L ExercisesDocument2 pagesDu de La Des de de L Exercisesapi-262811896Pas encore d'évaluation