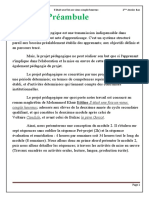Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse Linéaire de Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Mort de Manon
Analyse Linéaire de Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Mort de Manon
Transféré par
junkie20012Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Analyse Linéaire de Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Mort de Manon
Analyse Linéaire de Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Mort de Manon
Transféré par
junkie20012Droits d'auteur :
Formats disponibles
Séance n°5 : La mort de Manon
Introduction
Présentation de l’extrait :
Manon Lescaut de l’abbé Prévost est publiée en 1731. Ce roman qui est fait scandale et est interdit entre 1733 et
1735. Constituant le septième et dernier tome des Mémoires et aventures d’un homme de qualité qui s’est retiré
du monde. Ce roman raconte les aventures de deux jeunes amoureux : le chevalier Des Grieux et Manon
Lescaut. Selon son auteur il est un traité de morale sur les dangers de la passion.
Dans cet excipit, des Grieux achève son récit à Renoncour, l’homme de qualité. Manon et des Grieux vivent
enfin des moments heureux et en paix, jusqu’à ce que le gouverneur du village décide de marier son fils,
Synnelet à Manon. Des Grieux se bat en duel avec Synnelet, et pensant l’avoir tué, s’enfuit avec Manon dans le
désert. Dans ce désert, Manon meurt d’épuisement.
Ce célèbre passage est émouvant et tragique à la fois, puisque nous assistons à la mort de l’héroïne, à laquelle
nous nous sommes attachés durant le roman, que cette mort est racontée par son amant. Loin de fonctionner
comme une condamnation morale, ce dénouement offre à Manon la possibilité d’une rédemption : Manon meurt
comme une sainte.
Problématique : Comment le récit de des Grieux fait-il de la mort de Manon un épisode pathétique et édifiant à
la fois ?
Plan :
L. 1 à 6 : Des Grieux multiplie les détours langagiers comme pour retarder le récit de la mort de Manon qui est,
pour lui, une nouvelle épreuve.
L. 7- 14 : Le récit de la mort d’une sainte
L. 14-17 : Un récit euphémisé et pathétique
L. 18-20 : La poignante solitude de des Grieux
I- L. 1 à 6 : Des Grieux multiplie les détours langagiers comme pour retarder le récit de la mort
de Manon qui est, pour lui, une nouvelle épreuve.
Même un an après la mort de Manon, Des Grieux éprouve une réelle difficulté à raconter cet événement.
C’est pourquoi, dans ces deux premiers paragraphes, il en retarde le récit.
1. La première phrase du passage amorce le récit de la mort de Manon.
« Je passai la nuit entière à veiller près d’elle, et à prier le Ciel de lui accorder un sommeil doux et
paisible.».
Il s’agit d’un récit rétrospectif, mené aux temps du passé : passé simple (« passai ») et imparfait
(« étaient ») et plus-que -parfait (« aviez résolu »).
Des Grieux se montre dévoué et tente de sauver sa maîtresse : « passai la nuit à veiller ».
2. Mais rapidement, dès la deuxième phrase, Des Grieux interrompt ce récit et s’adresse à Dieu.
l’apostrophe « Ô Dieu ! » + discours direct → marques du lyrisme : à travers cette interjection, des
Grieux exprime sa souffrance.
Cette prière reste vaine et le Ciel refuse par un « rigoureux jugement », telle une punition, d’accéder
aux « vœux » de des Grieux.
3. Il s’adresse ensuite directement à Renoncour, le destinataire principal de son récit.
Il s’agit d’une rupture narrative qui vise à mobiliser l’attention du lecteur et créer un effet d’attente.
Le marquis de Renoncour, « l’homme de qualité » est le destinataire immédiat de Des Grieux (récit-
cadre) : « Pardonnez, si j’achève en peu de mots un récit qui me tue. »
Il s’adresse à lui au discours direct, au présent « j’achève », « tue » (moment de l’énonciation).
Il emploie l’impératif « pardonnez » à la deuxième personne du pluriel. On notera qu’à travers
Renoncour, c’est au lecteur qu’il s’adresse aussi.
Cet impératif sonne comme une supplication à travers laquelle il supplie de comprendre,
d’éprouver de la compassion pour lui.
4. enfin, il évoque son traumatisme.
L’émotion que ressent Des Grieux à raconter l’épisode de la mort de Manon semble « sincère » : « Ô
Dieu ! que mes vœux étaient vifs et sincères !»
Cette émotion est due à la violence du traumatisme : propos hyperboliques du narrateur : « un malheur
qui n’eut jamais d’exemple », « je le porte sans cesse dans ma mémoire », « qui me tue »
Des Grieux emploie le champ lexical de la narration (« peu de mots », « un récit », « je vous raconte »,
« l’exprimer ») lié à celui de l’horreur (« me tue », « un malheur », « reculer d’horreur »). Ce récit de la
mort de Manon reste une véritable torture pour lui, qui est obligé de revivre la scène avec les mêmes
émotions. D’ailleurs, c’est « le récit » qui est le sujet du verbe « tue ».
Tous ces procédés visent à renforcer le pathétisme.
=˃ Ces détours du langage et la sobriété du récit obligent le lecteur à ressentir de l’empathie pour Des
Grieux et le contraint aussi à imaginer l’épisode de la mort de Manon
Ces détours de langage étant faits, Des Grieux retrouve alors la maîtrise de sa narration (II).
II. L7 à 15 : Le récit de la mort d’une sainte
1. La perception progressive de la mort de Manon
Tout d’abord, le paragraphe débute par une phrase paisible : « Nous avions passé tranquillement
une partie de la nuit. » L’adverbe « tranquillement » contribue à la dramatisation de l’épisode puisqu’il
s’oppose à ce qui va suivre.
Puis, alors que des Grieux « croyai[t] » vivre une scène paisible, le lecteur comprend que la situation
risque de prendre une tournure dramatique. C’est le vocabulaire des sensations qui permet au
lecteur de le comprendre : « moindre souffle », « mains froides et tremblantes » que des Grieux tente
d’« échauffer ».
Enfin, c’est des Grieux qui en prend conscience :
o deni de des Grieux qui il ne saisit pas le tragique de la situation + champ lexical du sommeil dans
son récit : « endormie », « sommeil », « tranquillement » : CDG pense que Manon est simplement
fatiguée par cette longue marche dans le désert.
o C’est seulement à la fin du paragraphe, qu’il réalise que Manon va mourir. En effet, le conjonction
de coordination « Mais » montre changement dans pensée CDG :groupe verbal « fit connaître » et
le champ lexical de la mort
2. A travers ce récit de la mort de Manon, Des Grieux décrit une passion absolue.
Des Grieux apparaît transit d’amour
o Durant l’agonie de Manon, Des Grieux se montre entièrement dévoué à sa : il protège son
sommeil, tente de la réchauffer et lui prodigue « les tendres consolations de l’amour ».
Mais Des Grieux insiste également sur la réciprocité de cet amour :
o Cette réciprocité se manifeste surtout par les gestes, puisque Manon est pratiquement
privée de parole : « pour saisir les miennes »/ « le serrement de ses mains »/ « continuait de
tenir les miennes ».
Manon à ce moment, accepte l’amour de des Grieux, ce qu’elle avait toujours refusé jusqu’alors.
3. Manon est sublimée à travers le récit de des Grieux.
Ce récit se rapproche d’un discours funèbre tant il est élogieux à l’égard de Manon.
Au moment de sa mort, le portrait de Manon, qu’en fait des Grieux, change. En effet, tout au long
du roman, nous avons vu une Manon très attachée au plaisir, mais aussi pécheresse, immorale.
Dans ce passage, elle apparaît à travers le champ lexical de la tranquillité (« tranquillement »,
« endormie ») très stoïque face à la mort, elle accepte son sort ; elle apparaît courageuse.
III. L15 à 17 : un récit euphémisé et pathétique
1. Le récit est à nouveau interrompu par une adresse directe à Renoncour
« N’exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières
expressions. » A nouveau, des Grieux interrompt son récit et s’adresse directement à Renoncour, ce
qui nous rappelle que nous sommes dans un récit-cadre (récit qui sert de cadre à un récit enchâssé).
Cette adresse peut d’ailleurs paraître surprenante puisque Renoncour n’intervient pas !
Cette adresse souligne l’ellipse faite par Des Grieux : son silence sur les « sentiments » et les
« dernières expressions » de Manon
Cette adresse sonne comme une supplication à travers l’emploi de l’impératif, « n’exigez » ; un appel
à l’empathie de Renoncour (et aux lecteurs) amené(s) à partager les sentiments et la douleur de des
Grieux.
2. Surtout, le moment même de la mort de Manon est raconté avec sobriété et pudeur…
Des Grieux interrompt son récit, manière pudique de montrer que sa souffrance est trop grande
pour être racontée ou par crainte de raviver la souffrance en donnant des détails ou encore pour
garder en lui les souvenirs les plus intimes et sacrés. On relève deux déclarations de réticences
« N’exigez pas de moi » et « c’est tout ce que j’ai la force de vous raconter » et le moment même de la
mort de Manon se résume à deux phrases très courtes.
« Je la perdis ; je reçus d’elle des marques d’amour, au moment même qu’elle expirait. » : par le biais
d’une ellipse narrative, le moment critique de la mort est soustrait au lecteur.
De plus, par pudeur, des Grieux multiplie les euphémismes :
o « je la perdis » : il s’agit d’un euphémisme (= elle mourut) qui suggère la mort de manière sobre et
épurée.
o De même, « je reçus des marques d’amour » sonne comme un euphémisme empli de sensualité qui
montre Manon aimante au moment de sa mort.
o « Ce fatal et déplorable événement » : il s’agit d’une périphrase euphémistique pour désigner la
mort.
3. … ce qui renforce le pathétisme du récit
A ce moment tragique du récit, des Grieux amène le lecteur à ressentir la souffrance du narrateur et de la
pitié pour Manon.
« au moment même » : complément circonstanciel de temps qui montre la simultanéité. Manon qui
meurt alors qu’elle aime, qu’ils pourraient vivre heureux, c’est maintenant qu’elle est prête à vivre un
amour pur, sincère, sans histoire.
L’adjectif « fatal » qui désigne le destin est associé à « déplorable » (= pleurer sur, regretter), le
tragique est donc associé au pathétique d’autant que ces deux adjectifs sont rejetés en fin de phrase.
IV. L18 à 20 : la poignante solitude de des Grieux .
La solitude de Des Grieux se manifeste tout d’abord par la présence des pronoms personnels « je »,
« me » : Manon n’est plus et le narrateur se retrouve seul.
C’est sur le ton de la plainte, et non de la révolte, qu’il exprime cette solitude : rejeté du monde des
hommes tout au long du roman, il est aujourd’hui rejeté du monde de Dieu.
o On relève le champ lexical religieux : « âme », « Ciel », « puni ».
o Le ciel est tenu pour responsable de la mort de Manon, c’est une punition divine : « il a voulu »,
le « Ciel » est sujet et est celui qui « rigoureusement puni[t] ».
o Des Grieux, il estime être doublement puni au moment même où leur amour est purifié :
d’abord parce qu’il a perdu Manon, ce qui le condamne à une vie monotone « une vie
languissante et misérable » une vie de mourant, sans but (« trainé »). On notera l’assonance en
[an], l’allitération en [l], la longueur des deux adjectifs (3 syllabes) : il est un mort-vivant
condamné à une vie longue et sans intérêt.
ensuite parce que Ciel lui refuse la mort : « Mon âme ne suivit pas la sienne ». Il désire mourir
mais c’est une mort symbolique que lui inflige le Ciel : il a perdu le goût de vivre et a banni
l’idée d’être heureux désormais : « Je renonce volontairement à la mener jamais plus
heureuse. ». L’adverbe « jamais » exprime bien cette condamnation irrévocable.
Eléments de conclusion
Le lecteur est touché par ce récit de Des Grieux : même s’il a pu juger sévèrement leur immoralité tout au long
du roman, il s’émeut devant ce destin tragique et romanesque des héros, poursuivis, malgré leur jeunesse par la
fatalité qui les empêche d’accéder au bonheur, au moment où ils sont enfin réunis.
Vous aimerez peut-être aussi
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de ManonDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de Manonjunkie20012Pas encore d'évaluation
- 7FR16TE0223 - Texte 2 - Lecture LineaireDocument2 pages7FR16TE0223 - Texte 2 - Lecture Lineairedazaiozamu980Pas encore d'évaluation
- Manon Lescaut L'enterrementDocument3 pagesManon Lescaut L'enterrementbenoldikillianPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire Manon EnterrementDocument3 pagesAnalyse Linéaire Manon Enterrementsandrine.fontaine03Pas encore d'évaluation
- Explication de Texte 1 La TrahisonDocument6 pagesExplication de Texte 1 La TrahisonPrésident ImothepienPas encore d'évaluation
- ETUDE LINEAIRE N°7 La Mort de ManonDocument3 pagesETUDE LINEAIRE N°7 La Mort de Manoncmmcpbbw7n100% (1)
- Ll13 Manon MortDocument3 pagesLl13 Manon Mortlouise.lemeur1Pas encore d'évaluation
- Andromaque de Racine - Dénouement: Commentaire de texteD'EverandAndromaque de Racine - Dénouement: Commentaire de textePas encore d'évaluation
- A la recherche du temps perdu: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandA la recherche du temps perdu: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Le Nègre de Surinam Lecture LinéaireDocument2 pagesLe Nègre de Surinam Lecture LinéaireanneribeyrolPas encore d'évaluation
- Balzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude LinéaireDocument10 pagesBalzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude Linéairelyblanc100% (1)
- JLFDM Scene 2 P 2Document3 pagesJLFDM Scene 2 P 2daomasln.15Pas encore d'évaluation
- Le Prologue - Etude LineaireDocument3 pagesLe Prologue - Etude LineaireKhagny SyllaPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbé Prévost, Scène de La RencontreDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbé Prévost, Scène de La Rencontrejunkie20012100% (1)
- Scene 2 Partie 2 JLDocument3 pagesScene 2 Partie 2 JLdiamantmouanda7Pas encore d'évaluation
- Le Forgeron (Version Élève)Document3 pagesLe Forgeron (Version Élève)amir.beaunePas encore d'évaluation
- La 4 Corneille Médée Acte V, Scène 2Document5 pagesLa 4 Corneille Médée Acte V, Scène 2Hélène BardoultPas encore d'évaluation
- Lagarce Partie2 Scène 1Document3 pagesLagarce Partie2 Scène 1nuggettbarbeucPas encore d'évaluation
- Manon Lescaut La Rencontre Amoureuse AnalyseDocument3 pagesManon Lescaut La Rencontre Amoureuse AnalysesafayaalitaPas encore d'évaluation
- Mes Forêts Sont Des Bêtes Qui Attendent La Nuit Dorion AnalyseDocument5 pagesMes Forêts Sont Des Bêtes Qui Attendent La Nuit Dorion Analysesaskia.velasquezPas encore d'évaluation
- Un Rêve BACDocument6 pagesUn Rêve BACasma rachidPas encore d'évaluation
- Colette - Étude TEXTE 3Document9 pagesColette - Étude TEXTE 3lyblanc100% (1)
- Les Effarés Rimbaud Analyse LinéaireDocument12 pagesLes Effarés Rimbaud Analyse Linéaireapolline.charrondierePas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud, À La Musique - Plan Détaillé Pour Un Commentaire ComposéDocument2 pagesArthur Rimbaud, À La Musique - Plan Détaillé Pour Un Commentaire ComposéAlavi AurélienPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde p2 Scene 3Document5 pagesJuste La Fin Du Monde p2 Scene 3siyeon9242Pas encore d'évaluation
- El Le MalDocument4 pagesEl Le MalZeus100% (1)
- Sido Texte 5Document2 pagesSido Texte 5wennamanyPas encore d'évaluation
- L'huitreDocument3 pagesL'huitreYaniss BainaPas encore d'évaluation
- Fiche Revision Oral Bac FrancaisDocument3 pagesFiche Revision Oral Bac FrancaisIman Fachtali0% (1)
- Manon Lescaut, Scène de La Rencontre - Synthèse Tableau Étude LinéaireDocument3 pagesManon Lescaut, Scène de La Rencontre - Synthèse Tableau Étude Linéairemarius confiant100% (1)
- Texte 13 Dispute Antoine Suzanne Scene 9Document5 pagesTexte 13 Dispute Antoine Suzanne Scene 9aPas encore d'évaluation
- Fiche LA RENCONTREDocument7 pagesFiche LA RENCONTREAsmaa AssoumaPas encore d'évaluation
- 1re Francais La Bruyere Caracteres V X La Comedie SocialeDocument2 pages1re Francais La Bruyere Caracteres V X La Comedie Socialepierre caillouPas encore d'évaluation
- Analyse Prologue - Juste La Fin Du MondeDocument5 pagesAnalyse Prologue - Juste La Fin Du MondeAndrea OrtizPas encore d'évaluation
- le mal analyse lineaireDocument2 pagesle mal analyse lineairechirineghostine0112Pas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 10 BADocument5 pagesLecture Linéaire 10 BAfawemaPas encore d'évaluation
- Explication Linéaire Du TEXTE 6Document4 pagesExplication Linéaire Du TEXTE 6el sezPas encore d'évaluation
- 2.les Fausses Confidences A.L Acte I Scene 14Document2 pages2.les Fausses Confidences A.L Acte I Scene 14cordo.seraphinPas encore d'évaluation
- Le Monologue de RodrigueDocument2 pagesLe Monologue de RodrigueGtuvf100% (1)
- OralDocument3 pagesOralstallrbetterPas encore d'évaluation
- Fireworks - LDP - 1re Chapitre 6 - HacktivismDocument43 pagesFireworks - LDP - 1re Chapitre 6 - HacktivismplumagathaPas encore d'évaluation
- La Casquette de Charles BovaryDocument3 pagesLa Casquette de Charles BovaryPopescu DumitruPas encore d'évaluation
- Dissertation-Rire-Savoir - 240329 - 201858 - CopieDocument5 pagesDissertation-Rire-Savoir - 240329 - 201858 - CopielenamorataPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire Candide Chapitre 19Document3 pagesLecture Linéaire Candide Chapitre 19Le MeurPas encore d'évaluation
- Explication Linéaire 7 LA PEAU de CHAGRINDocument4 pagesExplication Linéaire 7 LA PEAU de CHAGRINenora.legrandPas encore d'évaluation
- ANALYSE Blaise Cendrars Extrait de La Prose Du Transsibérien Et de La Petite Jehanne de FranceDocument5 pagesANALYSE Blaise Cendrars Extrait de La Prose Du Transsibérien Et de La Petite Jehanne de Francesonia l'hôtePas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire MOLIÈRE, Le Malade Imaginaire, 1673, Acte III, Scène 12Document2 pagesLecture Linéaire MOLIÈRE, Le Malade Imaginaire, 1673, Acte III, Scène 12teulierlaurianePas encore d'évaluation
- Les Vrilles - Partie de Pêche - LLDocument5 pagesLes Vrilles - Partie de Pêche - LLChedlia El FALAHPas encore d'évaluation
- Ma BohèmeDocument5 pagesMa BohèmecolasadlerlilianPas encore d'évaluation
- Ma Bohème Arthur Rimbaud AnalyseDocument6 pagesMa Bohème Arthur Rimbaud AnalyseIrvinPas encore d'évaluation
- 2 Discours de GwynplaineDocument4 pages2 Discours de Gwynplainedjosko97xPas encore d'évaluation
- A La Musique Rimbaud AnalyseDocument7 pagesA La Musique Rimbaud Analysemjegham20190% (1)
- CL Tableau Analyse MLDocument5 pagesCL Tableau Analyse ML07gatcha100% (1)
- Lecture Linéaire - Tu M'accable, Juste À La Fin Du Monde, Jean Luc LagarceDocument6 pagesLecture Linéaire - Tu M'accable, Juste À La Fin Du Monde, Jean Luc LagarceAce151Pas encore d'évaluation
- Le Soliloque D 2Document2 pagesLe Soliloque D 2aairouche11Pas encore d'évaluation
- LL 10 Les Réparties de NinaDocument4 pagesLL 10 Les Réparties de Ninalv.ghina.jomaaPas encore d'évaluation
- 1re Francais Dorion Mes Forets La Poesie La Nature L IntimeDocument3 pages1re Francais Dorion Mes Forets La Poesie La Nature L Intimeademch123456789fghPas encore d'évaluation
- Analyse Juste La Fin Du Monde Scène 3Document2 pagesAnalyse Juste La Fin Du Monde Scène 3Jeunl ZeosPas encore d'évaluation
- Analyse Lineaire N6Document4 pagesAnalyse Lineaire N6lexsacha131Pas encore d'évaluation
- Leonard BernsteinDocument1 pageLeonard Bernsteinjunkie20012Pas encore d'évaluation
- PlatonDocument3 pagesPlatonjunkie20012Pas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbé Prévost, Scène de La RencontreDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbé Prévost, Scène de La Rencontrejunkie20012100% (1)
- Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie ErnauxDocument4 pagesAnalyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernauxjunkie20012Pas encore d'évaluation
- E QlhIdmETE1N6t-kdhAfxBJlXADocument3 pagesE QlhIdmETE1N6t-kdhAfxBJlXAademmnasri47Pas encore d'évaluation
- Méthodologie de L'argumentationDocument8 pagesMéthodologie de L'argumentationLora DoraPas encore d'évaluation
- Résumé: René, Ou Les Effets Des Passions, de François-René de Chateaubriand (1802)Document2 pagesRésumé: René, Ou Les Effets Des Passions, de François-René de Chateaubriand (1802)wahbihouda2022Pas encore d'évaluation
- Le Renard Et La PanthèreDocument2 pagesLe Renard Et La PanthèreJessicaPas encore d'évaluation
- PDFDocument51 pagesPDFAmath DiopPas encore d'évaluation
- Évaluation N° 3 Au 1er Semestre - Compréhension + Langue - Tronc Commun (Aux Champs) + Corrigé Et BarèmeDocument3 pagesÉvaluation N° 3 Au 1er Semestre - Compréhension + Langue - Tronc Commun (Aux Champs) + Corrigé Et Barèmeaghnaj04Pas encore d'évaluation
- Complement Circonstanciel ExercicesDocument4 pagesComplement Circonstanciel ExercicesNeil Walls100% (1)
- Analyse Linéraire, Chapitre XLIDocument2 pagesAnalyse Linéraire, Chapitre XLIJustine QuéréPas encore d'évaluation
- A L'epreuve de La ReecritureDocument32 pagesA L'epreuve de La ReecritureJames CarroPas encore d'évaluation
- La Structure de Madame BovaryDocument2 pagesLa Structure de Madame Bovaryleximan100% (1)
- Semaine 3 EB3Document7 pagesSemaine 3 EB3satiPas encore d'évaluation
- Prénom Bad Boy - Faîtes Rapidement Un Choix Lorsque Vous Êtes Indécis ! - ? La-Roue - FR 2Document1 pagePrénom Bad Boy - Faîtes Rapidement Un Choix Lorsque Vous Êtes Indécis ! - ? La-Roue - FR 2elise.belafaPas encore d'évaluation
- UntitledDocument1 pageUntitledGoldenJayPas encore d'évaluation
- Compo 2ASDocument2 pagesCompo 2ASMOUMEN ABDELMOEZZPas encore d'évaluation
- 01 08 LABYRINTHES BAT BonusDocument8 pages01 08 LABYRINTHES BAT Bonusmourdinawel91210Pas encore d'évaluation
- Dornier, Interpréter Les Lettres PersanesDocument17 pagesDornier, Interpréter Les Lettres PersanesGuillermo LoyolaPas encore d'évaluation
- Info WakfuDocument1 pageInfo Wakfumathiasdimeglio58Pas encore d'évaluation
- Le Diable Et Le Cinéma FantastiqueDocument3 pagesLe Diable Et Le Cinéma Fantastiquebeebac2009100% (1)
- La Blanche Neige PDFDocument3 pagesLa Blanche Neige PDFHocem Edin100% (1)
- DD DiDocument4 pagesDD Dicarinebechara1785Pas encore d'évaluation
- Méthode de La DissertationDocument4 pagesMéthode de La DissertationEl Moustapha Malick100% (1)
- Dissertation 2Document34 pagesDissertation 2sabrineaissiou23Pas encore d'évaluation
- Exercices Pronoms RelatifsDocument5 pagesExercices Pronoms Relatifsmelaniesanchez100% (1)
- Les Aventures Du Petit Nicolas - 05 - On A Eu L'inspecteurDocument3 pagesLes Aventures Du Petit Nicolas - 05 - On A Eu L'inspecteurSamaneh AbdiPas encore d'évaluation
- Aide A La Creation de PersonnageDocument51 pagesAide A La Creation de PersonnageTRASH ATTACKPas encore d'évaluation
- Maurice SceveDocument442 pagesMaurice Scevehorizein1Pas encore d'évaluation
- Fiche Exercice Trouver Ma Mission Dans La VieDocument4 pagesFiche Exercice Trouver Ma Mission Dans La Vieمروا المنديليPas encore d'évaluation
- Le Projet Il Était Une Fois À Imprimer (1) - 1.doc Version 1Document95 pagesLe Projet Il Était Une Fois À Imprimer (1) - 1.doc Version 1Azedine Achettouh100% (2)
- Dissertation TheatreDocument4 pagesDissertation TheatreGabriella MgnPas encore d'évaluation
- Femmes Tissage MythologieDocument19 pagesFemmes Tissage MythologieLuisina BarriosPas encore d'évaluation