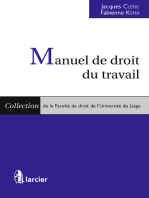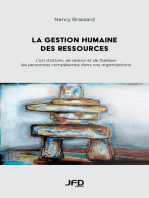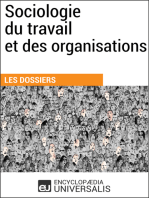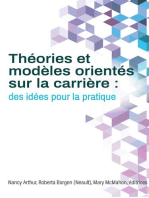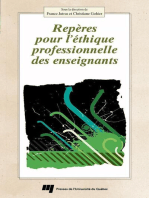Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Sociologie Du Travail L3 AES
Cours Sociologie Du Travail L3 AES
Transféré par
Amélie TouzartTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Sociologie Du Travail L3 AES
Cours Sociologie Du Travail L3 AES
Transféré par
Amélie TouzartDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
Introduction
Quest-ce que le travail ? Travail histoire ? Travail philosophie et conomie ? Travail psychosociale et psychologique ? Travail et anthropologie ? Travail et ergonomie ? Quest-ce que peut tre la sociologie du travail ? Travail douleur ? Travail contrainte ? Travail librateur ? Pour gagner ma vie ? Le travail est une obligation qui se dcline en contraintes mais peut tre aussi une valeur. Dans la dclaration des droits de lhomme de 1793, il est indiqu que la socit doit subsistance aux citoyens malheureux soit en leur provoquant du travail soit en leur procurant des moyens de subsister ceux qui ne peuvent travailler . Est-ce que lEtat doit quelque chose aux gens sils sont en tat de travailler ? Oui, un emploi. Au 19me sicle, il y a de graves crises de lemploi, beaucoup de gens nont pas eu demploi. Le prambule de la constitution de 1946 stipule que chacun a le droit de travailler . Toutes les institutions qui procdent de cette affirmation se sont mises en place pendant les Trente Glorieuses. 1958 : assurance chmage 1967 : ANPE cre (actuellement le Ple emploi) Annes 1970 : apparition de doutes, certains auteurs parlent de disparition du travail. Dominique Mda, Le travail : une valeur en voie de disparition, Rifkin, La fin du travail. Dernirement un auteur a crit louvrage Ce qui tue le travail, on continue penser que le travail disparait. Il existe un rapport intitul Le Travail dans 20 ans.
I-
Le travail et lhistoire
Travail vient de tripalium qui est un objet de torture ou un objet utilis pour ferrer les chevaux, cest un instrument 3 pieds. Le travailleur serait normalement le bourreau, celui qui actionne la machine, ce nest pas la victime. Il y a avait une vision dAdam et Eve galement avec la rfrence du travail la sueur de ton front. Cest une vision trs oriente. Dans lAntiquit, en Grce, la place centrale tait la cit, la fonction publique et non le travail. Pour les sociologues, cest avec lessor du salariat que le travail est devenu le principe organisateur de notre socit et une valeur centrale. Sabine Herbs Seguin prcise que cest la premire rvolution industrielle qui a produit la relation salariale. On tait dans une vision du labeur mal salarie des hommes et des femmes mais aussi des enfants. Elle dit que les autres rvolutions ont transformes le rapport au travail avec le travail la chane puis lautomatisation Page | 1
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
avec la parcellisation du travail et une certaine amlioration de la condition salariale. Aprs la Seconde Guerre Mondiale, lorganisation du travail humain joint au progrs technique et aux volutions technologiques ont permis laccroissement de la productivit, les ngociations collectives ont contribues lamlioration des conditions du travail, cest le compromis fordiste. Depuis le milieu des annes 1970, on se trouve face une baisse de la quantit du travail cause du progrs des machines et la standardisation des processus. Avec la mondialisation des changes, une concurrence sest tablit entre travailleurs et lenjeu des relations collectives est devenu plus le partage de lemploi disponible que la sauvegarde du pouvoir dachat. Les sociologues du travail ont longtemps t occups crer leur histoire. Il fallait que la discipline existe en tant que telle. Ils ont donc raliss des entretiens, des questionnaires Pendant ce temps les archives taient pauvres. Ctait les historiens qui pouvaient aider comprendre lvolution du travail. Cest pourquoi les sociologues actuels se rfrent Michelle Perrot. Un sociologue qui a fait uvre dhistorien est Tourel, il a tudi lvolution du travail lusine Renault dans les annes 1950. En 1966, une historienne a tudi le travail des femmes et leur place dans le syndicalisme. Cest partir de 1990 que lon voit la prise dautonomie de la discipline de la sociologie et des analyses historiques en lien avec le travail.
II-
Travail philosophie et conomie
John Lock, philosophe anglais du 18e sicle (1632 - 1704). Il a reprsent le mouvement empiriste (la connaissance vient de lexprience), cest le fondateur intellectuel du libralisme de lEtat de droit. Il voque le travail comme une manifestation de la volont individuelle, un droit de proprit sur son corps et donc une facult de ngocier sa place dans la socit. En France, Saint Simon (dbut du 17me sicle, conomiste et philosophe, mort en 1825, il avait comme disciple Augustin Thierry et Auguste le Comte) a influenc les philosophes du 19e sicle. Il a tait le penseur de la socit industrielle et est lorigine du mouvement saint simonisme. Il prne le progrs de lhumanit par lindustrie. On doit grimper lchelle sociale en fonction de ses mrites mme si une majorit de travailleurs est exploit par une faible minorit oisive condition que ces travaux soient utiles la socit et lui donne des bnfices en lien avec ses capacits. On retrouve ici Adam Smith avec sa recherche des causes de la richesse des nations. Il est lun des premiers voquer le travail humain comme tant crateur de richesse. Il a contribu dvelopper la notion de travail abstrait qui fonde lchange marchand. Pour lconomiste Karl Marx le travail humain est synonyme de facteur de production. Lvolution du travail dans sa conception socialiste et conomiste est au centre du processus de transformation du capitalisme. (Livre 1 du Capital, 1867). Le travail cest lalination et tre contraint de vendre sa force de travail, cest tre exploit. Au 19e sicle, Durkheim a impos la sociologie comme discipline universitaire, cest un contemporain de Jaurs et de Bergson. Il sest oppos Marx et aux conomistes classiques. Le travail nest pas plus un facteur daffrontement quune source conomique. Son ouvrage de 1893, La division du travail , aborde les rapports sociaux et estime que le travail induit, participe lautonomisation des individus mais elle est complexe et souvent contradictoire. La Page | 2
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
division du travail ne met pas en prsence des individus mais des fonctions sociales. Pour la plupart des conomistes du 20e sicle, le travail est un facteur de production. Loriginalit est venue de Keynes qui a voqu le march du travail dans un contexte de crise et de chmage.
III-
Travail et psychologie, psychologie sociale et psychosociologie
La psychologie sociale analyse le droulement concret de lactivit, porte sur les actes, les actions qui posent le travailleur, comment il effectue ses actes, il investi ses facults, ses aptitudes. Pour Serge , la sociologie est la science des conflits entre lindividu et la socit, science des phnomnes de lidologie, la science des phnomnes de communication. Sa discipline se distingue moins par un espace quon limiterait que par un regard des phnomnes et des relations. Il rappelle qu la diffrence de la psychologie sociale, la sociologie na pas comme sujet lindividu mais une collectivit. Pour les auteurs de la psychosociologie, cette discipline sest dveloppe en quatre priodes : les annes troubles (annonce changements sociaux), les annes 1930, la reconstruction de laprs guerre, les annes 1960 et la priode mi 1970 mi 1990. Dans le Vocabulaire de la psychosociologie de 2004 il est prcis que la psychosociologie sest donne pour tche danalyser de faon critique les modalits dorganisation pr dominantes et leurs consquences pour les personnes et les collectivits et dlaborer des moyens pour mieux les transformer ou les faire voluer. Les auteurs de rfrences sont Ewin (notion de camp), Moreno Levy, Karl Rogers. Ils disent que ce nest pas un simple ensemble technique mais bien une discipline part entire. Paralllement dautres auteurs disent que la psychosociologie est une psychologie sociale qui part de la psychologie dindividu et la resitue dans la socit. Cette dynamique peut tre inverse en considrant la psychosociologie. La psychosociologie se distingue de la psychologie sociale du fait quelle traite lindividu dune manire pratique. Dans les deux disciplines, on a faire luniversit. La sociologue franais dorigine russe Durbitsch travail sur les phnomnes sociaux instance sur lindividuel et le collectif. Pour Raymond Boudon, Dictionnaire critique de la sociologie, il est indispensable de remuer les individus. Le premier a voquer lidentit au travail est Saint Soulieu. Un des premiers a voquer limplication subjective des salaris dans les relations du travail. A partir de ces recherches, toute une sociologie est apparue assez proche de la psycho sociologie.
IV-
Travail et droit, droit du travail et droit social
Quelle est la diffrence ? Le droit du travail est venu pour compenser lingalit entre les employeurs et les personnes qui sengageaient dans un contrat, qui se retrouvaient dans un niveau ingal avec leur cocontractant. Petit petit a t mis en place le droit du travail. Tout dabord au milieu du 19e sicle pour limiter le travail des enfants. On est typiquement dans la Page | 3
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
relation de prestation de travail avec un employeur. Dans le droit social il y a tout le droit des prestations sociales. Toute la lgislation en lien avec la politique sociale de ltat dans lequel on est. Pour autant, le droit du travail fait partie du droit social puisque que cest au titre de droit du travail quon retrouve une convention collective. Le droit et la sociologie sont deux disciplines dont les oppositions en terme de mthodologie ou de contenu sont les plus manifestent. La sociologie ne soccupe en aucun cas de la fonction du droit dans les relations de travail. Pourtant le droit du travail est au cur des volutions comme au cur des proccupations des travailleurs dans lentreprise. Le prof Ray a crit un livre, droit du travail, droit vivant paru en 2002 o il crit faire du droit cest tout simplement connaitre les rgles du jeu social. Dans lentreprise le droit du travail pose les rgles officielles fixant les rapports entre lemployeur et les salaris, il va de soit quil constitue un minimum beaucoup dautres normes de comportement au moins aussi importantes existent (exemple la courtoisie ou la loyaut la plus lmentaire). Mais la violation du droit est sanctionne par la socit . On peut aussi se rfrer la dfinition du prof Lyon-Caen, pour lui le droit du travail est lensemble des rgles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privs et ceux qui travaillent sous leur autorit moyennant une rmunration appele salaire. Etymologie du salaire : Le pain de sel donn tait le paiement en nature et ctait important parce que a permettait de garder les lments. Le droit du travail sadresse des personnes prives mais cela ne veut pas dire quon peut faire nimporte quoi dans la fonction publique. Cela veut dire que non seulement les fonctionnaires de ltat comme les fonctionnaires territoriaux (1,5 millions) et les assimils (moins dun million) ne relvent pas du droit du travail. De la mme manire les artisans, les commerants, les professions librales ne se voient pas appliques le droit du travail. Bien videmment le droit social sinscrit dans lhistoire des faits sociaux et des institutions sociales. Face lui le droit du travail est une des branches du droit social qui porte sur les relations individuelles et collectives nes du contrat de travail. Le droit social concerne plus gnralement la protection de tout individu face aux risques sociaux (chmage, maladie, accident de travail). Le droit ne dfini pas les risques sociaux. LEIT a dfini les risques sociaux dans sa convention 102 qui sont les risques que lindividu peut avoir supporter qui sont lis son quotidien, ses besoins. Ce sont tous les risques qui empchent tous les travailleurs dtre sur le march du travail. Ds lors que lon est en tat de d-marchandisation il faut quil y ait quelquun qui vienne nous donner un revenu de substitution (tat, tat providence). Si lon considre la branche du droit du travail qui concerne le droit lemploi, il faut considrer deux domaines. Dune part lassurance collective en faveur des demandeurs demploi et dautre part lensemble des actions et mcanismes qui tendent favoriser et orienter lemploi pour prvenir et/ou traiter le risque. On se retrouve dans la politique de lemploi avec lemploi aid, dans le domaine de la formation professionnelle pour maintenir lemployabilit (capacit pour un travailleur de trouver un emploi correspondant ses comptences et au besoin du march du travail, dfinition de la revue sociale de Chasquar et Chasco) des travailleurs. Avec le traitement du chmage, on retrouve un des lments de la Page | 4
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
politique sociale et cette politique peut tre soit tatique soit conventionnelle laisse aux partenaires sociaux. Cest notamment en ce qui concerne le traitement du chmage, la rgulation par le march ne suffit pas, ltat intervient pour des actions dinsertions, de formation, de conversion voire une certaine poque de pr-retraite en prvoyant des aides financires de diffrentes faons qui accompagnent les diffrentes situations, il faut dcliner les textes et notamment des moyens de contrle et de sanction pour les attitudes dviantes. Un autre concept que lon retrouve dans ce domaine de lemploi est la notion de flexibilit qui est apparue dans la seconde moiti des annes 1980 en lien avec la gestion des entreprises. On a voulu dans le cadre de la mondialisation activer la modernisation comptitive des entreprises. Face cela, le droit du travail apparait rigide. On peut en rapprocher la notion de drglementation. En voquant ce terme on peut vouloir rduire les normes collectives au profit de ngociations individuelles. On sait que cest dangereux, lindividu se retrouvant soumis au besoin de la gestion de lorganisation. On peut aussi voquer le fait quil faut plus de ngociation collective autrement dit donner plus dimportance aux partenaires sociaux par rapport au rglement et la loi. Ces dernires annes cest ce qui sest fait en Europe. Autre notion : le partage du travail. Le march du travail nest pas limit, il nest pas clos. Le volume nest pas constant. Au moment o on a ngoci les lois sur lamnagement du travail (Aubry 1 et 2), on avait lair de penser que si on rduit le travail, a laisse la place quelquun. Mais cela est faux. Dans la semaine sociale de septembre 1993 le prof Ray soulignait le droit du travail sefface, lemploi fait la loi . Il voulait souligner que le droit du travail nest pas un catalogue de mesures de gestion de lemploi. Depuis 2009 on parle dune refondation du droit social. Dbut 2010 un rapport a t prsent en ce sens : les auteurs (Jacques Barthlmy et Gilbert Tte) ont considrs que la refondation devait passer par une rduction du droit rglementaire pour laisser plus de place au droit conventionnel et la pratique des contrats. Beaucoup de voix se sont leves pour dire que cela peut tre dangereux. A la lecture de ce rapport, plusieurs observations doivent tre voques pour que les ngociations que le droit conventionnel prenne toute son importance, il faudrait que les acteurs (les partenaires sociaux) aient une relle lgitimit. Cest tout le problme du taux de syndicalisation. (8, 9 %). De la mme manire encourager la ngociation collective en prvention des conflits et des grves, encourager la conciliation, imposent lvolution des mentalits au sens sociologique du terme (au sein des organisations) pour pouvoir les faire accder un droit du travail quils participent faire voluer. Ce nest pas ce qui existe forcment actuellement. Et sans doute que nos manires de travailler nencouragent pas la dmarche participative que lon trouve dans diffrents endroits.
V-
Travail et anthropologie
Avant les annes 1980, lanthropologie se proccupait des civilisations lointaines. Depuis, et notamment linstigation de lcole de Chicago, les anthropologues ont commenc soccuper des socits occidentales. Anthro en grec cest tre humain, opo cest ltude. Donc lanthropologie tudie les tre humains sous tous leurs aspects aussi bien physiques (volutions) que culturels (socio, psycho, gographique). Lanthropologie tente dfinir ltre humain, Page | 5
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
lhumanit en se rfrant en synthse aux diffrentes sciences naturelles. Lorsquelle tudie les faits anthropologiques, elle les tudie de faon spcifique lhomme par rapport aux autres tres vivants. Les symboles, les langages, les rites funraires, tout ce qui est funraire, les mythes, arts, religions, costumes mais aussi tous les aspects en ce qui concerne les techniques culturelles, instrumentales, les manires de mmoriser, les reprsentations spatiales et temporelles. Souvent elle procde par comparaison entre socit, ethnie. Et elle essaye de trouver lunicit de lesprit humain au travers de diffrentes cultures. On en rapproche lethnologie. Quand on parle dethnologie on parle quelque fois danthropologie sociale et culturelle. On est dans le domaine des sciences humaines, lobjet de lethnologie est ltude explicative et comparative de lensemble des caractres sociaux et culturels des groupes humains au travers des thories et des concepts qui mergent des observations. Lethnologie essaie de dfinir la structure, le fondement des socits. On parle aussi de lethnographie. Cest la branche de lethnologie qui connecte de faon mthodique les donnes du terrain. L encore, elle dcrit, elle analyse lhumeur, les habitudes des populations tudies. Avant les annes 1980 on tait dans les visions dune population trs lointaine. On parlait dtude des primitifs. On sest aperu quil y avait autant de varits, de groupe tudier et de plus en plus on trouve des ethnologues dans les lieux de travail. La sociologie du travail qui tablie des questionnaires, ralise des enqutes, trs souvent se dplace dans les milieux quils veulent tudier. On parle dobservation participante, de recherche action. a t le cas en sociologie du travail avec des sociologues qui ont voulu connaitre la condition ouvrire. Les premiers avoir travaill sur la condition ouvrire dans les annes 1960 Andrieux et Ninon qui ont publi, louvrier daujourdhui sur les changements de la condition ouvrire . Pour ltudier ils ont particip, ils ont travaill comme des ouvriers. Dautres sociologues se sont inspirs des disciplines comme lanthropologie notamment Dumazedier qui, en 1962, a observ les relations entre travail et loisir. Il a crit vers la civilisation du loisir . Danielle Nilhart a travaill sur la satisfaction au travail, la prcarisation. Prcisment les difficults ont t cre par les changements dorganisations.
VI-
Travail et ergonomie
On la dfini comme ltude scientifique de la relation entre lhomme au travail et ses moyens, ses mthodes et son milieu de travail. Le but est de concevoir des systmes qui puissent tre utiliss avec le maximum de confort, de scurit, defficacit par le plus grand nombre. Ergon = travail, nomos = rgles. Cest un terme qui est apparu dans les annes 1950 mme si le premier mdecin intervenu dans ce domaine tait au milieu du 19e sicle. La discipline sest structure dans les annes 1960 en France mme si depuis 1913 le CNAM (conservatoire national des arts et mtiers) hbergeait dj un laboratoire de recherche sur le travail musculaire. Dans les annes 1930, il a mis au point un labo de psycho du travail puis lergonomie est devenue une discipline qui a t enseigne et maintenant le mtier dergonome est reconnu et il existe une socit dergonomie de langue franaise qui veille lvolution de la discipline. Les tudes des ergonomes portent sur les postes de travail, sur les lments qui se trouvent dans ces espaces de travail, sur les effets de processus de gestion et de production, sur les interfaces comme machines (logiciels, sites intranet) mais aussi sur lorganisation du travail (rotation des Page | 6
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
quipes, des horaires, organisations des services). Les ergonomes utilisent des connaissances qui sont issues de plusieurs disciplines que ce soit laspect mdical, la psychologie au regard des usages de lattention, de la mmoire, tout ce qui est apprentissage, la vigilance, les postures. Ils vont bordurer la sociologie des organisations au regard des chaines de commandement, des chaines de rpartition, les ergonomes vont faire des empreints la psycho sociale, la linguistique. Comment distingue-t-on la socio industrielle de la socio du travail et de la socio des organisations ? Au sein de la socio on a des rapprochements de disciplines. Sociologie contemporaine , Durand et Veil, les diffrents axes de la sociologie dans la seconde partie de louvrage. Chapitre consacr la sociologie du travail et la sociologie des organisations. Dans un livre paru en 2008, au-del de la sociologie des organisations , ditions Eres, Gilles Herreros, distingue la sociologie des organisations et les diffrentes sociologies appliques aux organisations. Il voque les difficults que les observateurs rencontrent ds lors quon cherche prsenter la sociologie des organisations dans le panorama disciplinaire sociologique des organisations en tant que lieu de travail. Il insiste sur la difficult de dfinir les contours aussi bien thoriques que mthodologique du fait prcisment des interdisciplinarits qui se produisent au sein de la pluridisciplinarit. Herreros classe dans le corpus classique de la socio des organisations les travaux dirigs par Michel Crozier, il dit que les gens qui ont travaills derrire Crozier sont des classiques de lorganisation, les recherches qui ont voulu complter, assouplir, modifier les tudes du CNRS la suite de Crozier et dans cette ligne on retrouve Saint Saulieu, Reynaud il oppose les nouvelles approches sociologiques des organisations qui regroupent les ensembles thoriques assez diffrents dans lesquels on retrouve Boltanski et Tehvenot qui ont dvelopp lcole dconomie des grandeurs. On trouve aussi tout ce qui est thorie de lacteur rseau dans le cadre des ouvertures dentreprises (Bruna Latour et Michel Calon). Autre dmarche la sociologie clinique qui est dans la ligne dHenri Quez, Gaulejac, des sociologues qui ont travaills dans la ligne de lcole de Chicago o ils vont dans les organisations o ils observent et participent pour comprendre et faire leurs enqutes. Lorsque Herreros oppose la sociologie classique ces nouvelles tendances, il explique pour les diffrencier que dans les visions classiques de la socio des organisations il y avait les pouvoirs, la culture, la rgulation, le systme, actuellement on parle plus de rseau, de convention, de controverse et de ce fait les tudes sont plus varies ce qui naide pas pour les observateurs extrieurs la comprhension de la situation des diffrentes disciplines.
Page | 7
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
Chapitre 1 :
Section 1 : De lorganisation du travail la sociologie du travail
ILe taylorisme
Frdric Winslow Taylor, n en 1856 mort en 1915. Comment on pouvait vivre le travail cette poque ? Taylorisme fin du 19e et au tournant du 20e sicle.
Biographie :
Il tait de sant faible et a interrompu ses tudes suprieures. Il pensait sortir diplm sur le march du travail mais il est sorti apprenti du modeleur. Il a travaill dans une fabrique de chaussure. Ensuite, il est parti dans une usine dacirie. Il devient contremaitre puis responsable datelier et comme il naccepte pas davoir fini ses tudes, il prend des cours du soir. Son employeur na pas eu envie de reconnaitre ses nouvelles comptences. Ses savoirs taient devenus des vritables comptences. Il change dusine et sen va en 1880. Dans cette nouvelle usine, il mne diverses exprimentations dans le domaine de la production mais aussi des exprimentations gnrales dorganisation. En 1893 il sinstalle consultant indpendant. Il met au point une mthode de travail destine amliore la rentabilit des entreprises. Ses principes sont prsents en 1895 une confrence bien faire et faire savoir . Il prcise ses ides tout au dbut du 20me sicle propos du choc management (direction de latelier) et cest en 1909 quil sort ses principes du management scientifique. Entre temps, il remet en uvre ses connaissances en reprenant un poste dans lindustrie. Jusqu sa mort en 1915 il va passer son temps donner des conseils bnvoles aux USA, il va ltranger. En France ses travaux sont diffuss par un chimiste : Henri Le Chatelier. Face au principe de lOST, tous ses disciples sont enthousiastes mais les milieux patronaux sont rticents au dpart. Un sociologue, George Friedman, dit dans la crise du progrs propos de Taylor que sous langle de la bourgeoisie amricaine de la cte Est Taylor dans sa dmarche est trs marqu dans ce milieu gographiquement comme sociologiquement et par son poque de la fin du 19e sicle qui est la fois une poque hroque, industrialiste et scientifique aux USA. Pour les disciples de Taylor, cela est dfensable car ils insistent sur le caractre moderne de sa dmarche entre le milieu industriel et intellectuel. Parmi les techniques et mthodes employes il existe toujours une voie plus efficace que les autres (One Best Way). Pour la trouver, une tude scientifique du travail est ncessaire pour atteindre la meilleure mthode. Cette tude doit permettre de dterminer les temps de ralisation, les modes opratoires et cest lencadrement de faire les prescriptions. Lide de tches est llment le plus important du management puisquil faut valuer la dure ncessaire lexcution de chaque tche. Pour arriver discerner les diffrentes tches on fait une tude critique du contenu du travail, analyse scientifique des mouvements, recherche excution attente repos, tude des temps dexcution, observation directe, chronomtrage, utilisation des Page | 8
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
tables de temps selon les types de tches. Pour Taylor, le divorce entre excution et rflexion. Pour lui il est impossible lhomme le mieux adapter un mode de travail de comprendre les principes scientifiques qui gouvernent ce travail. Il faut que quelquun dducation suprieure laide. Pour les ouvriers qui travaillent la pice il faut prvoir un salaire plus lev chaque fois quils travaillent plus rapidement. Incitation par la rmunration pour que louvrier entre dans la logique daugmentation de la rentabilit. Pour Taylor, le travail est pnible et ne permet pas aux hommes dtre pleinement efficace en raison des rgles empiriques (apprentissage, rgles personnelles) qui frnes le rythme de travail. Il dit quil faut recruter les individus les mieux mme daccomplir la tche en tudiant le caractre, le rendement de chaque ouvrier. La formation, le suivi et le contrle permanent sont ncessaires. Il est important de sparer les tches entre ceux qui conoivent (bureau de planification) et ceux qui excutent (ateliers). Pour Olivier Meier, les grands auteurs en management , collection management et socit, lOST consiste dans la gestion et la coordination des tches en vue dtablir et de maintenir lamnagement optimum du travail au sein de lentreprise partir de principes ou de mthodes rsultant dune recherche scientifique. Il est de la responsabilit des dirigeants de runir, de dchiffrer, classer les informations en vue de concevoir des principes, des rgles, des lois qui permettent aux ouvriers de mieux accomplir leur travail quotidien. Il faut une prsence dun contrle troit pour lexcution du travail qui insert louvrier dans un rseau de contrainte. Qui le pousse soit agir efficacement soit dmissionner. La notion de systme est importante. La comptence aussi. Pour Catherine Balay, elle souligne le rle de lencadrement chez Taylor qui selon elle prfigure la rvolution managriale des annes 1920. Chez Taylor, la relation entre employ et patron nest pas ngative. La prosprit de lentreprise passe par le consensus social. On a quitt lorganisation hirarchique traditionnelle, la maitrise est tourne vers des fonctions spcialises et les activits intellectuelles sont centralises puisquon va voir une unit de conception de lorganisation laquelle va tre rattache la qualit du personnel. On a une division verticale et horizontale du travail. Horizontale avec la dcomposition du processus de production en tches et une division verticale entre tches de conception et de contrle dorganisation et tches dexcution. Film de Charlie Chaplin : Le hros des temps moderne lutte pour survivre dans le monde industrialis. Son film est une satire du chmage. Chaplin a voulu soulign la pnibilit et le caractre absurde des conditions imposes aux ouvriers au prtexte de recherche de gains defficacit. Ces conditions, ces parcellisations des tches, standardisation pour la production en grande srie, aucunes maitrises de sa propre production, cest la vitesse de la chaine qui est dterminante. La vision de Taylor du dbut du sicle ramene dans la souffrance du chmage de la crise 1929 donne un esprit critique. Les conditions matrielles et humaines de la production industrielles ont t un moment donn transforme de manire profonde et rversible. A la suite de Taylor, un grand patron dindustrie automobile : Ford (1863 1947) a instaur le travail la chane. Lintrt de ce travaille la chane est que pour la premire fois on ne bouge pas de son poste, on limite les dplacements, on rduit les temps morts, les temps de manutention. Toutes ces choses sont particulirement moderne, symptomatique du management. Page | 9
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
Elton Mayo (1880-1949) est un mdecin, psychologue et philosophe australien qui a fait ses tudes en Ecosse. Lcole quil fonde est lcole des ressources humaines. Trs vite, il sest intress aux effets du taylorisme dans lindustrie. Il est arriv aux USA en 1922. Avec cette exprience de lobservation dans lindustrie, avec sa formation, il va devenir professeur Harvard et il va participer la cration de la premire chaine de psychologie industrielle. Ses travaux sinscrivent en raction ceux de Taylor. Ses expriences vont sappeler expriences Howthorne. Durkheim, cole positivisme, de la division du travail social . Il considre que dans les formes contemporaines de division du travail il y a une automatisation complexe et contradictoire des rapports entre la sociologie et lindividu et la sociologie et son environnement. La division du travail cre entre les hommes tout un systme de droit et de devoir qui les lient les uns aux autres durablement. Cela donne des rgles qui assurent le concours pacifique et rgulier des fonctions divisionnaires. La sociologie doit soccuper du travail sous langle des fonctions sociales et pas des individus. Dans le suicide ou division du travail , il reconnait que le lieu social peut tre sujet des dysfonctionnements. La division du travail pousse mne lisolement, la crise du lieu social provient de lisolement suprieur la solidarit du groupe. Il y a une incapacit de partage, la mise en commun. Weber (1864-1920) pense que le monde social est constitu par un dveloppement demploi, dactivit, dactions que font les agents. Lunit se base en sociologie. Dfinition de la sociologie : sociologie se propose de comprendre par interprtation lactivit sociale et par laction dexpliquer causalement son droulement et ses effets. Les sociologues de la culture tudient lhomme en tant qutre conscient qui agit en fonction de sa comprhension du monde. Les sociologues nont pas sintresser aux choses qui nont aucun contenu significatif ds lors que ce sont seulement des occasions ou lments qui favorisent laction sociale . Exemple : le cycle organique de la vie humaine, porte sociologique en raison des manires o lactivit humaine soriente pour tenir compte de cet tat des choses. La sociologie doit tre comprhensive car on cherche les sens de comportement humain. /!\ science social : on cherche lvidence (peut avoir un caractre rationnel ou le caractre de ce quon peut revivre par empathie, cest une recherche motionnelle). Certains processus externes semblables ou analogues peuvent avoir pour fondement des ensembles significatifs divers.
II-
G. Friedmad, Paris 1902-1999, P. Naville
Friedman est le fondateur de la sociologie du travail plutt humaniste, aprs la seconde guerre mondiale. Etude des relations entre humains et machines dans les socits industrielles le travail en miette , 1956 = problme de machinisme industriel. Il a contribu faire connaitre les sociologues amricains et a t connu aux USA, il a travaill beaucoup sur la communication de culture de masse. Il tait philosophe, il a travaill sur la civilisation technicienne trotskiste. Il vient dune famille bourgeoise, mouvement surraliste, codirecteur de la rvolution surraliste. Anne 4 L5 = la lecture de Lenine et Trostsky. Il adhre au parti communiste franais. Il travaille au centre dtude psychologique.
Page | 10
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
Ils se sont distingus de la sociologie industrielle amricaine. Ils sont influencs par lanthropologie. Friedman critiquait les mfaits du travail sur lhomme mais reconnaissait quon ne peut pas imprimer la sociologie du travail une unit thorique quelle ne possde pas de son tat dlaboration prsente . Naville a analys la logique des rapports sociaux, il indique que le travail le sous bassement sur lequel sappuie le dveloppement des sociologies ce qui fait de la sociologie du travail est lune des branches principale de la sociologie dans un certain point, celle qui annonait des autres avait de recevoir de celle-ci le rapporte . Annes 1950-1960 : r industrialisations de laprs guerre, progrs technique, implication de ltat, organisation multinationale. On pensait augmenter lconomie sans fin. On leur demande de chercher les voies damliorations de la production ouvrire. Apparait la revue sociologique du travail. Alain Tourraine a commenc ses recherches dans les ateliers de mineur du chili. Dans les annes 1950 il publie ses observations sur la conscience ouvrire. Aprs mai 1968 il travaille sur les variations de la sociologie, la domination est conomique et culturelle. Ceux qui ont le savoir faire et ceux qui ont linfluence. Nouveaux mouvements sociaux = mouvement fministe, rgionaliste = ne sont pas facteurs fondamentales dans les changements postindustriels. Position activiste contre dterministe : il hsite. Il a rcrit la prface de la sociologie du travail . Il distingue la sociologie du travail classique ne au 19me sicle de la nouvelle sociologie du travail apparut dans les annes 1970. Ces travailleurs sociologues se distinguent pour lui de celle daujourdhui qui sont influencs par la socit de production postindustrielle (production culturelle, type sant, ducation, information). Son approche est beaucoup plus socitale. Il se rinscrit dans les ractions mondiales. Dans les annes 1990, le conflit dans les socits postindustrielles est fond sur le capital intellectuel, les liens avec linnovation, les conflits viennent du contrle de linnovation. P. Rolle (son disciple) a travaill sur les relations partir du travail. Les relations de travail voluent avec la socit. Cette vision des volutions est reprise par Dub, Linpart. Ils ont publi ds 1970. Rolle a crit une introduction la sociologie du travail, il remet en cause la spcificit du travail. J.P. Durant, dans un livre de 2007 dit ceux qui voient la sociologie du travail en crise confondent monolithisme et puissance . Il souligne limportance du travail : axe. Thorie importante : exclusion socit, rapport sociologie de sexe au travail, travaux mens par sociologues. Dub en 2001 apparente parpillement du travail des sociologues. La centralit du travail dans le capital fait converger sociologie du travail et sociologie gnrale. La sociologie se fixe des objectifs simultanment et dissocis rendre compte dexpliquer ce qui est nouveau ou ce qui perdure dans le champ du travail et ensuite valuer ses capacits dvaluation des autres disciplines qui traitent le travail.
Page | 11
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
Chapitre 2 : Les acteurs et les institutions
Ce sont les syndicats de salaris, le patronat et ltat. Pour Madame Strubans, en page 89 de Sociologie du travail : les conditions de travail des salaris et leurs acquis sociaux sont le produit dune longue histoire au cours de laquelle les travailleurs organiss ont tent de limiter larbitraire patronal en transformant des rapports individuels en relations collectives , cette volution nest ni linaire ni uniforme, limportance est la stabilit des conqutes dpendant du rapport de force entre les interlocuteurs sociaux et de la conjoncture conomique . Malgr des points communs les salaris et les diffrentes organisations le syndicalisme a des formes trs diversifies selon les pays et lintrieur dun . Un syndicat est un type dassociation qui regroupe des personnes physiques ou morales pour la dfense ou la gestion dintrts communs. Dans lacception la plus courante, ce sont les organisations de dfense de lintrt des salaris ouvriers, employs ou cadres. On parle des organisations syndicales et on voque la lgislation ou la rglementation particulire qui sy attache : libert syndicale, droit de grve, reprsentativit En France, un syndicat est rgi par le livre 1er de la deuxime partie du code du travail, articles 2111-1 et suivants. Le syndicalisme dans sa forme moderne est n en Europe la fin du 19me sicle notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Des professeurs du droit du travail, Ribero et Sabatier, ont soulign que le syndicalisme tant patronal quouvrier a donn une assise lorganisation professionnelle et disent que cela a permis porter remde aux outrances de lindividualisme librale dans les rapports entre membres de la profession. Le syndicalisme sest impos lEtat lui-mme qui lui a fait une place croissante dans ses institutions. Avant cette priode, notamment avant la rvolution, on tait dans lorganisation corporative qui sest dveloppe partir du 12me sicle. Cette organisation stait dveloppe dans les mtiers traditionnels avec les hirarchies dapprenti, compagnon sous lautorit du chef dentreprise qui tait le maitre. Avec notamment des rmunrations en partie en nature comme le logement ou la nourriture et en partie en espce. On tait dans des relations de caractres personnels dans les milieux artisanaux petites entreprises et seuls chapps ce systme les mtiers dits libres qui relevaient des manufactures royales. Dj sous lancien rgime des groupements forms entre compagnons savraient contraire au rgime corporatif. Ils taient en principe interdits mais ils se sont dvelopps dans les derniers moments de la hirarchie avec un caractre occulte avec certains rites dinitiation, ils avaient un rle dans le domaine de la formation (compagnon du tour de France). Leur faon de sopposer, dexercer des pressions prparaient laction collective. Dans les derniers moments de lancien rgime on sent nettement lhostilit au compagnonnage. A la rvolution, la loi Le Chapelier en 1791 interdit tout groupement professionnel. On est dans une phase dindividualisme et de libralisme. Cette vision a t renforce sous lempire et dans les rgimes qui ont suivie. Tout groupe de plus de 20 personnes taient punis. Seules les socits de secours mutuel du fait de leur caractre de bienfaisance chapp aux sanctions. La libert dassociation a dur le temps de la rvolution de 48, et suite aux ractions policires du second empire il ntait plus question dorganiser ce genre de chose. A la fin du 19me sicle, 50 % de la population active travaille dans le secteur secondaire au Royaume-Uni, 40 % en Allemagne, 27 % en France. Les grandes rgions Page | 12
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
industrielles se dveloppent, comme le bassin minier. Toute la priode 75-95 est marque par une concentration des manufactures, des ententes entre les entreprises. En Allemagne cest le dbut de tissem de groupe. A la mme poque se fait la croissance dmographique. En un demi sicle une progression de 85 % au Royaume-Uni, 50 % en Allemagne, 20 % en France. Une urbanisation trs forte, 26 % de la population se trouve dans les villes de plus de 100 000 habitants au RU, 10 % en France. Ces grandes villes ouvrires vont devenir des capitales syndicales. En France, on retrouve Lille, en Angleterre Manchester, Allemagne Hossein. Cest dans ce contexte quapparait la condition ouvrire. Cette notion voquant la proximit des ouvriers par rapport leur lieu de travail et prcisment les grandes cits de rgions industrielles, les ruptures sociales que cela induit par rapport aux anciennes communauts familiales, ethniques, rurales. Lapparition dune nouvelle identit de masse, la classe ouvrire, le proltariat. Mme si le progrs conomique profite dans son ensemble la socit fin 19me, la condition de la classe ouvrire est loin dtre enviable do lenvie de changer la socit, une volont de vivre mieux. Une certaine stagnation du pouvoir dachat des ouvriers, des fluctuations salariales, des fluctuations de lemploi qui amnent tantt des phases de chmage partiel, tantt des phases de chmage total. De dures conditions dexistences lies la maladie, la vieillesse, la protection sociale napparaissant quen 1880. Des rpressions de grves et des lois qui limitaient la dure du travail rarement respecte. Enfin des rglements dintrieur dentreprises souvent excessifs. La dernire phase du 19 sicle apparait comme la phase B du kondratiev avec une grande dpression. Le travail des enfants existe encore, dislocation des familles, violence, alcoolisme En 1864 tait apparu le droit de grve. Labolition de la loi le Chapelier. Le droit de grve est accord avec reconnaissance de la licit de la coalition, avec la possibilit de groupements temporaires constitus en vue de la grve. En 1874 cest la cration de linspection du travail et en 1884 cest la loi Valdec-Rousseau avec la reconnaissance de la lgalit de groupements permanents destins la dfense des intrts professionnels (syndicats).
[Ce qui est important : Comment a sest pass avant la rvolution ? Les liens avec le travail ? Les compagnons]
Un certain internationalisme va caractriser le phnomne ouvrier. Cest lensemble de lEurope occidentale qui volue dans le mme sens mme si le syndicalisme britannique se diffrencie quelque peu. Les professeurs du droit du travail Ribeiro et Sabatier disent grouper, les salaris ont pu chapper la prcarit et la totale dpendance auquel leur isolement y est vou face lemployeur cest par syndicalisme que les conditions du travail se sont transformes du plan individuel au plan collectif. Les milieux du syndicalisme ouvrier en France cette poque ont vu se dvelopper des idologies essentielles pour la comprhension du mouvement ouvrier. Le pouvoir syndicaliste en France est peu reprsent, il y a entre 7 et 9 % de syndiqus. 1901 : constitution des associations. Congrs dAmiens, congrs de Tour. Lhistoire de laction syndicale et des grands groupements qui lont conduite et qui la conduisent encore est indispensable pour comprendre lorganisation de la sociologie. Le syndicalisme limit lorigine aux ouvriers et aux patrons na cess de stendre de nouvelles catgories professionnelles et sociales. Les modes de fonctionnement Page | 13
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
du syndicalisme se sont dvelopps et est apparu au-del des limites du droit du travail proprement dites. Dbut 20me : les mouvements politiques qui existaient : le marxisme, le communisme et lanarchisme forgent le mouvement ouvrier. Les syndicats ont t influencs par ces courants. Ils ont donn au courant ouvrier une base thorique et un idal militant qui a contribu au dveloppement du syndicalisme europen. Des communauts se sont cres dans les villes pour rpondre des besoins psycho sociologiques de solidarit (vision dentraide, atmosphre fraternelle) cest important car on est dans lanonymat des villes, des usines de plus en plus grande, les gens taient anciennement des paysans enracins et laspect communautaire leur donne des repres. Le syndicalisme est un moyen de promotion collective de la classe ouvrire avec linformation de leurs adhrents sur les lois, sur les conditions de travail, sur les moyens de lutte, sur les possibilits de secours. Les congrs sont des occasions dchanges. Certains prennent des dimensions internationales, la presse syndicale a contribu la diffusion des informations, assurer la propagande, des universits se crent, des centres de formation et de perfectionnement relevant daide syndicale. La structuration des syndicats sest faite globalement dans lEurope occidentale avec des principes semblables mais avec des combinaisons trs variables selon les pays. Pour Mme Strubans, lentit gographique est une constante de lorganisation syndicale depuis les sections locales et rgionales jusquaux confdrations nationales, cest ainsi que dans la plupart des pays cest au niveau national que sont ngocis les normes salariales et les conditions concernant lensemble des salaris. Le plan professionnel : le mtier facilite le principe dassociation, le secteur ou la branche dactivit et le niveau o se situe le principe dorganisation des syndicats europens. A ce niveau la ngociation des conventions, la fixation des salaris se fait par fonctions occupes. Cela est vrai pour la France, lAllemagne, les Pays-Bas, la Belgique lentreprise apparait comme unit dexploitation, cest le point de dpart et la base de laction collective mais rarement le niveau principal de ngociation. Sauf au Royaume-Uni et en Irlande. Il a marqu dans les volutions rcentes que certaines ngociations se sont dplaces vers lentreprise, ce phnomne confirme laffaiblissement du syndicalisme. Un des pays o le phnomne est le plus flagrant est : .., o les structures de branches ont t dmanteles. Les subdivisions entre catgories ouvriers, employs, cadres. Elle est moins forte au RoyaumeUni quailleurs. En France, la rglementation dans le domaine syndical intervient diffrents niveaux : la cration des syndicats qui est codifi aux articles L 2131-1 2131-6 du code du travail. Les conditions de reprsentativits ont fait lobjet dune rforme rcente. Deux types de syndicalismes peuvent tre reprs : un syndicalisme de revendication et de contrle : accepte la socit capitaliste mais veut en obtenir le maximum davantages en la contrlant donc en participant aux institutions. On le rencontre au Royaume-Uni, pays scandinaves et en Allemagne. Et un syndicalisme de revendication et dopposition bti sur un projet de changement de socit en lien avec lanarchisme, le communisme, le syndicalisme rvolutionnaire. Au Royaume-Uni on parle de Trade Unions en lien avec le travaillisme. En Allemagne on est aussi dans un syndicalisme plus rformiste, plus spcifique cest un syndicalisme massif. La diffrence avec le Royaume-Uni est notamment labsence de rapport avec le socialisme. En Suisse, la tendance est la constitution de syndicats interprofessionnels. Enfin il existe des organisations internationales : la confdration syndicale internationale (CSI) Page | 14
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
issue du rapprochement depuis les annes 2000 de la confdration internationale des syndicats libres et de la confdration mondiale du travail, lInternational Trade Union Confederation (ITUC), linternationaler die bersachpunt (IGB) fonde en 2006. Cette configuration internationale des syndicats a son sige Bruxelles, elle se veut unitaire et pluraliste, ouverte aux centrales syndicales nationales, dmocratiques, indpendantes et reprsentatives. La constitution de cette configuration internationale a pour but des actions de lobbying auprs des institutions multilatrales telles que la banque mondiale, le FMI ou lOMC. La CSI a galement pour objectif de se confronter aux entreprises multinationales et daccentuer les rapprochements avec dautres organisations de la socit civile notamment les ONG dans le cadre des programmes sociaux mondiaux.
Page | 15
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
Chapitre 3 : Les relations collectives : conflit et ngociation
ILes conflits
Les conflits du travail peuvent prendre de multiples formes. a peut impliquer un travailleur particulier (conflit individuel) un groupe de travailleurs (conflit collectif). Au plan juridique, les conflits peuvent porter sur les mises en uvre et linterprtation dun droit existant entrin ou non par la loi, la convention collective, contrat de travail. Ils surviennent gnralement l o la ngociation collective a chou et en gnral les lgislations prvoient des procdures de rglement des conflits. En particulier des procdures volontaires dont conviennent les parties elles-mmes. Elles peuvent prendre diffrentes formes : conciliation, mdiation, arbitrage ou une dcision judiciaire classique sachant quen droit du travail la juridiction est le conseil des prudhommes (prsident magistrat et une composition salaris employeurs galitaire). Lorganisation internationale du travail aide et encourage les tats amliorer le rglement des conflits mises en place et mettre sur pieds des institutions de prvention et de rsolution de ces conflits. La tendance tant une responsabilisation de plus en plus forte des partenaires sociaux. Des encouragements donns visent renforcer le fonctionnement dmocratique des rpubliques et promouvoir la stabilit conomique et politique. Mouvement social : en histoire cest lensemble des vnements au cours desquels certains groupes tentent de modifier lorganisation de la socit en fonction de leurs ido. La dfinition en science politique est proche de cette interprtation. Trs souvent on voque des actions qui se veulent pour la recherche du progrs social. En sociologie, le mouvement social est la mobilisation de rseaux composs dorganisations ou dindividus isols se structurants sur des valeurs partags et sur la solidarit pour dfendre des enjeux conflictuels en ayant recours la protestation. Les mouvements sociaux ont pris des formes diffrentes selon les pays et les poques. En histoire on en parle propos des luttes pendant la rvolution, syndicats et les mouvements du 19me sicle. Au 20me sicle les mouvements taient de plus en plus institutionnaliss du fait de lexistence des syndicats. Nanmoins les formes dactions sont varies. Cela va de la simple ptition lmeute en passant par les manifestations, les grves, les occupations. La ngociation collective : elle a lieu entre un employeur ou un groupe demployeurs, organisation demployeurs et une ou plusieurs organisations de travailleurs. Elle peut intervenir diffrents niveaux. Lunit de production dune entreprise, la totalit de lentreprise, un secteur dactivit, une rgion, une nation. La ngociation collective de travail a une double fonction : dterminer les conditions de travail et les salaires qui vont prvaloir pour un ou plusieurs groupes donns de travailleurs, elle offre aux employeurs comme aux travailleurs la possibilit de dfinir les rgles qui rgissent leurs relations. Lintrt de la ngociation collective est que les conditions de travail et les salaires ngocis le sont en principe plus quitablement du fait de lexpression collective des voix. De mme, la forme collective permet dinfluer sur les dcisions concernant le personnel dans lentreprise. En principe elle permet une rpartition Page | 16
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
quitable des avantages qui rsulte du progrs technologique et dune meilleure productivit conscutive. Pour les employeurs, ils recherchent des relations professionnelles durables, un maintient dun climat stable et un ajustement des conditions de travail la modernisation et la restructuration. Pour que la ngociation collective fonctionne il faut respecter des conditions, une constitution dmocratique, un cadre juridique appropri qui garantissent lindpendance et la participation effective des partenaires sociaux. Dialogue social : il vise promouvoir les possibilits pour les femmes comme pour les hommes de prtendre un travail dcent et productif dans un climat de libert, dquit, de scurit et de dignit humaine. Dfinition de lOIT, elle inclut toutes formes de ngociations, de consultations voire le simple change dinformations se droulant en prsence ou non de gouvernement entre employeur et travailleur. Le processus peut tre tripartite ou bipartite lorsquil implique uniquement main duvre et direction ou syndicats et organisation demployeurs. La participation du gouvernement peut tre directe ou indirecte. La concertation est prendre mutuellement la vie des uns des autres en vue de la mise au point du projet commun. Cest trouver un accord en vue de laction. Cette concertation peut tre informelle, institutionnalise ou les deux la fois. A nouveau on peut la retrouver diffrents niveaux depuis lentreprise jusquau national. Elle peut tre interprofessionnelle ou sectorielle ou les deux. Lobjectif du dialogue social est de favoriser le consensus, encourager la participation dmocratique des diffrentes parties prenante au monde du travail en vue de rsoudre des problmes conomiques et sociaux, de grer les affaires sociales, de maintenir la stabilit dans ce domaine tout en stimulant le progrs conomique. La grve est un autre concept. Cest une action collective qui consiste en une cessation concerte du travail par les salaris. Le plus souvent elle intervient linitiative des syndicats. Le mouvement peut se situer diffrents niveaux : entreprise, secteur conomique, catgorie professionnelle, activit productive La grve ne prend pas forcment une tournure spectaculaire, a peut tre un arrt de travail pendant quelques heures comme a peut tre un blocage complet, adoption de mesures destines gagner lopinion publique, induire des manifestations, parfois a saccompagne dactions illgales voire pnalement rprhensibles (chantages environnementaux, squestrations par exemples). Il y a souvent des constitutions de piquets de grves. Leur but est dentraner les salaris non grvistes rejoindre la grve. Ils sont lgaux tant quils ne conduisent pas un blocage total de la production. Sinon on porte atteinte au principe constitutionnel qui affirme la libert du travail. Au plan financier, les grvistes ne sont pas rmunrs. La non production est une perte pour lentreprise. Selon les pays, le statut juridique de la grve diffre depuis linterdiction pure et simple jusqu lencadrement lgislatif voire la reconnaissance constitutionnelle. Dans les pays o la grve est lgale, certaines professions en ont un droit limit (militaires, pompiers). La premire grve apparait dans lantiquit, il date de lEgypte au moment de la valle des rois 12 sicles av J.C. o on a retrouv des contestations des ouvriers. Sous lancien rgime, il y avait des rpressions. Avec la loi Le Chapelier sous la rvolution linterdiction des corporations et des groupements rendait la grve illgale. La premire grande grve du 19 sicle est ce quon a appel la grve des canus1 en 1831 Lyon. Jusquen 1864 la grve en France tait interdite ce qui voulait dire que non
Ouvriers du tissage.
Page | 17
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
seulement les ouvriers qui ne se prsentaient pas au travail perdaient leur salaire et risquaient dtre arrts, jugs et emprisonns. Cest sous la phase librale de lempire de Napolon III quest intervenu le mouvement de rforme avec la reconnaissance du droit de grve. Le droit a t reconnu en Angleterre en 1859. A la suite de la reconnaissance du droit de grve en France, de nombreux mouvements ont eu lieux. Par exemple dans la dcennie 1870 il y a eu prs dun millier de mouvements de grves. Grve du 1er 1891 Fourmies avait fait 9 morts. Aux alentours des annes 1890 les syndicats sont de plus en plus prsents dans les conflits mme sils ne les organisent pas toujours. Le principe de grve gnral date de 1880 avec le blocage de villes entires, de branches dindustries voire de rgions avec des revendications en lien avec le salaire, dure du travail, indemnisations daccidents du travail, indemnisation du chmage. La notion de rduction du temps du travail a t un des thmes trs importants au long de lhistoire en ce qui concerne les mouvements sociaux. La journe du 1er mai est une cration de 1889. Elle tait reconnue comme journe annuelle de grve pour ramener la journe de travail 8 heures. En France la premire grve caractre national date de 1906. Cest en 1919 que lon trouve la notion de jour de 8 heures, semaine 48 heures, les trois huit. Cest cette poque quapparait la notion de droit du travail. La grve jusque dans les annes 1950 est interprte comme une rupture du contrat de travail. Ensuite, cela a t considr comme une suspension. Ce qui faisait la rsistance fasse aux grves ctait la crainte des employeurs comme des gouvernements pour loutil de production (destruction, dgradations), la perte de rentabilit du fait des arrts de travail, les baisses de cadences et des blocages dune industrie lautre. Ce qui reste encore cest la grve gnrale de juin 1936, cest elle qui a permis lobtention des congs pays, reconnaissance des conventions collectives, cration des dlgus du personnel. A certains moments la grve prend une tournure politique. Cest ainsi quil y a eu la grve du 12 fvrier 1934 contre le fascisme, la grande grve de 1944 laquelle se sont associs tous les fonctionnaires pour la libration de Paris. Dans notre constitution de la 5me rpublique, on ne parle pas du droit de grve. Cest une dcision du conseil constitutionnel de 1971 qui a donn valeur constitutionnelle au prambule de la constitution de 1946 dans lequel on fait allusion au droit de grve qui de ce fait a induit le droit de grve. En ce qui concerne les fonctionnaires, cest un arrt de juillet 1950, conseil dtat, qui a affirm et prcis les conditions du droit de grve dans la fonction publique. En 1968, les vnements du mois de mai ont lieu peu prs en mme temps partout dans le monde avec une coloration lie aux manifestations tudiantes qui sont rejointes par une importante grve gnrale. La paralysie recherche du pays lpoque saccompagnait dune frnsie de dbats, de discutions dAG. Depuis, diffrentes grve ont eu lieu dans les annes 1980 dont beaucoup dans la fonction publique. En 1995, le nombre moyen annuel de jours de grve a t six fois suprieur la moyenne des dix ans antrieurs. Chirac a t lu cette anne l sur le thme de la fracture sociale. En 1997, la suite de la dcision de Renault de fermer un site en Belgique et de supprimer plus de 3 000 emplois dclenche un mouvement dampleur europenne. Cest la premire euro grve. Des sociologues ont travaills sur ces vnements. Parmi eux Reynaud a sorti ds 1982 un ouvrage dans lequel il analyse lapparition, les modalits, les conditions de russite des grves. Il les voque comme des actions collectives par opposition aux dcisions individuelles comme labsentisme. Il distingue entre conflits ouverts et conflits latents. Considrant que le conflit latent peut naitre dun sentiment dinjustice sans consquence visible qui peut impliquer de la frustration voire du dsaccord mais que se solde par de la rsignation alors que le conflit ouvert Page | 18
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
est la grve. Pour lui, labsentisme voire la dmission ou les faibles rendements sont des voies prives de contestation. Toujours partir du conflit latent il introduit un troisime type danalyse en considrant linterdpendance des acteurs, il parle de relchement, de dbrailliage voire de sabotage. Ce type de mouvement se produit sans concertation pralable, cest une raction muette mais consensuelle. A propos de la grve, il souligne que lorsque le conflit clate aucune des deux parties ne connait lavance son issue puisque compte tenu du caractre trs couteux pour chacune des parties de la grve par dfinition si le rsultat tait prvu on aurait vit le conflit. Quand on regarde le droit du travail, la notion de grve est quasi absente des textes. On retrouve dans larticle L 521-1 du code du travail lindication que le salari ne peut pas tre pnalis pour avoir fait grve. Selon le code le droit de grve est un droit individuel pour autant il faut tre au moins deux pour faire grve. Il ny a rien sur les assembles de salaris, sur les pravis. Cest lordonnance du 12 mars 2007 qui a introduit cette notion que lon retrouve aux articles L 2512-1 et L 2512-2 du code du travail qui dit que la cessation concerte dorganismes publics doit tre prcde dun pravis de grve dpos par une organisation syndicale reprsentant au niveau nationale ou au niveau de lentreprise le service cessant le travail. Les articles L 124-2 et L 124-3 du code du travail et larticle L 122-3 concernent lemployeur face la grve. Il est possible dembaucher pendant une grve des CDD sils sont maintenus aprs la grve. Cela ninterdit pas laide de bnvoles ou laide extrieure. La jurisprudence est intervenue pour limiter le droit de grve au regard des abus. Notamment lorsque la grve est mise au service dintrts professionnels non lgitimes en particulier lorsque le motif est purement politique, grve perle ou grve tournante dans la fonction publique. Le code voque la notion de dlit dentrave lorsque la grve empche certains salaris deffectu leur travail, article L 2328-1. Concernant les services publics les conditions sont plus restrictives (voir dbat sur le service minimum). Certaines professions peuvent faire lobjet de rquisition cest le cas notamment en sant, dans lducation nationale. Les tudiants et les lycens ne peuvent pas faire grve mais les mouvements collectifs de protestation existent. Les tudiants votent en AG et dcident ou non daller aux cours. Lvolution de ces dernires annes a montr quun certain nombre de grve dans des domaines inhabituels ont eu lieu (buralistes, chauffeurs de taxi, mdecins).
II-
Les ngociations
Les ngociations dbouchent sur des accords, des conventions. Le conflit intervient une fois que la ngociation a chou. Les ngociations traitent des conditions de travail, les rmunrations la manire dont on va russir produire ensemble dans lentreprise. La ngociation dune convention ou dun accord va permettre dadapter les rgles du code du travail aux spcificits des besoins de lactivit. En principe se sont les dlgus syndicaux qui ngocient auprs de lemployeur. Mais pour favoriser la ngociation dans les petites entreprises o les syndicats sont peu prsents, des accords peuvent tre conclus sous certaines conditions par les reprsentants lus du personnel ou ds lors quil ny a pas de dmarches ou dlus par un membre spcifiquement mandat par ses collgues. Au regard du droit du travail, les accords dentreprise sont soumis certaines conditions de validit et au respect de certaines formalits. Page | 19
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
La particularit de laspect conventionnel : un accord collectif ne peut quamliorer les conditions des salaris par rapport aux dispositions lgales ou rglementaires. Sous peine dencourir des sanctions pour discrimination syndicale, un employeur doit inviter toutes les organisations reprsentes la ngociation et le temps pass en ngociation est pay comme un temps de travail puisque lemployeur est linitiative des discussions et nest pas dcompt des crdits dheures dont dispose les reprsentants syndicaux pour leurs propres dmarches. Pour tre valable, laccord doit tre approuv par une commission paritaire nationale si ce sont les reprsentants du Comit dEntreprise et lorsquil sagit dun salari mandat il faut que la validation intervienne par un vote la majorit des suffrages exprims. Tout ce domaine des ngociations est repris dans les articles L 2232-21 29 du code du travail. Un certain nombre de conditions sont ncessaires : lindpendance des ngociations vis--vis de lemployeur, une laboration conjointe de projet daccord entre ngociateurs, la concertation et la facult de consulter les organisations syndicales reprsentatives et pour les ngociateurs. Ds lors quil y a des sections syndicales dans lentreprise, lemployeur doit tous les ans convoquer les dlgus syndicaux pour ngocier sur les salaires effectifs, lorganisation et la dure du travail (mise en place de temps partiel). On regarde lvolution de lemploi dans lentreprise, on voque les mesures relatives linsertion professionnelles, lemployeur handicap. Si lemployeur ne prend pas linitiative dorganiser les ngociations dans lanne, une organisation syndicale reprsentative peut dclencher la ngociation qui devra sengager dans les 15 jours suivant sa demande. Loi de dcembre 2008 qui prvoit des sanctions en cas de non respect avec notamment la perte de certaines rductions sociales. Dans le cadre de ces ngociations sur les salaires effectifs il y a avait les mesures destines supprimer les carts de rmunrations entre les hommes et les femmes, le dlai est au 31 dcembre 2010. Un diagnostic des carts a d tre conduit pour tablir une situation. Ce travail est prvu dans une circulaire de 2007. Si un accord collectif en faveur de lgalit professionnelle homme femme a t sign dans lentreprise, une ngociation a lieu tous les trois ans. De mme, pour linsertion professionnelle et le maintient dans lemploi des travailleurs handicaps la priodicit de trois ans a t retenue. Avec toujours le mme processus. Concernant lpargne salariale, lemployeur est tenu dengager chaque anne des ngociations sur les diffrents dispositifs : participation, intressement, plan dpargne entreprise. De la mme faon, lorsque les salari ne sont pas couvert par un accord de branche ou dentreprise, dans le domaine de la prvoyance maladie (prise en charge de lincapacit et des frais mdicaux) lemployeur est tenu dengager chaque anne une ngociation dans le domaine de la prvoyance maladie complmentaire. Le fait pour un employeur de ne pas prendre linitiative dengager les ngociations peut constituer un dlit dentrave au droit syndical. En revanche, lobligation des ngocis ne veut pas dire obligation de conclure. On peut tablir un procs verbal de dsaccord qui sera adress la direction dpartementale du travail. Parmi les ngociations qui doivent avoir lieu tous les trois ans, pour les entreprises qui occupent au moins 300 salaris en France, les ngociations doivent porter sur les modalits dinformation et de consultation du CE, sur la stratgie de lentreprise et sur les effets que cette stratgie pourrait avoir sur lemploi, les salaires. La ngociation porte aussi sur la mise en place dun dispositif prvisionnel de lemploi et des comptences. Elles portent aussi sur la formation et sur la validation des acquis dexprience. De la mme manire, il y a des informations sur les conditions daccs et de maintient sur les salaris gs. Page | 20
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
Il existe des axes de ngociations libres dans les entreprises. Par exemple : les congs, les modalits de travail, la manire darriver au rsultat souhait par la stratgie. Dans le cadre des ngociations, le lgislateur dfini tout ce quil y a lieu de remettre aux dlgus pour que linformation soit bien faite. Cela doit tre transmis la direction dpartementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ds lors quon a des accords dentreprises. Il peut y avoir des accords de branches, des accords inter professionnels (dans le domaine de la formation professionnelle) ce sont des accords conclus au niveau national valables pour plusieurs professionnels ayant pour but dassurer une cohsion densemble des diffrents niveaux de ngociation. On parlera dadhsion lorsquune partie non signataire dune convention ou dun accord sign adhre au texte. Il faut adhsion lensemble du texte. Les conventions collectives nationales ou dentreprises sont des accords crits relatifs aux conditions demploi, de travail et aux garanties sociales applicables dans les contrats de travail individuels. Ils sont ngocis entre les partenaires sociaux, ventuellement les salaris. Dans certains cas on parle de convention collective tendu ou largi. On emploi ces termes lorsque la convention collective devient obligatoire dans un champ professionnel plus grand que celui pour lequel il avait t initialement ngoci. Llargissement se fait par arrt ministriel. Il rend applicable un secteur professionnel ou gographique donn une convention ou un accord collectif. Il y a publication au journal officiel. Lextension cest lorsque la convention collective devient obligatoire pour lensemble du champ professionnel et territorial. La commission nationale de la ngociation collective transmet son avis au ministre du travail et le ministre du travail prend un arrt dextension avec nouveau publication au journal officiel. Le pivot de la ngociation collective en matire de lgislation est les lois Auroux prises en 1982. La loi de 2008 est le prolongement sur le poids des partenaires sociaux en Europe.
Page | 21
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
Chapitre 4 : La notion demploi et de chmage
Le Bureau International du Travail a adopt une dfinition en 1982 : Un chmeur est une personne en ge de travailler (15 ans et plus) qui est simultanment sans emploi c'est--dire quelle na pas travaill ne serait-ce quune heure durant une semaine de rfrence qui est disponible pour prendre un emploi dans les quinze jours et qui a cherch activement un emploi dans le mois prcdant ou qui en a trouv un qui commence dans moins de trois mois. Ple emploi regroupe lANPE et les Assedics (association emploi dans lindustrie et le commerce). LUNEDIC est form par les partenaires sociaux. La rforme de ple emploi est de faire correspondre un organisme des partenaires sociaux avec une agence nationale. Au regard du chmage en France, le nombre des inscrits ple emploi reprsente un actif sur six savoir 4,6 millions. Dans les inscrits ple emploi, il y a des gens qui ne sont pas chmeurs au sens strict, il y a des personnes en formation, dans des contrats de transition professionnelle, qui relve des conventions de reclassement personnaliss et les employs. Les demandeurs demplois proprement parl sont de lordre de 3,7 millions c'est--dire un actif sur sept. Parmi les gens inscrits ple emploi et vritable demandeur demplois, ceux qui nont pas du tout travaill en octobre 2010 tait de lordre dun actif sur dix en grande partie d au redmarrage de lintrim de ces derniers mois. Pour les chmeurs longue dure on retrouve un actif sur vingt, il y en a plus dun million. Parmi les catgories que regardent les sociologues, ils analysent la notion de taux demploi c'est-dire que la proportion des personnes dans une tranche dge donne a un travail. Pour lensemble des 15 64 ans, la baisse du taux demploi est de un point depuis mi-2008. Dans cette catgorie, les 25 49 ans ont t les plus frapps. De la mme manire, les hommes ont t plus frapps que les femmes. Le taux demploi des moins de 25 ans est faible en France, il a recul galement l o depuis les derniers mois lemploi des plus de 50 ans a progress.
[Quel est leffet des aides lemploi ? Ce quon en pense. Pourquoi la chute de lemploi a t plus limite que dans les rcessions antrieures ?]
La loi de dcentralisation sur les collectivits locales va limiter les embauches. Lemploi public global stagne depuis 2008. Le taux de chmage qui tait plus fort chez les femmes devient peu prs le mme. En revanche il est diffrenci selon les catgories sociales. Les ouvriers sont les plus touchs. Pour autant les gains de productivit, lindustrialisation ont de manire conjugue amen une baisse des emplois des employs. La notion de taux dactivit : volution de la population active, comment volue lensemble form par les personnes en emploi plus les chmeurs ? Or il se trouve que lemploi des femmes a continu progresser depuis plusieurs dcennies, la proportion de femmes de 15 64 ans en emploi continu progresser. On anticipe une hausse de trois points du taux dactivit dici 2020 qui vient de se que les femmes continuent travailler et de ce que les sniors vont devoir plus travailler. Pour le march de lemploi, le taux dactivit global franais Page | 22
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
on anticipe une augmentation de 110 000 personnes par an. Laugmentation du taux dactivit fait que si on veut diviser par deux le nombre des chmeurs, il faut que lconomie soit capable de pourvoir une cration demplois de lordre de 150 000 emplois par an compte tenu du nombre en progression du taux dactivit. (Chiffres novembre 2010). Les politiques publiques sont lensemble des actions coordonnes mises en uvre avec pour objectif une modification ou une volution dune situation donne. Toutes les interventions sont dans tous les pays sont le rsultat de lhistoire. Intervention publique : les questions sociales ne se limitent pas au problme du travail proprement dit ou au problme de la scurit sociale, a englobe la politique du travail (notion dhoraires, types de contrats). En 1960 la France comptait 20 million dactifs, en 2000 environ 26 millions. Les tranches dges tournent autour de 25 45 ans. La population active se fminise. Au fil du temps la population active tudie par les sociologues volue au mme titre que lactivit elle-mme, change de visage, dge, de profil et de la mme manire linactivit dans son concept lui-mme va voluer. Pour les sociologues ils observent les transformations et comment les difficults de chmage, demploi sont mouvantes afin dtudier en profondeur les normes sociales qui permettent de dfinir ce quest un emploi, de dire qui y a lgitimement droit, reprer ceux qui y ont effectivement accs. Quest-ce quon considre comme chmage ? Quelle diffrence entre non emploi et linactivit ? La population active est compose des personnes et des catgories qui sont la fois socialement lgitimes, socialement capables mais aussi socialement mobilises. De la mme manire on va se demander qui est capable doccuper un tel emploi ? Reprer ceux qui en recherchent effectivement. Les catgories voluent selon les priodes et selon les configurations sociales. Llargissement de la population active en 40 ans nest pas le fait dune simple addition, elle rsulte de deux mouvements inverses : une addition des femmes (prs de 6 millions de femmes en plus au travail entre 1962 et 2002) et une soustraction aux deux niveaux : moins dactifs de moins de 25 ans et une baisse considrable des plus de 55 ans au travail. Les sociologues vont sinterroger sur ces statistiques, chercher do viennent ces chiffres. Causes : niveau de scolarit obligatoire, abaissement de lge de la retraite partir de 1981 sachant que la crise de lemploi a ensuite pris le relai de ces deux phnomnes pour amplifier le mouvement. Laugmentation du temps de scolarit sest double dun temps plus long pour linsertion professionnelle et labaissement de lge lgal de 65 60 a t amplifi par la multiplication des prretraites jusquau coup darrt par la loi Fillon de 2003. Pour que les politiques sociales voluent il fallait une prise de conscience de ce que ces dparts prcoces devenaient des handicaps pour la socit. En ce qui concerne le travail des femmes, sauf dans la vision trs rcente, a ntait pas la politique sociale qui encourageait le travail des femmes. Cest lvolution de socit, une volont des femmes de trouver leur place dans la socit. Lorsquon va tudier la population active, on va commencer par observer lge au travail. Cette notion se rescinde en deux autres notions : lge de travailler et lge des travailleurs qui sont les taux dactivits rels par tranches dges. Actuellement, 18 ans comme 55 ans on est en ge de travailler mais quand on regarde les statistiques depuis le 21me sicle, on constate que de moins en moins de gens travaillent 18 ou 55 ans. Lge de travailler a t plusieurs fois Page | 23
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
modifi sous langle des deux bornes : lge de scolarit obligatoire (plancher) et lge de retrait dactivit. Pendant tout le 19me sicle et jusquau milieu du 20me on ne parlait que du plancher : plus de 10 ans au 19me sicle, plus de 13 ans de 1881 1936, plus de 14 ans de 1946 1955. Ce nest qu partir des annes 1960 quon voque le plafond. Il na cess de baisser jusqu descendre 60 ans en 1981. Si on regarde ces chiffres concernant lge de travailler, on saperoit que du dbut des annes 60 la fin des annes 90 la population en ge de travailler a perdu 13 ans. Lge des travailleurs : cest le taux dactivit par tranche dge. Lge rel au travail a une volution encore plus accuse que celle de lge de travailler. On est dans une tendance gnrale la baisse depuis la fin du 19me sicle avec le maximum dampleur dans la seconde moiti du 20me. Les taux dactivit des hommes de 15 24 ans comme les taux dactivit des hommes de plus de 55 ans ont t divis par deux et dans certains cas par trois. Ces statistiques franaises vont tre rapproches des chiffres internationaux. On constate que la quasi-totalit des pays de lOCDE connaissent depuis 30 ans la mme tendance au raccourcissement du temps dactivit. Nous sommes le pays o la tendance et les effets ont t les plus marqus. Nous avons la plus forte intensit. En Allemagne et en Espagne la tendance est semblable mais la pente de la courbe est plus douce. Au Japon la situation est stable depuis le milieu des annes 60 et aux USA on observe des tendances diffrentes avec une stagnation de lactivit des jeunes hommes, une forte augmentation de lactivit des jeunes femmes, une diminution de lactivit des hommes de 55 64 ans et une augmentation de lactivit des femmes du mme ge. En Angleterre, lactivit des moins de 25 ans est leve mais fluctuante, lactivit des personnes de 55 64 ans un peu augment pour les femmes, beaucoup baiss pour les hommes. Dans les pays industrialiss on retrouve le raccourcissement de lge de lactivit, pour autant les configurations sont varies parce quelles sont le produit des mesures pour lemploi et dautres axes politiques qui ne sont pas directement en lien avec le march du travail mais qui influence la population active. En France les volutions concernant lge de lactivit ont donn lieu de nombreuses recherches. Les travaux portent sur lactivit de telle ou telle catgorie dge plus que sur les effets des transformations de lge au travail. Dans les annes 80 les chercheurs se sont interrogs sur la crise des valeurs, lallergie au travail qui avait marqu la priode des annes 70. Dans le contexte des annes 80 ils ont volu dans leur rflexion en faisant porter leurs tudes sur les difficults de linsertion professionnelle, sur les modalits daccs au march du travail et cest le dbut des tudes sur les problmes dexclusion du fait du chmage. Travaux de Claude Dubar sur la socialisation professionnelle, il analyse les dispositifs dinsertion, il les considre comme un espace social, structur par les organismes chargs de la formation et de lorientation. En parallle et la mme priode on trouve des sociologues qui travaillent sur la socialisation lexclusion en 1987 avec les crits de Dubet sur la galre. Plusieurs sociologues retravaillent lide de prcarit. Certains considrent que cest une stratgie dadaptation des jeunes aux turbulences du march du travail, analyse de Nicole Drancourt dans les annes 1992 1994. Pendant toute cette priode, les sociologues du travail vont porter sur la reconstitution de trajectoire professionnelle, sociale et familiale des jeunes (travaux de Bouffartigues) et on trouve aussi les travaux de Linhart qui a essay de comprendre leur rapport au syndicalisme et laction collective. Toute une varit de travaux en lien avec lge avec deux points communs : ltude des processus travers les trajectoires, les
Page | 24
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
itinraires des gens au travail et linsertion professionnelle, sur le statut social li lacquisition dun emploi ou sur lexprience du chmage. Les recherches sur les travailleurs ges cette poque sont beaucoup moins nombreuses. Elles sont parties de linvention du troisime ge et ont port sur lincidence des politiques publiques quant la sortie de lactivit. Travaux dAnne-Marie Guillemard o elle traite de la redfinition sociale de la vieillesse et de la retraite. Les sociologues ont montr que pour les salaris la sortie dfinitive de la vie professionnelle stale sur une priode de 10 15 ans. Les dparts la retraite ne sont pas aussi transparents quon peut le penser du fait des priodes de chmage, des prretraites, des invalidits, dune inactivit contrainte. Le sexe de lemploi : croissance sans prcdant de lactivit professionnelle des femmes partir des annes 1960. Les historiens, les conomistes comme les sociologues reconnaissent que les femmes ont toujours travaill mais ce qui a chang se sont les modalits de leur activit, sa traduction en statut socialement dfini. La nouveaut est le salariat des femmes. Les femmes ont toujours constitu une part importante de la population active en France mais il tait difficile de mesurer lactivit des femmes notamment au regard du travail agricole au dbut du 20me sicle, les statistiques ne sont pas claires ce niveau. Au dbut des annes 60, la fminisation de la population sest maintenue malgr la crise de lemploi et linstallation du chmage. Entre 75 et 79 la population active de la France a grossi de 4,5 millions de personnes dont 4,1 millions de femmes et 400 000 hommes. Ce qui est vrai en France se vrifie peu prs partout en Europe. Pour lensemble des pays les taux dactivit fminin sont en hausse constante depuis les annes 60 alors que ceux masculins diminuent ou stagnes. On assiste une volution significative du travail masculin et fminin dans lactivit conomique, un rquilibrage des sexes sur le march du travail. Autre tendance : homognisation des comportements de lactivit masculin et fminin. On assiste une rupture sociologique, dplacement des normes sociales qui rgissent les comportements vis--vis du march du travail. Si cette croissance est lvnement principal des quarante dernires annes, il a pour autant t analys de faon plus incertaine. Cest partir des travaux de lINSEE quon a soulign la transformation des comportements, les conomistes ont insist sur la place et le poids des femmes dans les mouvements de main duvre et dans lexpansion du salariat mais les mcanismes sociaux eux-mmes ont t peu expliqus. Ltude de production des mcanismes du chmage taient laiss aux conomistes. Ces derniers se chargeaient de la thorie du chmage (Keynes) et des dterminants de la pnurie demplois et les sociologues sintressaient au vcu des chmeurs, se contentaient danalyser les consquences de la privation de lemploi. Dans les annes 80 on a vu merger des lections sur le concept de chmage qui ont creus ces contours, son histoire, sa gense sans se confondre avec la mesure du phnomne. Pour autant, la plupart des tudes partent de questionnement du type qui sont-ils ces chmeurs ? Combien sont-ils ? Sont-ils tous vraiment chmeurs ? Les at-on tous rellement recens ? On voit que ds lors quon pose ces questions on se situe dans des dbats autant statistiques, politiques, conomiques que sociologiques. Si lon part de la mesure du chmage, en France on a trois type dinstrument de mesure qui sont des systmes
Page | 25
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
dinclusion ou dexclusion du non emploi dans lactivit. Un chmeur est un actif priv demploi mais tous les sans emploi ne sont pas des chmeurs. Plusieurs manires de mesurer le chmage : le chmage au sens du BIT, lINSEE se rfre aussi la population sans emploi la recherche dun emploi. Cest un sous ensemble qui exclut les personnes sans emploi pour le moment mais qui en ont trouv un. Autre mesure qui concerne les demandes demploi en fin de mois. Cest ce quon utilise Ple emploi, cest le DEFN. Cest ce quon retrouve dans la presse sous le titre les chiffres du chmage. En ralit il y a un double chiffre : une premire catgorie qui exclu les demandeurs demplois qui ont eu une activit rduite de 78 heures tandis que les autres les inclus. Lorsquon limine les demandeurs demplois qui ont eu une activit rduite, a permet de distinguer le chmage vritable des emplois temps partiel courts. Le troisime type de mesure rencontr est le chmage tel quil rsulte du recensement. Cest un aspect plus subjectif puisque dans les recensements effectus par lINSEE on considre comme chmeurs tous ceux qui en font la dclaration. Il faut donc bien prciser la dfinition laquelle on se rfre quand on parle de statistiques. Les mesures sont variables. Il y a un problme de lhtrognit, diversit, ingalit lintrieur de la situation de chmage. Selon quon se rfre lune ou lautre des mesures les catgories de chmeurs sont plus ou moins fortes. Il y a une diffrence entre le chmage masculin et le chmage fminin et notamment ces diffrences sont accentues lorsquon calcule les taux en fonction des dclarations des recensements ou en fonction de lANPE. De la mme manire, les critres du BIT attnues le chmage des plus de 50 ans. Le dcalage entre ces dfinitions pose le problme de la dfinition de la frontire entre chmage et inactivit. Cette diversit se retrouve parce quau travers dun taux de chmage global de lordre de 8-9 % on a une fourchette qui va de un peu plus de 7 % pour les hommes de 25 49 ans plus de 22 % pour les femmes de moins de 25 ans. Selon la mesure laquelle on se rfre il est trs important de le mentionner puisque les variations sont trs diffrentes et aigues selon les catgories de population quon considre. a renvoi aussi la flexibilit face lemploi. Des formes particulires demploi peuvent tre apprhendes. Bien videmment cest llment central de la demande de flexibilit des employeurs, cest aussi un argument en termes de moyen dinsertion pour les catgories en difficults mme si le lien entre flexibilit et insertion nest pas toujours facile observer. Plusieurs dispositifs se sont succder en France et le bilan est assez contrast avec globalement des rsultats peu satisfaisant au regard de linsertion. La flexibilit revt diffrentes forme et recouvre divers ralit. Mais elle rpond une volont de facilit dadaptation des entreprises un environnement de plus en plus instable parce quen continuel changement. Elle renvoi lensemble de lorganisation du travail au sens dadaptabilit de lorganisation productive, au concept de polyvalence des tches, dadaptabilit des travailleurs au changement de poste, la capacit mobiliser des forces de travail en lien avec un affaiblissement des contraintes juridiques qui rgissent le contrat de travail. Elle renvoi aussi la notion damnagement du temps de travail et donc un ajustement du temps dactivit des salaris la charge du travail des entreprises. a renvoi la gestion de lchelle des rmunrations et une individualisation des salaires en fonction de lactivit et du temps de travail. Cette notion de flexibilit de lemploi concerne lensemble des composants du rapport Page | 26
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
salarial depuis lorganisation jusquau contenu de lemploi, au temps attribu mais aussi aux rgles de droit quils rgissent. Lorsque les sociologues observent la notion de flexibilit, ils sy intressent avant tout comme une pratique de gestion, de mobilisation du personnel et ils distinguent la flexibilit interne et la flexibilit externe. La flexibilit externe comprend aussi bien le recours au travail intrimaire, lappel la sous-traitance que lemploi de salaris en CDD. Dans la mobilit interne on retrouve le ramnagement de la mobilit de gestion de la main duvre, laction sur les horaires et les formes de mise au travail. Le recours de plus en plus frquent la flexibilit externe a crer des formes atypiques demplois et participent la prcarisation. Sous cet angle, cela porte atteinte aux normes de rfrence habituelles du travail. On constate que certains salaris cumulent les handicaps. Parmi cela on note labsence de qualification, phnomne qui sest amplifi avec le management par les comptences. Cela renforce le clivage, aggrave le phnomne de disqualification des salaris qui nont pas pu acqurir ces comptences. On retrouve la notion demployabilit, ce sont donc les qualits qui sont reconnues pour aider la performance de lentreprise. Cette gestion des comptences ne se contente pas de classer, de hirarchiser les salaris, elle aggrave les fractures. Le chmage reste un sujet dtude priphrique pour les sociologues, trs peu tudi avant les annes 1980. Plus observ aujourdhui. Pour Freyssinet, le chmage est source de scandale individuel et social, il souligne que les individus qui cherchent vainement un emploi sont dans une position dinfriorit qui va bien au-del du ressenti sur les revenus, cest plus un ressenti dexclusion qui perturbe aussi bien leurs relations avec lenvironnement immdiat que leur propre quilibre et leur dveloppement personnel. Il voque lide dun taux de chmage naturel qui est de plus en plus couramment admis. Pour lui il existe trois facteurs fondamentaux de chmage qui amnent souvent des fausses pistes : le chmage est d lafflux de nouveaux arrivants sur le march du travail ou la prsence injustifie de certaines catgories de population, le chmage est d aux chmeurs eux-mmes, le progrs techniques. Le chmage sexpliquerait soit par les caractristiques du march de lemploi, soit par les comportements des chmeurs. On voit que tous ces arguments sont fonds sur des variations qualitatives de la population active. Freyssinet parle de chmage dinadaptation et voque la modification des structures de lemploi par lconomie. Du fait des perturbations du systme conomique se produisent des degrs divers des inadaptations dans le domaine de la formation au regard de la qualification des emplois proposs et les formes de mobilits se trouvent modifies parce quil faut plus longtemps, par exemple, pour changer demploi. Ces inadaptations entraineraient des priodes de chmages plus lourdes pour les salaris qui sont plus aigues pour les CSP les moins qualifies parce quils sont les moins mobiles. Il y a eu des recherches de lien de causalit et les sociologues disent quil y a des corrlations mais pas des causalits tout cela. Chmage volontaire qui serait consquence de stratgie individuelle de recherche demploi : Anne Perrot en 1992 souligne que dans un environnement o linformation est trs partielle sur les diffrents postes de travail disponibles et accessibles, un individu rationnel fait le choix de sabstenir par manque dinformations. Pourtant il nest pas possible de montrer que les facteurs que retient cette thorie du chmage de prospection ait produit un effet sur la dure du chmage volontaire. Les facteurs dinfluence nont pas jou leur rle dans lexplication du phnomne daccroissement du chmage contemporain. Freyssinet pose la question en disant le progrs technique a-t-il un effet ngatif durable sur lemploi du fait de substitution de moyens matriels du travail humain ? Les technologies Page | 27
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
nouvelles compensent-elles le march humain ? De nombreux travaux depuis les annes 1970 ont essay de le dmontrer. Beaucoup de ces dmonstrations sont plus idologiques que scientifiques. Elles apparaissent comme des rsistances conservatrices, un certain refus de linnovation. La relation entre changement technique et chmage existe mais elle nest pas automatique, elle est fonction des processus conomiques et sociaux qui oprent dans trois domaines : les critres dutilisation de la recherche et de slection des innovations, le niveau et les modes de satisfaction des besoins, les conditions dutilisation de la force de travail. Le progrs technique nest pas destructeur ou crateur demplois il intervient en modification des conditions de dtermination du niveau demploi. Il faut analyser les modes de rgulation du systme productif. Le taux de chmage doubler pour les pays de lOCDE entre 1974 et 1980. On tait 3,3 de moyenne en 1973, en 1983 on tait 8,5. Au cercle vertueux qui existait depuis les annes 1960-1970 sest substitu cet effet vicieux de croissance faible et irrgulire. Le taux de chmage na connu une baisse que dans les annes 1990 avec une remonte dans la crise. On est dans un effet structurel de longue dure priodiquement aggrav par des rcessions cycliques mais lobservation du phnomne est rendu dautant plus difficile que les principaux pays de lOCDE ne sont pas homognes. On ne peut pas induire un modle explicatif gnralisable lensemble des pays capitalistes. Diribarne en 1990 propose une logique sociale et des modles culturels et souligne que le chmage nest pas le produit dun dterminisme conomique, il explique que les systmes sociaux ont des solutions diverses pour grer larticulation entre ressources et besoins de main duvre. Il considre que le choix dune solution est fonction des structures sociales et des systmes de valeurs historiquement produits. Evolution du march du travail en France : chmage de longue dure considr part. En 1974, les chmeurs inscrits au chmage depuis un an reprsentaient 12 % des demandeurs demplois, en 2002 ils taient plus de 32 %. Les tudes ont conduis faire voluer la conception mme du chmage. On a tudi les dimensions constituantes du phnomne, la porte explicative en rapport avec le march du travail, le mode dentre au chmage, la structure de la carrire professionnelle antrieure, les diffrentes tapes de chmage en lien avec sa dure, linfluence des vnements en termes dindemnisation de passage par diffrents dispositifs de politique demploi, le mode de sortie, les consquences moyen terme. On est pass dune conception du chmage comme indicateur des tensions sur le march de lemploi la conception dun phnomne complexe qui a des rgulations propres, des institutions spcifiques et dans lesquelles les individus qui le vivent doit laborer des stratgies qui sinscrivent dans la dure. Les sociologues de la fin du 20me sicle ont commenc considrer le chmage comme un univers professionnel comme un autre. Des sociologues ont montr linteraction entre les chmeurs et les agents de ltat. Les chmeurs ont un rle actif dans la dfinition de leur situation et de leur classement, dans les diffrentes catgories dintervention administratives. Plusieurs analyses ont port sur les sorties du chmage partir des indemnisations soit pour conduire linactivit parce que les chmeurs renoncent soit par les stages de formation (y compris retour lemploi) ou en sortant par les contrats aids. Dirribarne voque le refus de dchoir ds lors quil y a arrt de lindemnisation. Dautres sociologues, comme Gauvin en 1992, montrent quil y a un lien entre au niveau dexigence et rapidit de reclassement. Il faut viter la sortie du chmage par le bas. Il ne sagit Page | 28
A.Closse
Sociologie du travail Ressources Humaines
L3 AES
pas de refuser un nouveau dpart dans la vie au prix dune situation temporairement moins leve mais il sagit dviter la spirale de dqualification qui aboutit lexclusion du march du travail du fait demplois prcaires successifs. Les sociologues observent que lorsque la qualification est peu leve, peu dfinie, le travailleur se distingue difficilement du poste quil occupe. Dans ce cas, la dqualification est presque irrversible. Certains travailleurs prcaires alternent des emplois de courte dure et des priodes de chmage, ils ne sont pas considrs comme chmeurs de longue dure pour autant leur niveau et leur condition de vie, leur statut social sont durablement ceux de chmeurs en voie dexclusion (Nicolas HERPIN, 1992).
Page | 29
A.Closse
Vous aimerez peut-être aussi
- Michel Crozier, L'acteur Et Le SystémeDocument17 pagesMichel Crozier, L'acteur Et Le Systémehistoireg100% (1)
- Études de cas en GRH, en relations industrielles et en managementD'EverandÉtudes de cas en GRH, en relations industrielles et en managementÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- La Sociologie Des Organisations by Philippe Bernoux - Bernoux - Philippe - Z Lib - OrgDocument367 pagesLa Sociologie Des Organisations by Philippe Bernoux - Bernoux - Philippe - Z Lib - OrgHalima Bouchikha100% (1)
- Cours Contentieux Administratif, Licence AESDocument69 pagesCours Contentieux Administratif, Licence AESPitchoune6289100% (8)
- Aicha - Marek HALTERDocument280 pagesAicha - Marek HALTERXavier NkongPas encore d'évaluation
- Sociologie Des OrganisationsDocument70 pagesSociologie Des OrganisationsSophie80% (5)
- Cours Sociologie, L2 AESDocument21 pagesCours Sociologie, L2 AESPitchoune6289100% (3)
- Sujet + Corrigé Anthropologie Et Sociologie L1Document6 pagesSujet + Corrigé Anthropologie Et Sociologie L1CarlKaroyan33% (3)
- Grands Problèmes Politiques ContemporainsDocument91 pagesGrands Problèmes Politiques ContemporainsYouness Ian Rams100% (13)
- Les Grands Courants de La Pensée de La Théorie Des OrganisationsDocument6 pagesLes Grands Courants de La Pensée de La Théorie Des Organisationsعبداللهبنزنو75% (4)
- Cours Sociologie PolitiqueDocument14 pagesCours Sociologie PolitiqueDenisa Elena Focaru100% (2)
- Cours de Gestion Des Relations SocialesDocument2 pagesCours de Gestion Des Relations SocialesYedidya Simplice LibiPas encore d'évaluation
- STEINER Philippe.-La Sociologie de Durkheim-La Découverte (2005.) PDFDocument122 pagesSTEINER Philippe.-La Sociologie de Durkheim-La Découverte (2005.) PDFCristiano Desconsi100% (1)
- Cours Économie Internationale, Licence 3 AESDocument31 pagesCours Économie Internationale, Licence 3 AESPitchoune628993% (15)
- Cours Sociologie, L2 AESDocument21 pagesCours Sociologie, L2 AESPitchoune6289100% (3)
- Cours Économie D'entreprise, L2 AESDocument54 pagesCours Économie D'entreprise, L2 AESPitchoune6289100% (9)
- ArmureDocument4 pagesArmureFrederic WustPas encore d'évaluation
- Sociologie de Travail Et Des Orga Master1 GimDocument27 pagesSociologie de Travail Et Des Orga Master1 GimIsidore NEYA100% (2)
- Cours de Sociologie Du TravailDocument39 pagesCours de Sociologie Du Travailzerbo100% (1)
- La Sociologie Du TravailDocument130 pagesLa Sociologie Du Travailfelicity2301100% (4)
- L'ecole Des Relation HumaineDocument11 pagesL'ecole Des Relation HumaineIkram La100% (3)
- Module GRHDocument49 pagesModule GRHdelta200185% (27)
- Cours de Sociologie Organisations Et TravailDocument73 pagesCours de Sociologie Organisations Et TravailPhreedom DvdPas encore d'évaluation
- Concepts Fondamentaux de La SociologieDocument10 pagesConcepts Fondamentaux de La SociologieClem100% (3)
- Sociologie de La PrecariteDocument12 pagesSociologie de La PrecariteVharsha Ramchurn83% (6)
- COURS DE SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION F2a2Document16 pagesCOURS DE SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION F2a2Moustapha Sarr80% (5)
- Thème Cohésion SocialeDocument44 pagesThème Cohésion SocialeMme et Mr Lafon100% (1)
- La Théorie ZDocument27 pagesLa Théorie ZŞããd Zoùàk75% (4)
- Cours Sociologie Des OrganisationsDocument24 pagesCours Sociologie Des OrganisationsBZDR67% (3)
- La Condition de L'homme Moderne Par H. ArendtDocument6 pagesLa Condition de L'homme Moderne Par H. Arendtorodri45Pas encore d'évaluation
- Exposé Théories Des OrganisationsDocument56 pagesExposé Théories Des Organisationshajar1988100% (2)
- Psychologie Du Travail PSYC0022-1 PDFDocument43 pagesPsychologie Du Travail PSYC0022-1 PDFZakaria EncgPas encore d'évaluation
- L' APPROCHE SYSTEMIQUE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DU XXIE SIECLE, 2E EDITIOND'EverandL' APPROCHE SYSTEMIQUE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DU XXIE SIECLE, 2E EDITIONPas encore d'évaluation
- Cours Croissance Et Développement, Licence AESDocument30 pagesCours Croissance Et Développement, Licence AESPitchoune6289100% (6)
- L3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEDocument37 pagesL3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEPitchoune628971% (7)
- Cours Economie Du Travail, L3 AESDocument26 pagesCours Economie Du Travail, L3 AESPitchoune6289100% (8)
- Cours Droit Des Contrats Publics, L2 AESDocument22 pagesCours Droit Des Contrats Publics, L2 AESPitchoune6289100% (1)
- Cours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialeDocument37 pagesCours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (18)
- Cours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialeDocument22 pagesCours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (3)
- Sociologie Du Travail Cours CompletDocument32 pagesSociologie Du Travail Cours CompletHichSady100% (2)
- Sociologie PolitiqueDocument34 pagesSociologie PolitiqueSidiki Camara100% (1)
- Sociologie Du TravailDocument21 pagesSociologie Du TravailAbdellah Km100% (3)
- Cours de Sociologie Des OrganisationsDocument26 pagesCours de Sociologie Des OrganisationsPhreedom DvdPas encore d'évaluation
- Introduction À La SociologieDocument30 pagesIntroduction À La SociologieLatif Ssay100% (3)
- Thème 1 - Max WeberDocument31 pagesThème 1 - Max WeberMme et Mr Lafon100% (1)
- Sociologie OrganisationDocument18 pagesSociologie OrganisationYoussef MoussaidPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture de L'école Des Relations HumainesDocument8 pagesFiche de Lecture de L'école Des Relations Humainesencgland100% (1)
- L'école Des Relations HumainesDocument5 pagesL'école Des Relations HumainesAnonymous ETwFaG100% (1)
- Sociologie de L EducationDocument11 pagesSociologie de L EducationAbdourahmanPas encore d'évaluation
- Dossier Dissertation Numéro 1Document72 pagesDossier Dissertation Numéro 1Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Thème Max WeberDocument12 pagesThème Max WeberMme et Mr Lafon67% (3)
- Psycho TravailDocument5 pagesPsycho TravailIlham ElkamraouiPas encore d'évaluation
- La Théorie D'elton MayoDocument6 pagesLa Théorie D'elton MayoMaître Maro100% (2)
- L'école Des Relations HumainesDocument2 pagesL'école Des Relations HumainesMme et Mr Lafon50% (2)
- 3 Les Relations Humaines Dans L EntrepriseDocument6 pages3 Les Relations Humaines Dans L EntrepriseMariam Tv AllPas encore d'évaluation
- Les Relations Professionnelles - pptx1Document67 pagesLes Relations Professionnelles - pptx1Aliou Maiga100% (2)
- Cours Introduction À La Sociologie de La Famille, L1, UASZDocument7 pagesCours Introduction À La Sociologie de La Famille, L1, UASZBakaye Dembele100% (3)
- Chap 3 Les Théories Managériales Des OrganisationsDocument46 pagesChap 3 Les Théories Managériales Des OrganisationsClovis Tshituka100% (2)
- Impact de La Remuneration Dans La Motivation Des Salaries de L Entreprise Algerienne Cas de La Societe Nationale Algerienne de Commercialisation PDFDocument106 pagesImpact de La Remuneration Dans La Motivation Des Salaries de L Entreprise Algerienne Cas de La Societe Nationale Algerienne de Commercialisation PDFKawtar KaPas encore d'évaluation
- La Psychologie Du TravailDocument13 pagesLa Psychologie Du TravailSara Masmar100% (3)
- Séance 1 - Cours de Psychosociologie Des Organisations 2020 (PL2)Document6 pagesSéance 1 - Cours de Psychosociologie Des Organisations 2020 (PL2)Yan'n Ib100% (2)
- Ecole SOCIO TECHNIQUEDocument11 pagesEcole SOCIO TECHNIQUEZakaria Achir67% (6)
- Théories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardeD'EverandThéories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardePas encore d'évaluation
- Recruter aujourd'hui: Comment séduire les nouvelles générations ?D'EverandRecruter aujourd'hui: Comment séduire les nouvelles générations ?Pas encore d'évaluation
- La gestion des ressources humaines pour la réussite scolaire, 2e éditionD'EverandLa gestion des ressources humaines pour la réussite scolaire, 2e éditionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- La LA GESTION HUMAINES DES RESSOURCES: L'art d'attirer, de retenir et de fidéliser les personnes compétentes dans nos organisationsD'EverandLa LA GESTION HUMAINES DES RESSOURCES: L'art d'attirer, de retenir et de fidéliser les personnes compétentes dans nos organisationsPas encore d'évaluation
- Sociologie du travail et des organisations: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandSociologie du travail et des organisations: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Théories et modèles orientés sur la carrière: Des idées pour la pratiqueD'EverandThéories et modèles orientés sur la carrière: Des idées pour la pratiqueÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Nouveau Management Public et Nouvelle Gouvernance publique : des paradigmes aux transformations: Gouvernance Management Public Prospective, #3D'EverandNouveau Management Public et Nouvelle Gouvernance publique : des paradigmes aux transformations: Gouvernance Management Public Prospective, #3Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- L3 AES, Finances PubliquesDocument74 pagesL3 AES, Finances PubliquesPitchoune628967% (3)
- Cours Sociologie, L3 AESDocument27 pagesCours Sociologie, L3 AESPitchoune6289100% (1)
- Cours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialeDocument35 pagesCours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (9)
- Cours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESDocument20 pagesCours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESPitchoune6289Pas encore d'évaluation
- Cours Démographie, L3 AESDocument21 pagesCours Démographie, L3 AESPitchoune6289100% (3)
- Cours Droit Pénal, L2 AESDocument43 pagesCours Droit Pénal, L2 AESPitchoune62890% (1)
- Cours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialeDocument69 pagesCours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialePitchoune628950% (2)
- Acides AminésDocument8 pagesAcides Aminésami190Pas encore d'évaluation
- Projet1 PDFDocument101 pagesProjet1 PDFKaoutar malekPas encore d'évaluation
- Modèle de Kirkpatrick Comment Évaluer Une Action de FormationDocument2 pagesModèle de Kirkpatrick Comment Évaluer Une Action de FormationzaarirPas encore d'évaluation
- Le Journal de L'économieDocument12 pagesLe Journal de L'économiekjmanoPas encore d'évaluation
- NoeuxDocument1 pageNoeuxMargaux PlatteauPas encore d'évaluation
- 210868 Manual de Instalaciвn y partes - V. InglВs PDFDocument4 pages210868 Manual de Instalaciвn y partes - V. InglВs PDFturbitolocoPas encore d'évaluation
- 539 Les Defauts de PiquresDocument1 page539 Les Defauts de PiquresMoulay Ismail QobiPas encore d'évaluation
- 2022 - Plaquette Tarifaire MutuelleDocument3 pages2022 - Plaquette Tarifaire MutuellecryoPas encore d'évaluation
- L'ambiguite, Fait de LangueDocument14 pagesL'ambiguite, Fait de LangueMichner AlfredPas encore d'évaluation
- PianoDocument9 pagesPianoSeven Blech ArmyPas encore d'évaluation
- Demande Carte FRDocument4 pagesDemande Carte FRPaul RegnierPas encore d'évaluation
- Procédures ECDIS - FRDocument72 pagesProcédures ECDIS - FRMKHELLASPas encore d'évaluation
- Hem Guide de Letudiant 2021-2022 WebDocument178 pagesHem Guide de Letudiant 2021-2022 WebGianni BalestrieriPas encore d'évaluation
- TD 2 Econometrie FellajiDocument2 pagesTD 2 Econometrie FellajiAhmed JebariPas encore d'évaluation
- Fiche Des Activités Strctures Des Donnes2Document2 pagesFiche Des Activités Strctures Des Donnes2Zouheir MezziPas encore d'évaluation
- Benchemarking Iam MeditelDocument39 pagesBenchemarking Iam Meditelba9ba9Pas encore d'évaluation
- Tarifs 2021 Integration SensorielleDocument17 pagesTarifs 2021 Integration SensorielleAlix Brossard OlivePas encore d'évaluation
- Brochure Alimentation Tip TopDocument28 pagesBrochure Alimentation Tip TopL.R ArchitectePas encore d'évaluation
- Lettre Motivation Licence Pro InformatiqueDocument2 pagesLettre Motivation Licence Pro InformatiquekengnePas encore d'évaluation
- P0131MBF16Document68 pagesP0131MBF16KOUADIO Tigoli PrincePas encore d'évaluation
- GDP Chap 1 Lecon 4 Cours v4Document6 pagesGDP Chap 1 Lecon 4 Cours v4EsmaDergalPas encore d'évaluation
- Université de Constantine BDocument4 pagesUniversité de Constantine BTahiryhenintsuPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Des Sûretés Et Des Procédures CollectivesDocument78 pagesCours de Droit Des Sûretés Et Des Procédures CollectivesGeorges100% (1)
- El Ve de Premiere Techno Comment Calculer Note Bac 2022 94496Document1 pageEl Ve de Premiere Techno Comment Calculer Note Bac 2022 94496Wisal TouilPas encore d'évaluation
- Fiches de Lecture 5Document14 pagesFiches de Lecture 5Romane Torregrossa100% (1)
- 1 - CalorimetrieDocument3 pages1 - CalorimetrieDoha DahbiPas encore d'évaluation
- TFE Antoine-PIERI PDFDocument11 pagesTFE Antoine-PIERI PDFaze rezPas encore d'évaluation
- Cours 06 Génétique DiploidesDocument38 pagesCours 06 Génétique Diploidesjames deyPas encore d'évaluation