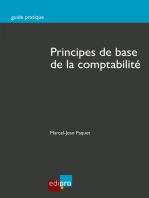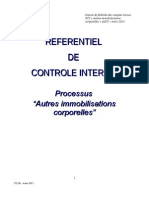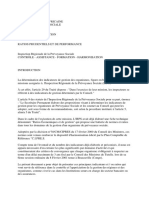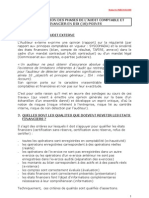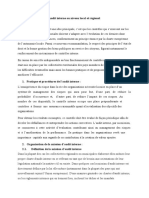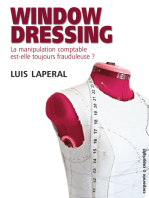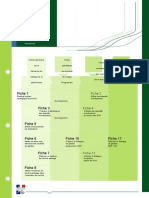Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Referentiel Commande Publique Oct13 PDF
Referentiel Commande Publique Oct13 PDF
Transféré par
Youssef ElansraouiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Referentiel Commande Publique Oct13 PDF
Referentiel Commande Publique Oct13 PDF
Transféré par
Youssef ElansraouiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rfrentiel de contrle interne
du processus de la commande publique
dans les collectivits locales
Le prsent guide sattache au processus de la commande publique. Il analyse chaque
procdure, tches et oprations devant tre ralises tout au long dune chane de travail
comptable et financire, depuis le service gestionnaire, initiant la dpense (dfinition du
besoin et commande du bien), jusquau comptable charg du paiement.
Ces travaux sadressent par consquent toutes les collectivits quelles soient dans la
perspective dune certification ou non de leurs comptes.
) Ce guide constitue une documentation de base pour les responsables territoriaux
souhaitant renforcer la scurit de leurs procdures dans lobjectif damliorer la
qualit des oprations financires et comptables et, in fine, de renforcer la fiabilit
des comptes de leur collectivit. Le document propose un rappel de la rglementation
applicable au niveau de la tche considre et propose une organisation possible, en
fonction des expriences rencontres par les diffrents praticiens des collectivits,
runis autour de la table.
) Ce guide na rien dimpratif, il est simplement propos aux responsables et agents
oprationnels pour leur permettre dapprhender la notion de contrle interne
comptable et financier (CICF) travers un processus fort enjeu au sein de la
collectivit. Il doit permettre de rflchir lorganisation actuelle des services, non
plus sous langle budgtaire ou rglementaire habituel mais sous un angle
comptable, en partant du processus comptable, lui-mme dclin en procdures et
tches afin de recenser les risques inhrents chacune de ces tches ou opration.
Un tel rfrentiel a donc pour but de porter un regard comptable sur des procdures
familires et de se poser les questions relatives la meilleure manire de matriser ces
risques en fonction de leur dtection au sein du service.
Lintrt est de prsenter de manire synthtique ces diffrentes oprations et la
rglementation qui sy rattache, sous forme de fiches de risque. Seuls les risques considrs
comme majeurs sont recenss travers ce document.
Un tel dispositif de contrle doit bien videmment tre adapt la taille de la structure, aux
moyens dont dispose le service ou la collectivit ainsi quaux enjeux financiers grs. Par
ses enjeux financiers, la commande publique constitue cet gard lun des processus
majeurs, au sein de toutes les entits publiques.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
1
Description densemble du processus commande
publique
(ordonnateur et comptable)
Fiabilit V209/2013
descomptes Processuscommandepublique(ordonnateur)
Procdures Tches Oprations Acteurs
Evaluation des besoins Recensement et valuation Services
gestionnaires
Dfinition du besoin
Dcision de commander service des
Commande et choix du fournisseur Choix de la procdure de commande achats
D.A.F. / service
Engagement Comptable gestionnaire
Engagement
Engagement Juridique
D.A.F. / Service
Transmission archivage gestionnaire
Constatation service fait Rception de la commande Services
gestionnaires
Contrle du service fait
D.A.F. / service
Liquidation de la Rception de la facture gestionnaire
Liquidation
commande
Vrification dcompte / PJ Services
gestionnaires
Retenues de garantie Remboursement RG
D.A.F. /service
Contrle conditions Avance gestionnaire
Avances Ordre Payer D.A.F.
Ordre de Rcupration Avance
D.A.F. /service
payer gestionnaire
Etablissement du mandat
Acomptes et versement
dfinitif Enregistrement comptable du mandat
D.A.F.
Transmission mandat au comptable
Etablissement des fiches
Recensement Etablissement et D.A.F.
des marchs transmission fiches de Transmission des fiches
recensement
Recensement des charges rattacher Services
de lexercice
gestionnaires
Oprations Recensement des Etablissement du mandat
de fin oprations dinventaire et
mandatement D.A.F.
dexercice Contre-passation des critures en
dbut dexercice suivant
Comit national de fiabilit des comptes locaux
2
Fiabilit V209/2013
descomptes Processuscommandepublique(Comptable)
l
Procdures Tches Oprations Acteurs
Contrle de la rgularit de la dpense
en fonction du plan CHD et du CAP
VISA du mandat Enregistrement comptable de la prise en COMPTABLE
charge de l'ordre de payer
Archivage
Contrle conditions de remboursement
Rcupration des
Enregistrement rcupration de l'avance COMPTABLE
avances
Prise en Contrle notification cession crances
charge
Enregistrement de la notification
Suivi et clture de la cession de crances
COMPTABLE
Oppositions
et cessions de Contrle prsence de cession de crances
crances
Evaluation du montant verser
comptabilisation paiement du crancier
Archivage des PJ COMPTABLE
Contrle des conditions de la RG
Retenues de
garantie Enregistrement comptable de la RG
Suivi de la libration des garanties
COMPTABLE
Libration des
garanties Contrle rgularit libration RG
comptabilisation libration RG
COMPTABLE
Contrle des charges rattacher
Oprations
Intgration Comptabilisation des charges rattacher
de fin
dexercice comptable
COMPTABLE
Archivage des documents
Comit national de fiabilit des comptes locaux
3
LES RISQUES MAJEURS CHEZ LORDONNATEUR
Ce document ne reprend que des exemples dorganisation ou de bonnes pratiques
destines scuriser au mieux chaque procdure, il nest donc pas mettre en uvre
intgralement dans toutes ses composantes.
Il constitue avant tout une base documentaire permettant danalyser lorganisation et la
rpartition des tches oprationnelles et de contrle afin den analyser les risques rels au
sein de la collectivit.
Un dispositif de contrle interne doit bien videmment tre adapt la taille de la structure,
les moyens dont dispose le service ou la collectivit ainsi que les enjeux.
Seront privilgis les processus et procdures forts enjeux financiers, la commande
publique constitue cet gard un processus majeur au sein de toutes les entits publiques.
Les principaux risques identifis par le groupe de travail sont au nombre de 6, pour 6
oprations spcifiques :
Opration 1 : Recensement pralable et valuation globale des besoins
Risque n 1 : Mauvaise dfinition des besoins
Opration 2 : Dfinition prcise du besoin
Risque n 2 : Mauvaise valuation des besoins sous estimation
Opration 3 : Dtermination de la procdure de commande
Risque N 3 : Non respect de la procdure de passation de commande
Opration 4 : Engagement comptable de la commande
Risque n 4 : Les engagements ne sont pas retracs en comptabilit
Opration 5 : Engagement comptable
Risque n 5 : Erreur dans la comptabilisation de lengagement
Opration 6 : Contrle du service fait
Risque n 6 : Absence de contrle rel du service fait
Deux fiches complmentaires sont proposes galement, elles viennent apporter des
prcisions utiles sur des ponts trs prcis ou reprendre quelques lments rglementaires
de manire trs synthtique :
La fiche n1 reprenant les gnralits sur la commande publique
La fiche n 2 prsentant un risque particulier li au suivi de lexcution des marchs
Elles pourront tre enrichies dautres fiches de mme nature suivant lvolution des besoins
des services
Comit national de fiabilit des comptes locaux
4
RISQUE N 1
Procdure : Commande
Tche : Evaluation des besoins
Opration : Recensement pralable et valuation globale
Objectif : exhaustivit
Risque : Mauvaise dfinition des besoins
Dtail composants risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant : Gnralits :
Gestion centralise/dcentralise : La priode du processus budgtaire implique une premire phase de recensement des
organisation dficiente des services besoins, qui se poursuit tout au long de lanne. Cette phase est incontournable car elle
demandeurs (services techniques permet de chiffrer les besoins globaux de la collectivit en consolidant lensemble des besoins
services gestionnaires). Absence de de la collectivit estims, par service.
concertation et communication ou Il importe par consquent de disposer dune liste (nomenclature) de fournitures regroupes en
communication dficiente entre les grandes familles de produits. Le recensement des besoins des diffrentes directions /
services demandeurs afin daboutir services oprationnels est effectu partir de cette nomenclature de produits labore et
lexpression dun besoin commun actualise priodiquement pour quelle soit toujours adapte aux besoins rels
lensemble de la collectivit.
Cette liste permet de dterminer la procdure de commande publique la mieux adapte en
Incertitude, imprcision dans fonction des seuils de commande estime sur lanne. Le principal risque pour une collectivit
lexpression des besoins par les tant le dcoupage abusif des commandes dans le but dchapper aux seuils de publicit
services demandeurs. Inadaptation de impliquant le choix dune procdure plus contraignante.
la dfinition des familles de produits Cette tape permet alors darrter le montant des crdits budgtaires ncessaires sur une
aux besoins de la collectivit. base la plus proche de la ralit possible.
Carence de formation du personnel.
Evnement : Documentation :
Les besoins sont mal valus - Code des marchs publics
notamment sous valus - Rdaction et diffusion dun Guide de procdure tabli au sein de la collectivit
- Rdaction et diffusion dun Document spcifique recensant les familles de produits
utilises
Traabilit :
) Conserver la trace du contrle par le service juridique (date acteur) et observations
adresses aux prescripteurs.
) Archivage des PV de runions du rseau des rfrents (cf. infra) adapter en fonction
de la taille de la collectivit.
Impacts : Organisation :
Impact juridique : procdures Optimiser la fonction achat :
inadaptes non respect du code des Mettre en place un rseau de rfrents / acheteurs au sein de chaque service afin de
marchs publics multiplication des dcloisonner lexpression des besoins.
avenants pour rpondre la demande Il est prconis de dsigner un pilote qui runit les chefs de service et anime le rseau des
des services non consults au rfrents acheteurs implants dans chaque service afin dviter la multiplication de petites
pralable commandes auprs dun ou plusieurs fournisseurs pour des produits appartenant la mme
- risque de bouleverser lconomie famille.
du march,
- allongement des dlais, ) phase de recensement annuelle des besoins et reporting en fin danne afin didentifier les
- surcots financiers, erreurs et mettre en place les moyens dy remdier.
) amliorer la connaissance du march par les acheteurs=> Mettre en place une veille sur
Impact budgtaire et comptable : loffre, mise en concurrence des acteurs prsents sur le march.
consommation sur les comptes de ) vrifier la mise en cohrence des procdures entre elles (prospective financire, plans
crdits non prvus ou insuffisamment pluriannuels dinvestissement ou daction / affectation).
ouverts.
) Dfinir des familles de produits adaptes aux besoins de chaque collectivit.
Risque pour limage de la collectivit ) Mettre en place un observatoire de la commande publique et raliser un bilan des achats.
) En fin danne, effectuer un bilan de la politique dachats afin didentifier et valuer les
anomalies de lexercice => utiliser les restitutions du SI (Systme informatique),
Mesures de contrles proposes :
Contrle de supervision contemporain :
Contrle de lorganisation par le directeur en charge du service acheteur de leffectivit
des mesures mises en place comme la communication des PV de runions, le suivi des
actions menes par le rseau ou la fixation dun calendrier de runions
Contrle de supervision a postriori par le DAF :
Contrle sur un chantillon de 30 commandes effectues en N-1 sur diffrentes familles de
produits pour sassurer de leffectivit et la qualit du recensement notamment lutilisation de
la nomenclature, le respect de celle-ci au regard des commandes passes lexercice
prcdent et rapprocher les crdits budgtaires allous.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
5
RISQUE N2
Procdure : Commande
Tche : Dcision de commander et choix de la procdure et du fournisseur
Opration : Dfinition prcise du besoin
Objectif : Rgularit
Risque : Mauvaise valuation des besoins sous estimation
Dtail composants risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant : Gnralits :
Mauvaise connaissance des marchs
La phase de recensement des besoins seffectue au moment du processus budgtaire.
et des produits proposs
Elle apparat comme incontournable car elle permet de chiffrer les besoins globaux de la
Carence dans lorganisation collectivit et de passer outre le cloisonnement par services ou directions
Dfaut ou consultation incompltes des
prescripteurs
Evnement : Documentation :
- Code des marchs publics
Les besoins sont mal valus - Rdaction et diffusion de Guide de procdure
Les procdures de passation des
marchs utilises sont inadaptes - Rdaction et diffusion de Document spcifique recensant les familles de produits
utilises
Traabilit :
) Archivage des PV de runion des rfrents, des reporting de fin danne.
La traabilit est adapte en fonction de la taille de la collectivit et des possibilits offertes
par le systme dinformation
Impacts : Organisation :
Non respect de la rglementation des Optimiser la fonction achat :
marchs publics Mettre en place un rseau de rfrents / acheteurs au sein de chaque service afin de
dcloisonner lexpression des besoins.
Marchs infructueux => allongement
des dlais Il est prconis de dsigner un pilote qui runit les chefs de service et anime le rseau des
rfrents acheteurs implants dans chaque service afin dviter la multiplication de
Impact budgtaire et comptable : commandes auprs dun ou plusieurs fournisseurs pour des produits appartenant la mme
consommation sur les comptes de famille.
crdits non prvus ou insuffisamment
ouverts Le rseau des rfrents mutualise les difficults rencontres par chaque service - remonte
des observations, rclamations manant des utilisateurs.
multiplication des avenants pour
adapter le march conclu des besoins Amliorer la connaissance du march par les acheteurs => Mettre en place une veille sur
non initialement pris en compte et loffre afin de bien connatre les produits et les fournisseurs prsents sur le march.
pouvant gnrer des surcots.
Mettre en concurrence les acteurs prsents sur le march.
Impacts lis lallongement des dlais
de ralisation dune opration. Ne pas tre trop contraignant dans la rdaction du cahier des charges afin de laisser des
marges de manuvres aux fournisseurs dans leurs rponses. Se laisser la possibilit
daccepter des variantes.
) Dvelopper le recours aux accords cadre de marchs.
Vrifier la mise en cohrence des procdures entre elles (prospective financire, plans
pluriannuels dinvestissement ou daction / affectation).
Consulter les utilisateurs en organisant une consultation priodique des services utilisateurs
pour prvenir les ventuelles erreurs dapprciation. Exemple : dans une crche la
consultation du personnel dune collectivit a permis de dfinir prcisment la hauteur
souhaite par le personnel, des diffrents quipements.
Mesures de contrles proposes :
Contrle de supervision contemporain :
Il sagit dun contrle de validation ralis par la hirarchie ; ce contrle peut tre exhaustif ou
par chantillon en fonction de seuils. Le contrle sera adapt en fonction de la taille de la
collectivit et/ou des enjeux, des moyens disponibles et de lorganisation mise en place.
En fin dopration, il est souhaitable deffectuer un bilan afin didentifier et recenser les
anomalies. Dans la mesure du possible, il est recommand de sappuyer sur les restitutions
du systme dinformation pour procder ce bilan. Le bilan devra donner lieu la mise en
place dactions correctives (rectification / corrections des marchs lors de leur
renouvellement, correction de clauses trop complexes mettre en uvre).
Cest une approche qualitative des marchs qui est privilgie.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
6
RISQUE N 3
Procdure : Commande
Tche : Dcision de commander et choix de la procdure et du fournisseur
Opration : Dtermination de la procdure de commande
Objectif : Rgularit, sincrit
Risque : Non respect de la procdure de passation de commande
Dtail composants risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant : Gnralits :
Mauvaise estimation du besoin. Les procdures de passation des marchs publics font lobjet de nombreuses rgles quil
Carence de formation. convient de matriser afin de scuriser les procdures utilises.
Mconnaissance / Non respect des
procdures de commande publique A dfaut, la collectivit se retrouvera confronte divers risques juridiques : dlibrations
Mconnaissance de la rglementation rejetes par le contrle de lgalit, saisine du tribunal administratif, recours de fournisseurs
relative aux dlgations de signature et sestimant lss, pouvant donner lieu des frais de justice et au paiement de dommages
au fonctionnement des CAO. intrts. Le march peut tre retard et mme annul.
Mconnaissance ou absence de suivi Ces divers vnements pouvant affecter un march, entranent des surcots lis aux frais de
des seuils atteints par la collectivit sur justice mais aussi lallongement du dlai de ralisation de lopration programme (par
un mme type de produit ou sur une exemple, le retard dans la livraison dun btiment entrane des surcots lis la location de
famille homogne de produits. locaux en attendant la livraison de lquipement).
Mauvais recensement des besoins sur
la totalit dune opration de travaux.
Evnement : Documentation :
Non respect des procdures. - Code des marchs publics
- Rdaction et diffusion du Guide de procdure ralis au sein de la collectivit
- Rdaction et diffusion de Document spcifique recensant les familles de produits utiliss
- Rdaction et diffusion dune Charte dontologique de lachat public mise jour en cas
de besoin (document sign par les lus en dbut de mandat dans lequel les lus
indiquent leurs autres fonctions pouvant donner lieu des incompatibilits).
- Rdaction et diffusion des Documents mis jour retraant les dlgations de signature.
- Organiser une veille juridique et prvoir des actions de formation rgulires sur la
rglementation relative la commande publique
Traabilit :
) Archivage des listes dites et utilises pour raliser les contrles - adapter en fonction
de la taille de la collectivit,
) Archivage des dlgations, procurations, etcvalides au moment de la signature de
chaque march.
) Archivage des contrles de la composition des diverses commissions lis chaque
march et des Procs verbaux ou comptes rendus de runions.
Impacts : Organisation :
Risque pnal dlit de favoritisme. Dployer un systme dinformation adapt (recensement des commandes en cours) afin de
dfinir des rgles de blocage et/ou dalerte en fonction de seuils au moment de ldition du bon
Risque juridique et financier - de commande. Cet outil dalerte ou de blocage est un outil de prvention qui permettra le
contentieux : recours dun fournisseur recensement des problmes rencontrs.
et/ou observations lies au contrle de Organiser le recensement des besoins partir des donnes historiques des commandes.
lgalit. Lanalyse des restitutions permettra damliorer le dispositif de recensement pour lexercice
Dpenses supplmentaires et suivant.
allongement des dlais de ralisation ) Recourir aux accords cadre pour les fournitures et prestations de services.
de lopration lis limpact. Organiser et documenter les dlgations de signature et/ou de pouvoirs permettant de sassurer
Dficit dimage de la collectivit peru au moment de la signature que le signataire dispose bien de la dlgation.
par les administrs et les fournisseurs Mesures de contrles proposes :
impact politique pour les lus :
Contrle mutuel ou contrle de supervision ralis par lencadrement dun chantillon de
Retard dans les oprations, dossiers de marchs :
dysfonctionnement des services publics
suite lallongement de la ralisation Contrle des marchs en fonction de seuils, du type de procdure, de la taille de la collectivit
des oprations. Le contrle du march sera opr par un service extrieur (service juridique ou DAF, selon le
type d'organisation).
Ce contrle pourra tre exhaustif ou par chantillon ; il sera adapt en fonction de paramtres
propres l'entit. Il peut sagir dun contrle exhaustif, dun contrle par chantillon selon des
seuils ou selon dautres critres, par exemple nature du march. Il est recommand dutiliser les
restitutions disponibles via le systme dinformation pour effectuer les contrles.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
7
RISQUE N 4
Procdure : Commande
Tche : Engagement
Opration : Engagement comptable de la commande
Objectif : exhaustivit, sincrit
Risque : Les engagements ne sont pas retracs en comptabilit
Dtail composants risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant : Gnralits :
Absence de comptabilit dengagement La tenue de la comptabilit dengagement des dpenses est une obligation qui incombe
lordonnateur. Lengagement comptable prcde lengagement juridique ou lui est concomitant.
Absence dengagement / Engagement
tardif Le suivi des engagements permet de connatre tout moment :
- Les crdits ouverts et les prvisions de recettes
Dfaut de formation Absence de - Les crdits disponibles pour engagement,
guide de procdure - Les crdits disponibles pour mandatement,
- Les dpenses et recettes ralises,
- Lemploi fait des recettes greves daffectation spciale.
En fin dexercice, le solde des engagements permet :
) de dterminer le montant des charges et produits rattacher lexercice lequel influe sur
le rsultat de fonctionnement (procdure ne concernant pas, titre obligatoire, les
communes de moins de 3500 habitants) ;
) de dresser ltat dtaill des restes raliser en investissement et fonctionnement. Ils font
partie intgrante du rsultat du compte administratif et doivent tre sincres
) dtablir le compte administratif
Evnement : Documentation :
Lengagement comptable nest pas - Diffusion Code gnral des collectivits territoriales
enregistr dans le SI. - Diffusion Instruction comptable
- Rdaction et diffusion Guide de procdure interne
- Guide synthtique de la comptabilit des dpenses engages
- Rglement budgtaire et financier de la collectivit
Traabilit :
) Systme dinformation permettant de retracer les engagements.
) Conservation et archivage des bons de commande
Impacts : Organisation :
Les comptes ne sont pas fiables. ) Disposer dun systme dinformation qui fasse le lien entre lengagement et llaboration
La collectivit ne connat pas le solde du bon de commande.
disponible alors quelle continue ) Paramtrer le systme dinformation afin de rendre obligatoire la prsence dun numro
engager : elle se met alors en situation dengagement avant la liquidation dune facture.
ventuelle dinsolvabilit. ) Mettre en place, ventuellement, un visa pralable de lengagement juridique, en fonction
Rejet des mandats par le comptable de seuils.
pour insuffisance de crdits ouverts => ) Prvoir une procdure assurant, en cas de bon de commande oral, la liaison entre
allongement des dlais / surcots lengagement comptable et le bon de commande.
Dficit dimage de la collectivit et
impact politique pour les lus,
Mesures de contrles proposes :
Les rattachements de charges et les Contrle mutuel/ auto contrle ;
restes raliser ne sont pas sincres.
Utilisation du systme dinformation : exemple, au moment de la saisie du bon de commande
=> blocage ou alerte si pas de n dengagement rfrenc.
Contrle de supervision posteriori :
Contrle par chantillon (priodicit et chantillon dterminer selon la taille de la collectivit,
les moyens disponibles et lorganisation de lentit) de lantriorit de lengagement comptable.
Utiliser les possibilits offertes par le systme dinformation afin dditer des listes
dengagements sur une priode dfinie ou en fonction dun seuil. Ces engagements seront
rapprochs du bon de commande afin de sassurer de lexistence dun numro dengagement
correspondant sur chaque bon de commande.
Exploiter les possibilits dutiliser les restitutions des anomalies dtectes par le systme
dinformation ; par exemple dtecter les liquidations sans n dengagement bons de
commande sans rfrence n dengagement).
Comit national de fiabilit des comptes locaux
8
RISQUE N 5
Procdure : Commande
T c h e : Engagement
Opration : Engagement comptable
Objectif : Rgularit
R i s q u e : Erreur dans la comptabilisation de lengagement
Dtail composants risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant : Gnralits :
Confusion entre investissement et Lengagement doit rester dans la limite des autorisations budgtaires. Cest pourquoi un
fonctionnement. engagement juridique doit correspondre un engagement comptable pralable ou concomitant.
Mauvaise identification des tiers. Lengagement comptable consiste rserver les crdits budgtaires correspondants
lengagement juridique jusquau mandatement.
Carence ou mauvaise gestion des
habilitations informatiques. Les erreurs pouvant affecter lenregistrement de lengagement comptable, sont multiples :
Absence de guide des procdures. - Erreur dans le montant,
Non dtection des marchs multi - Erreur dimputation,
imputations. - Tiers mal identifi,
Carence de formation - Engagement par une personne non habilite.
Lengagement comptable est la premire action sur la chane de la dpense. Cest une phase
essentielle. Les erreurs commises ce niveau risquent de se rpercuter tout au long de la
chane de la dpense et de gnrer des anomalies affectant non seulement lengagement mais
galement la liquidation et le mandatement.
Evnement : Documentation :
Lengagement nest pas enregistr - Diffusion des Instruction comptable / Rdaction et diffusion Guide de procdure interne,
correctement dans le SI . - Rdaction et diffusion dun Thsaurus ou chartre pour la cration des tiers,
- Renforcer la formation des personnels chargs de lengagement,
- Guide synthtique de la comptabilit des dpenses engages
- Rglement budgtaire et financier de la collectivit
Traabilit :
) Archivage des preuves des contrles.
) Systme dinformation permettant de retracer les engagements.
) Conservation et archivage des bons de commande
Impacts : Organisation :
La comptabilit dengagement nest Mettre en place des rgles de gestion spcifiques la collectivit.
pas sincre, les informations ) Bonne pratique pour les marchs multi imputations : utiliser le progiciel en
comptables dcoulant de la tenue de renseignant dans la fiche march les diffrentes imputations correspondant ce
la comptabilit des dpenses march. Un blocage est paramtr si au moment de lengagement, limputation
engages sont errones. utilise nest pas recense dans la fiche march parmi les imputations possibles.
La liquidation et le mandatement Scuriser la base tiers :
prsentent des anomalies / Paiement
irrgulier. - Personnes physiques => dfinir un numro stable dans la mesure du possible.
Montant du FCTVA erron. - Personnes morales => utiliser le N SIRET et en plus le code NAF.
La dpense est impute sur des - Centraliser la cration des tiers ou au moins centraliser la validation de la cration de tiers
crdits non ouverts ou insuffisants. par le service des finances.
Le mandat est rejet par le ) Exemple dune grande collectivit qui a labor un tableau de bord informatique
comptable : allongement du dlai de partir de son systme dinformation, recensant un certain nombre de critres de
paiement. fiabilit de la base tiers (doublons, adresses, noms mal orthographis.)
Dficit dimage de la collectivit vis Limiter et contrler par loctroi dhabilitations le nombre de personnes habilites crer, valider
vis des fournisseurs. la cration de tiers et assurer la gestion de la base ( nettoyage ).
Scuriser lalimentation de la base tiers par dversement dapplications mtier. Un audit rgulier
de la base tiers devrait permettre de la fiabiliser. Certaines entits font appel un prestataire
notamment pour effectuer un contrle des numros de SIRET.
) Utiliser les fonctionnalits du systme dinformation pour paramtrer des blocages
ou alertes.
Mesures de contrles proposes :
Contrle mutuel / auto contrle ; Contrle de la prsence du montant engag et cohrence
entre la comptabilit des engagements et les mandats effectus.
NB : des contrles doivent tre mens rgulirement pour sassurer que lors de la cration dun
nouveau tiers, ce dernier nexiste pas dj dans la base. La cration dun tiers de surcrot
devrait tre associe une sparation des tches entre la personne qui saisit les lments
notamment le compte bancaire et la personne qui valide ces informations dans la base.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
9
Contrle de supervision a posteriori :
Contrle a posteriori par chantillon ( dfinir selon la taille de la collectivit, la volumtrie et les
moyens disponibles)
Utiliser les listes dites par le systme dinformation pour contrler un certain nombre
dengagements.
Lencadrement ralisera un contrle exhaustif afin de sassurer de la correcte saisie dans le
systme dinformation des items lis lengagement (tiers, montant, imputation, antriorit de
lengagement, personne habilite engager).
Il sattachera vrifier leffectivit des mesures mises en uvre relatives la cration des
tiers partir dun chantillon de 30 tiers.
Contrle par chantillon et selon priodicit ( dfinir selon la taille de la collectivit et la
volumtrie des tiers cres) du respect des consignes relatives la gestion des tiers.
Utiliser les restitutions disponibles par le systme dinformation afin didentifier les anomalies
sur les tiers et procder un contrle exhaustif des anomalies.
Ces contrles donneront lieu un bilan qui permettra la mise en uvre de mesures correctives.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
10
RISQUE N 6
Procdure : Commande
Tche : Constatation et certification du service fait
Opration : Contrle du service fait
Objectif : Rgularit, sincrit, totalit
Risque : Absence de contrle rel du service fait
Dtail composants risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant : Gnralits :
Lordonnateur est charg de la liquidation des factures. La liquidation a pour objet de vrifier
Absence de contrle rel du service fait / la ralit de la dpense et darrter le montant de la dpense.
Absence de personne dsigne pour Elle est effectue au vu des titres tablissant les droits acquis aux cranciers ( dcret GBCP
procder au contrle rel du service fait. art 31).
La personne responsable nest pas La constatation du service fait consiste vrifier la ralit dune dette, cest dire vrifier
informe de la livraison / de la rception que le fournisseur a bien accompli ses obligations (quantit, qualit) par rapport la
des travaux / de la ralisation de la commande.
prestation.
Cest la premire tape de la liquidation.
Les personnes charges du contrle
nont pas la comptence technique La vrification du service fait nest pas quune formalit administrative, elle ne se limite pas
suffisante pour apprcier la qualit de lapposition de la signature dune personne habilite sur le bordereau de mandats. Larticle 12
service ralis ou de la livraison / ou nont du GBCP dicte que lordonnateur atteste sous sa responsabilit du service fait.
pas accs aux documents ncessaires Le fait dapposer sa signature et de certifier le service fait sur un bordereau sans avoir
(bon de livraison documents relatifs au vrifi au pralable la ralit et la conformit du service fait constitue une infraction aux
march la convention ) dfaut de rgles dexcution de la dpense (art. 313-4 du code des juridictions financires) et expose
formation son auteur une amende prononce par la CDBF (CDBF 22 juin 1992 Loing et CDBF 18
Le signataire na pas dlgation, juin 1997 Vilain).
Evnement : Documentation :
Le service fait nest pas contrl / est - Rdaction et diffusion dun Guide de procdure interne
mal contrl. - Diffusion Dcret de 2007-450 du 25 mars 2007 sur les PJ Annexe 1 du CGCT
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/pieces-justificatives-des-depenses-
publiques-locales-2
- Code des marchs / March convention contrat bon de commande bon de
livraison PV de rception
- site : Collectivits-locales-.gouv.fr/finances locales / les dpenses
Traabilit :
) Signature des bons de livraison par la personne comptente (dlgations de signatures
formalises et actualises)
) Archivage des bons de livraison rapprocher des bons de commande.
Impacts : Organisation :
La prestation nest pas conforme voire Mettre en place dun double niveau de contrle :
inexistante => fraude / Dpense 1 Rception de la livraison : formalisation par un document (bon de livraison)
irrgulire surcots.
2 Vrification de la qualit / conformit des biens ou services livrs au regard de la
Pertes de voies de recours lencontre commande = formalisation par un document.
du fournisseur.
Dsignation de responsables de la certification du service fait dans unit / service en tenant
Fiabilit : mauvaise qualit des compte des comptences techniques ncessaires. Lorganisation doit tre formalise
rattachements de charges. notamment par la mise en place de dlgations de signature (ventuellement selon montants,
Infraction aux rgles dexcution de la type de dpense.). Les dlgations doivent tre actualises rgulirement.
dpense publique (art. L 313-4 du Code
des juridictions financires) => amende Mesures de contrles proposes :
pouvant tre inflige par la CDBF.
Allongement des dlais de ralisation Contrle mutuel/ auto contrle ;
dune opration par exemple si la A la rception de la livraison : rapprochement avec le bon de commande.
commande rceptionne nest pas Vrification de la conformit : rapprochement avec le bon de livraison, le bon de commande et
conforme et quil faut passer une nouvelle le document formalisant la rception.
commande pour rpondre au besoin
Contrle de supervision posteriori
Dficit dimage de la collectivit vis vis
des administrs et des fournisseurs: Mettre en place un contrle hirarchis du service fait qui sera adapt la taille de la
impact politique pour les lus. collectivit, ses moyens et son organisation. Ce contrle pourra tenir compte des montants,
des types de dpenses .
Contrle de leffectivit des mesures mises en place : contrle par chantillon (seuils /
familles de biens ou services ) partir des mandatements raliss ; il sagit de reconstituer la
totalit des oprations intervenues depuis la livraison et ayant conduit certifier le service fait.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
11
FICHES COMPLEMENTAIRES
FICHE N1 : GENERALITES SUR LA COMMANDE PUBLIQUE
La commande publique est rgie par le code des marchs publics. Le code des marchs
publics sapplique ds le premier euro, mme si, en fonction de diffrents seuils, les
obligations respecter sont diffrentes.
Les grands principes qui prsident la commande publique sont :
La libert daccs la commande publique,
Lgalit de traitement entre les candidats,
La transparence des procdures.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en uvre conformment aux
rgles fixes par le prsent code (art. 1 du CMP).
Deux types de seuils rgissent la commande publique ; ceux relatifs au choix de la
procdure de passation proprement dite et ceux relatifs aux mesures de publicit mettre en
uvre.
1. Quelle procdure choisir en fonction du montant du march ?
Documentation :http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publi
cs/conseil_acheteurs/tableaux/ct-procedures.pdf
9 Procdure crite : 15 000 HT
Les marchs et accords - cadres d'un montant gal ou suprieur 15 000 HT sont passs
sous forme crite (Code des marchs publics art.11).
9 Dispense de procdure : 15 000 HT1
Les articles 28 et 203 du CMP fixent 15 000 HT le seuil de dispense de procdure.
Cependant une dispense de procdure ne signifie pas une libert totale pour lacheteur
public. Les marchs infrieurs 15 000 sont exonrs de formalits pralables (publicit,
mise en concurrence stricte dlais respecter ) mais ils restent soumis aux principes
de la commande publique.
Lacheteur public doit, selon larticle 28 du code, veiller : choisir une offre rpondant
de manire pertinente au besoin, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas
contracter systmatiquement avec un mme prestataire lorsqu'il existe une pluralit d'offres
potentielles susceptibles de rpondre au besoin .
Lacheteur public doit prendre en compte les rgles relatives au calcul des seuils (art. 27 du
code). Il ne doit pas dcouper son besoin dans le but de bnficier de la dispense de
procdure.2
1
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-
oeuvre-procedure/achats-moins-15-000-euros.pdf
2
Circulaire du 14 fvrier 2012 Guide de bonnes pratiques en matire de marchs publics.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025364925
Comit national de fiabilit des comptes locaux
12
Le choix dune offre doit rpondre de manire permanente au besoin :
) Les achats infrieurs 15 000 sont soumis aux obligations de dfinition pralable
des besoins (art. 5 du code).
) Bonne utilisation des deniers publics :
Lacheteur public gre de deniers publics, il doit donc veiller choisir une offre
financirement raisonnable et cohrente avec la nature de la prestation.
Lacheteur public adaptera et proportionnera sa dmarche dachat ses
connaissances, au march et lenvironnement. Le guide de bonnes pratiques en
matire de marchs publics prcit propose des exemples pratiques explicitant ce
concept.
Le guide prcise galement quil convient de garder les traces des dmarches
mises en uvre.
) Lacheteur ne doit pas contracter systmatiquement avec le mme prestataire
lorsquil existe une pluralit doffres potentielles. Pour rpondre cet objectif, les
acheteurs publics doivent avoir une connaissance suffisante du march, des produits
et des fournisseurs susceptibles de rpondre leur besoin. Lordonnateur peut
utilement mettre en place un veille sur loffre.
) Chaque collectivit dans son guide de procdure peut fixer la politique quelle
souhaite suivre et adopter des rgles internes afin de respecter cette obligation.
) Il est indispensable dorganiser la conservation et larchivage des documents
) Afin dtre en mesure de prouver que les principes de la commande publique ont t
respects, il est prconis de conserver la traces des lments ayant prsid au
choix des fournisseurs.
9 Procdure adapte3
La procdure adapte sapplique aux marchs de travaux, jusqu 5 000 000 HT et aux
marchs de fournitures et services jusqu 200 000 HT.
Cette procdure est rgie par larticle 28 du code des marchs publics. Dans cette
procdure, cest lacheteur public qui fixe la rgle du jeu . Pour dfinir les modalits de
passation, il peut se rfrer aux procdures formalises et les adapter en tenant compte de
la nature de la commande envisage. Les ordonnateurs ont aussi la possibilit de fixer
librement les modalits de passation du march toujours en fonction de la nature et des
caractristiques du besoin satisfaire, du nombre ou de la localisation des oprateurs
conomiques susceptibles d'y rpondre ainsi que des circonstances de l'achat .
Les modalits de passation de ce type de march doivent respecter les grands principes de
la commande publique : libert daccs, galit de traitement entre les candidats,
transparence des procdures. Les modalits choisies doivent tre proportionnelles la
nature, au montant de la commande ainsi qu lenvironnement socio-conomique.
Lacheteur public est li par les modalits de passation quil a lui mme choisies et doit sy
conformer.
Dans les cas o les modalits de passation se rfrent expressment une procdure
formalise, celle-ci sapplique sans drogation possible.
Dans son guide de procdure, chaque collectivit peut, utilement, dfinir la politique dcide
en matire de marchs passs en procdure adapte et proposer des procdures types
en fonction de la nature des besoins satisfaire.
3
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-
procedures/mapa.pdf
Comit national de fiabilit des comptes locaux
13
9 Les procdures formalises
Les marchs de travaux dun montant suprieur 5 000 000 HT et les marchs de
fournitures et services dun montant de 200 000 HT pour les doivent tre passs selon
lune des procdures formalises prvues par le code des marchs publics. Les appels
doffres peuvent tre ouverts ou restreints (art. 33 du CMP et 57 64 pour la procdure)4
Les procdures ngocies (art. 35 du CMP et 65 66 pour la procdure)5.
Selon les cas, les marchs ngocis peuvent tre passs avec publicit pralable et mise en
concurrence ou sans publicit pralable et mise en concurrence. Cette dernire forme
concerne des cas limitativement numrs dans le code, il sagit notamment de marchs
conclus pour faire face une urgence, une ncessit imprieuse rsultant de circonstances
imprvisibles, de marchs faisant suite un appel doffre infructueux.
Les accords cadres et marchs bons de commande (art. 76 et 77 du CMP)
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs dfinis
l'article 2 et des oprateurs conomiques publics ou privs, ayant pour objet d'tablir les
termes rgissant les marchs passer au cours d'une priode donne, notamment en ce qui
concerne les prix et, le cas chant, les quantits envisages. (art. 1 du CMP).
Le recours aux accords cadres et aux marchs bons de commande est une bonne pratique
qui gagnerait tre davantage utilise, elle rduit notamment les dlais, une fois laccord
cadre ou le march bons de commande pass.
Dialogue comptitif (art. 36 du CMP et 67 pour la procdure)6
Cf. Conception - ralisation (art. 37 du CMP et 69 pour la procdure) et Concours (art. 38 du
CMP et 70 pour la procdure)
2. Quelles sont les mesures de publicit mettre en uvre en fonction du montant du
march ?
Les dispositions relatives la publicit sont dtailles dans les articles 28, 35, 39 et 40 du
code des marchs publics. Ce dernier article dicte les principes.
Les seuils en matire de publicit ne sont pas exactement identiques ceux sappliquant
quant au choix de la procdure. En plus des seuils dj cits et relatifs aux choix de la
procdure, un seuil fix 90 000 HT intervient. Ce seuil est commun aux marchs de
travaux et de fournitures.
Le principe est que pour les achats compris entre 15 000 et 90 000 7 libert de choix
des modalits de publicit.
Le choix des modalits de publicit doit tre adapt et proportionnel aux caractristiques du
march.
9 Marchs de travaux :
4
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-
procedures/aoo.pdf et
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-
procedures/aor.pdf
5
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-
procedures/negoc-avec-pub.pdf et
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-
procedures/negoc-sans-pub.pdf
6
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/deroulement-
procedures/dialog.pdf
7
Et les achats de service relevant de larticle 30 I, dun montant gal ou suprieur 15 000 .
Comit national de fiabilit des comptes locaux
14
De 90 000 HT 5 000 000 HT :
BOAMP ou Journal habilit recevoir des annonces lgales / Publication sur le profil
acheteur / Les publications se conforment au modle officiel (arrt du 27 aot 2011)
Lavis peut tre publi dans un journal spcialis si le pouvoir adjudicateur lestime
ncessaire afin de respecter les principes noncs larticle 1 du CMP.
Au dessus de 5 000 000 HT :
BOAMP et journal officiel de lUnion Europenne / Publication sur le profil acheteur / Les
publications se conforment aux modles officiels (arrt du 27 aot 2011 et modle annex
au rglement n842/2011 du 19 aot 2011.
9 Marchs de fournitures et services :
De 90 000 HT 200 000 HT
BOAMP ou Journal habilit recevoir des annonces lgales / Publication sur le profil
acheteur / Les publications se conforment au modle officiel (arrt du 27 aot 2011)
Lavis peut tre publi dans un journal spcialis si le pouvoir adjudicateur lestime
ncessaire afin de respecter les principes noncs larticle 1 du CMP.
Au dessus de 200 000 HT :
BOAMP et journal officiel de lUnion Europenne / Publication sur le profil acheteur / Les
publications se conforment aux modles officiels (arrt du 27 aot 2011 et modle annex
au rglement n842/2011 du 19 aot 2011) Cf. documentation :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/tableaux/ct-
publicite.pdf
3 . Les obligations informatives sur les marchs publics.
9 Obligation de recensement annuel
Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque anne une liste
des marchs conclus l'anne prcdente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est
tablie dans les conditions dfinies par un arrt du ministre charg de l'conomie (Art.
133 du CMP).
Seuls sont concerns par cette publication les marchs suprieurs 20 000 HT (arrt du
21 juillet 2001). La publication est faite sur un support choisi par la collectivit (site Internet
de la collectivit, journal local, journal dannonces lgales). Cf.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D83ED32031FB6F9BAA09FF0097503630.tpdjo16v_1?cid
Texte=JORFTEXT000024433807&dateTexte=20120330
La collectivit doit veiller sorganiser afin dtre en capacit de produire cette liste.
9 Obligation de lexcutif de rendre compte des dcisions prises sur dlgation de
signature
Lorgane excutif, maire, prsident, doit rendre compte chaque runion de lorgane
dlibrant des attributions exerces par dlgation de lorgane dlibrant. (CGCT art. L
2121-3, 3221-11, 4231-8 et 5211-10 selon le type de collectivit).
Particularit pour les rgions : Le prsident du conseil rgional rend compte la plus proche
runion utile du conseil rgional de l'exercice de cette comptence et en informe la
commission permanente (art. L 4231-8 du CGCT).
Comit national de fiabilit des comptes locaux
15
FICHE N2 : LES RISQUES INHERENTS AU SUIVI DES MARCHES
Cette fiche a pour objectif dinsister plus prcisment sur un risque identifi dans ce
processus de la commande publique. Sans tre un risque majeur, il convient dappeler
lattention des praticiens sur ce sujet.
En effet, dans la pratique, les services techniques chargs de commander les biens,
fournitures ou services se retrouvent souvent confronts un manque dinformation quant
aux marchs en cours. Cela peut amener, un service gestionnaire ou technique de sortir du
cadre contractuel des marchs existants en toute bonne foi, simplement parce quils nont
pas t informs suffisamment des dlais, du choix dun nouveau fournisseur ou du
changement de tarifs.
Deux types de risques ont t principalement identifis :
9 Les services gestionnaires passent une commande alors que le march est soit termin,
soit na pas encore t notifi.
9 Les services gestionnaires passent une commande en absence davenant alors que le
montant des dpass ou alors que lavenant na pas encore t notifi.
Il sagit dun problme dinformation des services qui peut tre rsolu avec la mise en place
dune organisation adapte.
Documentation :
Une bonne pratique identifie consiste mettre la disposition des services oprationnels
diffrents documents leur permettant de connatre les marchs actifs sur lesquels ils
peuvent commander.
Il est prconis dorganiser la circulation de linformation partir dun service unique.
La direction des finances, ou un autre service, selon lorganisation, doit informer
rgulirement les services gestionnaires sur les nouveaux marchs notifis, sur les marchs
en fin de vie, sur les avenants notifis via des tableaux de bord. Cette information peut tre
diffuse via le site intranet de la collectivit.
En terme de bonne pratique, une grande collectivit ralise des tableaux de bord mensuels
dalerte reprenant les vnements affectant les marchs pour les 3 mois venir.
Organisation :
La dsignation dun service unique charg de la diffusion et du suivi des diffrents marchs
apparat indispensable notamment dans les collectivits o la commande est dcentralise.
De mme, ladaptation du systme dinformation permet de gnrer des alertes en bloquant
si besoin, laccs pour le service gestionnaire, un fournisseur. sur un marche qui ne serait
pas ou plus actif .
Traabilit
Elle est assure par le logiciel de suivi des marchs.
La dtection de lanomalie seffectue avec la date de service fait par rapport la date de
notification du march.
Imposer la rfrence des marchs sur les factures
Comit national de fiabilit des comptes locaux
16
LES RISQUES MAJEURS CHEZ LE COMPTABLE
La processus commande publique ne sarrte pas au stade du mandatement, puisque
lensemble des flux et des pices sont rceptionnes par le comptable qui devra exercer ses
contrles rglementaires tels que prvus par le dcret consacr la gestion budgtaire et
comptable publique (GBCP) du 7 novembre 20128.
Il exerce a cette occasion avant deffectuer la prise en charge un visa des oprations
transmises par lordonnateur.
Les fiches de risque majeur telles quelles sont prsentes, ci-dessous, dcrivent le travail
du comptable sur les tches mentionnes et le dispositif de contrle interne quil se doit de
mettre en uvre.
Ce rfrentiel a t labor en mai 2012 et valid au sein de la DGFiP, il est applicable
tous les comptables du secteur public local lesquels peuvent sen servir comme base
documentaire notamment pour structurer une dmarche dauto diagnostic ou alors sil
souhaite renforcer son dispositif de matrise des risques associs ce processus.
8 risques ont t considrs comme majeurs sur les 6 oprations suivantes :
Opration 1 : contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP,
Risque n1 : Incomptence juridique du signataire des pices
Risque n 2 : Pices justificatives absentes, insuffisantes ou invalides
Risque n 3 : absence de service fait
Opration 2 : Enregistrement comptable de la prise en charge de lordre de payer
Risque n 4 : Enregistrement comptable sur un compte erron
Opration 3 : Rgularisation de lavance
Risque n 5 : Carence dans la rgularisation de lavance
Opration 4 : Traitement de lopposition ou de la cession de crance
Risque n 6 : Carence dans le traitement de cession/opposition
Opration 5 : Contrle des conditions dapplication de la retenue de garantie
Risque N 7 : Absence de liquidation de la retenue de garantie
Opration 6 : Traitement de la libration de la retenue de garantie
Risque n 8 : Carence dans la libration de la retenue de garantie
8
Cf. Dcret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif la Gestion budgtaire et comptable publique
Comit national de fiabilit des comptes locaux
17
Risque n1
Procdure : Prise en charge
Tche : Visa
Opration : Contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP
Objectif : Qualit comptable / Ralit
Risque gnrique : Incomptence juridique / Risque spcifique : Incomptence juridique du signataire des pices.
Dtail composants risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant Gnralits
Une dpense n'est rgulire que pour autant que le signataire des pices est juridiquement
comptent. Les consquences du paiement d'une dpense engage par une personne
-Dfaut de mise jour des incomptente pouvant tre juridiquement et financirement trs lourdes, il appartient aux
dlgations de pouvoir et de comptables de mettre en uvre des mesures, notamment organisationnelles, propres faciliter
signature (suite des le contrle, par les agents en charge du paiement des mandats, de la qualit et de la
lections par exemple) ; comptence juridique des signataires des pices.
Documentation :
- Dfaut de formation ; Diffusion :
- du dcret GBCP du 7 novembre 2012 ;
- Tentative dopration - du dcret n2007-450 du 25 mars 2007 (annexe 1 du CGCT ) ce dcret insre au CGCT un
irrgulire (fraude). nouvel article D.1617-23 qui dispose que la signature par lordonnateur du bordereau
rcapitulant les mandats de dpense emporte justification du service fait des dpenses
vnement concernes et attestation du caractre excutoire des pices justifiant ces dpenses ;
- du guide mthodologique du CHD (mthodologies gnrale et mthodologie amnage) ;
Incomptence juridique du - du guide gnral du contrle partenarial.
signataire des pices. Traabilit :
Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes de
rgularisation notifies lordonnateur.
Organisation :
Auto-contrle :
Dans le cadre de l'auto-contrle, il est ncessaire de contrler la qualit du signataire des
pices : sa capacit engager la dpense au regard de ses fonctions ou de la dlgation de
signature quil a reue cet effet. A cette fin, un dossier comportant l'ensemble des actes de
Impacts nomination et des dlgations de pouvoir, de signature des personnes habilites doit tre tenu,
Impact budgtaire : mis jour au fil de l'eau et accessible au service tout moment pour faciliter l'exercice du visa.
engagement budgtaire tort. Contrle de supervision a posteriori :
Impact juridique : risque de Il appartient au comptable de s'assurer, dans le cadre du contrle de supervision a
contentieux. posteriori, de la mise jour rgulire, de l'accessibilit et de l'utilisation de ce dossier par les
agents.
Par ailleurs, le comptable doit s'assurer, par un contrle de supervision a posteriori, de la
qualit du signataire des pices .
Dans cet objectif, il s'assure sur un chantillon d'oprations comprises dans le plan de CHD,
de la capacit des signataires des pices engager la collectivit et ordonnancer des
dpenses, ainsi que de la correcte assignation de la dpense.
Modalits dchantillonnage
Le contrle de supervision ne doit pas se limiter l'analyse des rejets de mandats oprs par le
poste comptable. La qualit du visa doit galement tre apprcie partir des mandats pris en
charge. L'chantillon de 30 mandats doit tre tir partir de la liste des pices vises, qui
rcapitule les lignes de mandats qui ont fait l'objet d'un visa trac. Cette liste est fournie en
consultation comme en dition. L'dition est disponible au format CSV, ce qui permet au
comptable de manipuler les donnes
(cf. Mode opratoire 1).
Pour chaque ligne de mandat recense et comprise dans l'chantillon tir dans les conditions
ainsi dfinies, la liste des pices vises donne accs la fiche de visa, qui reprend les donnes
enregistres et les donnes relatives au visa intellectuel (date et dcision de visa, motifs
d'erreur et commentaires ventuels).
Comit national de fiabilit des comptes locaux
18
Risque 2
Procdure : Prise en charge
Tche : Visa
Opration : Contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP
Objectif : Qualit comptable / Justification
Risque gnrique : Pices justificatives absentes, insuffisantes ou invalides / Risque spcifique : Pices
justificatives insuffisantes ou errones.
Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant Gnralits
Le rle du comptable, en sa qualit de payeur, est de s'assurer, sur la base des pices
- Dfaut de formation, comptables et justificatives qui lui sont produites par la collectivit l'appui de son ordre de
paiement, de la rgularit formelle de la dpense. Il lui appartient notamment de vrifier,
conformment aux dispositions du dcret GBCP du 7 novembre 2012, la production des
- Mconnaissance de la justifications . La multiplicit et la gravit des consquences d'un paiement qui serait fait au
nomenclature des vu de pices justificatives insuffisantes ou incorrectes imposent au comptable de s'assurer
pices justificatives, que ce rapprochement a t fait par les agents en charge des paiements, conformment au
plan de CHD dfini par ses soins et valid par le DRFiP ou le DDFiP.
- CHD mal matris. Documentation :
Diffusion :
vnement - du guide mthodologique du CHD (mthodologies gnrale et mthodologie amnage) ;
- du guide gnral du contrle partenarial.
Pices justificatives
insuffisantes ou errones. Traabilit :
Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes
de rgularisation notifies lordonnateur.
Organisation :
Auto-contrle :
Il est en premier lieu demand aux agents en charge du visa des mandats de procder un
contrle de la prsence et de la qualit des pices justificatives jointes par lordonnateur
Impacts lappui du mandat. Les dpenses qui font lobjet dun contrle a priori dans le cadre du CHD
sont celles qui prsentent les risques les plus importants et leur visa doit faire lobjet dune
Dpense irrgulire. attention soutenue.
Contrle de supervision a posteriori :
Compte non justifi.
Il appartient par ailleurs au comptable de procder un contrle de supervision a
posteriori pour sassurer de la conformit des pices justificatives adresses lappui des
mandats.
La dmarche statistique utilise dans le cadre du contrle hirarchis induit que les mandats
contrls sont reprsentatifs de l'ensemble des mandats mis. L'enjeu du contrle de
supervision a posteriori est donc de s'assurer :
- du respect du plan de contrle ;
- de la qualit du visa sur les seuls mandats compris dans l'chantillon ayant donn lieu
contrle par le service.
Le respect du plan de contrle comporte diffrentes tapes, qui sont listes dans la fiche 16
du guide mthodologique du contrle hirarchis des dpenses.
Modalits dchantillonnage
Cf. Risque n1
Comit national de fiabilit des comptes locaux
19
Risque 3
Procdure : Prise en charge
Tche : Visa
Opration : Contrle de la rgularit de la dpense en fonction du plan CHD et du CAP
Objectif : Rgularit / ralit
Risque gnrique : Dette ou obligation inexistante, infonde ou prescrite
Risque spcifique : Absence de service fait
Dtail des composants du risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant Gnralits
- Absence ou carence dans Le dcret n2007-450 du 25 mars 2007 actualisant la liste des pices
laccs la rglementation et justificatives, insre au CGCT un nouvel article D.1617-23 qui dispose que la
aux instructions et signature par lordonnateur du bordereau rcapitulant les mandats de
circulaires ; dpense emporte justification du service fait des dpenses concernes et
- Dfaut de formation ; attestation du caractre excutoire des pices justifiant ces dpenses.
- Carence dans les points de
contrle.
vnement Documentation :
Diffusion :
Absence de service fait
- du dcret n2007-450 du 25 mars 2007 - annexe 1 du CGCT
- du guide mthodologique du CHD (mthodologies gnrale et mthodologie
amnage) ;
- du guide gnral du contrle partenarial.
Traabilit :
Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats
et demandes de rgularisation notifies lordonnateur.
Impacts
Organisation :
Collectivit irrgulirement dbitrice
Auto-contrle :
Contrle de la signature des bordereaux de mandats
Contrle de supervision a posteriori :
Il appartient au comptable de procder un contrle de supervision a
posteriori pour sassurer de la justification du service fait sur les dpenses.
Dans cet objectif, il s'assure sur un chantillon d'oprations comprises dans
le plan de CHD, de la formalisation du service fait, au travers de la signature
des bordereaux de mandats correspondants. Ce contrle est concomitant
celui de la vrification de la qualit du signataire, et peut sappuyer sur le
mme chantillon.
Modalits dchantillonnage
Cf. Risque n1
Comit national de fiabilit des comptes locaux
20
Risque 4
Procdure : Prise en charge
Tche : Visa
Opration : Enregistrement comptable de la prise en charge de lordre de payer
Objectif : Qualit comptable / Imputation
Risque gnrique : Enregistrement non conforme aux rgles dimputation comptable
Risque spcifique : Enregistrement comptable sur un compte erron.
Dtail des composants du risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant Gnralits
-Mconnaissance de la nomenclature La correcte comptabilisation des dpenses impacte directement la situation
comptable. financire des collectivits, et a parfois des consquences directes sur le
niveau des ressources, notamment fiscales, dont elle peut bnficier. Il
convient notamment de veiller, compte tenu de limpact dune
- Mconnaissance des rgles relatives comptabilisation errone au regard du bnfice du FCTVA ou de la
limputation en investissement ou disponibilit des crdits budgtaires, ce que les dpenses soient
fonctionnement. correctement comptabilises en classe 2 ou en classe 6.
Documentation :
vnement
Diffusion des instructions comptables M 14, M51, M71, M49.
Enregistrement comptable sur un
compte erron. Traabilit :
Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de
Impacts mandats et demandes de rgularisation notifies lordonnateur.
Mauvaise qualit comptable.
Organisation :
Diminution injustifie du rsultat Auto-contrle :
comptable en cas dimputation errone
en charge. Le correct enregistrement comptable doit donner lieu auto-contrle de la
part des agents en charge de la dpense.
Erreur dans le suivi des crdits
budgtaires (AE, AP, CP). Contrle de supervision a posteriori :
Le comptable doit par ailleurs s'assurer, dans le cadre d'un contrle de
Assiette du FCTVA sous-value. supervision a posteriori, portant sur un chantillon d'oprations ayant
donn lieu CHD, que les dpenses comprises dans le plan ont t
correctement comptabilises.
Modalits dchantillonnage
Cf. Risque n1
Comit national de fiabilit des comptes locaux
21
Risque 5
Procdure : Prise en charge
Tche : Gestion de lavance
Opration : Rgularisation de lavance
Objectif : Qualit comptable / Ralit
Risque : Dette ou obligation inexistante, infonde ou prescrite
Risque spcifique : Carence dans la rgularisation de lavance.
Dtail des composants du Dispositif de contrle interne
risque
Gnralits
Facteurs dclenchant Lavance est destine faciliter lexcution du march et assurer lgalit daccs aux
Dfaut de formation. marchs entre les entreprises. Elle leur permet de disposer dune trsorerie suffisante
pour dmarrer lexcution des prestations.
Le remboursement de l'avance s'impute sur le versement des acomptes, ds que le
Mconnaissance de la
montant des prestations atteint 65 % des sommes TTC dues au titulaire dfaut
rglementation.
dautres dispositions dans le march (cf article 88-II du Code des Marchs Publics). Il
doit tre achev lorsque le montant des prestations excutes par le titulaire atteint
Dfaut de suivi des avances. 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confies.
Documentation :
Diffusion de la fiche PNSR de Lyon du 05/04/2011 : Lavance.
Traabilit :
vnement
Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et
demandes de rgularisations notifies lordonnateur
Carence dans la rgularisation
Organisation :
de lavance.
Auto-contrle :
Lauto-contrle vise s'assurer que le seuil de 65 % du montant du march, partir
duquel l'avance doit tre rembourse, n'est pas atteint. Lapplication Hlios exerce
une surveillance de ce seuil. A cet effet, lagent doit renseigner la fiche march : dans
l'cran relatif aux modalits financires, il complte le champ "Rcupration avance
HT" de la somme correspondant 65 % du montant du march, dfaut dautres
dispositions dans le march.
Contrle de supervision a posteriori :
Il appartient par ailleurs au comptable dexercer un contrle de supervision a
Impacts posteriori pour sassurer dune part du respect du seuil de dclenchement de
Perte financire pour la rcupration de lavance et dautre part de la conformit des modalits de
collectivit. rcupration de lavance conformment aux dispositions du march. Pour exercer ce
contrle, le responsable prend appui notamment sur le CCAG et le CCAP.
Mauvaise qualit comptable :
dfaut dapurement du Modalits dchantillonnage
compte davance Editer les Livres auxiliaires des comptes de tiers et financiers des comptes davance
(237, 238 et 4091). Ldition est en format pdf actuellement. La constitution de
lchantillon de avances seffectue de manire alatoire ou selon un mode dgressif
(les montants les plus significatifs en premier).
Constituer un chantillon spcifique de 30 avances. Analyser le nombre danomalies
constates. La priode considrer pour constituer lchantillon est le dernier
semestre.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
22
Risque 6
Procdure : Prise en charge
Tche : Oppositions et cessions de crances
Opration : Traitement de lopposition ou de la cession de crance.
Objectif : Qualit comptable / Ralit
Risque gnrique : Paiement non libratoire / Risque spcifique : Carence dans le traitement de cession/oppo
Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant Gnralits
Carence dans lattribution des Le traitement des cessions/oppositions fait courir au comptable le risque d'effectuer un
tches. paiement non libratoire et des risques contentieux. C'est un domaine que le comptable
doit particulirement surveiller. En effet, sa responsabilit personnelle et pcuniaire est
mise en cause lorsquun paiement est ralis au mauvais crancier. Cette tche doit,
Mconnaissance des divers pour cette raison, faire l'objet de mesures fortes de matrise des risques.
types de cession/opposition. Documentation :
Diffusion des 3 fiches pratiques Hlios : La gestion des COP.
Traabilit :
- indication de la date darrive pour chaque cession / opposition reue. Les
oppositions reues sont enregistres dans lordre chronologique darrive ;
vnement - conservation de la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes
de rgularisation notifies lordonnateur.
Carence dans le traitement de
la cession/opposition. Organisation :
Auto-contrle :
Les agents ayant reu dlgation du comptable pour recevoir et traiter les
cessions/oppositions doivent procder un auto-contrle de toutes les dcisions ayant
pour effet d'admettre ou de rejeter les cessions/oppositions, et des dcisions de
Impacts mainleve. Les cessions/oppositions doivent tre enregistres ds rception.
Paiement non libratoire.
Contrle mutuel :
Risque de litiges, contentieux
juridiques. Les agents ayant reu dlgation du comptable pour recevoir et traiter les
Dbet. cessions/oppositions ne doivent pas tre galement chargs de procder au paiement
des cessionnaires/opposants. Lors du paiement des mandats, les agents en charge de la
Image. mission de caissier doivent procder un contrle de rapprochement entre la dette de la
collectivit et le fichier des cessions/oppositions enregistres. En prsence d'une
cession/opposition, ces agents procdent systmatiquement au contrle de la qualit du
cessionnaire/opposant (et de son identit bancaire).
Contrle de supervision a posteriori :
Ce contrle est destin s'assurer de la ractivit de la prise en compte des oppositions
par le service, mesure travers le dlai coul entre la date de rception de la
cession/opposition et sa date d'enregistrement. Par ailleurs, le comptable devra sassurer
de la correcte excution des cessions/oppositions.
Modalits dchantillonnage
Le comptable procde au contrle de la date de prise en compte dans sa base de suivi
des cessions/oppositions (module COP d'HELIOS) d'un chantillon dactes reus par le
poste au cours de la priode qui prcde son intervention (cf. Mode opratoire 2).
Constituer un chantillon spcifique de 30 cessions/oppositions dans le cadre de la
commande publique. Analyser le nombre danomalies constates. La priode
considrer est fonction du degr de risque considr par le comptable.
Le comptable s'assure que ces oppositions ou cessions reues ont fait l'objet d'un
enregistrement immdiat (date de rception de la notification / date de saisie) dans la
base de suivi et d'une dcision d'enregistrement ou de rejet.
Il sassure galement de la correcte excution des cessions /oppositions compte tenu des
actes notifis (montant, crancier ).
Comit national de fiabilit des comptes locaux
23
Risque 7
Procdure : Prise en charge
Tche : Retenues de garantie
Opration : Contrle des conditions dapplication de la retenue de garantie
Objectif : Qualit comptable / Ralit
Risque gnrique : Dette ou obligation inexistante, infonde ou prescrite / Risque spcifique : Absence de
liquidation de la RG.
Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant Gnralits
Dfaut de formation. L'application de la retenue de garantie aux marchs a pour objet de couvrir les rserves que
pourraient formuler les collectivits la rception des travaux, fournitures et services ainsi
que celles formules pendant le dlai de garantie. Il sagit de la garantie de droit commun en
Dfaut de suivi des P 530 matire de march public. Le fait de l'appliquer est une facult qui a pour effet de prserver
HELIOS. les intrts patrimoniaux de la collectivit et de lui faire conomiser une partie du prix
lorsque les rserves ne peuvent tre leves.
Mauvais tablissement du P Il appartient au comptable de procder au calcul du montant de la retenue de garantie, si les
stipulations du march ont prvu lapplication de cette dernire.
530.
Il est important de veiller la correcte application de la garantie, et la correcte information
des ordonnateurs des montants retenus ce titre.
Absence de matrise de la
rglementation. Documentation :
- la fiche du PNSR de Lyon du 24 juin 2011 : Les retenues de garantie.
- la fiche pratique Hlios : Les garanties dans les marchs publics.
vnement - la note CL1A du 24 aot 2009 relative au traitement des retenues de garantie et des
pnalits dans le cadre des marchs publics au regard de la taxe sur la valeur ajoute.
Traabilit :
Absence de liquidation de la
retenue de garantie. Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et demandes
de rgularisation notifies lordonnateur
Organisation :
Auto-contrle :
A cet effet, les agents en charge du visa des mandats doivent s'assurer, au moyen dun
auto-contrle, que l'ordonnateur applique bien le contrat (liquidation effective et pour le taux
prvu au contrat de la retenue de garantie).
Le montant de la retenue de garantie ne peut tre suprieur 5% : du montant initial du
march, augment, sil y a lieu, du montant des avenants.
Contrle de supervision a posteriori :
De son ct, le comptable exercera un contrle de supervision a posteriori pour
Impacts sassurer que les retenues de garantie ont t appliques conformment aux dispositions du
Impacts comptables : - march. Il contrlera galement le cas chant que les dispositions relatives la dduction
rgle du produit brut non de la TVA ont t correctement appliques.
respecte, Voir ce sujet la note CL1A du 24 aot 2009 relative au traitement des retenues de garantie
- mauvaise imputation en et des pnalits dans le cadre des marchs publics au regard de la taxe sur la valeur
compte de tiers. ajoute.
Modalits dchantillonnage
Impact financier : Le comptable retiendra un chantillon de 30 retenues de garantie sur une priode de 6 mois
prcdant la date du contrle. En cas de nombre de retenues de garantie infrieur 30 sur
non prservation des cette priode semestrielle, le nombre d'units contrler est exhaustif.
intrts patrimoniaux de la
collectivit. Le chef de poste demandera l'dition des fiches dtailles des paiements sur marchs sous
Hlios en dfinissant une priode (cf. Mode opratoire 3). Ces ditions lui permettront
d'analyser les modalits de traitement de la retenue de garantie. Le comptable examinera
les pices de chaque march concern fixant les modalits de ralisation des retenues de
garantie : il s'agira le plus souvent du cahier des charges particulires qui lui permettra de
s'assurer que l'ordonnateur a bien choisi d'appliquer une retenue de garantie et selon quel
taux. Le comptable procdera galement cette analyse au moyen de chaque mandat
considr.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
24
Risque 8
Procdure : Prise en charge
Tche : Libration de la retenue de garantie
Opration : Traitement de la libration de la retenue de garantie
Objectif : Rattachement la bonne priode
Risque gnrique : Risque de retard denregistrement en comptabilit / Risque spcifique : Carence dans la
libration de la retenue de garantie.
Dtail composants du risque Dispositif de contrle interne
Facteurs dclenchant Gnralits
Absence de suivi des librations
A l'issue du dlai de garantie, ou lorsque les ventuelles rserves ont t leves, les
de retenues de garantie.
retenues de garantie doivent tre libres par le comptable au vu dune dcision de
lordonnateur.
Absence dalerte du comptable
La retenue de garantie est rembourse un mois au plus tard aprs lexpiration du
auprs de lordonnateur.
dlai de garantie ou aprs la date de leve des rserves
Le fait de ne pas restituer cet lment du prix dans les dlais aux cranciers expose
Absence de pices justificatives.
au paiement d'intrts moratoires, et laisse subsister dans les comptes de tiers des
sommes dont le maintien est injustifi.
Carence dans la formation.
Comme il est important de procder la correcte application de la retenue de
vnement garantie lorsqu'elle est prvue, il est important de procder sa libration lorsque le
Carence dans la libration de la motif pour lequel elle a t retenue n'existe plus.
retenue de garantie. Documentation :
Diffusion de :
- la fiche du PNSR de Lyon du 24 juin 2011 : Les retenues de garantie.
- la fiche pratique Hlios : Les garanties dans les marchs publics.
Impacts
Impact financier : paiement - la note CL1A du 24 aot 2009 relative au traitement des retenues de garantie et
dintrts moratoires si la retenue des pnalits dans le cadre des marchs publics au regard de la taxe sur la valeur
de garantie nest pas libre ajoute.
dans les dlais. Traabilit :
Il convient de conserver la trace des anomalies, des suspensions de mandats et
Mauvaise qualit comptable : demandes de rgularisation notifies lordonnateur.
solde du compte de tiers non
apur. Organisation :
Auto - contrle :
Remboursement au mauvais
Les agents en charge de la dpense doivent s'assurer priodiquement que les
crancier.
sommes inscrites en comptes de tiers (40171 et 40471) le sont toujours
rgulirement. Il y a lieu pour ces agents de procder, dans le cadre d'un auto -
contrle, un balayage des tats de dveloppement des soldes afin de s'assurer de
l'apurement des sommes correspondant aux marchs solds.
Contrle de supervision a posteriori :
Le comptable doit sassurer, au moyen dun contrle de supervision a posteriori
de lapurement rgulier des comptes de tiers.
Modalits dchantillonnage
Le comptable dite la liste des tats de dveloppement des soldes des comptes de
retenue de garantie (40171 et 40471) des collectivits enjeux (cf. module de
cotation des collectivits) qui lui permettront de sassurer de leur correct apurement
rgulier.
Le contrle est oprer sur les retenues de garantie dans la limite de 30 en retenant
des plus anciennes.
Comit national de fiabilit des comptes locaux
25
Vous aimerez peut-être aussi
- Projet de Fin D'etudeDocument68 pagesProjet de Fin D'etudeYounes Bouchri67% (12)
- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation
- Guide Afigese Cetification-Mai2016Document42 pagesGuide Afigese Cetification-Mai2016La Gazette des communes0% (2)
- Audit - Cycle VenteDocument39 pagesAudit - Cycle VenteEssoulahi Essoulahi93% (27)
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Exposé N 06 Le LeadershipDocument29 pagesExposé N 06 Le LeadershipRachid Ait Mansour75% (4)
- Audit Comptable Et FinancierDocument2 pagesAudit Comptable Et FinancierjamilaPas encore d'évaluation
- Rapport Annuel 2016Document158 pagesRapport Annuel 2016DaniokoPas encore d'évaluation
- Memoire Version Originale 17 08 2021Document60 pagesMemoire Version Originale 17 08 2021Ismael Issa Malam OumarouPas encore d'évaluation
- Techniques Dexamen Des ComptesDocument27 pagesTechniques Dexamen Des Compteslp visaPas encore d'évaluation
- APPLICATION 45-QCU-corrigéDocument6 pagesAPPLICATION 45-QCU-corrigéMouna ElPas encore d'évaluation
- Cours IIDocument5 pagesCours IIImene Meha100% (1)
- Les Pieces Justificatives Une Competence PartageeDocument19 pagesLes Pieces Justificatives Une Competence Partageeisidore kpameganPas encore d'évaluation
- Les Risques de Dérapage Financier Des CTDocument3 pagesLes Risques de Dérapage Financier Des CTilyasPas encore d'évaluation
- BrinDocument16 pagesBrinIsmail LatifiPas encore d'évaluation
- Circuit de La DepenseDocument25 pagesCircuit de La DepenseWald Nass100% (1)
- Guide Service Facturier Dans Les EpnDocument21 pagesGuide Service Facturier Dans Les EpnEdouard KamePas encore d'évaluation
- RFC 519 Et 520 Consolides Pour CRCC Paris V3Document64 pagesRFC 519 Et 520 Consolides Pour CRCC Paris V3Mahamadou SANOGOPas encore d'évaluation
- Techniques D'examen Des ComptesDocument39 pagesTechniques D'examen Des ComptesB.I100% (61)
- Correction Cas PROMIMDocument5 pagesCorrection Cas PROMIMAmadou DiaPas encore d'évaluation
- Titre XII - Comptabilité PubliqueDocument35 pagesTitre XII - Comptabilité Publiquebenyfirst100% (1)
- Module GID IntroDocument9 pagesModule GID Introikram ouahenoudenPas encore d'évaluation
- Audit BasesDocument15 pagesAudit BasesBaraa MarwaPas encore d'évaluation
- Position Afigese: Bilan Certification ComptesDocument8 pagesPosition Afigese: Bilan Certification ComptesLa Gazette des communesPas encore d'évaluation
- Procedure Comptable ManuelDocument22 pagesProcedure Comptable ManuelRazik RamtaniPas encore d'évaluation
- Nouveau Document Microsoft Office WordDocument2 pagesNouveau Document Microsoft Office WordRazik RamtaniPas encore d'évaluation
- Support Cours Controle Fiscal 1Document46 pagesSupport Cours Controle Fiscal 1Doudi kidsPas encore d'évaluation
- Les Atouts de La Digitalisation Des Procédures de Contrôle Fiscal À La DGIDocument4 pagesLes Atouts de La Digitalisation Des Procédures de Contrôle Fiscal À La DGIDassi LionelPas encore d'évaluation
- Evaluation Du CI D'un Cycle VenteDocument16 pagesEvaluation Du CI D'un Cycle Ventehervediby3756Pas encore d'évaluation
- Audit Des Projets de DéveloppementDocument23 pagesAudit Des Projets de DéveloppementSamuel Sakou100% (3)
- Processus AICDocument57 pagesProcessus AICmonouche02Pas encore d'évaluation
- 1 Controle Interne CAHIER TD 2019 2020Document26 pages1 Controle Interne CAHIER TD 2019 2020Sahar Fekih100% (1)
- 712 Exam Intec 2009 CorrigeDocument12 pages712 Exam Intec 2009 Corrigekhaoula elPas encore d'évaluation
- Suite Complement Du Cours de CACDocument11 pagesSuite Complement Du Cours de CACtanguyefa84Pas encore d'évaluation
- Programme Travail Cycle Achat FournisseursDocument6 pagesProgramme Travail Cycle Achat FournisseursGondwanais LamdaPas encore d'évaluation
- Audit Procus PDFDocument22 pagesAudit Procus PDFbhz othmanePas encore d'évaluation
- Étape 1 de La Méthodologie DDocument5 pagesÉtape 1 de La Méthodologie DmsaddakPas encore d'évaluation
- Audit Ventes ClientsDocument39 pagesAudit Ventes ClientsMeryam TajabritePas encore d'évaluation
- CAPTIO - Guide Essentiel - Manuel de Poche Pour Le Controle FinancierDocument19 pagesCAPTIO - Guide Essentiel - Manuel de Poche Pour Le Controle FinancieroussamaPas encore d'évaluation
- Processus Du Cycle Comptable 2 Camtel RefaitDocument27 pagesProcessus Du Cycle Comptable 2 Camtel Refaitfridolin sombes100% (2)
- Module 2 - Démarche de L'auditeur Financier PDFDocument11 pagesModule 2 - Démarche de L'auditeur Financier PDFEtotoue Christian100% (2)
- Cahier de TD Controle Interne-1 PDFDocument18 pagesCahier de TD Controle Interne-1 PDFSahar Fekih100% (1)
- Cloture SapDocument18 pagesCloture SapYCART2Pas encore d'évaluation
- Guide de Reference Adaptee Tome2Document112 pagesGuide de Reference Adaptee Tome2Gianni ThuggaPas encore d'évaluation
- Obtention de La Preuve D'audit Dettes A Court Terme Et Charges A PayerDocument3 pagesObtention de La Preuve D'audit Dettes A Court Terme Et Charges A PayerB.IPas encore d'évaluation
- Controle Interne Et InventaireDocument118 pagesControle Interne Et Inventaireouma ya100% (1)
- Controle de Finance PubliqueDocument22 pagesControle de Finance PubliqueTouiti Moulay AzizPas encore d'évaluation
- INDICATEURSGESTIONDocument10 pagesINDICATEURSGESTIONTema NdongPas encore d'évaluation
- De La Nécessité de La Mise en Place D'un Manuel Des Procédures ComptablesDocument21 pagesDe La Nécessité de La Mise en Place D'un Manuel Des Procédures ComptablessayfuljabbarPas encore d'évaluation
- Rapport BnadefinitifDocument39 pagesRapport BnadefinitifZina MzoughiPas encore d'évaluation
- Axe2 6Document4 pagesAxe2 6massiki_hicham5544Pas encore d'évaluation
- Gid & GirDocument20 pagesGid & Girmouhcine.bellaouiPas encore d'évaluation
- La Justification Des Phases de L'audit Comptable Et Financier en 10 PointsDocument10 pagesLa Justification Des Phases de L'audit Comptable Et Financier en 10 PointsDuc LassPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture 1Document4 pagesFiche de Lecture 1oussama el haskouriPas encore d'évaluation
- Rci Recettes Comptable Vd-1Document53 pagesRci Recettes Comptable Vd-1Myn SdhmdPas encore d'évaluation
- Audit Vente CLTDocument5 pagesAudit Vente CLTZahra NAHIDPas encore d'évaluation
- Le Contrôle JuridictionnelDocument22 pagesLe Contrôle JuridictionnelSalim Wydadi0% (1)
- Window dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?D'EverandWindow dressing: La manipulation comptable est-elle toujours frauduleuse ?Pas encore d'évaluation
- Comprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgeD'EverandComprenez votre comptable: Découvrez les bases de la comptabilité belgePas encore d'évaluation
- Optimiser le coût du risque crédit - sous Bâle 3, IFRS 9 et la BCE - exemple en banque de détailD'EverandOptimiser le coût du risque crédit - sous Bâle 3, IFRS 9 et la BCE - exemple en banque de détailPas encore d'évaluation
- L'Intelligence ÉconomiqueDocument12 pagesL'Intelligence ÉconomiqueAli HabibPas encore d'évaluation
- Electricité Lancement D'un Méga Projet Reliant L'afrique À L'europeDocument1 pageElectricité Lancement D'un Méga Projet Reliant L'afrique À L'europeAli HabibPas encore d'évaluation
- Audits Diaporama Aix1112Document18 pagesAudits Diaporama Aix1112Ali HabibPas encore d'évaluation
- Compagnie Du MississippiDocument3 pagesCompagnie Du MississippiAli HabibPas encore d'évaluation
- Assemblée Constituante Tunisienne de 1956Document5 pagesAssemblée Constituante Tunisienne de 1956Ali HabibPas encore d'évaluation
- Guide Performance Min Transport Equipement Tourisme Mer MethodesDocument56 pagesGuide Performance Min Transport Equipement Tourisme Mer MethodesAli Habib100% (1)
- Book Politique Budgétaire3 - 1Document303 pagesBook Politique Budgétaire3 - 1Ali HabibPas encore d'évaluation
- L'analyse Economique Du Droit de La Concurrence PDFDocument11 pagesL'analyse Economique Du Droit de La Concurrence PDFAli HabibPas encore d'évaluation
- Lean ManagementDocument170 pagesLean ManagementAli Habib50% (2)
- Système Fiscal TunisienDocument9 pagesSystème Fiscal TunisienAli HabibPas encore d'évaluation
- Fonds de RoulementDocument5 pagesFonds de RoulementAli HabibPas encore d'évaluation
- Zone Monétaire OptimaleDocument5 pagesZone Monétaire OptimaleAli HabibPas encore d'évaluation
- Decision Ouverture Tests - Concours 2022-2023Document9 pagesDecision Ouverture Tests - Concours 2022-2023Mohamed CoulibalyPas encore d'évaluation
- Les Droits Et Les Devoirs Des Hommes Et Des Femmes en IslamDocument9 pagesLes Droits Et Les Devoirs Des Hommes Et Des Femmes en IslamMohamed Chérif KhouaidjiaPas encore d'évaluation
- Loctite-Guide Des Solutions de MaintenanceDocument52 pagesLoctite-Guide Des Solutions de MaintenanceAnonymous LfeGI2hM100% (1)
- TD Mecanique Des Fluides l3 SteDocument6 pagesTD Mecanique Des Fluides l3 SteAnzoumana Fofana100% (1)
- 082 Glaucome Chronique PDFDocument1 page082 Glaucome Chronique PDFYacine MilediPas encore d'évaluation
- Pro Outils Logiciel XL Pro 400 Manuel Dutilisation 0Document121 pagesPro Outils Logiciel XL Pro 400 Manuel Dutilisation 0Brell LÉKAKAPas encore d'évaluation
- Guide - Education Aux Droits de L'hommeDocument212 pagesGuide - Education Aux Droits de L'hommeReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Le Cycle de Vie Dun Produit PDFDocument23 pagesLe Cycle de Vie Dun Produit PDFAbdelhafid Satfi100% (1)
- Démarche 8DDocument3 pagesDémarche 8DAnonymadine MyaPas encore d'évaluation
- Serieec1 Tp4 Regime Transitoire RC Et RL Enonce-2Document2 pagesSerieec1 Tp4 Regime Transitoire RC Et RL Enonce-2Ya HiaPas encore d'évaluation
- 2nde CoursDocument4 pages2nde CoursfayePas encore d'évaluation
- PSU - Solicitation - Formulaire de Garantie de Restitution D'Avance - FRDocument17 pagesPSU - Solicitation - Formulaire de Garantie de Restitution D'Avance - FRNicolle BelloubetPas encore d'évaluation
- Rapport Mohamed Karoui CompletDocument24 pagesRapport Mohamed Karoui CompletOussema BejaouiPas encore d'évaluation
- Ree 36 App 01Document42 pagesRee 36 App 01Kamel KimoPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°3 Eco 2011 2012 (Mme Boubaker Rym)Document4 pagesDevoir de Contrôle N°3 Eco 2011 2012 (Mme Boubaker Rym)MerciPas encore d'évaluation
- Le Livret Du LicenciéDocument36 pagesLe Livret Du LicenciéUSRYB100% (2)
- Le Sol, Sa Definition, Ses Constituants: Chapitre IlDocument17 pagesLe Sol, Sa Definition, Ses Constituants: Chapitre IlDriss BouyaPas encore d'évaluation
- Corrigé 3: Mesftp Collection Essebil Au BAC Sciences NaturellesDocument11 pagesCorrigé 3: Mesftp Collection Essebil Au BAC Sciences Naturellesالشيخ معط الله عبد القادر100% (1)
- Controle BudgétaireDocument28 pagesControle BudgétaireTaha stylesPas encore d'évaluation
- Fiche n2 LangueDocument3 pagesFiche n2 LangueNadir GhezalaPas encore d'évaluation
- Imágenes - (Egipto) - Émile Prisse D'avennes - Visions D'égypteDocument17 pagesImágenes - (Egipto) - Émile Prisse D'avennes - Visions D'égypteFerdinand Da VinciPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document32 pagesChapitre 1Amira WarhéniPas encore d'évaluation
- Configuration LdapDocument2 pagesConfiguration LdapAli BabaPas encore d'évaluation
- NF en Iso 5667-3-2018Document57 pagesNF en Iso 5667-3-2018zanazePas encore d'évaluation
- Corrige Devoir-01 - Gpb-Finance Comptabilite TC - CerapDocument2 pagesCorrige Devoir-01 - Gpb-Finance Comptabilite TC - CerapBrigitta DjikiniPas encore d'évaluation