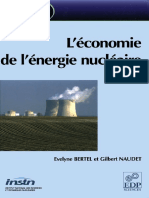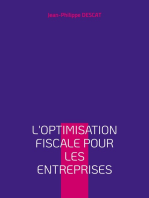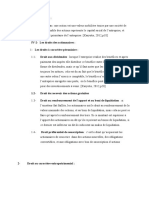Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ias 37 PDF
Ias 37 PDF
Transféré par
nawalTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ias 37 PDF
Ias 37 PDF
Transféré par
nawalDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiche de synthèse – IAS 37 Provisions, passifs éventuels
et actifs éventuels
DEFINITIONS
Définitions des provisions, des passifs et des passifs éventuels
Provision
Passif dont l’échéance ou le montant est incertain.
Passif
Obligation actuelle de l’entité résultant d’événements passés et dont le règlement devrait se traduire pour
l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.
Passif éventuel
− Obligation potentielle résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par
la survenance ou la non survenance d’un ou plusieurs événements futurs incertains, qui ne sont
pas totalement sous le contrôle de l’entreprise.
− Obligation actuelle résultant d’événements passés mais qui ne peut être comptabilisée :
• soit parce qu’il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation ;
• soit parce que le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
Distinctions entre provisions, dettes, charges à payer et passifs éventuels
Obligation à la date de Présentation dans
Sorties de
clôture résultant d’un Echéance Montant les états
ressources
événement passé financiers
Probable ou
Provisions Incertaine Incertain Provisions
certaine
Dettes
Certaine Certaine Certaine Certain Dettes
fournisseurs
Certaine ou Certaine ou
Charges à payer Certaine incertitude incertitude Dettes
faible faible
Informations à
Potentielle - - -
fournir en annexe
Passifs Impossibilité
éventuels d’évaluation
Certaine Improbable Informations à
- avec une
fournir en annexe
fiabilité
suffisante
Définitions des actifs éventuels
Actif éventuel
Actif potentiel résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance
ou non d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de
l’entreprise.
Principes de présentation dans les états financiers
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 1/13
Une entité ne doit pas comptabiliser un actif éventuel.
Lorsque des encaissements représentant des informations sur ces actifs éventuels à
avantages économiques sont probables mentionner en annexe.
Lorsque la réalisation des produits est quasi certaine l’actif correspondant n’est pas un actif
éventuel et doit être comptabilisé.
Les actifs éventuels sont à analyser de façon continue pour que les états financiers reflètent leur évolution
de manière appropriée.
COMPTABILISATION DES PROVISIONS
3 critères de comptabilisation d’une provision
Principe général
Une provision doit être comptabilisée lorsqu’il existe :
− une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé,
ET
− une sortie probable de ressources représentatives d’avantages économiques,
ET
− une estimation fiable du montant de l’obligation.
Si ces trois conditions ne sont pas réunies, aucune provision ne doit être comptabilisée.
Arbre de décision
Début
Non Non
Obligation actuelle résultant d’un Obligation potentielle ?
événement passé ?
Oui
Non Oui
Sortie de ressources probable ? Sortie de ressources faible ?
Oui
Non
Estimation fiable ?
Oui Non (rare)
Provision Indiquer le passif éventuel en annexe Ne rien faire
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 2/13
Premier critère : obligation actuelle résultant d’un événement passé
Obligation juridique et implicite
Un événement passé qui aboutit à une obligation actuelle est appelé fait générateur d’obligation.
L’entité n’a pas d’autre solution réaliste que de régler l’obligation créée par l’événement.
Obligation juridique : découle Obligation implicite découle des actions d’une
− d’un contrat (clauses explicites ou entité indiquant aux tiers, par ses pratiques
implicites), passées, par sa politique affichée, ou par une
− des dispositions légales ou déclaration récente suffisamment explicite
réglementaires, ou qu’elle assumera certaines responsabilités.
Création chez ces tiers d’une attente fondée
− de toute autre source de droit. qu’elle assumera ces responsabilités.
Autres caractéristiques de l’obligation générant la comptabilisation d’une provision
Une provision doit être comptabilisée si :
− L’obligation existe à la date de la clôture des comptes.
Aucune provision n’est comptabilisée au titre des coûts de fonctionnement qui devront être
encourus dans l’avenir.
− Une obligation implique toujours un engagement vis-à-vis d’une autre partie.
Toutefois, l’identité de l’autre partie n’est pas nécessairement connue, elle peut être une
collectivité.
− Une obligation implicite peut être créée par un événement qui ne génère pas une obligation
immédiate, mais qui peut en générer une, à une date ultérieure.
− Si les détails d’une nouvelle proposition de loi sont encore à finaliser, l’obligation naît uniquement
lorsque l’on a la quasi-certitude que les dispositions légales et réglementaires seront adoptées
sous la forme proposée.
− L’obligation résultant d’évènements passés est indépendante d’actions futures de l’entité.
Deuxième critère : sortie probable de ressources représentatives d’avantages
économiques
Une sortie de ressources est considérée comme probable, s’il est plus probable qu’improbable que cette
sortie de ressources se produira.
Probabilité de la sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.
Si probable > improbable Si improbable > probable Si probabilité très faible
Deuxième condition remplie Passif éventuel
− pour la constitution d’une provision − pas de constitution d’une provision − pas de constitution d’une provision
− information en annexe au titre d'une − information en annexe au titre d'un − pas d'information en annexe
provision passif éventuel
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 3/13
Troisième critère : estimation fiable du montant de l’obligation
Utilisation d’estimations sans que cela nuise à la fiabilité des états financiers car les provisions sont,
par nature, plus incertaines que la plupart des autres éléments du bilan.
Dans le cas extrêmement rare où aucune L’obligation est un passif éventuel faisant
estimation fiable ne peut être faite l’objet d’une information en annexe
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 4/13
EVALUATION DES PROVISIONS
Principes et méthodes d’estimation des provisions
Principe
Montant comptabilisé en provision la meilleure estimation de la dépense nécessaire au
règlement de l’obligation actuelle à la date de clôture.
Méthodes
− Montant que l’entreprise devra rationnellement payer pour régler son obligation ou la transférer à
un tiers, à la date de clôture.
− Estimations du résultat et de l’effet financier déterminées à partir du jugement de la direction de
l’entreprise et complétées par :
• l’expérience sur des transactions similaires,
• des rapports d’experts,
• et toute indication complémentaire fournie par des événements postérieurs à la date de
clôture.
− Cas d’incertitudes traitées par des moyens différents selon les circonstances :
Par exemple, lorsque la provision à évaluer comprend une population nombreuse d’éléments,
possibilité d’appliquer une méthode statistique appelée «méthode de la valeur attendue »
• Les montants estimés sont pondérés de probabilité de survenance (exemple : 60 %, 90 %)
• Lorsque les résultats possibles sont équiprobables dans un intervalle continu, le milieu de
l’intervalle est retenu.
Cas particulier : le montant de la provision peut être un montant plus élevé ou plus
faible que le montant le plus probable
Principe
Montant le plus probable pour éteindre l’obligation la meilleure estimation du passif
mais il reste nécessaire de considérer d’autres montants possibles.
Cas particuliers dans certaines circonstances
Autres montants plus élevés ou plus faibles que le montant le plus probable peuvent constituer la
meilleure estimation du passif.
Prise en compte des risques et des incertitudes dans l’évaluation de la provision
Les risques et incertitudes qui affectent inévitablement de nombreux événements et circonstances doivent être
pris en compte pour parvenir à la meilleure estimation d’une provision.
En conséquence, il convient de faire preuve d’une certaine prudence dans l’exercice du jugement des
incertitudes pour ne pas :
surestimer les produits ou les actifs ou,
sous-estimer les charges ou les passifs.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 5/13
Actualisation de la provision
Principe
Si l’effet de la valeur temps est Montant de la provision Valeur actuelle des dépenses
significatif attendues, estimées nécessaires
pour régler l'obligation.
Détermination des taux d’actualisation
− taux avant impôts,
− reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et des risques
spécifiques à ce passif.
En revanche, les taux d’actualisation ne doivent pas refléter les risques pour lesquels les estimations de flux
de trésorerie futurs ont été ajustées.
Prise en compte d’évènements futurs
Des événements futurs peuvent avoir un effet sur le montant nécessaire à l’extinction d’une obligation.
Ils doivent être traduits dans le montant de la provision lorsqu’il existe des indications objectives
suffisantes indiquant que ces événements se produiront.
Non prise en compte des pertes opérationnelles futures
Une provision ne doit pas être comptabilisée au titre de pertes opérationnelles futures.
Non prise en compte des profits résultant de la sortie attendue d’actifs pour
l’évaluation d’une provision
Les profits résultant de la sortie attendue d’actifs ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation d’une
provision même si la sortie attendue est étroitement liée à l’événement ayant donné lieu à la provision.
La cession d’actifs est à comptabiliser en fonction des autres normes IFRS applicables.
(Exemple : comptabilisation de la cession d’actifs corporels selon la norme IAS 16 Immobilisations corporelles)
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 6/13
EVOLUTION DES PROVISIONS
Comptabilisation de remboursements de dépenses liées à l’extinction d’une provision
Condition de comptabilisation d’un remboursement
Exemple de situations : remboursements issus de contrats d’assurance, de clauses d’indemnisations ou
de garanties du fournisseur
S’il est quasi-certain de recevoir le remboursement comptabilisation du remboursement
Comptabilisation du remboursement
− Au bilan
• Comptabilisation en tant qu’actif distinct car l’entreprise reste responsable du paiement de
l’obligation en cas de défaillance du tiers (compensation avec la provision interdite),
• Montant du remboursement < ou = au montant de la provision.
− Au compte de résultat
• Possibilité de présenter la charge de la provision nette du montant du remboursement
(compensation possible).
Changement affectant une provision
A chaque période comptable, les provisions doivent être revues et ajustées pour refléter la meilleure
estimation à cette date.
Conséquences pratiques
− Apprécier à nouveau les trois critères de comptabilisation des provisions :
• existence d’une obligation actuelle à cette date,
• probabilité de sortie de ressources,
• possibilité de réaliser une estimation fiable.
− Ajuster le montant des provisions en fonction de toute nouvelle indication apparue depuis la
dernière estimation.
− Actualiser les provisions ayant été comptabilisées pour une valeur actuelle pour refléter
l’écoulement du temps. L’augmentation est comptabilisée en charges financières.
Utilisation des provisions
Une provision ne doit être utilisée que pour les dépenses pour lesquelles elle a été comptabilisée à l’origine.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 7/13
CONTRATS DEFICITAIRES
Définition
Un contrat déficitaire est un contrat, établissant à la fois des droits et des obligations pour chacune des parties
contractantes, pour lequel les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs
aux avantages économiques à recevoir du contrat.
Coûts inévitables d’un contrat Coût net de sortie de contrat le plus faible de
Coût d’exécution du contrat Indemnisation ou pénalité
découlant du défaut d’exécution
Principe de comptabilisation
Si une entité a un contrat déficitaire champ d’application de la norme IAS 37
obligation actuelle génère une provision
Les contrats non entièrement exécutés qui ne répondent pas à la définition de contrat déficitaire n’entrent pas
dans le champ d’application de la norme IAS 37.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 8/13
PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION
Définition d’une restructuration
Une restructuration est un programme planifié et contrôlé par la direction, qui modifie de façon significative :
soit le champ d’activité d’une entreprise,
soit la manière dont cette activité est gérée.
Critères généraux de comptabilisation appliqués aux provisions pour restructuration
Principe général : application des trois critères généraux de comptabilisation des provisions
Rappel :
− L’entité a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé.
− Il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera
nécessaire pour régler l’obligation.
− Le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Obligation implicite
− Si l’entité a un plan formalisé et détaillé de restructuration précisant au minimum :
• l’activité ou la partie de l’activité concernée,
• les principaux sites affectés,
• la localisation, la fonction et le nombre approximatif des membres du personnel qui seront
indemnisés au titre de la fin de leur contrat de travail,
• les dépenses qui seront engagées,
• et, la date à laquelle le plan sera mis en œuvre.
− et si l’entité a créé, chez les personnes concernées, une attente fondée qu’elle mettra en œuvre
la restructuration
• soit en commençant à exécuter le plan (exemple : démantèlement d’une usine, vente
d’actifs),
• soit en leur annonçant les principales caractéristiques avec suffisamment de détails pour
créer une attente fondée de la mise en œuvre de la restructuration chez les tiers tels que
les clients, les fournisseurs, les membres du personnel ou leurs représentants.
Autres contextes particuliers générant une obligation implicite
Une décision de la direction ne suffit pas à elle seule à générer une obligation implicite.
Décision de la direction prise conjointement avec plusieurs évènements antérieurs peut générer une
obligation implicite.
Exemple : lorsque des négociations avec les représentants du personnel pour le paiement d’indemnités de
fin de contrat de travail, ou avec les acheteurs pour la vente d’une activité, sont conclues sous réserve
uniquement de l’approbation par le conseil d’administration, il y a une obligation implicite de restructurer dès
l’annonce aux parties de l’approbation.
Décision de la direction au sein d’un conseil comprenant des représentants d’intérêts autres que la
direction ou ayant nécessité la notification à de tels représentants.
Exemple : représentants du personnel au conseil d’administration
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 9/13
Du fait qu’une décision prise par ce conseil implique sa communication à ces représentants, il peut en
résulter une obligation implicite de restructurer.
En pratique, il convient de tenir compte de la possibilité qu’ont les représentants du personnel, de
communiquer aux salariés concernés à l’issue du conseil d’administration, les principales caractéristiques
du plan de restructuration
− Si les représentants du personnel date du fait générateur = date du conseil
peuvent informer les salariés d'administration
concernés
− Si les représentants du personnel ne date du fait générateur = date de communication
peuvent pas informer les salariés faite aux salariés concernés
concernés
Date de l’obligation dans le cas de la vente d’une activité
Dans le cadre de la vente d’une activité, il existe une obligation à partir de la date à laquelle une entité est
engagée à vendre par un accord de vente irrévocable.
Même si une entité a pris la décision de vendre une activité et l’a annoncé publiquement, elle n’a aucune
obligation, tant qu’aucun acheteur n’a été trouvé et tant qu’aucun accord de vente irrévocable n’a été conclu.
En effet, tant qu’aucun accord de vente irrévocable n’est conclu, l’entreprise peut changer d’avis et de fait doit
envisager un autre mode d’action si elle ne trouve aucun acheteur à des conditions acceptables.
Lorsque la vente d’une activité est envisagée dans le cadre d’une restructuration, les actifs correspondants
doivent faire l’objet de tests de dépréciation selon la norme IAS 36 Dépréciation d’actifs.
Principes d’évaluation d’une provision pour restructuration
Principe d’évaluation
Une provision pour restructuration inclut uniquement les dépenses liées à la restructuration, c’est-à-
dire les dépenses qui sont à la fois :
− nécessairement entraînées par la restructuration, et
− qui ne sont pas liées aux activités poursuivies par l’entreprise.
Exclusion de la provision
Une provision pour restructuration exclut les coûts liés à la conduite future de l’activité, c’est-à-dire
les dépenses :
− de reconversion ou de relocalisation du personnel conservé,
− de marketing,
− d’investissement dans de nouveaux systèmes et réseaux de distribution.
Autres exclusions
− Les pertes opérationnelles futures identifiables jusqu’à la date d’une restructuration sauf si
elles concernent un contrat déficitaire.
− Les profits sur la sortie attendue d’actifs même si la vente de ces actifs est envisagée dans le
cadre de la restructuration.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 10/13
PRESENTATION ET INFORMATIONS A FOURNIR SUR LES PROVISIONS,
PASSIFS EVENTUELS ET ACTIFS EVENTUELS
Informations à fournir par catégorie de provisions
Information narrative
− une brève description de la nature de l’obligation et de l’échéance attendue des sorties
d’avantages économiques en résultant,
− une indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties, et si
approprié, une information sur les principales hypothèses retenues concernant des évènements
futurs qui peuvent avoir un effet sur le montant nécessaire à l’extinction de l’obligation,
− le montant de tout remboursement attendu et de tout actif comptabilisé pour ce remboursement
attendu.
Informations chiffrées
− la valeur comptable des provisions à l’ouverture et à la clôture de l’exercice,
− les provisions supplémentaires constituées au cours de l’exercice, y compris l’augmentation des
provisions existantes,
− les montants utilisés au cours de l’exercice (encourus et imputés sur la provision),
− les montants non utilisés repris au cours de l’exercice et,
− l’augmentation au cours de l’exercice du montant actualisé résultant de l’écoulement du temps et
de l’effet de toute modification du taux d’actualisation.
L’information comparative n’est pas imposée.
Informations sur les passifs éventuels
Informations sur les passifs éventuels, sauf si la probabilité d’une sortie de ressources est très faible.
L’entité doit fournir à la date de clôture pour chaque catégorie de passif éventuel de nature similaire :
− une brève description de la nature du passif,
− et, dans la mesure du possible :
• une estimation de son effet financier,
• une indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de toute sortie, et
• la possibilité de tout remboursement.
Informations sur les actifs éventuels
Lorsqu’une entrée d’avantages économiques est probable, l’entité doit fournir :
une brève description de la nature des actifs éventuels à la date de clôture, et,
dans la mesure du possible, une estimation de leur effet financier.
Il convient d’éviter de donner des indications trompeuses sur la probabilité de survenance d’un produit.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 11/13
Mentions en l’absence d’information requise par la norme IAS 37
Cas où l’information sur les passifs ou actifs éventuels est impossible à donner
Lorsqu’il n’est pas possible de fournir une des informations requises par la norme IAS 37 sur les passifs ou
actifs éventuels, ce fait doit être mentionné.
Cas où l’information requise sur les passifs, passifs éventuels et actifs éventuels pourrait causer un
préjudice à l’entreprise dans un litige l’opposant à des tiers (cas extrêmement rares)
L’entité n’a pas à fournir ces informations, mais elle doit indiquer :
− la nature générale du litige,
− le fait que ces informations n’ont pas été fournies,
− la raison pour laquelle elles ne l’ont pas été.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 12/13
PRINCIPES DE COMPTABILISATION DES CHANGEMENTS AFFECTANT LES
PASSIFS EXISTANTS RELATIFS AUX COUTS DE DEMANTELEMENT ET DE
REMISE EN ETAT DE SITES ET ASSIMILES (IFRIC 1)
Rappel du principe général de comptabilisation
Coûts estimés initiaux :
inclus dans le coût initial des immobilisations selon la norme IAS 16 Immobilisations corporelles,
font l’objet d’une provision conformément à la norme IAS 37.
L’obligation existe dès l’acquisition d’une immobilisation ou durant la période d’utilisation de l’immobilisation.
Le montant du passif correspond au montant nécessaire à l’extinction de l’obligation à la date de clôture et
actualisée à un taux du marché.
Objectif de l’interprétation IFRIC 1
Précisions sur la contrepartie des variations de la valeur comptable des provisions inscrites au passif, qui
couvrent les coûts de démantèlement et de remise en état des sites et qui sont incorporées au coût des
immobilisations corporelles. Ces immobilisations corporelles sont prévues pour une utilisation autre que pour
la production de stock (industries extractives).
Exemple : un passif relatif au démantèlement et à la remise en état des sites et assimilés peut exister pour le
démantèlement d’une usine, la réhabilitation de dommages environnementaux dans les industries extractives
ou l’enlèvement de matériel.
Principes de comptabilisation des variations de l’évaluation d’un passif relatif au
démantèlement ou à la remise en état de sites
3 types de changements ayant une incidence sur l’évaluation d’un tel passif :
Changement d’estimation des Variation du taux d’actualisation Accroissement de la provision
sorties de ressources (avant impôt reflétant les dû à la désactualisation (c’est à
représentatives d’avantages appréciations actuelles du marché : dire l’effet du passage du temps)
économiques − valeur temps,
(Montant et échéancier) − risques spécifiques au passifs)
Comptabilisation en contrepartie de l’actif immobilisé ou du poste Ecarts Comptabilisation en charges
de réévaluation, selon la méthode de comptabilisation de l’immobilisation (IAS financières
16 Immobilisations corporelles) (Pas d’assimilation possible aux
− méthode du coût coûts d’emprunts incorporables
− méthode de la réévaluation aux coûts des actifs selon la
norme IAS 23 Coûts d’emprunt)
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 13/13
Vous aimerez peut-être aussi
- Gestion Financière:: Choix D'investissementDocument9 pagesGestion Financière:: Choix D'investissementbtissam100% (1)
- TD+ Corrigé IAS 40Document5 pagesTD+ Corrigé IAS 40Kardous Marwa100% (2)
- Exercices IAS 16 36 Et 38Document4 pagesExercices IAS 16 36 Et 38Samar Ben abdallahPas encore d'évaluation
- Ias 23Document9 pagesIas 23yembaba med mahmoudPas encore d'évaluation
- IFRS 16 Contrat de LocationDocument12 pagesIFRS 16 Contrat de LocationBéchyr BoukhrisPas encore d'évaluation
- Évaluation Des EntreprisesDocument64 pagesÉvaluation Des EntreprisesMohammed Blk100% (2)
- Cours IFRS 13Document6 pagesCours IFRS 13Béchyr BoukhrisPas encore d'évaluation
- Ias 36 PDFDocument18 pagesIas 36 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 19 PDFDocument24 pagesIas 19 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 37 PDFDocument13 pagesIas 37 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Politiques Financières de Long Terme: FinanceDocument221 pagesPolitiques Financières de Long Terme: Financeilias spiderPas encore d'évaluation
- L'economie de L'energie NucléaireDocument450 pagesL'economie de L'energie NucléaireAmine BENDAOUDPas encore d'évaluation
- Cash Flow Et Taux D'axtualisationDocument24 pagesCash Flow Et Taux D'axtualisationAbdellah El KhomriPas encore d'évaluation
- Creation de Valeur Et Capital-InvestissementDocument225 pagesCreation de Valeur Et Capital-InvestissementHicham Elbarkaoui100% (2)
- Comptabilite Anglo PDFDocument27 pagesComptabilite Anglo PDFAssy ArielPas encore d'évaluation
- Cous IAS 37 Provions Passifs Éventuels Actifs ÉventuelsDocument27 pagesCous IAS 37 Provions Passifs Éventuels Actifs ÉventuelsWafi ChikhaouiPas encore d'évaluation
- Ias 12 PDFDocument8 pagesIas 12 PDFnawalPas encore d'évaluation
- IAS 37 ProvisionsDocument16 pagesIAS 37 ProvisionsYahyaAhmedJeddouPas encore d'évaluation
- Résumé de IAS 37Document3 pagesRésumé de IAS 37layane100% (2)
- Les Zoom S Exercices de Normes Comptables Internationales IAS IfRS PDFDocument66 pagesLes Zoom S Exercices de Normes Comptables Internationales IAS IfRS PDFAmel Amoula67% (3)
- Cours IAS 36 Dépréciation D'actifsDocument28 pagesCours IAS 36 Dépréciation D'actifsMakram ZouariPas encore d'évaluation
- Tableau Comparatif IAS IFRSDocument5 pagesTableau Comparatif IAS IFRSMahfoudi MohamedPas encore d'évaluation
- 4.3 Cas Ias1, Ias 16, Ias 36 & Ias 37 SujetsDocument5 pages4.3 Cas Ias1, Ias 16, Ias 36 & Ias 37 SujetsCwassibley Sostherne Joken100% (1)
- Cours Ias 40 Immeubles de PlacementDocument12 pagesCours Ias 40 Immeubles de PlacementMakram ZouariPas encore d'évaluation
- Stock IfrsDocument23 pagesStock IfrsŽahra Ňah IdPas encore d'évaluation
- Exercices Sur Les Instruments Financiers (Correction) PDFDocument23 pagesExercices Sur Les Instruments Financiers (Correction) PDFJosué Sia100% (1)
- Evaluation de L'entreprise Par L'approche Patrimoniale: Actif Net CorrigéDocument16 pagesEvaluation de L'entreprise Par L'approche Patrimoniale: Actif Net CorrigéAngePas encore d'évaluation
- IAS 10 Evénements Postérieurs À La Date de ClôtureDocument8 pagesIAS 10 Evénements Postérieurs À La Date de ClôtureBéchyr BoukhrisPas encore d'évaluation
- Bilan Ifrs ExerciceDocument4 pagesBilan Ifrs ExerciceMAAROUFI MAROUANEPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Le GOODWILLDocument18 pagesChapitre 3 Le GOODWILLYasmin Bizid100% (1)
- Cours Ifrs IasDocument110 pagesCours Ifrs IasAmine BotzaPas encore d'évaluation
- Ias 16Document14 pagesIas 16kenza attaoui100% (1)
- Ias 1Document18 pagesIas 1STE HS SERVICESPas encore d'évaluation
- MODULE IV - Etude de Quelques NormesDocument159 pagesMODULE IV - Etude de Quelques NormesMamadou DiaPas encore d'évaluation
- Fiche TD N°2 - IAS 16 IAS 36Document2 pagesFiche TD N°2 - IAS 16 IAS 36Khalil Latreche100% (1)
- Cadre Conceptuel IFRSDocument29 pagesCadre Conceptuel IFRSAmine El AbbassiPas encore d'évaluation
- Immeuble de PlacementDocument10 pagesImmeuble de PlacementOlga MputubwelePas encore d'évaluation
- Exercice Comptabilite Approfondie Des Societes WWW Cours Fsjes ComDocument92 pagesExercice Comptabilite Approfondie Des Societes WWW Cours Fsjes ComKhalilErifiPas encore d'évaluation
- Exercices Évaluation D'entreprisesDocument2 pagesExercices Évaluation D'entreprisesKamal Siidox100% (1)
- IFRS 5 ÉtudiantsDocument5 pagesIFRS 5 ÉtudiantsmanelPas encore d'évaluation
- Ias 18Document10 pagesIas 18Béchyr BoukhrisPas encore d'évaluation
- Corrigé Indicatif Exercice 1Document3 pagesCorrigé Indicatif Exercice 1el khaiat mohamed amine100% (1)
- Séries Exercices Mme Angade Normes InternationalesDocument12 pagesSéries Exercices Mme Angade Normes InternationalesJeuneEtudiantPas encore d'évaluation
- Corrigé IAS 7Document3 pagesCorrigé IAS 7Oumayma OumaPas encore d'évaluation
- IAS16 PartDocument40 pagesIAS16 PartFella FezaniPas encore d'évaluation
- Série Norme IAS 1Document13 pagesSérie Norme IAS 1Hajar ChaaibiPas encore d'évaluation
- Ias 38 Immobilisations IncorporellesDocument12 pagesIas 38 Immobilisations IncorporellesDuc Zer100% (1)
- Ecart de Réévaluation.Document7 pagesEcart de Réévaluation.Sohaib HADDADPas encore d'évaluation
- Chapitre III - Options RéellesDocument24 pagesChapitre III - Options RéellesrimPas encore d'évaluation
- TD IFRS II (Corrigé) : Iscae - Ridha Zarrouk Avril 2019 1 Sur 8Document8 pagesTD IFRS II (Corrigé) : Iscae - Ridha Zarrouk Avril 2019 1 Sur 8NourAllah Aouini100% (1)
- Série Exo IAS16Document13 pagesSérie Exo IAS16Hajar ChaaibiPas encore d'évaluation
- Normes Comptables Internationales Ias / Ifrs: Ecole Nationale de Commerce Et de Gestion TangerDocument21 pagesNormes Comptables Internationales Ias / Ifrs: Ecole Nationale de Commerce Et de Gestion TangerAlae BoujjouPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Entreprises Exerice CorrigeDocument43 pagesEvaluation Des Entreprises Exerice CorrigeGhislaine TohouegnonPas encore d'évaluation
- Frais de Prospection Des Ressources MineralesDocument11 pagesFrais de Prospection Des Ressources Mineralesbasile DiandaPas encore d'évaluation
- NCT 7 PlacementsDocument26 pagesNCT 7 PlacementsAzza hammamiPas encore d'évaluation
- MODULE III - La Normalisation Comptable InternationaleDocument75 pagesMODULE III - La Normalisation Comptable InternationaleMamadou Dia100% (2)
- Emprunts ObligatairesDocument17 pagesEmprunts ObligatairesEL OUAFIPas encore d'évaluation
- Cours IAS 16 Immobilisations CorporellesDocument71 pagesCours IAS 16 Immobilisations CorporellesYasmineBlmr100% (1)
- IAS 21 Conversion - DevisesDocument22 pagesIAS 21 Conversion - DevisesHamid TalaiPas encore d'évaluation
- Immobilisations Corporelles IAS 16 (Mode de Compatibilité)Document148 pagesImmobilisations Corporelles IAS 16 (Mode de Compatibilité)mezouki100% (1)
- IFRS 5 Actifs Non Courants Détenus en Vue de La Vente Et AcDocument23 pagesIFRS 5 Actifs Non Courants Détenus en Vue de La Vente Et AcBéchyr Boukhris100% (1)
- Pourcentage de Contrôle Et Pourcentage D'intérêtDocument27 pagesPourcentage de Contrôle Et Pourcentage D'intérêtSalma HabibiPas encore d'évaluation
- Instruments Financiers IFRS 9 - IFRS 7 Et IAS 32Document12 pagesInstruments Financiers IFRS 9 - IFRS 7 Et IAS 32atef benyoussefPas encore d'évaluation
- Corriges TDS S6 Itro Refer Comp IntDocument73 pagesCorriges TDS S6 Itro Refer Comp IntKhalid EdianiPas encore d'évaluation
- IAS 16 Immobilisations CorporellesDocument72 pagesIAS 16 Immobilisations CorporellesChaimae BelkhouPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 - IAS 16 Les Immobilisations CorporellesDocument66 pagesChapitre 5 - IAS 16 Les Immobilisations Corporellesselmi ghada100% (1)
- 3 Périmètre de ConsolidationDocument25 pages3 Périmètre de ConsolidationSafae BelmazouziPas encore d'évaluation
- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- IAS 37 ProvisionsDocument4 pagesIAS 37 Provisionsyasmine AidaraPas encore d'évaluation
- Ias 39 PDFDocument28 pagesIas 39 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ifrs 2 PDFDocument19 pagesIfrs 2 PDFnawal100% (1)
- Ifrs 5 PDFDocument9 pagesIfrs 5 PDFnawalPas encore d'évaluation
- IAS 38 IMMOBILISATIONS INCORPORELLESpdf PDFDocument20 pagesIAS 38 IMMOBILISATIONS INCORPORELLESpdf PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 27 PDFDocument16 pagesIas 27 PDFnawalPas encore d'évaluation
- IAS 21 Effets Des Variations Des Cours Des DevisesDocument12 pagesIAS 21 Effets Des Variations Des Cours Des DevisesSimo Simo100% (1)
- Ias 18 PDFDocument4 pagesIas 18 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 24 - Informations - Relatives - Aux - Parties - Liees PDFDocument4 pagesIas 24 - Informations - Relatives - Aux - Parties - Liees PDFnawalPas encore d'évaluation
- MAITRISER L'ESSENTIEL DES IAS IFRS - SALUSTRO Berkani PDFDocument108 pagesMAITRISER L'ESSENTIEL DES IAS IFRS - SALUSTRO Berkani PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 20 PDFDocument4 pagesIas 20 PDFnawalPas encore d'évaluation
- L'évaluation Des Entreprises 2 PDFDocument3 pagesL'évaluation Des Entreprises 2 PDFYasser ErPas encore d'évaluation
- Procédure D'évaluation Des Projets D'investissement Chez Un Opérateur de TélécommunicationsDocument64 pagesProcédure D'évaluation Des Projets D'investissement Chez Un Opérateur de TélécommunicationsnestagalluslechatPas encore d'évaluation
- Choix InvestissementDocument109 pagesChoix InvestissementMohamed Tahri100% (1)
- MAS143Document132 pagesMAS143Mügėėz Abdoul KarimPas encore d'évaluation
- Cours EconomieDocument31 pagesCours EconomieTheophile IZEREPas encore d'évaluation
- Cif 1Document66 pagesCif 1abdelkhalek ouassiriPas encore d'évaluation
- Interet SimpleDocument4 pagesInteret SimpleazweegooPas encore d'évaluation
- Guide - Méthodologie Pour L'analyse D'impact Budgétaire À La HASDocument102 pagesGuide - Méthodologie Pour L'analyse D'impact Budgétaire À La HASSelinger AlicePas encore d'évaluation
- HEC CANADA - Chapitre2Document5 pagesHEC CANADA - Chapitre2Georges Michael YapiPas encore d'évaluation
- Finance D'ese-Et-Séries CorrigéesDocument95 pagesFinance D'ese-Et-Séries CorrigéesMouna GraaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Choix DinvestissementDocument8 pagesChapitre 2 - Choix DinvestissementYosr TurkyPas encore d'évaluation
- Evaluation Des ActionsDocument15 pagesEvaluation Des ActionsAldric DorianPas encore d'évaluation
- Résumé Gestion Financiere1Document10 pagesRésumé Gestion Financiere1Balloul MeriamPas encore d'évaluation
- 7608 CorrigesDocument33 pages7608 Corrigesdiamsa11Pas encore d'évaluation
- 6-Les Actions CourDocument14 pages6-Les Actions CourAISSAOUI SabrinaPas encore d'évaluation
- Évaluation Des Projets InternationauxDocument14 pagesÉvaluation Des Projets InternationauxMarco PoloPas encore d'évaluation
- Comptabilité Approfondie Et Difficultã© ComptableDocument57 pagesComptabilité Approfondie Et Difficultã© Comptablesaid ben bordiPas encore d'évaluation
- 2023-Étudiants-LP-ACC-Gestion Financière-Série1Document88 pages2023-Étudiants-LP-ACC-Gestion Financière-Série1Iss-haq abdoulaye KonePas encore d'évaluation
- Introduction À La GBDocument97 pagesIntroduction À La GBWalid FaridPas encore d'évaluation
- Financement Des Grands Projets Internationaux - OrianneDocument31 pagesFinancement Des Grands Projets Internationaux - OrianneHamadouchePas encore d'évaluation
- 6 Extraits - Fiches de LectureDocument194 pages6 Extraits - Fiches de LectureBenkiranePas encore d'évaluation
- Ias 19Document46 pagesIas 19lchinoisPas encore d'évaluation
- Management de Projet EPI2015Document221 pagesManagement de Projet EPI2015Mrizig AichaPas encore d'évaluation