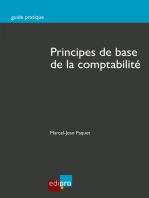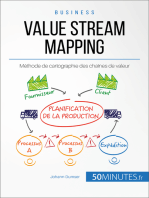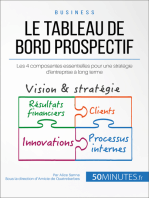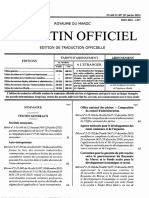Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
RC Lexique MOOC Compta de Gestion Et Tableur
RC Lexique MOOC Compta de Gestion Et Tableur
Transféré par
Dorcas OuattaraCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
RC Lexique MOOC Compta de Gestion Et Tableur
RC Lexique MOOC Compta de Gestion Et Tableur
Transféré par
Dorcas OuattaraDroits d'auteur :
Formats disponibles
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
Lexique MOOC Comptabilité de Gestion
et pratique du tableur
A
Activité : ensemble d’actions ou de tâches qui ont pour objectif de permettre, à plus
ou moins court terme, un ajout de valeur à l’objet. Les activités consomment des
ressources et elles peuvent être regroupées en processus.
Amortissement : étalement du coût d’une immobilisation sur sa durée d’utilisation.
Analyse budgétaire: comparaison des écarts entre les prévisions et les réalisations
budgétaires afin de trouver leurs causes et y remédier.
Analyse des activités : cartographie complète des processus de l’entreprise.
Annexes : document de la liasse comptable qui accompagne et donne des
précisions sur le bilan et le compte de résultat. Une annexe fait à ce titre partie
intégrante des états financiers d’une organisation.
Apprentissage organisationnel : fait, pour une organisation, d’apprendre de ses
erreurs, d’améliorer son fonctionnement. Cela passe généralement par la mise en
place d’un système de management des connaissances (KM : Knowledge
Management) et l’analyse budgétaire.
B
Besoin en fonds de roulement (BFR) : ressources financières dont l’entreprise a besoin
pour financer son cycle d’exploitation. On le calcule ainsi : Créances clients + Stocks
– Dettes fournisseurs.
Bilan : document de la liasse comptable qui présente le patrimoine de l’entreprise
(actif et passif).
Bon de réintégration : document interne permettant d’identifier les articles non
utilisés dans le cycle de production.
Budget des investissements : document regroupant les dépenses et les recettes
futures qui affecteront le patrimoine de l’entreprise. En général, ces opérations ont
des répercutions à moyen ou long terme : elles dépassent le cadre de l’exercice
comptable.
Budget de production : Budget listant tous les éléments nécessaires à la production. Il
sera mis en place à partir du budget des ventes, en tenant compte des choix
effectués au niveau de la production.
Budget de trésorerie : Document qui enregistre les flux de trésorerie (recettes,
dépenses) existants et à venir, liées au cycle d'investissement et au cycle de
financement.
Budget des ventes : Document qui permet de mettre en évidence les prévisions des
ventes. Il sera élaboré à partir d’études de la conjoncture, des variations du marché,
C. Averseng/ M. Dereumaux - Informatique : Excel, Graphiques
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
des structures coûts/rentabilité des principaux concurrents, etc. Les autres budgets
découleront généralement de ce budget.
Budget flexible : Budget dans lequel seules les charges variables vont évoluer en
fonction du niveau d’activité, les charges fixes restant constantes.
Budget standard : Budget dans lequel les charges variables et les charges fixes vont
évoluer en fonction du niveau d’activité.
C
Centre d’analyse : « subdivision comptable » de l’entreprise où sont analysés et
regroupés les éléments de charge indirecte préalablement à leur imputation aux
coûts (des objets de coût). Il s’agit en quelque sorte d’un collecteur de coûts qui
facilitera les calculs : il y aura autant de centres d’analyse que la complexité de
l’entreprise le nécessite. En général, ce découpage se fait par fonction
(administration, R&D, RH, approvisionnements, ateliers, vente,…)
Centres auxiliaires : centre d’analyse correspondant à des services de support, de
soutien : ils fournissent des prestations aux centres principaux et aux autres centres
auxiliaires, afin que ceux-ci soient pleinement opérationnels. Par exemple, le service
comptable, ou un restaurant d’entreprise. Les sommes regroupées dans les centres
auxiliaires seront déversées dans d’autres centres.
Centres principaux : centre d’analyse qui ajoute à l’objet de coût une valeur
perceptible pour le client. Par exemple, un atelier de production va transformer des
matières premières en produits finis. Les sommes regroupées dans ces centres
principaux seront déversées dans les objets de coût.
Chaîne de valeur : représentation de l’entreprise proposée par M. Porter. Elle
décompose l’entreprise en différentes activités qui contribuent à la valeur finale,
perçue par le client, du produit ou service.
Charge : sommes ou valeurs versées ou à verser en contrepartie de marchandises,
approvisionnements, travaux et services consommés par l’entité. Ces sommes
traduisent les consommations de ressources humaines (salaires), financières (intérêts,
agios, dividendes), économiques (matières premières, services, provisions),
techniques (amortissements, achats de matériels de production), technologiques
(gestion des bases de données, système d’information).
Charge calculée : charge qui n’entraîne pas de décaissement pour l’entreprise,
comme les amortissements et provisions.
Charge directe : charge que l’on peut affecter immédiatement au coût auquel elle
se rapporte, sans calcul intermédiaire.
Charge fixe : charge qui ne change pas lorsque l’activité, le CA par exemple,
évolue (exemple : le loyer d’un magasin).
Charge indirecte : charge qui nécessite un calcul intermédiaire pour être affectée
aux coûts auxquels elle se rapporte. On parlera ici d’imputation.
Charges non incorporables : charges qui ne relèvent pas de l’exploitation courante
et qui n’ont rien à voir avec une activité normale de l’entreprise. Par exemple, des
amendes, pénalités, charges de couverture d’un sinistre, charges de restructuration,
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 2/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
charges de personnel absent ou détaché... On les trouvera généralement dans les
charges exceptionnelles du compte de résultat.
Charge supplétive : élément qui ne figure pas dans la comptabilité pour des raisons
juridiques et fiscales. En effet, selon le statut juridique de l’entreprise, certains
éléments sont comptabilisés en charge ou non : dans une société en nom collectif,
le salaire des dirigeants ne peut pas être passé en charge (il se rémunère sur le
bénéfice), alors que c’est le cas dans une Société à Responsabilité Limitée. Le but
est ici d’éliminer l’incidence de la structure juridique ou financière quand on
compare deux établissements.
Charge variable : charge qui varie en fonction du niveau d’activité.
Chiffre d’affaires : ensemble des ventes de l’entreprise. CA = prix unitaire*quantité
vendues. Il traduit l’activité économique de l’organisation, mais il ne faut pas le
confondre avec le résultat.
Clé de répartition : critère de répartition permettant de déverser les charges
indirectes dans les centres principaux et auxiliaires.
Comptabilité financière ou Comptabilité générale : discipline qui recense, sous forme
monétaire, toutes les transactions économiques, sociales et financières de
l’entreprise avec ses partenaires. Elle permettra de créer de précieux documents tels
que le bilan, le compte de résultat et les annexes.
Comptabilité de gestion ou Comptabilité analytique : discipline qui s’intéresse aux
calculs de coût dans l’organisation. Elle est strictement interne à l’entreprise et n’est
pas normée.
Compte de résultat : document comptable qui reprend les produits et les charges de
l’exercice comptable. Leur différence permettra de définir le résultat de
l’organisation (bénéfice ou perte).
Contrôle budgétaire (ou analyse budgétaire) : comparaison des écarts entre les
prévisions et les réalisations budgétaires afin de trouver leurs causes et y remédier.
Contrôle de gestion : discipline qui s’intéresse aux flux internes de l’entreprise, avec
notamment l’analyse du résultat de l’entreprise. Il inclut notamment la comptabilité
de gestion, l’analyse de la performance, le contrôle budgétaire et les tableaux de
bord.
Coût : regroupement pertinent de charges comptables se rapportant à un bien ou
un service vendu au client, une activité, un département, un canal de distribution…
Coûts complets : coûts qui cherchent à prendre en compte toutes les charges.
Coûts constatés ou réels : coûts calculés a posteriori.
Coûts de lancement de commande (stocks) : coûts administratifs de passation de
commande (frais de courrier, frais de réception des commandes, frais de gestion
des documents internes).
Coût de distribution : publicité, packaging, image de marque, rémunération du
distributeur.
Coût de l’unité d’œuvre : montant des charges du centre d’analyse / nombre d’UO
(niveau de l’activité du centre).
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 3/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
Coûts partiels : coûts qui ne concernent qu’une partie des charges.
Coûts de pénurie (stocks) : coûts liés à une insuffisance de stocks (ruptures de
stocks).
Coûts de possession (ou de stockage) : coût de localisation spatiale des stocks
(location ou amortissement des entrepôts, personnel qui assure la manutention,
matériel, assurance des produits stockés contre les risques, impôts, dépréciation du
stock).
Coût de production des produits terminés = charges de production de la période
+ En cours Initiaux - En cours Finaux
Coût de revient (des produits vendus) : somme du coût de production et du coût de
distribution.
Coûts de stockage (ou coûts de possession) : coût de localisation spatiale des stocks
(location ou amortissement des entrepôts, personnel qui assure la manutention,
matériel, assurance des produits stockés contre les risques, impôts, dépréciation du
stock).
Coût direct : charges directement imputables à un objet de coût.
Coût Fixe : regroupement de charges, indépendant du niveau d’activité… (coûts
administratifs)
Coûts prévisionnels : coûts obtenus en divisant les charges globales budgétées par
la quantité de production prévue. Ils se calculent a priori.
Coût spécifique : ensemble des charges se rapportant à un produit, une activité, un
centre de responsabilité.
Coût variable : ensemble de charges variables se rapportant à une activité donnée,
il est proportionnel à l’activité.
CUMP : voir “Méthode du coût unitaire moyen pondéré”.
Cycle d’exploitation : Pour une entreprise industrielle, il s’agira de l’achat des
matières premières Production (transformation des matières) Vente et
paiement des produits finis. Pour une entreprise commerciale, ce sera achats des
marchandises Vente et paiement des marchandises.
Cycle d’investissement : Investissement amortissement de l’investissement
(l’investissement génère des revenus) cession ou mise au rebut de l’investissement.
D
Déchets : résidus de matière provenant de la fabrication.
DEPS (LIFO) : voir “Méthode de l’épuisement des lots sur les stocks”
E
Écart global : différence entre le budget standard ajusté à la production réelle et le
réel.
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 4/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
Ecart sur activité : mesure l’impact des variations dans le taux d’utilisation des
capacités installées. Il se calcule en faisant la différence entre le budget standard
ajusté au temps réel et le budget flexible ajusté au temps réel.
Écart sur budget : écart de prix sur l’ensemble des ressources consommées par le
centre d’analyse. Il se calcule en faisant la différence entre le budget flexible ajusté
au temps réel et le réel.
Écart sur charges directes : écart calculé entre le prévisionnel et le réel, au niveau
des matières premières ou la main d’œuvre.
Écart sur charges indirectes : écart calculé entre le prévisionnel et le réel au niveau
des centres d’analyse.
Écart sur main d’œuvre : différence entre le coût prévisionnel et le coût réel de la
main d’œuvre. On pourra l’analyser en identifiant un écart sur temps et un écart sur
taux horaire.
Écart sur matière première : différence entre le coût prévisionnel et le coût réel de la
matière première. On pourra l’analyser en identifiant un écart sur quantité et un
écart sur prix.
Écart sur rendement : mesure la performance dans la mise en œuvre des ressources
du centre. Il se calcule en faisant la différence entre le budget standard ajusté à la
production réelle et le budget standard ajusté au temps réel.
Écart sur volume : mesure l’impact sur le budget de la différence entre les quantités
prévues et les quantités réellement produites. Il se calcule en faisant la différence
entre le budget standard de base et le budget ajusté à la production réelle.
Écart total : égal à la somme de l’écart global et de l’écart sur volume (ou à la
différence entre le budget standard de base et le réel). Il n’a pas réellement de
signification, en raison des nombreux éléments qui le compose.
Économies d’échelle : il y a économie d'échelle si, quand la production augmente,
le coût de production unitaire du bien diminue.
Effet d’expérience : il y a effet d’expérience si, à chaque doublement de la quantité
produite, correspond une diminution constante du cout unitaire de fabrication, sans
que cette diminution ne provienne d’une économie d’échelle.
Efficacité : fait d’atteindre les objectifs fixés.
Efficience : fait d’utiliser au mieux les ressources, en évitant par exemple les
gaspillages (exemple : faire plus avec moins de salariés).
Élément causal du coût : facteur à l’origine du coût.
Équivalents terminés : quand le processus de fabrication entraîne l’existence d’en-
cours, l’équivalent terminé est un mode de calcul qui nous permettra de déterminer
la production réelle qui a été fabriquée et ainsi de calculer les coûts de production.
Évaluation détaillée (des en-cours de production) : inventaire de ce qu’ont coûté les
produits en-cours à partir des quantités de matière utilisées, du temps passé, du
nombre d’unités d’œuvre consommées, etc.
Évaluation forfaitaire : évaluation approximative du degré moyen d’achèvement
des en-cours, pour ensuite les comptabiliser en « équivalents terminés ».
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 5/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
Exercice comptable : année comptable. Ne commence pas forcement le 1er janvier
(dépend de la date de création de l’entreprise) et peut excéder 12 mois la 1ère
année.
F
Flux : mouvement de valeur : appauvrissement ou enrichissement du patrimoine de
l’entreprise. Les flux peuvent être réels (matières, marchandises), immatériels
(prestations de services) ou monétaires (flux financiers).
FIFO (PEPS) : voir “Méthode de l’épuisement des lots sur les stocks”.
G
Gestion prévisionnelle : planification des tâches futures de l’organisation qui
permettra de mettre en évidence les choix retenus pour atteindre les objectifs fixés.
I
Indice de prélèvement (IP) : représente le % du CA qui permet de couvrir les charges
fixes.
Indice de sécurité (IS) : expression de la marge de sécurité par rapport au CA. Il
représente le pourcentage de CA qui peut être supprimé sans que l’entreprise ne
perde de l’argent.
Inducteur d’activité : élément de rattachement d’une activité à un objet de coût
dans la méthode ABC.
Inducteur de coût : facteur explicatif de la charge qui permettra de rattacher cette
charge à un objet de coût.
Inducteur de ressource : élément de rattachement d’une ressource à une activité
dans la méthode ABC.
Inventaire (physique) : recensement physique de l’état d’un stock.
Inventaire intermittent : état des stocks physique une fois par an (on comptabilise
alors les variations de stocks dans les documents comptables).
Inventaire permanent : état des stocks, indispensable en comptabilité analytique,
afin de connaître à tout instant les existants en magasin. Il pourra être effectué en
valeur ou en quantité.
Inventaire permanent en valeur : stock à valoriser en fonction des entrées et sorties.
Inventaire permanent en quantité : permet de connaître l’existant quantifié en stock.
Différents documents sont utilisés pour suivre l’état des stocks en quantité (bons de
réception pour les entrées, bons de sortie, bons de retour, etc.).
Investissement : affectation de ressources financières dans le but de développer le
potentiel (au sens large) de l'entreprise pour l'avenir.
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 6/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
L
Levier opérationnel : il permet de mesurer la sensibilité du résultat de l’entreprise par
rapport à une variation de l’activité. Il est l’inverse de l’indice de sécurité.
Liasse comptable : regroupement de tous les documents comptables d’une
entreprise (bilan, compte de résultats, annexes et tout autre état financier) dans un
support unique. Le dépôt de ce document au tribunal de commerce est une
obligation légale.
LIFO (DEPS) : voir “Méthode de l’épuisement des lots sur les stocks”
M
Main d’œuvre directe (MOD) : ensemble des heures de travail directement affectée
à la fabrication des objets de coûts.
Marge : Différence entre un chiffre d’affaires et un coût.
Marge de sécurité (MS) : représente la baisse de CA qui pourrait être supportée par
l’entreprise sans qu’elle ne perde de l’argent.
Marge sur coût variable : différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables
de l’entreprise. Elle est proportionnelle à l’activité.
Matière première : Matériau d'origine naturelle faisant l'objet d'une transformation et
d'une utilisation économique, pour fabriquer un produit.
Méthode ABC (« Activity-Based Costing ») : méthode de calcul de coût complet
basé sur l’identification des processus, activités, et ressources de l’entreprise.
Méthode ABM (Activity Based Management) : Méthode de management des
activités et des processus qui prolonge la mise en œuvre de la méthode ABC
(budget ABC, tableaux de bord des activités, …).
Méthode de l’épuisement des lots sur les stocks : méthode de valorisation des stocks.
On distinguera la méthode PEPS (FIFO) : Premier Entré Premier Sorti (First In First Out)
de la méthode DEPS (LIFO) : Dernier Entré Premier Sorti (Last In First Out).
Méthode des coûts complets : méthode qui cherche à prendre en compte toutes les
charges.
Méthode des coûts complets des centres d’analyse ou sections homogènes :
méthode qui cherche à prendre en compte toutes les charges et qui, pour analyser
le fonctionnement de l’entreprise, utilise un découpage fonctionnel de cette
dernière (fonction achat, fonction production, fonction comptabilité, etc.).
Méthode des coûts partiels : méthode qui ne prend en compte que certaines
charges en fonction de l’objectif visé.
Méthode des coûts préétablis : méthode utilisée en analyse budgétaire consistant à
transposer les coûts réels de N-1 en coûts préétablis de N.
Méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP) : méthode de valorisation des
stocks fondée sur le principe d’un calcul de valorisation moyenne. Il peut se calculer
de plusieurs façons :
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 7/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
CUMP en fin de période avec stock initial (CUMP = Valeur (SI + entrées) /
Quantités (SI + entrées))
CUMP fin de période sans stock initial (CUMP = Valeur Globale des entrées /
Quantités entrées)
Méthode du coût variable, ou direct costing : méthode de calcul de coût qui
s’intéresse à la marge sur coût variable. Elle permet de calculer le seuil de rentabilité.
O
Objet de coût : élément pour lequel l’entreprise souhaite calculer un coût distinct
(bien, service, département…).
Objet de marge : objet de coût générant des coûts mais aussi des revenus (bien,
service).
Outil de pilotage : outil qui permettra d’aider à la prise de décision à court terme.
P
PEPS (FIFO) : voir “Méthode de l’épuisement des lots sur les stocks”.
Performance financière : La performance financière d’une entreprise se mesure par
des indicateurs issus de la comptabilité financière : résultat, profitabilité, taux de
rendement des actifs, etc. Elle traduit en termes monétaires la réussite économique,
technologiques, sociale d’une organisation.
Plan comptable général : en France, le plan comptable général (ou PCG) est un
ensemble d'articles définissant la pratique de la comptabilité générale (financière). Il
s'adresse à toute entreprise tenue par la loi d'établir des comptes annuels.
Planification opérationnelle : consiste à élaborer des plans détaillés à court terme. Ils
sont issus des budgets.
Planification stratégique : ensemble des choix d'objectifs et de moyens qui orientent
à moyen et long terme les activités d'une organisation, d'un groupe.
Pré-budget : étape préalable à l’établissement définitif des budgets pour chaque
centre de responsabilité.
Prestations (ou transferts) en escalier : prestations sans réciprocité d’un centre à un
autre.
Prestations réciproques (ou transferts croisés) : prestations que se rendent
mutuellement des centres d'analyse.
Prezitation : présentation faite à l’aide de l’application en ligne Prezi :
https://prezi.com.
Processus : enchaînement d’activités qui génèrent une valeur ajoutée pour le client.
Produits (comptable) : correspondent aux sommes ou valeurs reçues ou à recevoir
en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que des
avantages qu'elle a consentis.
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 8/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
Produit fini : produit qui est à son état final de fabrication, prêt à être vendu.
Produits en-cours : produits qui ne sont pas encore achevés. Ils sont constitués par
des matières premières dont la transformation est inachevée ou les modules non
encore assemblés.
Produit intermédiaire : Produit parvenu à son stade d’achèvement et qui va ensuite
être introduit dans la suite du processus de production pour la fabrication du bien
final. Comme exemple, un pot d’échappement est un bien intermédiaire de la
fabrication d’une voiture. Il est donc indispensable de connaître le coût de
production de ce produit intermédiaire. Ils peuvent être vendus à des tiers.
Rebuts : produits finis impropres à la vente ou à l’usage prévu, parce qu’ils
présentent des imperfections par exemple.
Répartition primaire : première affectation des charges indirectes de la comptabilité
analytique aux centres auxiliaires et principaux.
Répartition secondaire : déversement des charges des centres auxiliaires dans les
centres principaux.
Rentabilité : rapport entre un revenu et les moyens mis en œuvre pour obtenir ce
revenu. La rentabilité financière désigne généralement le revenu procuré par des
moyens techniques, immobiliers, financiers mobilisés par l’organisation.
Ressource : subdivision élémentaire pour calculer les coûts avec la méthode ABC,
correspondant à la notion classique de “charge”. Il s’agit de l’élément utilisé par
l’entreprise pour effectuer le travail, les ressources sont consommées par l’activité.
Résultat analytique par produit : chiffre d’affaires – coût de revient.
Résultat comptable : différence entre les produits et les charges de l’entreprise.
S
Sensibilité : variation d’un paramètre, par exemple le Résultat, lorsqu’un autre
paramètre change, par exemple lorsque le CA augmente de 10%.
Seuil de rentabilité en chiffre d’affaires : chiffre d’affaires qui devra être atteint pour
que le résultat soit égal à 0.
Seuil de rentabilité en date : si l’activité est assez régulière, on peut déterminer la
date à partir de laquelle le seuil de rentabilité est atteint, par proportionnalité.
Seuil de rentabilité en quantité : quantités qui doivent être vendues pour que le
résultat de l’entreprise soit égal à 0.
Sous-produit : produit que l’on n’avait pas prévu et qui est apparu pendant la
fabrication d’un produit fini.
Stock : réserve interne de matières premières, produits, produits intermédiaires ou de
marchandises. Un stock a un coût qui peut prendre 3 principales dimensions : les
coûts de stockage, de lancement et de pénurie.
Stock final théorique : stock prévisionnel à la fin de la période.
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 9/10
MOOC - COMPTABILITE DE GESTION ET PRATIQUE DU TABLEUR
Système budgétaire : système de suivi des coûts à court terme, comprenant des
budgets (ventes, production, etc.) et un système de contrôle de ces budgets. Il
permettra de vérifier que les actions menées à court terme sont conformes à la
stratégie de l’entreprise prévue sur le long terme.
T
Tableau de bord : document permettant le suivi permanent de plusieurs indicateurs
de la performance de l’entreprise sur une période donnée.
Taux de frais : montant des charges indirectes d’un centre d’analyse / assiette de
répartition. Exemple : € de chiffre d’affaires, K€ de coût de production, etc. Il permet
de mesurer l’activité du centre d’analyse quand l’utilisation d’unités physiques n’est
pas possible (ex : centre administration).
U
Unité d’œuvre : unité de mesure de l’activité des différents centres d’analyse.
V
Valeur : Perception qu’a le client de l’utilité des biens ou prestations fournies. Elle se
traduira par le prix qu’il acceptera de payer.
Valorisation des sorties : Processus qui permet de donner une valeur à un stock,
cette valeur se retrouvant à l’Actif du Bilan.
Ventilation des charges : répartition des charges.
C. Averseng / C. Marsal - Lexique Mooc Compta de Gestion et Tableur - 10/10
Vous aimerez peut-être aussi
- Audit Site Internet ExempleDocument10 pagesAudit Site Internet ExempleMohamed BourahlaPas encore d'évaluation
- La Négociation CommercialeDocument43 pagesLa Négociation CommercialeRaja Benaissa100% (1)
- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation
- Charte Editoriale - KP GROUPDocument8 pagesCharte Editoriale - KP GROUPValère NdiPas encore d'évaluation
- ComptabilDocument107 pagesComptabilGora SeckPas encore d'évaluation
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Calcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesD'EverandCalcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesPas encore d'évaluation
- Les tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseD'EverandLes tableaux de bord et business plan: Gérer la comptabilité de son entrepriseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- Value Stream Mapping: Méthode de cartographie des chaînes de valeurD'EverandValue Stream Mapping: Méthode de cartographie des chaînes de valeurPas encore d'évaluation
- PFEDocument78 pagesPFEchaimae100% (2)
- Entreposage 1Document28 pagesEntreposage 1akhriddPas encore d'évaluation
- Compta Anal Juin 2020 Ap2 - CopieDocument61 pagesCompta Anal Juin 2020 Ap2 - Copiehede100% (1)
- Chiffrage - AlineDocument4 pagesChiffrage - AlineAline Luiza Lima LeitePas encore d'évaluation
- I - Introduction CAE 2022 2023Document12 pagesI - Introduction CAE 2022 2023ayoubbagdadkhPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 1 Compt AnalytiqueDocument5 pagesCHAPITRE 1 Compt Analytiquehammou benzitaPas encore d'évaluation
- Système D'information Compta de GestionDocument7 pagesSystème D'information Compta de GestionKhalil LatrechePas encore d'évaluation
- Comptabilité Analytique MR KaramDocument32 pagesComptabilité Analytique MR KaramSalma NouniPas encore d'évaluation
- Comptabilité AnalytiqueDocument37 pagesComptabilité AnalytiqueaelkhattabyPas encore d'évaluation
- Cours de Comptabilite Analytique Chapitre 1 Fseg 2023Document32 pagesCours de Comptabilite Analytique Chapitre 1 Fseg 2023Thianfanga Oumar Sanogo ThianoPas encore d'évaluation
- CostingDocument12 pagesCostinghatemPas encore d'évaluation
- Environnement de La Comptabilité Analytique de GestionDocument2 pagesEnvironnement de La Comptabilité Analytique de Gestionsarra arfaouiPas encore d'évaluation
- Cours de Comptabilite AnalytiqueDocument20 pagesCours de Comptabilite AnalytiqueSaad Bouza100% (1)
- La Comptabilité AnalytiqueDocument60 pagesLa Comptabilité AnalytiqueJosue Ouattara100% (1)
- Support de Cours Comptabilite Analytique Mba/CaeDocument53 pagesSupport de Cours Comptabilite Analytique Mba/Caeibu seyePas encore d'évaluation
- Diagnostic FinancierDocument23 pagesDiagnostic FinancierYounes SitayebPas encore d'évaluation
- Comptabilité de GestionDocument9 pagesComptabilité de GestionWisal ElmansouriPas encore d'évaluation
- CH 1 Et CH 2 - 2Document14 pagesCH 1 Et CH 2 - 2Ali Janati IdrissiPas encore d'évaluation
- Ch1 Couts CompletsDocument90 pagesCh1 Couts CompletsHöűDa El100% (1)
- Théorique (CAE Budgets Analyse Fin Compta Des Stés)Document15 pagesThéorique (CAE Budgets Analyse Fin Compta Des Stés)goundallayla80100% (1)
- CH1 Section 1 Compta Anal S3Document62 pagesCH1 Section 1 Compta Anal S3Elyas100% (1)
- Chapitre 01Document8 pagesChapitre 01idarimanel03Pas encore d'évaluation
- Comptabilite AnalytiqueDocument46 pagesComptabilite AnalytiqueOmar ELPas encore d'évaluation
- Support Du Compta AnalytiqueDocument24 pagesSupport Du Compta AnalytiqueIKRAM AIT BENOMAR100% (1)
- La Comptabilité AnalytiqueDocument7 pagesLa Comptabilité Analytiqueouijdane elPas encore d'évaluation
- Comptabilité Analytique1Document34 pagesComptabilité Analytique1aitazziabdo100% (3)
- Compta Ana Gestion Mai 2022Document21 pagesCompta Ana Gestion Mai 2022Hassan chigata ouattaraPas encore d'évaluation
- Analyse Du Compte de Resultat SyscoaDocument21 pagesAnalyse Du Compte de Resultat SyscoaKossi EkpaoPas encore d'évaluation
- Budget de Vente TSGEDocument23 pagesBudget de Vente TSGEtt gh0% (1)
- Cout CacheDocument16 pagesCout Cacherochmarcchristian33% (3)
- La Méthode Des Coûts Compatibilité Analytique 2emeDocument8 pagesLa Méthode Des Coûts Compatibilité Analytique 2emeJunior Adya100% (1)
- Comptabilite Analytique CH1 2Document68 pagesComptabilite Analytique CH1 2Enseignant Universiataire100% (1)
- Résumé Calcul Des CoûtsDocument6 pagesRésumé Calcul Des CoûtsFree WatchingPas encore d'évaluation
- Comptabilité Analytique Cours 1-5 Commerce - Marketing - ComptabilitéDocument27 pagesComptabilité Analytique Cours 1-5 Commerce - Marketing - Comptabiliténishanth abirPas encore d'évaluation
- Projet D'exposé Finalisé en COMPTA ANALYTIQUEDocument11 pagesProjet D'exposé Finalisé en COMPTA ANALYTIQUERubs PastorePas encore d'évaluation
- Cage ESSECDocument49 pagesCage ESSECCédric NaitormbaidePas encore d'évaluation
- Synthèse Analy Budget TBord-1Document26 pagesSynthèse Analy Budget TBord-1lilian alléchiPas encore d'évaluation
- Comptabilité Analytique - Pr. NokairiDocument19 pagesComptabilité Analytique - Pr. Nokairiskybeatrex20Pas encore d'évaluation
- 1 - Introduction CaeDocument27 pages1 - Introduction CaehenryPas encore d'évaluation
- Thème 1 Centres D'analyse ExamenDocument25 pagesThème 1 Centres D'analyse ExamenyoussefPas encore d'évaluation
- Introduction GeneraleDocument4 pagesIntroduction GeneralesidyPas encore d'évaluation
- CHAP 2 La M - Thode Des Co - Ts Partiels PDFDocument12 pagesCHAP 2 La M - Thode Des Co - Ts Partiels PDFHamza ElkalaDy100% (2)
- La Comptabilité de Gestion (Enregistré Automatiquement)Document7 pagesLa Comptabilité de Gestion (Enregistré Automatiquement)Diane ParacletPas encore d'évaluation
- Comptabilite Analytique L2 Seg 2023 PDFDocument33 pagesComptabilite Analytique L2 Seg 2023 PDFJunior BrouPas encore d'évaluation
- Finance D'entrepriseDocument31 pagesFinance D'entrepriseAbidar AyoubPas encore d'évaluation
- CH1 Section 1 Ca AatDocument53 pagesCH1 Section 1 Ca AatSalah Boussetta100% (1)
- Contrôle-De Gestion-ResumeDocument8 pagesContrôle-De Gestion-ResumeAdil ELPas encore d'évaluation
- Seance 1 Comptabilita AnalytiqueDocument18 pagesSeance 1 Comptabilita AnalytiqueSalah Boussetta100% (1)
- Cour Contrôler Les Couts D'exploitationDocument11 pagesCour Contrôler Les Couts D'exploitationTouaiti RabiiPas encore d'évaluation
- Tout Comprendre Sur La Comptabilité AnalytiqueDocument11 pagesTout Comprendre Sur La Comptabilité AnalytiquehatemPas encore d'évaluation
- Cours de Compta-AnalytiqueDocument56 pagesCours de Compta-AnalytiqueOne pac100% (1)
- Contrôle de Gestion Les Coûts Et La Comptabilité AnalytiqueDocument20 pagesContrôle de Gestion Les Coûts Et La Comptabilité AnalytiqueElie fontenel MoubedaPas encore d'évaluation
- PCI - TD - Centres Resp Et Profit - Correction CASDocument28 pagesPCI - TD - Centres Resp Et Profit - Correction CASDevin Ramos100% (1)
- Le tableau de bord prospectif: Les 4 composantes essentielles pour une stratégie d'entreprise à long termeD'EverandLe tableau de bord prospectif: Les 4 composantes essentielles pour une stratégie d'entreprise à long termePas encore d'évaluation
- Le tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?D'EverandLe tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?Pas encore d'évaluation
- Difficulté ComptableDocument16 pagesDifficulté ComptablemadoumoPas encore d'évaluation
- Résumé Droit Social-Travail CoursDocument5 pagesRésumé Droit Social-Travail Coursmadoumo100% (4)
- BO 6432 FRDocument108 pagesBO 6432 FRmadoumoPas encore d'évaluation
- Support Cours AuditDocument222 pagesSupport Cours AuditmadoumoPas encore d'évaluation
- Mariamou SOUFFOU 1 MCV 3Document18 pagesMariamou SOUFFOU 1 MCV 3sffmarie42Pas encore d'évaluation
- Exposé de Communication ExterneDocument5 pagesExposé de Communication ExterneMamoudou KanePas encore d'évaluation
- Luxembourg Chambre Des Metiers Les Cahiers Juridiques N 6 Droit de La ConstructionDocument46 pagesLuxembourg Chambre Des Metiers Les Cahiers Juridiques N 6 Droit de La ConstructionGaétan MaisonneuvePas encore d'évaluation
- Chapitre II PDFDocument35 pagesChapitre II PDFIsmail El AlamiPas encore d'évaluation
- Plannification Operationnelle AMSID 2022Document9 pagesPlannification Operationnelle AMSID 2022Raziel BackoulasPas encore d'évaluation
- Support Challenge 1Document141 pagesSupport Challenge 1nomenarakotovaooPas encore d'évaluation
- Thème 1 IntroductionDocument24 pagesThème 1 IntroductionNoor KchloufPas encore d'évaluation
- Stratégies de Marketing Digital Pour Le Coach Sportif (Coach Othmane)Document6 pagesStratégies de Marketing Digital Pour Le Coach Sportif (Coach Othmane)Abdelhamid AguniPas encore d'évaluation
- Décision Du TGI NanterreDocument5 pagesDécision Du TGI NanterrelucertolePas encore d'évaluation
- Negociateur Technico-Commercial - 19.07.18Document1 pageNegociateur Technico-Commercial - 19.07.18Val PlmPas encore d'évaluation
- Commerce InternationalDocument68 pagesCommerce Internationalalkawtarmed100% (2)
- Création D'une Entreprise de Transformation Agroalimentaire (Création Et Gestion Des PME)Document12 pagesCréation D'une Entreprise de Transformation Agroalimentaire (Création Et Gestion Des PME)Nerou Loloupetsca100% (1)
- Marketings3 Partie 3Document1 pageMarketings3 Partie 3jaoudsPas encore d'évaluation
- Marketing and Brand Manager Resume Example 1Document2 pagesMarketing and Brand Manager Resume Example 1Nes SyPas encore d'évaluation
- Barok Buisness Plan IntilakaDocument8 pagesBarok Buisness Plan IntilakaAmine DRIFPas encore d'évaluation
- TourismeDocument183 pagesTourismeVictoria UngureanuPas encore d'évaluation
- Projet 2017Document27 pagesProjet 2017PortlandPas encore d'évaluation
- L'analyse TechnologiqueDocument3 pagesL'analyse Technologiquemery0% (1)
- LogistiqueDocument12 pagesLogistiqueAnGel AngelPas encore d'évaluation
- Plan Daffaires Standardisé Ferme Avicole 22 04 TransmiseDocument62 pagesPlan Daffaires Standardisé Ferme Avicole 22 04 Transmisekomoin allialli andrée vivianePas encore d'évaluation
- ExternalisationDocument15 pagesExternalisationNamira RefoufiPas encore d'évaluation
- Theme 1 MKG STRATEGIEDocument35 pagesTheme 1 MKG STRATEGIEProfesseur MkgPas encore d'évaluation
- Le Plan de CommunicationDocument21 pagesLe Plan de CommunicationSarah Sanbi100% (1)
- Chapitre I Les Fondements Du MarketingDocument5 pagesChapitre I Les Fondements Du MarketingHanae ElHaChoice100% (5)
- Sound CorrigeDocument7 pagesSound CorrigeMustapha Mektan100% (1)