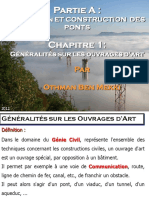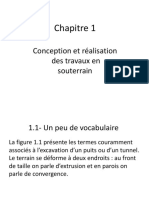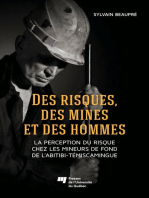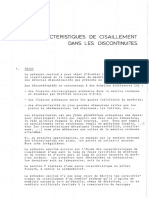Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chapitre I Généralités Sur Les Travaux en Souterrain
Chapitre I Généralités Sur Les Travaux en Souterrain
Transféré par
Tus AndrianintsoaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre I Généralités Sur Les Travaux en Souterrain
Chapitre I Généralités Sur Les Travaux en Souterrain
Transféré par
Tus AndrianintsoaDroits d'auteur :
Formats disponibles
CHAPITRE I: Généralités
1. Introduction
Les ouvrages souterrains constituent un domaine important et en plein développement de la
géotechnique. En effet, l’extension des voies de communication (routes, autoroutes et voies ferrées)
impose souvent des franchissements difficiles, qui conduisent généralement à la construction de
tunnels, De même, l’encombrement de la surface du sol des villes rend nécessaire la construction en
souterrain des nouvelles voies de circulation (voirie, métros) et de nouveaux équipements urbains
(parkings, réseaux d’assainissement, etc,,,). Ces derniers ouvrages sont généralement construits à
faible profondeur. L’utilisation des cavités souterraines pour le stockage de différents produits
constitue également un domaine d’activités conséquent. Les ouvrages souterrains sont donc de types
d’usages et de dimensions très divers
2. Qu’est-ce qu’un ouvrage souterrain
On entend par "travaux souterrains " tous travaux exécutés en dessous de la surface du sol dans des
excavations ayant une configuration complexe et évolutive.
Donc, un ouvrage souterrain est une construction réalisée sous le sol. La réalisation de celle-ci
nécessite des travaux de déblais.
Ces ouvrages sont souvent destinés:
à la circulation des personnes, des véhicules et des marchandises (tunnels routiers et
autoroutiers, tunnels ferroviaires, métro, …..);
au stockage des déchets dangereux ou différents produits, en particulier des hydrocarbures ;
à la production d'énergie (central nucléaire, central thermique..);
a l’évacuation des eaux usées ou l’approvisionnement en eau potable (aqueduc) .
3. Importance des ouvrages souterrains
Les ouvrages souterrains constituent la solution la mieux adaptée à la création de nouvelles
infrastructures en zone urbaine et au franchissement des zones montagneuses. En zone urbaine, le
sous-sol devient une alternative quasi incontournable aux problèmes d’occupation et d’encombrement
de surface. La réalisation des travaux en souterrain permet de s’affranchir des obstacles,
d’utiliser au maximum l’espace souterrain quasi illimité et de libérer la surface au sol.
4. Les problèmes majeurs liés à la construction des ouvrages souterrains sont :
La stabilité de terrain pendant les travaux notamment au front de taille
Le choix de type de soutènement et de revêtement à mettre en œuvre pour assurer la tenue des
parois à court terme, puis à long terme
La maîtrise des mouvements engendrés en surface par le creusement particulier lorsque
l’ouvrage est construit à une faible profondeur ou à proximité d’autre structures (en site urbain)
Maîtrise les problèmes hydrauliques (présence d’une nappe phréatique).
Cours d’infrastructures souterraines 2018-2019 Enseignant : S. CHOUCHA
CHAPITRE I: Généralités
5. Principaux et différents types des ouvrages souterrains :
Si l’on se réfère à leur objet, on peut distinguer plusieurs types
de tunnels :
— les tunnels de communication parmi lesquels :
• les tunnels ferroviaires,
• les tunnels routiers,
• les tunnels de navigation ;
— les tunnels de transport :
• adductions d’eau,
• galeries hydrauliques,
• égouts,
• galeries de canalisations ;
— les tunnels et cavités de stockage :
• garages et parkings,
• stockages liquides ou gazeux,
• dépôts.
Si l’on se réfère à leur mode d’exécution, on peut distinguer :
— les tunnels ou cavités construits à ciel ouvert ;
— les tunnels construits en souterrain à faible ou forte profondeur;
— les tunnels construits par éléments immergés.
6. Tunnel :
c’est un ouvrage souterrain linéaire ouvert à la circulation, le plus souvent ferroviaire ou routière. Le
mot galerie est employé de préférence pour les ouvrages hydrauliques (adductions d'eau, égouts).
6.1 Définition géométrique d’un tunnel
Dans un projet de tunnel, l’un des premiers choix à effectuer est celui de ses caractéristiques
géométriques (tracé en plan, profil en long et profil en travers) qui aident à l’implantation de l’ouvrage
6.1.1.Tracé en plan
Tracé en plan représente la projection, a une échelle réduite, du tunnel sur un plan horizontal .il
caractérise par une succession de courbes et d'alignements droits séparés par des raccordements
progressifs ou des raccordements circulaires.
Cours d’infrastructures souterraines 2018-2019 Enseignant : S. CHOUCHA
CHAPITRE I: Généralités
6.1.2. Profil en long.
Le profil en long est une coupe verticale passant par l’axe du tunnel, développée et
représentée sur un plan à une certaine échelle. Il précise les longueurs (en abscisse) et les hauteur
( en ordonnée ) . Il précise les longueurs et les valeurs des pentes ou des rampes, ainsi que les rayons
courbure des sommets de côtes et des points bas aux raccordements
La déclivité maximale doit rester, autant que possible, telle qu’elle permette de maintenir la
capacité de service de la route : jusqu’à 4 à 6 % dans les tunnels urbains de courte longueur, mais
seulement 2 à 3 % sauf exception sur les longs tunnels autoroutiers
On recommande de ne pas descendre au-dessous d’une pente de 0,25 % pour éviter la stagnation
des eaux de ruissellement.
6.1.3. Profil en travers
Le profil en travers est une coupe transversale perpendiculaire à l’axe du tunnel Il précise, pour une position
donnée, la forme géométrique de la section du tunnel ( circulaire ,rectangulaire ..) ainsi que les largeurs des
voies routable, trottoirs, largeur de bande d’arrêt d’urgence et tous les détail qui peuvent être existent
Tunnel à section circulaire
Tunnel plein cintre Tunnel à voûte surbaissée Tunnel à section en fer à cheval
Cours d’infrastructures souterraines 2018-2019 Enseignant : S. CHOUCHA
CHAPITRE I: Généralités
La section utile d’un tunnel ferroviaire dépend de plusieurs facteurs et, en premier lieu, du gabarit du
matériel roulant appelé à circuler sur la ligne. Un autre facteur intervient sur les lignes où doivent
circuler des trains à grande vitesse, c’est la notion du volume minimal d’air à réserver autour du
gabarit
6.2 Facteurs influençant la conception des tunnels
L’opération de la conception d’un tunnel souvent est régit par plusieurs facteurs on peut citer :
- La destination de l’ouvrage (circulation, stockage,….)
- La nature des terrains à traverser (sol ou massif rocheux) et sa sensibilité aux déformations
- La présence de la nappe d’eau
- la direction de discontinuité par rapport l’orientation du tunnel te tels que caniveaux, avaloirs
…etc.
6.3 Description d'un tunnel
Lorsque l’on creuse un tunnel, on parle d’ L'excavation. Lors de l’excavation, le terrain se déforme à
deux endroits (dû aux pressions exercées) :
-Au front de taille, on parle d’extrusion.
- En parois, on parle de convergence.
Coupe transversale et longitudinale d'un tunnel au voisinage du front de taille
Cours d’infrastructures souterraines 2018-2019 Enseignant : S. CHOUCHA
CHAPITRE I: Généralités
Front de taille : est une surface plane dont le contour forme le profil du tunnel
Voûte : Paroi supérieure cintré du tunnel appuyant sur les piédroits .
Clé de voûte: section de la voûte située dans son plan de symétrie.
Piédroits : parties verticales de la section transversale du tunnel, comprises entre la voûte et le
sol de fondation de l'ouvrage
Extrados : face supérieure de la voûte.
Intrados: face inférieure de la voûte.
Radier : partie inférieure du tunnel située entre les deux piédroits, Le radier peut être constitué
par une dalle ou un arc en béton.
7. Petit lexique
Auscultation : instrumentation et mesure de grandeurs physiques permettant de comprendre et de
maîtriser d’une part le comportement de l’ouvrage, d’autre part son incidence sur l’environnement
(terrain, tunnel, ouvrages voisins).
Bouclier : système de protection et de soutènement d’un tunnelier constitué le plus souvent d’un
tube métallique épais à peu près du diamètre de la section excavée.
Cintre : profilé métallique normalisé (IPE, HEA, HEB...) cintré selon la géométrie du tunnel et
qui sert à soutenir le terrain.
Confinement: application d’une pression sur les parois d’un tunnel, par le biais d’un soutènement
principalement, dans le but de limiter les convergences et le déconfinement du terrain.
Front de taille: zone où l’excavation se réalise, fin provisoire du tunnel en creusement. Souvent le
terme désigne la paroi verticale de terrain.
Injection: terme générique désignant les techniques de substitution et de comblement des vides
dans les terrains par un coulis durcissant. Les injections ont deux utilités : augmenter la résistance
et/ou étancher.
Tunnelier: machine pleine section destinée à réaliser des tunnels, pouvant aller du creusement à la
pose du revêtement final.
Excavation (creusement):Ensemble des deux opérations d'abattage et de marinage. Peut désigner
le résultat c'est-à-dire le volume vide laissé par celles-ci.
Soutènement: ensemble des dispositifs assurant la stabilité provisoire (jusqu'à la mise en place
d'un revêtement définitif) de l'excavation et de la sécurité chantier.
Revêtement: ensemble des dispositifs à ajouter au soutènement pour assurer la stabilité de
l'ouvrages souterrain. Le revêtement constitue la structure résistante placée le plus à l'intrados du
tunnel.
Marinage: évacuation des marins issus de l’excavation
Voussoir: écaille de béton armé préfabriquée. Plusieurs voussoirs forment un anneau, et plusieurs
anneaux forment le revêtement de certains tunnels
Cours d’infrastructures souterraines 2018-2019 Enseignant : S. CHOUCHA
Vous aimerez peut-être aussi
- Rapport de Stage: Étude D'un Remblai Ferroviaire Sur Des Sols Compressibles, Taha BoukhloufiDocument58 pagesRapport de Stage: Étude D'un Remblai Ferroviaire Sur Des Sols Compressibles, Taha BoukhloufitahaPas encore d'évaluation
- Cours 10 Dégradation - Auscultation - Entretien Des RoutesDocument87 pagesCours 10 Dégradation - Auscultation - Entretien Des RoutesMamadou SowPas encore d'évaluation
- Rapport Ouvrages D'artDocument44 pagesRapport Ouvrages D'artSoufian SabarPas encore d'évaluation
- Methodes de Dimensionnement Des TunnelsDocument12 pagesMethodes de Dimensionnement Des TunnelsAbdelkader Safa100% (1)
- Introduction GénéraleDocument4 pagesIntroduction GénéraleBaha Mdini100% (1)
- TunnelsDocument24 pagesTunnelsHamidPas encore d'évaluation
- Etude Et Conception D'un Tunnel Bitube FerroviaireDocument200 pagesEtude Et Conception D'un Tunnel Bitube FerroviaireMahmoud Arslane100% (8)
- Du Projet A La Construction Du Tunnel PDFDocument107 pagesDu Projet A La Construction Du Tunnel PDFMOoMOouȟPas encore d'évaluation
- A1-Les Ouvrages D'art2012Document98 pagesA1-Les Ouvrages D'art2012Amine TakaliPas encore d'évaluation
- Revetement TPDocument4 pagesRevetement TPInsaf SaifiPas encore d'évaluation
- ABAHDocument14 pagesABAHABAH BRUNOPas encore d'évaluation
- 0 - Ch1Généralités Sur Les Ouvrages Souterrains 20-21Document4 pages0 - Ch1Généralités Sur Les Ouvrages Souterrains 20-21Roza Rose100% (1)
- Chap 1 Généralité Ouvrage SouterrainDocument5 pagesChap 1 Généralité Ouvrage SouterrainInsaf Saifi100% (3)
- Cours Tun2018Document79 pagesCours Tun2018Máýá Háýáá100% (5)
- Chapitre 05 - Galerie Souterraine Et TunnelsDocument54 pagesChapitre 05 - Galerie Souterraine Et TunnelsIbtissam RachidiPas encore d'évaluation
- TunnelDocument50 pagesTunnelAbdelkader BenkreddaPas encore d'évaluation
- Chapitre I Tunnel M2Document7 pagesChapitre I Tunnel M2Fidel AlfinetePas encore d'évaluation
- Infrastructures Souterraines 2 1Document121 pagesInfrastructures Souterraines 2 1alberto rafik100% (1)
- Conception Et Réalisation Des TunnelsDocument32 pagesConception Et Réalisation Des TunnelsAbdelkader SafaPas encore d'évaluation
- Cours OS Chapitre 1Document25 pagesCours OS Chapitre 1Alaeddine Kharchi100% (1)
- Beton PDFDocument21 pagesBeton PDFHala YahPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 CALCUL DES TUNNELS - GA 4Document135 pagesChapitre 3 CALCUL DES TUNNELS - GA 4Hilary ParkerPas encore d'évaluation
- Ouvrages Souterrains Version WebDocument49 pagesOuvrages Souterrains Version WebSérgio BernardesPas encore d'évaluation
- Presentation Projet Tunnel Djebel El OuahchDocument9 pagesPresentation Projet Tunnel Djebel El OuahchSaid SitayebPas encore d'évaluation
- Exposé Tunnels ModDocument19 pagesExposé Tunnels ModLynVanderson50% (2)
- Guide Beton Coffre en Tunnel Cle5d3179Document86 pagesGuide Beton Coffre en Tunnel Cle5d3179Oussama StinsonPas encore d'évaluation
- Expose Sur Les TunnelsDocument18 pagesExpose Sur Les Tunnelsaissa razikiPas encore d'évaluation
- 1 TunnelsDocument35 pages1 TunnelsMongi Ben Ouezdou67% (3)
- Travaux SouterrainsDocument35 pagesTravaux SouterrainsKhalifaKhelifaPas encore d'évaluation
- Chapitre 04Document10 pagesChapitre 04ObaidaAiche100% (1)
- Généralités Sur Les Ouvrages D'artDocument31 pagesGénéralités Sur Les Ouvrages D'artsoh kllPas encore d'évaluation
- Tunnel Chap4Document20 pagesTunnel Chap4Ali HamdanePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 TUNNELDocument9 pagesChapitre 2 TUNNELbayek 3robiPas encore d'évaluation
- GéotechniqueDocument15 pagesGéotechniqueAmineHadjout100% (1)
- 01 - La Méthode de Construction Des Tunnels Avec Soutènement Immédiat Par Béton Projeté Et BoulonnageDocument14 pages01 - La Méthode de Construction Des Tunnels Avec Soutènement Immédiat Par Béton Projeté Et BoulonnageAbdelkader SafaPas encore d'évaluation
- Convergence ConfinementDocument11 pagesConvergence ConfinementFranck LançonPas encore d'évaluation
- Renforcement Des SolsDocument21 pagesRenforcement Des SolsMohamed Jafjaf100% (4)
- 07 - Choix D'un Type de Soutènement en GalerieDocument16 pages07 - Choix D'un Type de Soutènement en GalerieAbdelkader Safa100% (1)
- Méthodes de Creusement de TunnelDocument32 pagesMéthodes de Creusement de TunnelMohamed Ali HkimaPas encore d'évaluation
- TP RouteDocument14 pagesTP RouteMedBng 220% (1)
- Cours 3 MODES D'ATTAQUE Et DE CREUSEMENTDocument9 pagesCours 3 MODES D'ATTAQUE Et DE CREUSEMENTAliPas encore d'évaluation
- Me - 15 Essai PressiométriqueDocument16 pagesMe - 15 Essai PressiométriqueYounes TaoufikPas encore d'évaluation
- 2 Generalites ChausseeDocument126 pages2 Generalites Chausseekhalidboutahri100% (2)
- Tunnels 23Document47 pagesTunnels 23Mohamed El AdnaniPas encore d'évaluation
- Cours de Ponts 2Document73 pagesCours de Ponts 2Iatissami IlyassPas encore d'évaluation
- Cours de Ponts 2-Partie2 PDFDocument79 pagesCours de Ponts 2-Partie2 PDFAmin MinouPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Infrastructure FerroviaireDocument12 pagesChapitre 2 Infrastructure FerroviaireKarim AbdeslamPas encore d'évaluation
- Plaquette GeofondDocument2 pagesPlaquette GeofondAbdelhay ElomariPas encore d'évaluation
- Caractérisation Et Modélisation D Une Phase de Creusement D'un Tunnel: Cas Du Tunnel D Ait Yahia MDocument187 pagesCaractérisation Et Modélisation D Une Phase de Creusement D'un Tunnel: Cas Du Tunnel D Ait Yahia MkeitaPas encore d'évaluation
- Chapter 5 To Research GateDocument52 pagesChapter 5 To Research GateIatissami IlyassPas encore d'évaluation
- 3.1. M. Si - Tayeb - Reparation Des Tunnels PDFDocument27 pages3.1. M. Si - Tayeb - Reparation Des Tunnels PDFSmail ZennouchePas encore d'évaluation
- Presentation Des PontsDocument80 pagesPresentation Des PontsDaniel Dias0% (1)
- Etude de La Tremie - La ConcordeDocument121 pagesEtude de La Tremie - La Concordes.savoir4557100% (1)
- Des risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscamingueD'EverandDes risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscaminguePas encore d'évaluation
- TunnelsDocument24 pagesTunnelsHamidPas encore d'évaluation
- Ouvrage Sous TerainDocument4 pagesOuvrage Sous TerainAggoun YounesPas encore d'évaluation
- Assainissement RoutierDocument17 pagesAssainissement RoutierImane Ncr100% (2)
- Assainissement Routier Transversal: Les Buses Et Les DalotsDocument17 pagesAssainissement Routier Transversal: Les Buses Et Les DalotsferdaousPas encore d'évaluation
- Bs 1Document31 pagesBs 1Farid MessaadPas encore d'évaluation
- Cours Ouvrage D'art2Document20 pagesCours Ouvrage D'art2djonossiestellaPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 - Rce Au Cisaillement Des SolsDocument9 pagesChapitre 5 - Rce Au Cisaillement Des SolsyouceftliPas encore d'évaluation
- Test 19 No 6 CorrigeDocument2 pagesTest 19 No 6 CorrigeyouceftliPas encore d'évaluation
- Test 19-No 3-CorrigeDocument8 pagesTest 19-No 3-CorrigeyouceftliPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 - Compressibilité Et ConsolidationDocument13 pagesChapitre 4 - Compressibilité Et ConsolidationyouceftliPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Charges de Surface en MDSDocument12 pagesChapitre 3 - Charges de Surface en MDSyouceftliPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Contraintes Dans Le SolDocument8 pagesChapitre 2 - Contraintes Dans Le SolyouceftliPas encore d'évaluation
- App Culée 3Document11 pagesApp Culée 3youceftliPas encore d'évaluation
- SYS846 Chap2 2 PDFDocument17 pagesSYS846 Chap2 2 PDFyouceftliPas encore d'évaluation
- Exo12 Corigé PDFDocument2 pagesExo12 Corigé PDFyouceftliPas encore d'évaluation
- TheseDocument83 pagesTheseyouceftliPas encore d'évaluation
- Exo17 CorigéDocument4 pagesExo17 CorigéyouceftliPas encore d'évaluation
- 1a IE 2000-2001 GClim PDFDocument2 pages1a IE 2000-2001 GClim PDFyouceftliPas encore d'évaluation
- Mécanique Des Roches Chap DDocument37 pagesMécanique Des Roches Chap DyouceftliPas encore d'évaluation
- Meca Roche PDFDocument29 pagesMeca Roche PDFyouceftliPas encore d'évaluation
- Conditions ParticulièresDocument61 pagesConditions ParticulièresdiodatPas encore d'évaluation
- Rapport Jury Agreg-Externe SII IM 2014 v2 418174 PDFDocument67 pagesRapport Jury Agreg-Externe SII IM 2014 v2 418174 PDFabdoPas encore d'évaluation
- RA BP 2017-Web PDFDocument170 pagesRA BP 2017-Web PDFImane MegzariPas encore d'évaluation
- TP Les Essais Mecaniques M1 G SurfaceDocument8 pagesTP Les Essais Mecaniques M1 G SurfaceRaouf ZitouniPas encore d'évaluation
- PCZADocument2 pagesPCZARafik Ben NasrPas encore d'évaluation
- Maison Emploi Juin2011Document1 pageMaison Emploi Juin2011lessinesPas encore d'évaluation
- C9 - Transformateur Mono PDFDocument9 pagesC9 - Transformateur Mono PDFKIDS APP100% (1)
- Modèle de Lettre D'affirmationDocument2 pagesModèle de Lettre D'affirmationrazafi mahefa100% (1)
- Algerie Referentiel Technique Et Reglementaire de La Construction PDFDocument69 pagesAlgerie Referentiel Technique Et Reglementaire de La Construction PDFEdouard Francis Jareth100% (1)
- Rapport Modele Stage PerfectionnementDocument13 pagesRapport Modele Stage PerfectionnementHama S'dPas encore d'évaluation
- Copie de SOLUTION-EXAMEN MP-MSDG-23-24-VDDocument10 pagesCopie de SOLUTION-EXAMEN MP-MSDG-23-24-VDmeryem.sabirPas encore d'évaluation
- CH4-Design PatternsDocument39 pagesCH4-Design Patternssamiakouame21Pas encore d'évaluation
- HJB L'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) DansDocument7 pagesHJB L'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) DansnasseraivoPas encore d'évaluation
- Chapitre 01Document12 pagesChapitre 01Hafa ApbPas encore d'évaluation
- 7 Métrologie Des Enceintes Climatiques v.3Document23 pages7 Métrologie Des Enceintes Climatiques v.3boukhari sofianePas encore d'évaluation
- Production, Transmission Et Distribution - MATLAB & SimulinkDocument6 pagesProduction, Transmission Et Distribution - MATLAB & SimulinkHerintsoa TanterakaPas encore d'évaluation
- Cours Environnement Et Développement Durable (PDFDrive)Document216 pagesCours Environnement Et Développement Durable (PDFDrive)Abraham Eric Kut NjoyaPas encore d'évaluation
- Contrat de Maintenance Informatique Mise A Jour Site Internet Creerweb 2Document5 pagesContrat de Maintenance Informatique Mise A Jour Site Internet Creerweb 2Eric GamePas encore d'évaluation
- Codage FC2Document64 pagesCodage FC2Suley Paterson100% (1)
- Comment Récupérer Le Mot de Passe WiFi Sur Android (Sans Root)Document8 pagesComment Récupérer Le Mot de Passe WiFi Sur Android (Sans Root)Mergilles WatelinPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Procédés de DécoupageDocument11 pagesChapitre 1 Procédés de DécoupageRihab HammamiPas encore d'évaluation
- Exam KhayaliDocument4 pagesExam KhayalikamalPas encore d'évaluation
- MémoireDocument16 pagesMémoireMimi NourPas encore d'évaluation
- 3 - Dipoles Lineaires Et Puissances en MonoDocument6 pages3 - Dipoles Lineaires Et Puissances en MonoSans SnoqPas encore d'évaluation
- 7-Matériaux de RéparationDocument3 pages7-Matériaux de Réparationsam1gc geniec21Pas encore d'évaluation
- R19 16s Tutoriel de Réglage Du Potentiomètre de PapillonDocument2 pagesR19 16s Tutoriel de Réglage Du Potentiomètre de PapillonHichamRabanePas encore d'évaluation
- 17 19 Rue Des Orteaux 75020Document2 pages17 19 Rue Des Orteaux 75020bcenergiesPas encore d'évaluation
- GUIDE Carte Des Regions FranceDocument12 pagesGUIDE Carte Des Regions FranceEmily Montosa NunesPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage CimcoDocument6 pagesRapport de Stage CimcoprincenicooaglagoPas encore d'évaluation
- Boissonade, J.F.Fabulae Iambicae - Paris, 1844 - 123+10 Fragmentos - Ed.griega Con Trad - LatinaDocument298 pagesBoissonade, J.F.Fabulae Iambicae - Paris, 1844 - 123+10 Fragmentos - Ed.griega Con Trad - LatinaJustino GarciaPas encore d'évaluation