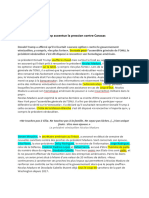Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Article Crise Perou
Transféré par
Jorge VargasTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Article Crise Perou
Transféré par
Jorge VargasDroits d'auteur :
Formats disponibles
On pouvait se douter que Pedro Castillo, le président péruvien de gauche, n’irait
pas au bout de son mandat. On ignorait, en revanche, qu’il le finirait de cette
manière, seul, accusé de rébellion après une tentative manquée de coup d’Etat, le
7 décembre, et enfermé dans la même prison que son lointain prédécesseur Alberto
Fujimori (1990-2000).
Mal élu, avec 19 % des voix au premier tour, le 11 avril 2021, parmi dix-sept
autres candidats, puis avec seulement 50 000 voix d’avance sur Keiko Fujimori,
fille de l’ancien président, au second, le 6 juin, inexpérimenté, sans majorité,
Pedro Castillo a été, pendant les dix-sept mois de son mandat, un chef d’Etat
incompétent. Cinq gouvernements et quatre-vingts ministres se sont succédé. Et,
alors qu’il se présentait comme le candidat de la rupture, six enquêtes pour
corruption ont été ouvertes contre lui.
Mais il a été entravé également par l’opposition de droite, déversant sur lui des
flots de haine et de racisme, les élites ne supportant pas qu’un simple instituteur
des Andes marche sur leurs plates-bandes. Il n’a jamais vraiment pu gouverner, au
point que l’Organisation des Etats américains avait, le 1er décembre, demandé une
« trêve » de cent jours aux différentes forces politiques.
Mercredi 7 décembre, il affrontait la troisième tentative du Congrès de le
destituer. Personne ne s’attendait à ce qu’il tente le tout pour le tout :
dissoudre le Congrès, dénonçant l’obstruction des parlementaires et la « dictature
du Congrès ». En trois heures, Pedro Castillo est lâché par ses ministres, par
l’armée et par ses propres gardes du corps, qui l’arrêtent alors qu’il tente de se
réfugier à l’ambassade du Mexique. Le Congrès se réunit, obtenant largement les
deux tiers des voix nécessaires à sa destitution.
Le même jour, sa vice-présidente, Dina Boluarte, a à peine le temps d’être investie
que les premières manifestations éclatent. Les protestataires exigent sa démission,
la dissolution du Congrès et l’organisation d’élections générales. Certains
demandent le retour de Pedro Castillo, qui traite Mme Boluarte d’« usurpatrice ».
Etat d’urgence
Les Péruviens des Andes, qui avaient massivement voté pour lui, s’emparent
d’aéroports, montent des barrages. Les élites de Lima les traitent de « vandales »,
de « terroristes » qui défendent un « putschiste ». La répression policière est
violente, l’état d’urgence instauré, la police et l’armée tirent à balles réelles.
Au moins vingt-six morts sont à déplorer.
Un coup d’Etat impardonnable ; une répression inacceptable. Le Pérou se déchire. Le
coup de force de Pedro Castillo n’est que l’ultime manifestation de l’incompétence
et de la décadence de l’ensemble de la classe politique péruvienne. Tous ses
prédécesseurs depuis trente-deux ans, à l’exception de deux, sont soit en prison,
soit mis en examen pour corruption. L’affaire Odebrecht, du nom de l’entreprise
brésilienne de BTP qui a versé des pots-de-vin à de nombreux dirigeants latino-
américains, a accru le discrédit jeté sur les dirigeants péruviens.
Si l’exécutif se caractérise par sa médiocrité, le pouvoir législatif n’est pas en
reste. En novembre, le Congrès recueillait 86 % d’opinions défavorables dans un
sondage, soit plus que Pedro Castillo (61 %). La plupart des partis politiques sont
des conglomérats d’intérêts particuliers. « Ce qu’on appelle le centre, ce sont des
franchises créées par des millionnaires sans autre doctrine que celle de défendre
leurs affaires », explique le journaliste Marco Sifuentes, directeur du podcast
« La Encerrona ». Les demandes des citoyens restent lettre morte, et le refus
actuel du Congrès de convoquer des élections immédiates – qui impliqueraient que
les cent trente parlementaires de la Chambre unique perdent leur siège, la
réélection n’étant pas permise – en est une nouvelle illustration.
Tout cela explique la volonté de « dégagisme » des manifestants. En outre, les
électeurs de M.Castillo conçoivent mal qu’il soit le seul à payer les frais d’une
crise dont ils jugent le Congrès largement responsable. Un Congrès qui use et abuse
d’outils permettant de démettre les présidents, telle que l’« incapacité morale
permanente », au gré de ses intérêts. « Au Pérou, il n’est pas nécessaire de
prouver quoi que ce soit pour destituer un président : il suffit d’avoir les deux
tiers des voix au Congrès », déplore M. Sifuentes.
Des réformes structurelles indispensables
Résultat : sept motions de censure et six chefs d’Etat en six ans. Cette crise
rappelle celle qui avait secoué le pays deux ans plus tôt, en novembre 2020. Trois
présidents s’étaient alors succédé en une semaine. A l’époque, la jeunesse était
sortie dans les rues. « Il y avait l’espoir qu’il s’agissait d’un moment de
rupture, se souvient M. Sifuentes. Il aurait dû y avoir des réformes politiques
pour empêcher que ne se reproduise ce qui avait provoqué cette crise. Et rien n’a
été fait. »
Si la réaction à la tentative de coup d’Etat montre que certains réflexes
démocratiques ont été acquis, le pays reste ingouvernable. Sans réforme
structurelle, il continuera de l’être. « Ceux qui devraient changer les choses sont
précisément ceux qui sortent gagnants de ce chaos, ils n’ont donc aucun intérêt à
réformer quoi que ce soit, estime Alberto Vergara, professeur à l’université du
Pacifique, à Lima. Tout cela démontre la médiocrité, l’amateurisme, la vision
court-termiste de la plupart des politiciens péruviens. »
Rares sont les analystes qui, au Pérou, entrevoient une solution à la crise. « Pour
la première fois de ma carrière, je n’ai aucune idée de ce qui peut arriver demain,
constate avec amertume M. Sifuentes. Nous pensions avoir appris des leçons de la
violence des années 1990. Et, aujourd’hui, on crible de balles les manifestants. »
Angeline Montoya
Vous aimerez peut-être aussi
- Brevet Blanc Corrige HG LetudiantDocument4 pagesBrevet Blanc Corrige HG LetudiantLETUDIANT96% (25)
- Agenda 2030 - maîtres et esclaves ?: La vérité sur la grande réinitialisation et l'influence du WEF, de Blackrock et des élites mondialistes - Crise économique - Pénuries alimentaires - Hyperinflation mondialeD'EverandAgenda 2030 - maîtres et esclaves ?: La vérité sur la grande réinitialisation et l'influence du WEF, de Blackrock et des élites mondialistes - Crise économique - Pénuries alimentaires - Hyperinflation mondialePas encore d'évaluation
- Copie Statuts Coop-CADocument21 pagesCopie Statuts Coop-CAessiben ngangue100% (2)
- 55a97c03d3ec33a7fbdbf9dea76d03ebafef38308080323d4b71403300531269Document31 pages55a97c03d3ec33a7fbdbf9dea76d03ebafef38308080323d4b71403300531269Mouhamed Lamine DiankhaPas encore d'évaluation
- Journal de Notre Amérique N°14: No Pasaran !Document37 pagesJournal de Notre Amérique N°14: No Pasaran !AlexAnfrunsPas encore d'évaluation
- Le Précipice - Noam ChomskyDocument288 pagesLe Précipice - Noam ChomskyCaroline DelestretPas encore d'évaluation
- Où Va La FranceDocument3 pagesOù Va La FranceAndré DeFranciaPas encore d'évaluation
- 6 7071 2497330b PDFDocument28 pages6 7071 2497330b PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- A) Les Limites de La Base Des Démocraties: Démocratie Et Autoritarisme en AfriqueDocument2 pagesA) Les Limites de La Base Des Démocraties: Démocratie Et Autoritarisme en AfriqueLa BlédardiennePas encore d'évaluation
- Libérer Les Argentins: PrésidentDocument6 pagesLibérer Les Argentins: Présidentwissem.bezPas encore d'évaluation
- Le Journal de Notre Amérique N°5Document45 pagesLe Journal de Notre Amérique N°5AlexAnfrunsPas encore d'évaluation
- Pourquoi Les Riches Votent A Ga - Frank, ThomasDocument392 pagesPourquoi Les Riches Votent A Ga - Frank, ThomasAnatolie IavorschiPas encore d'évaluation
- Recherche Sur HaitiDocument14 pagesRecherche Sur HaitiHuguesMakpenonPas encore d'évaluation
- Chili, 11 Septembre 1973 L'ingérence Des États-Unis, Ou La Chute D'un État DémocratiqueDocument1 pageChili, 11 Septembre 1973 L'ingérence Des États-Unis, Ou La Chute D'un État Démocratiqueanais.auclPas encore d'évaluation
- PerestroïkaDocument6 pagesPerestroïkaMarco RodriguezPas encore d'évaluation
- Christine Zumello - Primaires Et Partis Aux USADocument20 pagesChristine Zumello - Primaires Et Partis Aux USAaldenaldensonnPas encore d'évaluation
- Lula - Dix Ans Après Juin 2013Document5 pagesLula - Dix Ans Après Juin 2013caltamira-1Pas encore d'évaluation
- Algérie Le Grand Dérapage by Abed CharefDocument542 pagesAlgérie Le Grand Dérapage by Abed CharefRebeu HamedPas encore d'évaluation
- Pourquoi Voter en DémocratieDocument6 pagesPourquoi Voter en DémocratieJl DPas encore d'évaluation
- La Lucha TshisekediDocument10 pagesLa Lucha Tshisekedi8rvz5qg7rmPas encore d'évaluation
- Après Le Rejet Massif de La Nouvelle Constitution, Le Président Chi... - MediapartDocument4 pagesAprès Le Rejet Massif de La Nouvelle Constitution, Le Président Chi... - MediapartinfoLibrePas encore d'évaluation
- La Victoire de Javier Milei en Argentine: I) L'histoire D'un Pays: L'argentineDocument4 pagesLa Victoire de Javier Milei en Argentine: I) L'histoire D'un Pays: L'argentinewissem.bezPas encore d'évaluation
- 27 Hai Ti-Billet-Terreur-Complicite LongDocument3 pages27 Hai Ti-Billet-Terreur-Complicite LongArthur MaximePas encore d'évaluation
- Avancées Et Reculs de La Démocratie-Composition EntraînementDocument2 pagesAvancées Et Reculs de La Démocratie-Composition EntraînementHind SaidiPas encore d'évaluation
- Le Monde1Document3 pagesLe Monde1Patrick AlmeidaPas encore d'évaluation
- Comment Comprendre Le Comportement Des Américains Dans La Crise Actuelle D'haitiDocument4 pagesComment Comprendre Le Comportement Des Américains Dans La Crise Actuelle D'haitiF. Bien AimePas encore d'évaluation
- Figaro 1Document4 pagesFigaro 1marielaure.l2104Pas encore d'évaluation
- Crépuscule by Branco JuanDocument111 pagesCrépuscule by Branco JuanSeydou Sy OBAMAPas encore d'évaluation
- EXPO - Coup D'état Du 11 Septembre (Chili) W - Girls ? - 2Document8 pagesEXPO - Coup D'état Du 11 Septembre (Chili) W - Girls ? - 2Ines NejjarPas encore d'évaluation
- Prisonniers Politiques en HaitiDocument48 pagesPrisonniers Politiques en HaitiLaurette M. BackerPas encore d'évaluation
- Act. de Clase - LVMPEHDocument17 pagesAct. de Clase - LVMPEHKevin HervertPas encore d'évaluation
- La déchéance de la nationalité ou la désagrégation de l'EtatD'EverandLa déchéance de la nationalité ou la désagrégation de l'EtatPas encore d'évaluation
- Thème 1 Chapitre 2Document2 pagesThème 1 Chapitre 2daaisuPas encore d'évaluation
- Sénégal - Une Démocrature JudiciaireDocument4 pagesSénégal - Une Démocrature JudiciaireAriel MbemPas encore d'évaluation
- Marvel Dandin: 100 Premiers Jours Qui Ne Sont Ni Roses Ni Blancs !Document4 pagesMarvel Dandin: 100 Premiers Jours Qui Ne Sont Ni Roses Ni Blancs !Laurette M. BackerPas encore d'évaluation
- Clinton en Porte À FauxDocument1 pageClinton en Porte À Fauxclaro legerPas encore d'évaluation
- L'Arche des Temps Nouveaux: Un long chemin d'épreuves jusqu'à DieuD'EverandL'Arche des Temps Nouveaux: Un long chemin d'épreuves jusqu'à DieuPas encore d'évaluation
- La Démocratie en Haïti - Entre Le Réel Et L'illusoireDocument11 pagesLa Démocratie en Haïti - Entre Le Réel Et L'illusoireSAM WILKENPas encore d'évaluation
- Haiti Observateur PresseDocument16 pagesHaiti Observateur PresseIdeeMark HaitiPas encore d'évaluation
- Transition Democratique Au BresilDocument2 pagesTransition Democratique Au BresilAntonin Couturier OmelianenkoPas encore d'évaluation
- Article 624635Document3 pagesArticle 624635Luciene SouzaPas encore d'évaluation
- 6 7080 81cfe83d PDFDocument30 pages6 7080 81cfe83d PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- Crise Des Droits de L'homme Et Fabrication D'une Nouvelle Catégorie Humaine - Cairn - InfoDocument9 pagesCrise Des Droits de L'homme Et Fabrication D'une Nouvelle Catégorie Humaine - Cairn - InfoJade IlboudoPas encore d'évaluation
- Bayart - La Revanche Des Societes AfricainesDocument33 pagesBayart - La Revanche Des Societes AfricainesRogers Tabe Orock0% (1)
- Jean Claude Duvalier Devant Le Tribunal de L'Histoire Par Ives IsidorDocument5 pagesJean Claude Duvalier Devant Le Tribunal de L'Histoire Par Ives IsidorIves IsidorPas encore d'évaluation
- 6 7136 16afefa3 PDFDocument26 pages6 7136 16afefa3 PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- La CEDEAO Et Les Coups D'état en Afrique de L'ouest - Quel Cadre Juridique PourDocument13 pagesLa CEDEAO Et Les Coups D'état en Afrique de L'ouest - Quel Cadre Juridique PourleeyasphoraculeebalyPas encore d'évaluation
- Boute Ika Face À Ses: PromessesDocument33 pagesBoute Ika Face À Ses: PromessesMohand BakirPas encore d'évaluation
- Corruption AlgrDocument13 pagesCorruption AlgrNoda NodamPas encore d'évaluation
- Disours de Martine Moise GeneveDocument4 pagesDisours de Martine Moise GeneveMartine MoisePas encore d'évaluation
- Commentaire TransitionDocument4 pagesCommentaire TransitionZiyad Moussa El HnoudiPas encore d'évaluation
- Travail Final - Démocratie ReprésentativeDocument4 pagesTravail Final - Démocratie ReprésentativeKwok Ming Clinton CHANPas encore d'évaluation
- Exemple PFE OustraDocument15 pagesExemple PFE OustraFodé Karifa KantéPas encore d'évaluation
- Le Journal de Notre Amérique N°12: Entre Turbulence Et RésistanceDocument46 pagesLe Journal de Notre Amérique N°12: Entre Turbulence Et RésistanceAlexAnfrunsPas encore d'évaluation
- HistoireDocument3 pagesHistoireErasmo AlvarezPas encore d'évaluation
- Le Lavage de Cerveaux en Liberté, Par Noam ChomskyDocument8 pagesLe Lavage de Cerveaux en Liberté, Par Noam ChomskyPaulo MarcelinoPas encore d'évaluation
- De L'etat de Droit À L'etat de Sécurité, AgambenDocument6 pagesDe L'etat de Droit À L'etat de Sécurité, Agambenstella.bejaninPas encore d'évaluation
- Dans Le Monde, Les Gains Démocratiques Depuis 1989 Ont Été Effacés - MediapartDocument5 pagesDans Le Monde, Les Gains Démocratiques Depuis 1989 Ont Été Effacés - MediapartinfoLibrePas encore d'évaluation
- Castoriadis-Stopper La Montée de L'insignifianceDocument5 pagesCastoriadis-Stopper La Montée de L'insignifiancecrates11Pas encore d'évaluation
- Le maccarthysme ou la peur Rouge: La croisade américaine contre le communismeD'EverandLe maccarthysme ou la peur Rouge: La croisade américaine contre le communismePas encore d'évaluation
- Jacques Rancière C'est Vrai Que L'alibi Littéraire' A Servi À Rendre Plus Fréquentables Certaines Idées (Les Trente Inglorieuses)Document15 pagesJacques Rancière C'est Vrai Que L'alibi Littéraire' A Servi À Rendre Plus Fréquentables Certaines Idées (Les Trente Inglorieuses)Yoshiyuki SatoPas encore d'évaluation
- Sujet BP1 ÈreDocument9 pagesSujet BP1 ÈreporasPas encore d'évaluation
- Le Flagrant Délit - Édition Février 2012Document24 pagesLe Flagrant Délit - Édition Février 2012flagrant194Pas encore d'évaluation
- La Dã©centralisation Administrative PDFDocument13 pagesLa Dã©centralisation Administrative PDFKamal LabayPas encore d'évaluation
- Partie 4Document6 pagesPartie 4boulaidPas encore d'évaluation
- Modele Document Reglement InterieurDocument3 pagesModele Document Reglement InterieursezinevivianePas encore d'évaluation
- Protocole Du Concours Révu Et Corrigé PDFDocument2 pagesProtocole Du Concours Révu Et Corrigé PDFEsther Sheena MorencyPas encore d'évaluation
- Memoire Finale FinaleDocument56 pagesMemoire Finale FinaleHery Fifaliana TrimozafyPas encore d'évaluation
- Les Lois Votees Par La 48eme Legislature (Députés) 2006-2010Document2 pagesLes Lois Votees Par La 48eme Legislature (Députés) 2006-2010Laurette M. BackerPas encore d'évaluation
- Démocratie 1) Les ÉlectionsDocument2 pagesDémocratie 1) Les Électionsazerty56Pas encore d'évaluation
- Collectivités LocalesDocument4 pagesCollectivités LocalesdiourouPas encore d'évaluation
- Le Monde Du Dimanche 03 Et Lundi 04 Mai PDFDocument26 pagesLe Monde Du Dimanche 03 Et Lundi 04 Mai PDFrafimanePas encore d'évaluation
- Profession de Foi Bedreddine Montreuil 2e Tour 2011Document2 pagesProfession de Foi Bedreddine Montreuil 2e Tour 2011adrien_saumier5181Pas encore d'évaluation
- Lorganisation Administrative PDFDocument27 pagesLorganisation Administrative PDFSalsabil SendidPas encore d'évaluation
- Lettre de Munich N°55 - Printemps-Été 2013Document24 pagesLettre de Munich N°55 - Printemps-Été 2013Adfm MunichPas encore d'évaluation
- 477 Em02112011Document19 pages477 Em02112011elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Karim Wade, Une Tentation Dynastique Au SénégalDocument6 pagesKarim Wade, Une Tentation Dynastique Au Sénégalamadou_amathPas encore d'évaluation
- Simplification Bilan PDFDocument171 pagesSimplification Bilan PDFAnonymous zFNLnrcPas encore d'évaluation
- Liste Députation Provinciale - TanganyikaDocument73 pagesListe Députation Provinciale - TanganyikairgracierPas encore d'évaluation
- La Gazette Du Var 137Document28 pagesLa Gazette Du Var 137ADECOHAPas encore d'évaluation
- Livre AGO - Pourquoi J'y CroisDocument94 pagesLivre AGO - Pourquoi J'y CroisjacquesauxiettePas encore d'évaluation
- Int La Tunisie de Mes RevesDocument184 pagesInt La Tunisie de Mes Revesaad100% (1)
- PRESBY - Statuts Et ActesDocument56 pagesPRESBY - Statuts Et ActesEmmanuel Foka100% (1)
- La Face Cachee Des Revolutions ArabesDocument31 pagesLa Face Cachee Des Revolutions Arabeseric_fortune641250% (2)
- 640 Em03052012Document20 pages640 Em03052012elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Projet de Loi Portant Constitution RciDocument29 pagesProjet de Loi Portant Constitution Rcioro100% (1)
- Journal LE MONDE Et Suppl Du Vendredi 12 Octobre 2018Document38 pagesJournal LE MONDE Et Suppl Du Vendredi 12 Octobre 2018raabePas encore d'évaluation
- Maigret PDFDocument3 pagesMaigret PDFLucrezia MassaroPas encore d'évaluation