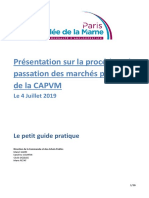Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Deloitte - Marches Locaux Et Calcul Des Parts de Marche
Deloitte - Marches Locaux Et Calcul Des Parts de Marche
Transféré par
respocomTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Deloitte - Marches Locaux Et Calcul Des Parts de Marche
Deloitte - Marches Locaux Et Calcul Des Parts de Marche
Transféré par
respocomDroits d'auteur :
Formats disponibles
Économie
RLC 3033
Marchés locaux et calcul des
parts de marché
Quand la concurrence est locale, l’analyse des autorités de concurrence se doit Par Ariane
de délimiter chaque marché local pertinent. Quels outils sont à la disposition CHARPIN(*))
des autorités de concurrence pour la définition des marchés locaux ? Quelle(s) Économiste
méthode(s) utiliser pour déterminer les parts de marché des entreprises sur de tels du cabinet
marchés ? MICROECONOMIX
La provenance des clients d’un détail- classiques utilisées, en identifiant leurs
lant ou d’une entreprise de service, qu’ils forces et leurs faiblesses.
s’adressent à des particuliers ou à des pro-
fessionnels, est souvent limitée géographi-
quement. Un supermarché, un coiffeur ou Enjeux en droit de la
une banque attirent des clients qui habitent
ou travaillent à proximité. Une entreprise
concurrence
de construction achète ses fournitures près De manière générale, l’analyse de la concur-
de son chantier. rence au niveau local a un sens dès lors
que les produits font face à une contrainte
La conséquence du point de vue concur-
spatiale forte, qu’elle provienne de la de-
rentiel est qu’un supermarché situé à Paris
mande ou de l’offre. La demande est locale
n’est pas en concurrence avec un autre si-
lorsque les consommateurs ne sont prêts
tué à Marseille car aucun client de Paris ne
qu’à parcourir une distance réduite pour se
décidera d’aller faire ses courses à Marseille
rendre dans un magasin. De même, l’offre
s’il juge les produits trop chers à Paris. La
est locale lorsqu’un fournisseur ne livre des
concurrence se joue donc à un niveau lo-
clients que dans un périmètre réduit.
cal. Pour l’analyser, on calcule les parts de
marché des entreprises sur des marchés L’étude de la concurrence au niveau local
géographiques locaux censés représenter est centrale dans les analyses des autorités
le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la de concurrence. Lorsque la concurrence se
demande d’un produit ou d’un service spé- joue localement, toute analyse commence
cifique. par la délimitation des marchés pertinents
locaux.
Cet article commence par présenter les
enjeux de l’analyse de la concurrence au En contrôle des concentrations, les auto-
niveau local pour la politique de la concur- rités de concurrence comparent, par zone
rence. Il explique ensuite les méthodes locale, les parts de marché des entreprises
concernées avant et après la fusion. Elles
déterminent ainsi si l’opération pourrait
(*) Avertissement : les opinions exprimées dans cet
avoir des effets anticoncurrentiels et iden-
article sont les opinions personnelles de l’auteur
et n’engagent en rien la responsabilité du cabinet tifient les zones potentiellement problé-
Microeconomix, ni a fortiori celle de ses clients. matiques.
Nº 53 SEPTEMBRE 2016 Revue Lamy de la concurrence 49
En contentieux, les parts de marché donnent une première
approximation du pouvoir de marché des entreprises. En
outre, l’impact d’ententes mises en œuvre localement
peut être estimé en comparant des zones de concurrence
locales non affectées par l’entente avec celles qui sont af-
fectées par l’entente.
Méthodes de délimitation des marchés
locaux
Pour bien comprendre le concept de marché géogra-
phique local, un exercice intéressant consiste à raisonner
dans le cadre du test du monopoleur hypothétique(1). Ce
test suit un processus itératif. On commence par choisir la
plus petite zone géographique possible autour du point de
vente dont on souhaite délimiter la zone de concurrence
locale. On calcule la rentabilité d’une légère et transitoire
hausse de prix sur ce marché du point de vue d’une entre-
prise hypothétique qui y serait en monopole. Si la hausse
de prix est rentable, alors le marché géographique local
est correctement délimité. Si non, il convient de l’élargir
Distance parcourue
pour intégrer d’autres points de vente. On recommence
ainsi de suite le test jusqu’à ce que la hausse de prix soit Une approche un peu plus réaliste consiste à délimiter
profitable. À la fin, on a délimité une zone de concurrence une zone de chalandise en identifiant tous les points aux-
locale. quels il est possible d’accéder en parcourant une même
distance sur le réseau routier à partir du point de vente
Le test du monopoleur hypothétique, s’il permet de bien
étudié. La carte ci-dessous représente par exemple une
comprendre le concept de concurrence sur une zone lo-
distance de 20 kilomètres en voiture autour du point de
cale, est difficile à mettre en œuvre en pratique. La zone
vente représenté par un gros point noir.
de chalandise en fournit une approximation pragma-
tique(2). Elle correspond à la zone dans laquelle se situe la
majorité des clients du point de vente.
Plusieurs méthodes classiques de délimitation et de re-
présentation des zones de chalandise se côtoient dans la
pratique de l’Autorité de la concurrence (ci-après, l’ADLC).
Distance à vol d’oiseau
L’approche la plus simple pour délimiter une zone de
chalandise consiste à tracer un cercle autour du point de
vente étudié. La zone colorée en gris sur la carte suivante
représente une distance à vol d’oiseau de 20 kilomètres
autour du point de vente, qui est représenté par un gros
point rouge. La carte permet d’identifier facilement les
autres magasins de la même entreprise (en noir) et les
magasins des concurrents (en bleu) situés dans la zone de
chalandise.
(1) Voir Charpin, A. (2016), L’indispensable test du monopoleur hypo-
thétique, RLC 2016/47, n° 2905.
(2) La zone de chalandise ne correspond pas exactement à la définition
Temps de parcours
de la zone de concurrence locale qui repose sur le test du monopo-
leur hypothétique. Devant les autorités de concurrence, des preuves
Il est également très courant de délimiter une zone de cha-
complémentaires à la zone de chalandise doivent donc être consi- landise en retenant un temps de parcours en voiture ou à
dérées lors de la définition du marché géographique pertinent. pied pour le consommateur. Contrairement aux autres,
50 Revue Lamy de la concurrence Nº 53 SEPTEMBRE 2016
Économie
cette méthode tient compte de la qualité du réseau routier tifier les coordonnées géographiques des points de vente de
et de la topographie du territoire. Sur la carte suivante, la l’entreprise et de ses concurrents, ce qui peut être effectué
zone en gris inclut les points auxquels il est possible d’accé- automatiquement à partir des adresses des magasins. Il faut
der en moins de 15 minutes en voiture à partir du magasin ensuite disposer d’un logiciel qui permet de calculer et de re-
étudié qui est représenté par le gros point noir. présenter des zones de chalandise sur des cartes.
La difficulté majeure de ces méthodes est qu’elles im-
pliquent de choisir un seuil pour délimiter la frontière de la
zone de chalandise. Ce choix n’est pas neutre ; le résultat
du calcul des parts de marché peut y être très sensible, en
particulier si de nombreux magasins sont situés en bor-
dure de zone.
Quel seuil retenir ?
Les choix effectués pour délimiter les zones de concur-
rence locales doivent reposer dans la mesure du possible
sur des preuves empiriques.
L’ADLC indique des seuils dans plusieurs secteurs dans les-
quels elle a eu l’occasion d’effectuer des analyses appro-
fondies dans le cadre du contrôle des concentrations. Ces
seuils peuvent servir de référence aux analyses concurren-
tielles sur des zones locales.
Une sélection des seuils retenus par l’ADLC est synthéti-
sée dans le tableau suivant, en distinguant les seuils qui
L’avantage principal de ces méthodes réside dans leur simpli- concernent des distances et ceux qui concernent des
cité. Pour les mettre en œuvre en pratique, il convient d’iden- temps de parcours.
Tableau 1 - Seuils retenus par l’ADLC
Secteur Délimitation de l’ADLC Sélection de références
DISTANCES
15-DCC-190
Distribution de produits alimentaires aux cafés, hôtels, 15-DCC-170
Entre 60 et 300 km
restaurants et aux commerces de proximité 15-DCC-141
15-DCC-80
Grossistes en sanitaire-chauffage livrant des matériaux 40 à 60 km et ne dépassant pas 30 minutes de 15-DCC-167
aux professionnels trajet en voiture 15-DCC-145
15-DCC-167
Distribution aux professionnels de matériel électrique 30 km
12-DCC-46
15-DCC-145
15-DCC-29
Négociants spécialistes en matériaux de construction 50 à 75 km
10-DCC-03
11-DCC-157
15-DCC-29
Négociants généralistes en matériaux de construction 50 km au plus
11-DCC-157
15-DCC-144
Collecte de porcs en vue de l’abattage 120 à 200 km (approximativement une région) 15-DCC-33
10-DCC-137
15-DCC-144
Marché des aliments complets pour la nutrition animale 100 à 150 km 15-DCC-127
15-DCC-52
Nº 53 SEPTEMBRE 2016 Revue Lamy de la concurrence 51
Secteur Délimitation de l’ADLC Sélection de références
15-DCC-127
Collecte de céréales, protéagineux et oléagineux Niveau départemental et zones de 45 km 15-DCC-52
15-DCC-34
14-DCC-37
Ventes de produits pétroliers hors réseau 100 à 150 km
11-DCC-13
Supérettes : 300 mètres à pied
Distribution alimentaire à Paris 14-DCC-173
Autres : 500 mètres à pied
TEMPS DE PARCOURS
30 minutes en voiture 16-DCC-18
16-DCC-14
Distribution alimentaire : hypermarchés 20 minutes en voiture autour des 16-DCC-11
hypermarchés situés en grande couronne ou 15-DCC-166
dans les villes de province 15-DCC-136
15 minutes en voiture 16-DCC-18
10 minutes en voiture pour les supermarchés 16-DCC-14
Distribution alimentaire : supermarchés et magasins situés en proche banlieue parisienne 16-DCC-11
discompteurs 10 et 15 minutes en voitures autour des 16-DCC-04
supermarchés situés en grande couronne ou 15-DCC-146
dans les villes de province 14-DCC-196
16-DCC-04
Distribution alimentaire : petit commerce de détail
10 minutes à pied 15-DCC-136
(supérettes)
14-DCC-173
10 minutes à pied pour les restaurants situés
dans Paris intramuros et dans les dix villes les
Restauration plus peuplées de France 15-DCC-170
commerciale rapide à bas-prix
10 minutes en voiture pour les restaurants
situés dans le reste de la France
15-DCC-155
Offre de diagnostics et de soins hospitaliers Entre 30 minutes en voiture et 1 heure
15-DCC-146
Centres auditifs 25 minutes en voiture 15-DCC-115
15 à 20 minutes en voiture pour les GSB entre
2 000 et 3 000 m2
30 minutes en voiture pour les points de vente
plus importants en superficie ou présentant
une taille relativement plus élevée par rapport 15-DCC-83
Distribution au détail d’articles de bricolage
aux concurrents immédiats ou bien encore 14-DCC-198
se trouvant à proximité d’un hypermarché
particulièrement attractif
40 minutes en voiture pour les magasins d’une
surface supérieure à 5 000 m2.
15-DCC-52
Distribution grand public de produits de jardinage, 15-DCC-34
20 minutes en voiture
bricolage, aménagements extérieurs et animalerie 10-DCC-144
12-DCC-49
Distribution au détail de produits d’ameublement, 15-DCC-28
de produits de bazar et de décoration et de produits 20 à 45 minutes en voiture 15-DCC-15
électrodomestiques 14-DCC-39
52 Revue Lamy de la concurrence Nº 53 SEPTEMBRE 2016
Économie
On constate que les critères retenus par l’ADLC diffèrent effectivement la zone d’attractivité du point de vente en
beaucoup d’un secteur à l’autre. Ils ont été définis à partir excluant uniquement des clients isolés.
des réponses à des tests de marché, qui consistent à in-
De manière générale, la sensibilité des résultats au seuil
terroger les entreprises d’un secteur, d’enquêtes menées
doit être examinée. Une zone de chalandise à 15 minutes
directement auprès de points de vente ou encore de l’ana-
peut donner des parts de marché très différentes d’une
lyse de l’emplacement des clients. Ils reposent donc sur
zone à 13 ou à 17 minutes si de nombreux magasins sont
des preuves objectives.
situés à la frontière de la zone. Dans les études marke-
ting, la zone de chalandise est d’ailleurs souvent divisée
Cependant, ils sont communs à tous les points de vente en zones primaire, secondaire et tertiaire correspondant
d’une industrie et ne reflètent donc pas forcément bien à des temps de parcours échelonnés (par exemple moins
la réalité de la concurrence locale pour chaque point de de 5 minutes, de 5 à 10 minutes et de 10 à 20 minutes).
vente.
Cette sensibilité est aisément étudiée à l’aide d’outils spé-
Puisqu’une zone de chalandise d’un magasin correspond à cifiques permettant de calculer les parts de marché sous
la zone dans laquelle se situe la majorité de ses clients, une diverses hypothèses.
possibilité pour choisir le seuil consiste à se fonder sur la
localisation des clients de ce point de vente, qui reflète la
distance que les clients sont prêts à parcourir. La localisa- Le calcul classique des parts de marché
tion des clients peut être obtenue en exploitant les moyens dans les zones de chalandise
de paiement, les cartes de fidélité ou par une demande de
code postal lors du passage en caisse. Cette méthode per- L’indicateur d’analyse de la concurrence le plus commu-
met d’adapter le seuil retenu à chaque magasin. nément utilisé est la part de marché.
Pour calculer la part de marché de chacune des entre-
L’ADLC retient fréquemment comme seuil le temps de prises présentes dans la zone de chalandise délimitée, le
parcours qui intègre 80 % des clients du point de vente plus simple consiste à compter le nombre de magasins
dans la zone(4). Elle veut ainsi identifier la zone d’attracti- de chaque entreprise. On peut également utiliser leurs
vité du point de vente, tout en excluant les clients qui re- chiffres d’affaires afin de mieux refléter le poids de chaque
présentent une clientèle ponctuelle et non représentative. magasin. Comme généralement cette information n’est
Le seuil de 80 % est bien-sûr arbitraire, mais une analyse pas disponible, on utilise la surface de vente ou d’autres
de sensibilité à ce seuil et une carte de la localisation des indicateurs (nombre de pompes d’une station-service,…)
clients permettent de se rendre compte s’il représente comme base d’approximation du chiffre d’affaires.
Tableau 2 - Exemple de calcul des parts de marché
PDM en nombre de PDM en surface de
Nombre de magasins Surfaces
magasins vente
Entreprise concernée 3 13 000 60 % 68 %
Entreprise concurrente 2 6 000 40 % 32 %
Total 5 19 000 100 % 100 %
À partir des parts de marché, on peut calculer un indica-
(3)
Aller plus loin dans le calcul des parts de
teur de la concentration dans la zone, l’indice de Herfin- marché
dahl-Hirschmann (HHI). Il consiste à additionner le carré
des parts de marché de toutes les entreprises de la zone. Cet article présente le calcul des parts de marché sur les
Son avantage est qu’il mesure la concurrence sur un mar- zones de concurrence locales délimitées en utilisant les
ché de manière synthétique. Il est utilisé par les autorités méthodes les plus couramment mises en œuvre. Ce calcul
de concurrence comme indicateur de la pression concur- classique des parts de marché sur une zone a le mérite
rentielle. de la simplicité, mais on peut lui reprocher de ne pas re-
présenter la concurrence de manière satisfaisante(4). En
(3) La méthode dite « des 80 % » est abordée notamment dans les dé-
cisions n° 15-DCC-167, n° 15-DCC-83, n° 14-DCC-71, n° 12-DCC-41, (4) Chapsal, A. et L. Eymard, Remarks on the calculation of local market
n° 12-DCC-46 et n° 15-DCC-145. shares, Concurrences, 1-2011, p. 37-41.
Nº 53 SEPTEMBRE 2016 Revue Lamy de la concurrence 53
particulier, il suffit de modifier légèrement le seuil pour rayon des zones de chalandise. Elle implique cependant de
que les parts de marché obtenues soient complètement supposer que les clients sont distribués de manière uni-
différentes. Une méthode qui mesurerait bien la concur- forme dans les zones de chalandise.
rence au niveau local ne devrait pas être si sensible aux
Cette hypothèse peut être relâchée en pondérant les
effets de seuil.
parts de marché par la surface de chevauchement des
Une faiblesse de la méthode classique du calcul des parts zones de chalandise ainsi que par la densité de population
de marché est qu’elle ne fait pas de différence entre les des zones de chalandise de chaque concurrent.
concurrents de la zone de chalandise. Pourtant, il semble
Une autre solution plus sophistiquée est de raisonner di-
qu’un magasin situé très proche du point de vente étu-
rectement à partir des clients. Elle consiste à effectuer
dié exerce une pression concurrentielle plus forte qu’un
une zone centrée sur chaque client de la zone de chalan-
magasin situé en bordure de zone puisque les magasins
dise du magasin étudié et à calculer les parts de marché
proches sont en concurrence pour plus de clients poten-
du point de vue de chaque client, puis d’agréger ces parts
tiels que les magasins éloignés.
de marché avec une pondération appropriée. Cette mé-
Une autre critique est que la méthode classique se place thode a l’avantage de tenir compte de la distribution des
du point de vue du magasin étudié et non du point du vue clients sur le territoire.
du consommateur. C’est pourtant ce dernier qui choisit
Elle peut être mise en œuvre à partir de la localisation
entre plusieurs points de vente en fonction de ses préfé-
réelle des clients ou de la simulation de la localisation de
rences. En centrant la zone de chalandise sur le magasin,
clients hypothétiques, comme cela a été fait dans l’avis de
le raisonnement fait comme si tous les consommateurs
l’ADLC relatif à la situation concurrentielle dans le secteur
du point de vente étaient situés précisément à ce point.
de la distribution alimentaire à Paris(6). Cette approche
Ce n’est bien sûr pas le cas et chaque consommateur évo-
n’a à ce jour été utilisée que dans une décision de l’ADLC
lue en fait dans une zone de chalandise qui lui est propre
(Monoprix/Casino(7)). Son potentiel n’a cependant été
et qui inclut potentiellement le point de vente étudié et
exploité que partiellement car elle a été mise en œuvre
d’autres points de vente qui peuvent ne pas être dans la
uniquement pour fournir une image globale des enseignes
zone de chalandise délimitée par la méthode classique. La
accessibles aux Parisiens ; la méthode classique a ensuite
méthode classique exclut donc des magasins qui font en
été utilisée pour identifier les zones de chalandise problé-
pratique concurrence au point de vente étudié puisqu’ils
matiques.
tentent d’attirer un même consommateur.
Une solution pour tenir compte de l’intensité concurren-
tielle exercée par chaque concurrent est de délimiter la
zone de chalandise de tous les magasins et de pondérer
Conclusion
la part de marché de chaque magasin par la surface de L’analyse de la concurrence sur des zones locales, qui se
chevauchement entre sa zone de chalandise et la zone de traduit notamment par la délimitation de zones de cha-
chalandise du magasin étudié(5). Ainsi, la pression concur- landise et le calcul de parts de marché dans ces zones,
rentielle exercée par chaque magasin sur le magasin étu- repose sur des méthodes standards simples à mettre en
dié est proportionnelle à ses clients situés dans la zone de œuvre lorsque l’on dispose des outils adaptés.
chalandise.
Des méthodes de calcul des parts de marché légèrement
Cette méthode permet de tenir compte de l’impact de plus sophistiquées existent et pourraient être utilisées
la distance des concurrents. En outre, elle conduit à une relativement facilement afin de mieux refléter l’intensité
continuité des parts de marché lorsque l’on fait varier le concurrentielle au niveau local.
(6) Aut. conc., avis n° 12-A-01, 11 janv. 2012, relatif à la situation
concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris,
encadré p. 32 et 33.
(7) Aut. conc., déc. n° 13-DCC-90, 11 juill. 2013, relative à la prise de
(5) de Muizon, G., Concurrence et niveau des prix dans la grande distri- contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Gui-
bution, Concurrences, 2-2012. chard-Perrachon.
54 Revue Lamy de la concurrence Nº 53 SEPTEMBRE 2016
Vous aimerez peut-être aussi
- Comment réaliser une étude de marché ?: Lancez votre projet d’entreprise en toute connaissance de causeD'EverandComment réaliser une étude de marché ?: Lancez votre projet d’entreprise en toute connaissance de causeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Business Model Canvas: Élaborer une stratégie de développementD'EverandBusiness Model Canvas: Élaborer une stratégie de développementÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Le benchmarking: S'inspirer des plus grands pour évoluerD'EverandLe benchmarking: S'inspirer des plus grands pour évoluerPas encore d'évaluation
- Les 5 forces de Porter: Comprendre les sources des avantages concurrentielsD'EverandLes 5 forces de Porter: Comprendre les sources des avantages concurrentielsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Eyrolles - Tableaux de Bord - Outils de PerformanceDocument212 pagesEyrolles - Tableaux de Bord - Outils de PerformanceMaminiaina ANDRIANAVELONA50% (2)
- La Zone de ChalandiseDocument12 pagesLa Zone de Chalandiseamadounicolas diopPas encore d'évaluation
- Parc Walibi ConvertiDocument7 pagesParc Walibi ConvertiKhadija BoufalaPas encore d'évaluation
- La Procédure D'appel D'offres Dans Les Marchés PublicsDocument14 pagesLa Procédure D'appel D'offres Dans Les Marchés PublicsFrance Marchés100% (1)
- Cours DUT TC2 Marketing Du Point de VenteDocument7 pagesCours DUT TC2 Marketing Du Point de VenteAartang0% (2)
- Le Bon Accord avec le Bon Fournisseur: Comment Mobiliser Toute la Puissance de vos Partenaires Commerciaux pour Réaliser vos ObjectifsD'EverandLe Bon Accord avec le Bon Fournisseur: Comment Mobiliser Toute la Puissance de vos Partenaires Commerciaux pour Réaliser vos ObjectifsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Guide Procedure Passation Marches PublicsDocument16 pagesGuide Procedure Passation Marches PublicsSpéro FaladePas encore d'évaluation
- Merchandising PDFDocument1 pageMerchandising PDFvdvfPas encore d'évaluation
- Cours Etude de ConcurrenceDocument22 pagesCours Etude de ConcurrenceDelphine BAUDARTPas encore d'évaluation
- Cours Etudier La Zone de ChalandiseDocument16 pagesCours Etudier La Zone de ChalandiseDelphine BAUDARTPas encore d'évaluation
- DRCVC - TD GifiDocument9 pagesDRCVC - TD GifiSacha Cohen100% (1)
- IntroductionDocument2 pagesIntroductionMryouL BmlPas encore d'évaluation
- Analyser La ConcurrenceDocument4 pagesAnalyser La Concurrenceperico1962Pas encore d'évaluation
- La Zone de ChalandiseDocument10 pagesLa Zone de ChalandiseSaid Yahiatene100% (1)
- Résumé - Marketing Stratégique PDFDocument15 pagesRésumé - Marketing Stratégique PDFYoussefOulaajeb64% (11)
- Cours de Geomarketing 2021Document83 pagesCours de Geomarketing 2021Mawa Ndiaye100% (4)
- Rapport de Stage Kouyate Mohamed LDocument34 pagesRapport de Stage Kouyate Mohamed Lعمر عمريPas encore d'évaluation
- M12 Merchandising TER ATVDocument48 pagesM12 Merchandising TER ATVAbdo Slimane67% (6)
- Communication Interne Et Externe CoursDocument12 pagesCommunication Interne Et Externe CoursNassim Ksouri75% (4)
- Corrigé Cas AuchanDocument10 pagesCorrigé Cas AuchanChloé JudicPas encore d'évaluation
- Marchandising Et Gestion Des RayonsDocument25 pagesMarchandising Et Gestion Des Rayonsarsene ananiPas encore d'évaluation
- Economie de La Concurrence L3 AESDocument23 pagesEconomie de La Concurrence L3 AESjulia1407Pas encore d'évaluation
- M15 Merchandising TERATVDocument51 pagesM15 Merchandising TERATVlamsatfijalal100% (1)
- Merchandising 3Document38 pagesMerchandising 3Abdelali Abarkan100% (1)
- La Zone de ChalandiseDocument4 pagesLa Zone de ChalandiseSara Belayachi100% (2)
- BTS 2012 E5 Mediatables SujetDocument14 pagesBTS 2012 E5 Mediatables SujetMargo NPas encore d'évaluation
- Etude de La Zone de ChalandiseDocument11 pagesEtude de La Zone de ChalandiseÖmer AghPas encore d'évaluation
- Rapport Techniques de VenteDocument11 pagesRapport Techniques de Ventesekkat salmaPas encore d'évaluation
- Marketing International-Chap 4 - La Politique Internationale de PrixDocument19 pagesMarketing International-Chap 4 - La Politique Internationale de PrixBernhard Adriaensens100% (3)
- Etude de Cas Meuh ColaDocument2 pagesEtude de Cas Meuh ColaOliver VADELEUX100% (1)
- Realização de estudos de mercado: A chave para um bom negócio reside no planeamentoD'EverandRealização de estudos de mercado: A chave para um bom negócio reside no planeamentoPas encore d'évaluation
- BTS - Module 2A - Marche de l' Apres-VenteDocument12 pagesBTS - Module 2A - Marche de l' Apres-Ventealves pereiraPas encore d'évaluation
- La Zone de ChalandiseDocument4 pagesLa Zone de ChalandiseAli FousshiPas encore d'évaluation
- Définition: D'après l'IFM (Institut Français Du Marchandisage), LeDocument6 pagesDéfinition: D'après l'IFM (Institut Français Du Marchandisage), LeNouheila BouPas encore d'évaluation
- Synthese Etude Zone de Chalandise UFC QCDocument28 pagesSynthese Etude Zone de Chalandise UFC QCgilles_evrardPas encore d'évaluation
- 532 C 44 B 66 AbceDocument19 pages532 C 44 B 66 AbceAlami FatiPas encore d'évaluation
- Mettre en Oeuvre Une Veille Concurrentielle Le Marketing Achat 14112006 1Document16 pagesMettre en Oeuvre Une Veille Concurrentielle Le Marketing Achat 14112006 1atoufhiba20Pas encore d'évaluation
- Les Marchés Publics Passés Sans Publicité Ni Mise en Concurrence Et Les Marchés Publics À Procédure Adaptée Fondamentaux JuridiquesDocument26 pagesLes Marchés Publics Passés Sans Publicité Ni Mise en Concurrence Et Les Marchés Publics À Procédure Adaptée Fondamentaux JuridiquesMustapha MimouvePas encore d'évaluation
- CHAPITRES 4 ET 5 GESCOM L2 SOA Nov 2021Document21 pagesCHAPITRES 4 ET 5 GESCOM L2 SOA Nov 2021Ornel DJEUDJI NGASSAMPas encore d'évaluation
- M1co Exercice de SyntheseDocument13 pagesM1co Exercice de SyntheseHarinjaka HajaniainaPas encore d'évaluation
- TSC M110 Merchandising CMDocument49 pagesTSC M110 Merchandising CMVILGAX F F100% (1)
- Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès Ecole Supérieure de TechnologieDocument21 pagesUniversité Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès Ecole Supérieure de TechnologieMac de BasmaPas encore d'évaluation
- MerchandinsingDocument10 pagesMerchandinsingMeryem ZaradiPas encore d'évaluation
- Deuxieme PartieDocument22 pagesDeuxieme Partiegéraldine guéiPas encore d'évaluation
- Geomarketing Explique PDFDocument8 pagesGeomarketing Explique PDFMimoun KandoussiPas encore d'évaluation
- Etude de La Zone de ChalandiseDocument4 pagesEtude de La Zone de ChalandisemasmoudiPas encore d'évaluation
- m212 MerchandisingDocument94 pagesm212 MerchandisingSanae OubelaidPas encore d'évaluation
- Pour Les Marches Publics de Fournitures Et ServicesDocument9 pagesPour Les Marches Publics de Fournitures Et Servicesbenth alexPas encore d'évaluation
- Indus CCDocument31 pagesIndus CCtml137310Pas encore d'évaluation
- DQE Détail Quantitatif Estimatif Consultant Collectivité Audit Marches Publics Informatique DefinitionDocument2 pagesDQE Détail Quantitatif Estimatif Consultant Collectivité Audit Marches Publics Informatique DefinitionlecouveyPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document5 pagesChapitre 3Arthur GiraudPas encore d'évaluation
- CM - 3 - Initiation MKG Diagnostic MKGDocument61 pagesCM - 3 - Initiation MKG Diagnostic MKGvictor100% (1)
- PPPPPDocument12 pagesPPPPPTafardoust Khalil100% (1)
- 11-Atelier - Le Prix Dans Les Marches PublicsDocument26 pages11-Atelier - Le Prix Dans Les Marches PublicsAnnette AgbPas encore d'évaluation
- Distribution KedgeDocument56 pagesDistribution KedgeMaya NdiayePas encore d'évaluation
- Offre Anormalement BasseDocument6 pagesOffre Anormalement BassemohamedPas encore d'évaluation
- Merchandising GEOCMDocument85 pagesMerchandising GEOCMsouiken mohammedPas encore d'évaluation
- m2 Le Marche Cahier de ChargeDocument15 pagesm2 Le Marche Cahier de ChargeMohamed LounesPas encore d'évaluation
- Guide Vérification Des Prix Des Marchés Publics - V12 - 20181206Document23 pagesGuide Vérification Des Prix Des Marchés Publics - V12 - 20181206Marouan BenyPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Diagnostic Et Etudes Des Marchés InternationauxDocument4 pagesChapitre 3 - Diagnostic Et Etudes Des Marchés Internationauxnathan_deverrePas encore d'évaluation
- Stratégie Industrielle s6Document19 pagesStratégie Industrielle s6Erraji AbdelhakPas encore d'évaluation
- OAB-Charte FFB-Villes de France-2015Document5 pagesOAB-Charte FFB-Villes de France-2015vladPas encore d'évaluation
- Tarification géographique: Libérer la rentabilité sur le marché mondial, un guide de tarification géographiqueD'EverandTarification géographique: Libérer la rentabilité sur le marché mondial, un guide de tarification géographiquePas encore d'évaluation
- Compteur de personnes: Libérer des informations grâce à l'analyse visuelleD'EverandCompteur de personnes: Libérer des informations grâce à l'analyse visuellePas encore d'évaluation
- Entreprise de distributeurs automatiques: Comment commencer à gagner de l’argent avec les distributeurs automatiquesD'EverandEntreprise de distributeurs automatiques: Comment commencer à gagner de l’argent avec les distributeurs automatiquesPas encore d'évaluation
- Marketing s2 l3Document10 pagesMarketing s2 l3mathurakinimuruPas encore d'évaluation
- Volet 3 - Comportement Consomateur Et Stratégies de CommunicationDocument21 pagesVolet 3 - Comportement Consomateur Et Stratégies de CommunicationSamira TaziPas encore d'évaluation
- UQAM-Montreal - Événements Spéciaux - 2021Document20 pagesUQAM-Montreal - Événements Spéciaux - 2021Younés BhdPas encore d'évaluation
- WWW - Cours Gratuit - Com Id 9911Document8 pagesWWW - Cours Gratuit - Com Id 9911Osmän Abdøu IbrPas encore d'évaluation
- Présentation Sur Les Typologies StratégiquesDocument22 pagesPrésentation Sur Les Typologies StratégiquesIkram EI HARROUNI ALAOUIPas encore d'évaluation
- Cours MARING OPERELDocument36 pagesCours MARING OPERELغون زولديكPas encore d'évaluation
- La GRC PDFDocument9 pagesLa GRC PDFBAC MENPSPas encore d'évaluation
- Mediakit 01.03.2022-CompresséDocument17 pagesMediakit 01.03.2022-CompresséF Guillaume JarryPas encore d'évaluation
- PDF Etude de Lancement Dx27un Nouveau Produit Bancaire DDDocument92 pagesPDF Etude de Lancement Dx27un Nouveau Produit Bancaire DDAymen alhyanPas encore d'évaluation
- Chapitre Indroductif MarketingDocument50 pagesChapitre Indroductif MarketingAbdelkarim FikriPas encore d'évaluation
- NumeriFOS PrendreDesNotesPourUnCompteRendu B2 1h APPDocument3 pagesNumeriFOS PrendreDesNotesPourUnCompteRendu B2 1h APPJanviMehtaPas encore d'évaluation
- Module Stracom Ce Iut-UtaDocument39 pagesModule Stracom Ce Iut-UtaSadickPas encore d'évaluation
- Chap 1 Et 2 Presentation Du Concept deDocument8 pagesChap 1 Et 2 Presentation Du Concept decontactmoribaPas encore d'évaluation
- Projet de RechercheDocument5 pagesProjet de RecherchehananPas encore d'évaluation
- Yabiso Business Plan PDFDocument16 pagesYabiso Business Plan PDFAhimana zéphirinPas encore d'évaluation
- Exposé BCG FinalDocument7 pagesExposé BCG FinalAdil BentalebPas encore d'évaluation
- EBTC Calendrier de Formation Février-Avril 2023.cleanedDocument5 pagesEBTC Calendrier de Formation Février-Avril 2023.cleanedfedor remyPas encore d'évaluation
- Cours - Actions Et Outils de Communication (Digitale)Document13 pagesCours - Actions Et Outils de Communication (Digitale)Kentache AtmanPas encore d'évaluation
- Recrutement D'un Directeur Retail & InnovationDocument1 pageRecrutement D'un Directeur Retail & InnovationMoniquePas encore d'évaluation
- Les Programmes D'appui À La Création D'entreprise-Cas de FORSADocument37 pagesLes Programmes D'appui À La Création D'entreprise-Cas de FORSAMeriem ChPas encore d'évaluation
- Analyse de Marketing Opérationnel Mrani Alaoui KawtarDocument8 pagesAnalyse de Marketing Opérationnel Mrani Alaoui KawtarKawtar AlaouiPas encore d'évaluation