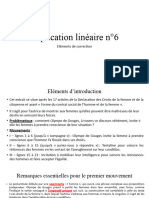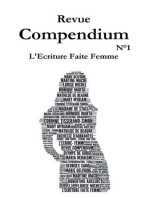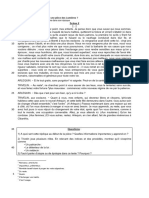Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Texte 3 - Postambule 2eme Partie
Texte 3 - Postambule 2eme Partie
Transféré par
hugo TUILLIERCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Texte 3 - Postambule 2eme Partie
Texte 3 - Postambule 2eme Partie
Transféré par
hugo TUILLIERDroits d'auteur :
Formats disponibles
Introduction :
Olympe de Gouges a vécu à la fin du 18 siècle. C’est une auteure, écrivaine, dramaturge,
ème
pamphlétaire, appartenant au mouvement des Lumières. Elle a longuement lutté pour
l'émancipation de la femme, pour la reconnaissance de sa place sociale et politique . Elle est
principalement connue pour avoir écrit la DDFC en 1791, un pastiche de la DDHC. Cette
littérature d’idée promue l’émancipation des femmes ainsi que l’égalité entre les deux sexes. Le
passage que nous allons étudier est la deuxième partie du postambule où Olympe de Gouges
critique à la fois les hommes qui sont responsables de la condition des femmes mais elle critique
également les femmes qui ont œuvré à la corruption de la société.
Projet de lecture : Quel changement cet extrait propose-t-il à travers la dénonciation
formulée ?
Axes :
I- l1 à 10 – Le paradoxe : critique des femmes
II- l11 à 21 – L’assujettissement des femmes
III- l22 à 27 – Comparaison entre les femmes et les esclaves
I- Le paradoxe : critique des femmes :
o Effet de surprise « Les femmes ont fait plus de mal que de bien »
Affirmation choque qui contredit totalement son combat féministe qu’elle
promue.
o Antithèse et parallélisme « Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu »
Les femmes ont été contraintes d’utiliser la « ruse » car elles étaient
oppressées par la « force » de hommes.
o Gradation provocatrice « ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat,
cardinalat »
Sous l’Ancien Régime avec l’utilisation de la ruse, les femmes accédaient aux
plus hautes instances du pouvoir mais Olympe de Gouges se moquent des
hommes qui se croient libre lorsqu’ils sont manipulés par celles qui les
méprisent.
Elle les dépeint de manière très dépréciatif « orgueilleux » « serviles
adorateurs » « la sottise des hommes »
o Imparfait « résistait » « était » « commandaient »
Temps révolu.
o Chiasme « ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la Révolution, respectable et
méprisé »
Montre le paradoxe de la Révolution aux yeux d’Olympe de Gouges, selon
elle avant la Révolution les hommes prenaient en considération les femmes
mais cette considération avait été perdue après la Révolution.
Comme si leur combat avait été inutile.
II- L’assujettissement des femmes :
o Exclamation « Dans cette sorte d’antithèse, que de remarques n’ai-je point à offrir ! »
Elle reconnait ce paradoxe et met en scène son discours afin d’attirer
l’attention.
o Négation restrictive et futur de l’indicatif « Je n’ai qu’un moment pour les faire, mais ce
moment fixera l’attention de la postérité la plus reculée. »
Montre l’importance et l’urgence du combat mais l’utilisation du futur et du
superlatif témoignent de l’espoir que porte l’auteure.
o Louer et blâmer « Sous l’Ancien Régime, tout était vicieux, tout était coupable »
Description dépréciative de la monarchie qui est au service de la dénonciation
exprimée.
o Négation restrictive – antithèse « Une femme n’avait besoin que d’être belle ou aimable,
quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait cent fortunes à ses pieds. »
La beauté permettait à la femme de se garantir une place dans la haute société
mais cela met en valeur, la corruption, la femme devait plaire aux hommes
pour avoir une place dans la société. Elles étaient donc soumises à une sorte
de prostitution.
o Imparfait d’habitude « le commerce des femmes était … »
Situation révolue.
o Futur prophétique « qui, désormais, n’aura plus de crédit. »
Les femmes connaitront l’émancipation.
III- Comparaison entre les femmes et les esclaves :
o Comparaison « la femme que l’homme achète, comme l’esclave sur les côtés d’Afrique »
L’auteure compare l’esclavage des femmes à la traite des esclaves achetés en
Afrique, elle militait également pour l’abolition de l’esclavage. Elle créée
donc un parallèle entre les oppressions sexistes et racistes. Cette comparaison
est très dévalorisante pour les femmes.
o Atténuation « La différence est grande »
Afin de ne pas choquer.
o Réification des femmes « jouet »
La réification des femmes souligne leur impuissance lorsqu’elles ont perdu
leurs charmes.
o Discours direct « elle est pauvre et vieille, dit-on ; pourquoi n’a-t-elle pas su faire fortune ? »
Olympes de Gouges fait entendre le mépris collectif dont est victime une
femme qui lutte contre les hommes.
L’argumentation passe ainsi par le récit, qui donne vie au discours et
suscite l’empathie mais également la révolte.
Vous aimerez peut-être aussi
- OLYMPE de GOUGES - Explication Linéaire - Femme Réveille-Toi - LLélèveDocument11 pagesOLYMPE de GOUGES - Explication Linéaire - Femme Réveille-Toi - LLélèvebehohi6595Pas encore d'évaluation
- 02-Fiche de Révision Olympe de Gouges PostambuleDocument2 pages02-Fiche de Révision Olympe de Gouges PostambuleArthur DhellemmesPas encore d'évaluation
- 1 - Explication Linéaire Postambule Olympe de GougeDocument3 pages1 - Explication Linéaire Postambule Olympe de GougeBRUNEPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire - Olympe de Gouge, Extrait Du Postambule, Déclaration de La Femme Et de La Citoyenne, 1791Document5 pagesLecture Linéaire - Olympe de Gouge, Extrait Du Postambule, Déclaration de La Femme Et de La Citoyenne, 1791mohamed100% (1)
- Pour Une Histoire Comparée Des Sociétés EuropéennesDocument32 pagesPour Une Histoire Comparée Des Sociétés EuropéennesAnalice Marinho100% (1)
- Publications-Manuel D Histoire CritiqueDocument463 pagesPublications-Manuel D Histoire CritiqueNicolas Dally100% (3)
- Vodou Guy Maxi Mi LienDocument127 pagesVodou Guy Maxi Mi LienSarahjames Ja86% (22)
- ThalyDocument11 pagesThalyfidinhoPas encore d'évaluation
- Séance 6 - LL n5 - Le Postambule Le Tableau Des FemmesDocument4 pagesSéance 6 - LL n5 - Le Postambule Le Tableau Des Femmesshaheermasih100% (1)
- Texte 5 - MémoiresDocument3 pagesTexte 5 - Mémoireshugo TUILLIERPas encore d'évaluation
- Texte 2 - Postambule 1ere PartieDocument2 pagesTexte 2 - Postambule 1ere Partiehugo TUILLIERPas encore d'évaluation
- Analyse POSTAMBULE DDFCDocument2 pagesAnalyse POSTAMBULE DDFCmeriemtouil.803Pas encore d'évaluation
- EL Postambule Olympe de GougesDocument2 pagesEL Postambule Olympe de GougesMrsidox5Pas encore d'évaluation
- ANALYSE DDFC, Olympe de Gouges, Postambule (Du Début À Qu'à Le Vouloir )Document3 pagesANALYSE DDFC, Olympe de Gouges, Postambule (Du Début À Qu'à Le Vouloir )clairepannier28Pas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 3Document2 pagesLecture Linéaire 3matuszak.carlaPas encore d'évaluation
- Synthese GougesDocument8 pagesSynthese GougesNagore RiveroPas encore d'évaluation
- Analyse 3 GougesDocument6 pagesAnalyse 3 GougesahlaamPas encore d'évaluation
- Postambule 2 (Extrait de La DDFC)Document2 pagesPostambule 2 (Extrait de La DDFC)tazoukpersoPas encore d'évaluation
- Analyse Postambule - Olympe de GougesDocument5 pagesAnalyse Postambule - Olympe de GougesAndrea OrtizPas encore d'évaluation
- Cours EL 7 DDFC ÉlèvesDocument4 pagesCours EL 7 DDFC ÉlèvesessertaizeemmaPas encore d'évaluation
- Commentaire Louise Michel TAOUFIK BasmaDocument5 pagesCommentaire Louise Michel TAOUFIK Basmabasma.taoufik2005Pas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 7Document4 pagesLecture Linéaire 72nmb6242fgPas encore d'évaluation
- Corrigée Lecture-Linéaire N 5Document4 pagesCorrigée Lecture-Linéaire N 5Second accountPas encore d'évaluation
- Postambule DDFCDocument11 pagesPostambule DDFCleolenne08Pas encore d'évaluation
- FRA Lecture Linéaire n11Document2 pagesFRA Lecture Linéaire n11rorogueullePas encore d'évaluation
- Analyse DissertationDocument3 pagesAnalyse Dissertationclairepannier28Pas encore d'évaluation
- Modele Gouges 3Document6 pagesModele Gouges 3geoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Le PostambuleDocument3 pagesLe PostambuleLORETPas encore d'évaluation
- OG Texte 3 - Explication Linã©aireDocument8 pagesOG Texte 3 - Explication Linã©airew8sk6tdc65Pas encore d'évaluation
- Ana. Linéaire Debut PostambuleDocument2 pagesAna. Linéaire Debut Postambulekml mdPas encore d'évaluation
- Olympe de Gouge, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyenneDocument3 pagesOlympe de Gouge, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyennetroallicPas encore d'évaluation
- DDFC Texte 3 (Postambule 2)Document4 pagesDDFC Texte 3 (Postambule 2)IvoPas encore d'évaluation
- PP - Explication Linéaire N°6Document9 pagesPP - Explication Linéaire N°6theoroland2007Pas encore d'évaluation
- UntitledDocument5 pagesUntitledRita JennanePas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 3 ODG PostambuleDocument4 pagesLecture Linéaire 3 ODG Postambulemaya.weberPas encore d'évaluation
- Bac Olympe de Gouges PDFDocument9 pagesBac Olympe de Gouges PDFMarwa KhabetPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire Olympe de GDocument5 pagesAnalyse Linéaire Olympe de GhyfjvsyvddPas encore d'évaluation
- Analyse de Postambule de La DDFC: Raison L'univers Le Flambeau de La VéritéDocument2 pagesAnalyse de Postambule de La DDFC: Raison L'univers Le Flambeau de La VéritéChim Chim My Little Fairy100% (2)
- Dissertation Dialectique ODG 1Document8 pagesDissertation Dialectique ODG 1cemilefatmadenizPas encore d'évaluation
- Proposition de Dissertation Sur Olympe de GougesDocument2 pagesProposition de Dissertation Sur Olympe de Gougesseffah100% (2)
- Analyse Linéaire Postambule 1ère DDFCDocument5 pagesAnalyse Linéaire Postambule 1ère DDFCLiliana Cabrera100% (1)
- FR Analyse PostambuleDocument3 pagesFR Analyse Postambuleviator P.NPas encore d'évaluation
- 1080 Olympe de GougesDocument2 pages1080 Olympe de Gougesmathisriquelme242Pas encore d'évaluation
- Étude Linéaire Postambule GougesDocument3 pagesÉtude Linéaire Postambule GougesgeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Sujet DissertationDocument5 pagesSujet DissertationMhmd KhaskiehPas encore d'évaluation
- Explication Linéaire N - 10 - Postambule Olympes de GougesDocument5 pagesExplication Linéaire N - 10 - Postambule Olympes de Gougeshafidiyazid07Pas encore d'évaluation
- À L'orée de L'ère de La Femme, Lynchage, Empire Et Sexualité Dans La Théorie Du Féminisme Noir Hazel V. CarbyDocument16 pagesÀ L'orée de L'ère de La Femme, Lynchage, Empire Et Sexualité Dans La Théorie Du Féminisme Noir Hazel V. CarbyAnonymous LOcT0gjqdSPas encore d'évaluation
- Olympe de Gouges EL Extrait 3 Postambule MilieuDocument4 pagesOlympe de Gouges EL Extrait 3 Postambule MilieujujuPas encore d'évaluation
- VoltaireDocument7 pagesVoltairelola.viollePas encore d'évaluation
- Canva Docs Fiche de Cours Dans Un Style Professionnel Et Vivant en Rouge Et OrangeDocument3 pagesCanva Docs Fiche de Cours Dans Un Style Professionnel Et Vivant en Rouge Et OrangeAurore BeffPas encore d'évaluation
- Explication Linéaire: Postambule, de La DDFCDocument5 pagesExplication Linéaire: Postambule, de La DDFCClaraPas encore d'évaluation
- Modele Gouges 1Document3 pagesModele Gouges 1geoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Commentaire Olympe de Gouge - PostambuleDocument3 pagesCommentaire Olympe de Gouge - PostambuleClea BESSET100% (2)
- Corrigé 4 - MaquetteDocument3 pagesCorrigé 4 - Maquetteoripori2804Pas encore d'évaluation
- Littérature D'idees, Olympe de GougesDocument4 pagesLittérature D'idees, Olympe de Gougesoipeixeboidigaoi1Pas encore d'évaluation
- EseufrDocument3 pagesEseufrBianca BarbuPas encore d'évaluation
- EAF 4 Postambule TXT Et AnalyseDocument5 pagesEAF 4 Postambule TXT Et Analysetexiane974Pas encore d'évaluation
- Histoire de La ViriliteDocument16 pagesHistoire de La ViriliteJay Laino100% (1)
- DDFC 2 Sujets TraitésDocument8 pagesDDFC 2 Sujets TraitésMathias BPas encore d'évaluation
- Spé Moderne Jeudi (Schaub)Document20 pagesSpé Moderne Jeudi (Schaub)nightlover2087Pas encore d'évaluation
- S7. LL2. Tableau ProfDocument5 pagesS7. LL2. Tableau ProfLuis LopezPas encore d'évaluation
- De L'archétype de La Sorcière À La Condition Féminine de L'extrême ContemporainDocument3 pagesDe L'archétype de La Sorcière À La Condition Féminine de L'extrême ContemporainDora CernauPas encore d'évaluation
- La Femme doit-elle voter? (Le pour et le contre): Thèse pour le doctorat ès sciences politiques et économiquesD'EverandLa Femme doit-elle voter? (Le pour et le contre): Thèse pour le doctorat ès sciences politiques et économiquesPas encore d'évaluation
- Revue Compendium: Semestriel Janvier 2018, #1D'EverandRevue Compendium: Semestriel Janvier 2018, #1Pas encore d'évaluation
- Texte 10 - L'OeuvreDocument2 pagesTexte 10 - L'Oeuvrehugo TUILLIERPas encore d'évaluation
- Texte 12 - Vernon SubutexDocument2 pagesTexte 12 - Vernon Subutexhugo TUILLIERPas encore d'évaluation
- Texte 2 - Postambule 1ere PartieDocument2 pagesTexte 2 - Postambule 1ere Partiehugo TUILLIERPas encore d'évaluation
- Texte 14 - Le PrologueDocument2 pagesTexte 14 - Le Prologuehugo TUILLIERPas encore d'évaluation
- P1 LL2 Postambule 1ere PartieDocument1 pageP1 LL2 Postambule 1ere Partiehugo TUILLIERPas encore d'évaluation
- Yakuzas T2 Vengeance Mortelle (Cyril Vial) (Z-Library)Document267 pagesYakuzas T2 Vengeance Mortelle (Cyril Vial) (Z-Library)4nn4fx9hqrPas encore d'évaluation
- Amidu Magasa Papa Commandant 1978Document157 pagesAmidu Magasa Papa Commandant 1978jeanmariepaulPas encore d'évaluation
- Ali BabaDocument10 pagesAli BabaNabil Ouled AhmedPas encore d'évaluation
- 4e Theme 1 ACTIVITE ST Domingue Commerce TriangulaireDocument21 pages4e Theme 1 ACTIVITE ST Domingue Commerce Triangulairenatacha59495Pas encore d'évaluation
- Etude de Texte ch19 Candide Seq5Document3 pagesEtude de Texte ch19 Candide Seq5manal kirechPas encore d'évaluation
- Séance 4 - Pièce Des LumièresDocument2 pagesSéance 4 - Pièce Des Lumièresclementmairesse17Pas encore d'évaluation
- Teh Etude Accords Regionaux TDR Et Cahier Des ChargesDocument8 pagesTeh Etude Accords Regionaux TDR Et Cahier Des ChargesAnes HamoudaPas encore d'évaluation
- Bien Agir, L'appel de L'aventureDocument3 pagesBien Agir, L'appel de L'aventurecel.haddadPas encore d'évaluation
- Fiche ÉlèveDocument2 pagesFiche ÉlèveMarie-Laure JegerlehnerPas encore d'évaluation
- Lewis Howard Latimer - WikipédiaDocument17 pagesLewis Howard Latimer - WikipédiaKouassi EmmanuelPas encore d'évaluation
- Le Développement de L'économie Sucrière Et de L'esclavage Dans Les Iles Portugaises Et Au BrésilDocument2 pagesLe Développement de L'économie Sucrière Et de L'esclavage Dans Les Iles Portugaises Et Au BrésilVanessa FerreiraPas encore d'évaluation
- Paul Allard Les Origines Du Servage en FranceDocument334 pagesPaul Allard Les Origines Du Servage en FranceneirotsihPas encore d'évaluation
- Dissert Entrainement 3 CorrigeDocument7 pagesDissert Entrainement 3 CorrigeAbdousalam OUMA MAHAMATPas encore d'évaluation
- COURS DE DESALIENATION N°18 Willy LynchDocument2 pagesCOURS DE DESALIENATION N°18 Willy LynchNicolas MenyiéPas encore d'évaluation
- Le Code Noir de Colbert - Mars 1685Document8 pagesLe Code Noir de Colbert - Mars 1685Lun_ElectroniquePas encore d'évaluation
- Candide Chapitre 19Document4 pagesCandide Chapitre 19lina znatiPas encore d'évaluation
- Histoire Moderne Fascicule L1.UE3Document12 pagesHistoire Moderne Fascicule L1.UE3massimojitoPas encore d'évaluation
- Leçon Chapitre 1Document4 pagesLeçon Chapitre 1MarinésPas encore d'évaluation
- (Textes À L'appui) Boubacar Barry - Le Royaume Du Waalo, Le Sénégal Avant La Conquête-F. Maspero (1972)Document418 pages(Textes À L'appui) Boubacar Barry - Le Royaume Du Waalo, Le Sénégal Avant La Conquête-F. Maspero (1972)dieyemamadou937Pas encore d'évaluation
- French-Based CreolesDocument9 pagesFrench-Based CreolesGeorgy KhabarovskiyPas encore d'évaluation
- Esclavage ModerneDocument6 pagesEsclavage ModerneYasouzPas encore d'évaluation
- Bac SVTDocument2 pagesBac SVTAhmed MenassiPas encore d'évaluation
- L'histoire Du MarocDocument377 pagesL'histoire Du MarocAmi Ine100% (1)
- Blues - Livret-Activité PDFDocument31 pagesBlues - Livret-Activité PDFSugar Moon SugarPas encore d'évaluation
- Les Négriers en Terres D - IslamDocument290 pagesLes Négriers en Terres D - IslamaliPas encore d'évaluation
- Léonard de Vinci, Fils D'une EsclaveDocument3 pagesLéonard de Vinci, Fils D'une EsclavemafournierPas encore d'évaluation