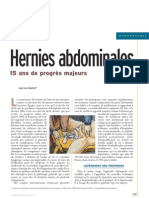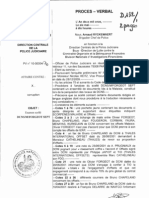Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le pneumopéritoine en laparoscopie
Le pneumopéritoine en laparoscopie
Transféré par
youssef ibneloualidCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le pneumopéritoine en laparoscopie
Le pneumopéritoine en laparoscopie
Transféré par
youssef ibneloualidDroits d'auteur :
Formats disponibles
Geste de base
Le pneumopéritoine en laparoscopie :
1. la ponction
X. Pouliquen
Service de Chirurgie Digestive et Générale, Centre Hospitalier Victor Dupouy – Argenteuil.
e-mail : xavier.pouliquen@ch-argenteuil.fr
Correspondance : X. Pouliquen, Service de Chirurgie Digestive et Générale, Centre Hospitalier
Victor Dupouy, F 95100 Argenteuil.
Introduction
La création d’un pneumopéritoine est le premier temps, incontournable, de toute
laparoscopie, forçant à choisir entre trois techniques possibles :
1) L’« open-cœlioscopie » est une mini-laparotomie de fait. Séduisante
dans son principe, celui d’une ouverture contrôlée de la cavité péritonéale, elle
met pratiquement à l’abri d’une blessure des gros vaisseaux abdominaux et du
risque exceptionnel, mais grave, d’embolie gazeuse. Malgré la nécessité de
s’agrandir à la demande, elle ne permet pas toujours d’éviter la blessure d’un
intestin adhérent à la paroi, en raison de l’exiguïté relative de la voie d’abord et
de sa profondeur, surtout chez les obèses. Son indication systématique ne fait
donc pas l’objet d’un consensus, à l’exception de l’enfant ou elle est très simple
42 à réaliser. Elle reste pour nous la méthode de choix, en cas de contre indication
à la ponction (voir plus bas). Un article lui sera prochainement consacré dans le
Journal de Chirurgie.
2) On peut utiliser un premier trocart spécial, restérilisable ou non, permet-
tant le contrôle optique endoluminal de son introduction. Cette solution est éga-
lement séduisante dans son principe mais n’apporte pas toujours le parfait
contrôle visuel attendu, notamment chez les patients déjà opérés au moment le
plus crucial, celui de la traversée pariétale.
3) La ponction transpariétale, qui fait l’objet de cet article. C’est la technique
la plus ancienne, qui a l’avantage sur les autres méthodes d’être la plus simple et
la plus rapide, mais l’inconvénient d’être aveugle. Elle ne se conçoit donc que
dans les conditions de sécurité suivantes :
– des indications restrictives : elle est contre-indiquée chez l’enfant non pubère
ainsi que chez tout adulte présentant soit une distension digestive (occlusion),
soit une cicatrice de laparotomie, à l’exception d’une petite cicatrice à distance
du lieu de ponction ;
– un matériel spécifique : aiguilles à mandrin mousse à ressort, de type Veress ou
Palmer, à usage unique ou non. L’usage unique a l’avantage d’une plus grande
fiabilité et d’un diamètre interne plus large ;
– des lieux de ponctions reconnus comme sûrs. Pour notre part nous n’en rete-
nons que deux : l’ombilic et la région sous-costale gauche ;
– une technique rigoureusement codifiée, qui fait l’objet de cet article.
Mots-clés : Paroi. Geste de base. Laparoscopie. Pneumopéritoine.
J Chir 2003,140, N°1 • © Masson, Paris, 2003
J Chir 2003,140, N°1 • © Masson, Paris, 2003
Geste de base
a b
Ponction à l’ombilic : l’incision préalable
1 Elle doit éviter les quadrant supérieur et supéro-gauche de l’ombilic où s’insère le ligament rond. Elle est donc
inférieure ou latérale. Elle est préparée par une ponction cutanée à la pointe du bistouri ou par une incision de la taille du premier
trocart si l’on prévoit d’implanter celui-ci à l’ombilic. Dans ce cas le bistouri, orienté vers la base de l’ombilic cherche sans
forcer à caresser légèrement son socle aponévrotique pour en diminuer la résistance, notamment chez l’adulte jeune.
43
Ponction à l’ombilic : la ponction proprement Ponction sous-costale gauche
2 dite
Elle exige toutes les précautions suivantes :
3 On vérifie qu’il n’existe pas de rate palpable ni de tym-
panisme localisé, témoin d’une distension gastrique (à suspec-
– suspension élective et forte de l’ombilic au zénith par une so- ter systématiquement après une ventilation prolongée au
lide pince à griffe de type Kocher (qui ne laisse aucune disgrâce masque). La paroi de l’hypochondre gauche est suspendue par
à ce niveau) ; les deux mains de l’aide, à distance du lieu de ponction. On per-
– tenue de l’aiguille entre le pouce et l’index, qui font l’effet çoit deux ressauts correspondant aux deux plans aponévroti-
d’une garde, à cinq centimètres chez un opéré moyennement ques traversés. La tenue de l’aiguille et l’épreuve de la seringue
corpulent ; sont identiques à la technique ombilicale.
– direction de l’aiguille presque verticale, légèrement latérali-
sée d’un angle inférieur à 20° ;
– perception d’un ressaut en principe unique correspondant à
la transfixion de l’aponévrose et du péritoine adhérents à cet
endroit ;
– épreuve de l’écoulement libre de l’air d’une seringue en verre
avec son piston (sans possibilité de réaspirer l’air injecté) ou du
sérum d’une seringue de 5 ml sans piston.
Le pneumopéritoine en laparoscopie X. Pouliquen
L’insufflation Implantation du premier trocart : la direction
4 Elle est commencée à faible débit (1 l/min), en n’aug- 5 Deuxième geste aveugle, cette implantation ne doit se
mentant progressivement ce débit qu’après perception d’un tym- faire, après insufflation par ponction, qu’à l’ombilic ou à son
panisme pré hépatique. La pression imposée au départ ne doit voisinage immédiat, et ne souffre aucune exception aux règles
pas dépasser 12 cm Hg, 10 cm Hg chez les patients à paroi hypo- qui suivent. L’inclinaison postérieure doit être à 45°, en mar-
tonique ou insuffisants respiratoires. Le premier trocart ne peut quant un petit recul après la traversée de la peau pour accrocher
être implanté que lorsque les critères suivants sont réunis : un ab- l’aponévrose, sans glisser sur elle. Vers le haut, le trocart ne
domen cliniquement tendu et tympanique ; un débit d’insuffla- doit jamais viser la ligne médiane (tronc de l’aorte !) mais s’en
44 tion nul ; une pression intra-abdominale (P1) égale à la pression écarter latéralement. Vers le bas, le trocart ne doit jamais quit-
imposée (P2). Si elle est dépasse cette dernière, il faut se méfier ter le plan sagittal de cette ligne médiane pour ne pas courir le
d’un défaut de curarisation risquant d’entraîner des contractions risque, majeur dans ce cas, d’embrocher les vaisseaux iliaques.
abdominales dangereuses lors de l’introduction du trocart.
a b
Implantation du premier trocart : la gestuelle
6 L’opérateur doit se placer du coté ou il est « à sa bonne main ». Pour un droitier le trocart, muni de son mandrin,
est empaumé de la main droite, la main gauche « faisant garde » à 5 cm de son extrémité. Il est alors enfoncé fermement en vérifiant
en permanence : qu’il n’entraîne pas l’incision cutanée, dans le cas contraire il faut l’agrandir immédiatement (a) ; qu’on
ne dévie pas de la bonne direction définie plus haut.
Pour les trocarts à pointe pyramidale ou spiralée, des mouvements francs de rotation doivent être associés, réduisant considérable-
ment la force de pression exercée sur la paroi.
J Chir 2003,140, N°1 • © Masson, Paris, 2003
Geste de base
Branchement de la tubulure à gaz
7 Ce branchement ne doit être fait qu’après deux
vérifications :
1. il existe une fuite spontanée de gaz à l’ouverture du robinet
du trocart ;
2. on fait un contrôle optique de la situation intra-péritonéale
libre de l’extrémité du trocart.
45
Vous aimerez peut-être aussi
- Karak AzgalDocument97 pagesKarak AzgalAubrun100% (4)
- Le Pneumopéritoine en Laparoscopie 2Document3 pagesLe Pneumopéritoine en Laparoscopie 2youssef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Le pneumopéritoine en laparoscopie 3Document2 pagesLe pneumopéritoine en laparoscopie 3youssef ibneloualidPas encore d'évaluation
- La Grossesse Extra-Utérine Par LaparoscopieDocument3 pagesLa Grossesse Extra-Utérine Par Laparoscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Appendicectomie LaparoscopiqueDocument9 pagesAppendicectomie LaparoscopiqueYassine ZenPas encore d'évaluation
- APPPENDICITE Lapaoscopie 2006Document9 pagesAPPPENDICITE Lapaoscopie 2006Don MoorixPas encore d'évaluation
- cp015 Enteroscopie 2019-06052019-Guillaume PerrodDocument6 pagescp015 Enteroscopie 2019-06052019-Guillaume PerrodIlyas BCPas encore d'évaluation
- PulpotomieDocument6 pagesPulpotomieSafia NouriPas encore d'évaluation
- Hand Drawn Style Healthcare Center by SlidesgoDocument21 pagesHand Drawn Style Healthcare Center by SlidesgoOussama MechtriPas encore d'évaluation
- Traitement laparoscopique d’une éventrationDocument5 pagesTraitement laparoscopique d’une éventrationyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Anastomose Colo-Anale Différée, Après Exérèse Totale Du MésorectumDocument4 pagesAnastomose Colo-Anale Différée, Après Exérèse Totale Du Mésorectummowoize83 mowoize83100% (1)
- Laparoscopie Pelvienne Pré-péritonéaleDocument4 pagesLaparoscopie Pelvienne Pré-péritonéaleyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Therapeutiques Des PulpopathiesDocument10 pagesTherapeutiques Des PulpopathiesMayssa BourenanePas encore d'évaluation
- Anastomose Colorectale Laparoscopique à Ciel OuvertDocument2 pagesAnastomose Colorectale Laparoscopique à Ciel Ouvertyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Thrapeutiques Des Atteintes PulpairesDocument47 pagesThrapeutiques Des Atteintes Pulpairesمصطفى أمين علي أو صالحPas encore d'évaluation
- Pylorotomie Extramuqueuse Du NourrissonDocument5 pagesPylorotomie Extramuqueuse Du NourrissonGabriela Zahiu100% (1)
- EpisiotomieDocument4 pagesEpisiotomiesatlakPas encore d'évaluation
- Classification Des Hernies de L AineDocument6 pagesClassification Des Hernies de L AineTha Vila Le ColloPas encore d'évaluation
- SpécialiserDocument3 pagesSpécialiserislamPas encore d'évaluation
- L'appendicectomie LaparoscopiqueDocument5 pagesL'appendicectomie Laparoscopiqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- 2008 GO 379 PloteauDocument21 pages2008 GO 379 Ploteauazizadiallo14Pas encore d'évaluation
- Presentation Coloplast 280218Document159 pagesPresentation Coloplast 280218BERNPas encore d'évaluation
- Chirurgie de La Cystocele Par Voie Vaginale Techniques Sans ProtheseDocument14 pagesChirurgie de La Cystocele Par Voie Vaginale Techniques Sans Prothesebevhir.becirPas encore d'évaluation
- Microchirurgie Par Laparotomie Du Segment Proximal de La TrompeDocument10 pagesMicrochirurgie Par Laparotomie Du Segment Proximal de La TrompeCristinaCaprosPas encore d'évaluation
- Module 1 Les Drains 2019-2020Document28 pagesModule 1 Les Drains 2019-2020Willfried yoletsa tchoupePas encore d'évaluation
- EpisiotomieDocument38 pagesEpisiotomieYi FongPas encore d'évaluation
- Hernies AbdominalesDocument52 pagesHernies AbdominalesVlad Popa100% (2)
- CH DigestiveDocument42 pagesCH DigestiveOmayma ElPas encore d'évaluation
- Chirurgie Oculaire Sous Les Climats Chauds 10Document10 pagesChirurgie Oculaire Sous Les Climats Chauds 10Viergelene PercinePas encore d'évaluation
- Gastro-Entéro-Anastomoses: F. Reche, C. Brigand, C. MeyerDocument13 pagesGastro-Entéro-Anastomoses: F. Reche, C. Brigand, C. MeyerYasmine HammamiPas encore d'évaluation
- Examens HematologieDocument7 pagesExamens HematologieYASMEROPas encore d'évaluation
- Chir Endometriose 2Document8 pagesChir Endometriose 2Tauriel MirkwoodPas encore d'évaluation
- ChirurgiefistuleanaleDocument9 pagesChirurgiefistuleanalen7gy6wkv9rPas encore d'évaluation
- La Fissure AnaleDocument4 pagesLa Fissure Analeyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Cholécystectomie LaparoscopiqueDocument5 pagesCholécystectomie Laparoscopiqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Extrait Des Mises À Jour en Gynécologie Et Obstétrique: - Tome Xxxiii Publié Le 9.12.2009Document14 pagesExtrait Des Mises À Jour en Gynécologie Et Obstétrique: - Tome Xxxiii Publié Le 9.12.2009Aubin Poshombili ThathakuluPas encore d'évaluation
- Ch3 TEMPS FONCTIONNELDocument53 pagesCh3 TEMPS FONCTIONNELMamadou FayePas encore d'évaluation
- Chirurgie de La Maladie Diverticulaire Du CôlonDocument16 pagesChirurgie de La Maladie Diverticulaire Du CôlonAbderrahim FrPas encore d'évaluation
- BoudaaDocument36 pagesBoudaamohamed abderrazak LagariPas encore d'évaluation
- Intubation DifficileDocument104 pagesIntubation DifficileKashPas encore d'évaluation
- Eviscerations Postoperatoires PDFDocument28 pagesEviscerations Postoperatoires PDFAlilou Le DucPas encore d'évaluation
- Épisio PDFDocument8 pagesÉpisio PDFelhamza ahmedPas encore d'évaluation
- MC Chirurgerie de Base FR MSF 1989 207pps BPD 136890Document320 pagesMC Chirurgerie de Base FR MSF 1989 207pps BPD 136890YomePas encore d'évaluation
- Traitement laparoscopique de la lithiase de la voie biliaireDocument5 pagesTraitement laparoscopique de la lithiase de la voie biliaireyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Le Manuel Du Généraliste - OphtalmologieDocument90 pagesLe Manuel Du Généraliste - OphtalmologiealdoPas encore d'évaluation
- PyloroplastiesDocument10 pagesPyloroplastiesderradjim100% (2)
- Drainage ThoraciqueDocument4 pagesDrainage ThoraciquefadPas encore d'évaluation
- Abcès Du Sein P2021Document8 pagesAbcès Du Sein P2021nganvtk.hmuPas encore d'évaluation
- C660 Neuroendoscopy FRDocument38 pagesC660 Neuroendoscopy FRGeomar LaraPas encore d'évaluation
- EpisiotomieDocument83 pagesEpisiotomieSamira OunefloussePas encore d'évaluation
- Protocole OrlDocument7 pagesProtocole OrlLucas LeclercqPas encore d'évaluation
- Imagerie DigestiveDocument8 pagesImagerie DigestiveMukiza FélicienPas encore d'évaluation
- Frottis CV Congres SASPAS 2Document11 pagesFrottis CV Congres SASPAS 2Msnk VicPas encore d'évaluation
- Colostomie DEMSDocument10 pagesColostomie DEMSAbderrahim FrPas encore d'évaluation
- Traitement Chirurgical Des Hernies Hiatales Et Leur ComplicationDocument10 pagesTraitement Chirurgical Des Hernies Hiatales Et Leur ComplicationChater Wafa100% (1)
- tp tech chirgDocument5 pagestp tech chirgducmikaaaaPas encore d'évaluation
- Cngof Info 17-CoelioscopieDocument2 pagesCngof Info 17-CoelioscopieRima BouallegPas encore d'évaluation
- 9173 Exercices Sur L Intubation Difficile30.06.2021 1 1Document9 pages9173 Exercices Sur L Intubation Difficile30.06.2021 1 1Amine WlPas encore d'évaluation
- Ce Intubdiff PDFDocument12 pagesCe Intubdiff PDFoumaima halloumPas encore d'évaluation
- Infiltrations des articulations périphériques: Technique d'infiltration de l'appareil locomoteur selon les repères cliniques et echographiquesD'EverandInfiltrations des articulations périphériques: Technique d'infiltration de l'appareil locomoteur selon les repères cliniques et echographiquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Œil humain: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandŒil humain: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Hernies Inguinales - Pratique de l’Anesthésie LocaleDocument3 pagesHernies Inguinales - Pratique de l’Anesthésie Localeyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Le « Shouldice »Document4 pagesLe « Shouldice »youssef ibneloualidPas encore d'évaluation
- La trachéotomieDocument2 pagesLa trachéotomieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Laparoscopie Pelvienne Pré-péritonéaleDocument4 pagesLaparoscopie Pelvienne Pré-péritonéaleyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- khmekhem2012Document7 pageskhmekhem2012youssef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Technique d’exérèse vidéo-endoscopiqueDocument4 pagesTechnique d’exérèse vidéo-endoscopiqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- La thoracotomie postéro-latéraleDocument4 pagesLa thoracotomie postéro-latéraleyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- La Thyroïdectomie EndoscopiqueDocument3 pagesLa Thyroïdectomie Endoscopiqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- La Lymphadénectomie InteriliaqueDocument6 pagesLa Lymphadénectomie Interiliaqueyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Colectomie Droite Sous CoelioscopieDocument5 pagesColectomie Droite Sous Coelioscopieyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- Berthou JC. Rétablissement de La ContinuitéDocument1 pageBerthou JC. Rétablissement de La Continuitéyoussef ibneloualidPas encore d'évaluation
- 3-Sismique Notion de BaseDocument34 pages3-Sismique Notion de BaseAIT TAHAR NeilaPas encore d'évaluation
- 2 ORIGINE Carnet SavoirDocument56 pages2 ORIGINE Carnet Savoirriverdale9669unicornioPas encore d'évaluation
- TP 6 Shared Pref ISIDocument7 pagesTP 6 Shared Pref ISIGtfPas encore d'évaluation
- Égalité Professionnelle Femme/Homme en Afrique: Défis Et PerspectivesDocument302 pagesÉgalité Professionnelle Femme/Homme en Afrique: Défis Et PerspectivessergesofonnPas encore d'évaluation
- Introducti: Algorithme Pour La Conduite D'une Étude ProspectiveDocument11 pagesIntroducti: Algorithme Pour La Conduite D'une Étude Prospectiveamara camaraPas encore d'évaluation
- 00 - Notes de Cours Semaine 02Document35 pages00 - Notes de Cours Semaine 02AdjoumaPas encore d'évaluation
- Gestion Des Exceptions - Gestion Des Entrees Et Des Sorties PDFDocument25 pagesGestion Des Exceptions - Gestion Des Entrees Et Des Sorties PDFNizar MouhssinePas encore d'évaluation
- Cornelius Castoriadis - La Montee de L'insignifianceDocument10 pagesCornelius Castoriadis - La Montee de L'insignifianceclaudinhotavaresPas encore d'évaluation
- Mon Inventaire Spirituel: Je FaisDocument13 pagesMon Inventaire Spirituel: Je FaisDivine KaliPas encore d'évaluation
- Les Questions A1Document3 pagesLes Questions A1batulPas encore d'évaluation
- Pithiviers Et Galette Des RoisDocument2 pagesPithiviers Et Galette Des RoisBenjamin GevoldePas encore d'évaluation
- Granulométrie de Poudre de MaltitolDocument18 pagesGranulométrie de Poudre de MaltitolNihel FarroukhPas encore d'évaluation
- CPS - Piste ROUACHEDDocument61 pagesCPS - Piste ROUACHEDYasmine RachidPas encore d'évaluation
- Manuel D'entretien PCE-210 PDFDocument85 pagesManuel D'entretien PCE-210 PDFRachid IdresPas encore d'évaluation
- Dyspnée Laryngée - Complement A L - ED - A Lire Car CA Resume La Reference Et Couvre Les ObjectifsDocument22 pagesDyspnée Laryngée - Complement A L - ED - A Lire Car CA Resume La Reference Et Couvre Les ObjectifsGeorges BakhosPas encore d'évaluation
- Option 3GII 2022-2023Document3 pagesOption 3GII 2022-2023Youssef ElfekihPas encore d'évaluation
- Réponses À LexamenDocument59 pagesRéponses À LexamenScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Cours Aires Et Perimetres 1college 2Document10 pagesCours Aires Et Perimetres 1college 2mabchourabdellahhPas encore d'évaluation
- Chantal - 20 3 2007Document3 pagesChantal - 20 3 2007yassinaaroch6Pas encore d'évaluation
- Cahier Dentrainement DELF A2Document15 pagesCahier Dentrainement DELF A2Safaa NajjayPas encore d'évaluation
- D00132Document2 pagesD00132Asia SentinelPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés 1Document4 pagesTravaux Dirigés 1riahimelek6Pas encore d'évaluation
- Nombre D'or Versio FinaleDocument2 pagesNombre D'or Versio FinaleGold Phoenix100% (1)
- Libretto La Bohème de PucciniDocument45 pagesLibretto La Bohème de Puccinimarina DigimPas encore d'évaluation
- Syndrome de Shulman Ou Fasciite Avec Éosinophilie: l'IRM Peut Être UtileDocument2 pagesSyndrome de Shulman Ou Fasciite Avec Éosinophilie: l'IRM Peut Être Utilesba-medecinePas encore d'évaluation
- Outils Black Belt 2Document12 pagesOutils Black Belt 2formation MagpharmPas encore d'évaluation
- LES TROUBLES DU LANGAGe Cours 3Document3 pagesLES TROUBLES DU LANGAGe Cours 3roroririazPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'année Sur La SuperhydrophobieDocument40 pagesMémoire de Fin D'année Sur La SuperhydrophobieJules Simonin100% (1)
- Examen Préparatoire 2023 Eco Gene SGCDocument11 pagesExamen Préparatoire 2023 Eco Gene SGC3ONSORY FFPas encore d'évaluation