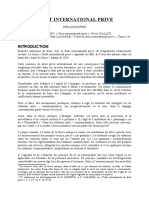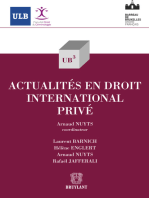Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Institution Exorbitante
Institution Exorbitante
Transféré par
Mmle LawrenceCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Institution Exorbitante
Institution Exorbitante
Transféré par
Mmle LawrenceDroits d'auteur :
Formats disponibles
D ROIT INTERNATIONAL PRIVE
Master recherche de Droit international priv
et du Commerce international
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)
(2009-2010)
BERTRAND ANCEL
L INSTITUTION
EXORBITANTE .
Lusage en Droit international priv sollicite le qualificatif exorbitant pour
stigmatiser certains chefs de comptence juridictionnelle internationale ; il
considre ainsi que les articles 14 et 15 du code civil crent une
comptence exorbitante des juridictions franaises fonde sur la nationalit
du plaideur. Le terme suggre que ce privilge de juridiction chappe
lorbite des principes qui animent la comptence internationale de droit
commun. Lexorbitance est une anomalie. De fait, le privilge de juridiction
repose sur des considrations trangres tant la protection des intrts du
dfendeur, quau souci de renforcer la protection de ceux de la partie
faible, tant lexigence de bonne administration de la justice qu lobjectif
dconomie procdurale, lesquels constituent les quatre ples lattraction
desquels est expose la dtermination des chefs de comptence
internationale des tribunaux.
Etendre dans le champ du droit international priv le qualificatif exorbitant
une institution de droit matriel pourrait signifier que celle-ci nest pas
conforme au modle que met en uvre le droit du for, le systme juridique
du point de vue duquel on raisonne. Les institutions du droit du for sont les
institutions de droit commun lintrieur de lordre juridique du for. Une
institution devient exorbitante lorsque, consacre ltranger, elle na que
trop peu de chose en commun avec les institutions du for. Le concept
antagoniste, celui par rapport auquel se dfint lexorbitance dune
institution, cest la notion de communaut juridique.
Cette notion de communaut juridique a t utilise, semble-t-il, pour la
premire fois par Karl Friedrich von SAVIGNY. Sans doute avait-on pu y tre
sensible avant 1849, date de la parution du volume VIII du Trait de droit
romain contemporain ; sans doute mme y avait-on t sensible ds le
Moyen ge ; peut-tre dailleurs loccasion se prsentera-t-elle dvoquer
ce propos la notion de statut prohibitif qui a t promue par BARTOLE ds le
e
XIV
sicle et qui dsigne effectivement une lgislation drogatoire du droit
commun. Mais admettons, ne serait-ce que par provision, que la notion de
communaut juridique soit fille de SAVIGNY. De fait, il lui revient davoir
soulign que cette notion recouvrait une exigence incontournable du
fonctionnement de la rgle de conflit traditionnelle, rgle indirecte, neutre
et
bilatrale oprant le choix de la
loi applicable pour rsoudre la
question du conflit de lois. Si on se place du point de vue de lordre du for
qui met en uvre une pareille rgle, on dcouvre que celle-ci peut aboutir
la dsignation dune loi trangre et que cette loi trangre devra donc
tre applique aux lieu et place des rgles que les juges du for ont
lhabitude de mettre en uvre, aux lieu et place de la lex fori. De la sorte,
dans llaboration de la solution matrielle apporter la situation
considre, linstitution conue par la loi trangre dsigne prendra la
place linstitution du for ; dune certaine manire, la rgle de conflit
bilatrale estime que linstitution trangre vaut bien linstitution du for et
quau vu des circonstances concrtes du cas et notamment de sa
configuration internationale, cest--dire des liens que celui-ci entretient
avec lordre juridique tranger, il est prfrable de solliciter linstitution
trangre. A la base du raisonnement, il y a lhypothse de la permutabilit
des institutions, de lquivalence des institutions.
De fait, il est clair que cette quivalence est une condition de
fonctionnement de la rgle de conflit. Voici deux personnes de sexe
diffrent qui procdent dans leur pays une crmonie au cours de
laquelle elles consentent sengager lune envers lautre vivre en
commun pour une dure indtermine, le cas chant jusquau dcs de
lune dentre elles. Saisi de la question de la validit de cet acte conclu
ltranger dans les formes et selon les conditions de fond de la loi
trangre, le juge franais y discernera un mariage en dpit du fait que les
exigences de forme et de fond diffrent de celles quimpose le code civil.
Parce quil discerne dans la situation qui lui est reprsente les traits qui
sont distinctifs du mariage dans la conception que cultive le droit civil
franais, il peut mettre en uvre la rgle franaise de conflit qui soumet les
conditions de fond du mariage la loi nationale des intresss. Sil navait
pas russi dtecter ce quil y a de commun entre linstitution mise en
uvre ltranger et linstitution franaise, il naurait pas aperu que la
question dont il tait saisi concernait un mariage et il se serait tourn vers
une autre rgle de conflit.
Cette communaut de droit ne pse pas seulement sur le processus de
choix de la rgle de conflit, sur cette opration particulire quon dnomme
depuis BARTIN Qualification. Elle intervient aussi, non plus en amont, mais
bien en aval du fonctionnement de la rgle de conflit. Il se peut en effet que
la loi quil y a lieu dappliquer parce que dsigne par la rgle de conflit
fournisse un produit, un tat de droit, une institution insusceptible dtre
accueilli dans lordre juridique du for, soit parce que cet tat de droit est
incompatible avec les valeurs fondamentales que cultive lordre juridique
du for, soit parce que dans sa teneur ou dans son agencement, il ne sajuste
pas lenvironnement juridique constitu par lordre du for. NIBOYET disait
que, dans ce dernier cas, il y avait incompatibilit technique, tandis que
dans le premier cas, il dcelait une incompatibilit sur le plan de
lopportunit. Mais lun et lautre cas rvlaient un dfaut de communaut
juridique : linstitution trangre tait en somme exorbitante du droit
commun (qui sentend ici comme la lex fori).
NIBOYET dveloppe assez longuement cette ide spcialement au n1022 de
son Trait. Saluant au passage SAVIGNY et son ide de communaut
juridique, il rappelle aussi avec un peu dinsistance que le droit
international priv est conu pour respecter la diversit des systmes
juridiques et qu il se propose seulement dtablir une sorte de
collaboration
possible
entre
les
lgislations,
les
autorits
et
les
juridictions . Ainsi les rgles de la dvolution ab intestat de lEtat tranger
du dernier domicile du dfunt vont remplacer les rgles franaises de
dvolution pour dterminer le sort des meubles successoraux se trouvant
sur le territoire franais ; ventuellement le notaire ou le tribunal tranger
du dernier domicile interviendront pour tablir le partage de ces meubles
entre le hritiers sans quil y ait faire appel aux autorits franaises et, sil
fallait, une dcision judiciaire, celle-ci prise par le juge tranger du dernier
domicile, sera le cas chant reconnue et excute en France.
Dans la formule de NIBOYET, il faut avant tout retenir dun ct la diversit
des droits, de lautre la possibilit dune collaboration entre ordres
juridiques. La condition de cette coopration inter-ordinale, le ressort de
cette possibilit est la communaut juridique. Au fond, cette coopration
inter-ordinale prend la forme dun libre change des institutions ; NIBOYET
prcise que tout cela suppose que les institutions trangres appeles de la
sorte oprer dans lordre juridique du for
ne soient pas trop distinctes des ntres, afin que stablisse ce quun vieil auteur
du XVIIIe sicle qualifiait un droit de parcours et dentrecours1 entre les instituions
des divers pays. Il convient donc, de toute ncessit, quil existe un minimum de
parent entre les lgislations, soit sur le terrain technique, soit sur celui des
conceptions sociales, cest--dire de lopportunit. En effet, toute institution se
ramne, en gnrale, deux lments : 1 soit des lments constitutifs, absolument
comme le sont les rouages dune mcanique ou le systme circulatoire dun tre
humain, et qui obissent gnralement des rgles inluctables, fonction du
progrs des sciences ; 2 soit des lments qui dcoulent de lide sociale que le
lgislateur se fait des choses, compte tenu des influences religieuses, morales,
historiques, politiques ou conomiques. La coexistence du technique et de
lopportun est tellement vidente quon ne devrait pas avoir besoin dy insister,
2
bien que parfois elle soit perdue de vue .
Relevons aussitt ici, sans nous y attarder toutefois, ce que cette distinction
de NIBOYET doit Franois GENY et son ouvrage Science et technique du
droit priv positif, qui oppose trs clairement dans toute lgislation
llment technique et llment scientifique ce dernier correspondant en
gros cet lment dopportunit, lordre le lopportun dtermin par les
valeurs de la tradition, les donnes religieuses, morales, politiques,
conomiques etc.
Grand pdagogue, NIBOYET aussitt illustre sa distinction par des
exemples :
- le transfert de proprit dans la vente de biens mobiliers qui requiert
selon le droit suisse une tradition dont dispense le droit franais : cest ici
une affaire de technique ;
Droit rciproque de deux ou plusieurs communauts voisines d'envoyer patre leur btail sur leurs
territoires respectifs en temps de vaine pture`` (MARION Instit. 1923)
NIBOYET, Trait de Droit international priv franais, t. 3, p. 497
- en revanche, la licit en droit suisse des pactes successoraux obit un
concept dopportunit de mme quen droit franais la prohibition de ce
genre dacte part dune tout autre conception de lopportunit .
Mais au fond, si exacte et pertinente que soit lanalyse sur laquelle repose,
la distinction na pas en elle-mme une trs grande porte. NIBOYET va
conclure en effet que les divergences sont plus graves, plus marques sur
le terrain de lopportunit (des valeurs essentielles) que sur celui de la
technique o tous les ordres juridiques modernes pratiquent peu prs les
mmes procds. Mais, de toute faon, dun ct comme de lautre, cest la
divergence qui importe. Si celle-ci dpasse un certain seuil, lexception
dordre
public
soppose
lapplication
de
linstitution
trangre
exorbitante que la rgle de conflit se propose dintroduire dans lordre
juridique du for.
Encore faut-il prciser que lintensit du dsaccord entre lordre juridique
tranger et lordre du for sapprcie de manire diffrente selon que celuici porte sur llment technique ou sur llment dopportunit. Quant au
dsaccord dordre technique,
Il se manifeste en droit loccasion des trop grandes oppositions de construction
juridique. L en effet, cest absolument comme en matire de mcanique, o il
existe une limite mathmatique de rsistance. Lenclenchement du droit tranger
dans le mcanisme du droit franais se fait dans les mmes conditions de prcision
que celui des diverses pices dun engrenage. Pour dterminer le point limite, il est
ncessaire de savoir o et comment le situer 3 .
Ces lignes annoncent une certaine rigueur, mais en ralit, cette rigueur,
nous prcise-t-on, ne concernera que certaines discordances techniques :
celles qui sont relatives au contenu des droits et non pas celles qui sont
relatives leur mode dacquisition.
En revanche, la rigueur ne parat pas de mise lorsquest en cause llment
dopportunit. Lauteur note que, sur ce terrain, les oppositions peuvent
tre frquentes et nettement marques, que des ides trs diffrentes
peuvent inspirer les institutions visant les mmes situations, les mmes
types de rapports. Le dfaut de communaut juridique,
NIBOYET, op.cit., p. 499
la rupture du minimum dquivalence des lgislations, produit historique de
chaque milieu, subit au maximum linfluence du phnomne de la frontire.
Nanmoins, la moindre varit dans les conceptions sociales ne sera tout de mme
pas suffisante et une marge de tolrance se prsentera, galement ne pas franchir,
toute de fait. On pourra aller jusqu un certain point et pas au del 4.
Et dajouter :
Tandis, cependant, quavec llment technique la libert sera trs limite
puisquil prsente un certain caractre dabsolue rigueur, llment dopportunit
au contraire sera infiniment relatif et soulvera des problmes dapprciation
essentiellement contingents 5.
Quoi quil en soit, la conclusion est que le dfaut de communaut juridique
doit tre sanctionn par lexception dordre public et partant part lviction
de la loi trangre applicable, autrement dit linstitution exorbitante
succombe devant les exigences tantt techniques, tantt axiologiques, de
lordre public du for.
Disons tout de suite que si cela tait exact, si vritablement linstitution
exorbitante nappelait dautre raction que celle qui prend la forme de
lexception dordre public international, ce cours serait pratiquement
termin ou, en tout cas, manquerait singulirement de substance. En dpit
de toute la dfrence admirative que lon prouve pour lauteur, il est
permis ici de douter de lexactitude de la conclusion de NIBOYET. Au
demeurant, a dj t signale une autre incidence de lexorbitance : la
difficult de qualifier, de parvenir un choix de la rgle de conflit mettre
en action. Cette difficult sest rencontre tout rcemment avec le
problme du partenariat enregistr, mais elle sest aussi rencontre avec
dautres institutions. Et cela a t loccasion dapercevoir les potentialits
dautres modes de rglementation des rapports internationaux dintrt
priv. Il ny va pas seulement de lordre public et que quelques autres
incidents du fonctionnement de la rgle de conflit.
Enfin il faut ajouter que ces perturbations rsultant de lapparition dans le
paysage du for
dinstitutions exorbitantes ont augment dans des
4
5
NIBOYET, op.cit., p. 502
NIBOYET, op.cit., eod. loc.
proportions significatives. Il en est ainsi en raison de la porosit toujours
plus grande des frontires, de la circulation toujours plus intense des
personnes, de linternationalisation croissante des activits de toute nature,
de ce quon a appel la globalisation ou la mondialisation. Ce mouvement
qui affaiblit lemprise de lordre juridique sur lindividu porte celui-ci
aller rechercher ailleurs ce quil ne trouve pas chez lui et alors soit il amne
avec lui des institutions parfois trs exotiques de son pays dorigine, soit il
est poursuivi ou accompagn par les institutions du pays o il sest rendu de
sorte que lordre du for, de plus en plus, est confront des institutions
exorbitantes.
Il nest pas sr que lvolution du phnomne commande ici cette attitude
de fermeture caractristique de lemploi de lexception dordre public ;
linternationalisation a transform en profondeur le phnomne de la
frontire et conduit ne plus considrer que ce qui est exotique est
ncessairement inacceptable chez nous. Aussi bien ne faut-il pas tre
surpris que soient proposes dautres dmarches que la dmarche
traditionnelle de la rgle de conflit complte par lexception dordre
public. Dans un autre monde, dautres mthodes peuvent se rvler
adquates.
Ceci dit, il nest pas question dans ce cours de faire du droit prospectif, du
droit de demain. Le droit daujourdhui, et mme celui dhier suffiront
combler notre curiosit. Linstitution exorbitante sera tudie sur le mode
critique, si lon veut bien conserver ce terme critique son sens
fondamental.
L'adjectif critique renvoie au terme de crise, la krisis des Grecs, ; il
ne se rapporte pas ici, quoique dans un cours de Master 2 Recherche ,
toutes ces indcisions thoriques que les auteurs dtecteraient puis
trancheraient comme autant de nuds gordiens lorsquils sattaquent ce
quils appellent parfois la crise du conflit de lois . La crise ici considre
n'est pas une crise du discours doctrinal; le terme ne dnote pas une
impuissance des auteurs, un fait de morbidit intellectuelle ni un tat
maladif de la discipline. La krisis, telle quici entendue, renvoie beaucoup
plus banalement un phnomne ordinaire, une donne courante de la
ralit juridique, une composante naturelle, quotidienne et essentielle de la
vie juridique. Ce phnomne demande une examen srieux ; cest celui qui
alimente et en mme temps justifie toute la machinerie du droit par cela
qu'il renferme une situation litigieuse concrte o se combattent des
individus dont les intrts divergents s'affrontent, ce qui appelle une
dcision propre apaiser les rapports entre les parties. Essentiellement, il
s'agit des affaires trs concrtes et trs pratiques, des conflits d'intrts qui,
tantt sous les formes du procs, sont ports par les justiciables devant les
tribunaux ou qui, tantt, dans le meilleur des cas, sont rsolus par des voies
plus consensuelles. Le regard critique sur le droit international priv est
alors celui qui capte (entre autres) les questions de conflit de lois au travers
des dcisions de justice, ou des dcisions administratives individuelles ou
mme de source prive comme les sentences arbitrales, en somme des
dcisions individuelles tranchant un diffrend. Le regard critique dchiffre
non pas le droit crit par le lgislateur ou par les spcialistes, non pas le
droit savant, mais le droit vivant. Pour mieux apprhender le sens donn ici
au mot critique, il suffit de se rappeler que le recueil des dcisions
judiciaires en Belgique est dnomm de manire aussi judicieuse
qu'lgante Pasicrisie6 et qu'en France la publication qui dfend l'ide que
tout le droit international priv n'est pas enferm dans la loi et moins encore
dans la doctrine, s'appelle Revue critique de droit international priv,
laquelle en effet privilgie dlibrment les donnes jurisprudentielles et
6
A l'origine, ce recueil portait le titre Pasicrisie ou Recueil gnral de la jurisprudence des cours de
France et de Belgique, en matire civile, commerciale, criminelle, de droit public et administratif, depuis
l'origine de la Cour de cassation, jusqu' ce jour. Depuis 1814, la Pasicrisie belge est le recueil gnral de
la jurisprudence des cours et tribunaux de Belgique, laquelle est venue se joindre la jurisprudence du
Conseil d'Etat. Depuis 1998, la Pasicrisie belge ne reprend cependant plus que les arrts de la Cour de
cassation, rebaptise ainsi : Pasicrisie belge, contenant les arrts rendus par la Cour de cassation ainsi que
les discours prononcs devant elle.
10
travers celles-ci le traitement des situations ou rapports critiques dans
l'ordre du droit priv7.
Cependant, il faut ajouter que cette option smantique et mme
pistmologique n'est pas exclusive d'un examen critique, c'est--dire d'une
analyse qui n'accepte aucune assertion sans contrler la valeur de son
contenu, la ralit de son objet et lidentit de son origine et qui soit
suffisamment raisonne, objective et approfondie pour fonder un jugement
de valeur. En effet, ce cours ne peut ni renoncer cette ambition, ni
chapper sa nature de discours professoral dlivr dans un Master 2
Recherche
Son dveloppement se fera donc partir, non pas des thories labores
par les auteurs, si prcieuses et si clairantes soient-elles parfois ; il se fera
partir des donnes de la jurisprudence, majoritairement et non
exclusivement franaise, en essayant de visiter, autant que les affaires
judiciaires traites en offriront loccasion, tous les compartiments de la
discipline des conflits de lois et de juridictions. Mais le but de pareille
entreprise nest pas et ne peut tre purement descriptif. Il ne sagit pas de
rpertorier et prsenter les cas singuliers que les tribunaux ont d
rsoudre. Critique, le propos sera aussi dmonstratif. Il sarticulera autour
de la distinction des configurations de la rencontre entre linstitution
exorbitante et lordre juridique franais. Cette rencontre peut survenir
parce quon se demande si linstitution trangre peut tre mise en uvre
lintrieur de lordre juridique du for ou (brevitatis causa) de lordre
juridique franais (Ch. 1er) ; la perspective est celle dite de lacquisition
dun droit en France. Mais la rencontre peut aussi survenir parce quon se
demande si, de la mise en uvre ltranger de linstitution exorbitante, il
peut tre tir des effets de droit en France ; il sagit alors de ce quon
"Notre Revue sera Critique en ce sens qu'elle ne prsentera pas les solutions de la pratique sans un
examen doctrinal destin les passer au crible de la discussion, et bien fixer l'importance relative de
chacune d'elles. Pour obir cette proccupation, elle donnera des chroniques de jurisprudence
franaise et trangre. Vritables fresques du travail de nos tribunaux, celles-ci porteront sur : la
nationalit, la condition des trangers, les conflits de lois enfin sur les conflits de juridictions" J.-P.
NIBOYET, Rev. crit. DIP, 1934, p. VI. Les successeurs de Niboyet ont veill tout la fois adapter la forme
aux volutions de l'objet et maintenir l'orientation du projet ditorial, qui se veut doublement critique
par la matire comme par la manire, selon ce qu'indique la suite du texte.
11
appelle, de manire un peu imprcise, de la reconnaissance en France des
situations constitues ltranger (Ch. 2).
12
Chapitre 1 e r . Lacquisition dun droit en France.
Demble il faut prciser que cette expression recouvre aussi bien
lhypothse o il sagit dacqurir un droit que celle o il sagit daccder
un statut (tel celui de conjoint par mariage)
La premire dmarche que doit entreprendre linterprte, lagent
dapplication,
quil
soit
juge
ou
fonctionnaire
officier
public
ou
professionnel du droit, consiste dans le choix de la rgle de conflit mettre
en uvre pour dterminer la loi qui rgira les conditions dacquisition de
ce droit ou statut. Ce choix, opr en amont, avons-nous dit, du
fonctionnement de la rgle de conflit, rsulte dune opration qui doit tre
effectue dans toutes les branches du droit ds lors quon veut appliquer ou
sassurer de la vocation sappliquer dune rgle de droit. Cette opration
est dnomme qualification (BARTIN) ; dans une prsentation sommaire, il
sagit du raisonnement par suite duquel on dcide que tel fait ou telle
srie de faits relvent du champ dapplication dune rgle de droit
dtermine et dune seule . Il faudra sans doute prciser cette dfinition
pour comprendre la difficult que peut opposer linstitution exorbitante la
rgle de conflit franaise. Si cette difficult est matrise, la rgle de conflit
pourra tre choisie et remplir son office en dsignant la loi applicable.
Cette dsignation acquise, si elle a tourn en faveur dune loi trangre,
linstitution exorbitante peut rapparaitre et crer des difficults non plus
en amont mais en aval du fonctionnement de la rgle de conflit; cest ce que
NIBOYET signalait dans ses dveloppements sur lordre public. Il sera
dmontr quen ralit si lordre public peut effectivement tre sollicit, il
existe en droit positif dautres moyens daffronter le problme de
linstitution exorbitante.
Cest sur la base de cette distinction de laval et de lamont du
fonctionnement de la rgle de conflits que seront traits successivement ces
deux ordres de difficults.
13
Section 1 r e . Lamont ou linstitution exorbitante face au
systme de rgles de conflit.
Pour comprendre ici le problme et mesurer son importance qui, disonsle tout de suite, est considrable par lenjeu quil comporte plus que par la
difficult quil renferme il faut essayer de se reprsenter exactement
lopration de choix de la rgle de conflit, cest--dire lopration de
qualification.
Cette opration peut se dcomposer en deux phases, encore que bien
souvent la premire suffise obtenir le rsultat recherch : lidentification
de la rgle de conflit mettre en uvre.
La premire phase est celle de la subsomption (parfois ramene un
syllogisme) Cette subsomption requiert lexistence dun systme de
catgories. Ces catgories assemblent chacune selon des figures
diffrencies (les dfinitions) un certain nombre dlments discriminants,
cest--dire constitus de concepts voquant sur le mode synthtique et
des niveaux variables de gnralit, des faits de lhomme ou de la nature et
des rapports institus loccasion de ces faits ; ainsi dfinit-on la vente, en
droit civil et de manire trs hexagonale, par un enchanement type de
concepts : contrat par lequel lune des parties transmet la proprit dune
chose et sengage livrer celle-ci lautre partie qui soblige en payer le
prix (Vocabulaire Capitant) ; grce la combinaison des lments que
ralise cette dfinition, il est possible de reprer dans le flux des situations
de la vie sociale relle celles qui constituent pour le juriste des ventes et,
partant, il est possible didentifier le rgime juridique, lensemble des
rgles quils convient de leur appliquer.
14
Le concept ou la catgorie tablissement de la filiation utilis par le droit
international priv franais correspond cette prsentation ; il relie entre
eux divers lments discriminant, que sont la procration, voire mme la
relation sexuelle entre deux personnes suivie dune fcondation et du
dveloppement dun embryon, dune gestation etc. qui rattache lenfant
se sauteurs lesquels en assumeront la subsistance et lducation. Lorsque
tous ces lments sont articuls devant le tribunal, celui-ci reconnat grce
leur valeur discriminante, une demande de dclaration judiciaire de
paternit ou de maternit, cest--dire dtablissement de la filiation ; il peut
alors se tourner vers larticle 311-14 du code civil.
Mais le systme des catgories qui a cours dans lordre juridique franais
est imparfait ; il na pas t labor de manire rigoureusement scientifique
comme cela a t fait pour les classifications des tres anims ou des corps
chimiques. Cest lexprience qui la constitu sur un mode plutt
pragmatique, sans doute inform par la culture romaniste diffuse par les
universits mais aussi prouv par les ncessits de la pratique ; il sest en
quelque sorte mis en place progressivement au fur et mesure de
lvolution de la vie sociale et lapparition de besoins nouveaux qui nont
pas manqu dentraner des modifications et des innovations. Par ailleurs il
faut aussi relever que les catgories ainsi labores lont t dans la vue de
structurer la vie sociale interne ; le droit international priv les emprunte au
droit interne, non pas en raison dune carence, mais parce que la mission
de la rgle de conflit comporte la charge dintroduire dans la vie sociale
gre par lordre du for des situations correspondant le cas chant des
institutions trangres. Il ne lui est pas demand de bousculer les structures
de la vie sociale interne, mais au contraire et en quelque sorte dy
acclimater les institutions trangres. Dans ces conditions, les institutions
exorbitantes qui procdent dexpriences trangres cette vie sociale et
ses transformations vont produire des situations qui pourraient ne pas
rpondre nos catgories et rsister lopration de subsomption ; en
effet, bties sur des modles indits en France, ces situations en
15
reproduiront pas les lments discriminants quassemblent les catgories
du droit franais.
Pourtant, il ne faut pas dsesprer. La pratique des tribunaux dmontre que
la qualification est possible. Cest que lchec de la subsomption ouvre la
deuxime phase de lopration. Cette seconde phase nest pas opposer
la premire, quoiquelle sen distingue assez clairement. Lopration de
subsomption a quelquechose de quasi-mcanique ; on parle dailleurs
volontiers ici le langage de la logique et mme de syllogisme : une
opration qui consiste vrifier quun objet particulier offre les
caractristiques constitutives dune classe. La seconde phase en diffre en
ce quelle ne seffectue pas sur le plan de lextension (ou du champ ) du
concept, mais sur celui de sa comprhension, cest--dire des raisons pour
lesquelles ce concept ou cette catgorie ont t construits. Ces raisons ont
tout aussi bien command la sanction de la rgle qui utilise cette catgorie.
Sagissant des rgles de conflit, cette sanction consiste en la dsignation de
la loi qui prsente les liens les plus significatifs avec les situations que
couvre la catgorie. Cest le sens de la rgle de conflit quil faut alors
interroger lorsque la premire phase reste infructueuse.
Pour rendre tangible cette analyse, il suffit de sortir du monde du droit et de
saventurer dans celui du sport ou plus exactement des comptitions
sportives ; penchons-nous un instant sur le tournoi de Roland-Garros,
lOpen de France Dans cette comptition saffrontent des joueurs issus de
deux groupes diffrents. Le premier rassemble les concurrents que
dsignent leurs caractristiques acquises et reconnues sur la base de leurs
rsultats antrieurs ; ils remplissent un certain nombre dexigences,
lments discriminants qui les font entrer dans la cohorte des champions.
Le second groupe est peupl de joueurs plus laborieux, en tout cas ne
pouvant se prvaloir dun palmars susceptible de les faire figurer dans la
premire cohorte ; il leur faut passer par la voie dite prcisment des
qualifications ; cest--dire quils doivent se soumettre une procdure
pralable destine vrifier quils pourront se comporter honorablement
dans la comptition et quils sont susceptibles de la remporter. Ils doivent
16
dmontrer les qualits que lexprience na pas permis de rvler jusqu
prsent. Cette vocation triompher dans le tournoi est la comprhension de
la catgorie dont les lments discriminants (les points du classement ATP)
circonscrivent lextension.
La distinction en deux phases ne compromet pas la cohrence de
lopration. Faisant confiance aux critres dgags par lexprience et
assembls en la forme canonique de la catgorie, la subsomption fournit un
indice autorisant une prsomption de qualit ; la qualification au sens strict
sefforce, de son ct, de dceler, par une procdure ad hoc, les
caractristiques du sujet (ou du cas, de la situation) et dapprcier
directement la qualit en question sans passer par le filtre de la forme
canonique.
Ce raisonnement en comprhension, conduit sur la signification de la rgle
de conflit et constituant la qualification stricto sensu, est ce qui permet dans
les cas difficiles le choix de la rgle de conflit mettre en uvre. Il est
noter quil donne la catgorie une certaine lasticit ou plutt quil
augmente llasticit inhrente aux notions synthtiques que sont les
catgories; cette lasticit absorbe les singularits des situations modeles
sur les institutions trangres exorbitantes. Le problme avait t abord
assez volontiers dans des Cours gnraux de lAcadmie de droit
international sous un angle assez restreint ; il sagissait de la qualification de
linstitution inconnue8. Il est ici conu de manire plus large. Une institution,
avons-nous dit aprs NIBOYET, peut revtir un caractre exorbitant soit en
raison
des
diffrences
dordre
axiologique
(quant
aux
valeurs
fondamentales), soit en raison des diffrences dordre technique. Dans le
premier cas, linstitution exorbitante nest pas une institution inconnue, mais
une institution rprouve par lordre du for, une institution quil refuse, quil
condamne parce quelle sert des objectifs contraires aux valeurs quil
dfend et cest bien alors, prcisment parce quil la connat, quil sy
oppose. Tandis que dans le second cas, il sagit dinstitutions qui ne
V. J. MAURY, Rgles gnrales de conflit de lois, Rec. cours La Haye, 1936 III, n. 150 et s., p. 496 et s., R.
AGO, Rgles gnrales de conflit de lois, Rec. cours La Haye, 1936 IV n16 et s. p. 330 et s.
17
mconnaissent pas les valeurs du for, mais qui, par leur structure et les
moyens quelles emploient, nont pas dhomologue dans lordre du for et ne
sajustent pas au droit du for ; il sagit bien dinstitutions inconnues, mais qui
sont seulement des institutions exorbitantes. Il y a ainsi deux espces
dinstitution exorbitante. Ni lune, ni lautre noppose delle-mme une
rsistance la qualification du for.
1er Le dsaccord axiologique
2 Le dsaccord technique.
18
1er Le dsaccord axiologique
Le dsaccord axiologique nentrane aucune impossibilit de qualifier,
didentifier par le moyen des catgories du for la rgle de conflit quil
conviendra de mettre en uvre. Sur ce point, lexamen critique peut se
contenter de quelques exemples.
Il nest pas discut que lunion polygamique constitue, de manire
typique, une institution exorbitante du point de vue de lordre juridique
franais ; elle est mme une institution rprouve puisque la violation de
larticle 147 du code civil est en somme constitutive dune infraction, dun
dlit, pnalement rprime (art. 433-20 c. pn.).
Les juges franais ne semblent pas stre heurts une difficult de
qualification dans les affaires de polygamie au plan international ; il y ont vu
spontanment ou mme parfois sen se rendre compte du problme, une
affaire de mariage.
Cela ressort clairement de la premire dcision
habituellement signale en la matire. Il sagit de larrt Zermati Souissa
prononc par la Cour dappel dAlger le 9 fvrier 19109. Sans doute faut-il
aussitt souligner que cette cour tait la juridiction qui, parmi ses missions,
avait reu celle dexaminer les recours en rvision qui pouvaient tre
forms contre les dcisions prononces selon le droit musulman dans des
contentieux concernant le statut personnel des indignes dAlgrie ; elle
tait donc, loccasion, tribunal de droit musulman, gardienne de
lorthodoxie coranique, et, dans cette fonction particulire, elle tait
naturellement appele connatre des litiges matrimoniaux obissant ce
droit. Chacun sait que ce droit
dobdience coranique autorise la
polygamie et chacun peut en dduire lgitimement que la Cour dAlger
avait une certaine familiarit avec linstitution. De fait, en gnral, le
systme colonial prservait les statuts personnels des populations qui
taient tablies avant la colonisation sur le territoire subjugu. De sorte que
Alger, 9 fvrier 1910, Rev. dr. int., 1913. 113, note anonyme
19
lunion polygamique,
pour la Cour dAlger, tait certainement moins
exorbitante quelle pouvait ltre pour le tribunal de Guret ou de
Fontenay-le-Comte, par exemple. Mais, dans laffaire Zermati-Souissa, il
ntait pas question de droit colonial ; il sagissait dunions qui avaient t
contractes entre isralites marocains au cours du XIXe sicle, cest--dire
en un temps o le protectorat franais navait pas encore t impos au
Royaume du Maroc et o celui-ci constituait donc un Etat tranger comme
un autre. Il ne sagissait, pas dun cas colonial, mais dun cas international. Il
tait soutenu en lespce que ces unions pesaient sur la dvolution
dimmeubles situs en France laisss par un Marocain. Or la Cour dAlger
demble traite ces unions comme des mariages, quoique dans le droit du
for, le droit franais, le mariage soit conu de manire tout fait diffrente.
Voici les faits intressant cette question de qualification :
- 17 septembre 1850, Abraham Souissa, isralite ressortissant marocain,
domicili Tanger, pouse Oran Hanna Kalfon more mosaco (rgles de
la coutume de Castille, Les expulss ) ; une ketouba est tablie qui
constate les engagements du mari envers son pouse ;
- 21 juin 1885, Abraham Souissa souscrit Tanger une ketouba ladresse
de Freha Zaou, ressortissante marocaine ; selon le rite mosaque, il sagit
dun second mariage licite quoique la premire union du mari nait pas t
dissoute ;
- 9 octobre 1905, Abraham Souissa dcde, laissant ses deux pouses et
des enfants issus de ses deux unions. Une contestation slve propos de
la vocation des pouses et des diffrents enfants la succession un
immeuble situ en France, Oran. Cet immeuble a t vendu aprs le
dcs pour tre plus commodment partag et Freha Zaou prtend
exercer les droits du conjoint survivant sur le prix de licitation.
La Cour situe sans hsiter le rapport entre A. Souissa et Freha Zaou sur le
terrain conjugal ; il sagit manifestement pour les magistrats dAlger dun
mariage. En effet, aprs avoir mthodiquement distingu tous les lments
dun contentieux complexe, ils en viennent au quatrime point litigieux
pour sexprimer de la faon suivante :
Quatrime point litigieux. Freha Zaou, avec qui Abraham [Souissa] a
contract son second mariage, est-elle femme lgitime ? Au cas affirmatif,
quels sont ses droits sur le prix des immeubles de la succession Abraham
Souissa, licits Oran ? [] ;
20
Il sagit donc dune question de validit du mariage et il va de soi dans
lesprit de la cour que cette question de la validit dun second mariage
contract avant la dissolution du premier (art. 147 c. civ.) concerne une
condition de fond de formation du mariage laquelle il convient
dappliquer la loi personnelle. Il nest pas prcis sil sagit de la loi
personnelle dAbraham Souissa ou celle de Freha, car en lespce cela tait
inutile puisque les deux intresss partageaient le mme statut personnel,
celui que leur rservait la loi nationale commune, la loi marocaine. Mais si
la cour discerne aussitt une question de mariage qui fait de lunion
polygamique si lon peut dire un mariage comme un autre, sa dcision
laisse transparatre tout de mme comme lombre dune inquitude qui
semble la faire hsiter un instant avant daboutir la rgle de conflit
relative au statut personnel et aux conditions de fond de formation du
mariage comme si elle avait prouv la tentation de se drober
lapplication du statut marocain autorisant la polygamie. En effet, aux
questions quelle se pose la Cour commence par rpondre en appliquant
une rgle franaise qui empcherait ici de mettre en cause la validit du
mariage :
Attendu que Freha Zaou est femme lgitime ; quelle a valablement
pous Abraham Souissa ; qutrangre elle a pu contracter mariage
ltranger avec Abraham Souissa, tranger ; - Attendu que le premier juge
la admis avec raison ; que, sur ce point, il chet de confirmer la dcision
entreprise ; - Attendu que pour faire disparatre les effets lgaux de cette
seconde union dAbraham Souissa, il aurait fallu en demander la nullit ;
que personne na demand la nullit de ce mariage comme entach de
bigamie ; - Attendu quon distingue gnralement le mariage inexistant et
le mariage nul ; que le mariage inexistant est celui qui na pas besoin
dtre annul en justice et dont toute personne est fonde, en tout temps,
repousser les effets ; que tel serait le mariage contract entre personnes du
mme sexe et dont lidentit de sexe serait certaine ; celui qui aurait t
clbr par une personne nayant aucune qualit cet effet, par exemple
un notaire, un prtre [] ; que le mariage nul est celui dont la nullit doit
tre prononce par les tribunaux, qui ne peut tre annul que sous
certaines conditions dtermines par la loi, et, qui, jusque l produit tous
ses effets lgaux ; - Attendu que la bigamie fait partie de ces nullits ; Attendu que cette raison suffit elle seule pour dcider quil faut retenir les
effets lgaux du mariage dAbraham Souissa et de Freha Zaou ;
Ainsi dans lesprit de la cour, cette longue argumentation devrait couper
court toute discussion. Elle nest pourtant pas dcisive.
21
La distinction de linexistence et de la nullit est caractristique du droit
franais interne gouvernant le contentieux de lunion conjugale ; elle a t
invente, sinon exclusivement du moins principalement, pour les besoins
de la cause et la cause pour laquelle elle combat est celle de la lacit du
mariage au dix neuvime sicle. Larrt lexpose assez fidlement le
principe et les consquences : lunion qui serait clbre par une personne
qui naurait pas la qualit dofficier de ltat civil ou qui naurait pas reu
dlgation de lofficier dtat civil nest pas nulle, elle est nous dit-on
inexistante ; la solution se cherchait une justification formelle du ct de
ladage pas de nullit sans texte ; en ralit, il sagissait de pnaliser les
catholiques qui conservaient la pratique du mariage religieux et
ngligeaient de faire prcder celui-ci par le mariage civil la mairie : du
point de vue de la loi civile, les intresss ntaient pas maris, les enfants
taient naturels et donc taient exposs souffrir toutes les infriorits,
notamment successorales, attaches alors cette condition. Linexistence,
par sa brutalit, par sa prennit (imprescriptibilit) et par limpossibilit
dy porter remde (pas de mariage putatif) tait dissuasive. La distinction
est ici applique, mais elle ne dbouche pas sur linexistence, elle
dbouche sur la nullit pour non-dissolution du premier mariage, laquelle
est bien prvue par un texte et nest effective quautant quun jugement la
constatant est intervenu. Comment la cour en est-elle arrive voquer ces
solutions ? En supposant la vocation de la loi franaise. Serait-ce que les
problmes que le droit franais rsout de cette manire relvent de la
procdure et, partant, obissent la lex fori ?
Pourtant il nest pas sr que lon soit en prsence dun problme de
procdure. Lradication de la pratique des catholiques traditionnalistes de
lpoque nest pas une simple question de procdure, cest une affaire qui
engage la conception mme du mariage ; pas davantage la mconnaissance
de larticle 147 du code civil qui proscrit la conclusion dun second mariage
avant la dissolution du premier nest rductible une simple question de
procdure. Cest bien la rgularit au fond du mariage qui est en cause.
Vue sous cet angle, celle-ci noffre en lespce o les intresss sont
22
Marocains aucun titre dapplication la loi franaise. Larrt cet gard
encourt la critique et le motif quil juge suffisant ne lest pas vraiment. Il se
comprend dans ces conditions que la Cour ait ajout un second motif
Attendu du reste que, si la nullit de ce mariage tait mme demande, cette
demande ne saurait tre accueillie ; - Attendu que dame Freha Zaou, trangre,
sest marie avec Abraham Souissa, tranger, Tanger (Maroc), cest--dire
ltranger ; quil sagit de ltat des personnes, quil convient [] de tenir compte
de la loi des trangers ; que le mariage est valable daprs la loi nationale des
contractants ; - Attendu qu bon droit le premier juge a dcid que Freha Zaou est
lpouse lgitime dAbraham Souissa ;
Lexactitude de la solution (dsignation de la loi personnelle) dpend ici de
la qualification donne aux faits et actes sur la base desquels lunion sest
forme entre Abraham et Freha. Il sagit dans lesprit de la cour et sans la
moindre hsitation, sans la plus petite quivoque, dun mariage et laffaire
concerne les conditions de fond de formation, celles qui relvent de la loi
nationale des intresss.
Cest l lapport essentiel de larrt et mme, malgr lintention de ses
auteurs, son apport explicite en ce qui concerne linstitution exorbitante
quest lunion polygamique. Celle-ci est un mariage et si la qualit dpoux
est discute, il faut recourir la rgle de conflit relative aux conditions de
formation du mariage ; en somme, la question de la qualification est rsolue
alors mme quon vite de se la poser.
Bien sr, le rgime colonial en vigueur en Algrie orientait vers cette
solution ; mais il faut aussi tenir compte dun autre facteur. La Cour dAlger
peut faire preuve daudace dautant plus facilement que, de laccueil de
lunion polygamique au sein de la catgorie mariage du droit franais, elle
ne tirera, en lespce, aucune consquence concrte : il ny aura pas deux
conjoints survivants appels en concours lun avec lautre prendre part
dans la distribution du prix de licitation de limmeuble. Certes, la seconde
union est valable et Freha est bien lpouse du dfunt. Mais, aprs avoir
constat que celle-ci stait marie sous un rgime dotal qui ne lui confre,
au titre du rgime matrimonial, aucun droit (de communaut) sur
limmeuble dOran, la Cour lui dnie le bnfice de larticle 767 du code
23
civil qui lpoque accordait au conjoint survivant, titre successoral, un
quart en usufruit des biens du prdcd.
Cet article 767 du code civil avait certainement vocation sappliquer
puisqutaient en cause les droit successoraux exercer sur un immeuble
situ en France : la loi de la succession tait la loi franaise de la situation du
bien. Toutefois, nous rvle larrt, un lment venait ici faire obstacle la
ralisation de cette vocation de larticle 767 sappliquer : dans un crit
appel ketouba dress loccasion de son mariage en 1885, Freha Zaou
aurait selon la Cour dAlger renonc son usufruit et, partant, elle ne
pouvait aujourdhui venir le rclamer.
Attendu quil chet dinfirmer sur ce point la dcision entreprise et de dire que,
quant Freha Zaou, il ny a pas lieu application de larticle 767 ; - Attendu en effet
que Freha Zaou a renonc lusufruit ; que dans la Ketouba de 1885, elle dclare
expressment quelle ne pourra rclamer en dot que 3000 francs et pas autre
chose ; - Attendu que Freha Zaou pouvait dailleurs valablement renoncer
lusufruit ; que larticle 767 nest pas une disposition dordre public ; - Attendu que,
relativement lusufruit de Freha Zaou, deux appels incidents ont t relevs de la
dcision entreprise, lun par les cinq consorts Souissa, enfants mles du premier lit,
lautre par la dame Lasry, enfant du premier lit galement ; - Attendu quil y a lieu
de faire droit ces deux appels incidents []
Il faudra revenir sur cet crit, la ketouba, qui est aussi une institution
exorbitante. Mais pour linstant il suffit de constater que Freha ne recevra
pas plus que si elle navait jamais t marie Abraham. La qualification
mariage ne tire pas consquence ; elle ouvre sur le vide. Cest une
observation semblable que se prte larrt qui pourrait bien dans la
chronologie de la polygamie internationale devant les tribunaux franais
tre le second en date.
Cette deuxime dcision a t prononce par la Cour dappel de Hano le
24 mars 194910 dans une affaire concernant des Chinois installs sur le
territoire de la ville de Haphong, alors concession franaise au Tonkin.
Voici les faits :
A Haphong, le 16 avril 1918, Kam Yoei Tche a contract, selon les coutumes
chinoises, une union avec Tsai In Hoa, sa compatriote, dont il aura six enfants
10
Hano, 24 mars 1949, Rev. crit., 1950.399, note Andr Ponsard
24
Mais sans doute assez tt aprs cette premire union, Kam Yoei Tche doute de
la capacit de son pouse satisfaire pleinement ses ambitieux dsirs de
paternit ; aussi bien, contracte-t-il, toujours Haphong et selon les coutumes
chinoises, une seconde union, le 5 avril 1924, avec Lin Che, dite Lin Chau
Tchen, galement sa compatriote, qui lui donnera dix enfants supplmentaires.
M. Kam Yoei Tche ayant t victime dun accident mortel, ses pouses et ses
enfants ont au procs pnal demand rparation contre Wei You Tching,
auteur de laccident, et Kuo Tchin dit Ke Tchieng, civilement responsable.
La phalange des demandeurs est emmene par Tsai In Hoa, la premire
pouse qui, en cette qualit, est devenue le chef de la famille du dfunt, Lin
Chau Tchen tant seulement femme de deuxime rang, selon une hirarchie
particulire aux coutumes chinoises observes par la communaut chinoise
tablie au Tonkin. La procdure initie au pnal devant le tribunal de
Haphong ne fait droit, par jugement du 30 dcembre 1948, que trs
partiellement aux prtentions des parties civiles en leur allouant une
rparation de $20000 aprs avoir dclar irrecevable la constitution de partie
civile de Mme Tsai In Hoa en tant quelle disait reprsenter des enfants
mineurs issus de la seconde union. Laffaire est porte en appel
- tant par les parties civiles qui rclament 532000$ de dommages-intrts,
- que par les dfendeurs qui protestent quaucun lien nest juridique tabli
entre le dfunt et les demandeurs qui puisse autoriser une action leur
encontre.
Voici donc des Chinois qui, en territoire franais, pratiquent des usages
chinois comme cela leur est permis par le dcret du 3 octobre 1883 et
qui prtendent tre traits comme mari et femmes alors que la conception
mme des unions contractes est passablement loigne de la conception
que lordre juridique franais cultive du mariage.
Les lments discriminants dans cette conception franaise sont la
complmentarit des sexes, lgalit des poux qui implique la mutualit
et lexclusivit et enfin la dure indtermine (consortium omnis vitae). La
polygamie telle que rencontre dans laffaire Zermati-Souissa vrifiait sans
doute la complmentarit des sexes, mais non assurment lgalit, pas
plus que la mutualit ni lexclusivit. En effet, il ne faut pas voir dans ce
genre
dunion
polygamique
un
simple
empilement
de
mariages
monogamiques, la multiplication des lits ne constituant pas un millefeuille
conjugal dans lequel se dmultiplierait le mari ; il ny a quun seul mari qui
est simultanment le mari de toutes les pouses et qui, partant, ne peut se
consacrer exclusivement aucune dentre elles. Il doit se partager
25
quitablement entre ses pouses, lesquelles, par ailleurs, ne sont pas
tenues de subvenir aux charges du mariage qui incombent exclusivement
au chef de la famille en contrepartie de quoi elles lui doivent toutes et
chacune la fidlit, videmment sans rciprocit. Cest l un modle trs
diffrent de celui du code civil et non pas seulement un multiple de celui du
code civil. En ralit, lunion polygamique sorganise sur une structure
holistique en forme dtoile, une structure stellaire o chaque nouvelle
union ajoute une branche au module central que pilote le mari. Toute cette
construction rvle un profond dsaccord sur les donnes comme sur les
solutions du problme de la complmentarit des sexes.
En assimilant au mariage de la tradition romano-canonique ce genre
dinstitution exorbitante, larrt Zermati-Souissa soit en forait la nature, soit
dformait la catgorie en faisant abstraction du paramtre de lgalitmutualitexclusivit. Nanmoins, limpratif colonial pesait sans doute trop
fortement sur les mentalits pour sopposer ces altrations. Mais la
polygamie chinoise pratique par le sieur Kam Yoei Tche atteint un niveau
encore suprieur dexorbitance : non seulement un homme vaut plusieurs
femmes, ce qui, dans lordre arithmtique comme dans lordre juridique,
dnonce une ingalit entre les sexes, mais de plus les femmes ellesmmes ne sont pas gales entre elles (prior tempore, potior jure).
La Cour de Hano na, semble-t-il, pas mme song lobjection qui pouvait
se tirer de cette aggravation de lingalit, de cette discrimination porte
au carr ; lgalit civile, lgalit des sexes, lgalit des mes (si on se
souvient des origines canoniques de lunion conjugale recueillie par la loi
civile), tout cela est sans importance. Le mariage polygamique la chinoise
est rduit au gabarit des catgories du droit international priv franais. La
cour dclare :
Attendu que les unions dont se prvalent les dames Tsai In Hoa et Lin Che sont
respectivement du 16 avril 1918 et du 5 avril 1924 ; que ces dates ne sont pas
contestes ; - Attendu que en application de la thorie de droit international du
respect des droits acquis, cest en considration de cette date que la cour doit
apprcier la nature et la valeur des unions contractes par le sieur Kam Yoei Tche ; Attendu que ces unions devaient se faire selon les prescriptions du dcret du 3
octobre 1883, alors applicable aux Chinois ; quen application de ce dcret, les
ftes rituelles chinoises, pour constituer des mariages lgitimes devaient
26
saccompagner dune dclaration lofficier de ltat civil annamite selon les
prescriptions de larticle V du dcret du 3 octobre 1883 ; quen lespce, il appert
quil ny a eu aucune clbration conforme aux prescriptions de larticle 1er du titre
V de ce dcret ; quen tout tat de cause, les dames Tsai In Hoa et Lin Che ne
rapportent pas la preuve de leur mariage selon la seule forme permise par ce
dcret, savoir par la production dun acte de mariage ; que la production dun acte
notari est insuffisante et ne peut tre oppose aux tiers pour tablir leur qualit
dpouses lgitimes ; que, par consquent, elles ne peuvent tre considres que
comme des concubines
En soumettant ainsi les unions successivement formes aux dispositions du
dcret de 1883 et aux formalits que celles-ci imposaient, la cour, sans
hsiter sur la nature des actes de 1918 et 1924, applique le droit du
mariage ; elle admet sans autre forme de procs que ces actes sont des
actes de clbration du mariage. Cest une chose de dclarer que les
unions pouvaient se nouer sur le mode de ftes rituelles chinoises ; cen est
une autre que dadmettre que ces unions, qui avaient vocation se
multiplier du chef du mari, taient justiciables des rgles du mariage, cest-dire recevaient la qualification de mariage, entraient dans la catgorie
mariage.
Il est vrai que la question de la nature de linstitution a pu effleurer la cour,
puisquelle dclare devoir apprcier la nature et la valeur des unions
contractes par le sieur Kam Yoei Tche ; mais son enqute sur la nature se
rduit la rfrence au dcret du 3 octobre 1883. Texte de droit colonial
qui a pes sur la qualification et conduit ainsi un nouvel largissement de
la catgorie mariage du droit international priv franais pour y
comprendre cette polygamie hirarchise o toutes les branches de ltoile
conjugale ne sont pas sur le mme plan, mais des niveaux diffrents, se
dgradant chaque adjonction nouvelle comme sil sagissait de descendre
les marches dun escalier en colimaon.
Mais cet largissement si peu sensible lgalit, derechef, reste strile
pour les prtendues pouses, pour lpouse de second rang et mme aussi
pour lpouse de premier rang : faute, dans lun et lautre cas, en 1918 et en
1924, davoir t dclars lofficier de ltat civil annamite comme le
demandait le dcret de 1883, les actes rituels de la coutume chinoise sont
inoprants et la preuve du mariage nest pas rapporte - aut non probari aut
non esse idem est . La consquence en est que Tsai In Hoa et Lin Che sont
27
ramenes ltat et condition de concubines de M. Kam Yoei Tche ; elles
perdent ainsi tout espoir dtre indemnises du dommage rsultant pour
elles du dcs de leur mari11. Au fond, dans les circonstances o elle se
produit, labsorption de ce type de polygamie par le concept franais ne
compromet pas la rgle de conflit franaise qui ne peut conduire en fait
lacquisition du statut de conjoint ni partant la conscration des effets
attachs ou des suites inhrentes lunion conjugale.
De cette position, quon pourrait juger un peu hypocrite, il faut
rapprocher larrt Hyde v. Hyde and Woodmansee, prononc en 1866 par la
Matrimonial Court anglaise. Cette dcision est intressante parce que si elle
est
lue
dans
une
perspective
euro-continentale,
elle
paraitra
particulirement rigoureuse et sans doute plus franche en ce quelle refuse
de manire catgorique, pourrait-on dire dassimiler lunion
polygamique un mariage. Voici dans quelles circonstances :
En 1853, est clbr Salt Lake City par Brigham Young le mariage Mr
Hyde et Miss Hawkins, fidles de lEglise des Mormons ; les poux sont
originaires dAngleterre et ils se sont expatris pour mieux vivre leur foi
auprs du fondateur de lEglise des Mormons qui les marie selon le rite
mormon.
Aprs 3 ans de vie conjugale et quelques enfants, Mr Hyde part en 1856
pour une mission aux Iles Sandwich o il abjure sa foi mormone.
11
Attendu que les dames Tsai In Hoa et Lin Che tant des concubines au sens des us et coutumes
annamites, cest en considration de cette qualit que la cour doit rechercher si ces dames ont subi un
prjudice de par laccident mortel du sieur Kam Joei Tche Attendu que cette qualit de concubine ne
peut tre carte en considration du principe que cette institution est contraire lordre public, cest-dire contraire aux principes du droit civil franais ; quen lespce daprs le coutumes annamites, il est
retenir que la famille annamite ne fait aucune diffrence entre les enfants lgitimes et naturels, qui
viennent tous la succession galit de parts ; quil faut donc en conclure que la concubine sassocie,
sinon en droit, du moins en fait, la famille annamite ; quinvoquer le principe de lordre public franais
serait mconnatre les engagements pris par la France de respecter les us et coutumes des pays placs
sous notre protectorat ; - Attendu quil a notamment t jug que la concubine constituant avec le
concubin une vritable association de fait, cette dernire peut solliciter de la succession une indemnit
du fait de la mort du concubin (Cour dappel de Hano, 4 mai 1938, J.J. janvier 1938, p. 15) ; - Attendu que
ce droit que possde la concubine est un droit daction en dommages-intrts contre la succession de
son concubin dont elle ne fait pas partie, et non vis--vis des tiers ; le prjudice subi est ventuel et non
certain, et lorsque il provient du fait dun tiers, il nest pas direct ; il ne dcoule pas du droit de
succession qui nappartient quaux hritiers lesquels succdent aux actions appartenant au de cujus en
lespce laction en dommages intrts qui a appartenu Kam Joei Tche, en raison de laccident qui a
entrain sa mort - Attendu que les dames Tsai In Hoa et Lin Che ne pouvant exciper que de la qualit
de concubines, ne peuvent donc rclamer ce titre, des dommages-intrts Wei You Tching et Kuo
Tchin pour laccident mortel dont fut victime leur concubin Kam Joei Tche
28
Informes de cette dfection, les autorits religieuses (et civiles) du
Territoire de lUtah excommunient en 1857 M. Hyde et rendent Mme
Hawkins sa libert matrimoniale ; ce qui semble rpondre ses vux
puisquelle refuse de rejoindre son mari qui la presse dabandonner lUtah
et lglise des Mormons pour reprendre la vie conjugale avec lui de retour
en Angleterre.
En 1859 (ou 1860), Mme Hawkins pouse Salt Lake City le sieur
Woodmansee dont elle aura dautres enfants.
Persuad de ne pouvoir jamais rcuprer son pouse, M. Hyde demande
aux tribunaux dAngleterre la dissolution de son union avec Mme Hawkins
en raison de ladultre de celle-ci.
Il faut relever immdiatement que le mariage dont la dissolution est
demande nest pas effectivement ou actuellement polygamique ; il se
trouve seulement quil a t form selon une loi qui considre avec faveur
la polygamie ou plus exactement la polyginie. Nanmoins, ce mariage en
fait monogamique va tre rput polygamique ; cest linstitution (avec son
rgime) qui est prise en compte in abstracto, ce nest pas la relation
matrimoniale vcue.
Appel connatre de cette demande en divorce, Sir J.P. Wilde (futur Lord
Penzance) remarque quil ne peut accorder le divorce que sil y a un
mariage valable et non dissous entre Mr Hyde et Mrs Hawkins et que, si tel
est le cas, la conduite de la femme doit tre value en tant que cause de
divorce dans son rapport avec le comportement de Mr. Hyde. Or, y bien
rflchir, il lui semble quil est difficile dadmettre que
lunion de lhomme et de la femme telle que pratique et adopte par les
Mormons [soit] vraiment un mariage dans le sens retenu ici, la Matrimonial Court
dAngleterre, et [que] des personnes ainsi unies pouvaient tre considres mari et
femme au sens que reoivent ces mots dans la loi sur le divorce .
Pour tablir son opinion, Sir J.P. Wilde sapplique dabord dfinir la
conception du mariage dans la lgislation anglaise : le mariage est un
contrat, mais aussi une institution, laquelle confre un statut impliquant
droits et devoirs respectifs pour ceux qui lont fait natre et dont les
lments essentiels conduisent la dfinir comme
une union volontaire et pour la vie dun homme et dune femme, lexclusion
de tous les autres .
Ceci acquis, la surface du globe, une large fraction de lhumanit tablit
entre hommes et femmes des relations dun autre type ; ce type diffrent est
ingalitaire quoique cette ingalit soit masque par les mots puisque, pour
29
dsigner les sujets de la relation quelle caractrise, sont utiliss les termes
mari et femme. Cependant, il ne faut pas succomber la magie des mots, il
y a mariage et mariage et
lemploi dun terme commun pour exprimer ces deux relations distinctes ne les
transformera pas en une seule et mme chose, quoique ceci puisse entrainer la
confusion chez un observateur superficiel ;
Le rgime juridique du mariage selon la loi anglaise dessine la catgorie et
cest donc en dtaillant et en examinant les droits et devoirs des poux que
dtermine ce rgime que lon pourra constater quil ny a aucune possibilit
de faire entrer une union polygamique dans la catgorie anglaise ; ceci est
dmontr dans les termes suivants :
il est vident que le droit du mariage en ce pays [l'Angleterre] est adapt au
Christian marriage et est absolument inapplicable la polygamie.
Le droit du mariage est ajust au droits et devoirs que le contrat de mariage a, du
commun accord des parties, crs. Ainsi les engagements conjugaux peuvent tre
ramens excution au moyen dun decree for restitution of conjugal rights, dune
ordonnance de rtablissement des droits conjugaux. Ladultre de lune des parties
donne lautre le droit dobtenir une sparation judiciaire ; et ladultre de la
femme donne droit au divorce tandis que celui du mari, associ la bigamie,
encourt la mme sanction. La violence physique, le concubinage public, la
dbauche, latteinte lgalit sociale de la femme avec son mari dans son foyer,
son viction la tte du mnage constituent chez nous des offenses matrimoniales,
car elles violent les engagements du mariage. Une pouse ainsi bafoue peut
demander une sparation judiciaire et le soutien financier permanent de son mari
titre daliments proportion denviron un tiers du revenu de celui-ci.
Si ces dispositions et remdes taient appliqus des unions polygamiques, la cour
serait amene crer des devoirs conjugaux et ne se bornerait pas en ordonner
lexcution et elle prescrirait des remdes l o il ny a pas doffense. Car il serait
vraiment injuste et plutt absurde de rechercher un homme qui, au sein dune
communaut polygame, a pous deux femmes, parce que selon notre conception
du mariage, son comportement quivaudrait un adultre coupl une bigamie,
alors mme quil serait dsormais divorc de la premire. Et il ne serait ni plus
juste ni plus sage de sefforcer de le contraindre traiter celles avec lesquelles il a
contract mariage, au sens polygamique de ce terme, comme le prvoit le statut
que confre le Christian mariage .
On relvera ne serait-ce quen passant que la dmonstration tendant
tablir lincompatibilit entre Christian marriage et union polygamique
tourne autour du sort fait lpouse, alors quen la cause ce nest pas Mme
Hawkins qui se plaint dtre bafoue, mais cest M. Hyde qui dnonce
ladultre. Par rapport lespce, le raisonnement est un peu dconcertant.
La conclusion simpose nanmoins : lordre juridique anglais est rfractaire
lunion
polygamique ;
le
dsaccord
axiologique
dtermine
une
incompatibilit technique qui tient ce type de relation exotique lcart de
30
la catgorie mariage, Christian marriage ou, plus exactement et britannico
modo, lui interdit dentrer dans la machinerie matrimoniale des cours
dAngleterre , comme le dit J.D. MCLEAN12. Cest bien ce quexprime le
futur Lord Penzance :
Si, alors, les dispositions adaptes de notre systme matrimonial ne sont pas
applicables une union telle que la prsente, y en a-t-il quelque autre laquelle la
Cour puisse recourir ? Nous navons pas en Angleterre de loi conue lchelle de
la polygamie ou ajuste ses exigences. Et il est permis de douter quil arrivera
aux tribunaux de ce pays de sanctionner les devoirs (mme ceux que nous
connaissons) inhrents un systme si compltement en dsaccord avec la
conception chrtienne du mariage et si rvoltant du point de vue des ides que
nous cultivons sur la position sociale quil convient daccorder au sexe faible .
On peroit bien lobstacle : le droit anglais nest pas quip pour traiter ce
genre dunion et ds lors ceux qui, comme M. Hyde, demandent un remde
judiciaire ne peuvent que sadresser ailleurs. Il faut le souligner : le juge
Wilde, en bon anglais, prfre lapproche analytique en ce quelle conduit
accorder la priorit aux lments techniques : les droits et devoirs
composant en Angleterre le statut du mariage sont la ralit de ce statut qui,
en lui-mme, nest quune abstraction commode et opratoire sur le plan du
raisonnement ; ce nest pas ce statut que sajuste le pouvoir du juge
anglais, cest aux spcificits des droits et des devoirs incombant ceux qui
sont husband and wife ; aussi bien ceux qui prtendraient cette qualit de
gens maris alors que leur relation sest organise sans imposer des droits
et devoirs correspondant ceux que connat la loi anglaise nobtiendront
rien du juge anglais, lequel ne dispose pas de loutillage adquat et doit
donc opposer une fin de non recevoir toute demande qui tendrait la mise
en uvre de linstitution trangre.
Cette posture foncirement nominaliste est caractristique de la culture
juridique anglaise qui se mfie des mots, certainement, mais surtout des
concepts que les mots vhiculent. En se limitant larsenal judiciaire
assurant la protection juridique du mariage dans lordre juridique anglais,
Sir J.P. Wilde refuse dexploiter la caractre synthtique du concept de
12
DICEY and MORRIS, Ch. 17 137
31
mariage13 et donc se prive dlibrment des ressources de llasticit que
ce caractre synthtique confre ce concept de mariage.
Mais cette posture nempche pas de manier labstraction. En effet, lunion
entre M. Hyde et Mme Hawkins ntait pas effectivement polygamique ; le
caractre polygamique ntait pas ralis, pas concrtis et M. Hyde
paraissait dailleurs ntre en rien enclin prendre une seconde pouse
avant dtre dgag des liens de sa premire union : il demandait le
divorce. Aussi bien ce que stigmatise le juge Wilde cest le mariage clbr
aux conditions dune lgislation autorisant la polygamie, cest linstitution et
non pas la pratique polygamique, laquelle peut aussi bien se dvelopper
hors de linstitution matrimoniale monogamique (dlit de bigamie) comme la
pratique monogamique peut tre adopte dans linstitution matrimoniale
polygamique.
il est suggr que le droit matrimonial de ce pays peut tre convenablement
appliqu la premire dune mme srie dunions polygamiques ; que cette cour
serait fonde traiter pareille premire union comme un mariage chrtien et, le cas
chant, les unions subsquentes comme nulles ; [galement fonde traiter] la
premire femme prise pour pouse comme l pouse au sens de la loi sur le
divorce et toutes les autres comme des concubines. Les incohrences qui
rsulteraient dune tentative de ce genre sont assez dconcertantes. Daprs les
dispositions de la loi sur le divorce, le devoir de cohabitation est sanctionn lgard
de lun la demande de lautre, dans un procs en rtablissement des droits
conjugaux. Mais ce devoir nest jamais impos lun si lautre a commis ladultre.
En consquence, un mari mormon qui a pous une seconde femme serait inligible
ce remde et cette cour ne pourrait daucune manire laider recouvrer la
compagnie de son pouse si elle choisit de le quitter .
Donc, pas daction en divorce pour M. Hyde ; le juge dAngleterre na pas
modifier linstitution dans laquelle le demandeur a choisi dentrer lorsqu
Salt Lake City, il a obtenu de Bringham Young, fondateur et pasteur de
lglise des Mormons, dtre mari Mme Hawkins. Ainsi lincompatibilit
technique entre droit anglais des causes matrimoniales et droit mormon du
Territoire de lUtah permet de sanctionner le dsaccord axiologique, le
dsaccord sur le terrain de lopportunit, comme disait NIBOYET. De cette
manire, la situation concrte est escamote. Le juge sappuie sur une
13
A vrai dire ctait aussi la position de Bartin que son particularisme accentu portait clairement au
nominalisme : une institution trangre dont la lex fori est hors dtat de fournir la qualification est une
institution qui rpugne son esprit et dont le juge par consquent na pas tenir compte, raison de ce
quon a si improprement appel lordre public international BARTIN, De limpossibilit darriver la
suppression dfinitive des conflit de lois , JDI 1897, p. 468.
32
incompatibilit technique qui, en la cause, ne se vrifie pas : pour autant que
le divorce de Mme Hawkins nest pas reconnu (et il ne doit pas ltre, la
comptence tant en la matire rserve au juge du domicile du mari, en
Angleterre), il y a bien eu adultre de la femme attest par la multiplication
de sa progniture en contravention avec lengagement de fidlit propre
lpouse, mme dobdience mormone ; la sanction de ladultre de la
femme ne rencontrait ds lors aucun obstacle technique et elle naurait en
rien altr linstitution exorbitante ni linstitution du for. Largument de la
modification de linstitution trangre ne valait pas en lespce alors quen
effet il aurait pu valoir en dautres circonstances et justement en celles
quvoque Sir J.P. Wilde. Cest ce qui explique pourquoi celui-ci, dans sa
dmonstration, considre de manire presque exclusive le sort de lpouse
in genere et non pas celui de M. Hyde, in specie. Il y a l une espce de
dnivellation du discours qui permet la censure de linstitution trangre au
prtexte de ses caractristiques techniques. Et cette censure rejaillit sur la
relation particulire entre M. Hyde et Mme Hawkins.
De la sorte, lopposition du technique et de lopportun en prend un coup.
Mais le coup est moins douloureux pour NIBOYET que pour M. Hyde qui, au
plan international, se trouve irrmdiablement mari la femme dun autre
lequel autre occupe une position symtrique, quoique peut-tre plus
confortable puisquen possession de lpouse. Le droit anglais censure la
polygamie en son sein, mais il la favorise lchelle internationale. La
solution nest pas satisfaisante. Au demeurant, le refus de considrer comme
un mariage lunion polygamique qui ne serait mme que potentiellement
polygamique, cdera devant la gravit des consquences qui sy attachent :
les enfants ns de lunion de M. Hyde et de Mme Hawkins au cours de leurs
trois annes de vie conjugale ne seraient pas ns du mariage et, vrai dire,
resteraient sans filiation lgard de leur pre, ce qui terme les carterait
de la succession de celui-ci, tandis que M. Hyde pourrait contracter en
Angleterre de premires noces avec une seconde pouse sans tre libr
de sa premire union La jurisprudence anglaise nest jamais alle jusquau
bout de ces consquences ; elle a admis les enfants la succession de leur
33
pre, en qualit denfants lgitimes (The Sinha Peerage Claim, [1946] I All
E.R. 348) et elle a aussi accept la recevabilit de la demande de divorce
que la seconde pouse, Anglaise dorigine domicilie en Angleterre, avait
forme contre son mari devant les tribunaux anglais lorsquelle eut
dcouvert par hasard que celui-ci tait encore dans les liens dune premire
union au moment o il lpousait (Bandail v. Bandail, [1946] P. 122). Le
lgislateur embotera le pas et aujourdhui la solution de Hyde v. Hyde qui
interdit laccs aux remdes du droit anglais aux parties une union
polygamique est abandonne du fait de son abolition par le Matrimonial
Proceedings (Polygamous mariages) Act 1972 (devenu section 47 du
Matrimonial Causes Act 1973) et on peut considrer que les unions
polygamiques sont reconnus comme mariage de manire gnrale par le
droit international priv anglais (for most purposes). Le concept de mariage
sest largi et dborde les limites du Christian marriage pour absorber des
formes dunion indiffrentes au paramtre de lgalit des poux et
obissant non pas la structure du millefeuilles mais la structure stellaire
caractristique de la polygamie.
Mme ainsi dmenti par lvolution ultrieure, cet arrt de 1866 reste
intressant dans son rapport avec les dcisions manes des cours dappel
franaises prcdemment tudies. Il est intressant par la similitude des
rsultats pratiques atteints, mais il est intressant surtout par tout ce qui le
spare des dcisions franaises :
- assimilation, dun ct, et non-assimilation, de lautre, des deux types
dunions qui peuvent tre perus ou non comme deux rponses possibles au
mme problme, ou comme un effort tendant aux mmes fins de part et
dautre, mais aboutissant des solutions variant en fonction des donnes
locales - ces fins tant toujours de rgler les relations que la diffrenciation
sexuelle rend invitables et ce rglement se faisant sur le mode
institutionnel, de manire discipliner les sujets et prvenir, autant que
faire se peut, les dsordres que ne manquerait pas de provoquer dans la vie
sociale une comptition libre et ouverte en permanence dans la recherche
34
du partenaire et qui risquerait fort dtre prjudiciable lentretien et
lducation des enfants.
- dun ct, exploitation du caractre synthtique du concept de mariage,
par rduction de sa comprhension qui ne couvre plus que limplication par
le moyen dun acte solennel de socialisation de deux personnes de sexe
oppos dans une relation dure indtermine; seule subsiste, avec lacte
de socialisation, la complmentarit des sexes, sont limines lgalit, la
mutualit, la rciprocit De lautre ct, approche analytique de
linstitution du for, dcompose en ses divers lments saisis selon la
configuration spcifique que leur donne le droit interne du for, dont il
apparat alors clairement quils ne sont pas fongibles avec ceux de
linstitution exorbitante et quils se conjuguent pour constituer un verrou
interdisant laccueil de celle-ci dans lappareil juridique mis en place par le
for.
Avec cette approche victorienne , pourrait-on dire, le concours de lordre
juridique du for la mise en uvre ou la sanction de linstitution
exorbitante devient impossible et il faut donc rejeter la demande forme
devant la juridiction anglaise. Avec lexploitation du caractre synthtique,
au contraire, lordre juridique du for prend le risque davoir doter la
relation trangre deffets juridiques dont la teneur et lconomie nont pas
t conues pour celle-ci ; la difficult se prsentera chaque fois que les
conditions de formation et les effets, comme en matire de mariage,
obiront des lois distinctes. Pour conjurer le danger, les juges peuvent
parfois sabandonner la tentation dinterprter les faits de la cause de telle
manire quils se sentent autoriss conclure que la relation exorbitante na
pas t valablement constitue : quod nullum est, nullum effectum producit
La menace est ainsi neutralise.
Mais il ne faut pas trop accuser les diffrences releves sur les deux rives
de la Mer Manche. La jurisprudence franaise a aussi pratiqu loccasion
lapproche victorienne . Le cas est clbre ; il sagit de laffaire De Cousin
de Lavallire qui a donn lieu un arrt de la Cour de Nmes du 17 juin
35
192914, lequel a rsist un pourvoi en cassation, rejet par la Chambre des
requtes le 14 mars 193315. M. le Professeur FADLALLAH a consacr dans sa
thse de doctorat16 cette affaire quelques pages particulirement
clairantes quil faut recommander la lecture de quiconque sintresse au
sujet ; il est probable quelles auront inspir ce qui suit.
Henri de Cousin de Lavallire tait, au dbut de 20e sicle, administrateur
aux colonies, en poste Kankan, en Guine franaise. Le 6 novembre 1904
(approximativement, car la date na pas t enregistre au moment des
faits), il pouse dans les formes de la coutume locale devant le cadi et avec
versement dune dot, Mlle Kondi Kaba, appartenant la race ngre 17.
Lintensit des flicits conjugales dpasse sans doute toutes les esprances
de M. de Cousin de Lavallire ; comme Mlle Fantou Diana Kaba, sa bellesur, est disponible sur le march matrimonial, il pense redoubler son
bonheur et, moins dun mois de sa premire union, il pouse la cadette,
toujours selon le rite de la coutume indigne qui parat fortement islamise.
De ces deux unions naissent trois enfants Jean, Gaston et Paulette, quon ne
songe pas rpartir entre les deux lits qui peut-tre nen faisaient quun.
Au dcs de lheureux pre qui les a institus lgataires universels, les trois
enfants se heurtent aux apptits de leur grand-mre quils ne connaissent
gure, bien quils aient t duqus en France o celle-ci rside. Mme mre
de Cousin de Lavallire prtend recevoir le huitime de la succession de
son fils, ce qui constitue la part de rserve que larticle 915 de lpoque
attribue lascendant en prsence denfants naturels du dfunt. Jean, Gaston
et Paulette protestent quils sont enfants lgitimes et quen consquence, ils
priment leur grand-mre dans la succession qui ne peut se prvaloir
daucune rserve.
Il sagit donc de savoir sil y a bien eu mariage entre M. ladministrateur aux
colonies et les demoiselles Kaba.
A vrai dire, il nest pas contest qu supposer la preuve de leur clbration
rapporte, les unions sont frappes de nullit, car les conditions de
formation du mariage poses par le droit franais et applicables M. Cousin
de Lavallire nont pas t respectes. Mais les enfants de Cousin de
Lavallire prtendent que ces mariages nuls doivent tre assortis du
bnfice de la putativit en raison de la bonne foi des demoiselles Kaba lors
de leur conclusion; il en rsulterait que les demoiselles Kaba devraient tre
considres comme des pouses lgitimes et que les enfants devraient tre
rputs tout autant lgitimes.
Mme de Cousin de Lavallire tant dcde en cours dinstance, celle-ci est
reprise par sa fille, pouse de Bernardie, qui soutient, dune part, que la
preuve des mariages nest pas rapporte et, dautre part, que la bonne foi
des demoiselles Kaba faisait dfaut.
14
S. 1929. 2. 129, note Solus, RTDciv, 1929. 1069, obs. E. Gaudemet
S. 1934. 1. 121, concl. Pilon, note Solus, RTDciv 1933. 452, obs. G. Lagarde
16
I. FADLALLAH, La famille lgitime en droit international priv, Dalloz, 1979, n. 16-21
17
Nmes, 17 juin 1929, prc.
15
36
Aprs le Tribunal dAvignon, la Cour de Nmes donne raison Mme de
Bernardie. Les consorts de Cousin de Lavallire sont des enfants naturels qui
doivent supporter la rserve hrditaire attribue leur grand-mre.
La cour liquide dabord la question de preuve. Il ny a pas dactes de
mariage, ce qui sexplique par labsence dorganisation de registre de ltat
civil Kankan au moment des prtendues clbrations. Il y a sans doute des
certificats
de
mariage
tablis
sur
tmoignages
par
les
autorits
administratives de la colonie, mais dlivrs 24 ans aprs les faits, ces
certificats sont jugs non fiables par la cour, qui refuse par ailleurs
dordonner la mesure dinstruction que sollicitent les enfants. Il ny a pas
lieu, dit-elle, de prouver les mariages car ce qui est allgu tre des
mariages nen seraient pas en ralit et ne pourraient servir de support la
putativit.
Pour fermer ces unions laccs la catgorie mariage, la Cour de Nmes se
rfre aux rgles du droit civil franais du mariage ; il ny a pas eu
clbration par lofficier de ltat civil, il ny a pas eu publication des bans
la mairie du domicile de M. de Cousin de Lavallire, il ny a pas eu
consentement mariage des demoiselles Kaba et la condition de
monogamie a t viole. Pour la cour, ces unions contractes selon le rite
musulman devant le cadi et avec versement de la dot, mais qui ne satisfont
pas les conditions fondamentales du droit franais ne peuvent tre
considres comme de vritables mariages.
il sagit en ralit dapprcier si les formalits diverses auxquelles a pu se
prter de Lavallire en novembre et dcembre 1904 peuvent tre considres
comme constitutives dun vritable mariage, quels que soient les vices qui
pourraient en permettre lannulation ; - Attendu que lignorance complte dans
laquelle se trouvaient les dames Kaba dun tat des personnes tout diffrent du leur
permet davoir la certitude quelles nenvisageaient nullement la fondation dune
famille au sens de la loi franaise ; quelles nattendaient de leurs unions quun
tablissement plus ou moins durable, leur assurant des avantages matriels et une
protection personnelle ; quelles navaient pas t pralablement consultes et
quainsi faisait dfaut le consentement sans lequel il ne saurait y avoir de mariage
(article 146, c. civ.) ; quen cette matire lordre public est particulirement
intress ; que le respect de ses prescriptions simpose toute personne, et qu
lvidence, il naurait pu tolrer quun haut fonctionnaire donnt lexemple
scandaleux de la bigamie ; que lintention commune des parties contractantes tait
assurment de laisser leur porte restreinte ces unions , que ne constatait aucun
acte, et dont la dissolution tait toujours possible par simple rpudiation sous la
seule condition de non restitution de la dot .
37
Cest la mme technique que celle de mise en uvre par Sir J.P. Wilde dans
larrt Hyde v. Hyde : en entrant dans une institution dont les composantes
ne correspondent pas aux exigences du droit franais de la formation du
mariage, les intresss nont pas consenti un vritable mariage ; ds lors,
faute de mariage il ny a pu y avoir de mariage putatif.
Jean, Gaston et Paulette se pourvoiront en vain devant la Cour de cassation.
La Chambre des requtes rejettera le pourvoi, mais sans adhrer tout fait
au raisonnement de la Cour de Nmes. Son arrt nonce en effet que
la cour dappel, se fondant sur les faits et documents de la cause quelle numre
et apprcie souverainement, a considr que les dames Kaba navaient pu croire,
de bonne foi, contracter des unions produisant, notamment au regard des enfants,
les effets de mariages lgitimes ; do il suit, abstraction faite de certains motifs
critiqus par le pourvoi, qui sont surabondants, que larrt attaqu, lequel est
motiv et ne contient pas de contradiction dans ses motifs, na viol aucun des
textes viss au moyen
Ce nest pas dire ici quil ny a pas eu mariage, cest dire seulement quen
raison du dfaut de bonne foi dtect par la Cour de Nmes, il ny a pas pu y
avoir mariage putatif ; la Cour de cassation nexclut pas que le mariage
contract more islamico soit un vritable mariage, et elle lexclut si peu en
la cause quelle relve seulement de dfaut de bonne foi des dames Kaba,
or ce dfaut de bonne foi na de porte que sil y a eu mariage ce que nie
la Cour de Nmes ; nanmoins, elle a eu raison de rejeter les prtentions
des enfants de Cousin de Lavallire qui, daprs ses apprciations de fait,
ne bnficient pas de la lgitimit dont les aurait dot la putativit des
mariages clbrs en la forme coutumire locale.
Ainsi la Chambre des requtes sauve larrt de Nmes sans lapprouver
entirement ( motifs critiqussurabondants ) et elle reste sur la ligne
qui se tend entre larrt Zermati-Souissa de la Cour dAlger de 1910 et
larrt de la Cour dappel de Hano de 1949 : il y a bien mariage, mais
dnu de consquences pratiques et, il est vrai ici, dautant plus dnu de
consquences pratiques que le mariage est nul.
Mais la Cour de cassation na pu en rester l. Elle a fini par admettre
quun mariage polygamique contract ltranger en conformit avec la loi
nationale des intresss non seulement constitue un vritable mariage et
38
doit tre dclar valable dan s la mesure o il respecte les exigence des
lois applicables aux conditions de formation du mariage, mais encore
produit en France tous les effets qui ne sont pas contraires lordre public.
Le pas a t franchi avec larrt Chemouni du 24 janvier 1958.
Un isralite tunisien, Flix Chemouni, pouse en Tunisie, en la forme
religieuse mosaque, Esther Valensi, Franaise, le 30 juillet 1940 ; puis, il
clbre sa manire la fin de la seconde guerre mondiale en pousant
toujours en Tunisie la veille de larmistice, le 7 mai 1945, Henriette Krieff, sa
coreligionnaire et compatriote. Il sagit dun mariage polygamique autoris
par
la
loi
tunisienne qui
sen
remet
sur ce
point
un
usage
confessionnel local ; la polygamie ne sera interdite en Tunisie quen 1956.
Avec ses deux pouses et les enfants issus des deux unions, Chemouni
stablit en France o lentretien dun double mnage lui parut assez vite
draisonnable ; aussi et peut-tre anim du dsir se conformer aux murs
de son pays daccueil, il abandonne une de ses pouses : il conserve la
premire - prior tempore, potior jure - et rejette la Tunisienne Krieff. Celleci est alors contrainte de demander plusieurs reprises aux juridictions
parisiennes de condamner Felix Chemouni contribuer aux charges du
mariage. Statuant en appel contre une dcision qui navait fait droit la
demande de Mme Krieff que dans des proportions trop limites, le Tribunal
civil de la Seine (30 mars 1955) savise de ce que Felix Chemouni, en
sinstallant en France, aurait perdu son statut personnel tunisien et de ce
que la loi franaise ne pouvait donner effet une union contraire lordre
public ; le tribunal en conclut que Mme Krieff ne peut rclamer des
aliments.
Le jugement est cass sur pourvoi de Mme Krieff au motif principal que
la demande de la dame Chemouni-Krieff tendait uniquement se voir
reconnatre en France une crance alimentaire dcoulant de sa qualit dpouse
lgitime, qualit acquise sans fraude, en Tunisie, en conformit avec sa loi
nationale comptente .
Ce serait une interprtation incomplte, rductrice de larrt que de
restreindre celui-ci au traitement dun problme de reconnaissance dune
39
situation constitue ltranger. La question del validit de lunion
polygamique nest pas oublie ; elle est mme rsolue et elle est rsolue
cest ce qui importe ici par application de la loi personnelle des
intresss. Autrement dit le problme de reconnaissance renferme la
question de la validit de la seconde union. Et cette question de la validit
est immdiatement perue par la Cour de cassation comme une question de
loi applicable aux conditions de fond du mariage. Cest dire que
lhypothse polygamique noffre end pit de son exotisme aucune
rsistance la qualification mariage ; elle se loge sans difficult dans la
catgorie. Les prcdents mans des Cours dappel (Alger 1910 et Hano
1949) comme dailleurs celui que constitue larrt de Cousin de Lavallire, le
laissaient prvoir. Mais la diffrence est ici que cet accueil de lunion
polygamique dans la catgorie mariage nest pas un simple coup dpe
dans leau, une pure abstraction ; en effet, il porte consquence puisque la
Cour de cassation censure le jugement qui avait refus les aliments.
Assurons-nous rapidement de cette conscration de la qualification
mariage.
La Cour vise larticle 3, alina 3 du code civil. Par quoi elle ne se contente
pas dannoncer que le ressort de la cassation quelle prononce est
lattnuation de lexception dordre public. Sans doute aussitt aprs le visa
reprend-elle dans un chapeau la formule de larrt Rivire18 :
Attendu que la raction lencontre dune disposition contraire lordre public
nest pas la mme suivant quelle met obstacle lacquisition dun droit en France
ou suivant quil sagit de laisser se produire en France les effets dun droit acquis
sans fraude ltranger et en conformit avec la loi ayant comptence en vertu du
droit international priv franais
Mais il faut relever que le visa mentionne expressment lalina 3 de
larticle 3. Pareille indication nest pas inspire par le jeu de lordre public
quil intervienne avec effet plein ou avec effet attnu. Sil ne stait agi que
de cela, la mention de larticle 3, sans prcision dun quelconque alina,
aurait suffi larticle 3 jouant un rle un peu particulier, puisquil est la
disposition emblmatique sous la quelle la Cour place les censure fondes
18
Cass. civ. 17 avril 1953, Grands arrts , n 26
40
sur le rgles relevant, comme lexception de lordre public, de la thorie
gnrale des conflit de lois. A la limite, la cour aurait encore eu la
possibilit de viser larticle 3, alina 1er qui a beaucoup servi pour les lois
quon appelait parfois dordre public ou de police lesquelles taient censes
ne sappliquer que sur le territoire ; en lespce, le rejet de la polygamie
entre trangers auxquels elle nest pas interdite par leur loi personnelle se
cantonne au territoire national Le jugement du Tribunal de la Seine aurait
viol larticle 3, alina 1er.
Ce nest pas ainsi que la Cour voit les choses. La rfrence lalina 3
marque clairement le parti de la Cour : lordre public tant brid par le jeu
de son attnuation, ne reste active pour soutenir la cassation que la rgle de
conflit de lois relative au statut personnel. Il y a dautant moins dquivoque
sur ce point que, parmi les conditions justifiant le jeu de leffet attnu de
lordre public, larrt rappelle en termes exprs lexigence formule et
dj mise en uvre par larrt Rivire, dune acquisition dun droit
ltranger qui soit en conformit avec la loi ayant comptence en vertu
du droit international priv franais .
Satisfaire cette condition ne demande rien dautre que lapprciation de la
validit de lacquisition de la qualit dpouse selon la loi que dsigne la
rgle de conflit franaise. La reconnaissance de lunion polygamique
incorpore la question de la validit du mariage. Et cette question appartient
aux yeux de la Cour de cassation
la loi nationale comptente, loi
nationale des intresss, qui est la loi tunisienne au moment de la
clbration. Il ny a pas de doute, lunion polygamique est bien, comme
cela avait t annonc, traite par le systme franais de rglement de
conflit comme un mariage et larrt nhsite pas lui laisser produire les
effets dun mariage en France et spcialement leffet alimentaire.
Cette affaire, on le sait, ne sarrtera pas l. Chemouni sopinitrera et il
reviendra la charge devant la juridiction de renvoi ; il soutiendra que
depuis le jugement du Tribunal de la Seine cass en 1958, les donnes du
problme ont chang : il est devenu Franais (tant parvenu dissimuler ou
41
faire oublier son tat de bigamie qui aurait du faire obstacle sa
naturalisation) et il prtendra quen qualit de franais, il lui est interdit par
sa loi nationale dentretenir simultanment deux pouses. Largument ne
fera pas impression sur le Tribunal de Versailles19 et Chemouni sera
confirm dans sa dette daliments. Il se pourvoira en cassation, mais sans
succs ; le 19 fvrier 1963, la Cour de cassation rejette son pourvoi20. Il
nest pas indispensable de revenir ici sur cette seconde dcision de la Cour
de cassation, car la messe est dite : pour exorbitante quelle soit,
linstitution du mariage polygamique est prise en charge par le systme
franais de conflit au prix dun rtrcissement de la notion de mariage qui
permet llargissement de la catgorie21.
Il nest pas facile de trouver dans la jurisprudence franaise de droit
international priv des exemples dinstitutions qui soient exorbitantes en
raison de diffrences axiologique et qui aient oppos une pareille
rsistance lopration du rglement de conflit, et plus spcialement
lopration de subsomption ncessaire aux choix de la rgle de conflit
mettre en uvre. Dailleurs, mme avec lunion polygamique la rsistance
dans le droit franais na pas t frontale et dtermine ; cette rsistance
semble plutt avoir t feutre au contraire de ce qui sest pass en
Angleterre. Aussi bien il se pourrait que les pripties auxquelles a donn
lieu lunion polygamique rendent justice NIBOYET selon qui le dsaccord
qui surgit dans le domaine axiologique, dans le champ de l opportun ,
profiterait dune marge de tolrance qui permet habituellement
dassurer le fonctionnement du systme de conflit et spcialement de
lopration de qualification, alors qu lgard des diffrences de caractre
technique, la libert sera trs limite22 parce que l, en effet cest
absolument comme en matire de mcanique, o il existe une limite
19
Trib. gr. inst. Versailles, 2 fvrier 1960, Rev. crit., 1960. 370, concl . Lemant, note Francescakis, JCP
1960. II. 11625, concl. Lemant, obs. Louis-Lucas
20
Grands arrts, n 31
21
Cet largissement nest pas admis pour lunion polygamique en matire de regroupement familial,
CESEDA art. L 411-6, mais il sagit alors dune question de reconnaissance.
22
NIBOYET, Trait, op. cit., p. 502.
42
mathmatique de rsistance23 . Cette dernire affirmation demandera
tout de mme tre vrifie mme si il a pu tre remarqu que le
verrouillage qui a t tent lendroit de lunion polygamique par Hyde v.
Hyde ou par larrt de Cousin de Lavallire cherchait son ressort du ct des
incompatibilits techniques24. Quoi quil en soit cela na pas suffi mettre
lunion polygamique hors jeu.
Au del de cette institution et toujours dans les parages du mariage, il
faudrait mentionner le lvirat. Institution passablement exorbitante dont Cl.
LEVY-STRAUSS
a repr la pratique chez certaines tribus indiennes de
lAmazonie brsilienne25, mais qui appartient aussi lAntiquit puisquelle
tait familire aux Egyptiens, aux Babyloniens et aux Hbreux. Dailleurs le
lvirat a survcu au Maghreb notamment chez les Isralites et cest ainsi
que la rencontr la jurisprudence franaise. Il est encore vivace, plus au
Sud en Afrique, au Burkina-Faso, au Togo, au Tchad et au Sngal et, bien
sr, la prsence franaise dans ces pays aurait pu favoriser les contacts du
droit franais avec cette institution exorbitante.
A quoi tient ce caractre exorbitant ? Le lvirat consiste dans lattribution
de lpouse du dfunt au frre de celui-ci qui il revient de prendre le
relais en qualit dpoux : la veuve passe du frre mort au frre vif. Dans le
droit coutumier africain, cette attribution se fait titre successoral. Voici
comment M. Serge BILLARANT prsente linstitution dans sa thse de
doctorat :
Au dcs de son mari, [la veuve] devient un lment de lhrdit. La veuve est
une chose faisant partie de la masse successorale dont la gestion est partage,
comme tout autre bien de la succession, entre les hritiers du de cujus. Autrement
dit, la veuve est une valeur patrimoniale transmissible cause de mort ; elle est un
lment de lactif successoral. Ds lors quil est inconcevable de partager la
veuve en nature, la dvolution de celle-ci est organise de la manire suivante
[] : LAhossi est attribue en remariage, du moins si elle est encore jeune, aux
frres du dfunt, par ordre dcroissant dans lchelle des ges ; si les frres du
dfunt refusent, ou sils nexistent pas, alors un autre bnficiaire peut tre
dsign, comme un oncle du de cujus ou lun de ses cousins 26.
23
NIBOYET, op. cit., p. 499.
V. supra, p. 25-26, p. 30.
25
C. LEVY STRAUSS, Tristes tropiques, Plon d., coll. Terrre Humaine, p. 422
26
S. BILLARANT, Le caractre substantiel de la rglementation des successions internationales. Rflexions sur
la mthode conflictuelle, Dalloz, 2004, n.348 et s. p. 394 et s.
24
43
Au regard de la loi mosaque, cette dimension successorale est nettement
moins marque. Il semblerait que le lvirat soit conu dans lintrt mutuel
de la veuve, dune part, qui a besoin dun protecteur dans la vie civile pour
elle-mme, et de la famille de son mari, dautre part, qui porte intrt la
femme que le dfunt avait attache au lignage en lacqurant dans la vue de
perptuer celui-ci ; dailleurs si le dcs est intervenu aprs que cette
fonction de perptuation de la famille du mari a t satisfaite par la
naissance denfants, la veuve est libre du devoir dpouser son beaufrre. Ce nest que si le mariage na pas produit denfant que le mcanisme
du lvirat se dclenche. Il incombe alors au beau-frre de suppler le mari
dfunt.
Que ce soit la version africaine ou la version hbraque, il est malais de
subsumer la relation tablie par ce procd du lvirat sous la catgorie
mariage. La difficult apparat aussitt si on se souvient du rle
prpondrant que remplit dans cette institution le consentement ou encore
celle dgalit des poux. Il est clair que la libert matrimoniale est
srieusement entame par ce mcanisme de rpartition des femmes entre
les gniteurs et il est tout aussi clair que la femme qui se marie entre dans
une condition subordonne celle de son mari, dont elle est une espce de
dpendance personnelle et ventuellement patrimoniale.
Aussi bien faut-il regretter avec M. BILLARANT que le corpus jurisprudentiel
franais ne propose gure de dcision affrontant la question de la
qualification que peut soulever le lvirat. Cette carence est avre pour ce
qui est du lvirat africain, elle nest pas totale pour le lvirat mosaque. M.
BILLARANT cite trois dcisions de juridictions du fond qui auraient esquiv la
difficult en dclarant le lvirat contraire lordre public, ce qui dans leur
esprit les aurait dispens de rechercher la loi applicable et partant de
choisir la rgle de conflit mettre en oeuvre27. En ralit si les deux
premires dcisions, des jugements dAlger et de Tunis, peuvent tre ainsi
interprts, ce nest pas tout fait le cas du troisime arrt, qui a t
27
Trib. Alger 19 dcembre 1845, Jurispr. alg., 1846. 22 ; Trib. Tunis, 5 juin 1907, JDI 1908 et dans la
mme affaire sur appel, Alger 14 avril 1908, JDI 1909. 757, note J. P.
44
prononc par la Cour dappel dAlger. Mais cet arrt nest que la
prfiguration28 dune quatrime dcision, mane, elle aussi, de la Cour
dAlger et qui est tout aussi intressante ; la Cour dappel dAlger le 26
janvier 1911 avait statuer sur lespce suivante :
Joseph Houri, Isralite tunisien, protg italien, est mort en Tunisie sans enfant en
laissant une veuve et trois frres. Ceux-ci agissent contre la veuve qui au dcs de
son mari a fait mettre sous scells lensemble des biens de la succession. Lun des
trois frres exerce le lvirat qui est prsent par le tribunal comme
une institution de droit mosaque aux termes de laquelle lorsquun isralite
dcde sans enfants, ses frres, par rang dge ont le droit dpouser la veuve de
faon continuer la famille ; et le frre qui exerce le lvirat hrite des biens du
dfunt, pour les transmettre aux enfants natre du nouveau mnage ; suivant la
mme loi la veuve nest libre de cette obligation quaprs avoir mis
successivement, par ordre de primogniture, ses beaux-frres en demeure de
lpouser et avoir obtenu deux une espce de mainleve appele Halitza (ou
dchaussement)
Ainsi, en cas de rsistance des beaux-frres, la veuve recouvre sa libert
matrimoniale, mais non sa dot. Mais en loccurrence la question de la dot se posait,
car le beau-frre dnomm Chaloum qui avait exerc le lvirat stait ensuite
ddit. Cette drobade emporta condamnation des frres en qualit de successeurs
verser la veuve 6000 frs titre de dot et une pension de 100 frs par mois jusqu
rpudiation. Quant Chaloum, il fut condamn en premire instance payer un
augment de 3000 frs et une somme de 600 frs de dommages-intrts et il lui fut
enjoint de rpudier la veuve sous astreinte de 20 frs par jour29. La dcision a t
confirme en appel par la Cour dAlger sauf rduire de moiti les dommages
intrts mis la charge de Chaloum.
28
Alger, 14 avril 1908, prc., : LA COUR : - [] Sur le second moyen : - Attendu que Ruben Azoula
soutient que la succession de son fils, le mari de lintime [Pia Sarah Attias, Italienne, veuve de son fils
dfunt], est rgie par la loi de Mose ; que ladite intime stant marie sous lempire de ladite loi, ainsi
que cela rsulte expressment de son contrat de mariage, elle ne peut exiger le paiement de sa dot, que
si, aprs stre soumise lobligation du lvirat, elle en est libre successivement par tous les frres de
son mari dfunt ; - Attendu que le lvirat est uen disposition du droit mosaque aux termes de laquelle
lorsquun isralite dcde sans enfants, ses frres, par rang dge, ont le droit dpouser sa veuve de
faon continuer la famille, et le frre qui exerce le lvirat hrite de tous els biens du dfunt pour les
transmettre aux enfants natre de ce nouveau mariage ; - Attendu que , suivant la mme loi, la veuve
nest libre de cette obligation quaprs avoir mis successivement en demeure chacun de ses beauxfrres par ordre de primogniture de lpouser et avoir obtenu deux une sorte de mainleve appele
kalitza ou dchaussement ; - Attendu que le lvirat et la kalitza sont des prescriptions dun autre ge de
la loi de Mose que la morale universelle rprouve avec raison de nos jours ; -Attendu que ces instituions
sont aussi contraires lordre public international et notamment lordre public tel quil rsulte de la loi
italienne qui exige expressment le consentement libre des poux pour la validit du mariage ; Attendu que la veuve Azoula qui est ne et reste Italienne ne saurait tre contrainte sous peine de
perdre sa dot pouser contre son gr lun quelconque de ses beaux-frres ; - Attendu en consquence
que Ruben Azoula ne peut rclamer la veuve Azoula lexcution dune obligation, qui aux yeux de
ladite intime, doit tre considre comme nayant jamais exist ; - Attendu quil doit en tre dautant
plus ainsi quil est de rgle gnrale que les tribunaux franais ne peuvent sanctionner les lois
personnelles dun tranger contraires aux principes de lordre public international [] ; - Par ces
motifs, - Confirme .
29
Trib. Sousse 14 janvier et 8 juillet 1909, rapport par D. BODEN, Lordre public : limite et condition de la
tolrance. Recherches sur le pluralisme juridique, thse Paris 1, 2002, p. 81 ad notam 140
45
Lintrt de cette dcision reste toutefois anecdotique dans la perspective
de laccueil du lvirat par le systme de conflit franais. Cest par
application de la loi mosaque que les condamnations furent prononces,
mais la question de la qualification ne se posait pas dans les termes du droit
international priv; il sagissait dune affaire de droit interpersonnel surgie
dans le cadre du droit colonial dont les catgories taient assez
diffrentes30. En principe, le statut personnel englobait non seulement ltat
et la capacit des personnes mais aussi les relations relevant du droit
patrimonial de la famille et donc les questions de succession. Aussi
comprend-on que le tribunal de Sousse (en Tunisie) ait appliqu la loi
personnelle des divers protagonistes en retenant la motivation suivante :
Attendu que toutes les parties sont daccord pour reconnatre que la succession
devait tre rgie suivant la loi mosaque ; Que daprs les rgles de la loi
mosaque, le rglement de la succession dpend, dans le cas de lexercice du
lvirat ou droit pour les frres du dfunt dpouser la veuve par ordre de
primogniture, droit se manifestant par la remise du kebboudchine ou symbole du
mariage, et en prenant fin que par la halitza ou dchaussement ; que si lun des
frres du dfunt a exerc le lvirat par la remise du kebboudchine, il ne peut plus
exercer la halitza, sauf rupture de lunion, ainsi intervenue, par le guitt ou acte de
divorce 31.
Il y a donc application globale de la loi mosaque, loi personnelle des
intresss qui en sollicitent le bnfice ; cest l une solution conforme au
droit des conflits coloniaux interpersonnels qui conduit au mlange du droit
des personnes, au droit du mariage et au droit des successions comme
celui des rgimes matrimoniaux. Ds lors, il ntait pas ncessaire de
30
V. Parlement de Bordeaux, 1788, Blanche Silva, Vve de Jacob Tells Dacosta c. Daniel Tells Dacosta,
rapport par MERLIN, Rpertoire universel et raisonn de jurisprudence , 5e d., Bruxelles, 1818 , v
Divorce, p. 159 : En 1788, une femme juive nomme Blanche Sylva, se prsenta au parlement de
Bordeaux. Elle avait perdu son poux ; et cet poux avait un frre, nomm Tells dAcosta. Or, cest une
loi parmi les Juifs que le frre dun mari mort sans enfans, est tenu dpouser sa veuve ; ou bien, sil
refuse de faire ce mariage, il doit comparatre la porte de la ville, sasseoir sur une pierre ; et l, en
prsence des vieillards, la belle-sur ddaigne lui te ignominieusement son soulier, et lui crache au
visage. Cette femme demandait donc que son beau-frre lpoust, ce que celui-ci [dj mari de son
ct] ne voulait pas ; ou quil subt la peine de se voir ter son soulier , et cracher au visage : ce quil ne
voulait pas davantage. Les rabbins jugrent la punition ncessaire et indispensable ; mais le beau-frre
nen tint pas compte, et laffaire fut porte devant le parlement de Bordeaux.
Que fit alors le parlement ? Sil et voulu suivre, dans cette affaire, les lois et les usages de la France, il
et proscrit, sans examen, une demande qui y est essentiellement oppose, et rejet avec ddain un
genre de punition qui na rien de commun avec nos murs. Mais ctait sur les lois, ctaient sur les
usages, ctait sur les murs des Juifs, que ce tribunal voulait rgler son opinion et fonder son arrt ; en
consquence, il ordonna que le beau-frre serait contraint, mme par corps, de subir la punition porte
par la loi des Juifs, et prononce daprs cette loi par les rabbins.
Voil donc un tribunal souverain qui adopte les maximes et les usages Juifs, pour prononcer sur de
contestations qui slvent entre les Juifs [] .
31
Trib. Sousse 14 janvier et 8 juillet 1909, prc.
46
confronter le lvirat aux catgories du droit international priv franais. Se
serait-il agi dune affaire de pur droit international priv franais, il aurait
fallu souligner la qualification succession quaurait impliqu les termes de la
premire phrase des motifs ci dessus reproduits.
Ainsi le lvirat naura pas eu pour notre problme la fcondit de la
polygamie (avec laquelle il pouvait dailleurs se combiner) et les chances
de procurer des enseignements aussi prcieux se dissipent avec le temps.
Le lvirat parat en effet tre une espce en voie de disparition, que ce soit
en droit mosaque ou dans la pratique des communauts africaines o il
subsiste32. On se contentera donc de rappeler, en y insistant, quil na pas
offert loccasion de diagnostiquer une rigidit, vrai dire inattendue, des
catgories du droit international priv franais.
Pour en finir avec ces figures surprenantes de la conjugalit face au
systme de rgles de conflit, il faut encore voquer une dcision qui vaut
par elle-mme et par le commentaire qui en est fait au Journal de droit
international.
Il sagit dun arrt de la Chambre civile de la Cour de
cassation du 4 avril 1978 qui a russi enfouir la question de la qualification
propos dun maher de droit coranique tout en dbouchant sur une solution
tout fait digne dapprobation. Voici comment M. LEQUETTE, qui lannote,
prsente les faits de la cause :
Chabane Sadaoui, de nationalit franaise et de confession musulmane,
sprend dAkila Benziane ge de 18 ans et fille dun coreligionnaire de
nationalit algrienne ; ayant demand la main dAkila son pre, Chabane
obtient laccord de celui-ci condition de lui verser une somme de 17 500
FF [env. 2668 ]. La dot accepte en son principe et en son montant, le
mariage est fix au 4 mars 1971 pour la crmonie musulmane, au 17 juillet
1971 pour la crmonie civile franaise. Au jour dit, Akila et Chabane
sunissent Denain (Nord) en la forme musulmane : les consentements sont
changs devant tmoins et en la prsence (nullement obligatoire aux
32
V., par exemple, Monique GESSAIN et Annabel DESGREES DU LOU, Lvolution du lvirat chez les
Bassari , Journal des Africanistes 1998. 225, (Rsum : Chez les Bassari du Sngal Oriental, le lvirat
(selon lequel la veuve est hrite par le frre de son mari) concernait en 1930 toutes les veuves. Depuis,
sa frquence est passe de 91 % (de 1930 1959) 65 % (de 1960 1979) et 17 % (de 1980 1995).
Aujourd'hui, les femmes non hrites ne se marient pas plus souvent qu'autrefois avec un autre homme
que le frre de leur mari mais choisissent de vivre soit chez un de leurs enfants, soit seules. Parmi les
faits dmographiques, conomiques et psychologiques qui peuvent contribuer cette volution, l'un
semble trs important : la frquence accrue des pouses ges quittant le domicile de leurs maris pour
s'installer chez un de leurs enfants, chez qui, devenues veuves, elles resteront).
47
termes du droit musulman) dun marabout ; la dot de 17500 FF est
remise par le gendre son beau-pre . Et, le soir mme, Akila
sinstalle chez son poux . Cependant, quelques jours avant la date
prvue pour le mariage civil, M. Benziane prvient son gendre quil ne
lui donnera sa fille que sil abandonne la nationalit franaise au profit
de la nationalit algrienne. M. Sadaoui ayant refus dobtemprer, se
prsente seul le 17 juillet la mairie de Doullens : Akila est repartie vivre
chez ses parents ; elle y met au monde le 27 dcembre 1971 une fille
reconnue puis pensionne par M. Sadaoui. Poursuivi pour menaces de mort
sur les personnes des poux Benziane sils ne lui rendaient pas leur fille, M.
Sadaoui est condamn une amende et des dommages-intrts.
Quelques mois plus tard, il demande en justice la restitution de la dot .
Si, faisant abstraction de la nationalit franaise et de la localisation en
France des diverses pripties de laffaire, on se place uniquement au point
de vue du droit musulman, pour comprendre ce qui sest pass, il faut
considrer que Chabane et Akila sont mari et femme depuis lchange des
consentements accompagn du versement du maher effectu le 4 mars
1971. En effet, pas moins que le consentement, le paiement du maher est un
lment essentiel de la formation du mariage coranique. Ce maher quon
appelle par commodit la dot nest plus depuis longtemps en dpit de la
diffusion persistante du sentiment contraire chez les pres le prix payer
pour obtenir la fille en mariage, comme sil sagissait dune vente. Ce
maher forme une condition de fond du mariage et il peut tre purement
symbolique ou au contraire reprsenter un effort financier trs significatif ;
en effet, son montant peut tre ngoci comme ce fut le cas en lespce o il
fut convenu dun chiffre modeste dans labsolu quoique sans doute assez
important aux yeux des parties. Au demeurant, ce qui importe ce nest pas
son montant, ni les modalits de son excution (concomitante la
clbration ou postrieure celle-ci ou bien exigible au jour de la
dissolution), cest son principe, lequel est intangible au point que si aucune
discussion na permis de convenir du montant au moment du mariage, il
faut, selon la tradition sunnite33, se tourner vers le maher coutumier fix par
rfrence la situation sociale et conomique des familles respectives. Le
lien conjugal ne peut se nouer sans le versement, lexcution pouvant tre
diffre, mais le lien conjugal repose autant que sur le consentement sur la
33
Qui nest pas dominante au Maghreb, o prvaut la tradition malkite de laquelle relve le droit
algrien qui, plus radicalement considre nul le mariage non assorti de la stipulation dun mahr.
48
promesse du mari dacquitter le maher normalement entre les mains de la
fille mais, si celle-ci est mineure, entre les mains de son tuteur, cest--dire
le plus souvent entre les mains de son pre, comme en lespce. Cette
obligation du mari ne relve pas dans son essence de lordre patrimonial,
cest un facteur dquilibre dans un systme matrimonial o se combinent,
au bnfice du seul mari, la polygamie et la rpudiation. Cette obligation
renferme et signale lengagement du mari de bien peser sa dcision sil
dcide dexercer les prrogatives que lui confre ce type dunion. Cest, en
mme temps quune promesse de srieux34, une protection du lien conjugal
pralable et conditionnant tout autant la formation que la teneur de celui-ci
comme le montre le rgime juridique de cette dot35.
Plusieurs hypothses sont examiner. Dabord, il se peut le mariage nait
pas t consomm (a) ou quau contraire, il lait t (b); dans lun et lautre
cas il faut ensuite distinguer selon que le mariage est valable ou non ; en
effet,
a) - sil est nul et non consomm, le maher nest pas exig du non-mari,
qui ne doit assumer aucune obligation et qui doit par consquent tre
restitu sil a eu limprudence de sacquitter ; en revanche,
-
si le mariage est valable et non-consomm,
i) le maher est d en totalit lorsque la rupture du lien procde du
dcs du mari (soit quil ait prsum de ses forces, soit quil ait t surpris
par la mort avant davoir pu honorer sa nouvelle pouse), mais
34
A cet gard le maher doit tre rapproch de la dot ou du libellus dotis offert au Haut Moyen Age par le
futur sa fiance et qui tait indispensable la formation du mariage au point que son absence faisait
prsumer le concubinage.
35
V. Y. LINANT DE BELLEFONDS, Trait de droit musulman compar, II, p. 199 et s., P. GANNAGE, J.cl. Dr.
comp. V Liban (mariage-filiation), fasc. 2, n. 21 et s., et note sous Cass. civ. 1re, 2 dcembre 1997,
Kubicka, Rev. crit. 1998. 632, spc. p. 634, DAVID A., note sous Cass. civ ; 1re, 7 avril 1998, Hamidou, Rev.
crit. 1998. 644, spc. p. 646, M.-Cl. NAJM, note sous Cass. civ. 1re, 22 novembre 2005, Hamidou, JDI 2006.
1365, spc. p. 1367 et Principes directeurs du droit international priv et conflits de civilisation. Relations
entre systmes laques et systmes religieux, Thse Paris II, prface Y. Lequette, Dalloz 2005, n393 et s.,
qui, omettant la dos ex marito, souligne que lemploi du terme dot pour traduire maher manquerait de
rigueur en ce quil suggre que le crancier est le mari et non la femme ; R. EL HUSSEINI-BEGDACHE, Le
droit international priv franais et la rpudiation islamique, thse Paris II, LGDJ d. 2002, n 35 et n63
adopte la traduction dot.
49
ii) il nest d qu concurrence de moiti si la rupture procde de la
rpudiation auquel cas le mari conserve la moiti du montant sil sest
acquitt de son obligation, enfin
iii) le maher nest pas d si la rupture intervient la demande de la
femme.
b) - En cas de consommation du mariage valable, le maher est d
intgralement, moins que la rupture du lien ne soit imputable au
comportement de la femme, auquel cas lobligation du mari est rduite et il
peut obtenir la restitution de la fraction retranche.
- En cas de consommation du mariage nul, le maher reste d,
intgralement dans la tradition malkite (pretium virginitatis)36 alors que,
dans la tradition sunnite, la nullit permet au non-mari de limiter son
versement au montant de la dot coutumire.
Ce sont ces derniers cas, o il y a eu consommation, qui intressent ici,
mais ils montrent aussi bien que les autres o il ny a pas eu consommation,
que lobligation assume par le candidat au mariage et qui nest que la
contrepartie des pouvoirs exorbitants quexerce le mari sur linstitution
conjugale37 , sintgre aux conditions de fond du mariage et non pas aux
rapports patrimoniaux vers quoi pourraient orienter certains arrts qui font
de la promesse du mari un indice de choix par les poux de la loi coranique
comme loi de leur rgime matrimonial38. Le lien avec la formation et la
substance du mariage est peut-tre complexe, il nen est pas moins
solidement tabli.
En la circonstance la naissance dun enfant dans les mois qui suivirent la
crmonie traditionnelle atteste que lunion avait t consomme. Mais ceci
ne prjuge pas sa validit.
Cette question de validit ou de nullit du mariage est traite par
prtrition. La prtention de M. Sadaoui est examine dans la seule optique
36
Y. LEQUETTE, note prcite, citant G. H. BOUSQUET, Prcis de droit musulman, 3e ed., n54, p. 109
P. GANNAGE, note prc. Rev. crit., 1998, p. 634.
38
V. notamment les arrts cits la note 31
37
50
du droit franais ce qui ouvre la voie la plus favorable au succs de la
demande de restitution. Le droit algrien aurait-il t dclar applicable
cette demande, il aurait fallu effectivement prononcer sur la validit du
mariage valable et consomm, il aurait conduit une restitution partielle
en raison du comportement ultrieur de la femme, nul et consomm il
aurait, selon la tradition malkite, conduit refuser la restitution. Or il nest
pas vident quune crmonie traditionnelle, mme en prsence dun
marabout, soit considre lorsquelle se produit en France par le droit
algrien comme efficace et propre nouer le lien conjugal. La rgle locus
regit actum est reue en droit international priv algrien et, applique la
clbration du mariage (comme en droit international priv franais39), elle
impose lobservation de la loi franaise et partant la clbration civile
prescrite par ladite loi franaise. En loccurrence, cette exigence navait
pas t satisfaite. Il sagissait donc dun mariage nul, voire inexistant, faute
de clbration. Et si la loi algrienne devait rgir la question de la
restitution
du
maher,
cest
alors
quil
faudrait
constater
que
la
consommation jointe la nullit soppose, comme on la vu, toute
restitution. Mais dans la cause, rien ne permet denvisager ici lapplication
de la loi algrienne.
Dabord, celle-ci nest pas mentionne par larrt et il est donc penser
que les parties ne lont pas invoque devant les juges du fond. Or, en 1978,
la jurisprudence Bisbal40 relative lautorit de la rgle de conflit lgard
du juge nest pas encore renverse, il sen faut de dix ans41. Le juge franais
nest donc pas tenu de relever doffice linternationalit de la situation ni de
mettre en uvre la rgle de conflit :
les rgles franaises de conflit de lois, en tant du moins quelles prescrivent
lapplication dune loi trangre, nont pas un caractre dordre public, en ce sens
quil appartient aux parties den rclamer lapplication, et quon ne peut reprocher
aux juges du fond de ne pas appliquer doffice la loi trangre et de faire, en ce cas,
appel la loi interne franaise laquelle a vocation rgir tous les rapports de droit
priv
39
40
41
Cass. civ. 22 juin 1955, Caraslanis, Grands arrts, n 27
Cass. civ. 12 mai 1959, Grands arrts, n32
Cass. civ. 1re, 11 octobre 1988, Rebouh, Grands arrts, n 74
51
Ds lors la prtention la restitution devait sapprcier selon la loi
franaise.
Ensuite et cest une raison tout fait diffrente et qui, pas plus que la
premire, nest signale dans larrt de la Cour de cassation, en matire de
nullit de mariage, la rgle est que la loi applicable la condition viole
est celle qui rgit la nullit et ses consquences (comme les tempraments
quil y a lieu de leur apporter)42 ; en lespce le mariage est nul faute de la
clbration requise par la loi franaise rgissant la forme, cest donc la loi
franaise quil convient de sadresser pour dterminer le sort du maher. Pas
un mot pourtant sur le fondement de lapplication de la loi franaise.
Il est pourtant permis de penser que le rapporteur de larrt qui, comme
cest lusage, en a t le rdacteur, connaissait parfaitement ces solutions
de droit international priv franais. Avant de siger pendant une vingtaine
dannes la Cour de cassation, dont il devait prsider la premire
chambre civile, Andr PONSARD avait t agrg des facults de droit et
professeur pendant plus de vingt ans, dabord la Facult de Hano43, puis
la Facult de Dijon, o il enseigna le droit international priv, matire
dans laquelle il laisse une uvre de premier plan. Sil na souffl mot du
titre dapplication de la loi franaise, cest que la question, nayant pas t
souleve devant les juges du fond, navait probablement pas non plus t
souleve par le pourvoi (et le moyen aurait sans doute t dclar
irrecevable comme mlang de fait et de droit). Il ny avait donc rien en
dire. Il convenait de se cantonner au droit franais.
Nanmoins il est clair que dans la pense de la Cour de cassation la liaison
entre mariage et maher appartient la catgorie mariage.
Le pourvoi reprochait la Cour de Douai davoir jug que ntait pas
contraire lordre public ni aux bonnes murs franaises , cest--dire
pas contraire lordre public ni aux bonnes murs du droit interne
42
Cass. civ. 6 mars 1956, Vve Moreau, Grands arrts, n 28
Il fut lannotateur de larrt de la Cour dappel de Hano du 24 mars 1949, Kan Chang Hoei, tudi
supra
43
52
franais, la remise de fonds sous la condition implicite et certaine que
lunion qu[e Chabane Sadaoui] contracterait se raliserait sur les deux
plans quelle devait comporter . Personne ne parle de dot ou de maher.
Lanalyse en termes de condition suggrait au pourvoi de dnoncer une
espce de patrimonialisation ou, comme fcheusement on lentend parfois
aujourdhui, une espce de marchandisation de linstitution du mariage.
Plus exactement le moyen remontrait que faire dpendre de la
clbration ou de la non-clbration dun mariage selon la loi franaise le
sort dune somme dargent et [rduire] de ce fait ce mariage au rle de
condition dune obligation tait attentatoire lordre public et aux bonnes
murs en ce que le mariage entrait ainsi dans la sphre patrimoniale pour
dterminer la consolidation de lobligation souscrite et excute par le
futur.
Pareil moyen de cassation tait vou lchec. Il nest pas interdit en droit
civil franais de poser en condition la clbration ou la non-clbration du
mariage. La condition se distingue prcisment par cela qu la diffrence
de la charge, elle ne cre elle-mme aucune obligation ; elle najoute
aucune obligation lobligation quelle affecte mais conserve celui qui
laccepte son entire libert. Je puis vous donner aujourdhui la somme de
100 000 sous la condition que vous ne vous mariez pas avant davoir
obtenu votre diplme (clause de clibat, qui ne fait pas peser sur vous une
obligation de ne pas faire), ou encore sous la condition que vous vous
mariez avec la personne qui partage votre vie (donation propter nuptias, qui
ne vous impose pas de convoler). Si vous acceptez ces conditions, vous ne
renoncez pas votre libert matrimoniale, vous pimentez seulement son
exercice, dans la mesure o lavnement de la condition dpend au moins
partiellement de votre volont. Il est sr que sur le plan psychologique la
condition peut agir comme une pression qui orientera lexercice de votre
libert dans un sens dtermin, mais vous ntes nullement expos au
risque de lexcution force : la condition na pas de force obligatoire et
vous ne pouvez tre contraint au clibat (on nannulera pas le mariage que
vous avez contract au mpris de la clause de clibat) pas plus que vous ne
53
serez contraint au mariage (on ne vous mariera pas de force) ; simplement
en mconnaissant la condition impose, vous perdrez le bnfice de la
libralit.
Il nest donc pas surprenant que la Cour de cassation rponde au pourvoi
que
le fait quune somme dargent ait t verse par le futur mari au pre de sa future
pouse en vue de cette clbration et sous la condition rsolutoire de nonclbration ne portait pas atteinte lordre public ni aux bonnes murs .
Ctait l rpliquer parfaitement au pourvoi et cela suffisait justifier le
rejet et, par consquent, le droit de M. Sadaoui la restitution de la somme
verse puisque la date fixe, la clbration na pu avoir lieu.
La Cour aurait pu en rester l. Pourtant, elle a cru devoir prciser que sa
solution, parfaitement classique, simposait
en labsence de toute allgation dune atteinte la libert de lun ou de lautre des
futurs conjoints de donner ou refuser son consentement au mariage civil projet .
La cour prend ainsi linitiative de mettre ainsi dans la cause la libert du
consentement, lment fondamental de la conception du mariage que
cultive lordre juridique franais. Ce faisant, elle indique que lexigence
dun maher laquelle stait pli M. Chabane Sadaoui ne fait pas dellemme affront la conception du mariage du droit interne franais, ni donc
moins encore la conception plus relche du mariage que retient le droit
international priv. La maher, qui mesure lintensit de lengagement
conjugal de lhomme envers la femme quil pouse, nlve aucun obstacle
labsorption du mariage musulman par la catgorie du systme franais
de rglement de conflit qui dailleurs en saine logique ne pouvait le
refouler ds lors quelle accueillait dores et dj lunion polygamique dont
il est (avec la libert de rpudier concde au seul mari) une des pices
essentielles. Lantagonisme axiologique que pouvait rvler ici le maher se
dissout dans la catgorie.
54
Le commentaire de M. LEQUETTE44 explique dailleurs clairement pourquoi
le demande de restitution de la somme verse aurait d, si la question avait
t leve au plan du droit international priv, tre qualifie condition de
fond du mariage. Et linvocation de cette autorit doit tre comprise comme
une recommandation pressante de lire cette note. Le conseil dispense de
prolonger davantage ici la dmonstration45.
Il est temps de passer des affaires extrapatrimoniales aux affaires
patrimoniales. En ce domaine, toutefois, il nest pas ais de dcouvrir de
pareilles incompatibilits axiologiques entre droit tranger et droit
franais. Il y a longtemps maintenant que la prohibition de la stipulation
dintrts a t leve en droit franais et que lanatocisme mme nest plus
radicalement condamn. Aussi le droit franais ne se singularise pas par
rapport ceux des pays avec lesquels les changes conomiques sont les
plus frquents et les plus importants. Au demeurant, nul ne pourrait
imaginer aujourdhui que la stipulation dintrts avec ou sans clause de
capitalisation, puisse offrir dune manire ou de lautre quelque rsistance
face aux catgories du droit international priv franais ; il sagit clairement
de questions dobligation, justiciables, par consquent, des rgles de
conflit relatives aux obligations. De fait, lorsquil sagit daffaires purement
patrimoniales, les discordances sur le plan des valeurs ne sont pas en
gnral si considrables quon ne retrouve pas dans les situations
constitues sur des modles trangers des lments qui permettent la
subsomption sous les catgories du for.
Ce serait peut-tre du ct du droit patrimonial de la famille que le
problme pourrait se poser. Du ct des rapports patrimoniaux entre
44
Note prcite, JDI 1979, p. 355 et s.
La dmonstration aurait pu se poursuivre avec la rpudiation musulmane, mais il est trop connu que ce
mode de dissolution du mariage se loge sans difficult dans la catgorie divorce du droit international
priv, pour quil soit ncessaire dentreprendre un examen dont le rsultat nest pas douteux. V. sur la
question, les dveloppements que lui consacre Mme R. EL HUSSEINI-BEGDACHE, Le droit international priv
franais et la rpudiation islamique, thse Paris II, LGDJ d. 2002, n155 et s., et notamment n175, 176 o
sont rappels, contra, Tunis 10 mars 1951, Sitbon, Rev. crit., 1953. 119, note Jambu-Merlin : sil est exact
que la rpudiation en droit rabbinique dissout le mariage, tout comme le divorce, dans dautres pays,
aucune confusion nest possible entre ces deux modes de dissolution et T.F. 8 fvrier 1962, JDI 1965.
919, note P. Lalive ; v. aussi, pro, art. 13 Convention franco-marocaine du 10 aot 1981 relative au statut
des personnes et de la famille et la coopration judiciaire, et art. 57, Code belge de droit international
priv, (L. 16 juillet 2004)
45
55
poux, par exemple, on songerait larrt Vialaron46 de 1998. Mais nul
navait jamais dout que lunion des biens du droit suisse ft un rgime
matrimonial, bien quil consacrt lors de la liquidation et du partage une
discrimination entre les poux. Cette violation du principe dgalit ne
gnre apparemment aucune difficult de qualification et justifie seulement
en aval de la dsignation lintervention de lexception de lordre public
international.
Il faut alors en venir aux pactes successoraux que NIBOYET avait choisis
comme
exemple
de
divergence
axiologique.
Lexprience
jurisprudentielle rcente en la matire est fournie par un jugement du
Tribunal de premire instance de Monaco47. Mais dans la perspective du
problme de la qualification lapport de cette dcision est plutt modeste.
Voici les faits lorigine du litige quelle tranche :
Laffaire commence en Allemagne entre Allemands ; elle est lorigine purement
interne.
M. Lehmann a eu deux enfants de son mariage avec Mme Johanna
Staubwasser. Par acte du 29 avril 1963, ces enfants, un garon et une fille,
renoncent la succession du premier mourant de leurs parents ce que la
loi allemande autorise.
Le 19 mai 1963, les poux Lehmann-Staubwasser font un testament
olographe conjonctif, par lequel ils sinstituent mutuellement lgataires
universels et sengagent, chacun au cas o il survivrait, instituer leurs
deux enfants lgataires universels : ceux-ci ont renonc la succession du
premier mourant pour recueillir au dcs du dernier mourant le patrimoine
cumul des leurs parents.
Mme Staubwasser dcde en 1966 ; son mari recueille seul sa succession
par leffet combin de lacte du 29 avril 1963 qui limine les enfants et du
testament conjonctif du 19 mai 1963 qui linstitue lgataire universel
charge pour lui de lguer son tour la totalit de ses biens aux deux
enfants.
Mais en 1973, Lore Spenzer, ne Hammerschmidt apparat pour contrarier
lexcution de cette planification successorale. Le 28 septembre, M.
Lehmann lui cde titre de donation une proprit qui lui vient de feue son
pouse et qui est situe Pcking, dans la banlieue de Munich.
Cest un cadeau de fianailles, puisque trois semaines plus tard, le 17
octobre il pouse la donataire, sous le rgime lgal allemand de la
communaut diffre des augments. Entre temps il a vendu une socit
46
Cass. civ. 1re, 24 fvrier 1998, Vialaron, Rev. crit. 1998. 637, note G. Droz, JDI 1998. 730, note E.
Kerckhove, JCP 1998 II 10175, note T. Vignal, RTDciv, 1998. 347, obs. J. Hauser, 458, obs. B. Vareille et
520, obs. J.-P. Marguenaud
47
Trib. pr. inst Monaco, 23 fvrier 1995, Lehmann, Rev. crit. 1996. 439, note B. Ancel
56
par actions limmeuble quil possdait Munich pour le prix de 3 740 000
DM.
En dcembre 1973, laffaire devient internationale puisque les poux
sinstallent Monaco o M. Lehmann acquiert un immeuble, la villa
Bagatelle qui sera bientt divise et vendue en appartements. En 1975,
avant que la vente ne soit complte, les poux changent de rgime
matrimonial et adoptent la sparation de biens. En consquence de quoi, ils
se partagent les appartements non vendus.
En juillet 1976, pour la somme de 874 000 DM, Mme LehmannHammerschmidt vend la proprit de Pcking reue en donation moins de
trois ans plus tt selon un acte notari o elle tait dclare valoir 24 200
DM (la plus value acquise serait donc de 750 000 DM !).
Le 30 aot 1976, les enfants Lehmann, par un nouvel acte notari, dclarent
renoncer tout droit, notamment de rserve hrditaire dans la succession
future de leur pre tandis que celui-ci donne les actions dune socit
civile propritaire dun terrain son fils, charge pour ce dernier en cas
dalination de reverser sa sur une fraction du prix. Le fils alinera le
bien en question et il en retirera 136 000 DM pour son compte et 135 000
DM pour le compte de sa sur.
La mme anne M. Lehmann tablit une reconnaissance de dettes en faveur
de Lore, son pouse, pour un montant de 1 250 000 DM.
En 1985, par testament olographe, il institue son pouse lgataire
universelle et ritre la reconnaissance de dette.
Il dcde en 1990, laissant quelques biens mobiliers et un appartement de
58 m2 sis Monaco estim 1 100 000 F.
Cest alors que les hostilits commencent.
Les enfants demandent au Tribunal de premire instance de Monaco, cest-dire au tribunal du lieu douverture de la succession, de dclarer nul les
actes du 29 avril 1963 et du 30 aot 1976 portant de leur part renonciation
la succession du premier mourant puis la succession du survivant. Quelle
rgle de conflit mettre en uvre ?
Il sagit pour les enfants de convaincre le tribunal de ne pas se tourner vers
la loi allemande qui valide ces oprations, mais au contraire den apprcier
la validit au regard de larticle 985 du code civil de Monaco qui prohibe
toute renonciation une succession non ouverte et interdit toute stipulation
relative une pareille succession.
Sil faut en croire NIBOYET, la licit des pactes successoraux admise en
Suisse ou en Allemagne obit un concept dopportunit de mme
quen droit franais ou mongasque la prohibition de ce genre dacte part
dune tout autre conception de lopportunit . On serait en prsence dun
dsaccord axiologique.
Mais celui-ci ne prsente pas pour le tribunal la moindre difficult de
qualification.
Attendu que laction de Gehrard et Marianne Lehmann tend manifestement
remettre en cause le rglement, convenu par le parties, des successions respectives
de Johanna Lehmann et de Rudolf Lehmann, lesquelles, quel que soit le lieu de leur
ouverture, et selon la rgle mongasque de conflit de lois applicable en la
57
circonstance, doivent tre tenues pour exclusivement rgies en matire mobilire
par la loi allemande, loi nationale des de cujus, laquelle est galement appele
rgir la succession immobilire de Johanna Lehmann, entirement localise en
Allemagne .
On reconnat ici la rgle de conflit successorale qui sapplique en effet aux
questions de droit souleves par le rglement de la succession et qui
distingue entre succession aux meubles et succession aux immeubles, la
premire soumise en lespce par le droit international priv mongasque
la loi nationale du dfunt, la seconde la loi du lieu de situation du bien.
Dans ces conditions, cest la loi allemande admettant la validit des actes
qui doit tre applique intgralement lacte de 1963 par lequel il tait
renonc la succession de Mme Lehmann-Staubwasser, Allemande ne
laissant des immeubles quen Allemagne. Quant lacte de 1976, il est jug
valable en tant quil porte renonciation la succession aux meubles puisque
cette mme loi allemande gouvernait la succession mobilire laisse par M.
Lehmann qui avait conserv sa nationalit allemande jusqu son dcs.
Cest dire que, statuant ainsi, le tribunal na pas eu dhsitation retenir la
rgle de conflit relative aux successions et donc la qualification successions
pour les pactes successoraux discuts devant lui. Dailleurs, cette
qualification entranera lannulation, par application de larticle 985 du code
civil mongasque, de lacte de 1976 en tant quil concerne la succession
limmeuble laiss par M. Lehmann Monaco.
Au fond NIBOYET avait raison lorsquil enseignait que les conflits de valeurs
opposant institution du for et institution trangre ntaient pas les plus
difficiles surmonter. Mais les prmisses de cette conclusion ne sont pas
forcment celles quil suggrait. En ralit, une institution trangre
exorbitante sur le plan des valeurs et des principes est rarement inconnue
de lordre juridique du for ; elle est beaucoup plus souvent prohibe par
lordre du for. Prcisment, si elle est prohibe cest parce que elle est bien
connue et que ses vices et inconvnients ont t jugs tandis que si une
institution un tant soit peu exotique nest pas prohibe, cest que la
contrarit axiologique sest rvle lexamen, purement imaginaire. La
58
polygamie, le lvirat sont videmment proscrits par le droit franais, tandis
que le maher est, dans son principe, conforme aux valeurs et principes du
droit franais.
Les choses pourraient tre plus dlicates lorsque linstitution exorbitante
tient ce caractre des ses lments techniques. Cest ce quannonait
NIBOYET et cest ce que suggraient les arguments du Juge Wilde ou encore
de la Cour de Nmes lorsquils sefforaient de repousser hors mariage
lunion polygamique au motif que son conomie ne pouvait tre prise en
charge par la machinerie matrimoniale des cours dAngleterre ni par
lappareil normatif franais48.
48
V. supra
59
2 Le dsaccord technique
De nombreuses institutions trangres sont marques de caractres
originaux qui sans que leurs fins ni les rsultats quelles peuvent produire
ne les compromettent sur le terrain axiologique font nanmoins douter
quelles soient rductibles linstitution du for accomplissant la mme
fonction ou en tout cas quelles soient assimilables par la machinerie
juridique du for. Il serait ais den dcouvrir aussi bien du ct du droit des
personnes et de la famille que du ct du droit patrimonial. On se
contentera pourtant, brevitatis causa, de visiter ce dernier secteur (avec une
certaine clrit qui conduira ngliger beaucoup dhypothses).
Dans ce cadre restreint se prsente aussitt le problme du transfert du
droit de proprit par leffet du contrat de vente que NIBOYET avait propos
comme illustrant la discordance technologique. Dans le prolongement de
cette question, il faut aussi examiner celle que soulvent les srets relles
de facture trangre que lon envisagerait de constituer sur des biens qui se
trouvent en France. Et enfin, sur la mme ligne, se rencontre linvitable
problme de la constitution dun trust sur des biens situs en France.
I. Le transfert de proprit par leffet de la vente.
Ce transfert fait difficult en droit international priv car prcisment il ne
sopre pas de la mme manire dans les systmes juridiques. Certains se
contentent de la conclusion du contrat de vente, qui de stre form opre
par lui mme le transfert de la proprit alors que dautres requirent en
plus du contrat de vente une opration spcifique de transfert.
Soit, par exemple, un contrat de vente portant sur un bien corporel
mobilier, qui soit ou ne soit pas une marchandise49, par exemple, une
49
Cette prcision est seulement destine signaler que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les
contrats de vente internationale de marchandises laquelle France et Allemagne sont lune et lautre
parties et qui sapplique donc aux ventes transfrontires de marchandises entre les deux pays ne
comporte pas de disposition matrielle uniforme relative leffet du contrat de vente sur le transfert de
la proprit de la marchandise vendue (art. 4, litt. b) ; en consquence, mme souleve propos dun
contrat de vente internationale de marchandises, cette question reste du domaine du conflit de lois dans
lequel intervient du ct franais la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable la
60
voiture de collection. Le contrat est soumis la loi allemande alors que la
voiture est stationne en territoire franais. Pour le droit franais qui admet
le transfert solo consensu comme le droit anglais ou le droit italien il
suffit quil y ait eu un change des consentements propre sceller le contrat
pour que la proprit passe du vendeur lacheteur. En revanche, en droit
allemand prvaut la rgle de la sparation dite Trennungsprinzip, qui
distingue, dune part, laccord de volont crant un contrat gnrateur
dobligations (Verpflichtungsgeschft, acte dengagement) et donc mettant
la charge du vendeur lobligation de transfrer la proprit lacheteur et,
dautre part, un second accord de volont la source dun acte de transfert
(Verfgungsgeschft, acte de disposition ou dinglicher Vertrag, contrat rel,
ou dingliche Einigung, accord rel), ralisant de manire autonome
(Abstraktionprinzip)
lexcution
de
lobligation
de
vendeur
envers
lacheteur50.
La question est alors celle de savoir si le contrat conclu selon la loi
allemande a pu, comme le veut le droit civil franais du situs rei, dplacer le
droit de proprit de la tte du vendeur vers celle de lacheteur alors que
na pas t effectu le second acte, le contrat rel, requis par la loi
allemande.
Lhypothse symtrique est aussi embarrassante : la voiture de collection
est stationne en Allemagne, le contrat est soumis la loi franaise, faut-il
pour
que
lacqureur
reoive
la
proprit
conclure
le
Verfgungsgeschft bien que celui-ci ne soit pas exig par la loi du contrat ?
La question peut se poser par exemple si la voiture a t endommage par
cas fortuit aprs que la vente a t conclue mais avant quune quelconque
opration spcifique de transfert ait t effectue. Si le contrat est rgi par
la loi allemande et le bien situ en France, les risques et donc le dommage
en loccurrence doivent-ils tre supports par le vendeur (qui germanico
vente dobjets mobiliers corporels, laquelle se refuse galement rsoudre la question du transfert de
proprit, qui reste donc dans lorbite du droit commun des conflits de lois.
50
V. F. FERRAND, Droit priv allemand, Dalloz, 1997, p. 608 et s.
61
modo serait toujours propritaire51) ou sont-ils passs la charge de
lacheteur (qui gallico modo serait propritaire ds la conclusion de la
vente) ?
La solution frquemment recommande par la doctrine consiste dissocier
les rapports entre les parties et les rapports avec les tiers et attribuer les
premiers la lex contractus et les seconds la lex rei sitae.
A suivre cette directive il faudra admettre que la loi allemande rgit en tant
que loi du contrat le transfert des risques entre les parties, tandis que la loi
franaise indiquerait partir de quel moment la voiture ne fait plus partie
du patrimoine du vendeur et donc du gage gnral offert ses cranciers.
En lespce, le risque na pu passer lacheteur puisque la condition pose
par la loi allemande na pas t remplie, le risque est donc support par le
vendeur ; en revanche, puisque la voiture est en France, o prvaut le
transfert solo consensu, la proprit est passe erga omnes lacheteur et
les cranciers du vendeur ne peuvent plus la saisir, alors quau contraire
ceux de lacheteur le pourraient. Lide est au fond quil nest pas anormal
de demander la loi du contrat si celui-ci a ou non la force doprer le
transfert inter partes, i.e. de gnrer une obligation si puissante quelle
sauto-excute ; mais aussi quil nest pas incongru dinterroger la loi
gouvernant le statut du bien et de la proprit dont celui-ci est lobjet pour
savoir quelles conditions le transfert est opposable aux tiers, quelles
conditions ceux-ci doivent plier devant le jus prohibendi en quoi se rsume
le droit rel pour son titulaire. Comme lobservait BATIFFOL52 :
la localisation du meuble est un fait extrieur auquel les tiers se fient ; elle
constitue donc le rattachement le meilleur parce quil sauvegarde les
relations les plus nombreuses, et le droit vise par lui-mme lintrt
gnral. Sans doute le contrat tout entier ne sera-t-il pas soumis la loi
relle, parce que la loi dautonomie rpond aussi des besoins lgitimes,
tenant un plus grand compte des convenances des premiers intresss
51
Selon la loi allemande du contrat ; la loi allemande subordonnant le transfert des risques la livraison
effectue entre les mains de lacheteur, on supposera ici que la livraison na pas eu lieu.
52
H. BATIFFOL, Droit international priv, 4e dition, n524, BATIFFOL et LAGARDE, Droit international priv, 7e
d. n524.
62
En somme, dans sa dimension dacte gnrateur dobligations entre les
parties, le contrat est laffaire prive des parties par laquelle elles ont fix
librement et dun commun accord pour lune et lautre un programme
daction coordonn, cest--dire les engagements de donner, faire ou ne
pas faire auxquels elles sont tenues lune envers lautre ; mais ces parties
qui rglent ainsi pour lavenir leurs rapports mutuels navaient pas le
pouvoir de dterminer les comportements des tiers. Aussi bien, les
obligations sont pour la loi dautonomie et lopposabilit pour la loi du lieu
de situation du bien ; ainsi chaque protagoniste doit sen tenir ce que
prvoit la loi quil connat ou est cens connatre. Point de surprise ! au nom
de la scurit juridique, le partage sopre entre la loi du contrat et la lex
rei sitae.
Ce sont l galement les solutions qui se dduisent dun instrument qui
nest jamais entr en vigueur et qui ne constitue donc quun lment de
droit virtuel ou imaginaire : la Convention de La Haye du 15 avril 1958 sur la
loi applicable au transfert de la proprit en cas de vente caractre
international dobjets mobiliers corporels (art. 2, art. 3, et art. 5 ; convention
ratifie par lItalie et signe galement mais non ratifie par la Grce et, par
consquent, non entre en vigueur faute dun nombre suffisant de
ratifications [5]).
Cette dissociation est cependant expose la critique. P. Lagarde relve
ainsi qu
il tait inopportun de retenir, pour les questions concrtes dtailles
larticle 2 une qualification diffrentes selon que ces questions se posaient
dans les rapports entre le vendeur et lacheteur ou dans les rapports avec
les tiers. En effet, le propre du droit rel est son opposabilit tous. En
consquence, admettre que les effets rels de la vente, spcialement le
transfert de la proprit soient soumis la loi du contrat dans les rapports
inter partes et la lex situs dans les rapports avec les tiers, cest admettre
que leffet rel puisse se produire entre les parties sans tre opposable aux
tiers, auquel cas on ne peut plus parler vritablement deffet rel53 .
53
P. LAGARDE, Sur la loi applicable au transfert de proprit. Requiem critique pour une convention
mort-ne , Liber amicorum Georges Droz, p. 151, spc., p. 154
63
A lappui de la critique, P. Lagarde propose lexemple symtrique du
contrat soumis la loi franaise portant sur un bien frugifre situ en
Allemagne, sans quil y ait eu Verfgungsgeschft. Par application de la loi
franaise inter partes, lacqureur a droit de percevoir et consommer les
fruits produits par le bien depuis le jour de la vente tandis que par
application de la loi allemande du lieu de situation les cranciers du
vendeur ont, aussi longtemps que nest pas pass le contrat rel, le droit de
saisir ces fruits : le transfert de proprit leur est inopposable. Mais un droit
de proprit qui nest pas opposable aux tiers nest plus un droit de
proprit, nest plus un droit rel et le contrat de vente na pas opr le
transfert de la proprit
Il est vrai quil a pu tre avanc dans un sens diffrent quen ralit la
question de lopposabilit aux tiers se rvlait curieusement survalue par
le droit international priv, lorsque ses positions taient rapportes celles
du droit civil interne. Ainsi le droit civil franais admet en principe pour le
contrat de vente mobilire comme pour tout contrat une opposabilit erga
omnes. Mais il concde une exception dans le cas particulier o le bien a
t vendu deux fois par le vendeur deux acqureurs diffrents. Cette
situation, si aucun acqureur na t mis en possession relle du bien, se
rsout lavantage du premier acqureur ; cest celui-ci que le vendeur a
vendu le bien dont il tait propritaire alors quil a vendu au second
acqureur un bien dont il ntait plus le propritaire du fait de la vente
antrieur (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet). Dans
cette hypothse, le contrat de vente conclu avec le premier acqureur est
opposable au second. Mais si le second acqureur, devanant le premier,
sest mis en possession relle du bien vendu et revendu, ce moment l,
par exception, larticle 1141 du code civil rcompense la bonne foi et donne
la prfrence au possesseur :
Si la chose quon sest oblig de donner ou de livrer deux personnes
successivement, est purement mobilire, celles des deux qui en a t mise
en possession relle est prfre et en demeure propritaire, encore que
son titre soit postrieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de
bonne foi .
64
Rattache larticle 2279 c. civ. (aujourdhui art. 2276), cette issue indique
par elle-mme quen dehors du cas particulier vis (o il sagit de rtribuer
la bonne foi du possesseur), le transfert solo consensu opr par la vente est
en principe opposable aux tiers et, de fait, les cranciers du vendeur, ds la
conclusion du contrat en droit franais, voient le bien vendu chapper
leur droit de gage gnral ; ils suivent la foi de leur dbiteur
Et mutatis mutandis ce raisonnement pourrait aussi bien tre fait propos de
la vente immobilire54 laquelle, en cas de ventes successives, nest
exceptionnellement pas opposable lacqureur second en date qui a, de
bonne foi, publi son titre le premier.
Aussi bien, si tant entre les parties qu lgard des tiers le principe est que
le transfert de proprit est efficace, en droit franais, du seul fait du
consentement, il faut en projetant ces analyses sur le plan des conflits de
lois affirmer que ce transfert de proprit est dans la dpendance du
contrat, quil entre dans la sphre dautonomie, et par consquent le
rattacher la lex contractus.
Cest en ce sens que se prononce M. Louis DAVOUT55 dans sa thse de
doctorat dont largument, beaucoup plus riche et dtaill, vient dtre
brutalement raccourci. En principe la rgle de conflit solliciter pour
rgler cette question du transfert de la proprit dans la vente est celle qui
dtermine la loi applicable au contrat de vente. Cependant, il faut ajouter
aussitt que ceci est le principe de solution et que, dune part, ce principe
de solution est tir de linstitution du for ce qui, dune certaine manire, le
fragilise dans la mesure o les lois trangres usent dinstruments
techniques diffrents et, dautre part, ce principe de solution peut tre
entam par des exceptions, spcialement lorsque pour des raisons dintrt
54
V. J. FLOUR, Quelques remarques sur lvolution du formalisme , Etudes Ripert, t. 1, p. 93, spc. p.
102 : critiquant la dissociation entre effets inter partes et opposabilit aux tiers : La distinction nest-elle
pas artificielle, ds lors que lobjet du contrat est de transfrer ou constituer un droit dont le propre est
dtre opposable tous ? Pour un contrat translatif ou constitutif de droit rel, il revient au mme de ne
pas exister ou de na pas tre opposable
55
L. DAVOUT, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, prface H. Synvet, thse Paris II,
Economica, 2006, n141 et s., n 481 et s.
65
gnral auxquelles BATIFFOL stait montr si sensible il faut
saccommoder de cas dinopposabilit.
Lorigine franco-franaise du principe de solution nest pas fautive ; elle
est parfaitement fonde au regard de la thorie de la qualification lege fori.
Cette thorie dont la validit de principe nest pas encore branle repose
en dernire analyse sur lantriorit de lordre juridique interne du for ;
cette antriorit de lordre juridique du for nest toutefois que lune des
deux ides fondamentales qui inspirent llaboration du rglement de
conflit. Elle doit en effet composer avec la seconde ide, celle de lgitimit
du commerce juridique international, laquelle en quelque sorte encourage
sortir de lHexagone et prendre en considration dans la construction
des solutions les ralits de la vie juridique dans les ordres trangers au
sein desquels se dveloppent aussi les rapports privs internationaux ; il
sagirait en somme de rechercher des positions communes de manire
favoriser lharmonie des solutions. Cette seconde ide se fait videmment
plus pressante au temps de linternationalisation croissante, voire de la
mondialisation des rapports dintrts privs. Ds lors, revenant vers les
directives de Ernst RABEL, il serait aujourdhui raisonnable de sappliquer
concevoir les catgories du systme de conflit de manire moins chauvine
et les mtisser par un recours au droit compar. Ici, le droit compar
confronte le modle unitaire du consensualisme au modle binaire de la
tradition romaniste ; le droit international priv pourrait saccommoder de
cette dualit de perspectives en retenant que le transfert de proprit doit
tre rgi par la loi de lacte qui laccomplit : loi du contrat de vente dans le
courant napolonique , loi du contrat rel dans le courant de la
romanistique. Mais les auteurs allemands, notamment, nont pas t moins
perplexes devant les mrites de la dissociation qui rsulterait de cette
proposition, maintenant le rapport dobligation sous la loi du contrat et
plaant le transfert de la proprit sous lgide de la loi propre du contrat
rel, distincte de la loi de la vente. Cest cette dissociation qui est source de
difficult et ce diagnostic pousse certains dentre eux recommander, au
dtriment du Trennungsprinzip comme de lAbstraktionprinzip, la fusion des
66
deux lments composant la vente sous lautorit de principe de la lex
contractus56. Ces hsitations ne peuvent quencourager ne pas sloigner
de la solution franco-franaise .
La seconde observation quil convient de faire au sujet du choix de la
catgorie contrat pour le transfert de proprit concerne les raisons
dintrt gnral justifiant les cas o par exception linopposabilit vient
protger la position du second acqureur qui le premier de bonne foi a t
mis en possession de la chose ou a publi son titre.
Manifestement ces exceptions, par dfinition contraires au principe, la
justice et lalgbre contractuel que recueille en bloc la maxime nemo plus
juris, se fondent sur une dfense du crdit public qui sadosse la
scurit des transactions : lapplication indiffrencie de la maxime
provoquerait, bien sr, la destruction de lacte dalination second en date,
mais aussi, par voie de consquence, la destruction de toutes les oprations
ultrieures passes par le second acheteur avec des tiers sur le bien dont il
na jamais eu la proprit et il faudrait alors refaire lhistoire et procder
de difficiles restitutions de sorte que le rtablissement de lordre se
traduirait par un dsordre; or, par le fait de la possession ou de la
publication, le second acheteur en possession du meuble vendu ou ayant
publi son titre, est reprsent tous comme le titulaire du droit de
proprit et il a pu sembler opportun de le rputer tel, de lui confier le rle
du propritaire dans les rapports avec les tiers. Cest que la possession, la
publication produisent un effet dinformation, un effet daffichage quon ne
saurait dmentir au dtriment de quiconque ne dispose pas du moyen
daccder la connaissance juridiquement exacte de la situation, ds lors
que pareil dmenti entrainerait lanantissement de la position du
possesseur
ou
de
lacqureur
ayant
publi
et,
par
ricochet,
lanantissement des oprations que celui-ci puis ses ayant cause ont pu
passer avec des tiers sur la chose. Cet effet dinformation se joue au lieu o
la possession sexerce, au lieu o la publication est effectue, cest--dire
56
V. L. DAVOUT, op. cit., n487
67
au lieu de situation de la chose. Cest l que la protection du crdit public
sorganise. Ds lors, il est normal que les cas dinopposabilit que
dtermine cette protection organise du crdit public et de la scurit des
transactions obissent la loi du lieu de situation.
Cest bien cette solution, entamant le principe de la qualification
contractuelle, que parviennent les auteurs, comme M. L. DAVOUT ou M. P.
MAYER ou encore M. G. KHAIRALLAH, peu important cet gard que ces
auteurs recourent pour lapplication de la lex situs
des procds
techniques diffrents, loi de police, excuse dignorance lgitime de la loi
applicable, et - pourquoi pas ? - dans le primtre que dessinent les
exceptions du droit franais et pour lesquelles se pratiquerait un savant
dpeage , rgle de conflit relative au statut des biens.
Quelle que soit la voie mthodologique indique par les auteurs, il reste
que le dsaccord technique repr par NIBOYET propos du transfert de
proprit dans la vente nlve pas un obstacle infranchissable la
qualification contrat et au jeu du systme de rgles de conflit du for. Tout au
plus faut-il admettre que la divergence sur les moyens peut inciter
accueillir ct du principe de la mise en uvre de la rgle de conflit
relative au contrat de vente, une solution particulire pour rgler la
question de la protection de certains tiers de bonne foi57.
Mais en fait, si on parvient sen sortir si bon compte, cest parce que
lincorporation du transfert de proprit dans la catgorie contrat na pas
rencontr,
dans
les
relations
franco-allemandes,
une
rsistance
caractrise. Au demeurant, les conclusions quautorise lexamen de cette
57
Il est bien possible que la solution prconise par M. KHAIRALLAH soit la plus lgante, mais il est
douteux quelle soit venue lesprit des juges. La qualification loi de police est pertinente dans la
mesure o la protection du crdit public est leve au rang dobjectif dintrt tatique ou collectif,
voire dintrt public, ce qui nest pas absolument avr. Le recours la rgle de conflit relative au
statut rel se conoit pour autant que la protection assure en France par linopposabilit procde
ltranger dune institution dtachable du contrat lui-mme. En tout cas, cest bien la rgle de conflit
que se rfre larrt Locautra, Cass. civ. 1re, 9 dcembre 1974, Rev. crit., 1975. 504, note E. Mezger, JDI
1975. 534, note A. Ponsard, qui dans le cas de la revente en France dun matriel que le [re]vendeur
stait procur en Allemagne par leffet dune vente ensuite annule approuve la cour dappel davoir
distingu les questions qui relvent de la loi du contrat [ : les conditions dacquisition de la proprit]
et celles qui relvent de la loi relle [ la protection de ce droit de proprit]
68
question restent assez thoriques, puisquen ce domaine aucune dcision
ne semble stre signale au regard pourtant attentif des auteurs.
La mme facilit pour relative quelle soit ne se retrouve pas avec les
srets mobilires conventionnelles ; celles-ci ont nourri et embarrasse la
jurisprudence sans doute parce que lcart technique entre institutions
franaises et instituions trangres tait plus marqu et moins aisment
rductible .
II. Les srets mobilires conventionnelles.
La dcision de rfrence est larrt Kantoor de Maas de la Cour de
cassation du 23 mais 193358. La sret en cause rsultait dune clause
insre dans un contrat de prt et stipulant un transfert de proprit titre
de garantie portant sur cinq automobiles. Lopration tait conclue entre
Kantoor de Maas, socit financire nerlandaise, et une entreprise
franaise, la Socit des Automobiles Ravel, confronte de graves
difficults de trsorerie. Lacte est pass Mayence en Allemagne et est
soumis par les parties la loi allemande. La loi allemande valide en effet ce
type dopration et elle a t choisie probablement pour cette raison. En
revanche, la loi franaise de mme semble-t-il que la loi nerlandaise
pourrait bien lpoque interdire ce type de garantie, ce type de sret
conventionnelle mobilire fonde sur le transfert fiduciaire de proprit.
Peu aprs lopration, lentreprise franaise emprunteuse est dclare en
cessation de paiement et une procdure de faillite est ouverte en France
avant le complet dsintressement de la socit nerlandaise. Pour viter
le concours des autres cranciers, tout naturellement, elle se prvaut du
droit de proprit quelle tient du contrat et revendique lencontre de la
masse de la faillite les trois automobiles, assiette de la sret, qui sont
encore entre les mains dun tiers dpositaire en France. La Cour dappel
58
Cass. req., 23mai 1933, Rev. crit., 1934. 142, note J.-P. N(iboyet), S. 1935. 1. 253, note H. Batiffol
69
rejette la revendication au motif que serait illgale la convention qui a t
passe ltranger selon la loi du lieu (locus contractus ? ou situs rei ?
larrt de la Chambre des requtes voquera Mayence comme lieu de
conclusion du contrat, mais non comme situs rei lequel nest pas prcis,
allant sans doute de soi que les voitures greves taient en France au
moment de lacte de sorte quil ny aurait dans cette affaire aucun conflit
mobile). Ds lors, sil y a illgalit de la convention comme le juge la cour
dappel, ce nest pas du fait de la loi allemande qui, tout au contraire,
admet la validit ; ce ne peut tre que du fait de la loi franaise et la Cour
de cassation confirme que larrt attaqu a bien fait appel la loi franaise
pour valuer la clause de transfert de proprit fiduciaire.
Le pourvoi de Kantoor de Maas soutient que, valable selon la loi laquelle
les parties lavaient soumise, la convention doit produire effet et recevoir
excution partout o le crancier le demande. Cest la rgle en matire
contractuelle.
Le pourvoi est rejet :
la convention renferme un pacte commissoire prohib par la loi franaise, seule
applicable aux droits rels dont sont lobjet les biens meubles situs en France
(comp. Craven, 1872, Stewart, 1837).
Un pareil motif paraissait devoir conduire lapplication de larticle 2078
de lpoque et, dailleurs, la Cour juge effectivement quil y a eu une
application exacte de cette disposition. Cette affirmation est pourtant plus
que contestable. Lancien article 2078 nonait que
le crancier ne peut, dfaut de payement, disposer du gage : sauf lui faire
ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu due
concurrence, daprs une estimation faite par experts, o quil sera vendu aux
enchres.
Toute clause qui autoriserait le crancier sapproprier le gage ou en disposer
sans les formalits ci-dessus est nulle .
Aujourdhui larticle 2348 du code civil qui est le correspondant de cet
ancien article 2078 adopte une solution toute diffrente puis quil valide le
pacte commissoire. Mais jusquen 2006 le pacte, nous dit le code, est nul.
Si la loi franaise est bien applicable, elle commande lannulation.
70
La loi franaise est bien dclare applicable selon une formule qui ne
laisse aucune ambigit.
La Cour joue ici de la qualification et place la question de la dtermination
des modes de disposition de la proprit mobilire dans la catgorie du
statut rel, mme si ces modes de disposition passent par un canal
contractuel.
Il sera pourtant difficile de ne pas juger cette qualification tendancieuse.
Analyser la sret tablie selon la loi allemande en un pacte commissoire
nest pas tout fait exact et est peut-tre abusif. Le pacte commissoire est
celui par lequel le crancier impay devient lchance titulaire de la
proprit ou au moins dun droit de disposition sur la chose engage
reste dans le patrimoine du dbiteur ; en lespce, il ntait nullement
prvu que le crancier sapproprie le bien engag en cas de nonpaiement, mais il tait prvu quil en conserve la proprit quil avait
reue la naissance de sa crance ou, en tout cas, de la sret ;
simplement cette proprit acquise ds la mise en place de lopration de
crdit est greve dun droit restitution en faveur du dbiteur sous la
condition de complet paiement, condition non advenue en la circonstance.
Le pacte commissoire suppose au contraire que le dbiteur a la proprit
jusquau jour o son dfaut de paiement est constat et cest alors le dfaut
de paiement qui va, selon ce quil a consenti, lexproprier au profit du
crancier. La figure est tout fait diffrente. Lassimilation ne va pas de soi.
Juridiquement, elle ne simpose pas et, psychologiquement, elle est
infonde : le pacte commissoire est dangereux parce le besoin dargent
qui presse lemprunteur le porte engager auprs du crancier un bien
qui peut avoir une valeur considrablement suprieure au montant de la
dette souscrite, de sorte qu lchance, si celle-ci nest pas honore, le
crancier pourra en sappropriant lobjet un gage non seulement rentrer
dans ses fonds mais encore raliser une plus value exorbitante. Et le
dbiteur est dautant plus vulnrable que mme sil a remis le bien engag
au crancier ou un tiers, il en conserve jusqu lchance la proprit
71
sans ressentir ncessairement la prcarit de son droit sur la chose. En
revanche, avec lopration conclue selon le droit allemand, le dbiteur
ntait plus propritaire, mais avait seulement lespoir de le redevenir et,
de surcrot, les automobiles avaient t dposes chez un tiers en France. Il
est vrai que le droit franais inclinait tendre la prohibition la vente
rmr, par laquelle le dbiteur cde la proprit, mais obtient une facult
de rachat dans un dlai dtermin qui peut tre en ralit celui que
lacheteur-fournisseur du prix lui consent comme une chance de
remboursement. Lopration peut dissimuler un pacte commissoire, mais
encore faut-il que la simulation soit tablie. En lespce, il nest pas indiqu
que lopration conclue Mayence tait simule et il y avait si peu de
raison de la croire telle que les parties auraient trs bien pu dplacer les
voitures en Allemagne pour tre labri du droit franais ; or, ces voitures
taient restes en France. Innocence ou maladresse ? La Cour de cassation
choisit ici dlibrment dapprouver la cour dappel et de supposer en
quelque sorte que la configuration internationale de lopration en
tablissait le caractre frauduleux de manire lgitimer lassimilation au
pacte commissoire et arriver ainsi par le relais de la qualification droit
rel mobilier la dsignation du droit franais.
Mais alors il faudrait pousser lartifice jusquau bout et dclarer nulle la
clause de transfert fiduciaire de proprit portant sur un bien situ en
France. Ce nest pas ce que fait la Cour de cassation ; elle sanctionne
lirrgularit de la clause au regard de larticle 2078 ancien par
linopposabilit :
En refusant de faire produire effet la convention litigieuse et en rejetant en
consquence la revendication de la socit demanderesse, la cour dappel dont
larrt est motiv a justifi sa dcision sans violer et au contraire en appliquant
exactement larticle 2078 .
Refuser de faire produire effet, cest dclarer inopposable, ce nest pas
dclarer nul. La nullit est une chose, lopposabilit en est une autre.
En ralit, dclarer inopposable, refuser de faire produire effet, cest
paralyser un acte qui ne demande qu dployer son nergie.
72
Linopposabilit implique la validit et cette implication est directement
contraire la loi franaise pourtant dclare applicable.
La Cour de cassation restera pourtant fidle cette analyse dans laffaire
DIAC c. Oswald59, qui se prsentait un peu diffremment, la sret ayant t
convenue entre socits allemandes et constitue en Allemagne sur une
automobile qui sy trouvait et dont il sagissait de financer lacquisition.
Lautomobile en question ntait jamais entre dans le patrimoine du
dbiteur puisquelle avait t achete directement par ltablissement de
crdit qui en avait pay le prix et ne devait en transfrer la proprit au
dbiteur quaprs complet remboursement. La rduction un pacte
commissoire tait encore plus artificielle que dans laffaire Kantoor de Maas
car une pareille opration ne prsente aucun danger particulier pour le
dbiteur, la valeur de la chose greve correspondant ncessairement au
prix avanc par le crancier Autant dire que la solution retenue de
lassimilation un pacte commissoire tait alors carrment arbitraire60.
Mais ce quil importe de retenir ici, cest prcisment le caractre
tendancieux de la qualification. La Cour dappel et la Cour de cassation,
derrire elle, ne se sont pas heurtes une impossibilit ni mme une
difficult srieuse de faire entrer la sret allemande dans les catgories du
droit franais. Les mmes oprations en droit interne auraient subi le mme
sort et les diffrences techniques entre droit franais et droit allemand ne
sont pas la source dun refus de linstitution trangre. En ralit ce qui a
t refus ce nest pas la validit de la sret, mais bien et seulement la
59
Cass. civ. 1re, 8 juillet 1969, Rev. crit., 1971. 75 note Fouchard, JDI 1970. 916, note Derrupp, JCP 1970.
II. 16182, note H. Gaudemet-Tallon, Grands arrts, n48
60
La Cour de cassation marque clairement son hostilit la sret allemande dans laquelle elle
dcouvre un gage assorti dun pacte commissoire. Le pacte commissoire, sil doit tre, comme elle le
juge, soumis la loi franaise du lieu de situation, est nul ou en tout cas inefficace ; mais le gage en
tant que tel subsiste et la socit DIAC, en qualit de crancier-gagiste, comme lobserve FOUCHARD dans
sa note la Revue critique, aurait d pouvoir exercer sur le bien situ en France les prrogatives
rsultant du gage et notamment un droit de prfrence qui prime mme les cranciers privilgis. Sans
doute, le rejet de son pourvoi ne lempche pas de faire valoir son droit de prfrence sur le prix de la
vente conscutive la saisie pratique par Oswald, mais la cour aurait pu lgitimement casser larrt
attaqu en censurant la qualification retenue et reconnatre le droit (de proprit) de Socit DIAC qui
navait dutilit pour celle-ci que par la valeur que reprsentait le vhicule lequel tait vou tre vendu
pour assurer le recouvrement du prix quelle avait acquitt. Mais la crainte dintroduire une sret
trangre a retenu la cour daccueillir celle-ci dans sa vritable physionomie.
73
production en France sur les biens qui y sont situs des effets spcifiques
de lacte rgulirement conclu ltranger. Il sagissait dviter que de
pareilles srets sans publicit en France ne crent chez les tiers lillusion
dune solvabilit du dbiteur. Et pour parvenir ce rsultat les juridictions
franaises ont pens trouver dans les ressources de la qualification la voie
la plus directe pour aboutir neutraliser la sret trangre sur un bien
situ en France. Alors quen ralit, il leur suffisant de faire appel lordre
public par exemple pour empcher la production en France des effets des
droits acquis ltranger ; lintervention de lexception dordre public
pouvait tre fonde sur la protection du crdit public en France lequel
exigerait que dans les limites du territoire un bien mobilier ne soit lassiette
dun droit rel quautant que la loi franaise le prvoie et lorganise
notamment par le moyen de la publicit.
On pouvait aussi dans le cas de Kantoor de Maas se rabattre sur la notion de
lois de police. Il faut se souvenir que la Socit des Automobiles Ravel, en
raison de la cessation des paiements, a t place en France sous un
rgime de procdure dinsolvabilit et que cest pour soustraire aux
apptits de la masse des cranciers que Kantoor de Maas revendique les
automobiles qui lui ont t cdes fin de garantie. Or, il nest pas difficile
de trouver en jurisprudence laffirmation que la loi franaise de faillite
simpose mme lgard doprations relevant de lois trangres compte
tenu du caractre dordre public de ses dispositions. Par exemple :
Cass. com. 8 mars 1988, Otto Sauer Achsenfabrik61 :
La revendication litigieuse dirig contre la masse des cranciers dans le cadre
dune procdure collective dapurement du passif tant soumise aux dispositions
dordre public de larticle 65 de la loi du 13 juillet 1967, cest bon droit que la cour
dappel a fait application de ces dispositions en la cause .
Dispositions dordre public, cela ressemble fort nos lois de police, et
larrt St Heinrich Otto62 de la premire chambre civile du 8 janvier 1991
nous en rapproche davantage lors quil dit que :
61
62
Rev.proc.coll. 1988. 305, note Soinne ; v. aussi J.-P. Rmery, La faillite internationale, p. 83.
D. 1991. 276, note J.-P. Rmery, JDI 1991. 991, note A. Jacquemont
74
les conditions auxquelles peuvent tre revendiques des marchandises vendues
avec rserve de proprit sont, en cas de redressement judiciaire de lacheteur,
dtermine par la loi de la procdure collective, quelle que soit la loi rgissant la
validit et lopposabilit , en gnral, de la clause de rserve de proprit
La formule quelle que soit la loi applicable voque celle que retient larticle
9 du Rglement Rome 1 aprs larticle 7 de la Convention de Rome et que
retiennent aussi certaines conventions internationales pour caractriser les
lois de police. La Cour de cassation sest montre encore plus explicite
dans un arrt St Comast du 8 janvier 200263 :
Il rsulte de larticle 7 de la convention de Rome] que les dispositions de celle-ci
ne pourront porter atteinte lapplication des rgles de la loi du pays du juge saisi
qui rgissent imprativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat ;
que laction en revendication lencontre dune socit soumise une procdure
collective ayant t porte devant un juge franais tenu dappliquer les rgles qui
rgissent imprativement cette situation, cest bon droit que la cour dappel a
cart lapplication du droit italien
La rfrence larticle 7 dissipe toute ambigit sil en subsiste dans la
mesure o il est prcisment intitul lois de police.
Rapporte laffaire Kantoor de Maas, cette solution implique que le droit
allemand est comptent pour valider la clause entre les parties, mais elle
permet que, par le moyen de ses lois de police, lordre juridique franais
oppose son action normative propre aux droits rgulirement confrs par
la loi allemande et comme il est en position de faire prvaloir son propre
point de vue en France, spcialement sur les biens qui y sont situs, il se
donne la prfrence en refusant la clause les effets qui drangeraient
lorganisation de la procdure collective, du rglement densemble que
celle-ci recherche. A cette fin, nul besoin de salarmer de la validit de la
clause, il suffit de la tenir pour inefficace en France, de refuser de lui faire
produire effet en France. Cest bien ce que fait la Cour de cassation.
Il ne semble pas ncessaire daller plus loin dans le domaine des srets
relles conventionnelles64. Ce nest pas que celles-ci, lorsquelles se
63
Rev. crit. 2002. 328, note D. Bureau
V. aussi Cass. civ., 1re, 3 mai 1973, Nederlandsche Middenstands Financierings BanK BV, Rev. crit. 1974.
100, note Mezger, JDI 1975. 74, note Fouchard, Rec. gn. lois, 1974. 453, obs. Droz, ritrant le motif et la
solution de 1933 propos dun matriel industriel ayant fait aux Pays-Bas lobjet dun transfert fiduciaire
de proprit titre de garantie entre deux socits nerlandaises avant dtre introduit en France. Cass.
civ. 1re, 11 mai 1982, Localease, Rev. crit. 1983. 450, note G. Khairallah, D. 1983. 271, note C. Witz,
abandonne la solution et le motif, mais en loccurrence le bien introduit en France y tait dtenu et
64
75
constituent sur un modle tranger, pousent uniformment la structure de
celles que propose le droit allemand ; en vrit, il y a une assez grande
varit, mais cest lexprience jurisprudentielle qui fait dfaut. On pourra
ainsi regretter que par exemple la (ou le) floating charge du droit anglais
nait pas eu loccasion de se confronter au systme franais de rgles de
conflit de lois ; on ne relve quune seule dcision mentionnant cette
institution et elle concerne une question de recevabilit dune demande
dexequatur. Il suffit de lire la note de M. Paul LAGARDE sous cet arrt de la
Cour de Paris du 19 janvier 197665 pour apprcier toutes les particularits
et mesurer loriginalit de cette sret et dplorer enfin que ne se soit pas
pose la question de la validit dune floating charge relativement des
biens situs en France66
Mais ce nest pas seulement le dfaut
dapprovisionnement jurisprudentiel qui autorise ici la dcision de ne pas
avancer plus loin dans lexamen du problme de laccueil par le systme
franais des rgles de conflit des srets conventionnelles trangres.
Deux considrations doivent ici tre proposes.
Dune part, il faut rappeler ce quon pourrait dnommer le rveil du droit
civil franais qui stait endormi en matire de srets sur les schmas
davant guerre (la seconde guerre mondiale ? la premire ?) et qui
dsormais sest rapproch de manire significative des lgislation
trangres plus modernes et plus attentives aux ncessits de lconomie
contemporaine67. De sorte que les carts se rduisant, lexotisme natteint
plus aussi tt le seuil de lexorbitance68. Dautre part, la conclusion que
suggre lanalyse critique de la jurisprudence Kantoor de Maas-Socit
DIAC, rejoint celle qui avait t tire de lexamen, tout doctrinal, de la
question - bien des gards, connexe du transfert de proprit : une
qualification contractuelle de principe, tempre, le cas chant, par
exploit par lutilisateur en vertu dune sous-location consentie par un crdit-preneur et ne confrant
quun droit personnel non soumis publicit en France.
65
Revue critique, 1977. 126.
66
V. sur ces problmes, mais sans soutien positif, les travaux de F. DAHAN, La Floating Charge dans les
rapports internationaux de droit priv (Essai sur la reconnaissance dune institution trangre), thse Paris
1, 1995, et La Floating Charge : Reconnaissance en France dune sret anglaise , JDI, 1996. 381
67
Stimulant davantage la promotion du crdit que la protection des tiers.
76
lintervention dune exception - loi de police, ordre public ou encore
excuse dignorance lgitime de la loi applicable protectrice de lintrt
des tiers. Lobstacle que pourrait lever en ces domaines la discordance
technique ne parat pas plus insurmontable que celle que pourrait opposer
la discordance axiologique.
A vrai dire, lobstacle axiologique parat mme tre le plus srieux
puisquil savre que les rserves du droit international priv franais
lgard de ces srets trangres procdent dune considration qui, loin
dtre purement technique, est de celle dont on peut dire avec les mots de
NIBOYET quelle obit un concept dopportunit . La dfense du crdit
public dirige sur la protection des tiers au sacrifice, le cas chant, des
intrts du fournisseur de deniers relve dune vieille idologie qui
plonge ses racines dans le terreau canonique de la dfiance lendroit des
usuriers et autres publicains, tous ces hommes dargent Ce nest pas le
capitalisme rhnan, tant sen faut.
Cette observation peut trouver sa confirmation dans lanalyse de laffaire du
Voilier Sedov, qui ne mettait en cause aucune question de sret mobilire
conventionnelle, mais concernait laccueil en France des droits quune
entit publique trangre avait reus de lEtat tranger qui lavait institue
sur un bien qui avait ensuite t introduit sur le territoire franais. En fait de
territoire, il sagissait dun port et, en fait de bien, il sagissait du plus grand
quatre-mats au monde. Mais, la diffrence des cas prcdents, cette
affaire nengageait pas rellement la dfense du crdit public. Aussi bien,
le motif des arrts Kantoor de Maas-Socit DIAC ny apparat pas.
Le Sedov est un navire russe, immatricul au nom de l'Universit
Technique d'Etat de Mourmansk sur les registres de la Fdration de
Russie, et qui au moment de laffaire se trouve dans un port franais.
Alors qu'il mouille en rade de Brest (France) o il doit participer une
parade maritime, le voilier est l'objet d'une saisie excution de la part d'un
crancier suisse ; celui-ci, la Compagnie Noga, exhibe deux sentences
arbitrales prononces en Sude sous l'gide la Chambre de commerce de
Stockholm, et exequatures en France, condamnant la Fdration de Russie
lui verser la somme de $ 28M environ, augmente des intrts. Mais cette
77
procdure d'excution se heurte l'opposition de l'Universit de
Mourmansk69 qui proteste,
- d'abord, qu'elle constitue une entit juridique distincte de l'Etat de la
Fdration deRussie, dote de l'autonomie patrimoniale, et qu'elle n'est
donc pas engage par les dettes de cet Etat envers la Cie Noga;
- ensuite, que le voilier Sedov figure dans son patrimoine et donc ne peut
entrer dans le droit de gage gnral que la Cie Noga prtend exercer par
la voie de la saisie pratique Brest contre son dbiteur, la Fdration de
Russie.
Par jugement du 24 juillet 2000, le Prsident LOUVEL, du Tribunal de grande
instance de Brest, s qualits de juge de l'excution, ordonne la mainleve
de la saisie70. La Cie Noga fait appel et soutient en somme devant la Cour de
Rennes que pratique en France, la saisie doit obir la loi franaise
exclusivement, laquelle ne prvoit aucune cause d'insaisissabilit que
puisse ici invoquer son dbiteur qui, par ailleurs, a renonc son immunit
d'excution71. Sans doute, admet-elle, la dtention du voilier Sedov par
l'Universit de Mourmansk est conforme au droit russe, mais elle n'est pas
fonde sur un droit de proprit, la Fdration de Russie n'ayant transfr
cet tablissement public que l'usus et le fructus et s'tant rserv l'abusus ou
droit de disposer du navire - pris aux Allemands la fin de la Deuxime
guerre mondiale. La Fdration de Russie est donc, selon l'appelante, la
vritable propritaire du Sedov et celui-ci n'entre dans aucun cas
d'insaisissabilit admis par la loi franaise seule comptente.
C'est sur cette question de l'applicabilit de la loi franaise l'insaisissabilit
et la dtermination de ses causes qu'insistaient les conclusions de
l'appelante dans le sillage des deux consultations que la Compagnie Noga
avait obtenues d'minents professeurs spcialistes du droit international
priv et des procdures civiles d'excution.
Mais aux yeux des juges le vritable problme consistait savoir si, en
premier lieu,
- l'Universit de Mourmansk constituait ou non une personne morale
distincte de l'Etat de la Rpublique Fdrative de Russie et si, en second
lieu,
69 et aussi des organisateurs franais de la revue navale comme de la Fdration de Russie elle-mme,
toutes ces parties demandant pour les mmes motifs la mainleve de la saisie.
70
Trib. gr. inst. Brest, 24 juillet 2000, Dr. mar. fr. 2000. 1026, Gaz. Pal., 2001, n161, p. 35, v. G. de LA
PRADELLE, Blocage des comptes en banque de missions diplomatiques et saisie d'un navire d'Etat affect
une personne publique, eod. loc., p. 22.
71
Lengagement pris par lEtat signataire dune clause darbitrage dexcuter la sentence dans les
termes du rglement darbitrage implique renonciation de cet Etat limmunit dexcution, Cass. civ. ,
1re, 6 juillet 2000, Creighton Ltd c. Qatar, Rev. arb. 2001. 114 note Ph. Leboulanger, JDI 2000. 1054 note I.
Pingel, JCP 2001. II. 10512, note Ch. Kaplan et G. Cuniberti, RTDcom 2001. 410 obs. E. Loquin.
78
- le voilier Sedov appartenait l'Universit de Mourmansk et donc
chappait au gage gnral des cranciers de la Rpublique Fdrative de
Russie, seule dbitrice de la socit Noga.
Pour venir bout de ces deux difficults, il n'tait pas raliste d'interroger
le droit franais bien qu'il ft dsign pour gouverner la saisie ; le droit
franais n'avait en rien contribu l'organisation de l'tablissement public
d'enseignement que constitue l'Universit de Mourmansk, ni prsid de
quelque manire que ce soit l'attribution cette universit du voilier
Sedov. En dautres termes, la constitution des rapports entre la Fdration
de Russie, lUniversit et le voilier stait accomplie intgralement dans
lordre juridique russe, sans que la situation ait le moindre lien avec lordre
juridique franais.
Aussi bien, sur le point de la personnalit morale, la Cour de Rennes72
consulte les statuts de l'Universit. De la sorte, un acte public tranger est
pris en considration pour l'application d'une rgle du droit franais des
saisies : il faut s'assurer que les conditions fixes par les statuts ont cr une
situation rpondant aux exigences de la loi franaise (c'est--dire,
ngativement, : " savoir un organe de gestion dsign selon une
procdure interne, un budget propre avec recettes et dpenses clairement
individualises, un patrimoine personnel, outre la capacit d'accomplir des
actes juridiques"); si ces exigences sont satisfaites par les statuts, la rgle
franaise qui veut que seul celui qui est engag la dette et non son voisin
soit expos la saisie conclura que la procdure d'excution ne pouvait
tre dirige sur l'un des biens de l'Universit. En lespce la teneur des
statuts atteste que l'hypothse de la rgle matrielle franaise est remplie
par l'acte public tranger.
A vrai dire, cette prise en considration ne se limite pas aux statuts de
l'Universit, elle s'tend aussi certaines dispositions du Code civil de la
Fdration de Russie, tel l'article 126, al. 1er qui implique en effet une nette
distinction entre le patrimoine de l'Etat et le patrimoine des personnes
morales de droit public. C'est d'ailleurs cette mme disposition que se
rfre aussi la Cour de Rennes lorsqu'elle aborde la question de la
proprit du navire Sedov.
Sur le voilier, l'Universit de Mourmansk a reu un droit de gestion (ou de
direction) oprationnelle. C'est l une figure spcifique au droit des biens
hrite en 1994 de temps rvolus, "une survivance de l'poque de l'Union
sovitique dont il a t jug inopportun de se dfaire pour le moment"73.
72
73
Rennes, 27 juin 2002, DMF 2002. 734, obs. J.-P. Rmery
21 Rev. Centr. East Eur. Law [1995] 237, p. 242
79
En tant pourvue d'un droit de gestion oprationnelle, l'entit dvolutaire
du bien reoit, avec la dtention de celui-ci, la charge d'en exploiter toutes
les utilits susceptibles de servir l'objectif qui lui est assign, non plus
comme jadis par le Plan74, mais dsormais par ses statuts. Dans ce schma,
les prrogatives ainsi confres sur la chose sont fonctionnelles. Elles ne
s'insrent pas dans les notions du code Napolon, car elles ne sont pas
dtermines par application d'une gamme de concepts dclinant et
distinguant comme en droit franais divers faisceaux de pouvoirs dont le
bien peut tre l'assiette : usus, fructus et
abusus. Aujourd'hui, c'est la
mission de service public confie au dvolutaire du bien qui dfinit le
contenu de son investiture et qui justifie aussi que l'autorit publique, sous
la forme du Comit d'Etat en l'occurrence, exerce un contrle de la
conformit de l'emploi du bien aux exigences dudit service public.
L'ventail des pouvoirs composant le droit de gestion oprationnelle est
dploy par l'article 296 du code civil de la Fdration de Russie75 si
largement qu'aucune prrogative, aucune utilit, aucun mode d'exploitation
ne semblent refuss l'tablissement public dvolutaire sauf mesurer
dans chaque cas ltendue et la nature de ceux qui sont effectivement
ncessaires la ralisation rgulire du but dfini par celui qui, dans la
traduction, est dsign comme le propritaire. Il faut ici observer que le
propritaire mentionn par l'article 296 nest pas exactement celui que
dessine le droit franais, puisque c'est l'Etat, auteur de l'tablissement
destinataire, qui conserve ici curieusement cette qualit de propritaire
alors mme quil a transfr le bien sans en exclure le pouvoir de
disposition. Lappellation de propritaire est maintenue seulement pour
exprimer que lEtat a le contrle de la destination et de lexploitation
74
V. R. DAVID, Grands systmes de droit contemporain, n. 253, BUTLER, Marxian Concepts or Ownership
in Soviet Law, 23 Col. J. Trans'l Law [ 1985] 281 ,
75
"Article 296 : Droit de gestion oprationnelle - 1. Sur le bien qui lui est affect, lentreprise publique ou
linstitution exerce les droits de possession, de jouissance et de disposition dans les limites imposes
par la loi, en accord avec les fins de lactivit, les missions assignes par le propritaire et la destination
du bien.
2. Le propritaire du bien affect une entreprise publique ou une institution a le droit de reprendre
le bien concurrence de ce qui est en excdent ou non utilis ou de reprendre le bien-mme sil nest
pas exploit conformment sa destination."
80
conforme du bien transfr, comme lindique clairement le 2 de larticle
296 du code civil russe, mais le terme ne prjuge autrement pas du contenu
du droit de lEtat. Cependant, cette non-concidence des concepts importe
peu; l'essentiel est de constater, comme le fait la cour, que
le droit de direction oprationnelle opre transfert du bien dans le patrimoine
de la personne morale qui ledit bien est affect, [et que] d'ailleurs sur le plan
comptable le bien affect se trouve port au bilan de la personne morale
affectataire, et disparat du patrimoine comptable de l'autorit Fdrale, dont la
proprit se limite un pouvoir de contrle sur l'utilisation du bien affect; qu'en
consquence la MSTU76 dispose sur le navire Sedov d'un droit de direction
oprationnelle, aux termes duquel elle le possde, l'utilise et peut en disposer, de
telle sorte que le Sedov au jour de la saisie tait sorti du patrimoine de la
Fdration de Russie .
Le soin que la Cour de Rennes prend alors de ne pas utiliser le terme de
proprit et de raisonner sur le plan comptable, signale l'intention de ne
pas rduire le droit de l'Universit de Mourmansk sur le voilier Sedov
l'une ou l'autre des catgories du droit franais, mais de dterminer de
manire trs pratique l'tendue du droit de gage des cranciers de la
Fdration de Russie en rapportant les pouvoirs dtenus sur la chose
directement la ratio legis, l'esprit de l'article 2092 du code civil et du
droit franais de la saisie-excution, en vitant soigneusement le filtre des
qualifications du droit civil franais : au pouvoir s'attache et se mesure la
responsabilit et chacun engage l'acquittement de ses obligations
personnelles les biens dont il a une matrise telle qu'il lui est loisible d'en
disposer. Il est vident que les rgles du droit interne franais ont t
formules en contemplation de situations juridiques internes c'est--dire
rputes s'tre formes de manire homogne selon les termes du droit
franais. L'arrt de la Cour de Rennes du 27 juin 2002, parvient
internationaliser le droit matriel franais de la saisie pour lui permettre
dabsorber les particularits du droit russe en lespce.
La technologie franaise de la proprit mobilire ne fait pas ici obstacle
laccueil de linstitution trangre. A la vrit, cette capacit dabsorption
pouvait dj sobserver avec les arrts relatifs aux srets mobilires
76
Mourmansk State Technical University, Universit Technique d'Etat de Mourmansk
81
conventionnelles. Il y a donc bien confirmation que le dsaccord technique
est loin dimposer le verrouillage de lordre juridique franais. Mais il faut
noter aussi que dans cette affaire du Sedov, la politique de dfense du
crdit par la protection des tiers ntait pas concerne : cest lorsque le ou
les cranciers du possesseur du bien en France prtendent exercer leurs
droits sur celui-ci que cette politique dveloppe ses contraintes ; en
loccurrence, le navire tait immatricul et gr par lUniversit de
Mourmansk, qui en tait le possesseur et il ny avait donc pas lieu
dopposer la Compagnie Noga, crancire de la Fdration de Russie,
des dispositions du droit franais arbitrant les rapports entre lUniversit,
ses propres cranciers ventuels et les tiers.
Enfin, il convient dajouter que dans les cas o le droit franais, par
exception ordre public, loi de police ou autre , fait obstacle au droit qui a
pu tre acquis ltranger, le moment dintervention ne se situe pas,
comme la jurisprudence Kantoor de Maas-Socit DIAC voudrait le faire
croire, en amont du fonctionnement de la rgle de conflit, au stade du choix
de celle-ci, avant sa mise en uvre, mais en aval lorsque les prrogatives
confres par la loi trangre se rvlent dangereuses pour les tiers en
France.
82
III. Le trust.
Il faut bien sy arrter tant la rputation est solidement faite cette
institution dtre exorbitante et rfractaire lanalyse civiliste. Cette
rputation est bien mrite, si effectivement il faut se placer au point de vue
de lanalyse civiliste. Mais, rien nassure que ce point de vue, lorsquil sagit
du choix de la rgle de conflit et donc lorsquil sagit de la qualification, soit
suffisant et pleinement adquat : la qualification repose sur lanalyse de
linstitution sur laquelle sest modele la situation qui a donn lieu au projet
ou question de droit, mais elle repose sur lanalyse comme le pied de
lathlte repose sur le tremplin afin de mieux slever et daccder au
niveau du jugement synthtique.
Cette question du trust nappellera pas pourtant de trop longs
dveloppements car elle a dores et dj t tudi avec soin et mthode
par Mme Sara GODECHOT-PATRIS, aujourdhui professeur lUniversit de
Tours, lorsquelle rdigeait sa thse de doctorat
sous la direction du
Professeur LEQUETTE : Larticulation du trust et du droit des successions77. Le
titre est modeste et paraitrait en dessous des ambitions que dveloppe la
thse ; en ralit, larticulation dont il est question, cest--dire linsertion
du procd technique du trust dans le mcanisme du rglement dune
succession internationale gr par le droit franais, nest conu que comme
une illustration concrte de la question beaucoup plus gnrale de laccueil
de linstitution exorbitante dans le systme de rglement de conflit. La
thse aurait pu sintituler : le rglement franais des conflits de lois (en
matire de succession) lpreuve du trust anglo-amrician78. Sans doute
est-il possible de trouver aussi redire sur un tel titre, mais ce nest pas
lauteur des prsents propos dengager la critique de cette approche
relativement concrte de problmes fondamentaux et particulirement
77
S. GODECHOT, Larticulation du trust et du droit des successions, thse Paris II, 2002, d. Panthon-Assas,
prface Y. Lequette, Paris 2004
78
Comp. Les conflits de qualifications lpreuve de la donation entre poux, thse Paris II 1974, d Dalloz
1977 prface H. Batiffol
83
abstraits du droit des conflits en loccurrence, qualification, ordre public,
substitution, adaptation, etc. Et comme cette approche exploite un massif
jurisprudentiel assez riche don telle fait une analyse critique approfondie, il
ny aurait ici rien ajouter ce travail ; il suffirait dy renvoyer.
Mais ce serait laisser croire quil ny a qu approuver les positions que
lauteur tablit dans sa thse. Or cette approbation ne va pas sans quelques
nuances.
Le choix du thme et de linstitution tait tout fait pertinent. Le trust angloamricain se joue des catgories et concepts de la tradition romanogermanique laquelle appartient le droit international priv franais. La
simple description de linstitution en termes de droit franais savre dune
extraordinaire difficult.
La Confrence de droit international priv de La Haye sy est essay,
propos des seuls trusts exprs, cest--dire crs volontairement , par le
moyen dune dclaration de volont (consigne dans un crit et) tendant
placer certains biens dans la configuration quon dnomme trust. En effet, il
y a des trusts volontaires ou exprs, et il y a aussi des trusts lgaux
(statutory trusts) et des trusts judiciaires (constructive trusts, et peut-tre
resulting trusts encore que la cration de ceux-ci soit impute par les juges
lintention prsume des particuliers79) : il y a donc une pluralit de
sources possible pour un agencement technique constant. La Confrence
de La Haye, comme le rvle larticle 3 de la Convention du 1er juillet 1985
relative la loi applicable au trust et sa reconnaissance ne sapplique
quaux trusts cres volontairement, quelle dfinit (art. 2) en pas moins
dune quinzaine de lignes comme les complexe des
relations juridiques cres par une personne, le constituant par acte
entre vifs ou cause de mort lorsque les biens ont t placs sous le
contrle dun trustee dans lintrt dun bnficiaire ou dans un but
dtermin.
Le trust prsente les caractristiques suivantes :
79
Le resulting trust pourrait donc ntre pas un trust cr par la juge, mais bien par la volont prive,
cependant comme celle-ci nest pas exprime dans un crit, la convention ne sy applique pas
84
a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du
patrimoine du trustee ;
b) le titre relatif aux biens du trust est tabli an nom du trustee ou dune autre
personne pour le compte du trustee ;
c) le trustee est investi du pouvoir et charg de lobligation, dont il doit
rendre compte, dadministrer, de grer ou de disposer des biens selon les
termes du trust et les rgles particulires imposes au trustee par la loi.
Le fait que le constituant conserve certaines prrogatives ou que le trustee
possde certains droits en qualit de bnficiaire ne soppose pas
ncessairement lexistence dun trust 80.
Mais pour tre peu prs complet dans leffort de prsentation ; il faut aussi
mentionner larticle 4 de la convention qui prcise que celle-ci ne
sapplique pas des questions prliminaires relatives la validit des
testaments ou dautres actes juridiques par lesquels des biens sont
transfrs au trustee . Cest dire dune certaine faon quil ne faut pas
confondre lacte par lequel un trust est cr et le trust lui-mme ; de fait, le
trust est une figure juridique dexploitation des utilits dun bien ou dun
ensemble dactifs, ce nest pas en lui-mme lacte qui le met en place.
Linstitution dun trust est en quelque sorte un phnomne parasitaire ; le
trust se greffe sur un transfert de proprit convenu avec le trustee ou
encore sur un testament attribuant les biens en trust un lgataire qui
devient trustee. Lacte juridique qui sert de support au trust est ainsi soumis
ses propres rgles ; il a un rgime distinct qui ne relve donc pas de la
convention de 1985, bien quau bout du compte il puisse peser sur la
ralisation du trust ; par exemple, si par extraordinaire la loi applicable la
forme du testament (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) annule
celui-ci ou bien si la loi applicable au fond la dvolution testamentaire qui
rgit la disposition de dernire volont est rfractaire la cration de ce
complexe de relations juridiques caractristiques de linstitution.
80
legal relationships created inter vivos or on death by a person, the settlor, when assets have been
placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose.
A trust has the following characteristics
a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustees own estate ;
b) title to trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the
trustee ;
c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or
dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him
by law.
The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have
rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust .
85
La qualification impossible de linstitution (considre en bloc). Ce
complexe de relations juridiques caractristiques du trust soulve une
difficult qui nest pas purement thorique, mais est peut-tre dabord
pratique. Cest qu la diffrence de ce que proposent les exemples relatifs
aux srets mobilires, les prrogatives dont lexercice est rclam sur le
bien litigieux en application du trust ne correspondent pas celles que les
droits de la tradition romano-germanique dfinissent et rpartissent entre
les divers intresss. Avec les srets, il tait question de proprit, de
droit de prfrence, de droit de suite etc. et seul variait le type de
distribution des prrogatives et lordre de leur exercice entre le crancier
et le dbiteur, leurs ayants droit respectifs et les tiers. Le jeu ou la
combinaison nobissait pas au mme schma mais les lments du jeu ou
de la combinaison taient les mmes. La communaut de droit ntait
rompue quau niveau de la structure de la sret, elle subsistait au niveau
des composantes du mcanisme. Avec le trust, la structure est diffrente,
mais encore les lments sont diffrents ; ni lune, ni les autres ne figurent
au catalogue de la tradition romano-germanique.
De
la
diffrence
de
structure,
Mme
GODECHOT-PATRIS
conclut
limpossibilit dintgrer le trust dans les catgories du droit international
priv franais. Cette conclusion est, me semble-t-il, tout fait exacte.
Pourtant cela na pas empch les tribunaux franais de multiples reprises
dassurer laccueil de cette institution vraiment exorbitante, sur le plan
technique, par le systme franais de solution des conflits de lois.
De
mme, dans laffaire du voilier Sedov, il est apparu que la figure singulire
du droit de gestion oprationnel pouvait tre prise en charge par le
droit international priv franais, en dpit du fait que les prrogatives de la
Fdration de Russie ne trouvaient pas dans le code civil franais un exact
quivalent. En fait, si elle est incontestable en elle-mme, la constatation de
limpossibilit de qualifier le trust au moyen des catgories du for ne
semble tre inhibitoire pour le droit international priv que si linstitution
est considre en bloc, comme un tout, une figure aux lments
86
indissociables se conditionnant mutuellement de manire si stricte quil est
impossible de concevoir lun sans les autres.
Le dpeage entre dnaturation et dguisement. Mme GODECHOT-PATRIS
a parfaitement discern cela et cest prcisment ce qui la porte
reprocher aux dcisions franaises qui ont prononc sur des situations
mettant en cause un trust, de lavoir soumis un dpeage qui conduisait,
lui est-il apparu, qualifier distinctement, isol de lensemble, llment ou
les quelques lments de linstitution sur lesquels roulait le contentieux
soumis au juge. Pareil reproche dnonce une dnaturation de linstitution. Il
est vrai que le trust nest pas un mandat, que le trust nest pas une
stipulation
pour
autrui,
que
le
trust
nest
pas
une
substitution
fidicommissaire, quil nest pas un contrat , ni une disposition
testamentaire, etc. Et ce serait effectivement travestir la ralit que de
sen tenir ces qualifications - qui ne traduisent pas linstitution et qui ne
sauraient trouver leur explication que dans le rsultat auquel elles
permettaient daboutir respectivement sur le plan de la dsignation de la loi
applicable, sur le plan du choix de la rgle de conflit. Ce nest quhabillage
ou, pour le dire moins rvrencieusement, dguisement. Lorsque le juges
saventurent sur ces voies, en ralit ils veulent donner leur solution une
motivation qui lgitime soit ladmission, soit le refus de lexercice du droit
qui est contest dans le litige dont ils sont saisis et quon prtend dduire
dun trust. Ils ne sont pas saisis proprement parler du trust lui-mme, de
linstitution elle-mme ; ils sont saisis de lun de ses effets et sils le
rapportent une institution connue de la loi du for, cest pour appliquer le
droit que dsigne dans le cas despce la rgle de conflit dans la catgorie
de laquelle peut entrer le mandat, ou la substitution fidicommissaire, ou la
stipulation pour autrui, etc. Pour arriver la solution quant leffet
recherch que peut procurer, par exemple, lapplication de la loi anglaise
ou amricaine sous lempire de laquelle le trust a t constitu, ce trust
deviendra une libralit cause de mort en raison du dernier domicile du
constituant overseas ou, dans une autre configuration de la situation, un
contrat en raison du choix opr par le constituantIl faut rendre justice
87
aux facults danalyse de lauteur grce auxquelles elle peut dtecter trs
exactement lartifice et constater avec justesse que la qualification dans ces
hypothses tait essentiellement verbale, que le juge cherchait dans le
glossaire de la langue juridique franaise un terme qui permt
dapprhender la question de droit pose et qui permt aussi de motiver la
rponse quil apportait. Il y a une part de rhtorique, impose ici par
lobligation de motivation, laquelle est au fond une obligation de dire les
raisons qui fondent la solution ; pour dire, il faut des mots, il faut un lexique
partag avec les destinataires de la motivation
Larrt de Ganay. Larrt de la Cour dappel de Paris prononc le 10
janvier 1970, dans la nouvelle affaire de Ganay
81
propose une illustration
remarquable de ces jeux :
La princesse de Hnin, ne Charlotte de Ganay a conclu Paris rue Saint
Florentin en 1926 un contrat aux termes duquel elle transfrait la
Pennsylvania Company for Insurances un portefeuille de valeurs mobilires
dposes aux Etats-Unis, en contrepartie de la somme de $1, charge pour
cette socit dadministrer ledit portefeuille et de verser le revenu la
princesse elle-mme sa vie durant et de remettre le capital et ses
accroissements ventuels certains de ses parents dment dsigns dans
lacte. Un trust avait ainsi t greff sur la vente ( prix symbolique) des
actions ; vrai dire il sagissait dun double trust, inter vivos pour autant
quil prvoyait le droit de la princesse recevoir les revenus nets tant
quelle serait en vie, et mortis causa en tant quil prvoyait la remise du
capital certains bnficiaires au jour du dcs. Au demeurant, la
princesse stait rserve la facult de modifier tout moment la
dsignation des bnficiaires du capital. Elle exera cette facult en 1934,
sans dailleurs prendre garde den informer la Pennsylvania Company.
Ultrieurement, en 1942, elle rdigea un testament par lequel elle dclarait
rvoquer toutes les dispositions antrieures et instituer lgataires
universels tous ses neveux et petits neveux, en imposant le respect des
rgles de la reprsentation successorale ; sur quoi, elle mourut en 1943
Paris o elle tait domicilie. En ltat de ces actes, certaines difficults
taient prvoir et notamment il tait permis de sinterroger sur le point
de savoir si le testament de 1942 avait ou non rvoqu les attributions
mortis causa et spcialement la dsignation du bnficiaire substitu en
1934 ceux qui avaient t initialement indiqus. Pour rsoudre ces
difficults, les neveux et petits-neveux y compris ceux qui taient appels
recueillir les biens mis en trust conclurent un arrangement de famille, qui
fut excut en ce qui concerne les biens mobiliers et immobiliers dposs
ou existant en France. Cependant, une des petites-nices de la princesse
81
Paris, 10 janvier 1970, de Ganay, Rev. crit., 1971. 518, note Droz, JDI 1973. 207, note Loussourarn, D.
1972. 122, note Ph. Malaurie.
88
contesta la validit rglement de famille , auquel elle prtendit navoir
pas librement consenti ; elle demanda en outre que le trust soit dclar nul
pour contrarit aux dispositions impratives du droit franais des biens
comme du droit franais des libralits, subsidiairement quil soit dclar
rvoqu par le testament de 1942. La loi franaise tait applicable au statut
des biens dposs ou situs en France et leur dvolution dans le cadre
de la succession aux meubles, en tant que loi du dernier domicile, et dans
le cadre de la succession aux immeubles, en tant que lex rei sitae.
La Cour de Paris jugea que rien ntablissait que le consentement de Mme
Courtois, ne Irne de Ganay, au contrat de rglement de famille navait
pas t librement donn et quen consquence cet acte devait tre tenu
pour valable et efficace.
Surtout la Cour jugea que le trust tait valable. Cest ce qui importe ici.
La question de la qualification. Il tait prtendu qu
au regard de [la loi franaise rgissant la succession mobilire], dame de Hnin
ne pouvait valablement disposer de ses biens par le moyen dun trust, cette
institution se caractrisant par un clatement du droit de proprit entrainant la
constitution de droits rels inconnus en droit franais et ayant pour effet de raliser
une disposition cause de mort trangre aux modes de disposition prvus par ce
droit
Largument, on le voit, envisageait linstitution, non pas en bloc, dans son
ensemble pour la qualifier, mais dans lincidence particulire quelle
pourrait avoir sur la mise en uvre de la loi successorale franaise :
lincompatibilit technique atteste par l clatement du droit de
proprit (qui confrerait aux bnficiaires des droits que nattribueraient
pas les rgles du droit successoral franais) comme par la contrarit aux
articles 893 et suivants du code civil de lpoque (qui noffraient le choix
quentre deux modes de disposition, la donation entre vifs et le testament,
effectus dans les formes dfinies par ledit code). En ralit, la question de
droit pose, sans doute de faon un peu maladroite82, par les appelants ne
demandait pas que linstitution ft qualifie dans son ensemble ce qui
naurait pu se raliser avec les catgories franaises quau prix dune
dnaturation ; la question de droit pose allguait de manire plutt
implicite que le trust tait valable mais que ne pouvait y tre attachs des
effets successoraux conformes ceux que prvoit la loi franaise rgissant
82
Daprs les termes de larrt il semble que les appelants souhaitaient profiter du caractre inconnu du
trust et prcisment de la difficult de le qualifier dans son ensemble, alors quils soutenaient, bon
escient, une qualification successorale.
89
en lespce la succession mobilire. Seule cette question de droit pouvait
demander tre qualifie, mais comme telle elle ne devait pas soulever
beaucoup plus de difficult que la question de savoir si une institution
contractuelle ou un contrat successoral est susceptible de produire ses
effets lorsque la dvolution de la succession est rgie par une loi qui
lignore. Dailleurs, pourquoi ici la difficult de qualification aurait-elle t
plus grande ou autre que celle quaurait pu soulever le droit de gestion
oprationnelle dans laffaire du Sedov ?
Retour sur le Sedov et dautres. Dans laffaire du Sedov nul ne doutait que
les droits de lUniversit de Mourmansk relevaient de la loi russe ; seul
embarrassait le problme de lincidence exacte de ce droit de gestion
oprationnelle sur le droit de gage des cranciers de la Fdration de
Russie : la Compagnie Noga pouvait-elle saisir le voilier ?
Dans les affaires Kantoor de Maas et Socit DIAC, la Cour de cassation avait
choisi de se placer sur le terrain de la validit de la clause confrant la
sret et, ayant retenu lapplication de la loi franaise du lieu de situation,
elle avait ainsi de manire quasi expresse jug que la sret globalement
considre entrait dans la catgorie du statut rel. Mais on sait que cette
qualification tait commande par la volont de fonder (non pas la nullit,
mais) linopposabilit de la sret trangre aux cranciers du possesseur
du bien en France. Seulement pour refouler aux frontires les droits issus
de la sret allemande, la Cour de cassation a cru devoir balancer le pav
de lours et, pratiquent un a fortiori, sen prendre la validit de lacte :
quod nullum est, nullum effectum producit. En lespce, la Cour de Paris va
qualifier
linstitution
de
manire
tout
aussi
tendancieuse,
mais
apparemment dans le dessein inverse dassurer la pleine efficacit en
France de lacte pass sous la loi amricaine.
La qualification contrat et lextension de la validit. A cette fin, la cour
refuse la qualification successorale qui tait pourtant assez vidente
sagissant de la porte successorale de la dsignation des bnficiaires du
trust au dcs du constituant. La cour prfre fonder sa qualification sur le
90
support du trust qui tait le contrat pass entre dame de Hnin et la
Pennsylvania Company, car nul ne pouvait douter quil sagissait dun contrat
et, comme un contrat est soumis la loi sous lempire de laquelle les parties
lont localis, elle pouvait en loccurrence, atteindre par ce dtour la loi
amricaine de Pennsylvanie qui, bien sr, validait lopration. Il suffisait
alors de considrer que cette validit du contrat stendait lensemble de
lopration, y compris la constitution du trust mortis causa. Cest bien ce que
fait la Cour de Paris.
Dans sa note la Revue critique 1972, p. 530, DROZ approuve la solution aux
motifs que la ralisation de lattribution mortis causa au bnficiaire selon la
volont du settlor incombe au trustee et quil nest pas possible de ngliger
la position ce celui-ci cet gard, laquelle procde du contrat. Or, plaide le
commentateur, ce serait ngliger cette position du trustee, en aggravant ou
mme seulement en altrant les engagements quil a pris, si on appliquait
leur excution une autre loi que celle sous lautorit de laquelle les parties
ont plac leur contrat. Largument est faible : en acceptant le trust et les
fonctions qui lui taient proposes, le trustee a d ou aurait d envisager
(spcialement sil est, comme en lespce, un professionnel du trust) les
diverses ventualits susceptibles dinfluer sur la nature et ltendue de ses
charges et il na pas ou naurait pas d ngliger les risques inhrents la
constitution dun trust mortis causa, rvocable ou modifiable ad libitum par
le constituant qui ne lui pas promis de ne jamais changer de domicile83. La
dmonstration de Droz ne peut donc absoudre la Cour de Paris du pch
damalgame (si cen est un) ni de sa pratique de la qualification
fonctionnelle qui en loccurrence lui permettait de fourrer le contrat dun
trust mortis causa, alors quon se trouvait certainement dans un cas o le
dpeage tait on ne peut plus lgitime, quoi quen pense Mme GODECHOT.
83
Il faut dailleurs remarquer quen lespce dune part la dame de Hnin tait toujours domicilie
Paris au moment de son dcs comme elle ltait au moment de la constitution du trust, dautre part que
la Pennsylvania Company na pas t trouble dans sa gestion du trust par la modification de la
dsignation des bnficiaires survenue en 1934, puisque celle-ci ne lui avait pas t signifie et quelle
ne semble avoir t davantage perturbe par la rgularisation de cette modification opre la Orphans
Court de Philadelphie en 1948.
91
Contrle de lordre public international : dmembrement de la proprit.
Au demeurant, la Cour de Paris aprs avoir ainsi tendu au trust la validit
du contrat tait bien consciente de navoir pas rpondu au fond au moyen
que les appelants tiraient de lincompatibilit technique entre les droits
rsultant du trust et le droit franais des successions. Aussi bien, anticipant
la dmarche de la Cour de Rennes dans laffaire du Sedov, elle soumet les
droits acquis selon la loi amricaine au contrle de lordre public
international franais. Elle aurait pu sviter cette tche si, comme le
proposaient les appelants, elle avait retenu la qualification successorale ;
mais naturellement pareil choix laurait conduite aussitt la loi franaise
des successions et son rejet de s particularit s techniques du trust. En
passant par lordre public il tait plus facile de temprer lhostilit du droit
franais spcialement en dployant lombrelle de lordre public attnu :
il importe peu que ce contrat ait eu pour effet entre la constituante et le trustee un
dmembrement de proprit admis par la loi amricaine mais inconnu en droit
franais ds lors que les biens affects par ce dmembrement taient situs en
Amrique et que lexcution du contrat devait se poursuivre dans ce pays []
Cette rponse nest pas inapproprie et les appelants reoivent la monnaie
de leur pice : le dmembrement quils invoquaient est ralis par le trust,
qui double le droit de proprit at law du trustee dun equitable interest au
profit du cestui . Mais ce ddoublement ou redoublement ou plutt cette
superposition cesse lorsque le trust steint, ce qui en lespce devait se
produire, selon lacte de constitution, en suite du dcs du constituant par
la remise du capital aux bnficiaires ; ce moment-l la proprit se
consolide at law sur la tte des attributaires dsigns. La loi franaise
navait pas souffrir aucun moment sur ce point ds lorsque les biens
taient situs aux Etats Unis et mme, aurait-elle t considre comme loi
successorale, elle tait indemne ds lors que les attributaires percevaient
des droits entiers sur les actions.
Le contrle de lordre public : rvocabilit. Mais larrt poursuit en
abordant la question de la contrarit lordre public de la rvocabilit de
la dsignation des bnficiaire ; largument tir de cette rvocabilit aurait
t pertinent au regard des restrictions formules par lancien article 893 ;
92
mais celui-ci ntant pas, selon la cour, applicable titre de loi
successorale, navait pas intervenir ici. De sorte que lobstacle na pas
tre affront et que la cour peut affirmer quelle
na pas, en lespce, rechercher si les droits des bnficiaires sont ns dans
des conditions compatibles avec lordre public franais, mais seulement si ces
droits, ns sous lempire de la loi trangre comptente, sont eux-mmes
compatibles avec cet ordre public ; au surplus les exigences de lordre public
franais en la matire ne sauraient tre tenues pour imprieuses puisque notre
droit admet la rvocabilit de certaines libralits, notamment celles qui rsultent
des stipulations pour autrui et, en particulier, des assurances sur la vie
Un pareil rsultat naurait pu tre atteint si la question avait t soumise
directement, par la rgle de conflit successorale, aux dispositions du droit
franais des successions, le trust mortis causa de lespce nentrant pas
dans le cadre des exceptions de libre-rvocabilit mentionnes ou omises
par la Cour. Il tait ds lors ncessaire dviter la voie successorale et
demprunter la voie contractuelle que lordre public ne pouvait couper.
Contrle de lordre public : rserve hrditaire. La cour prolonge
lexamen de la conformit lordre public international franais en
voquant la rserve hrditaire ; mais cest pour constater que le problme
ne se pose pas Mme de Hnin tant dcde sans laisser dhritiers
rservataires. Lobservation est parfaitement exacte et que pourrait-on
contre un pareil motif ? Pourtant, si le bien fond nen est pas discutable, le
besoin qua prouv la cour de le formuler traduit une espce dinquitude
ou dincertitude. Dans quels cas un contrat peut-il porter atteinte aux
rgles dordre public relatives la rserve hrditaire ? Nest-ce pas tout
simplement lorsque le contrat renferme une libralit ? Une libralit
consentie cause mort et librement rvocable chappe-t-elle la
qualification successorale ?
Il y avait donc bien un tour de passe-passe dans cette qualification contrat.
Une fois de plus la jurisprudence joue de la qualification.
Il faut croire que les catgories sont souples, ce qui ntonne pas sil est vrai
que le systme de catgories est le produit de lexprience juridique et
93
[quil] a d accueillir au fur et mesure de lvolution de la vie sociale et de
lapparition de besoins nouveaux, des modifications et des innovations qui
nont pas toujours limin les lment primitifs sans pourtant se coordonner
spontanment avec ceux-ci . Le droit nest pas mathmatique, ni
mcanique contrairement ce que suggrait NIBOYET. La jurisprudence en
profite.
Ainsi sagissant des dcisions relatives aux srets relles mobilires, elle
nhsite pas procder une qualification globale de lopration, dans son
ensemble, qualification statut rel, qui permet daboutir la loi franaise
prohibitive des pactes commissoires et en principe une nullit quil lui
faut aussitt convertir en inopposabilit, ce qui est bien suffisant ds lors
que la question de droit rsoudre est limite lexercice dun droit de
prfrence. La qualification tendancieuse dporte les problmes vers laval
et contraint ici malmener la loi franaise qui ne reoit pas lapplication
que ses termes promettent.
Ainsi avec le trust, lui aussi qualifi dans son ensemble, mais cette fois pour
dboucher sur une loi trangre permissive, complte par un contrle de
lordre public. Derechef la qualification tendancieuse nempche pas le
dport des problmes vers laval.
[Section II. Laval ou linstitution exorbitante face la loi applicable.
1er. Procds de coordination matrielle
A. La substitution
Zieseniss, Civ. 1re 20 fvrier 1996, Rev. crit. 1996. 692, note Droz, chron. Y.
Lequette au D. 1996, doctr. 231
Eckensberger, Paris, 26 juin 1981, Rev. crit. 1982. 537, note B. Ancel, Cass.
civ. 1re, 22 avril 1981 et Cass. civ. 1re, 15 fvrier 1983, Rev. crit. 1983, 645,
note B. Ancel
B. Ladaptation
Le rgime matrimonial du polygame
Le conjoint survivant
2. Le refus de coordination matrielle : lordre public ]
94
95
Chapitre II. Le droit acquis ltranger
Lexpression droit acquis ltranger fait rfrence lhypothse o la
situation juridique quon entend faire valoir dans lordre du for sest
constitue dans un ordre distinct - o un ensemble de circonstances sest
produit auquel une rgle de droit a attach une srie deffets, dont il sagit
dobtenir la sanction ou la conscration dans lordre du for (appel aussi,
par synecdoque, lordre requis, voire lordre daccueil).
Cette
expression
connu
une
belle
fortune
dans
la
doctrine
internationalprivatiste franaise avec NIBOYET et avant lui son matre PILLET,
et aussi avec le Comte de VAREILLES-SOMMIERES. Elle provient du droit des
conflit dans le temps : jus quaesitum, jura quaesita, il y a droits acquis en
droit interne, au sein dun seul et mme ordre juridique, lorsquune loi, au
temps o elle tait en vigueur, avant son abrogation, a attribu la runion
des conditions quelle posait les consquences quelle prvoyait ; ces
consquences ou effets de droit ou sanction ou encore tout simplement,
droits pour le bnficiaire de lapplication de la rgle, sont acquis dans leur
principe en ce sens quune la loi nouvelle qui aurait durci les conditions
dacquisition resterait sans prise sur leur cration et ne compromettrait pas
leur survie ; la loi nouvelle ne rtroagit pas, elle ne sapplique que pour
lavenir. Les auteurs linstant cits tenaient pour leur part que si une loi
trangre stait ainsi applique pour confrer un droit et quaprs
lacquisition de ce droit, il sagissait non pas den disputer la validit dans
lordre du for mais den tirer des consquences ou de lui faire produire
effet, il convenait ici denregistrer le fait de cette acquisition ltranger.
Un maon italien immigr en France retourne en Italie pour y pouser une
fille de son village, puis revient en France ; aprs avoir rejoint le domicile
conjugal en France, la femme y aura un droit acquis la qualit dpouse
rsultant de lapplication de la loi italienne : elle pourra se prvaloir de
cette qualit pour bnficier de lextension de la protection sociale au
96
conjoint et cette qualit dpouse pourra aussi, lorsquelle aura contract
une dette mnagre, tre invoque pour diriger les poursuites contre son
mari. La difficult que rencontrait PILLET par exemple tenait ce quil y avait
des maons italiens ou autres qui allaient se marier ltranger dans un
pays qui ntait pas forcment le leur et sans toujours pouser des filles de
leur village, mais bien quelquefois des filles ressortissantes dun pays tiers
et ce moment l, si le mariage ainsi clbr ntait valable quau regard
de lun des ordres juridiques des divers pays concerns, il tait permis de
sinterroger sur celui de ces ordres juridiques auquel il convenait de se
fier ; cette question rintroduisait le problme de la loi applicable. Ctait l
une difficult que SAVIGNY avait dj stigmatise lorsquil observait que
pour dterminer sil y avait un droit acquis il fallait identifier lordre
juridique qui avait pu le faire acqurir84. Il ne suffisait pas de se conformer
une loi quelconque, il fallait se conformer la loi comptente.
La filire hollandaise. - Cette objection navait pas empch le
dveloppement de la doctrine des droits acquis. Elle a prospr en
Angleterre avec A. V. DICEY, aux Etats Unis avec J. BEALE, lun et lautre
lointains hritiers de J. STORY. Mais il faudrait remonter plus haut encore
dans la filire et retrouver ainsi la doctrine hollandaise du XVIIe sicle pour
laquelle la question du conflit de lois ou de la loi applicable sintgrait sans
heurt dans la machinerie de la reconnaissance des droits acquis
ltranger.
Il suffit de rappeler ici les trois axiomes de HUBER85 :
- 1. Les lois de chaque Etat ont autorit dans les limites de son territoire et
obligent tous ses sujets, mais pas au-del ;
- 2. Sont rputs sujets dun Etat tous ceux qui se trouvent lintrieur de ses
frontires, quils y demeurent titre permanent ou titre temporaire ;
84
F.K. Savigny, Trait de droit romain, trad. Guenoux, 2e d. Paris 1860, repr. Ed. Panthon-Assas, 2002,
av.-propos H. Synvet, 361 5, p. 131 : Ce nest l quune ptition de principe ; car pour reconnatre si
des droits sont bien acquis, il faut tout dabord savoir daprs quel droit local nous devons juger de leur
acquisition .
85
U. HUBER, Praelectiones juris Romani et hodierni, Franeker, 1689, devenues Praelectiones juris civilis
dans l'dition de Leipzig de 1707, De conflictu legum, n. 2 , V. trad. fr., B. ANCEL et H. MUIR WATT, Du
conflit des lois diffrentes dans des Etats diffrents , Mlanges J. Hron, Paris , p. 1 et s.
97
- 3. Les autorits des Etats, par courtoisie, font en sorte que les lois de chaque
peuple, aprs avoir t appliques dans les limites de son territoire,
conservent leur effet en tout lieu, sous la rserve que ni les autres Etas, ni leurs
sujets n'en subissent aucune atteinte dans leur pouvoir et dans leur droit.
La question de la loi applicable reste enfouie dans le principe de
territorialit fond sur une certaine conception de la souverainet des
ordres juridiques.
En bref, le premier axiome nous dit que chaque ordre juridique est
exclusivement matre de la teneur et de lapplication du droit sur son
territoire et quil est dnu de toute comptence normative sur ce qui se
passe hors de son territoire. Le deuxime axiome traduit en termes de
comptence ou, dans une langue plus philosophique, en termes
dimpratif cette souverainet lgard des personnes : lordre juridique
local est comptent pour gouverner la conduite de toute personne se
trouvant sur son territoire, quelle y demeure pour y avoir fix son domicile
ou quelle ny soit quen villgiature ou simplement en transit.
Aprs cette dlimitation du cercle des assujettis par application du critre
de la prsence sur le territoire, le troisime axiome introduit le facteurtemps en affirmant que lexercice que chaque ordre juridique a fait de sa
comptence dans les limites de celle-ci (par exemple, en clbrant par lun
de ses officiers de ltat civil sur son territoire un mariage entre personnes
prsentes) est lgitime et partant sera opposable tous les autres ordres
juridiques au sein desquels il y aurait lieu de tirer des consquences de cet
exercice (quoique marie ltranger, la femme peut rclamer une
contribution aux charges du mariage son mari qui sest rfugi sur le
territoire du for). Le droit acquis ltranger est reconnu au for. Sous la
rserve toutefois de ne pas compromettre le pouvoir du for ni les droits des
tiers.
La rduction du conflit de lois. - Ce systme de reconnaissance allge
considrablement la contrainte que rencontreront PILLET et dautres avec la
question de la loi comptente. Cest quen effet lorsquil se demande si un
droit prtendument acquis ltranger a t valablement acquis, PILLET est
contraint de choisir dans une pluralit de critres de comptence parce que
98
le droit positif ne connat pas un seul rattachement, mais une srie de
rattachements affects chacun des matires diffrentes. Force lui est alors
de revenir la question de conflit de lois. HUBER na pas ce problme ; la
territorialit de la souverainet le dispense dun pareil choix ; la
souverainet lui indique le critre unique et prvient toute hsitation sur le
droit applicable. Il suffit pour chaque cas de rechercher o il est advenu.
La reconnaissance opre ici sur deux paramtres : un paramtre
gographique et un paramtre temporel ou chronologique que la formule de
HUBER met en relief lorsquelle vise les lois de chaque Etat, aprs avoir t
appliques dans les limites de son territoire . Si lordre juridique
comptent
ratione territorii a confr un droit, il serait illgitime de
remettre en cause par la suite ce droit devant les juridictions du for requis.
La cristallisation. - La simplicit du procd ne garantit pas pleinement son
efficacit. Le paramtre temporel peut soulever des hsitations. HUBER dit :
avoir t appliques. Sagit-il dapplication par un juge ou au moins par un
organe dapplication, une autorit
(officier de ltat civil, greffier,
notaire, huissier, etc) ? Est quune application dcide par les parties ou
convenue entre elles, par exemple en matire de contrat ne serait pas une
application ? Il y a l un problme qui est important. Car ce qui rend
opposable le droit acquis ou la situation constitue, cest quils sont pris en
charge par lordre juridique comptent, celui du territoire. M. MAYER ce
propos demande quil y ait eu cristallisation de la situation, le terme est
lgant et aussi loquent : mais lloquence comme llgance sduisent
souvent et spcialement lorsquelles sont mtaphoriques par la marge
dinterprtation que leur imprcision laisse chacun. Cristallisation signifie
ici fixation par lintervention dune autorit, laquelle tablit le lien entre
lordre juridique qui la commise et la situation.
Cette intervention, cette liaison se produisent comme toute action humaine
un moment dtermin et ceci autorise le jeu du paramtre temporel. Mais
cette exigence de cristallisation, en tout cas ainsi conue, est sur le plan
thorique difficilement explicable et elle rduit dans des proportions
99
importantes le champ de la reconnaissance ; sont exclues de ce champ
toutes les hypothses o la constitution de la situation procde dun acte
priv ou encore directement de la loi, sans le truchement dun organe. Or la
reconnaissance est aujourdhui prsente comme le canal pertinent
dadmission de linstitution exorbitante dans lordre du for.
De son ct, le paramtre gographique nest pas aussi rudimentaire quil y
parat. Cest un problme que de savoir sur quel territoire se forme une
situation ou, plus exactement de savoir ce qui permet de dire quune
situation sest forme ltranger, en dehors de lordre juridique du for. L
encore parce quelle fait de lintervention dune autorit llment dcisif,
la cristallisation comme lentend M. MAYER, peut aider puisque cette
intervention se situera autant dans lespace que dans le temps. Mais faut-il,
pour cela aussi exclure, du champ de la reconnaissance toute situation qui
nest pas relie par une autorit un ordre juridique ?
La reconnaissance de lexorbitance. - Quoi quil en soit de ces hsitations,
qui deviennent aigus dans le cas o la situation dont il est prtendu quelle
sest constitue ltranger ne correspond pas un modle connu du for,
cette voie dite de la reconnaissance est recommande pour le traitement
des droits acquis ltranger de la mise en uvre dune institution
exorbitante.
Lexemple serait ici fourni par le partenariat enregistr et autres
conjugalits exorbitantes, dont le PACS est la version franaise, mais qui se
dcline en droit compar en une multitude dautres figures qui vont de la
simple convention de vie commune, une espce de contrat de service
mutuel, au mariage, mais un mariage new look, qui nest pas le mariage de
la tradition canonique rcupr par les systmes de droit occidental,
puisquil peut unir de manire plus ou moins durable des personnes de
mme sexe.
Cette union sans complmentarit des sexes est exorbitante par rapport au
droit civil franais, qui ne connat sur le mode unisexe quun partenariat communaut de vie conventionnelle. Nanmoins ds lors quun mariage
100
nouvelle formule, la mode espagnole, par exemple, aurait t clbr en
Espagne par une autorit
locale, il conviendrait de le reconnatre en
France, dans la mesure o il a t valablement contract au regard du pays
de clbration. La reconnaissance permettrait de digrer lexorbitance.
A vrai dire, la solution a sans doute quelque chose de magique qui fait
impression sur beaucoup desprits. Deux franaises qui se livreraient
cette crmonie espagnole sans rencontrer dobjection en Espagne o elles
ont rsid suffisamment longtemps pour se mnager laccs auprs de
lofficier de ltat civil local seraient en France considres comme maries
lune lautre, alors mme que leur loi nationale commune leur interdit ce
genre de mariage. Puisque cela sest pass ltranger sous la protection
du droit tranger, le pavillon couvre la marchandise et il ny aurait rien
redire la dessus en France, en dpit du fait que les mmes personnes
nauraient pu daprs les rgles de conflit franaises rgissant leur tat et
capacit, obtenir le mme rsultat en France ou des autorits franaises
ltranger. Le droit acquis ltranger serait ainsi reconnu en France.
Cest dailleurs ce quenseignait Huber avec les illustrations de son
temps86 :
8. Le mariage aussi relve de ces rgles. Rgulier au lieu o il a t
contract et clbr, il sera valable et aura effet en tout lieu, sous la mme
rserve qu'il ne cause dommage autrui et, est-il permis d'ajouter, que son
exemple ne fasse trop horreur - telle une union incestueuse de droit des
gens87 qui se contracterait au second degr et qu'il faudrait reconnatre
partout, ce qui peut difficilement tre imagin devenir usuel. En Frise, il y a
mariage lorsque l'homme et la femme consentent s'pouser et se
comportent mutuellement comme poux, mme si jamais ils ne sont unis
devant l'Eglise : en Hollande, ceci ne serait tenu pour mariage. Cependant,
sans aucun doute, les conjoints frisons jouiront en Hollande du statut
d'poux, qu'il s'agisse de dot, de donations, de la succession des enfants
etc88. De mme, sera reconnu le mariage conclu au degr prohib grce
une dispense papale par un Brabanon qui viendrait ensuite s'tablir ici;
86
HUBER, op. cit.
Jus gentium, lexpression est ici utilise dans son sens originel ; il ny avait Rome quun seul justum
matrimonium, celui du jus civile accessible en principe aux seuls citoyens romains. Les unions
conjugales des non-citoyens relevaient des lois prgrines, du droit tranger et elles taient alors
conclues iure gentium. Huber imagine ici quune loi trangre autorise lunion incestueuse.
88
Ce n'est pas entre droit frison et droit hollandais, mais entre droit cossais et droit anglais qu' plus
d'un sicle de distance s'est joue dans les mmes termes pour connatre la mme issue l'affaire du
mariage du cornette Dalrymple v. Dalrymple v. Dalrymple, (1811) 2 Hag. Con. 54, 161 ER 665.
87
101
toutefois, si un Frison allait en Brabant avec la fille de son frre pour l'y
pouser et revenait ici ensuite, l'union ne semble pas devoir tre reconnue,
parce que de cette faon notre droit serait bafou par les pires exemples;
et l-dessus importe l'observation suivante; il arrive souvent que des
jeunes gens encore sous curatelle dsirant sceller leurs secrtes amours
par le mariage se rendent en Frise Orientale ou autres lieux o le
consentement au mariage des curateurs n'est pas exig conformment aux
lois romaines, lesquelles sur cet article n'ont plus cours chez nous. Ils y
clbrent le mariage et regagnent aussitt leur Patrie89. Je suis d'avis que
cette manuvre manifestement ne tend qu' la ruine de notre droit et qu'en
consquence nos juges ne sont pas tenus par le Droit des gens90 de
reconnatre pareilles noces et les rputer valables91; et de beaucoup il
vaut mieux affirmer que contreviennent au Droit des gens92 ceux qui, le
sachant et le voulant, offrent aux ressortissants d'un autre Etat de partager,
en raison de sa complaisance, un droit contraire aux lois de leur patrie .
Ainsi sauf ordre public, si lunion est incestueuse par exemple, ou sauf
fraude la loi dans le dernier cas envisag, la reconnaissance de la
situation modele sur une institution exorbitante simpose.
Avec ce procd de la reconnaissance des droits acquis, on serait libr
des contraintes de la rgle de conflit et, sauf les exceptions en aval
linstant mentionnes, on admettrait au for ce qui a t fait conformment
au droit tranger. Si ce qui a t fait ltranger ne correspond aucune
institution connue du for, cela ne serait pas dirimant, parce que ladmission
au for ne dpend pas de la rgle de conflit et donc chappe au filtrage
vrai dire intermittent et en tout cas le plus souvent trs lger, lorsquil nest
pas tendancieux de la qualification93. Sans doute faut-il discerner assez
prcisment les contours et lidentit de la situation constitue ltranger
89
Gretna Green a donc pu trouver son modle hors des les britanniques.
Cet appel au Droit des gens marque bien que la reconnaissance du droit acquis l'tranger est une
obligation ne de la dialectique des souverainets pour l'Etat d'accueil dont il ne peut se librer que
dans des cas exceptionnels o son identit est menace.
91
A noter que Story s'oppose sur cette question Huber en refusant la sanction de la fraude prfrant,
en considration des enfants, un mariage frauduleux un mariage nul mais consomm.
92
Intressante tentative de normalisation de l'exception de Comitas : la raction de rejet du for d'accueil
est lgitim par le manquement de l'Etat d'origine ladite Comitas.
93 A propos dune adoption-protection prononce par un jugement malien (Paris, 4 juin 1998, Rev. crit.
1999. 108), Mme MUIR WATT donne sur ce point des explications qui pourraient, par gnralisation et au
prix de quelques retouches de vocabulaire, tre transposes lhypothse de la reconnaissance des
situations constitues ltranger ; ainsi lorsquelle crit (Rev. crit. prc. p. 116, n. 10-11) que la
fonction de la reconnaissance spuise dans la constatation de laptitude de la dcision [ : situation]
trangre produire un effet normatif quant aux points de droit quelle tranche [ : tablit] sans prjuger
aucunement de la qualification de son contenu. Cest pourquoi il est indiffrent, tout dabord, que les
catgories du for ignorent linstitution trangre quelle met en uvre Lobjet propre du contentieux
de la rgularit nest pas de qualifier le contenu de la dcision [ : situation] trangre, car une telle
qualification ne prend son sens quen vue de la ralisation deffets attachs ltat de droit quelle
consacre, en vertu dune rgle distincte .
90
102
ne serait-ce que pour savoir si elle a t effectivement constitue et aussi,
le cas chant, pour savoir si elle sest cristallise mais, cette fin, il ny a
dautre moyen que dinterroger la loi trangre qui a fourni linstitution sur
le modle de laquelle la situation est prtendument constitue. Si lon veut
voir l, dans cette vrification, une opration de qualification, il sagit
ncessairement dune qualification lege causae, chappant ds lors au
systme du for et aux restrictions quil pourrait imposer. Lexorbitance ne
peut donc delle-mme former une entrave la reconnaissance.
Cette doctrine des droits acquis est plus ancienne que lEcole hollandaise.
Celle-ci nest que le dveloppement dun mode de gestion spcifique du
droit des conflits qui apparat ds les origines de la discipline et qui
pourrait tre appel mode de gestion vertical de la pluralit des ordres
juridiques ; ce mode de gestion (on dirait assez volontiers aujourdhui,
cette mthode comme on parle de la mthode de la reconnaissance)
soppose sur le plan historique comme sur le plan thorique au mode de
gestion horizontal, lui aussi apparu ds les origines de la discipline et qui a
domin et sans doute dominera encore longtemps la matire en dpit de
contestations pisodiques lchelle des sicles.
Il convient de jeter un coup dil sur ces deux approches avant dexaminer
le sort que leur rserve aujourdhui la jurisprudence confronte aux
institutions exorbitantes.
103
Section 1 re . Les deux modes de gestion de la pluralit des
ordres juridiques.
1er. - Le mode de gestion vertical
Ce mode de gestion de la pluralit des systmes juridiques correspond
une
reprsentation
unipolaire
ou
impriale
de
lorganisation
des
comptences normatives dvolues chaque potestas locale, dfinissant
ainsi pour chacune delles le champ des relations prives quelle peut
assujettir ses normes.
Jus commune et jura propria. Aux XIIIe-XIVe sicles, la division des tches
entre les deux puissances suprmes, le Saint-Sige et lEmpire, confie
ladministration du temporel ce dernier lequel sen acquitte en
sappuyant sur le droit romain, qui avec la renaissance du XIIe sicle est
celui fix par Justinien, complt par le droit canonique pour former le jus
commune. Mais lEmpereur (Princeps) nexerce pas son dominium mundi de
manire uniforme ; sa faiblesse relative loblige composer avec la
diversit des potestates locales et spcialement, avec la diversit des
pouvoirs municipaux (civitates sibi principes). Son aspiration luniversalit
quil nest pas en mesure de satisfaire par la voie dune lgislation
commune lensemble de ses sujets, passe par laffirmation de
luniversalit du jus commune, mais non par laffirmation de son exclusivit.
Ne disposant pas en fait des moyens dempcher les potestates locales de
lgifrer ou de maintenir les coutumes rpondant aux besoins locaux,
lEmpire sen accommode en feignant de croire ces foyers lgislatifs
municipaux ou rgionaux ne sont que des pouvoirs drivs de sa propre
puissance et que les statuts et coutumes, jura propria, quils produisent ne
104
simposent que de son agrment, concessio ou permissio expresse ou
tacite94.
Formellement, la structure impriale valide et prtend tablir son emprise
sur la diversit des jura propria ; il lui appartient donc den rgler la
coexistence et cest bien ainsi que lentendent les Commentateurs qui
sefforcent de dgager du jus commune et spcialement du droit romain la
partition qui orchestrera les activits des potestates locales.
Matriellement, elle assigne au jus commune une double fonction ; dune
part, une fonction de pilotage qui lui demande de fournir la rfrence pour
lvaluation de la qualit des solutions du jus proprium95 et dautre part, une
fonction de supplance qui le charge de rgir, titre de loi gnrale et
subsidiaire, toute question non couverte par le jus proprium.
Cunctos populos et Statutum non ligat nisi subditos. Ainsi la question de
la pluralit et de la diversit des ordres juridiques locaux relve
formellement du droit romain ; le prcepte fondamental est tir de la loi De
Sancta Trinitate et Fide Catholica, C. 1, 1, 1, Cunctos populos96, qui
commande dans lesprit de lpoque le principe statutum non ligat nisi
subditos : le statut noblige que les sujets - en effet, les empereurs euxmmes limitent la porte de leur prescription aux seuls peuples runis sous
leur pouvoir (Cunctos populos quos clementiae nostrae regit imperium),
sabstenant de lgifrer ladresse de non-sujets. Ce qui vaut pour
lempereur vaut aussi pour lautorit municipale. De ce prcepte statutum
non ligat comme de son origine, il sinduit que la question primordiale est
celle de ltendue de la comptence de lauteur du statut97 ; lautorit
94
Sur cette question des rapports entre Empire et cits v. notamment M. DAVID, Le contenu de
lhgmonie impriale dans le doctrine de Bartole, Bartolo da Sassoferrato, Studi e Documenti per il VI
centenario, Milan, 1962 ; vol II, 199.
95
La conformit au jus commune autorise lapplication transfrontire du statut municipal tandis que la
non conformit, jouant comme lexception dordre public, fait obstacle cette application du statut
municipal hors du primtre de lordre juridique qui la dict.
96
Cunctos populos quos clementiae nostrae regit imperium in tali sanctissima volumus religione versari
quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis etc : nous voulons que les peuples runis que
gouverne le pouvoir de notre clmence soient accueillis dans la trs sainte religion que le divin aptre
Pierre a apporte aux Romains etc (Constitution des empereurs Gratien, Valentinien et Thodose de
381 ap. J.C.)
97
E.M. MEIJERS ,Tractatus duo de vi et potestate statutorum, I. - Baldi repetitio super lge Cunctos populos,
II. - Van der Kessel, Praelectiones juris hodierni ad Grotii introductiones, Haarlem 1939, introduction
105
municipale nest comptente et ne peut donc disposer qu lgard de ceux
qui sont ses sujets. Ainsi le problme est abord sous langle publiciste de
la comptence des potestates locales et confi au droit romain qui (si
modeste quait pu tre son apport historique cette discipline) est constitu
en modle commun, unitaire, de rpartition des comptences, tablissant
entre la structure impriale et les potestates une relation verticale (de
subordination relevant du droit public).
Le fonctionnement de ce systme de distribution des comptences requiert
que pour chaque statut soient identifis ceux qui en sont les sujets.
Statutum agit in rem vel in personam. - Sur ce point, de fins esprits
remarquent dabord quun individu peut tre sujet raison de son
appartenance la collectivit quadministre lautorit qui a dict la norme
et que ce type de sujtion se manifeste lorsque la norme semploie agir
sur la libert de la personne, agit in personam, soit en dfinissant un
programme daction observer dans la vie sociale (tat et capacit), soit en
lui imposant une obligation (de donner, faire ou ne pas faire) ; les mmes
auteurs soulignent ensuite quun individu
peut aussi tre sujet en et
raison des biens, historiquement des immeubles, quil possde sur le
territoire relevant de cette autorit lgifrante et quil en est ainsi lorsque le
statut faonne le rgime juridique du bien en fixant les prrogatives et les
charges dont celui-ci peut tre lobjet, agit in rem. Ainsi est-on amen
distinguer les statuts personnels qui semparent des personnes rattaches
par leur origine ou leur domicile la collectivit o ils ont cours et les
statuts rels rglant lusage et la destine des immeubles situs sur le
territoire o ils sont en vigueur. Ainsi arm de ces critres, origo et situs rei,
la mcanique de rpartition des comptences peut fonctionner. Lindividu
qui prvoit de contracter avec un entrepreneur doit tre capable, cest au
statut de son origo ou de son domicile de dfinir cette capacit de
contracter car celle-ci mesure sa libert dagir dans la vie sociale ; mais si
le contrat envisag avec lentrepreneur tend surlever un immeuble dun
reproduite in Rev. crit. 1946. 203, spc. p. 206 : Ce que lon nomme aujourdhui la science du droit
international priv se rduit pour Balde une recherche des limites de la souverainet des villes
106
tage, cest au jus proprium du situs rei de dire si pareille construction est
permise ou non. De la sorte, den haut, par une relation verticale entre
lEmpereur et la cit, se dtermine grce cette distinction des statuts le
domaine daction normative concd chaque potestas locale.
Reconnaissance. - Une des consquences positives de la mise en uvre de
ce mode de gestion imprial est de faire apparatre la notion de
reconnaissance en ce que chaque puissance particulire est tenue par cette
relation verticale de cantonner son action normative dans son propre
champ de comptence et de sabstenir corrlativement dempiter sur le
domaine dvolu aux autres ordres juridiques locaux ; ds lors, si la
rpartition des comptences est bien faite, si les deux critres oprent sans
chevauchement ni dcouvert, laction dune potestas qui sinscrit dans le
champ de sa comptence est formellement incontestable et en quelque
sorte opposable erga omnes : elle ne saurait tre remise en cause par une
autre potestas, laquelle par hypothse est dpourvue de comptence sur le
point trait. Ainsi chaque ordre juridique oprant lintrieur de lEmpire
reconnat en principe laction normative des autres ordres juridiques sous
la condition de conformit au systme de distribution des comptences98.
Laction normative en toutes ses formes. - A partir de semblables
prmisses, il nimporte BARTOLE99 que la norme en cause soit gnrale et
abstraite, formant une rgle ou un statutum, ou quelle soit particulire et
concrte, constituant un jugement ou une dcision. Lopposabilit et la
reconnaissance couvrent laction normative de lordre comptent de
manire indiffrencie, cest--dire en bloc, sans distinguer entre action
lgislative, statut, et action juridictionnelle, dcision ; loi et jugement,
cest gal ; or le sujet est tenu par le jugement de sa cit, donc il lest autant
98
Comp. L. CONDORELLI, La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere, Milan, 1967, p. 14 et s.
Bartoli Sassoferratei In primam Codicis Partem Praelectiones, Lyon, 1546, n. 50 du commentaire sur
Cunctos populos o lauteur affirme le caractre extra territorial lgard de la femme qui sest
soustraite lexcution de sa peine en senfuyant du lieu de son domicile o elle a encouru une
condamnation au bcher : sans doute lexcution ne peut avoir lieu, du moins la mort civile qui sattache
la condamnation a effet au lieu de refuge, car les dcisions de ce genre qui emportent rduction de
ltat affectent la personne et la suivent telle la lpre le lpreux (v. Le Commentaire de Bartole ad
legem Cunctos populos sur la glose Quod si Bononiensis, mis en franais , in Mlanges Anne LefebvreTeillard, Ed. Panthon-Assas, 2010, p. 53 et s.) ; v. aussi eod. op. , n. 32
99
107
par sa loi dclare BARTOLE100. La formule implique que la reconnaissance
stend au del des dcisions judiciaires toutes les situations constitues
ex lege ; et, en vrit, il faut ajouter les actes juridiques dans la mesure o
ils se prtent tre rattachs lordre juridique qui les comprend dans son
domaine de comptence. De fait, BARTOLE estime que leffet de la
condamnation au bcher qui, lorsquelle na pu tre excute, est de
frapper de mort civile la personne condamne et de lui enlever ainsi sa
capacit de disposer de ses biens se dploie en tout lieu et atteint donc tous
les biens de cette personne o quils se trouvent101; il admet aussi que
lmancipation quun Prugin a obtenue Prouse a effet partout, puisque
comptemment prononce102; et ses yeux, le testament qui avait t
valablement fait selon la loi du lieu de sa confection, dont il prne la
comptence, valait sans distinction et portait son effet sur tous les biens ou
quils soient, mme hors du territoire 103. Acte juridique ou jugement, il
nimporte, pour lun comme pour lautre, le facteur dcisif est quils
sinscrivent dans le champ de comptence de lauteur de la norme qui les
prend en charge.
Le facteur dterminant nest pas la forme que revt le produit normatif, mais
la comptence reconnue son auteur et le problme rsoudre est celui
dune rpartition des comptences dont la cl est fournie par les rgles de
conflit relatives au statut personnel et au statut rel.
Rgle de conflit, rgle de comptence, rgle de reconnaissance. - Aussi
bien, en pratique, il est sans importance que la situation individuelle rsulte
de laction normative du magistrat ou quelle rsulte de laction normative
du lgislateur; ds lors que lintress appartient au cercle des sujets que
dessine le lien dallgeance, relle ou personnelle selon le cas, envers le
titulaire de la potestas potestas adjudicandi ou potestas statuendi104 - il doit
100
BARTOLE, op. cit., , n47
BARTOLE, op. cit, n. 50
102
Eod op., n. 40
103
Eod op., n. 36
104
pouvoir de lgifrer, distingu du pouvoir de juger (potestas adjudicandi) et du pouvoir de
contraindre (potestas cogendi) selon une trilogie scholastique qui se retrouve telle quelle dans le
Restatement (third) of the Foreign Relations Law of the United States, St Paul Minn., 1987, vol 1, p. 230 et s.
101
108
obir lauteur de la norme et lui seul. Il sensuit cette consquence quasi
mcanique que les autorits trangres potentiellement concurrentes sont
exclues parce que sans comptence tandis que la norme lie son destinataire
en tout lieu. Ainsi est assure la porte extraterritoriale tant des rgles que
des dcisions, quoique de manire variable selon que la norme atteint la
personne ou le bien ; lextraterritorialit est patente et complte en ce qui
concerne les normes affectant la personne qui en portera donc les
stigmates partout o elle se trouvera de telle sorte que lexcution pourra
au besoin en tre demande une autorit trangre qui laccordera sur
lettres rogatoires sine causae cognitione105 (en raison de son incomptence
au fond), tandis que lextraterritorialit est discrte et seulement latente ou
incidente en ce qui concerne les normes affectant les immeubles puisquil
ny a pas dintrt demander leur excution hors le ressort de lautorit
comptente o ceux-ci sont situs. Toutefois parce quils sont les plus
courants, seuls retiennent lattention des auteurs les cas impliquant des
normes personnelles ; en revanche, celles qui touchent aux immeubles ne
trouvent sexporter que de manire incidente et sont dlaisses et elles
napparaissent donc pas dans le dbat. Quoi quil en soit de cette absence,
il reste que le mme raisonnement, fond sur les rgles de comptence et
sans quil soit question de cristallisation, est mis en uvre pour justifier la
porte dans lespace des normes, quil sagisse de jugements ou de rgles.
Dans le langage daujourdhui, o il dsigne dabord le procd par lequel
un ordre juridique fait entrer en quelque manire dans le milieu national
les jugements trangers pour quils y dveloppent une certaine
efficacit 106, le terme reconnaissance peut, selon cette optique statutiste,
tre aussi appliqu la rception dans un ordre juridique de laction
normative exerce sur un fait ou comportement par un lgislateur tranger
pour que celle-ci y dveloppe une certaine efficacit.
105
REVIGNY, Ad legem Properandum Sin autem (C., 3,1, 13 , 3) reproduit par MEIJERS in Etudes dhistoire
du droit international priv, (traduction TIMBAL et METMAN) Paris, 1967, p. 126-127 ; BARTOLE lui embotera
le pas.
106
L. CONDORELLI, La funzione del riconoscimento di sentenze straniere, p. 7 ad notam, v. aussi n. 9
109
Cest dire quavec ce mode de gestion vertical, il ny pas lieu de distinguer
dans larsenal du droit international priv entre rgle de conflit de lois et
rgles de conflit de juridictions entre rgles de comptence ou rgles de
reconnaissance.
Aprs Bartole. - Lassimilation de la dcision et de la rgle sera tout aussi
vidente chez les successeurs de BARTOLE mais encore chez DARGENTRE qui
restera indiffrent la source de la relation lorsquil affirmera que si on
senquiert du statut de la personne ou de sa capacit passer les actes de la
vie civile, le pouvoir den juger est sans rserve le pouvoir qui juge au
domicile ; cest--dire le pouvoir auquel la personne est soumise et qui ldessus peut dcider de telle manire que ce quil disposera, jugera,
ordonnera du droit de la personne vaudra en quelque lieu que celle-ci se
transporte, parce que la personne en est affecte, comme nous disons 107.
Il sagit bien de comptence normative et de reconnaissance. La mme
confusion se retrouve dlibrment chez Jean VOET qui runit sous la
dnomination de statuts
non seulement les prescriptions des magistrats infrieurs, mais aussi
celles des princes souverains et des peuples en majest, quelles soient
sanctionnes par disposition expresse ou quelles soient issues des murs
des usagers ou de la coutume, comme chez les Allemands, les Anglais, les
Franais, les Hollandais, les Ultrajectins et autres, en somme, les lois de
tous les peuples lexception du droit romain et du droit canonique, y
compris mme les jugements et dcrets pris par le juge et le magistrat
concernant les particuliers tels ceux qui dclarent la prodigalit ou
linfamie ou accordent lmancipation 108 ;
de mme son contemporain Ulrich HUBER qui ne veut connatre quune
seule rgle de conflit ou de comptence, celle qui dsigne lordre juridique
local, associe rgles et dcisions, lorsque mettant en place avec son
troisime axiome le mcanisme de la reconnaissance des droits acquis,
explique aprs avoir nonc son troisime axiome109 que
107
Art. 218, gl. 6, n. 4
Commentarius ad Pandectas, L. I, Tit. IV, De statutis, n.1
U. HUBER, De conflictu legum, prc., n. 2 : Les autorits des Etats, par courtoisie, font en sorte que les
lois de chaque peuple, aprs avoir t appliques dans les limites de son territoire, conservent leur effet
en tout lieu, sous la rserve que ni les autres Etats, ni leurs sujets n'en subissent aucune atteinte dans
leur pouvoir et dans leur droit .
108
109
110
tous les actes et oprations, judiciaires ou extra judiciaires, cause de
mort ou entre vifs, rgulirement passs selon la loi dun certain lieu, sont
valables mme l o prvaut une loi diffrente et o ils nauraient donc pas
t valables sils y avaient t passs [] 110.
Conformit matrielle au jus commune. - Ce principe de reconnaissance
mutuelle est toutefois amen se temprer chez BARTOLE lorsquil rencontre
la seconde fonction du jus commune, la fonction de rfrence matrielle.
Lopposabilit et la reconnaissance procdent formellement de la
distribution des comptences impute au jus commune ; mais celui-ci a son
mot dire aussi sur le plan matriel et, de fait, il est, comme on sait,
beaucoup plus dvelopp, beaucoup plus disert sur ce plan. Oprant sur le
mode vertical, en surplomb des jura propria, il nautorisera rayonner au
besoin hors de leur ordre juridique dorigine que les actions normatives
conformes ses orientations matrielles. Cest bien ainsi que BARTOLE
lentend lorsquil circonscrit laction du statut personnel qui serait la fois
prohibitif et odieux111. Sans entrer dans le labyrinthe bartolien, disons que
selon cet auteur, laction normative dune autorit locale ne peut
dvelopper ses effets chez les autres que sils sont tolrables du point de
vue de lquit et de la raison naturelle telles que les exprime lagrgat de
droit romain, vulgaire et savant, et de droit canonique constitutif du droit de
lEmpire. Un peu dagilit desprit suggrera ici une prfiguration de
lexception dordre public. Cette prfiguration, se prcisant avec le temps
a travers les sicles, porte dabord par BALDE puis par de moindres
disciples, elle sera reprise ensuite, par exemple au XVIe sicle, par DU
MOULIN qui pour les besoins de son enseignement en Allemagne se fait
bartoliste jusqu un certain point.
Il est ainsi amen professer en
premier lieu que
celui qui est pourvu dun tuteur ou dun curateur par le juge comptent
[est] entrav par cette tutelle ou curatelle lgard de nimporte lequel de
ses biens en nimporte quel lieu quil se trouve. Ceci ne procde pas
seulement de lautorit du seul statut, mais aussi de lautorit du droit
110
Eod. op., n. 3, et pour dautres application n.6 et n.12.
V. B. ANCEL et H. MUIR WATT, Du statut prohibitif (droit savant et tendances rgressives) , Mlanges
Bruno Oppetit, p. 7 et s.
111
111
commun qui, par le jeu de linterprtation passive de la loi, a effet
partout 112 ;
mais il ajoute aussitt, en deuxime lieu, que cette interprtation passive de
la loi ne joue pas pour les dispositions
qui sont carrment exorbitantes comme celle qui donne au tuteur le droit
de jouissance lgale qui sajoute au droit dadministrer les biens du pupille
ou du mineur. Un tel droit exorbitant ne stend pas au del des biens
situs dans le ressort du statut qui le confre, parce quil porte davantage
sur les choses et les biens quil nentre dans le gouvernement de la
personne, mme si le tuteur ou curateur a le soin de la personne. Cest
quayant le soutien du droit commun la protection de la personne stend
ainsi partout : au contraire, le droit de faire les fruits siens, parce quil est
rel, ne peut se porter hors du lieu o le statut laccorde113.
Et il a dj t relev que le troisime axiome de HUBER comportait la
rserve sopposant la reconnaissance des droits acquis ltranger que
ni les autres Etats, ni leur sujets nen subissent aucune atteinte dans leur
pouvoir et dans leur droit
En somme. - De sorte quau bout du compte il apparat quavec ce mode de
gestion vertical ou imprial,
a) la reconnaissance porte directement sur laction normative de la potestas
locale et par voie de consquence sur ses produits quelle que soit la
qualit de louvrier, juge ou particulier, ou mme le simple cours des
choses et donc sans que soit exige une quelconque cristallisation ;
b) la reconnaissance est subordonne,
- dune part, la comptence de la potestas et,
- dautre part, la conformit matrielle au jus commune, et
Peut-tre faut-il enfin, prciser que la reconnaissance ainsi obtenue
propos dun jugement tranger peut, lorsquelle est sollicite en justice
aux fins dexcution force, commander llaboration [dans lordre
requis] dun jugement dont le contenu et la porte sont calqus sur les siens
, par la voie dune action particulire, qui nest pas laction dexequatur
112
113
Conclusiones, p. 556
Ibidem
112
ne de la jurisprudence Parker114, mais la beaucoup plus vnrable actio
judicati, par laquelle le juge requis, saisi de la demande mme qui a t
juge ltranger, lappui de laquelle est produite la dcision trangre,
exerce un contrle de celle-ci et le cas chant en ordonne lexcution.
Mais, en principe, sauf contestation, aucune procdure nest ncessaire
pour la reconnaissance qui a pour effet seulement de laisser se dvelopper
dans lordre daccueil la situation telle que la fixe laction normative de
lordre comptent. Et cet effet de la reconnaissance nest nullement rserv
au cas du jugement tranger, il est le mme pour tout autre produit normatif
issu dun ordre juridique tranger.
2. Le mode de gestion horizontal
Ce mode de gestion horizontal de la diversit des systmes juridiques
fonctionne sur une hypothse diffrente puisque, dune part, celle-ci ne
comporte pas de structure impriale et, dautre part, le jus commune ny a
ni la mme consistance, ni le mme rle que ceux que lui prte le mode de
gestion vertical.
Coutume et droit commun coutumier. Pour trouver une ralisation simple
et peu prs pure de ce mode de gestion horizontal, il faudrait quitter
Prouse et BARTOLE pour franchir les Alpes et se diriger vers le conflit
intercoutumier tel que le configurait le Moyen ge dans le Royaume de
France.
Point de structure impriale, en effet, qui se chargerait dorienter, de diriger
et de contrler le dveloppement de la vie sociale de lensemble de la
chrtient ; le droit ne rside pas dans la loi, la volont du prince, ni dans le
statut dict par quelque potestas subordonne dlgataire dune parcelle
du pouvoir imprial ; le droit est dans la coutume laquelle chappe en
principe au pouvoir politique ; bien mieux, sauf exception, celui-ci doit
114
Cass. Civ., 19 avril 1819, Grands arrts, n2.
113
seffacer devant la coutume, les seigneurs et le roi par dessus eux doivent
respecter et garder la coutume , selon ce quobservait P. C. TIMBAL115.
Quant au jus commune, sans doute il est, dans sa version (pr)hexagonale,
un assemblage de droit romain et dlments de droit canonique les
matires denseignement dans les coles mais il salimente surtout au
droit coutumier et il vaudrait mieux pour viter toute confusion le
dnommer par les termes franais droit commun coutumier . Celui-ci se
spare clairement du jus commune en ce quil nexerce aucune influence
sur lapplicabilit de la coutume.
Matriellement, ce droit commun coutumier peut conduire lviction de la
mauvaise coutume 116, mais cette limination nest pas lie un
occasionnel conflit de coutumes, elle atteint en elle-mme toute coutume
dont la teneur lui est trop violemment contraire ; en dautres termes,
lexistence dun lment dextranit nest pas loccasion ncessaire de
lintervention du droit commun dans sa fonction de contrle matriel de la
teneur de la coutume, de son aequitas, de sa ratio ; au contraire, ce contrle
peut tre exerc hors le cas du rapport transfrontire117 .
Formellement, surtout et au rebours du jus commune, ce droit commun
ne soumet pas le conflit de coutumes laxiome tir de Cunctos populos :
statutum non ligat nisi subditos.
La prpondrance de llment rationnel. Pareille soumission, assez
malvenue dans le Royaume (qui naime pas le droit romain, droit de
lEmpire), contraindrait denvisager le problme du conflit de coutumes
sous langle de la comptence de la potestas locale. Sagissant de coutume,
lide de potestas locale serait une pure fiction puisque, par dfinition, la
115
P. C. TIMBAL, La coutume, source du droit priv franais, Cours de doctorat 1958-1959, p. 107, citant Ph.
de BEAUMANOIR, Coutume de Beauvaisis, n683 : Et si le cuens meismes les vouloit corrompre ou
souffrir quelles fussent corrompues, ne le devroit pas li rois souffrir, car il est tenus garder et fere
garder les coustumes de son roiaume , Pierre de FONTAINES, Conseil un ami, XXII, 32 et 33,
lordonnance de Philippe le Bel de 1302 sur la rformation du royaume (art. 4, ISAMBERT, T. II, p. 766),etc.
116
V. P.C. TIMBAL, op. cit., p. 110, p. 123, F. OLIVIER MARTIN, Le roi et les mauvaises coutumes , ZSS GA,
1938. 109, J.-M. CARBASSE, Philippe III et les mauvaises coutumes pnales de Gascogne , Hommage
Boulvert, 1986
117
Sensuit cette consquence que la censure de la mauvaise coutume ne se ramne pas la seule
impossibilit de linvoquer dans lordre juridique daccueil, mais conduit son abrogation ou sa
rformation
114
coutume ne procde pas dune potestas statuendi, dun pouvoir de lgifrer
non pas que celui-ci se dissolve dans le peuple, mais tout simplement
parce que elle nest pas impose par les pouvoirs publics, elle nest pas
louvrage dun acte de gouvernement, dun acte dune autorit suprieure,
elle est vcue et si lon peut dire vcue en bas et non reue den haut.
Parler ici daction et de comptence normative serait incongru ; il nest nul
besoin de se reprsenter un systme de distribution des comptences, qui
rglerait la concurrence entre pouvoirs lgifrant. La coutume est un
usage juridique oral, consacr par le temps et accept par la population
dun territoire dtermin118 . Elle est luvre des gouverns qui, sils nen
ont pas toujours eu linitiative, du moins la maintiennent en vigueur par un
consentement continu. Son effectivit se confond avec son autorit. En
somme, des deux lments qui sassocient pour constituer une norme
juridique, llment impratif, celui qui ordonne, qui prescrit, qui requiert
lobissance et llment rationnel, celui qui attache aux circonstances
considres une consquence proportionne, le premier est neutre, sans
relief, tant il parat absorb par le second.
Et cest cet lment rationnel qui seul importe dans le conflit de coutumes
parce que prcisment les coutumes se distinguent les unes des autres par
leurs contenus respectifs ; cest cette diffrence de teneur, cette variation
de llment rationnel, qui complique lexistence des individus lorsque
leurs intrts viennent se dvelopper simultanment dans deux ou
plusieurs collectivits coutumires : le divergence entre les rgles
coutumires est source dembarras et cest en cela quil y a conflit. Cest le
sort des sujets dobir aux rgles, mais encore faut-il savoir laquelle il
convient dobir. Toute la dimension du pouvoir, du commandement, et
partant de la comptence, qui nest que dlimitation du pouvoir de
commander, reste hors champ.
Aussi bien, la tonalit publiciste qui caractrise le mode de gestion vertical
fait ici dfaut. Du fait de la non-centralisation (plutt que dcentralisation)
118
P.C. TIMBAL, op. cit.,
115
de lordre juridique royal, le conflit de coutumes se place sur la ligne
privatiste o il sefforce darbitrer entre les coutumes au mieux des intrts
privs engags dans la relation transfrontire. Le mode de gestion
horizontal opre non pas den bas vers le haut - du rapport juridique
traiter vers la comptence de la loi ou de la coutume qui pourrait sen
charger - linverse du mode de gestion verticale qui oprait de haut en
bas - de la comptence de la loi ou de la coutume vers le rapport juridique ;
le mode de gestion horizontal opre en bas - au ras de la coutume.
Un choix localisateur. Le procd quil utilise pour surmonter la difficult
que reprsente, pour les intrts privs, la
pluralit des rgles aux
contenus diffrents appartenant des coutumes au contact desquelles se
dveloppe la relation, est celui du choix119. Ne pas choisir serait
dsastreux ; les parties seraient prises dans des Pflichtenkonflikte, conflits
dobissances ou autres dsagrments. Il faut donc pour chaque question
lire une coutume et exclure les autres.
Lobjectif prioritaire est alors la justice du choix, la justice de la dsignation
quon peut, sauf anachronisme, appeler justice conflictuelle.
Celle-ci demande dabord que le rgime qui sera impos ne constitue pas
un obstacle au dveloppement normal de la relation, cest--dire ne la
soumette pas des contraintes plus svres et plus nombreuses que celles
qui sappliquent aux relations internes ; cest ce que recherche le procd
des rgles de conflit de lois lorsque lisant une loi il exclut toutes les autres,
de sorte que, comme dans les hypothses purement internes, le sujet nest
tenu pour une mme question que par une seule rgle.
Cette justice conflictuelle veut ensuite que cette rgle de droit - qui est
destine servir de modle de conduite (future) avant de devenir un outil
de jugement (des conduites passes) - ne soit impose qu ceux qui sont
en mesure de la connatre avant dagir et ainsi de lobserver spontanment.
Cette requte daccessibilit la rgle conduit assez naturellement
119
V. supra n4
116
retenir un critre dapplication locale, qui est le vritable critre de
lintgration dans le cas de la coutume qui prcisment nait du sein dune
collectivit locale. Sans entrer plus avant dans le dtail des justifications,
disons dans un style plus contemporain que le choix se portera sur la loi qui,
eu gard la nature des intrts que la relation met aux prises, sera celle de
lordre juridique qui, de lavis des sujets comme de celui des tiers ou de tout
homme raisonnable, serait en raison des liens que la situation entretient avec
lui, le plus intensment affect si aucune solution ntait apporte et que ltat
de choses tait abandonn sa propre pente Dans la langue des
internationalprivatistes modernes, cette formule se ramne la notion de
localisation et au critre des liens les plus significatifs. Cette option
mthodologique qui, pour ainsi dire, met disposition du systme de conflit
lentier ventail des lois des pays et des coutumes des dtroits o la relation
se dveloppe, opre sur le plan horizontal sans prtendre tirer des choix
que celui-ci ralise des attributions de comptence normative. Toutes les
lois sont gales, toutes les coutumes sont gales120, lemportera celle que
dsignera le critre des liens les plus significatifs121.
Ceci correspond au paradigme conflictuel daujourdhui, mais ceci nous
vient du Moyen ge, sil faut en croire Jacques de REVIGNY (1296) lorsquil
prtend adosser ses thses lexprience jurisprudentielle spcialement
du Parlement de Paris. Il faut seulement relever cette particularit que les
liens les plus significatifs sont, pour lui et parce quil raisonne sur les
coutumes, dordre essentiellement territorial : locus contractus, locus delicti,
lex rei sitae, lex domicilii, etc. et chaque locus se dterminant en fonction
120
Egalit des coutumes en ce sens du moins que sur le immeubles situs Villeneuve et lgard des
Villeneuviens (il sagit de Villanova Regis, devenue Villeneuve-sur-Yonne et non de Villeneuve-sur-Lot
dont les habitants sont les Villeneuvois) la coutume de Villeneuve a la mme valeur et autorit que la
Coutume de Paris sur les immeubles situs Paris et lgard des Parisiens.
121
Au temps mdival, aucune prime la lex fori, qui nexiste pas dans la consistance qui lui est
aujourdhui donne et qui associe aux dispositions relatives la procdure, un jeu complet de rgles de
fond que naturellement le juge a quelque scrupule a carter en faveur dune loi trangre, mme si
celle-ci est dsigne par une rgle de conflit (cest toute la question du statut procdural de la rgle de
conflit et de son application doffice), alors que jadis elle se limitait ntre quun stilus curiae
fournissant les ordinatoria litis, et laissant les decisoria litis aux diverses coutumes touches par la cause ;
au demeurant, le ressort de chaque juridiction embrassait plusieurs dtroits coutumiers de sorte
quaucune des coutumes qui y avaient cours ne pouvait revendiquer la qualit de lex fori.
117
de la nature du rapport de droit ralise linscription de la situation dans la
coutume.
Rsistance du mode de gestion vertical sur le conflit de juridictions.
Elimin du champ du conflit de lois ou de coutumes, le mode de gestion
vertical ne disparat pas compltement ; il a son domaine rserv, dans
lequel la question de comptence est essentielle. Cest le domaine du
conflit de juridictions, ce que J. de REVIGNY discernait clairement trs bien
lorsquil abordait deux questions apparemment bien distinctes mais qui se
rejoignent cependant sur le thme de la coopration judiciaire.
La premire de ces deux questions est celle de lextradition, qui est cette
institution en vertu de laquelle le prvenu dune infraction qui est dtenu
par lautorit judiciaire du lieu de son arrestation est remis lautorit
judiciaire qui est comptente pour connatre du dlit et qui manifeste la
volont dexercer cette comptence. A lvidence, le mcanisme est
destin garantir le respect et donc la ralisation des rgles distribuant la
comptence entre les juridictions. J. de REVIGNY confre ce mcanisme un
caractre quasi-automatique : Ego dico quod remittendus sine causae
cognitione delicti122. Le fait que le juge saisi de la demande dextradition
doive sabstenir de connatre de la cause au fond rvle lexistence active
dun systme commun de rpartition de la potestas adjudicandi, aux termes
duquel il doit seffacer devant le juge comptent. Cest bien ainsi que
lentend le Parlement de Paris123.
La seconde question est celle de la reconnaissance et excution dans un
ressort des dcisions rendues dans un autre ressort. J. de REVIGNY est
catgorique : ds lors que le juge du lieu o lefficacit est demande est
saisi par lettres rogatoires du juge qui a prononc, il doit assurer la force
excutoire sans connaissance de cause : certe ego credo quod debeat ei
122
Ad authenticam Qua in provincia (C,3, 15, 2), repr. in MEIJERS, Etudes dhistoire du droit international
priv, p.167 ; il faut avoir prsent lesprit qu cette poque la matire dlictuelle est mixte, mi-pnale,
mi-civile.
123
V. MEIJERS, Etudes, op. cit. , p. 31 et s.
118
parere nec est suum cognoscere in civilibus124. Ce mode
dcisions qui prendra la forme du pareatis
125
daccueil des
prfigure celui que,
laborieusement, lchelle europenne mettra en place le Rglement
44/2001 du 22 dcembre 2000, dit Bruxelles I126 ; au Moyen ge et sous
lAncien Droit dans le Royaume, comme aujourdhui dans lUnion
europenne, il repose sur lexistence dun systme commun de distribution
des comptences, systme commun qui fonde (ou impose) la confiance
rciproque et, par suite, la reconnaissance mutuelle entre les juridictions.
Un mode de gestion royal. Il faut seulement ajouter ici que ce mode de
traitement vertical ne mrite plus lpithte imprial, mais bien lpithte
royal ; si le roi en France doit garder et fere tenir les coutumes du
pays 127, sil en est le simple conservateur, il occupe une tout autre position
lgard de la juridiction. Le Parlement est la curia regis, la cour du roi, et
cest bien lui, le roi, qui, en thorie, est fontaine de toute justice ; il ne
peut quapprouver et soutenir les efforts de son parlement pour exercer un
contrle troit sur les juridictions infrieures, quelles soient seigneuriales
ou urbaines128. La structure hirarchique, centralise, qui rgle lexercice
de la comptence normative en gnral dans le systme imprial se
retrouve dans le systme royal, mais limite la potestas adjudicandi.
Cela suffit pour que se retrouve ici dans lespace du Royaume cette facilit
de circulation assure par le mode de gestion vertical ou imprial, mais
naturellement, au seul bnfice de laction normative des juridictions, cest-dire des jugements lexclusion donc de laction normative des rgles
124
Ad legem Properandum sin autem (C, 3, 1, 13, 3), repr. in MEIJERS, op. cit., p. 126 ; Dans son cours
lAcadmie de droit international,
MEIJERS ( Lhistoire des principes fondamentaux du droit
international priv , Rec. cours La Haye, 1934, III, 547, spc. p. 632) observe que tous les auteurs de ce
temps reconnaissent ainsi quun jugement prononc dans un Etat peut tre excut dans un autre, soit
par suite de lettres rquisitoires du juge qui a prononc le jugement, soit par lintermdiaire dune
action nouvelle se fondant sur la sentence (NEUMEYER, p. 106, note 1, G. DURANT, Speculum, tit. De exec.
sent. nunc est dicendum in fine, BARTOLE, ad D. 42, 1, 15, 1 Sententiam) ; le second procd, celui de
lactio iudicati, est utilis en Italie (dans les pays de jus commune, v. A. MIELE, ), le premier, celui des
lettres rogatoires est sanctionn par le Parlement de Paris.
125
Ordonnance de Saint Germain en Laye de 1667, tit. 17, art. 6
126
V. Art. 41, 53 et 54 Rglement Bruxelles I, o les lettres rogatoires ou rquisitoires sont
devenues certificat .
127
P. de FONTAINES, op. cit. eod. Loc.
128
V. B. BASDEVANT-GAUDEMET et J. GAUDEMET, Introduction historique au droit - XIIIe-XXe sicles, 2e d. p.
123 et s.
119
de droit lesquelles relvent du mode de gestion horizontal. Ainsi, dun ct,
la reconnaissance pour la rception des jugements, de lautre le choix, la
rgle de conflit pour la rception de lacte ou du fait transfrontire .
Ce mode de gestion royal, dualiste, est celui qui domine encore aujourdhui
le droit international priv positif franais, faisant preuve dune continuit
admirable, quoique parfois bouscule rgulirement en doctrine qui
longtemps reste majoritairement statutiste, mais aussi en pratique
notamment au XIXe sicle sous linfluence combine de la codification et
dauteurs tels que Mancini, Pillet etc. Mais il faut aussi relever que la
frontire sparant les domaines respectifs du mode horizontal et du mode
vertical, du conflictualisme et du statutisme, manque tout le moins de
fermet. Il nest pas surprenant que le mode vertical, celui de la
reconnaissance des droits acquis ou du statutisme, sefforce de repousser
lautre, puisque prcisment il ne distingue pas entre les diffrentes formes
que revt laction normative et est prt rgir aussi bien le sort
international des rgles que celui des dcisions et, vrai dire, de tous les
actes et faits juridiques. De fait, il se manifeste trs tt et de manire
durable dans le champ que revendique le conflit de lois, avec le
phnomne des lois de police par exemple. Plus inattendues sont, en sens
contraires, les immixtions du conflit de lois dans le domaine du mode de
gestion vertical, spcialement de la reconnaissance des dcisions ; ainsi,
ouvertement jusqu larrt Cornelissen129, la rgularit internationale dun
jugement au regard de lordre juridique franais dpendait, entre autres,
de sa conformit au systme franais de conflits de lois : le juge tranger
devait avoir respect les rgles de conflit franaises et il nest pas avr
que cette intrusion soit dfinitivement condamne, car elle pourrait bien
encore tre observe de manire clandestine dans certains cas sous le
masque complaisant dune intervention de lordre public130. Toutefois,
129
Cass. 1re civ., 20 fvrier 2007, Rev. crit. 2007. 420 et la note, D. 2007. 1115, note L. dAvout et S. Bolle,
JDI 2007. 1195, note F.-X. Train, et B. ANCEL et H. MUIR WATT, in Mlanges H. Gaudemet-Tallon, p. 136 et s.
130
Trib. gr. inst. Paris, 26 novembre 2008, Rev. crit., 2009. 310 et la note
120
officiellement la rgle de conflit de lois a t refoule hors du champ de la
reconnaissance.
Cependant larrt Cornelissen qui rtablit la frontire entre les deux
mthodes est rcent. Lhistoire nest pas reste immobile sur les positions
du Parlement de Paris aux XIIIeXIVe sicles. Il serait certainement trs
fructueux de suivre pas pas lvolution depuis ces temps lointains. Mais,
naturellement cela suppose une exploration des archives du Parlement au
moins pour la priode des XIVe-XVe sicles, puis des recueils de
jurisprudence ensuite imprims. Ce serait un travail considrable et sans
doute disproportionn, qui supposerait le maniement et lanalyse
dinnombrables documents sans garantir pourtant une pche abondante et
statistiquement significative. Aussi bien renonant exhumer lhistoire
enfouie se contentera-t-on dun regard sur lhistoire rvle, ce qui conduit
examiner une affaire qui a connu une certaine notorit et qui a produit
diverses dcisions du Chtelet de Paris, du Parlement de Bordeaux et du
Parlement de Paris, le dernier mot revenant par la force de choses au
Chtelet. Cette affaire fera la transition avec la jurisprudence moderne qui
montrera aussi comment avec la thorie des droits acquis il fait exploitation
du mode de gestion vertical pour rsoudre ou tenter de rsoudre le
problme de linstitution exorbitante. Cest une tentation qui nest pas
franchement nouvelle quoiquelle se fasse aujourdhui trs pressante.
Laffaire Peixotto131 qui se droule la fin de lancien rgime offrira donc
ici le tremplin qui permettra de bondir au dessus des dix neuvime et
vingtime sicles pour arriver aux temps prsents. Elle a un caractre un
peu exceptionnel car il y va de la reconnaissance dun divorce non
judiciaire, dun divorce priv, par lordre juridique royal et, prcisment
cest la voie de la reconnaissance qui est emprunte pour assurer laccueil
dune institution qui lpoque en France pouvait tre qualifie exorbitante.
131
Sur le droulement de laffaire v. DENISART, Collection de dcisions nouvelles, 8e d. Paris, 1783-1789,
v Divorce, p. 567 et s. GUYOT, Rpertoire universel de jurisprudence, Paris 1781, v Divorce, MERLIN,
Rpertoire, 5e d. Bruxelles 1818, v Divorce, p. 143 et s., M. HUMBERT, Un divorce judaque devant la
juridiction royale : laffaire Samuel Pexotto-Sarah Mends dAcosta, Mlanges la mmoire de MarcelHenri Prvost, PUF, 1982, p. 307 et s. ; J. HUDAULT, Un divorce hbraque devant les juridictions du Roi
Trs Chrtien : laffaire Pexotto (1778), Hommage Romuald Szramkiewicz, Litec 199, p. 529 et s.
121
Il faut noter aussi au passage cette affaire apporte la preuve une nouvelle
fois de ce que les constructions intellectuelles comme ces idal typen que
constituent les deux modes de gestion de la diversit linstant voqus, se
ralisent rarement ltat pur dans lhistoire. Ce sont des recompositions
artificielles, des uvres de lesprit que la complexit del
sociale et
juridique se plait perturber. En loccurrence, il fallait une donne
exceptionnelle pour que la thorie des droits acquis, issue du mode de
gestion vertical, puisse semparer dune situation non judiciaire. Cette
donne consistait dans lexistence, vrai dire marginale, de deux ordres
juridiques au sein du Royaume comme sil y avait eu contamination du
modle imprial ; le roi avait admis que stablisse et perdure en France
ct de lordre juridique de droit commun un ordre juridique particulier,
propre aux rfugis juifs expulss de la Pninsule ibrique.
Originaire de Bordeaux o sa famille exerce le commerce de banque,
Samuel Pexotto de la nation juive et portugaise, na pas atteint lge de 21
ans lorsquil pouse le 3 mars 1762 Londres la synagogue portugaise
selon le rite hbraque, la demoiselle Sara Mends dAcosta, sensiblement
son ane.
Le mnage se fixe Bordeaux. Au bout de cinq annes de mariage et aprs
la naissance de trois enfants, Samuel ny tient plus, il plante l son pouse
et sinstalle Paris. Il lui faut cependant encore huit annes de rflexion
avant denvisager une mesure plus radicale. En 1775, il forme devant les
juges du Chtelet de Paris une demande dannulation de son mariage avec
Sara. Ngligeant le privilge de la nation portugaise et spcialement le
bnfice de lapplication du droit hbraque, le demandeur articule une
srie de griefs tirs du droit commun : minorit, sduction, dfaut de
consentement maternel, dfaut de lautorisation du roi ncessaire au
mariage des sujets franais ltranger, violation des rgles de publicit
etc. Le Chtelet avale tout cela par une sentence prononce par dfaut le
30 septembre 1775 : Mme Mends na pas comparu. Toutefois, la noncomparution de Sara nexprime nullement son assentiment la demande
dannulation ; au contraire, Sara conteste la comptence du Chtelet. Mais
cette contestation choue, le Parlement rgle la question de comptence
en faveur du Chtelet. Aussi Sara fait-elle appel de la sentence dannulation
du 30 dcembre 1775 et elle invoque devant la grandchambre la loi juive,
dont il est assez clair quelle lui donne raison.
Sans doute Samuel partage-t-il cet avis ; il est contraint de modifier sa
stratgie. Le voici donc qui exploite maintenant les facilits de la loi
mosaque quil avait dabord ddaignes : il adresse Sara un libelle de
rpudiation (gueth). Par arrt du 9 avril 1778, le Parlement enregistre son
122
dsistement de la procdure dannulation et laisse filer laffaire du divorce ;
celle-ci vient devant le Chtelet, Samuel demandant lexcution du gueth,
Sara rpliquant par une demande de sparation de corps. Dsormais, cest
donc le mari qui prend appui sur le droit hbraque tandis que la femme se
rfugie sous les lois du royaume ! Avec ce renversement des fronts, laffaire
prend une tournure encore plus intressante.
Il faut seulement rappeler ici que la position des Juifs de la Pninsule
rfugis en France et protgs du Roi volue par rapport lordre juridique
du Royaume non pas sur le plan territorial, mais sur le plan interpersonnel ;
le conflit de lois apparat lintrieur du royaume, cest un conflit interne
entre deux communauts obissant chacune un systme juridique
distinct ; il nimplique pas une relation transfrontire se dveloppant au
contact de deux coutumes locales, mais il met aux prises deux lois
personnelles. Cependant, ce changement de dimension naltre pas la
configuration du problme des droits acquis et de la reconnaissance des
institutions exorbitantes. Samuel Pexotto se prvaut dsormais de
lexercice dun droit acquis selon la loi de sa nation et entend en dduire
les effets dans lordre du droit commun lorsquil sollicite lapprobation et,
au besoin, le concours de la juridiction royale. De son ct, Sara Mends
dAcosta proteste que pareil divorce ne peut pas tre reconnu par la justice
du roi prcisment parce que ce mode de dissolution, le supposer admis
par la loi juive, serait odieux, ou dirait-on aujourdhui, contraire lordre
public ou au principe de lgalit des responsabilits des poux dans la
dissolution du lien conjugal
Le Chtelet statue le 10 mai 1779132 sans trancher dfinitivement ; il indique
seulement le cheminement quil convient de suivre pour parvenir au
rsultat souhait par Pexotto : il invite les poux se prsenter devant
deux rabbins qui mettront en uvre la procdure de dlivrance du gueth
(ou get) et dresseront procs-verbal de leurs diligences et du rsultat
auquel elles ont abouti. Sils constatent la dissolution du lien conjugal, ils
132
AN Y1664, DENISART, op. cit, p. 569, MERLIN, op. cit. p. 160-161
123
dposeront le procs-verbal et les pices quil y aurait eu lieu dtablir
selon la loi juive auprs dun notaire qui en tablira la minute et en
dlivrera une copie aux parties, lesquelles comparatront nouveau devant
le Chtelet, qui il appartiendra de statuer dfinitivement.
Autrement dit, la juridiction royale se dclare prte reconnatre
linstitution du gueth, lorsquelle est pratique entre personnes relevant de
la loi hbraque. Son caractre exorbitant par rapport la prohibition du
droit canonique qui constitue en la matire le droit commun du Royaume,
auquel sont assujettis mme les nouveaux convertis et autres Rforms,
nest pas en soi un obstacle ; cependant, cette rception dans lordre
juridique du Royaume gnralement impose par le rgime de protection
royale consenti la nation juive portugaise, comme une espce de libert
de circulation 133, peut par exception tre refuse si la rgle trangre
dont il sagit de reconnatre laction conduit un rsultat trop contraire la
police , cest--dire aux principes fondamentaux de bonne gouvernance
du corps social relevant de lautorit du Roi trs chrtien.
Le statut des Juifs dans le Royaume. Les commentateurs contemporains ne
manquent pas de souligner limportance de cette sentence sur le terrain de
lvolution de la condition des communauts isralites accueillies et
protges par le roi de France. Si grave que ft cette question, elle ne
prsentait sans doute pas le mme caractre durgence que celle
concernant ltat civil des Protestants : les Juifs pouvaient pratiquer leur
religion sans tre privs de leur tat civil ; cest bien ce que confirme la
sentence du Chtelet. Et si le Roi Louis XVI aura le temps de rgler par
lordonnance de novembre 1787 le sort des Rforms, il sera pris de vitesse
par les vnements et laissera la Constituante lhonneur de conclure ses
133
Selon MERLIN, op. cit., p. 155 : Henri II rgnait alors : il les accueillit avec bont et leur accorda des
lettres-patentes qui leur permirent dentrer dans le royaume, den sortir, daller et venir sans aucun
trouble ni empchement. Cet exemple a t suivi par les successeurs de Henri ; et de rgne en rgne ;
ces lettres patentes ont t renouveles avec lextension de pouvoir vivre selon leurs usages, et dfenses
de les y troubler, TANT EN JUGEMENT QUE DEHORS. Enfin, Louis XVI les a confirms dans leurs privilges ds
les premires annes de son rgne, et leur a accord de nouvelles lettres-patentes au mois de juin
1776
124
travaux et de faire accder par les dcrets de 1790-1791 les Juifs la peine
citoyennet franaise.
Mais au regard du problme de linstitution exorbitante et de son accueil
plus intressant est ici le mcanisme prescrit par les juges du Chtelet. Les
dmarches quil impose aux poux sont en ralit celles du droit
hbraque ; si elles sont suivies par les intresss avec intervention des
autorits religieuses de leur confession, elles pourront tre prises en
compte par lordre juridique royal qui tiendra pour acquise la situation ainsi
constitue. Trois observations doivent tre faites.
Condition de comptence . i) Il faut dabord remarquer l-dessus que cette
exigence de suivre le rite de la loi juive exprime simplement la condition de
comptence : les Juifs de la nation portugaise relvent personnellement de
lordre juridique hbraque en vertu des privilges qui leur sont confrs
par lettres patentes constamment renouveles depuis leur expulsion de la
Pninsule. Cest parce que le divorce sera acquis en conformit de lordre
juridique comptent quil deviendra opposable ou efficace dans le
Royaume, sans que linobservation des lois et procdure y ayant cours,
cest--dire en loccurrence des voies du droit canonique, puissent
autoriser la critique, puisque la comptence de lordre hbraque exclut ici
la comptence de lordre canonique (celui-ci na donc rien redire :
statututm non ligat nisi subditos).
Lexigence dacte notari. ii) Il faut noter galement quil convient de faire
la preuve, selon les exigences du droit commun, par acte notari, de
laccomplissement effectif des dmarches dictes par la loi juive et dont
lordre juridique royal impose lobservation en lespce. A proprement
parler, lintervention du notaire nest pas ici une cristallisation qui
dvoilerait la prise en charge de la dissolution du mariage par le droit
hbraque ; pareille cristallisation ne relve pas en principe du droit de
lordre requis, mais des autorits dont les diligences sont prvues et
organises par lordre dorigine. La minute est ici louvrage du notaire
royal et non pas, videmment des rabbins qui ne sont pas investis de
125
fonctions notariales dans le Royaume. Sil y a eu cristallisation, ce ne peut
tre que par la participation des rabbins la procdure de dlivrance du
gueth, si vraiment cette participation est exige par la loi juive et y est
reprsente comme rien de moins quune prconstitution de preuve
obligatoire. En somme, ce qui importe pour la mise en uvre de la
reconnaissance, cest que les conditions de lordre comptent, quelles
soient de fond ou de forme ( supposer que les unes soient dissociables des
autres), aient t respectes et que la preuve en soit rapporte.
La rserve de lordre public. iii) Il faut souligner ensuite derechef que la
reconnaissance de la dissolution de lunion, acquise de principe, ne pourra
cependant produire ses effets civils dans le Royaume que si le divorce sest
accompli selon des modalits non attentatoires aux valeurs fondamentales
de lordre juridique daccueil. Cest ce qui justifie ici que le Chtelet
impose une nouvelle comparution aux parties pour tre entendues en
personne, par quoi il se rserve le pouvoir de statuer dfinitivement, aprs
avoir vrifi la condition de conformit lordre public134. Il sagit bien de
lordre public, quil faudrait qualifier interpersonnel ou interconfessionnel,
comme on parle dordre public international ; il ne sagit pas dimposer les
rgles du droit canonique, qui nest pas applicable, comme cela ressort
aussi de la comptence que sattribue ici le tribunal du Chtelet, juridiction
civile et non pas juridiction ecclsiastique.
Comptence personnelle, conformit lordre public, cest bien le schma
constitutif du mode de gestion vertical qui se retrouve ici. Mais il se
retrouve au sein du Royaume, o il fait figure dexception.
Lexception statutiste. Cette exception procde de la concession et du
constant renouvellement des privilges des Juifs portugais. Il ne sagit pas
ici dun phnomne coutumier ; ces privilges, qui permettent cette
communaut de vivre selon ses lois et dans le respect des institutions de sa
religion sur le territoire du Royaume et donc sous lautorit et la protection
du Roi, sont des dispositions particulires crant dlibrment ct du
134
v. J. HUDAULT, art. prc.
126
droit commun une espce dordre juridique de deuxime rang et
exprimant un partage des comptences sur la base de lappartenance
confessionnelle. Selon ce mode de gestion vertical exerc par le souverain,
le systme de distribution des comptences emporte, comme indiqu plus
haut, limpratif de la reconnaissance de ce qui a t accompli dans les
limites de la comptence concde aux lois et autorits juives et il sera
permis de dire, si les poux Pexotto suivent les directives dgages par le
Chtelet135, quil y aura droit acquis ltranger tant entendu quici
lextranit sapprcie, non pas comme chez les Hollandais, sur une base
territoriale, mais sur une base personnelle. Cest cette extranit qui
maintient la communaut des Juifs portugais la lisire de lordre de droit
commun du Royaume136 qui explique que la contrarit de la dissolution
inter vivos du mariage aux prceptes du droit canonique nest pas juge en
elle-mme rdhibitoire, mme si, bien sr, reste active la rserve de
lordre public qui pourrait rprouver le caractre discrtionnaire de la
rpudiation137-138.
Ce quil faut retenir ici, cest que dans un systme de conflit en principe
dobdience conflictualiste, lexception statutiste peut se manifester en
diverses occasions pour faire triompher notamment les lois de police du
135
Lhistoire des poux Peixotto se drobe ici ; les dmarches prescrites par le Chtelet ne seront pas
entreprises, Sara Mends dAcosta dcdant avant quelles ne soient engages et cest donc une
dissolution mortis causa qui interviendra pour mettre un terme ce procs, sinon aux dmls
judiciaires de Samuel Peixotto, v. sur ce point M. HUMBERT, art. prc. p. 310
136
Les Juifs portugais sont-ils ou ne sont-ils pas rgnicoles ? V. M. HUMBERT ; op. cit., p. 314 et s.
137
Les circonstances voques la note 48 empcheront de faire fonctionner la rserve ; il aurait t
intressant de voir le dveloppement de la procdure fixe par le Chtelet cet gard, compte tenu,
dune part, du caractre unilatral et discrtionnaire de lacte de dissolution en la cause et aussi, dautre
part, du fait quavant le dcs de son pouse Samuel Pexotto tait pass en Espagne, sy tait fait
baptiser et avait prsent lvque de Siguenza requte pour faire dcider que sa conversion
emportait annulation de son mariage (v. M. HUMBERT, op. cit., eod loc.), de sorte quil aurait sans doute
t difficile au juge civil dadmettre quun divorce pt tre invoqu par un converti pour se librer dun
lien rgulirement constitu avant sa conversion (v. Parl. Paris 2 janvier 1758, Borach-Levy, A. N. X1A
7826, f328, v. DENISART, 8e d. prc. v Divorce, III, p. 569, cit par J. HUDAULT art. prc. p. 538, objectant
que la loi qui concerne lindissolubilit du lien a pour objet le bon ordre et le maintien de la
socit ).
138
Faut-il esquisser ici un parallle avec la jurisprudence que la Cour de cassation a inaugure le 17
fvrier 2004, propos des rpudiations unilatrales et masculines pratiques dans certains pays
dobdience coranique (arrts At Amer et Khireddine Rahmani, Rev. crit., 2004. 423, note P. Hammje, JDI
2004. 1200, note L. Gannag, Grands arrts, n64) ? Nayant pas leur disposition le Protocole nVII
additionnel la Convention europenne de sauvegarde les droits de lhomme et des liberts
fondamentales, le Chtelet et, au besoin, le Parlement aprs lui eussent certainement trouv quelque
moyen de refouler la rpudiation (ne serait-ce que du ct du caractre purement discrtionnaire)
Mais poursuivre sur ces suppositions, ce serait entrer dans le champ de la jurisprudence-fiction
127
for, alors appeles statuts prohibitifs139, et donc affirmer lantriorit de
lordre juridique du for mais aussi pour mnager dans lordre du for un
accueil aux institutions trangres exorbitantes, dont lexorbitance ne sera
juge quen aval de la reconnaissance par le moyen de lintervention de
lordre public. La comptence est le moteur de la reconnaissance, lordre
public en est le frein.
Inspirs de lhistoire ces propos ne sont pas dmentis par lactualit. En
effet, ce schma explicatif, cette thorie des droits acquis140 se retrouvent
aujourdhui mme sils connaissent de srieux inflchissements destins
les ajuster aux dsirs de lpoque, lesquels ne se contentent plus dtre
imprieux mais prtendent tre impratifs.
139
V. B. ANCEL et H. MUIR WATT, Du statut prohibitif (Droit savant et tendances rgressives , Etudes la
mmoire de B. Oppetit, p. 7 et s.
E. PATAUT, Le renouveau de la thorie des droits acquis, Trav. com. fr. DIP 2006-2008, p ; 71 et s.
140
128
Section 2 La jurisprudence moderne et la reconnaissance de
linstitution exorbitante.
Larticle 515-7-1du code civil. Des indices de persistance ou de rmanence
de la vieille thorie des droits acquis sont dabord fournis par certains
textes. Il faut naturellement citer ici un texte lgislatif, le nouvel article 5157-0-1 introduit dans le code civil par la loi du 12 mai 2009141. Certes, cette
disposition se prsente en la forme dune rgle de conflit de lois, mais,
dune part, cette prtendue rgle de conflit de lois dapparence bilatrale
classique a t conue expressment pour assurer la reconnaissance ou la
production deffets en France des partenariats enregistrs ltranger, si
loigns de notre pacte civil de solidarit (PACS) quils puissent tre, si
exorbitants quils soient ; lintention dment exprime au cours des travaux
parlementaires tait dnue dquivoque, en revanche il se peut que le
procd de ralisation choisi en soit charg. Dautre part, en retenant
comme facteur de rattachement le pays denregistrement cette disposition
se place directement dans le sillage de larticle 2 du projet de convention
n32 sur la reconnaissance des partenariats enregistrs de la Commission
internationale de ltat civil (CIEC) qui, quant lui, ne prtend pas noncer
autre chose quune rgle de reconnaissance, mme si certains gards
celle-ci nest pas indemne de toute interfrence du mode de gestion
horizontal.
Une catgorie ouverte. Larticle 515-7-1 ne donne aucune dfinition de ce
quest le partenariat enregistr dont il soccupe. Il nous dit que
les conditions de formation et les effets dun partenariat enregistr ainsi
que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions
matrielles de lEtat de lautorit qui a procd son enregistrement .
La formule est riche, notamment de difficults ; mais, dans sa gnrosit,
elle se garde dindiquer ce quil faut entendre par partenariat enregistr.
Sans doute est-ce quelquechose qui ressemble au PACS du code civil, mais
141
V. commentaires de P. HAMMJE, Rev. crit. 2009. 483 et s., P. CALLE, Defrnois, 2009. 1662
129
en juger par les expriences trangres, la ressemblance peut tre trs
limite, certains partenariats se rapprochant jusqu se confondre avec le
mariage, dautres au contraire ntant que des contrat effets rduits
apportant une organisation embryonnaire des rapports entre partenaires.
Sil tait bien question dnoncer une rgle de conflit, il naurait peut-tre
pas t superflu de prendre le risque que prend, alors mme quil sinscrit
dans une perspective de reconnaissance, larticle 1er du projet CIEC qui
dlimite le champ matriel dapplication de larticle 2 en prcisant qu
au sens de la prsente convention, un partenariat enregistr est un
engagement de vie commune entre deux personnes de mme sexe ou de
sexe diffrent, donnant lieu un enregistrement par une autorit publique,
lexclusion dun mariage
Dfinition sommaire, mais qui a au moins leffet dcarter tout ce qui est
mariage pour naccueillir que les pactes de vie commune rsultant dune
dclaration de volont reue par un officier public, une autorit la
consignant sur un registre. Une vie commune sans alliance, ni clbration
par lofficier public. Sans alliance, cest--dire sans cration dun lien
personnel fondant des droits et des devoirs rciproques tant personnels
que patrimoniaux aussi tendus que ceux que gnre le mariage ; sans
clbration, cest--dire sans que lordre juridique simplique par lun de
ses organes dans ltablissement de ce lien
En sabstenant de donner une dfinition, le lgislateur franais, pour sa
part, a sans doute jug dune part, que lenregistrement, la simple
consignation sur un registre, cette opration purement bureaucratique tait
un critre matriel appropri et que ce critre suffisait distinguer le
partenariat en ce quil ne correspondait pas une clbration, au cours de
laquelle lofficier de ltat civil joue un rle actif et doit dclarer les
comparants unis par le mariage ; dautre part, que lobjet du partenariat
ressortait du terme mme : engagement de vie commune. Il aurait t plus
simple de sortir de limplicite et dexprimer clairement et de faon moins
minimaliste quoi larticle 515-7-1 sappliquait, mais il se comprend que le
lgislateur nait pas pris ce risque dajouter des prcisions qui auraient pu
conduire liminer des figures de partenariat indites qui auraient dpass
130
les bornes de son imagination. Ce risque serait retomb sur les partenaires
ayant opt pour ces constructions exorbitantes en les privant de la
possibilit dexercer en France les droits quils taient censs en tirer.
Une catgorie vorace. Ceci tant, larticle 515-7-1 place sous lautorit de la
loi du lEtat de lenregistrement la totalit de laventure partenariale :
conditions de formation et effets du lien, conditions et effets de la
dissolution. Cest l faire preuve dune vaste ambition et ne pas reculer
devant les complications. Mais lide fondamentale est quil aurait t
draisonnable ou en tout cas inappropri de scinder conditions et effets
dun ct, et formation et dissolution de lautre. Ces lments sont traits
par les lgislations nationales de manire globale et solidaire : conditions
simples, effets rduits les prcautions ne simposent pas pour un maigre
profit (cest de lanalyse conomique du droit) ; conditions strictes, effets
importants ;
solennelle,
formation lourde et solennelle, dissolution lourde et
mais
formation
lgre,
dissolution
simplifie.
Ce
conditionnement mutuel nempche pas que, comme souvent avec les
institutions sans substrat naturel, chaque loi reste libre de se situer o il lui
convient sur lchelle de la rigueur ou du libralisme, de sorte que le droit
compar ouvre un large ventail la diversit : autant de lois, autant de
partenariats, tot leges, quot consortia, diraient les lettrs. De cette manire,
en vitant le morcellement de linstitution, sont prvenues les incohrences
qui rsulteraient de lapplication, dune part, dune loi svre aux
conditions de formation et, dautre part, dune loi avare de consquences
aux effets dun partenariat international ou encore de la dsignation, dun
ct, dune loi imposant un formalisme simplissime pour la cration du lien
et, de lautre ct, dune autre loi prodigue en solennits pour la
dissolution. Mais il est vrai que cela nempchera pas les difficults de
surgir en aval de la reconnaissance142.
Un rattachement flottant. En dotant larticle 515-7-1 dune catgorie
partenariat ample et peu prcise, le lgislateur lui donne la capacit
142
V. P. HAMMJE, art. prc. p. 488 et s.
131
dabsorber des institutions loignes de celle que consacre le code civil.
Mais cest plus encore par la dsignation de lordre juridique comptent
que cette capacit dabsorption se manifeste. Cet ordre juridique
comptent
est
celui
dont
les
agents
ont
ou
auront
procd
lenregistrement. Quil demande tre dfini par un pass compos (ont
procd) ou par un futur antrieur (auront procd), le rattachement opre
toujours a posteriori : cest lorsque lenregistrement sera consomm que le
rattachement se rvlera. Il faut que le droit li cette formalit soit acquis,
cest--dire que cette formalit soit accomplie pour quelle opre le
rattachement un ordre juridique, cette fameuse cristallisation dont parle
M. MAYER. Et ce rattachement qui sinscrit dans le temps et dans lespace
procde fondamentalement de la comptence de lautorit qui instrumente.
Un auto-rattachement. Ainsi, sous lapparence dune rgle de conflit
relevant du mode de gestion horizontal, mais dune rgle de conflit qui ne
dsigne une loi que par le truchement de lautorit qui la met en uvre, se
dissimule en ralit une rgle de reconnaissance ressortissant au mode de
gestion vertical : la dsignation de la loi de lEtat de lautorit ayant
enregistr, sans autre indication, nest pas dtermine par la rgle de
larticle 515-7-1 ; cette dsignation sen remet en ralit la comptence
que lEtat de lenregistrement attribue et est en droit dattribuer ses
propres autorits : est valable et reconnu tout partenariat qui, en quelque
pays que ce soit, aussi bien en France qu ltranger, a t enregistr par
une autorit dont la comptence daprs lordre qui la institue stendait
la situation des partenaires.
Ainsi un partenariat clbr aux Pays-Bas entre un sujet franais et un sujet
belge sera reconnu en France comme partenariat nerlandais sil a t
conclu conformment aux lois de lEtat denregistrement.
La particularit de cette rgle est que la comptence de lautorit est
dtermine par le droit de lEtat qui la confre. Ceci signifie que chaque
pays en labsence dun ordre imprial ou universel de distribution des
comptences est charg dassumer dsormais la dlimitation de sa
132
propre comptence et quen somme, toutes les rgles nationales de
comptence circonscrivant laction normative de chaque ordre juridique
sur le plan international sont galement lgitimes ; il sensuit que lexercice
que, par lintermdiaire de ses autorits, un ordre juridique fait de la
comptence quil soctroie doit tre respect ailleurs et que pareillement le
droit acquis en vertu de cet exercice doit tre reconnu internationalement.
Une application du mode de gestion vertical. Il pourra sembler certains
difficile ou inadquat de parler de mode de gestion vertical dans cette
hypothse : si chaque ordre juridique reoit sa comptence de lui-mme, il
ny a pas de systme commun de distribution des comptences. Il reste
cependant que ce jeu du couple comptence-reconnaissance du droit acquis
est domin par une ide laquelle est attache valeur universelle, un
principe commun, supra national, selon lequel toutes les rgles tablissant
dans et pour chaque Etat sa comptence internationale sont galement
bonnes et respectables.
i) Cest ce principe qui, aprs la disparition de lordre imprial, sous un
rgime pluraliste command par lide de souverainet, maintient un mode
de gestion vertical : cette notion de souverainet veut que la comptence
de chaque Etat soit entrine par tous les autres et donc, comme le montre
larticle 515-7-1, quelle le soit par le France ; ds lors, ce principe impose
la reconnaissance en France de ce qui a t rgulirement accompli
ltranger dans les limites de la comptence des autorits trangres. Le
mode de gestion vertical survit en sadaptant la nouvelle donne
gouvernant les rapports entre Etats.
ii) A quoi il faut ajouter que cette disposition du code civil ne peut
srieusement tre reprsente comme une rgle de conflit de lois
classique, bilatrale, oprant parmi les lois au contact desquelles se trouve
le partenariat un choix qui serait la fois lection de lune et exclusion de
toutes les autres. Bien au contraire, larticle 515-7-1 est prt saligner sur
nimporte quelle loi et, de la sorte, se drobe au choix. Or le choix est, on la
vu, caractristique du mode de gestion horizontal qui ne se rfre pas
133
llment impratif des rgles en prsence, qui est indiffrent au cercle des
destinataires desquels chacune entend obtenir obissance. Il ne considre
que la diversit de la teneur des rgles en concours et se dtermine en
fonction de la nature du rapport de droit que ces rgles soffrent rgir. Ce
nest videmment pas ce que fait larticle 515-7-1 qui en vrit ne choisit
aucune loi.
Consquences. Si deux Franais veulent conclure un partenariat moins
exigeant ou un partenariat plus riche en effets que celui du droit franais, il
leur suffit de trouver lordre juridique qui consent le leur accorder. Ainsi
en supposant que la Cacanie143 prvoit que ses agents peuvent enregistrer
un partenariat ds que les candidats ont rsid au moins quinze jours sur
son territoire, il suffira nos deux Franais souhaitant jouir du rgime
partenarial cacanien de profiter de leur congs pays, voire de leur RTT
pour conclure au terme et au prix dune brve villgiature le partenariat de
leurs vux. Il en sera ici comme autrefois des mariages de Gretna Green,
dont chacun se souvient quils taient conclus devant le forgeron du village,
surnomm Anvil Priest, aux conditions de la loi locale qui tait
particulirement librale envers les mineurs dont elle nexigeait pas quils
aient obtenu le consentement de leurs parents. Les jeunes gens domicilis
en Angleterre senfuyaient pour sceller leurs amours prcoces et
rprouves dans ce village dEcosse, juste de lautre ct de la frontire, o
ils obtenaient sans dlai et conformment au droit local la formalisation de
lunion quils nauraient pu conclure chez eux ; ceci fait, ils revenaient en
Angleterre o le mariage tait reconnu puisque rgulirement clbr
selon le droit cossais. Il fallut lgifrer pour combattre le dveloppement
de cette pratique frauduleuse. De fait une loi fut vote par la Parlement; ce
fut le Lord Hardwickes Act de 1753 rejetant le mariage purement
consensuel et exigeant des personnes domicilies en Angleterre la
publication des bans ou lobtention dune autorisation de justice et, de toute
faon, le consentement des parents pour les mineurs de 21 ans. Ces
143
R. MUSIL, Lhomme sans qualits, d. du Seuil
134
exigences contrecarraient, pensait-on, la solution traditionnelle admettant
la comptence des autorits et des lois du lieu de clbration de lunion.
Rien de tel pour discipliner nos candidats au partenariat ; sils dcouvrent
un Etat un peu complaisant, allouant gnreusement comptence ses
autorits, quils en profitent ds lors que leur est offert le service quils
rclament.
Cest dailleurs la crainte de tels comportements frauduleux qui a inspir
une disposition de larticle 7 du projet de la convention CIEC sur la
reconnaissance des partenariats enregistrs auquel renvoie larticle 2 cidessus mentionn. Cet article 7 numre les divers motifs pour lesquels un
Etat membre est autoris refuser la reconnaissance du partenariat
enregistr dans un autre Etat : endogamie, conjugalit plurielle, ge,
insanit desprit, toutes causes quil ntait pas mauvais de prciser
quoique elles eussent pu tre laisses dans lombre de lexception dordre
public ds lors que celle-ci figure aussi sur la liste des obstacles ; mais cette
liste ne comprend pas seulement des motifs de droit matriel, puisque, sans
souci des distinctions, le chiffre 5 de larticle 7 prvoit un motif proprement
conflictuel : la reconnaissance peut tre refuse lorsque
au moment de la dclaration de volont devant lautorit comptente,
aucun des deux partenaires ne se rattachait, par la nationalit ou la
rsidence habituelle lEtat du lieu de lenregistrement .
Rien de tel avec larticle 515-7-1 ; celui-ci accepte les comportements de
contournement, il saccommode du tourisme partenarial . Et se garde
bien de rintroduire dans son conomie une considration de proximit qui
serait impose par le droit franais des ordres juridiques trangers.
Entraves la mobilit des partenariats. i) Lordre public. Bien sr, cette
conscration de la fraude nexprime pas delle-mme une dfrence
absolue envers la valeur suprme que serait la flicit partenariale ; elle
nest offerte quautant quelle ne dbouche pas sur un rsultat
matriellement inacceptable pour lordre daccueil, pour lordre juridique
franais. Quoique larticle 515-7-1 ne formule pas la rserve de la
conformit lordre public, celle-ci nest pas limine ; tant une rserve
135
gnrale, il nest besoin den assortir expressment le libell de chaque
disposition de droit international priv. Ainsi ce serait sans doute peine
perdue pour la tante Julia rsidant habituellement en France avec son
neveu, Mario144, demmener celui-ci faire enregistrer une dclaration de
volont par lagent dun pays qui admettrait ce genre de combinaison. On
peut prvoir que lordre public international franais, accaparant alors
lide de proximit, ragirait et neutraliserait lopration.
Lordre public ne sera pas sollicit seulement pour apprcier la formation
dun partenariat tranger et en contrler la reconnaissance en France. Le
systme de la reconnaissance est ici en effet tendu aux effets du
partenariat comme dailleurs aux conditions et effets de la dissolution.
Cette apprhension globale permet limportation de linstitution trangre,
exorbitante, in toto. Cest ce que souhaitait le lgislateur de 2009, au
rebours des choix effectus ltranger qui
- tantt, la manire de Joseph BEALE le sicle dernier145, reconnaissent la
cration du droit ou la cration du lien effectue ltranger, mais ne lui
font produire au for que les effets que la loi interne du for attache ce
lien146 cest la solution anglaise aujourdhui ;
- tantt posent des limitations la reconnaissance par des moyens
juridiques diffrents, qui traduisent cette ncessit de retrouver une
communaut de droit minimale entre institutions afin quelles soient
reconnues en tant que partenariat enregistrs147 .
Larticle 515-7-1 rcuse ces restrictions. Lordre juridique franais semble
plus accueillant que les autres. Mais en ralit son libralisme envers
linstitution exorbitante trouvera sa limite, qui sera imprcise, fluctuante et
parfois imprvisible, avec lexception dordre public, incorporant lide
galement flottante de proximit.
144
M. VARGAS LLOSA, La ta Julia y el escribidor, 1977 ( : La tante Julia et le scribouillard, 1980)
J. BEALE, Treatise on the Conflict of Laws, 1935, 8A-9 et s.
146
Comp. art. 370-5 c. civ.
147
P. HAMMJE, art. prc. p. 489, o sont mentionns larticle 58 de la loi belge du 16 juillet 2004, larticle
2, 5 de la loi nerlandaise du 6 juillet 2004, larticle 17b, 4 EGBGB.
145
136
De nouveau, on le voit, la complaisance du mcanisme daccueil envers
linstitution exorbitante se paiera en aval, avec le filtre de lordre public.
ii) Le refus de coordination. Mais ce nest pas la seule limite qui tienne en
chec la reconnaissance en France dun partenariat enregistr ltranger.
Il en est une autre, tout fait incongrue, que pose larticle 515-7-1 lui-mme
lencontre de son dessein qui est, daprs les meilleurs commentateurs,
de rpondre aux objectifs mmes du droit international priv dans le
domaine de ltat des personnes [], mais galement aux exigences
communautaires imposant aujourdhui une reconnaissance facilite de ltat
des personnes, au nom de la libre circulation des personnes, voire de la
citoyennet europenne, et au ncessaire respect d la vie familiale des
individus tel quenvisag par la convention europenne des droits de
lhomme 148. En effet, ne bnficieront de la bienveillance de larticle 5157-1 que les partenariats obissant aux dispositions matrielles de lEtat de
lautorit qui a procd [leur] enregistrement . Or, dans lhypothse dun
partenariat conclu entre deux personnes de nationalit diffrente et/ou
domicilies
respectivement
en
des
pays
diffrent,
lEtat
du
lieu
denregistrement, face cette situation internationale, naura pas
ncessairement appliqu les dispositions matrielles de son droit ; le
rapport tant marqu dextranit, il aura fait jouer ses rgles de droit
international priv lesquelles auront pu bien conduire lapplication dune
loi qui nest pas la sienne. Dans ce cas, point de faveur et, vrai dire, point
de solution ; le bnfice de la reconnaissance est refus, mais larticle 5157-1 nindique pas ce quil faut faire de ce partenariat dont il nest pas exclu
quil soit rgulier partout ailleurs quen France.
Une singulire mprise. Cette erreur de vise sexplique par une
circonstance un peu dcourageante : le lgislateur est un mdiocre
internationalprivatiste ; il lavait dj montr en 1972 ou en 1975, il le
confirme en 2009. Il a cru cette fois que la reconnaissance des situations
constitues ltranger pouvait rsulter de laction dune rgle de conflit de
148
P. HAMMJE, art. prc. p. 484
137
lois classique. Et il a souhait que cette rgle de conflit de lois classique soit
la plus simple et la plus favorable possible linstitution. En consquence, il
a interdit que la dsignation de lordre denregistrement se prolonge par la
prise en compte des rgles du droit international priv de celui-ci ; ce
faisant, contrevenant au mode de gestion vertical, il refusait de saligner sur
le point de vue de lordre comptent, sur le point de vue de lordre de
lenregistrement, alors quil a cru ne faire autre chose que protger le
partenariat de la complication du renvoi sans doute aussi parce quil lui a
sembl quen lgitimant le tourisme partenarial, cest--dire le choix de
lordre denregistrement par les intresss eux-mmes, il seffaait devant
lautonomie des parties, avec laquelle, on le sait, le renvoi nest pas
compatible. Par cette bvue sur la nature de la rgle quil dictait, il na fait
que rtrcir le champ defficacit de celle-ci : ne seront reconnus en France
que
les
partenariats
conformes
au
droit
matriel
du
pays
de
lenregistrement, et seront laisss de ct, privs de libert de circulation,
privs de vie familiale normale, tous les partenariats dont le pays de
lenregistrement a exig quils respectent un droit matriel tranger
dsign par ses solutions de conflit.
Droits acquis et rejet du renvoi. La solution est surprenante. La liaison de la
doctrine des droits acquis avec le renvoi est avre149 ; cest un secret de
Polichinelle. Il est notoire par exemple que lun des griefs fondamentaux
dirigs contre la doctrine de J. BEALE, la doctrine des Vested Rights, tait
que lexclusion du renvoi quelle profrait150 conduisait tenir pour acquis
des droits qui ne ltaient pas, puisquon prtendait vrifier lacquisition de
ces droits ltranger en se rfrant une loi qui ntait pas celle qui leur
tait applicable selon le droit international priv du pays o ils taient
censs avoir t crs. A. V. DICEY stait bien gard de rcuser le
mcanisme du renvoi, bien au contraire il tait favorable au double renvoi
(Total Renvoi), la Foreign Law Theory151. Walter W. COOK152 ne manquera
149
V. FRANCESCAKIS, La thorie du renvoi, n152
J. BEALE, op. cit., 7-3, 58
151
A.V. DICEY, Conflict of Laws, 5e d., p. 66 et s.
152
W. W. COOK, The Logical and Legal Bases of the Conflict of Laws, 1942
150
138
pas de lancer lobjection lencontre de BEALE et de dnoncer
lincohrence quil y a dire quon reconnat les droits acquis ltranger
sans tenir compte de la position que lordre juridique tranger
effectivement sur cette acquisition. Manifestement le lgislateur franais na
frquent ni DICEY, ni COOK153.
Une option discriminatoire. Ou alors, et cest la seule justification quon
pourrait imaginer, le lgislateur franais en rservant la reconnaissance aux
seuls partenariats enregistrs ltranger qui sont conformes aux
dispositions matrielles du droit du pays denregistrement, a entendu
limiter son libralisme aux seuls cas de partenariat suffisamment intgrs
la vie sociale de ce pays pour que celui-ci y applique son propre droit
interne.
Cest l nanmoins une solution difficile justifier : on aurait mieux compris
cette prtendue exigence dintgration si sa mesure avait t fixe par
larticle 515-7-1, qui aurait demand, par exemple et linstar de larticle 7
n. 5 de la convention CIEC154, que les partenaires ou lun deux soient des
nationaux ou des rsidents habituels de lEtat denregistrement ; de cette
manire, la pratique du tourisme partenarial aurait t jugule. Mais ce
nest pas ce que fait larticle en question : il abandonne lexigence
dintgration lapprciation du pays de lenregistrement ; or cette
apprciation peut tre tout fait laxiste et saccommoder de toutes les
fraudes aux lois trangres on en revient Gretna Green et la Cacanie
voqus plus haut.
Dans ces conditions, lexclusion du renvoi par cet article 515-7-1 offre un
exemple rare de traitement discriminatoire ouvertement impos par la loi.
Le Franais qui contracte un partenariat dans un pays tranger qui prescrit
le respect de la loi franaise ne bnficiera pas de la reconnaissance tandis
que bnficiera de la reconnaissance le Franais qui contracte un
153
Lequel auteur ne rcusait que la construction intellectuelle chafaude par BEALE ; W. W. Cook
soutenant pour sa part que chaque Etat est dans son propre ordre juridique matre du sort quil convient
de rserver aux situations qui par certains de leurs lments sont au contact dEtats trangers, sans que
les ractions de ces derniers doivent commander lattitude du premier : Local Law Theory
154
V. supra.
139
partenariat dans un pays qui prvoit lapplication des dispositions
matrielles de son propre droit. Il est heureux que depuis larrt Jacques
Vabre, lexception dinconventionnalit soit recevable devant les tribunaux
franais et tende ainsi garantir le respect de la Convention de sauvegarde
des droits de lhomme et des liberts fondamentales et il faut aussi se
rjouir de linvention de la question prioritaire de constitutionnalit et de son
introduction en 2009 dans le droit franais ; souvrent ainsi des voies qui
pourraient bien un jour tre fatales larticle 515-7-1 du code civil
Mais il ne faut pas trop esprer. Il nest pas sr, en effet que la question
prioritaire de constitutionnalit ni lexception dinconventionnalit soient
jamais souleves ; cest que, assez gnralement, les ordres juridiques qui
connaissent le partenariat se proccupent surtout de dlimiter la
comptence
de
leurs
autorits
denregistrement
et
alignent
paresseusement la dtermination de la loi applicable sur leur choix de
comptence, se satisfaisant de la formule forge par NIBOYET : auctor regit
actum. Il sensuit que bien rares seront probablement les cas dans lesquels
le partenariat enregistr ltranger naura pas t conclu sous lempire de
la loi du pays de son enregistrement. Les occasions manqueront ainsi en fait
de soulever les questions de conformit aux traits ou la constitution.
Un ordre public tout faire. Cest donc essentiellement lordre public
quil incombera de contrler les reconnaissances de partenariats
exorbitants. Il est permis de le dplorer. Certes, il ne saurait tre
srieusement envisag de supprimer toute possibilit de refouler une
institution trangre attentatoire aux fondements de lordre juridique
franais. Mais le procd technique qui cette mission est confie nest pas
tout fait satisfaisant. Lexception dordre public nest quun pis aller ; elle
est larme ultime des impuissants et, comme telle, elle doit demeurer
exceptionnelle. Le mode dintervention de cette exception est trop
imprvisible, tributaire dapprciations despce qui sont, ici dans le
champ des droits acquis plus encore que dans le conflit de lois, opres a
posteriori, au mpris de toute scurit juridique. Ces apprciations dordre
matriel reposent sur de critres fluides exprimant des exigences par trop
140
gnrales et produisant des rsultats parfois peu prvisibles Ces
apprciations dordre matriel se combinent aujourdhui avec le paramtre
de la proximit (Inlandsbeziehung) qui nest en vrit quune ide vague,
une intuition qui se prte des emplois quivoques aggravant
lindtermination des solutions.
Si modeste soit-elle pour linstant, lexprience lgislative de la
reconnaissance des institutions exorbitantes nest pas encourageante. Sans
doute atteste-t-elle la capacit du procd favoriser laccueil dans le for
de situations constitues sur des modles exotiques. Mais sur ce terrain,
rien ne dit que les performances soient suprieures celles de la rgle de
conflit classique qui, elle, a dj dmontr son aptitude grer le mariage
polygamique, le lvirat, le maher ou le trust etc., et qui a aussi en appelant
son secours lexception dordre public rvl ses limites. Au demeurant, le
lgislateur on la vu, sy est tromp, ne parvenant pas distinguer une rgle
de reconnaissance dune rgle de conflit de lois bilatrale.
Il est temps den venir lexprience jurisprudentielle.
Jurisprudence. Un lment contemporain de cette exprience est offert
avec la question des maternits de substitution qui na sans doute pas encore
trouv sa solution, mais qui a dj donn lieu quelques dcisions. Il y a,
bien sr, laffaire Mennesson qui a donn lieu un arrt de la Cour de
cassation du 17 dcembre 2008, censurant une dcision un peu
complaisante de la Cour de Paris. Il y a aussi, en provenance dEspagne, la
rsolution de la Direction gnrale des Registres et du Notariat en date du
18 fvrier 2009.
Dans les deux cas, lordre juridique du for est confront une institution
trangre exorbitante dailleurs formellement prohibe par son droit
interne et, dans les deux cas il est confront une tentative de pntration
qui trouve ou voudrait trouver son vecteur dans un acte instrumentaire
public. La figure nest pas absolument indite ; elle avoisine celle de
laffaire Peixotto o le Chtelet avait exig un acte notari attestant
laccomplissement des formalits requises par la loi mosaque ; elle
141
avoisine aussi lhypothse du partenariat enregistr ltranger. Elle
ramne vers lide de cristallisation.
Affaire Mennesson. A vrai dire, il nest pas tout fait juste de dire que
cette affaire a confront lordre juridique franais au problme de la
maternit de substitution accomplie ltranger. Car, en fait, ce problme
a t pos de manire oblique ; les intresss, qui se sont trouvs tre les
dfendeurs dans la procdure, avaient pens pouvoir faire avaler par
lordre juridique franais linstitution exorbitante de la gestation pour
autrui par le simple effet de transcription sur les registres franais de ltat
civil des certificats et actes de naissance tablis en Californie et imputant
lgalement la maternit la femme commettante ou commanditaire
de lopratrice ou gestatrice amricaine. Cest donc sous langle
bureaucratique, celui des critures, des registres que la rsistance du droit
franais est prouve et non pas directement au fond. Voici les
circonstances qui sont au dpart de laffaire.
Maris depuis plusieurs annes, Dominique et Sylvie Mennesson, de
nationalit franaise, savent quen raison de quelque dficience de
lpouse, ils ne pourront jamais avoir denfant. Ils dcident dutiliser les
facilits que les sciences mdicales, le droit californien et certaines
femmes amricaines peuvent offrir. Se rendant en Californie, ils sont mis en
contact avec une dame Mary Ellen Floyd, qui se porte volontaire pour
suppler Sylvie dans la fonction de gestatrice, dans le respect des lois et
procdures californiennes. Les poux Mennesson obtiennent ainsi le 14
juillet 2000 une dcision de la Cour suprme de Californie leur confrant
la qualit de pre et mre des enfants natre ports par Mary Ellen Floyd,
la gestatrice, depuis mars 2000, conformment la loi de lEtat de
Californie qui autorise, sous contrle judiciaire, la procdure de gestation
pour autrui aux termes du Family Act Section 7630 et 7650, sous protocole
mdical par recours une fcondation in vitro avec gamtes de Dominique
Mennesson et Mary Ellen Floyd et gestation par cette dernire . Le 25
octobre 2000, - Valentina, La, Dsire et Fiorella, Pearl, Isadora, deux
jumelles, naissent La Mesa, comt de San Diego o sont tablis des
142
certificats et actes de naissance dsignant Dominique et Sylvie comme
leurs parents et comportant certaines indications confidentielles assorties
de la mention non divulgu .
Mais, quoique tout fait rguliers au regard de lordre juridique amricain,
ces documents qui expriment aux yeux des poux Mennesson leur qualit
de pre et mre des jumelles suscitent une forte perplexit chez le Consul
de France Los Angeles. Sollicit de procder la transcription des actes
californiens, celui-ci croit devoir consulter le Service central de ltat civil
du Ministre des Affaires trangres Nantes, lequel en rponse fait
procder la transcription. La transcription est ainsi opre sur les
registres de ltat civil, mais non pas pour complaire aux poux Mennesson
et leur permettre de tirer en France toutes les consquences qui sont
attaches la qualit de parents atteste par les documents ; au contraire,
dans lesprit du ministre public, la transcription est effectue aux fins de
permettre au procureur de la Rpublique de leur domicile den demander
lannulation et ainsi de neutraliser dans lordre juridique franais les actes
de ltat civil tablissant la filiation des jumelles. Cependant, par jugement
du 13 dcembre 2005, le tribunal de grande instance de Crteil dclare le
ministre public irrecevable en sa demande dannulation de la
transcription, sur les registres de ltat civil de Nantes, des actes de
naissance de Valentina et Fiorella . Le ministre public fait appel. Il
appuie son recours sur les articles 423 du code de procdure civile et 16-7
du code civil ; la premire de ces dispositions donne au ministre public le
droit dagir pour la dfense de lordre public loccasion de faits ports
sa connaissance tandis que la seconde, en nonant que toute convention
portant sur la procration ou la gestation pour le compte dautrui est
nulle , exprimerait une valeur fondamentale de lordre juridique
franais(art. 16-9), constitutive dune exigence dordre public international.
Lacte-cran. Le 25 octobre 2007, la Cour de Paris confirme le jugement
aux motifs que
1) il ny a rien de contraire lordre public transcrire sur les registres de
Nantes des actes rgulirement dresss aux Etats-Unis en conformit dun
143
jugement dont la rgularit nest pas conteste. Ces actes dont ni
lopposabilit, ni la force probante au regard de larticle 47 du code civil
ne sont en cause sont exacts et sincres ; garantie par la signature de
lautorit publique trangre, leur fiabilit justifie quils fassent lobjet
dune transcription sur les registres franais destins faciliter leur
utilisation dans la machinerie juridico-bureaucratique franaise ;
2) la non-transcription des actes serait contraire lintrt suprieur des
enfants qui, au regard du droit franais, se verraient priver (sic) dactes
dtat civil indiquant leur lien de filiation, y compris lgard de leur pre
biologique155 .
Ce second lment de la motivation est rvlateur de la drive
intellectuelle qui peut porter les juristes daujourdhui se fourvoyer. Cet
lment dnonce un risque de situation boiteuse ; les jumelles sont les
filles de Dominique et Sylvie aux Etats-Unis, elles ne sont pas les filles de
Dominique et Sylvie en France. Lunit et la continuit de leur statut
personnel serait compromise par une annulation de la transcription, avec
toutes les consquences pratiques qui sensuivent156, sans oublier
naturellement les discriminations etc157. Cest dire que la transcription en
imposant la reprsentation toute paperassire et bureaucratique des
rapports entre les enfants et les poux Menesson, devient pour ceux-ci
155
Paris, 25 octobre 2007, D. 2007. AJ. 2953, obs. F. Luxembourg, JDI, 2008. 145, note G. Cuniberti, Gaz
Pal, 2008. 20, note G. de Geouffre de La Pradelle, Defrnois 2008. , n38717, obs. Chendeb,
156
P. LAGARDE, note prcite p. 325 : Les parents de lenfant ne peuvent plus invoquer en France les
actes de naissance tablis ltranger. Lenfant est priv en France de filiation maternelle et peut-tre
aussi de filiation paternelle, comme lindique larrt cass de la Cour dappel de Paris. Cest en effet la
transcription de lacte de naissance dans son ensemble, indiquant les filiations maternelle et paternelle,
qui est annul. Si les parents ne sont pas maris, le pre pourrait certes reconnatre lenfant. Sils sont
maris, le pre le pourrait galement, thoriquement, reconnatre lenfant comme adultrin et n de la
mre porteuse, mais ce serait contraire la ralit psychologique et sociale, et mme la vrit
juridique, car il ny a pas dacte de ltat civil tablissant la maternit de la mre porteuse . Au pluriel, il
aurait t plus exact de parler des commanditaires et non des parents de lenfant , puisquen
lespce lpouse du pre nest en rien la mre de lenfant. Il aurait t aussi plus juste de concder
quen aucun cas lenfant nest priv de filiation, il est seulement priv de la facult dinvoquer des
instrumenta travestissant la ralit de sa filiation. Enfin, il aurait t plus franc de reconnatre que le
commanditaire qui se trouvait tre le pre biologique avait la facult dtablir volontairement sa
paternit tandis que la sous-traitante, mre de substitution, dont la maternit ntait pas constate dans
les actes de ltat civil ntait pas dans une situation plus dramatique que celle de la mre qui en France
a accouch sous X et na pas reconnu lenfant.
157
V. H. MUIR WATT, European Federalism and the New Unilatralism, 82 Tulane L. Rev., 1983 (2008), p.
1991 s.
144
constitutive de la ralit juridique en France. Lenveloppe formelle tient
lieu de ralit substantielle.
La Cour de Paris labore ainsi une thorie de lacte-cran158 o la
rgularit formelle de lacte public
- non seulement interdit de sinquiter de la correspondance de ses
nonciations avec la situation substantielle rsultant de lapplication des
rgles de fond et dont il est cens consigner lexistence et les caractres,
- mais encore oblige insrer dans la machinerie juridico-bureaucratique
les lments renferms dans le document159.
Cest bien cette thorie que larrt retient aussi dans son premier motif :
formellement rgulier, lacte de naissance tranger doit tre rput
exprimer la ralit substantielle. Manifestement, la Cour de Paris prsente
le syndrome des vrais faux-papiers dont on pouvait croire jusqu prsent
quil affectait, outre quelques prvenus en cavale , les immigrants
clandestins et les bnvoles solidaires : si le document produit, aussi
mensonger soit-il, a toutes les apparences du document officiel, sa
rgularit externe rend indiscutables les qualits quil atteste et convertit
en comportement dloyal tout contrle qui serait exerc linitiative de la
partie qui on loppose. A beau mentir qui vient de loin
Equivoque. Mais cette thorie de lacte-cran repose, on le souponne, sur
une quivoque.
Cest quil faudrait pouvoir distinguer plusieurs problmes dont on peut
comprendre que larticle 423 du code de procdure civile ou mme les
rgles relatives la transcription des actes de ltat civil aient entrain la
confusion.
158
V. L. dAVOUT, note prc. : l existence dun acte public ou dune dcision de justice trangre ne
font pas cran au conflit de lois prexistant ; les actes attribuables une autorit publique, au lieu
dteindre en toute circonstance le conflit de lois, ne font parfois que le raviver
159
Ce nest pas la premire fois que la Cour de Paris sautorise mettre en uvre cette thorie du
mensonge ; v. Paris, 11 juin 1994, 0smar B. alias Jessica, Rev. crit., 1995. 308, note Y. Lequette.
145
Le premier problme est celui de la transcription, qui est une opration
confie lofficier de ltat civil et qui consiste reporter sur le registre de
ltat civil quil administre un acte de ltat civil reu ailleurs (ou une
dcision judiciaire). En loccurrence, lofficier de ltat civil sollicit de
transcrire tait le Consul de France Los Angeles et les actes transcrire
taient constitus par le jugement et les certificats de naissance dresss
San Diego par lautorit locale.
En principe, lofficier de ltat civil consulaire ne peut refuser de prter son
concours. Nanmoins, dans certains cas dlimits, il lui est permis de
repousser la demande ; certains de ces cas ne demandent pas dexplication
et ne font pas difficult, mais il en est un qui est propre alimenter
lquivoque. Les premiers de ces cas adviennent :
- Si lacte dont la copie intgrale doit tre prsente est formellement
irrgulier, ce qui sapprcie selon la loi trangre de lautorit qui la
tabli. Il faut naturellement que lirrgularit soit flagrante de manire
apparatre au premier regard de lofficier de ltat civil consulaire ;
- Si les lments en la possession de lofficier de ltat civil consulaire
permettent dtablir la fausset de lacte ;
- Si lacte prsent ne correspond pas ce qui en droit franais est un acte
de ltat civil160 ;
- Si lacte prsent comporte des informations dont les comparants
demandent
la
transcription mais
dont
la
loi
franaise
relative
lorganisation de ltat civil ne permet pas la consignation sur les registres :
seuls les lments retenus par la loi franaise sont susceptibles dtre
transcrits ;
En ralit, les hypothses ici numres relvent de la bonne gestion
administrative voir mme bureaucratique du service : lagent nest pas tenu
160
V. Civ. 1re, 14 juin 1983, Suhami, Rev. crit. 1984. 316 et la note : lacte de ltat civil est un crit dans
lequel lautorit constate, dune manire authentique, un vnement dont dpend ltat dune ou de
plusieurs personnes
146
et doit mme refuser daccorder autre chose, un aliud, que ce quil est
habilit accorder.
Le dernier cas auquel le ministre public a choisi de nous intresser est
celui o lacte tranger tel quil se prsente est contraire au droit franais :
ce serait le cas de lacte de naissance qui serait tabli par lautorit
trangre en application dun jugement dadoption au profit de parents
franais161 (IGEC, n. 510) ; ou encore, doit-on se demander, un acte de
naissance dont la copie intgrale rvlerait comme en la cause une
maternit de substitution, cest--dire une convention de mre porteuse et
une absence de maternit biologique ou utrine du chef de la personne
qui la filiation maternelle est impute dans lacte ? Cest ici la difficult
rencontre Los Angeles o les actes californiens taient formellement
rguliers et navaient rien de mensonger mais dont les mentions recueillies
par la transcription, par le tri dont elles auraient fait lobjet, auraient tu le
caractre artificiel et en lespce illicite de la filiation quils auraient
affiche ; cest ce qui a incit le consul solliciter les instructions du
procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance de Nantes.
Dans de tels cas, il semble que le parquet de Nantes peut dcider la
transcription aux fins dannulation ; ceci se fait par exemple en matire de
mariage lorsquune cause de nullit le justifie. Mais cette possibilit
daction en matire de mariage est dirige contre le negotium ; cest la
validit du mariage au fond qui est conteste, la confection de
linstrumentum ayant seulement permis dalerter le ministre public, lui
indiquant quil y avait sans doute anguille sous roche et partant ncessit
dclaircir la situation. Il est en effet prfrable de ne pas publier une
information qui scarte de vrit juridique Pour cela, le parquet
demande lapprciation de la validit du mariage et si la rponse est
ngative, la transcription tombe par voie de consquence.
161
Cass. civ., 1re, 18 juillet 2000, Wallon, Rev. crit. 2001. 349, note H. Muir Watt : cest en principe le
jugement tranger qui doit tre transcrit et non lacte de ltat civil dress en application de celui-ci ;
par aillerus lacte de ltat civil tranger reconstitu en vertu du jugement dadoption prononc
ltranger indiquait un lieu de naissance fictif.
147
En dehors des cas spcifis par la loi (art. 422 c. pr. civ.), le ministre
public peut agir pour la dfense de lordre public loccasion des faits qui
portent atteinte celui-ci (art. 423). Cest cette voie de droit ouverte au
parquet qui complique ici sensiblement les choses dans la mesure o elle
est exerce non pas en vue de faire dclarer la nullit de la filiation, mais
dobtenir directement et exclusivement lannulation de la transcription.
Lacte de ltat civil est un instrumentum qui a pour fonction de consigner et
conserver en vue dune exploitation probatoire divers vnements
dterminant ltat dune personne. Dress ltranger par une autorit
habilite, il fait foi en vertu de larticle 47 du code civil et accrdite en
France ltat quil constate. Mais pour la commodit de celui qui veut
lutiliser, il est souhaitable de procder sa transcription sur les registres
franais de ltat civil ; cela vitera davoir traverser lAtlantique et le
continent nord-amricain pour, chaque fois que ce sera ncessaire ici, se
procurer une copie ou un extrait dlivr San Diego. La transcription
tablit domicile une copie permanente et authentique. En loccurrence, le
parquet demande lannulation de la transcription. Celle-ci peut tre
irrgulire en tant quinstrumentum, mais ce nest pas cela qui est ici vis.
Ce nest mme pas non plus lacte tranger originaire, en tant
quinstrumentum ; ce qui est vis ici, cest ce que cet acte consigne et ce
que la transcription introduira dans le registre franais sans rvler
nanmoins le caractre particulier et mme illicite au regard du droit
franais de cette imputation de filiation maternelle. Au fond, le ministre
public refuse que la transcription serve dcran. Il ne dirige pas son attaque
contre la filiation ni contre la gestation pour autrui en tant que telles, mais
seulement contre la tromperie qui rsulterait de laffichage aux normes
franaises de la situation cre en Californie. Il allgue ainsi une
incompatibilit entre le droit franais de ltat civil et les oprations
conduites aux Etats-Unis. Pas seulement sous langle de l opportunit ,
mais aussi sous langle technique comme disait NIBOYET, la convention
de mre-porteuse ou la maternit de substitution apparat bien exorbitante.
Le ministre public forme donc un pourvoi.
148
La censure de la Cour de cassation. Dans son pourvoi, le ministre public
ritre sa position : son action est recevable parce que les actes
californiens rvlent et entrinent une filiation rsultant dun ensemble de
faits contraires lordre public international franais. Linstrumentum ne
blanchit pas le negotium. Cest ce que rappelait dans une affaire trs
semblable la Cour de Rennes le 4 juillet 2002 nonant que la rgularit
des actes trangers
ne fait pas obstacle laction de ministre public puisquil [art. 47 c. civ.] vise
lacte instrumentaire lui-mme qui fait foi de ses seules constatations matrielles,
mais ne concerne nullement les questions dtat
La Cour de cassation accueille le pourvoi et, ce faisant, condamne la
thorie de lacte-cran. Sans se prononcer sur la valeur en France de la
situation au fond qui sest constitue aux Etats-Unis, elle admet avec le
parquet que les actes de ltat civil californiens sont insusceptibles de
transcription, si du moins les circonstances quils rsument et concluent
sont avres mais il ne lui appartient pas de statuer sur cette question de
vracit ; laquelle, dailleurs, nest pas une question en labsence de
dsaccord entre les parties sur ce point, les faits de la cause devant ds
lors tre tenus pour constants, de sorte quils simposent au juge du fond
comme au juge de cassation. La seule question que vide ici laccueil du
pourvoi est celle qui tait pose, celle de la recevabilit de laction en
annulation des transcriptions.
La question du bien-fond de la demande du ministre public reste entire
sur le plan procdural aprs la cassation de larrt de Paris. Nanmoins,
ds lors quen vertu de larticle 423 du code de procdure civile, laction
nest ouverte au parquet que si lordre public est engag dans laffaire, ne
faut-il pas admettre que la dclaration de recevabilit manant de la Cour
de cassation repose sur lassertion que les actes amricains consacraient
une convention portant sur la gestation pour autrui constitutive dune
violation de lordre public justifiant laction du ministre public ? Dans ces
conditions, il est permis de sinterroger avec Mme A. MIRKOVIC162 sur la
162
Note prc.
149
porte de la cassation obtenue de cette manire sur la recevabilit : que
reste-t-il juger pour la cour de renvoi ? Sil est acquis que les lments
recueillis dans les actes consommaient une atteinte lordre public, la cour
de renvoi, sauf rbellion, na plus qu juger que ces actes ne sont pas
susceptibles de transcription en France et que par consquent ils doivent
tre annuls. Cest quen interprtant larticle larticle 423 c. pr. civ., la
Cour de cassation, sans prononcer elle-mme sur le bien fond de la
demande dannulation, alors quelle se rfre la violation de lordre
public sur la base de faits que personne ne conteste, laisse la dcision au
fond la cour de renvoi, mais habilite et encourage celle-ci dpasser la
reprsentation pure que la transcription, slective, donne de la situation
et rechercher les composantes de celles-ci au de l mme des actes de
ltat civil
Retour la Cour de Paris. Cest dans ces conditions que laffaire fait retour
devant la cour dappel de Paris autrement compose. Le ministre public
appelant du jugement de Crteil, demande, dune part, que son action soit
dclare recevable pour quoi il a lappui de larrt de cassation et,
dautre part, que soit prononce lannulation de la transcription des actes
de naissance. Ceux-ci ont t dresss en excution de la dcision de la
Cour suprieure de lEtat de Californie du 14 juillet 2000 et, soutient-il,
forment avec elle un ensemble indissociable ; la transcription donnerait
effet au tout en France. Or, il se trouve quau principe de ces oprations il y
a une gestation pour autrui qui contrevient lordre public (art. 16-7 et 16-9
c. civ.) et qui va prosprer en France labri de la transcription. La
transcription nest pas faite pour servir de couverture aux violations de
lordre public.
Les poux Mennesson voient plus grand et formulent en rponse toute une
srie de demandes. Certaines ne sont en ralit que des arguments
dambiance, destins exercer une sorte de pression morale sur la cour
dappel ; cela justifie moins les honoraires que la demande dhonoraires
Cest ainsi quest sollicit un sursis statuer au prtexte que le lgislateur
150
sest saisi du problme des maternits de substitution, cest ainsi quest
demande que soit dclare recevable lintervention volontaire des poux
Mennesson (comme si celle-ci tait conteste), cest ainsi quest invoqu
lestoppel stigmatisant la dloyaut du parquet qui ordonne la transcription
pour en demander lannulation, quest dnonce une violation du principe
de lgalit des armes (la dpendance organique du parquet lgard du
ministre de la justice en fait lexcuteur des basses-uvres de lexcutif)
etc. Tout cela est insignifiant.
En revanche, dautres moyens sont plus intressants, sinon mieux fonds.
Ils intressent par cela quils persistent dans une stratgie fidle la
thorie de lacte-cran, stratgie qui ne peut atteindre quindirectement la
question de lannulation des transcriptions, en consquence de la
lgitimit, peut-on dire aujourdhui, de la filiation affirme. Ils consistent
dire que la filiation existe bel et bien, quelle est parfaitement rgulire et
que partant les actes qui la constatent, eux-mmes rguliers, doivent tre
transcrits. En somme, le fait que les autorits californiennes, judiciaires ou
administratives, aient agi dans les limites de leur comptence en autorisant
la production et lacquisition des enfants rend par l-mme cette action
normative trangre opposable tous et y compris lordre juridique
franais.
Les intims soutiennent alors assez logiquement que le ministre public ne
saurait contester la rgularit des oprations menes sur le territoire
amricain, ds lors que dans ses conclusions antrieures devant les juges
du fond, il avait reconnu cette rgularit ; il y a l-dessus un accord
procdural qui lie le parquet et le contraint reconnatre la maternit
impute Mme Mennesson.
Et ils ajoutent que la possession dtat conforme un acte de naissance
rgulier rend incontestable la filiation (art. 333, c. civ., art. 311-15, c. civ.)
et enfin que la contestation de celle-ci par le parquet est contraire
lintrt suprieur des enfants.
151
Non seulement, la reconnaissance de la filiation amricaine est lgitime,
mais encore elle est opportune.
Larrt du 18 mars 2010. Dans lensemble la Cour de Paris accueille les
demandes du ministre public et rejette celles des poux Mennesson.
Sur la recevabilit de laction du parquet, la cour se place dans le sillage
de la Cour de cassation. Elle nprouve pas davantage de difficult se
dbarrasser des arguments dambiance, stigmatisant un acharnement aussi
dloyal quintempestif du ministre public, mais inoprant en ltat de
linterprtation de larticle 423 retenue par la Cour de cassation et daprs
laquelle le parquet na fait quuser de pouvoirs qui lui sont dvolus pour
accomplir sa mission.
Mais cest sur la question de lannulation quelle tait attendue. L dessus
elle refuse son tour de suivre les poux Mennesson et de sengager sur le
terrain de la rgularit au fond du lien de filiation tabli aux Etats-Unis :
hors sujet, dcrte-t-elle :
Laction du ministre public ne vise pas contester ltat des enfants, mais
carter les effets en France de leur tat civil tabli aux Etats Unis
Ds lors, la validit de limputation de la filiation maternelle la mre
lgale ou la commettante ou commanditaire ntait pas en cause,
mais seulement les effets de cette filiation artificielle et il tait permis de
penser que la cour dappel concentrerait son examen sur le mode de
circulation internationale ou de pntration de ltat civil tranger dans
lordre juridique franais. Dans quelle mesure les indications que
lopration de transcription recueille des actes amricains pouvaient-elles
produire des effets en France ? La transcription ne transfrant sur les
registres franais, on la dit, que les mentions exiges des actes franais
eux-mmes, se serait accomplie une limination des lments impurs, tels
la conscration judiciaire de la convention de mre-porteuse et aurait t
ainsi favorise lassimilation de la filiation artificielle la filiation
biologique de sorte que les enfants auraient pu retirer de cette opration
tous le bnfices que dautres en France retirent des actes franais. A
priori, rien de choquant cela. Valentina et Fiorella, si cest bien ainsi
152
quon les appelle, auraient joui dans la vie juridico-administrative
quotidienne de la mme condition que les enfants ns en France. Il ne saute
pas aux yeux que lordre public aurait t mis en pril.
Lindissociabilit. Procdure et fond. Mais, sans doute claire par le
ministre public et encourage par la Cour de cassation, la Cour de Paris
reprend lide dindissociabilit163 ou dindivisibilit pour tablir entre les
actes de ltat civil et le jugement californien une solidarit telle que le
second finit par absorber les premiers.
i) Cette indissociabilit permet datteindre au travers des actes transcrire
le jugement californien, lequel entrine et officialise la convention de
gestation pour autrui. Cette translatio ad substantiam tait naturelle dans
laffaire sur laquelle a statu la Cour dappel de Bari dans son arrt du 13
fvrier 2009, mais dans laffaire espagnole elle a t refuse par la
Direction Gnrale des Registres et du Notariat (Rsolution du 18 fvrier
2009).
Dans le cas italien, devant la mauvaise volont de lofficier de ltat civil de
la Commune de Bari, lpouse italienne commettante avait assign son
mari, citoyen britannique, en vue dobtenir la reconnaissance, non pas des
documents dtat civil
trangers, mais des jugements trangers, en
loccurrence des parental orders qui lui imputaient la maternit des enfants
et qui avaient t prononcs en Angleterre o avait t ralises les
maternits de substitution et o les enfants taient ns. Il sagissait donc de
lefficacit en Italie de dcisions judiciaires anglaises ; ce qui relevait des
articles 64, 65 et 67 de la loi n. 218 du 31 mai 1995. Il ntait pas question
dans cette affaire dacte-cran, ctait le fond quil fallait aborder.
En revanche, lacte-cran tait si lon peut dire de principe dans laffaire
espagnole. Les circonstances de fait y taient analogues celles de laffaire
Mennesson, ceci prs que les poux commettants, lun et lautre
espagnols rsidant en Espagne, taient de mme sexe mais le mariage
sans complmentarit des sexes est licite dans ce pays. Cependant, en ce
163
Ide dj exploite par Paris, 26 fvrier 2009, JCP 2009. n26, 22 juin p. 17, note A. Mirkovic
153
qui concerne la transcription, lenvironnement juridique tait assez diffrent
de celui qui prvaut en France. Cest que le service espagnol de ltat civil,
le Registre civil, est entre les mains dune administration spcialise ; il est
gr par des fonctionnaires contre les dcisions desquels il est possible de
recourir par la voie administrative. Et cette voie administrative conduit la
Direction Gnrale des Registres et du Notariat, qui est place sous
lautorit du Ministre de la justice ; cet organisme prend sur les difficults
concrtes qui lui sont soumises des rsolutions qui sont destines tout
autant clairer le charg du registre local lorigine de la dcision
conteste, qu instruire lensemble des chargs des registres en leur
indiquant sur la base dune motivation parfois trs dveloppe (mais aussi
parfois discutable) la marche suivre pour les cas semblables ; le cas
concret offre loccasion de fixer une doctrine administrative. Evidemment,
en principe, il nest pas du ressort de cette administration spcialise dans
les registres dentrer dans le fond du droit, qui reste le monopole de
lautorit judiciaire en cas de contestation164. Aussi bien, on comprend que
la rsolution du 18 fvrier 2009 prtende se concentrer sur la seule question
presque technique de la transcription dun acte tranger de ltat civil qui a
sa base un ensemble de faits dont lillicit est patente au regard du droit
espagnol qui pourrait par ailleurs tre applicable la question de filiation
au fond, tant donn la nationalit espagnole des intresss. Mais ici la
sparation entre laspect instrumentaire du problme et son aspect
substantiel a une source institutionnelle : cest lorganisation du service de
ltat civil et sa dimension administrative accentue qui dissocie les deux
aspects, lesquels sont moins nettement distingus en France ou en Italie.
164
Au demeurant, la contestation au fond engagerait le sort du jugement tranger imputant la maternit,
or du point de vue du Registre civil, la reconnaissance dun jugement aux fins de transcription passe
(hors trait) par la procdure dexequatur Il ne peut tre procd aucune inscription en application
dun jugement ou dune dcision trangers qui nait force de chose juge en Espagne ; ainsi, pour y
procder il faudra obtenir pralablement lexequatur , Rglement sur le Registre civil, art. 83. En
lespce, cette disposition nintervenait pas, puisquil sagissait de lefficacit dun acte de ltat civil,
pour lesquels pareille procdure judiciaire nest pas prvue : art. 81 Linstrument authentique, quil
soit en original ou en copie, quil soit judiciaire, administratif ou notarial est un titre dinscription du fait
dont il fait foi. De mme linstrument authentique tranger, avec autorit en Espagne conformment aux
lois et aux traits internationaux
154
Cette dissociation est parfaitement admise par la DGRN qui (V., septimo)
reconnat que
lacte de ltat civil californien est dress aux seules fins dattester la filiation des
enfants et fonde une prsomption de paternit qui peut tre dtruite par dcision
de justice [selon le droit californien, tandis que] la transcription sur le Registre civil
espagnol de lacte de ltat civil californien produit les effets indiqus par les lois
espagnoles sur les Registres [] Pour quoi, toute partie ayant qualit peut attaquer
le contenu de ladite inscription par la voie civile ordinaire devant les tribunaux
espagnols .
Cette sparation de linstrumentaire et du substantiel, la Cour de Paris la
pratique elle-mme sur le plan procdural pour dlimiter lobjet de la
demande, puisquelle tient prciser :
laction du ministre public ne vise pas contester ltat des enfants, mais
carter les effets en France de leur tat civil tabli aux Etats-Unis ,
autrement dit, empcher que lon puisse se prvaloir en France de la
transcription des actes de ltat civil californien.
Ainsi quelle que soit lissue de la cause, que la cour conclue au maintien ou
quelle conclue lannulation de la transcription, il ne saurait tre question
de prononcer sur le fond, de rendre une dcision susceptible dtre dote
de lautorit de chose juge sur la filiation de Valentina et de Fiorella. A cet
gard, la Cour de Paris est bien en ligne avec la DGRN ce qui ne surprend
pas puisque les deux instances ne se nouent que sur la transcription.
Mais la diffrence de la DGRN, la Cour de Paris nadmet pas que
lisolement qui est opr sur le plan procdural de la question de
transcription et qui laisse hors de cause la question dtat provoque par de
la maternit de substitution, puisse aller jusqu rompre les liens entre les
instrumenta et les vnements quils relatent. Pour ne juger que de la
rgularit de la transcription, la cour se laisse nanmoins la possibilit
dexaminer les lments constitutifs des faits consigns dans les actes. Ce
mme processus chirurgical sophistiqu et slectif qui spare dans la
procdure ce qui reste indissociable au fond peut aussi sobserver dans le
domaine de la reconnaissance, dans un pays membre de lUnion
europenne ou partie la Convention de la Haye de 1973, des
condamnations alimentaires prononces ltranger : le bnfice du droit
conventionnel ou communautaire limite le libralisme de la reconnaissance
au chef alimentaire et ne couvre pas le lien de filiation qui en est la source
155
et qui reste tributaire du droit commun des effets des jugements165 ;
nanmoins, les faits qui ont justifi ltranger ltablissement de la filiation
doivent tre pris en compte, en tant que tels et abstraction faite de la
qualification quils ont reue du juge dorigine, pour lapprciation par
exemple de la conformit lordre public de la condamnation aux
aliments166. Cest un procd du mme genre qui est ici mis en uvre : le
primtre de la demande est circonscrit la question de la transcription,
lexamen de la demande peut sapprofondir et ainsi crever lcran que
constitue lacte transcrire. Cest en somme ce que la Cour de cassation
disait lorsquelle rattachait latteinte lordre public lgitimant laction du
ministre public sur le fait, dment constat,
que les nonciations inscrites sur les actes de ltat civil ne pouvaient rsulter que
dune convention portant sur la gestation pour autrui
Scission sur le plan formel, indissociabilit sur le plan matriel. Grce
cette indissociabilit la Cour de Paris se trouve dans une situation au fond
assez voisine de celle de la Cour de Bari, devant laquelle lexamen de la
rgularit des parental orders impliquait la prise en compte des lments
sur lesquels ceux-ci avaient fond lattribution de la filiation maternelle.
Indissociabilit et assimilation au jugement tranger. ii) Cette ide
dindissociabilit ramne aussi vers la position de la jurisprudence167 qui
est galement celle de lInstruction gnrale relative ltat civil en matire
de transcription des dcisions dadoption, autre hypothse de filiation
artificielle ; comme lobserve Mme MUIR WATT propos du rejet dun acte
de naissance tranger compos bien aprs la naissance et en fonction du
dispositif dun jugement dadoption :
lacte de naissance ayant t tabli en excution du jugement dadoption, son sort
est inexorablement li celui de ce dernier. Si le jugement lui-mme savre
165
Sauf le cas o il y aurait une convention, par exemple, bilatrale prvoyant un rgime particulier de
reconnaissance pour les jugements dtat ; dans cette hypothse le chef alimentaire bnficierait du
rgime communautaire ou des facilits de la Convention de la Haye de 1973 tandis que le chef dtat
bnficierait du rgime rsultant de la convention bilatrale.
166
V. Cass. civ. 1re, 12 juillet 1994, Rev. crit., 1995. 68 et la note, spc. pp. 77-78 et Mlanges Sturm, p.
1343 et s.
167 Cass. civ. 1re, 12 novembre 1987, Rev. crit. 1986. 557, note E. Poisson Drocourt, D. 1987 . 157 note J.
Massip, 18 juillet 2000, Epoux Wallon, Rev. crit., 2001. 349, note H. Muir Watt
156
irrgulier, lacte reconstitu pour tenir compte du nouvel tat civil de ladopt
tombe ainsi de son socle168
Par le jeu de cette indissociabilit (le terme est repris de larrt Wallon de
2000), la transcription demande par les poux Mennesson se trouve
pareillement subordonne aux conditions de rgularit des dcisions
judiciaires selon le droit commun franais des effets des jugements. Il
apparat ds lors quil ny a quant au travail juridictionnel effectuer dans
le primtre de la demande dannulation de la transcription, aucune
diffrence avec celui exig par une demande de reconnaissance de
jugement. La Cour de Paris qui tait en ligne avec la DGRN sur le plan de
lobjet de la demande, rejoint la Cour de Bari sur le plan de son traitement
juridictionnel.
Cela ressort en toute clart de la dmarche de la Cour de Paris. Celle-ci,
pour noncer les conditions de rgularit de la transcription, oublie quelle
ne traite que de la gestion du registre et reprend purement et simplement
la liste des conditions de rgularit des jugements trangers telle que la
fixe le 20 fvrier 2007 larrt Cornelissen169 :
trois conditions, savoir la comptence indirecte du juge tranger fonde sur
le rattachement du litige au juge saisi, la conformit lordre public international
de fond et labsence de fraude la loi .
Il ntait pourtant pas interdit dimaginer quil y ait un ensemble de
conditions de rgularit spcifique laccueil des actes de ltat civil
tranger. Lindissociabilit dispense de linstituer et lgitime lapplication
du rgime de rgularit des jugements trangers. Il suffit donc que lune
de ces trois conditions de la nomenclature Cornelissen soit dfaillante pour
que la reconnaissance soit refuse.
Il serait difficile, dans le cas Mennesson, de douter de la comptence des
autorits judiciaires californiennes pour homologuer une convention de
mre-porteuse souscrite par une femme rsidant en leur ressort ou de la
comptence des autorits administratives locales pour tablir un acte de
ltat civil rapportant des faits qui se sont produits sur le territoire de la
168
169
H. MUIR WATT, note prc. Rev. crit, 2001, p. 352
Cass. civ. 1re, 20 fvrier 2007, Rev. crit. 2007. 420, note Ancel et Muir Watt,
157
Californie ; personne ne sy est aventur. En revanche, le parquet
dnonait une violation de lordre public et aussi une fraude la loi
franaise prohibant la maternit sous-traite.
La fraude la loi. Sagissant de la fraude la loi, la Cour de Paris naura
pas sy arrter. Car elle aura constat au pralable quest dfaillie lune
des trois conditions numre et elle disposera alors dun motif suffisant
pour justifier le refus de reconnaissance des actes et de transcription. Cest
la condition de conformit lordre public que - selon la suggestion de la
Cour de cassation la Cour de Paris vrifie par priorit et, comme elle va
la juger non satisfaite, elle naura pas examiner la question de la fraude.
La DGRN ne sest pas accorde cette facilit ; il est vrai quelle a conclu la
rgularit des actes de ltat civil californien et la possibilit de leur
transcription ; sil suffit que manque une condition de rgularit pour que la
reconnaissance reste hors de porte, linverse celle-ci ne peut tre
acquise que sil est tabli que toutes les conditions de rgularit sont
runies. Il tait donc ncessaire de vrifier labsence de fraude la loi.
Quoi quil en soit, la DGRN croit pouvoir remarquer que
Les intresss ne se sont pas servi dune rgle de conflit pas plus que de
quelque autre norme dans le dessein dluder une loi imprative espagnole. Il ny a
pas eu de modification du point de rattachement de la rgle de conflit espagnole,
par exemple, par un changement artificiel de la nationalit des enfants pour
provoquer lapplication de la loi de Californie grce la cration dune connexion
existante, quoique fictive et vide de contenu, avec lEtat de Californie .
La formule est intressante, de mme que le visa sous lequel elle se place,
essentiellement celui de larticle 12. 4 Codigo civil qui nonce que
sera considre comme une fraude la loi lutilisation dune norme de conflit
dans le but dluder une norme imprative espagnole .
La dfinition est trs proche de celle que retient depuis larrt
Bauffremont170 la jurisprudence franaise. Mais il faut tout de mme
observer aussitt que tant dans cette dcision que dans larticle 12. 4, il est
question de conflit de lois ; il est question de fraude la loi par
manipulation de la rgle de conflit. Ce qui est manifestement hors sujet,
Cass. civ. 18 mars 1878, Grands arrts, n6, v. aussi Civ. 1re, 17 mai 1983, Soc. Lafarge, Rev. crit., 1985.
346 et la note
170
158
puisque comme la DGRN y insiste et comme ladmet la Cour de Paris de
faon quasi explicite171, dans ces affaires de reconnaissance les rgles de
conflit de lois nont pas intervenir. Ds lors, la dfinition canonique
donne par la jurisprudence franaise ou par la disposition espagnole en
considration des conflits de lois et articule sur les rgles de conflit, na
pas lieu dtre retenue ; dans le champ de la reconnaissance, si un obstacle
la rgularit se tire de la fraude la loi, celle-ci doit tre redfinie en
fonction des mcanismes de contrle mis en uvre : la rgle de conflit
limine, il faut trouver dautres paramtres de contrle de labsence de
fraude172.
Au demeurant la DGRN ladmet lorsquelle passe de la fraude au forum
shopping frauduleux . Mais celui-ci, quoi quelle en dise,
ne peut pas
consister
placer la question de la dtermination de la filiation entre les mains des autorits
californiennes dans le but dluder une loi imprative espagnole ,
ce qui fait reposer la fraude sur une rfrence la loi applicable ; le
forum
shopping
frauduleux
consistera
plutt
profiter
de
la
complaisance des rgles de comptence trangres pour naller vers le
juge tranger que dans le seul but den obtenir ce qui ne pourrait tre
obtenu du juge naturel, cest--dire du juge que les circonstances de la
cause dsignent comme le plus proche et le plus directement accessible.
Au demeurant, il nest pas sr que cette conception maladroite de la fraude
en matire de reconnaissance que prtend cultiver la Direction gnrale
ne rponde pas au souci de blanchir le comportement des poux
commettants. Lobjectif dunit du statut des enfants, de continuit de leur
condition juridique, que commanderait leur intrt suprieur aurait t mis
en pril par la dnonciation dune fraude Un peu de fonctionnalisme
dans la dfinition prvenait ce danger.
par la rfrence larrt Cornelissen qui a prcisment expuls le rglement du conflit de lois du
processus de vrification de la rgularit.
172 Comp. BUREAU et MUIR WATT, n 267 et n279 ; v. Cass. civ. 1re, 1er mars 1988, Rev. crit. , 1989. 721, note
A. Sinay-Cytermann, Cass. civ. 1re, 6 juin 1990, Rev. crit. 1991. 593, note P. Courbe, D. 1990. Som. com.
265, obs. B. Audit
171
159
La Cour de Paris a chapp ce souci parce que, moins empresse de
subordonner la simple validit de la transcription lunit et la continuit
du statut des enfants, elle ne se prononce pas sur ce statut. Et de son ct,
particulirement sensible lintrt suprieur des enfants et soucieuse de
garantir lunit et la continuit de leur condition, la Cour dappel de Bari,
qui elle prononce au fond, naurait pu, si elle avait soulev la question, que
se fliciter de lostracisme traditionnel dont le droit international priv
italien frappe la fraude la loi. Quoique, vrai dire, le spectre de la fraude
plane parfois sur sa dcision, mais seulement pour tre cart : si lpouse
commettante tait italienne, le mari, lui, tait anglais et la Cour ne manque
de le rappeler, comme pour suggrer quil ntait pas illgitime de
sadresser au march anglais des enfants natre et livrer
La fraude est ainsi dmobilise dans ces trois affaires. En revanche, lordre
public est bien sollicit.
Lordre public. Cet appel lordre public, encourag par la Cour de
cassation, conduit la Cour de Paris se rfrer aux article 16-7 et 16-9 du
code civil aux termes desquels toute convention portant sur la
procration ou la gestation pour le compte dautrui est frappe dune
nullit dordre public. En opposant ainsi ces dispositions au jugement
californien, la cour ralise une extension de lordre public interne lordre
international. Larrt de cassation qui ne statuait que sur la recevabilit de
la demande dannulation, laissait le doute subsister sur cette extension.
Sagissant alors de la recevabilit de laction du parquet en annulation
devant les tribunaux franais, lordre public que veut protger larticle 423
c. pr. civ. est certainement lordre public interne ? Naturellement dans
certains cas, cet ordre public interne dveloppe une nergie telle quil
alimente lordre public international. Ainsi la prohibition de lunion
polygamique rsultant de larticle 147 du code civil est dordre public
interne, mais elle fait aussi obstacle la clbration en France du mariage
avec une compatriote de ltranger de statut personnel coranique qui se
160
trouve encore dans les liens dune premire union. Daprs la Cour de
Paris les articles 16-7 et 16-9 du code civil sont aussi exigeants et aussi
ttus que larticle 147 du code civil et, exprimant aussi lordre public
international franais, ils tiennent en chec la dcision californienne :
l'arrt de la Cour suprieure de l'Etat de Californie, en ce qu'il a valid
indirectement une convention de gestation pour autrui, est en contrarit avec la
conception franaise de l'ordre public international ; qu'en consquence, sans qu'il
soit ncessaire de rechercher si une fraude la loi a t ralise, il y a lieu
d'annuler la transcription, sur les registres du service central d'tat civil franais,
des actes de naissance amricains qui dsignent Mme Mennesson comme mre
des enfants et d'ordonner la transcription du prsent arrt en marge des actes de
naissance annuls
La messe est dite.
Nanmoins, la cour prolonge sa motivation pour rpondre, sinon aux
moyens, du moins sur les moyens articuls par les intims. Au del dune
rplique la dploration dune violation du droit un procs quitable, il
sagit essentiellement de lintrt suprieur de lenfant.
Lintrt suprieur de lenfant. Lintrt suprieur de lenfant est un critre
ou un standard dcisif en matire de reconnaissance des dcisions ou actes
concernant les enfants. La Convention de New York sur les droits de
lenfant du 20 novembre 1989 limpose173 ; larrt de la Cour dappel de
Bari aussi bien que la rsolution de la DGRN lattestent. Le premier
linvoque pour justifier la reconnaissance des parental orders, la seconde
pour justifier la transcription sur les registres espagnols. La Cour de Paris
carte pourtant le moyen, en se fondant sur deux considrations.
i) En premier lieu, la cour admet quil peut tre incommode pour les
jumelles ou pour les personnes qui en ont la garde de ne pas disposer des
facilits que procure la transcription lorsquil conviendra de faire en
France la preuve non contentieuse de leur tat, mais elle juge que la
173
Art. 3 : 1. Dans toutes les dcisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions
publiques ou prives de protection sociale, des tribunaux, des autorits administratives ou des organes
lgislatifs, lintrt suprieur de lenfant doit tre une considration primordiale. 2. Les Etats parties
sengagent assurer lenfant la protection et les soins ncessaires son bien-tre, compte tenu des
droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes lgalement responsables de
lui, et ils prennent cette fin toutes les mesures lgislatives et administratives appropries .
161
complication des dmarches que cela impose aux intresss (qui, a-t-elle
not, se rendent rgulirement aux Etats Unis pour leurs activits
professionnelles ) est infiniment moins grave que la publication
dinformations pchant par dfaut et dissimulant une infraction lourde la
prohibition franaise qui na certainement pas t dicte de manire
arbitraire, pour nuire aux enfants, mais qui rpond des motifs dintrt
gnral, social et collectif. La proportionnalit joue contre les intims.
ii) En second lieu, aprs avoir refus de sengager sur le terrain de la
rgularit au fond du lien de filiation tabli aux Etats-Unis, il est ais pour la
cour qui a ainsi spar la question de la transcription et la question dtat
de corriger la position quelle avait cru devoir prendre dans larrt du 25
octobre 2007. Dans cette dcision, elle dclarait en effet que du fait de la
non-transcription des actes de naissance, les enfants
au regard du droit franais, se verraient priver (sic) dactes dtat civil indiquant
leur lien de filiation, y compris lgard de leur pre biologique .
Ctait, on la dit, videmment faux ; les actes amricains ne pouvaient tre
annuls par un juge franais. La seule incidence en France de la nontranscription - faut-il y insister ? - nest pas lanantissement des actes
trangers, mais la ncessit daller chercher des copies ou extraits auprs
du service de ltat civil de San Diego. Pour le reste, la filiation biologique
ou autre nest pas en cause. Ds lors, venant rsipiscence, elle peut
affirmer que
l'absence de transcription n'a pas pour effet de priver les deux enfants de leur
tat civil amricain et de remettre en cause le lien de filiation qui leur est reconnu
l'gard des poux Mennesson par le droit californien .
Ds lors quelle ne tranche pas la question dtat, la question de laccueil
en France des droits acquis en Californie, mais simplement celle de
lincidence de lordre public international sur le fonctionnement des
registres franais de ltat civil, cette dcision parat fonde.
En revanche, la rsolution de la DGRN qui autorise la transcription laissera
perplexe lorsquelle considre (V, 4) que la solution contraire aurait
compromis lintrt suprieur de lenfant qui
162
se concrtise dans le droit dudit mineur une identit unique , [lequel] comporte le
droit de jouir dune filiation unique valable en divers pays et non dune filiation variant de
pays pays qui les ferait changer de parents chaque fois quils franchiraient une frontire .
tandis quelle admet ailleurs (V, 7) que la transcription ntablit pas en
droit la preuve de la filiation des enfants parce que
toute partie ayant qualit peut attaquer le contenu de ladite inscription par la voie
civile ordinaire devant les tribunaux espagnols .
Autrement dit la DGRN, qui nest pas comptente pour connatre du rapport
substantiel de filiation issu dune gestation pour autrui, ne salarme de
lventualit dun dmenti judiciaire. Peu lui importe, en somme, de
publier une information trompeuse. En effet,
lincertitude de la filiation de ces mineurs qui changerait chaque fois quils
franchiraient la frontire des Etats-Unis pour venir en Espagne et vice versa [], il
est toujours prfrable de procder cette transcription au nom de l intrt
suprieur du mineur ,
ds lors que, son avis,
la transcription de lacte de ltat civil californien sur le Registre civil espagnol est
le moyen le plus effectif de raliser ce droit des mineurs leur identit unique par
dessus les frontires des Etats .
Il nest donc pas trop grave de compromettre la crdibilit, la fiabilit de
linstrument dinformation quest le Registre civil ; il nest pas trop grave
non plus que lautorit espagnole de ltat civil jette le manteau de No sur
une violation de la prohibition espagnole des conventions de mre
porteuse commise par deux espagnols rsidant en Espagne Ainsi, de
manire curieuse (ou scandaleuse ou en tout cas alarmante sur ltat de
lEtat de droit espagnol), les agents de lEtat ne sont pas tenus de veiller
lexcution et au respect des lois de lEtat Lintrt suprieur de lenfant
lgitime la thorie de lacte-cran.
Ce nest pas par ce biais que la Cour dappel de Bari parvient autoriser la
transcription sur les registres de ltat civil de la commune de Bari. Cette
solution nest que la consquence de la reconnaissance des parental orders
britanniques dont la rgularit, objet de linstance, est constate au double
motif
163
1 que ces dcisions ne heurtent pas lordre public international italien ds
lors que dans linstance indirecte celui-ci se fait plus libral que lordre
interne qui nimposerait ses prohibitions quaux nationaux italiens (?)174 ;
2 que la reconnaissance de ces dcisions viterait aux mineurs
un prjudice gravissime au regard de leur intrt prpondrant tre reconnus
comme [les enfants de dame I. ] quils se trouvent en Angleterre ou quils se
trouvent en Italie 175.
Se retrouve ici largument du droit une identit unique , qui sera
renforc par celui de la libert de circulation176 (dont la CJCE fait parfois un
usage excessif) et qui sera aussi discrtement paul par celui du droit
une vie familiale normale177 (auquel est attentive la Cour europenne des
droits de lhomme). On mesure ici quelle pression peut exercer le droit
conventionnel ou communautaire et combien elle peut temprer les
svrits de lordre public international. Le fait est que de droit italien est
particulirement sensible lidologie internationaliste et quil nest pas
rare que certains de ses agents dapplication doutent de sa valeur... Aussi
bien, si la situation acquise ltranger se rattache, comme en lespce
traite par la Cour de Bari, de manire assez nette lordre juridique
tranger, il arrive que soit prfr le parti de ltranger . Mais il faut
souligner que linstance italienne tout indirecte quelle ft, portait sur la
question dtat et non sur la question de la transcription et de la bonne
gestion des registres de ltat civil laquelle, si elle avait t pose,
naurait intress que lordre juridique italien.
Bien sr, en France non plus, il nest pas question de laisser les enfants
labandon, mais ce soin qui incombe assurment M. Mennesson peut,
pour tre partag par Mme Mennesson, passer par dautres voies que celle
de la transcription sur les registres de ltat civil et de la dsactivation
de limprativit de dispositions qui ont leur raison dtre.
174
La rdaction du 15-1 est assez malencontreuse lorsquelle sefforce de distinguer deux niveaux
dordre public international quune plume franaise aurait assigns respectivement leffet plein (en cas
de rattachement srieux avec lordre juridique franais) et leffet attnu (en labsence de tel
rattachement)
175
V. 16 18
176
18-1 et s.
177
16-1, 16-2 et 16-3
164
Au del de la dimension humaine de la situation des enfants victimes de
linfraction quil est particulirement difficile de grer de faon
approprie, il reste que - pour tirer une premire et rapide conclusion - la
voie de la reconnaissance des situations constitues ltranger ouvre une
avenue linstitution exorbitante pour pntrer dans lordre du for, celui-ci
la rprouverait-il dans son principe. La position du parquet est cet gard
clairante : il ne conteste que lopration de transcription, mme sil est
convaincu de la ncessit de repousser les droits qui ont t acquis
ltranger au mpris de la prohibition de larticle 16-7c. civ., il sabstient de
porter lattaque contre la rgularit de la convention, du jugement et des
actes de ltat civil californiens, de sorte que jusqu ce quadvienne leur
ventuelle censure par les tribunaux franais, ces lments soutiennent la
relation familiale qui sest tablie entre les intresss. Sans doute si le
contentieux de la rgularit au fond est un jour ouvert en France, il nest
nullement exclu quil dbouche sur une dcision constatant la contrarit
lordre public des droits acquis ltranger. Certes, il nest pas interdit de
prtendre, par exemple, sous le signe de lordre public de proximit que,
les actes ayant t dresss en Californie, entrinant des circonstances
survenues en ce pays et concernant la filiation denfants de nationalit
amricaine, lloignement de la situation par rapport lordre juridique du
for franais commande une certaine modration dans lapprciation des
exigences de lordre public international franais et que, par consquent,
ces actes doivent en France bnficier de la reconnaissance qui est due
aux actes mans dautorits trangres comptentes aussi bien ratione
loci que ratione materiae. Mais il faut aussi souligner en sens contraire que
si la situation se rattachait troitement lordre juridique californien, elle
entretenait aussi des liens srieux avec lordre juridique franais ; liens
srieux au point
- quil a paru ncessaire de demander la transcription des actes amricains
sur les registres franais de ltat civil, cest--dire sur les registres utiles
dans le pays
165
- dont les poux Mennesson ont la nationalit et o ils rsident et o
rsident galement les jumelles au moment de cette procdure178
et lon sait de quelle intensit est ce lien de la rsidence de lenfant179, si
consistant quil ramne lapplication de la loi franaise Lordre public
de proximit ou la thorie de lInlandsbeziehung180 pourraient, la rigueur,
tolrer le cas de jumelles nes dune gestation pour autrui entame et
acheve La Mesa, comt de San Diego, o elles auraient t remises dans
les mmes conditions aux poux commettants, si ceux-ci, de nationalit
franaise, avaient eu de manire effective aux Etats-Unis leur rsidence
habituelle au moment des oprations et taient simplement venus par la
suite sjourner en France. Tout dpend, au fond, des circonstances de la
cause.
Cest bien l ce quil y a de fcheux avec ce procd de la reconnaissance :
laccueil des droits acquis ltranger est assur par la condition de
comptence de lordre juridique tranger et la seule dfense contre cette
pntration qui peut tre dvastatrice, dsactivant limprativit, est
celle de lordre public international lequel, dans sa mallabilit,
fonctionne sur un mode qui noffre gure de scurit au justiciable, puisque
sa raction est commande par lapprciation quun juge portera in
concreto sur les circonstances particulires de la cause. Autant la
personnalit du juge, autant les singularits du cas, cest-dire des
lments variables et contingents, dterminent lefficacit ou non en
France de la situation constitue ltranger.
Limprvisibilit de cet ordre public de proximit fera regretter labolition
par larrt Cornelissen de la condition de conformit au systme franais de
conflit de lois : sil est admis, come cela est vraisemblable, que les articles
16-7 et 16-9 c. civ. constituent des lois de police franaise dont les critres
178
V. Cass. civ. 1re, 20 septembre 2006, Sam, supra, n177 et s., Cass. civ. 1re, 31 octobre 2007, M. Arab
c. dame Y. Ed Douaissy (n 06-20 799)
179
V. Cass. civ. 1re, 10 fvrier 1993, Enfant Sarah (Latouz), Rev. crit DIP, 1993. 620, note Jacques Foyer, JDI
1994. 124, note I. Barrire-Brousse; Cass. civ. 1re, 10 mai 2006, enfant Lana-Myriam, D. 2006. 2890, note
G. Kessler et G. Salam ; JCP. 2006.II. 1165, note T. Azzi ; JCP.2007. I. 109, note L. Corbion ; Dr. famille.
Septembre 2006. 33, note M. Farge.
180
V. P. LAGARDE, note prc., p. 327
166
defficacit dans lespace sont la rsidence habituelle en France et/ou la
nationalit franaise des parties la convention de mre-porteuse, les cas
dans lesquels les intresss contreviennent linterdiction sont aisment
dterminables ds avant lengagement des oprations ; la scurit est
assure, chacun sachant au moment o il agit ce quil lui est permis et ce
qui lui est dfendu de faire au regard du droit international priv franais. Il
nest pas interdit de penser que cette solution serait meilleure.
Tempus defuit
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours de Droit International Privé s5Document43 pagesCours de Droit International Privé s5Bennaceur Thami100% (6)
- Droit International Des Affaires (Cour Complet)Document49 pagesDroit International Des Affaires (Cour Complet)Slali OthmanPas encore d'évaluation
- DEcret Adaptant Les Structures Organlsattonnelles Du MENJS AUX NOUVELLES REALITES POLITIQUESDocument32 pagesDEcret Adaptant Les Structures Organlsattonnelles Du MENJS AUX NOUVELLES REALITES POLITIQUESRoller Saint PierrePas encore d'évaluation
- Les Types D'etatDocument3 pagesLes Types D'etatissa dieye100% (1)
- PFE - Master - Conseil de La ConcurrenceDocument25 pagesPFE - Master - Conseil de La ConcurrenceAdnane AdnanePas encore d'évaluation
- La Notion de Sujet de (... ) Demogue René bpt6k9373462Document58 pagesLa Notion de Sujet de (... ) Demogue René bpt6k9373462Éverton Willian PonaPas encore d'évaluation
- Mémoire Droit Pénal Des Entités - Mécanismes D'évitement D'engagement de La Responsabilité Pénale Des Personnes MoralesDocument47 pagesMémoire Droit Pénal Des Entités - Mécanismes D'évitement D'engagement de La Responsabilité Pénale Des Personnes MoralesRudy AlbinaPas encore d'évaluation
- Grands Courants Pensée JuridiqueDocument57 pagesGrands Courants Pensée JuridiqueBérénice Sauzeau100% (3)
- Contrat en DIPDocument17 pagesContrat en DIPalae00Pas encore d'évaluation
- Droit International Prive ResumeDocument6 pagesDroit International Prive Resumeisrael MakayaPas encore d'évaluation
- S3 - Introduction Au Droit International Privé PDFDocument9 pagesS3 - Introduction Au Droit International Privé PDFRachid JockPas encore d'évaluation
- 3 DIP Pol..Document171 pages3 DIP Pol..PAKAS1Pas encore d'évaluation
- DIP CassandreDocument77 pagesDIP Cassandreirma_j_1Pas encore d'évaluation
- Dip S5 - 114354Document9 pagesDip S5 - 114354saadelabdouni7Pas encore d'évaluation
- La Règle de Conflits Des Lois Et GRANDS ARRETS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVEDocument8 pagesLa Règle de Conflits Des Lois Et GRANDS ARRETS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVEMohamed Amine Benayad100% (1)
- Introduction Au Cours de Droit International Privé Ou DIPDocument17 pagesIntroduction Au Cours de Droit International Privé Ou DIPMalika Iben MansourPas encore d'évaluation
- Résumé conflits-WPS OfficeDocument11 pagesRésumé conflits-WPS OfficefunmyalohoutadePas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitk.aarab76Pas encore d'évaluation
- Droit International Prive 2Document39 pagesDroit International Prive 2ousmanePas encore d'évaluation
- DIPMASTER1Document95 pagesDIPMASTER1akiva.hammerPas encore d'évaluation
- Qualification Du Contrat 1Document9 pagesQualification Du Contrat 1alae00Pas encore d'évaluation
- Droit International PrivéDocument21 pagesDroit International PrivéKhalilTawïlPas encore d'évaluation
- Séquence 2 Droit International PrivéDocument28 pagesSéquence 2 Droit International PrivéBada NdiayePas encore d'évaluation
- Droit International Prive IIDocument30 pagesDroit International Prive IIJessica SionPas encore d'évaluation
- Introduction Générale Droit International PrivéDocument13 pagesIntroduction Générale Droit International PrivéBada NdiayePas encore d'évaluation
- Ucao Dip Master I - CopieDocument66 pagesUcao Dip Master I - Copieaminata7193Pas encore d'évaluation
- Cours de Droit International Prive Ivoirien DefinitifDocument71 pagesCours de Droit International Prive Ivoirien Definitifsouys23100% (2)
- Expose ZaherDocument14 pagesExpose ZaherAtae MstfaPas encore d'évaluation
- France (S. Godechot-Patris) Final PDFDocument26 pagesFrance (S. Godechot-Patris) Final PDFDiana Andreea CojanPas encore d'évaluation
- Contrat DEtatDocument42 pagesContrat DEtatElmostafa Zakaria HamdouchePas encore d'évaluation
- Les Conflits de LoisDocument17 pagesLes Conflits de LoisimanePas encore d'évaluation
- 72 - La Pratique Notariale Dans Le Droit International Privé (2006-02) - A. ArdillierDocument301 pages72 - La Pratique Notariale Dans Le Droit International Privé (2006-02) - A. ArdillierAwama TiacohPas encore d'évaluation
- Cours de Droit International PriveDocument109 pagesCours de Droit International PriveFayssal AllouchPas encore d'évaluation
- DROIT INTERNATIONAL PRIVE CompletDocument73 pagesDROIT INTERNATIONAL PRIVE Completdak dikPas encore d'évaluation
- Droit International Prive - L2 UCCDocument67 pagesDroit International Prive - L2 UCCelyseebunani10Pas encore d'évaluation
- Droit de Commerce InternationalDocument21 pagesDroit de Commerce InternationalAlaleh Irooni100% (1)
- Séquence 1 Droit International PrivéDocument25 pagesSéquence 1 Droit International PrivéBada NdiayePas encore d'évaluation
- La Formation Du Droit InternationalDocument5 pagesLa Formation Du Droit Internationalzoubida el rhoulPas encore d'évaluation
- TP DROIT SOCIAL - WPS OfficeDocument3 pagesTP DROIT SOCIAL - WPS Officegildardkyungungoy007Pas encore d'évaluation
- Droit International Prive1Document6 pagesDroit International Prive1Asmae BoulartalPas encore d'évaluation
- La Déconstruction Structurelle Du Droit InternationalDocument17 pagesLa Déconstruction Structurelle Du Droit InternationalAbdelhamid KarrakyPas encore d'évaluation
- TD 8 La Hierarchie Des Normes DMDocument4 pagesTD 8 La Hierarchie Des Normes DMnehasenanayake19Pas encore d'évaluation
- Droit International PriveDocument46 pagesDroit International Privejustin BIANOUPas encore d'évaluation
- A Pillet - La Theorie Generale Des Droit AcquisDocument72 pagesA Pillet - La Theorie Generale Des Droit AcquisFelipe SartórioPas encore d'évaluation
- DIP MinimiséDocument15 pagesDIP MinimisébenjellounlamiaaPas encore d'évaluation
- La Liberte de Traiter Des Etats Et Le Jus CogensDocument27 pagesLa Liberte de Traiter Des Etats Et Le Jus CogensClaudy MonjaPas encore d'évaluation
- Master 1 Dpf/Daf: en Guise D'IntroductionDocument11 pagesMaster 1 Dpf/Daf: en Guise D'Introductionallaramadjisylvain7Pas encore d'évaluation
- Cours de Droit International PrivéDocument122 pagesCours de Droit International Privétianjanahary fredoPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés - Droit International PrivéDocument10 pagesTravaux Dirigés - Droit International PrivéZina ZGPas encore d'évaluation
- Syllabus de D.I.P. Mars 2017Document276 pagesSyllabus de D.I.P. Mars 2017julien ntwaliPas encore d'évaluation
- Cours Numérique de DIP 1 PR Atangana Malongue 2020Document38 pagesCours Numérique de DIP 1 PR Atangana Malongue 2020Alexy's Jordan86% (7)
- Examen Final DIP Master I Droit Privé U.FHB Janvier 2019Document5 pagesExamen Final DIP Master I Droit Privé U.FHB Janvier 2019Anoh Harris A Akré100% (2)
- Ridc 0035-3337 1970 Num 22 4 15829Document15 pagesRidc 0035-3337 1970 Num 22 4 15829noemienzinza2Pas encore d'évaluation
- Le Contrat Sans Loi en Droit International Privé PDFDocument32 pagesLe Contrat Sans Loi en Droit International Privé PDFayoub2310Pas encore d'évaluation
- ProcessuelDocument103 pagesProcessuelmitnickcrewPas encore d'évaluation
- Chapitre 2: Les Différentes Matières Relevant Du Statut RéelDocument11 pagesChapitre 2: Les Différentes Matières Relevant Du Statut Réelinessandra.loloPas encore d'évaluation
- Notion Darbitrage-1Document7 pagesNotion Darbitrage-1Imane imane100% (1)
- Droit International PrivéDocument11 pagesDroit International PrivéStéphane DA SILVEIRAPas encore d'évaluation
- Fische Cas Pratique de DIPDocument12 pagesFische Cas Pratique de DIPOana ViziteuPas encore d'évaluation
- Le droit européen des successions: Commentaire du Règlement n°650/2012 du 04 juillet 2012D'EverandLe droit européen des successions: Commentaire du Règlement n°650/2012 du 04 juillet 2012Pas encore d'évaluation
- Annales du droit luxembourgeois – Volumes 27-28 – 2017-2018D'EverandAnnales du droit luxembourgeois – Volumes 27-28 – 2017-2018Pas encore d'évaluation
- Cours de Droit CommercialDocument143 pagesCours de Droit CommercialMohammed EL BassiriPas encore d'évaluation
- 682.06.10.1 Decret Du 2 Juin 2010 Portant Manuel de Procdure de La Loi Sur Les Marches PublicsDocument61 pages682.06.10.1 Decret Du 2 Juin 2010 Portant Manuel de Procdure de La Loi Sur Les Marches PublicsJoel MukinayiPas encore d'évaluation
- Cameroun FinDocument2 pagesCameroun FinIsaac Desire MatenPas encore d'évaluation
- GUIDE JURIDIQUE Pour La LIBERTE VACCINALE.V1.0Document43 pagesGUIDE JURIDIQUE Pour La LIBERTE VACCINALE.V1.0bollybolly2012100% (1)
- Recueil - Textes - Decentralisation 1996Document259 pagesRecueil - Textes - Decentralisation 1996Saliou Bobo Kane DialloPas encore d'évaluation
- Le Régime Indemnitaire Tenant Compte Des Fonctions, Des Sujétions, de L'expertise Et de L'engagement Professionnel R.I.F.S.E.E.PDocument19 pagesLe Régime Indemnitaire Tenant Compte Des Fonctions, Des Sujétions, de L'expertise Et de L'engagement Professionnel R.I.F.S.E.E.PDominique GayraudPas encore d'évaluation
- CM5 PDFDocument69 pagesCM5 PDFVictor LucianPas encore d'évaluation
- Constitution de La Republique Gabonaise 1Document20 pagesConstitution de La Republique Gabonaise 1shali108Pas encore d'évaluation
- Droit Commercial Et Des SociétésDocument19 pagesDroit Commercial Et Des SociétésMOHAMMED AMINE BOUCHAREBPas encore d'évaluation
- Plan Précis de Droit AdministratifDocument9 pagesPlan Précis de Droit AdministratifXénia ChavirovPas encore d'évaluation
- SGES Du Projet COMPETENCES (ESMS) Partie 1 PDFDocument73 pagesSGES Du Projet COMPETENCES (ESMS) Partie 1 PDFIBRAHIMA NDIAYEPas encore d'évaluation
- Ethique Et Deontologie de La Profession de Commissaire de Justice-2Document118 pagesEthique Et Deontologie de La Profession de Commissaire de Justice-2Fortunat BoubériPas encore d'évaluation
- Manuel - APA Version 2019 PDFDocument33 pagesManuel - APA Version 2019 PDFthomas nicouleauPas encore d'évaluation
- 24 Madagascar-Code-2006-des-changesDocument10 pages24 Madagascar-Code-2006-des-changesMraPas encore d'évaluation
- Cours 84 5 A3 1626688749Document43 pagesCours 84 5 A3 1626688749Nguessan Parfait KouamePas encore d'évaluation
- Bulletin Officiel FR 2015Document154 pagesBulletin Officiel FR 2015Salim GreffouPas encore d'évaluation
- Contentieux Constitutionnel ExamDocument8 pagesContentieux Constitutionnel Examjihane amraniPas encore d'évaluation
- Notions Droit Commercial - Pr. BenmoussaDocument19 pagesNotions Droit Commercial - Pr. BenmoussaMaatoubePas encore d'évaluation
- Gabon Decret 2016 94 Reglement General Comptabilite PubliqueDocument28 pagesGabon Decret 2016 94 Reglement General Comptabilite PubliqueJO.menguePas encore d'évaluation
- L'impact Des Réformes Bancaires Sur Le: Financement Des PME en Algérie: Cas de BNA, Agence de Tizi-OuzouDocument125 pagesL'impact Des Réformes Bancaires Sur Le: Financement Des PME en Algérie: Cas de BNA, Agence de Tizi-OuzouFer Sal100% (1)
- La HalDocument366 pagesLa HalnasroPas encore d'évaluation
- DT4049 PDFDocument50 pagesDT4049 PDFmalik belmokhtarPas encore d'évaluation
- Pensées Du Droit, Lois de La PhilosophieDocument180 pagesPensées Du Droit, Lois de La PhilosophieLucas GrinsteinPas encore d'évaluation
- Droit International Privé - Cours 2009/2010Document93 pagesDroit International Privé - Cours 2009/2010La Machine80% (5)