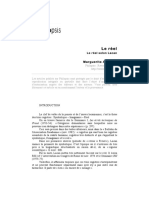Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
À Condition de S'en Servir
À Condition de S'en Servir
Transféré par
ElisangelaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
À Condition de S'en Servir
À Condition de S'en Servir
Transféré par
ElisangelaDroits d'auteur :
Formats disponibles
À condition de s'en servir ?
Marie-Claire Boons-Grafé
Dans La clinique lacanienne 2009/2 (n° 16), pages 13 à 30
Éditions Érès
ISSN 1288-6629
ISBN 9782749211541
DOI 10.3917/cla.016.0013
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
Article disponible en ligne à l’adresse
https://www.cairn.info/revue-la-clinique-lacanienne-2009-2-page-13.htm
Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...
Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
Distribution électronique Cairn.info pour Érès.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le
cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est
précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
À condition de s’en servir ?
Marie-Claire Boons-Grafé
À François
Au cas où elle réussirait, la psychanalyse fournirait-elle la
preuve qu’il est possible de se passer du Nom-du-Père, si on s’en
sert ? S’en servir, de ce signifiant, ferait condition pour pouvoir
s’en passer. S’en passer… « aussi bien » dit Lacan en avril 1976.
Ce qui veut dire qu’on peut ne pas s’en passer, mais… « aussi
bien », qu’on peut s’en passer, si toutefois on parvient à s’en
servir. Objection : mais si on s’en sert, des services attribués
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
à ce signifiant, ça veut dire qu’on ne s’en passe pas ! Eh bien
justement non ! Il y aurait un savoir s’en servir qui permettrait
qu’on s’en passe. Mais on se sert de quoi ? On se sert d’une pure
fonction logique, celle assignée par la théorie psychanalytique à
ce signifiant. Et on se passe de quoi ? On apprend à se passer de
l’imaginaire qui tourne autour du nom qu’a reçu cette fonction,
qui est le nom hérité à la fois de la tradition judéo-chrétienne, de
la tradition patriarcale et du mythe fabriqué par Freud dans Totem
et tabou.
Si, comme l’énonce Lacan, « supposer le Nom-du-Père,
certes, c’est Dieu », alors on ne suppose plus et on se passe d’une
foi qui est « foire » autour du nom « Dieu », et on prend acte des
conséquences symboliques et réelles de ce qui est devenu pour
nous cela, qui n’existe pas.
13
Clinique lacanienne 16.indd 13 1/12/09 9:47:04
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
Et « aussi bien », comme analyste, ici en France, aujourd’hui,
on se passe de sacraliser les textes de Freud ou de Lacan : ce
qu’ils ont dit et écrit n’est plus intouchable.
Cependant, loin de tout scepticisme et de tout nihilisme, notre
soudaine angoisse se double d’une possibilité de faire confiance :
on fait confiance, on accorde un crédit à la fonction du signifiant
Nom-du-Père et c’est cette fonction centrale qu’il s’agirait de
faire consister logiquement en s’en servant. De même, accorde-
t-on une confiance aux textes de ceux qui nous ont précédés. On
ne peut que passer par ce qu’ils ont dit et nommé avant nous. On
s’y empêtre, on y patauge, on doit partir des problèmes qu’ils
nous lèguent, des questions qu’ils nous posent. Si on reconnaît
l’efficace d’une place, vide, unique, c’est en la délestant de l’ima-
ginaire qui la remplissait, c’est prendre en compte cette place sans
la sacraliser : alors, on éprouve les effets – bénéfiques et non plus
terrifiants – de ce qui fait « trou » dans la structure.
Lacan ayant décrit un certain nombre de trous, il faut ici spéci-
fier que le trou dont nous parlons est celui propre à l’absence de
garantie, assignée à la formule « Il n’y a pas d’Autre de l’Autre » :
il n’y a aucune instance susceptible de prononcer un jugement
dernier. À cette place même – dans le Nœud Borroméen –, Lacan
situe la « Jouissance Autre » qualifiée souvent de féminine, celle
pour laquelle il n’y a pas de mots. À cet « il n’y a pas de mots »
pour la jouissance féminine, adjoignons la donnée suivante : dans
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
le champ symbolique où lalangue inscrit un savoir, il y a aussi
un trou constitué par l’inscription définitive d’un trait qui ne sera
jamais représenté, irréductible à tout processus de symbolisation.
Ce trait unique, non symbolisable, a été pensé comme le fonde-
ment même de la symbolisation, qu’il amorce. Dans sa langue
borroméenne, Lacan assimile ce trait à une « Droite Infinie »
(venant à la place de l’einziger Zug freudien), et il dit que ce trait
« a pour vertu d’avoir le trou tout autour. C’est le support le plus
simple du trou 1 ».
Comment donc articuler ce trou du refoulement originaire,
censé affecter la chaîne signifiante d’un trait-trou qu’elle ne peut
résorber, au trou situé dans le nœud au coincement du Réel et
1. J. Lacan, Le séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Paris, Le Seuil, 2005,
p. 145.
14
Clinique lacanienne 16.indd 14 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
de l’Imaginaire où Lacan inscrit tout à la fois son « pas d’Autre
de l’Autre » et la Jouissance féminine ? S’agit-il d’un seul et
même trou ? C’est à mes yeux un problème théorique non encore
résolu.
Qu’un sujet, grâce aux effets de la fonction logique attribuée
au signifiant du Nom-du-Père – qu’il soit ou non « abonné à
l’inconscient », qu’il fasse une analyse ou pas – selon les circons-
tances, les aléas de sa vie, qu’un sujet puisse se situer par rapport
à ces trous, accueillir ce qu’ils produisent au lieu d’être menacé
par le gouffre qu’ils contiennent, induit des effets tels qu’en
vérité ils tiennent à la hauteur de leurs charges et de leurs tâches,
ces animaux de jouissance, condamnés au langage, que nous ne
pouvons pas ne pas être. Quels effets, quelles charges et quelles
tâches ? S’agirait-il d’ouvrir pour chacun la possibilité de ce qui,
par un travail acharné, ne cesse pas de se gagner : une capacité
de nommer, donc de distinguer, de sortir de la parlotte en se
risquant, dans un dire, quant à ce qui arrive ? Ce dire peut être
un écrire : c’est potentiellement, en tout cas, un faire, parce que
nommer fait coupure, sépare, crée de l’écart dans tout donné et,
par cette opération même, fait place à de nouveaux agencements
dans les discours. Ainsi, un tel dire est-il susceptible de créer
des liens ouverts à de l’inédit entre les semblables et les dissem-
blables, entre les corps et le langage, entre les humains. Nous y
reviendrons.
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
Pour l’instant, contentons-nous de souligner que Dieu dit le
Père, et pour nous, analystes en France, un Freud, un Lacan, ont
été, dans le mythe d’origine des religions monothéistes, ou dans
l’histoire de la pensée, des « nommants ». Ils ont donné nom à
ce qui demeurait dans l’imaginaire opaque, l’obscur ou le chaos.
Ils ont déplacé l’impossible, gagné du terrain sur celui souvent
distingué par Lacan comme Réel.
Nous ne sommes pas Dieu, ni Le Père, ni Freud, ni Lacan, et il
ne s’agit surtout pas de se prendre pour Dieu, ou pour Le Père, ou
pour Freud, ou pour Lacan. Cette fonction de nomination qu’on
leur a attribuée à l’origine, ou qu’ils ont si remarquablement
exercée, il s’agit de la relayer, de la reprendre à notre compte,
fut-ce pour déplacer un grain, un petit grain de sable, ou pour
préparer ce déplacement, chacun à son tour. À chacun de le faire
là où il se trouve, avec ses moyens propres, déterminés par les
15
Clinique lacanienne 16.indd 15 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
avatars de son histoire particulière, elle-même inscrite dans, et
marquée par, l’Histoire. Donc, avec les moyens du bord, car tout
le monde n’a pas les mêmes moyens. Sur ce point, comme sur
tant d’autres, la contingence est encore radicale, l’égalité, encore
nulle, l’injustice, encore absolue.
Car il y a ceux qui, en principe, sont indemnes : les trau-
matismes de l’enfance, de la rencontre avec la sexualité, ceux
qu’inflige la famille, dans ce monde tel qu’il va, avec son cortège
d’injustices sans nom, ne paraissent pas les avoir entamés.
Entendons, dans les termes les plus simples de la langue lacano-
borroméenne : pour ces sujets-là, leur support, soit le nouage
entre l’Imaginaire, le Symbolique et le Réel, paraît tenir tout seul.
Qu’ils s’aperçoivent ou pas de ce qui ne tourne pas rond en eux
ou autour d’eux, qu’ils se servent ou non des appuis imaginaires
fournis par la religion du coin, il y a là, sans doute, refoulement
réussi, possibilité de se tenir debout dans le semblant, dans la
« Vraie Semblance » qui désigne un mode d’apparaître du sujet.
Cette vraie semblance doit être distinguée du « pouvoir faire
comme si »… tout allait bien. Car le « pouvoir faire comme si »,
ancré dans la dénégation, est une position subjective fragile,
toujours menacée d’effondrement au moindre accroc. « Faire
comme si », c’est en tout cas ce à quoi nous engagent fortement
les discours idéologiques dominants. Sourire, envers et contre
tout, surtout ne pas souffrir. On fait « comme si »… tout allait
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
bien. Avec ça, avec cet idéal-là, on crée de bons consommateurs,
domestiqués, mais fragiles, on crée un ersatz de lien social, mais
qui rapporte.
Puis il y a les autres, les pas indemnes, quasiment tous, voire
tous, tant il est vrai, comme s’exprimait Lacan, en octobre 1974 à
Rome, que « l’être parlant est un animal malade » et que, « comme
être vivants, nous sommes rongés, mordus par le symptôme ».
Malades de quoi ? Malades d’un monde, d’une famille dans
lesquels nous tombons ici ou là par le plus grand des hasards.
Malades à cause du langage dont on subit la loi. Malades des
avatars d’une structure s’organisant autour de ce refoulement
originaire, ici évoqué, dont Freud, le premier, a écrit l’opération,
repensée par Lacan avec ses propres catégories et concepts.
Malades d’un ratage dans ce qui noue, singulièrement pour
chacun, le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire.
16
Clinique lacanienne 16.indd 16 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
Rappelons seulement le b.a-ba de ce que Lacan nous enseigne
sur la structure.
De ce que les vivants soient obligés d’en passer par le
« verbe », tamponne d’emblée leur jouissance de vivants au sens
où le langage la frappe de son tampon : il la constitue en impri-
mant en elle le sceau d’une perte, le sceau scellé, le trait inscrit
une fois pour toute de cette perte. À partir de quoi, fixée par des
lettres et/ou filtrée par les signifiants, cette jouissance, mortifiée,
dénaturée, se spécifie, se démultiplie autour d’un vide central,
porteur, lui, d’un « plus-de-jouir » dont Lacan a fait un objet. Un
objet inimaginable, sauf à « le briser dans ses éclats pulsionnels 2 ».
On dira donc : à cause de « a » en quoi se condense un reste de
jouissance, quelque chose échappe toujours à l’opération d’appri-
voisement de cette jouissance. Cette « tâche de civilisation » n’est
jamais toute, elle ouvre donc à la possibilité de désirer.
Freud, lui, en 1915, lorsqu’il décrivait le refoulement origi-
naire, n’utilisait pas le concept de jouissance. Il mettait en jeu
un premier refoulement, celui d’un représentant psychique de
la pulsion, exclu de toute prise en charge par la conscience. Ce
représentant, définitivement séparé de la symbolisation, impos-
sible à dire, dont l’inscription fixe un mode de plaisir pulsionnel
qui lui est désormais lié de façon inaltérable, constitue une sorte
de point abyssal. Ce point, tout à la fois, produit ce que Freud
nomme des « rejetons » et attire, voire aspire toute chaîne de
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
pensée « venue d’ailleurs », à laquelle le représentant originai-
rement refoulé tenterait de s’associer. Ces dits « rejetons » sont
eux-mêmes soumis aux refoulements secondaires, qui composent
le refoulement proprement dit. C’est donc à partir de ce matériel
où les représentations de choses et de mots – déjà liées par du
perçu (impressions du corps, sons, images, mots…) – accrochent
les pulsions, que se constituerait l’inconscient freudien. Et c’est
à travers les déplacements, désinvestissements et contre-inves-
tissements de ces « rejetons », dont certains se fixeront dans des
symptômes, que se manifeste l’inaccessibilité du point abyssal.
Retenons cette double dynamique attribuée par Freud à ce
hors champ, inaccessible à la conscience, créé par le refoulement
2. J. Lacan, Le séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973.
17
Clinique lacanienne 16.indd 17 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
originaire : d’un côté, attirer, happer, engouffrer, aspirer, de
l’autre, produire des rejetons. Ça avale et ça crache. Retenons
encore qu’en 1926, dans « Inhibition, Symptôme, Angoisse »,
Freud fait l’hypothèse qu’en assignant une cause traumatique au
refoulement originaire on pourrait le pluraliser. Il n’y en aurait
pas qu’un, mais plusieurs, effets à chaque fois de traumatismes
contingents provoqués par un trop d’excitation. Eu égard à la
question complexe du refoulement originaire, voilà sans doute
l’essentiel de ce qu’il nous fallait rappeler, pour aborder la suite.
Je dois maintenant rendre compte d’un choix, le choix de
mettre l’accent sur le Réel, celui redéployé et valorisé par Lacan,
au cours des dernières années de son enseignement : 1974, 1975,
1976…
Essentiellement conçu sous la modalité de l’impossible à
symboliser, Lacan taxe le Réel de « relié à rien », de « sans loi »,
de « hors sens » et, cependant, nous dit-il parfois, le Réel se
distingue en ceci qu’il peut faire tenir ensemble l’Imaginaire et
le Symbolique. Réel enchaînant et enchaîné donc, qu’il qualifiera
aussi bien de « tiers ». De ce Réel qu’il interroge, il dit que l’ana-
lyste a à le « contrer », à l’évider, que « le langage le mange ».
Jusqu’à sa mort, Lacan ne cessera pas de traquer le Réel, de le
« flairer », de le « suivre à la trace », comme il dit. Il veut nous
en dire un bout, il nous le présente avec son « nœud-bo », ce
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
« machin » qui ex-siste, se manie, ne se laisse pas imaginer et dont
le réel tient à la matérialité effective d’un nouage. Le nœud borro-
méen, dit-il en décembre 1974, c’est « une écriture qui supporte
un réel », formule, nous le verrons, proche parente de celle qu’on
peut appliquer au symptôme.
Parvenu au terme de son parcours, Lacan soutiendra que ce
réel qu’il invente et qui l’obsède est son symptôme à lui, ou plutôt
sa réponse symptomatique à ce qu’il repère comme un défaut
dans les constructions freudiennes. Freud a inventé l’inconscient
et il en a donné une métaphore énergétique. C’est aux yeux de
Lacan une erreur qu’il a corrigée avec « son Réel », qu’il dit donc
être « son symptôme ». Ne serait-ce pas là indiquer – ici, au cœur
même de ce qui opère et se joue de créateur dans un processus
de transmission – comment, en utilisant son symptôme, d’une
certaine manière, soit en le faisant travailler dans un champ où
18
Clinique lacanienne 16.indd 18 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
l’Autre pourra le confirmer, ou l’infirmer, on fait l’économie,
tout en s’en servant, de cela que prescrit le signifiant du Nom-du-
Père ?
Mais privilégier les ultimes articulations du Réel par Lacan
signifie qu’on fait toujours un choix dans le parcours qui sédi-
mente un concept, même si on tente de garder à l’esprit les
couches successives de cette sédimentation.
En vérité, cet accent mis sur le Réel n’est pas libre : il est
d’abord l’effet symptomatique des discours d’une époque, la
nôtre, soumise aux « effets de réel » d’une mutation extrêmement
rapide dont on commence à repérer les conséquences. Le couplet
très général est maintenant archi-connu : développement tous
azimuts de la science et de ses découvertes qui donne lieu à une
invasion gadgétique sans précédent, touchant au cœur du désir
et donc du lien entre les humains. En Occident, on fait tout pour
nous donner à croire qu’on ne manque de rien. Or, c’est de…
« rien » qu’on manque.
Par ailleurs, développement sauvage, c’est-à-dire néolibéral
du capital mondialisé, soumis à la loi d’airain du profit et de
l’argent, entraînant des flux migratoires de millions de gens
depuis les pays les plus pauvres vers les pays les plus riches.
Enfin, notons la vacillation, la perte, en tout cas pour le monde
occidental, des repères symboliques traditionnels. Ces pertes sont
loin d’être toutes regrettables, certaines sont la base de nouveaux
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
acquis dont on ne mesure pas encore l’ampleur bénéfique.
Qu’avons-nous perdu en Occident ? Disons-le plus que schéma-
tiquement : la foi dans le message chrétien, l’assise du patriarcat,
la stabilité des identités sexuelles, la domination du masculin,
l’autorité du père réel, un certain lien au travail – seule compte
la rentabilité –, à l’espace, devenu tout petit grâce au « toujours
plus vite » – nous habitons désormais un village mondial –, au
temps, tramé contradictoirement dans la dénégation de la mort…
et sa menace généralisée – nucléaire, écologique… –, induisant
l’obsession de gagner du temps, la peur d’en perdre.
Face à quoi on assiste, d’un côté, à l’inflation du judiciaire :
les députés, dans notre pays n’arrêtent pas de bricoler des lois
pour tout, et pour n’importe quoi, à toute allure, à ce point qu’il
y a aujourd’hui en cours le projet d’une loi visant à réguler la
fabrique des lois ; de l’autre, nous constatons un déploiement
19
Clinique lacanienne 16.indd 19 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
sans précédent des mesures policières, visant à assurer la sécurité
du monde riche, face à ce qui est perçu, non sans raison, comme
une menace du monde pauvre. On ne peut que penser à la fin de
l’empire romain assiégé par les barbares. Quoi qu’il en soit, nous
vivons dans la menace permanente d’un déferlement de réel lié
aux conséquences qu’engendre le capitalisme sauvage.
Ce qui vient d’être énoncé – caricaturalement – court partout.
En revanche, ce qui n’est pas encore tout à fait une ritournelle –
mais on y vient –, ce sont les conséquences subjectives et donc
les effets symptomatiques d’une telle transformation historique,
frappant la vie publique, familiale et privée de chacun.
La déferlante des psychothérapies de tout poil – les compor-
tementalistes en tête –, les interventions de l’État visant à réguler
la vie psychique de chacun, sont à ranger dans les mutations qui
viennent d’être évoquées. Plus que jamais, la psychanalyse est
un objet de haine, voué à des attaques furieuses. Preuve qu’elle
transporte quelque chose qui résiste à l’ambiance : l’idéologie
dominante exclut qu’on pense par soi-même, qu’on réfléchisse,
qu’un sujet prenne le temps de repérer ce qui le détermine et
trouve en lui les forces, tout à la fois, d’assumer et de contrer son
destin. Quant aux « nouveaux symptômes et nouvelles demandes »
– s’il y en a –, ils obligent, en tout cas, chaque psychanalyste à
repenser, en la réaffirmant, la singularité de sa pratique, cette
pratique structurée par un désir de savoir, dont les humains en
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
quête de bonheur ont horreur 3. En vérité, on sait de toujours que
les coordonnées de base, au principe de la direction de la cure,
n’excluent jamais la particularité du cas dont l’analyste répond
et auquel il s’agit pour lui à chaque fois d’inventer comment il y
répond. Aujourd’hui, les analystes ne sont-ils pas tout particuliè-
rement convoqués à rendre compte de ce à quoi tient leur acte, et
comment ils sont amenés à prendre en charge ceux qui se présen-
tent, si tant est que l’idéologie dominante s’acharne à dévoyer
la psychanalyse de sa singularité quant à ce qu’elle nous dit du
rapport de l’homme au désir ?
3. Relire à cet effet la « Note italienne », dans J. Lacan, Autres Écrits, Paris, Le
Seuil, 2001.
20
Clinique lacanienne 16.indd 20 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
Quoi qu’il en soit des « errances » actuelles, du recours de
plus en plus fréquent aux drogues, de l’invasion du dépressif,
de l’anorexique, des violences à l’école pouvant aller jusqu’au
meurtre, des taux en hausse de suicide, etc., tous symptômes qui
peuvent échouer, un à un, chez l’analyste, on peut donc dire de
notre époque que cette vacillation accélérée des repères symbo-
liques traditionnels qu’elle traverse est singulièrement marquée
par le Réel : derrière nous, au cœur des gigantesques boucheries
des deux grandes guerres, le Réel monstrueux, absolu parce
que programmé, de la destruction des Juifs d’Europe et, devant
nous, ce réel annoncé qui compose l’inimaginable d’un futur
terrifiant. Si cette menace existe pour tous comme pour chacun,
on peut comprendre pourquoi l’homme contemporain se réfugie
dans un présent sans pensée : à l’effondrement de la promesse
communiste des lendemains qui chantent s’est substitué le spectre
d’un monde en train de devenir trop chaud, où on ne pourra plus
respirer, où les espèces disparaissent, monde livré aux caprices
des détenteurs de bombe atomique, monde somme toute en voie
de destruction par la capacité généralisée, propre à l’humain, de
pouvoir détruire, et lui-même et ce qui le porte.
Est-ce là ce Réel dont, nous prévient Lacan, dépendrait
l’avenir de la psychanalyse ? Oui et non. Oui, parce qu’à supposer
que rien ne parvienne à le contrer, elle disparaîtrait comme tout le
reste. Non, parce que du réel en jeu sur son propre terrain, d’une
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
certaine manière, aujourd’hui, la psychanalyse en vit. C’est là
l’idée avancée par Lacan. La psychanalyse aurait encore quelques
beaux jours devant elle, si tant est qu’elle échoue, par son acte
singulier, justement à « contrer » le sans-loi et le hors-sens du
Réel. Mais, si elle réussissait, elle fournirait la preuve qu’on peut
se passer du Nom-du-Père tout en s’en servant. À moins, suggère
encore Lacan, que le traitement spécifique de la question du sens
par la psychanalyse ne survive pas à « l’increvable » ressource du
religieux, capable de faire sens et image de tout bois.
Ce que je viens d’évoquer peut paraître détour inutile. C’est
cependant le contexte dans lequel on soutiendra que la question
du « se passer du Nom-du-Père à condition de s’en servir » est une
question de notre temps. C’est une question posée à ce qu’il en est
d’un agir collectif et donc d’une pensée politique, aujourd’hui. Et
à ce titre, elle nous interroge.
21
Clinique lacanienne 16.indd 21 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
Pour subsumer la question posée par le titre de ce travail, nous
avons convoqué la fonction de la place vide lestée d’imaginaire,
le trou du refoulement originaire, celui de la Jouissance féminine,
pas-toute, où s’inscrirait le « pas d’Autre de l’Autre », la capacité
de nommer, le Réel du dernier Lacan, réel articulé dans la struc-
ture et à la conjoncture mondiale actuelle. Convoquons mainte-
nant trois autres « matériaux » : la fonction du symptôme, celle
justement du Nom-du-Père, et le nœud borroméen. Ce dont il
s’agit s’en trouvera-t-il quelque peu éclairé ?
Rappelons d’abord que les symptômes ont une structure
double : comme fruits masqués des refoulements qui n’ont pas
entièrement réussi, ils transportent une satisfaction pulsionnelle
venue à la place de celle qui fut interdite : Lacan dira une « jouis-
sance », certes, édulcorée, « tronquée », « à l’envers », mais dont le
sujet va faire son régal ambigu, le soutien de sa vie, cela qui lui
donne une identité. Et dans la même foulée, les symptômes véhi-
culent un texte-signe, signe d’une signification qui fait toujours
énigme pour celui qui se croit n’en être que la proie. Mixte d’un
réel hors-texte et d’un texte, le symptôme se donne comme l’ex-
pression insistante de ce qui a été mal refoulé. C’est un texte qui
véhicule du réel.
Lacan finira par écrire le symptôme comme une fonction de
la jouissance arrimée à une lettre, un x, assimilé à n’importe quel
élément de l’inconscient, mais localisé, inscrit hors-chaîne, et
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
donc hors-sens, lettre, « littorale » de faire pont entre jouissance et
signifiant, lettre, en fin de compte, pur objet de jouissance, voire
jouissance fixée.
Si le symptôme fonctionne tout seul comme retour insistant
d’une jouissance refoulée devenue méconnaissable, n’oublions
pas la teneur du message affiché autant que retenu dont est porteur
le symptôme, dès lors qu’un sujet se met en quête de l’adresser.
Il dit, en gros, que « ça ne va pas », qu’il ne peut pas se retrouver
dans ses comptes, qu’il y a là étrange entrave (Freud l’appelle
inhibition, Lacan parlera du Réel qui « se met en travers »), souf-
france inutile, dépense vaine de temps et d’énergie, impossibilité
d’agir, etc. Il étale l’inhibition, l’inconvénient, l’empêchement,
il cache ce que ces inconvénients, parfois terribles, contiennent :
une jouissance qui, d’être mise à mal par le langage, proteste
et fait appel. En vérité, cette jouissance au cœur du symptôme
22
Clinique lacanienne 16.indd 22 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
objecte à la loi phallique, inscrite au cœur du rapport sexuel qu’il
n’y a pas.
Sans entrer ici dans la considération des types de symptômes
propres aux névroses, psychoses, perversions et autres structures
psychiques éventuellement produites par notre époque, disons
qu’il y a pour chacun, selon les failles, les traumas, les conjonc-
tures signifiantes (générationnelles, familiales et sociales), des
refoulements et des retours du refoulé – plus ou moins réussis,
plus ou moins ratés – propres à chaque histoire, à chaque trauma-
tisme, à chaque rencontre avec le sexuel.
Le symptôme : une manière singulière qu’aurait la jouissance
de ne pas se résoudre à ce qu’on pourrait appeler les effets de la
dictature de l’ordre symbolique, une sorte de plaidoirie pour un
tort subi, qui ne cesserait pas, portée par une nécessaire poussée,
d’inscrire à tout prix dans cet ordre, et selon les lois de cet ordre,
un bout de son message. Lacan ne disait-il pas en 1974 que le
symptôme, c’est « ce qui ne cesse pas de s’écrire du Réel » ? Si le
Réel a été défini sous la modalité de l’impossible, comme ce qui
ne cesse pas de ne pas s’écrire, alors, par le symptôme s’écrirait
quelque chose de ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. Autre
définition lacanienne : le symptôme est « la manifestation du Réel
à notre niveau d’êtres vivants ». Comment traiter cette voie très
étroite d’accès au Réel ?
C’est bien là tout le problème si tant est – hypothèse du
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
dernier Lacan – que parvenir à se servir du symptôme pourrait
délivrer du recours au Nom-du-Père. Oui, mais sous quelles
astreintes ? Savoir faire usage de son symptôme nécessite quelles
conditions ?
Que Lacan nous a-t-il proposé quand il a inventé le signifiant
« Nom-du-Père » ?
Une remarque, d’abord. Ce signifiant ne doit pas être confondu
avec les pères « tout venant 4 », ceux, presque jamais à la hauteur
de leur fonction symbolique par laquelle se transmet la significa-
tion phallique, pères vecteurs d’un Réel qui paralyse et détruit,
lorsqu’ils battent, tuent, violent, commettent l’inceste, pères fixés
dans l’imaginaire. Ces pères que je dirai charnels, en quelque
4. J. Lacan, Le séminaire, L’identification, inédit, séance du 7 mars 1962.
23
Clinique lacanienne 16.indd 23 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
sorte, laissés à leurs propres forces, si tant est que les mutations
dont nous parlions leur ont enlevé les appuis symboliques d’où
ils tiraient la légitimité de leur pouvoir, c’est bien ces pères-là
auxquels nous avons affaire tous les jours, que nous aimons,
que nous idéalisons, que nous haïssons, que nous méprisons. Ils
sont là, dans leur fragilité même, ils veillent comme ils peuvent,
vaille que vaille : chacun, chacune a un père et se débrouille plus
ou moins mal, non sans dégâts, avec lui, toujours plus ou moins
carent, mais, comme le remarque Lacan, cette carence n’induit
pas nécessairement celle du Père comme signifiant.
Car le Nom-du-Père est un signifiant et ce signifiant a une
fonction. Pour l’aborder, allons droit à la fameuse phrase de
Lacan en 1958 : « Le Nom du Père, c’est-à-dire le signifiant qui
dans l’Autre, en tant que lieu du signifiant, est le signifiant de
l’Autre en tant que lieu de la loi 5. » C’est donc un élément de la
chaîne signifiante, chargé de représenter cette chaîne comme lieu
de la loi. Le Nom-du-Père signifie que le Symbolique, c’est la
loi. Lorsque Lacan introduit la métaphore paternelle, il énoncera
que le Nom-du-Père, se substituant au désir de la mère, est ce
signifiant qui, dans la parole de la mère, réfère à l’autorité d’une
loi autre que la sienne : la loi phallique. Posé en tiers, ce signifiant
introduirait au manque et, donc, au désir, par l’inscription du
phallus comme signifiant du désir de la mère. Il commanderait
la séparation d’avec la mère-toute, dont la jouissance se trouve
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
frappée d’interdit.
D’entrée de jeu, on peut penser, comme d’ailleurs beaucoup
d’analystes lacaniens le pensent, que la seule dialectique Langage/
Parole contient cette loi interdictrice assignée au Nom-du-Père.
C’est la parole, prise dans les lois du langage, qui fait interdic-
tion, c’est par elle que l’objet est perdu. Lacan l’a épinglée avec
ses propres concepts : « Ce à quoi il faut se tenir c’est que la
jouissance est interdite à qui parle comme tel, ou encore qu’elle
ne puisse être dite qu’entre les lignes pour quiconque est sujet
de la Loi, puisque la Loi se fonde de cette interdiction même 6. »
Cependant, il semble qu’en 1960, Lacan ne confondait pas les
5. J. Lacan, « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la
psychose », Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 583.
6. J. Lacan, Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 821.
24
Clinique lacanienne 16.indd 24 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
deux interdits, si tant est que l’un, celui porté sur la jouissance
par la parole, est mis au fondement de l’autre, celui, opéré par le
Nom-du-Père quant à l’interdit de l’inceste, ouvrant à la possibi-
lité de désirer.
Si le Nom-du-Père s’inscrit comme signifiant en lieu et place
du désir de la mère, il sert donc à garantir une loi qui sépare de
la jouissance de la mère, il sort l’enfant de son enfermement dans
un-jouir-d’elle-qui-jouit-de-lui, si je puis dire.
Voyons enfin ce qui se profile avec le nouage borroméen des
trois instances du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire.
Une remarque d’abord : après le séminaire interrompu en
1963, qui pluralisait le Nom-du-Père et donc les supports de sa
fonction, il aura fallu dix années (au cours desquelles, d’ailleurs,
Lacan ne cesse d’évoquer cette interruption) pour que ressurgisse,
avec le « Nœud Bo », le thème d’un Nom-du-Père qui ne serait pas
un signifiant indispensable. Les formulations de Lacan sont, à cet
égard, extrêmement prudentes, contournées. Par exemple : « Ce
n’est pas parce que ce serait indispensable et que je dis là-contre
que ça pourrait être controuvé que ça l’est en fait toujours 7 ! »,
foutus comme vous êtes – là, je paraphrase une de ses innom-
brables adresses à son auditoire – d’être encore suspendus à vos
pères, vous ne pouvez pas encore vous en passer 8.
Donc, les nœuds, supports de chaque sujet, risquent toujours
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
de se dénouer : il faut encore du Nom-du-Père, c’est-à-dire
un quatrième rond, pour faire en sorte que ça ait l’air de tenir
ensemble : du Nom-du-Père ou de l’Œdipe, sans qui « rien ne
tient ».
Avec la métaphore paternelle, nous l’avons vu, le signifiant
Nom-du-Père liait le désir de la mère à la signification du phallus,
la loi au désir. Avec le nœud, le Nom-du-Père lie l’Imaginaire,
le Symbolique, et le Réel. Mais il ne fait pas que les lier, il opère
leur distinction du fait que, dans sa fonction, le père comme
nom, nommé par la mère, se trouve ici enrichi d’un pouvoir :
celui de nommer. En tant qu’il donne nom, il est le père du nom.
Ainsi, matérialisé dans un 4e rond qui, de l’extérieur, viendrait
7. J. Lacan, RSI, séminaire inédit, séance du 11 février 1975.
8. Ibid.
25
Clinique lacanienne 16.indd 25 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
nouer les trois ronds, cette quatrième consistance, nommante
et nouante, cet un-en-plus, est déclaré être la solution de Freud.
Cette solution suppose que les trois ronds sont dénoués, ou plutôt
en mal de nouage, sous le coup d’une faute dans ce qui fut noué,
appelant réparation par une quatrième instance.
À cette solution freudienne, Lacan opposerait donc « sa »
solution. Mais laquelle ?
En fait, il faudrait dire lesquelles car il y en a deux, me
semble-t-il. D’une part, la solution du nœud à trois qui tient tout
seul, c’est-à-dire sans l’ajout d’un quatrième. Le « donner-nom »
fait partie du Symbolique et le nouage consiste dans la seule
relation des trois ronds. Le nœud à lui seul devient une écriture
qui donne une loi. C’est une loi-cadre pour le Réel.
L’autre solution conserve la structure du nœud à quatre – celle
qui suppose une erreur dans le nœud à trois, telle que ces trois
risquent de partir à la dérive, de se confondre, de se continuer l’un
dans l’autre, mais c’est le symptôme qui fait ici nouage, et non
plus le Nom-du-Père, au point que le père est lui-même taxé d’être
un symptôme : « Je dis qu’il faut supposer tétradique ce qui fait
le lien borroméen – que perversion ne veut dire que version vers
le père – qu’en somme le père est un symptôme, ou un sinthome,
comme vous voudrez. Poser le lien énigmatique de l’I, du S, et du
R implique ou suppose l’ex-sistence du symptôme 9. »
Il y a là un dire que Lacan estampille par un « Je dis que. »
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
Pour qu’il y ait nouage, il faudrait donc du symptôme, ou encore
du sinthome, ce que le père est déclaré être. Lacan passe ici
du signifiant « père » au signifiant « symptôme » redoublé par
le signifiant « sinthome » : ces deux signifiants sont articulés à
l’être du père. Si la loi s’avère être de l’ordre de ce qui fait tenir
ensemble, cela qui noue, alors on peut soutenir que le symptôme
fait office de loi.
Avant de questionner le sinthome, restons un instant au niveau
de la cure analytique dont Lacan, l’année suivant le séminaire
sur Joyce, présente la fin en terme de « savoir y faire avec son
symptôme ». Savoir le débrouiller, savoir le manipuler, l’ex-
ploiter. Je dirai savoir en tirer parti. Savoir s’en servir. En faire
9. J. Lacan, Le sinthome, op. cit., p. 19.
26
Clinique lacanienne 16.indd 26 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
bon usage. S’identifier au symptôme, oui, mais en « prenant ses
garanties, une espèce de distance » dit Lacan 10. Ce qui indique,
au minimum, qu’un sujet n’est plus la seule proie passive de son
symptôme, de la jouissance qu’il draine, mais qu’il peut y inter-
venir, y faire coupure, l’exploiter en utilisant l’énergie libidinale
qu’il retenait.
« Je le vois venir celui-là et je me mets à rire de lui » me
confiait une jeune femme qui ne pouvait rien entreprendre vu
qu’à chaque occasion elle était obligée de penser qu’elle était un
zéro absolu, une nulle, et que la vie ne valait pas la peine d’être
vécue. Si bien qu’être amoureuse et travailler lui étaient inter-
dits. Qu’à la suite d’un rêve, elle puisse enfin mener à bien son
doctorat dans une sorte d’allégresse et d’énergie dont elle n’avait
pas idée, n’empêche pas, jusqu’à nouvel ordre, « le murmure en
elle du néant », comme elle dit, entraînant la « glaciation » – c’est
son mot – qui frappe son corps dès qu’un garçon la regarde. Un
symptôme s’épuise, une inhibition tombe, une activité se libère,
une jouissance se transforme, mais un autre symptôme subsiste.
Le travail analytique se poursuit qui procède dans la parole, non
par le don d’une signification, mais par l’équivoque qui abolit le
sens tout en suggérant qu’il y a des sens possibles et qu’on peut
leur laisser faire leur chemin sans les fixer, c’est comme ça qu’ils
opèrent. Une équivoque, si elle touche juste dans le jeu serré des
signifiants, le remanie, peut du même coup libérer un sujet de
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
cette jouissance opaque, qui, dans son symptôme, le contraignait
à une aveugle répétition.
En psychanalyse, le traitement du symptôme, de la jouissance
qu’il enferme, passe par le « j’ouis sens », qui n’est pas don du
sens mais écoute passant par le long, patient travail sur le signi-
fiant, susceptible de délivrer des effets de signifié. Ce sont là des
effets de vérité, toujours dite à moitié. Mais à la fin de l’analyse,
Lacan pour qui il y a toujours, pour part, du symptôme, du pas-
tombé, propre à chacun, prônerait donc « un savoir faire » avec
cela qui reste d’un symptôme transformé, voire réduit : il s’agirait
de pouvoir manier le réel de la jouissance, l’imaginaire du corps,
le symbolique de la chaîne signifiante, noués par le symptôme,
10. J. Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, séminaire inédit,
séance du 16 novembre 1976.
27
Clinique lacanienne 16.indd 27 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
en sorte qu’on puisse faire, avec « ça », quelque chose. Ce n’est
pas nécessairement une œuvre d’art, c’est ce « quelque chose » où
cependant se fait entendre, face à l’ordre établi, cette insoumis-
sion rebelle de la jouissance évoquée précédemment.
Quelques remarques enfin sur le Sinthome.
Partons avec Lacan de l’écriture joycienne qui culmine dans
cette attaque de la langue anglaise de façon telle que cette langue
– celle des oppresseurs catholiques et anglais – n’existe plus
comme telle. À lire Finnegans Wake, ce qui passe au lecteur, ce
qui le saisit, ce n’est pas le sens qu’il y aurait – car il n’y en a pas
– ou plutôt il n’y en a pas d’autre que la jouissance en jeu dans
ce type d’écriture : ce qui passe au lecteur, ce n’est pas le sens,
c’est la jouissance. C’est donc une écriture qui, comme le suggère
Lacan, « vient d’ailleurs que du signifiant ». Nous pensons qu’elle
se soutient du trou du refoulement originaire que nous avons
évoqué. L’écriture de Joyce s’ancre là à partir de ce que crache
ce trou. Elle va faire artifice, feu d’artifice avec un écrit compo-
sant les translittérations, les homophonies, les ressources de
lettres et de sons de plusieurs langues démantelées. Cette écriture
sinthomatique écrit quelque chose du réel, en effet, car elle ne
passe pas par les signifiants de l’inconscient. C’est pourquoi,
dit Lacan, on peut affirmer qu’elle vise la vérité du symptôme,
qu’elle en montre l’essence, s’il est vrai qu’en son fond, la vérité
du symptôme est de sonder la loi du langage, avec une jouissance
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
qui refuse d’en pâtir.
C’est avec cette écriture-là que Joyce entreprend de parer à
la faute du père, qu’il la répare, c’est-à-dire qu’il fabrique une
œuvre et, la fabriquant, toujours très encadrée, bourrée d’énigmes
pour ceux qui s’attelleront à les déchiffrer, il se donne ce que son
père ne lui a pas donné : un nom, une loi, la castration, le phallus.
Ceci est maintenant classique : le sinthome comme suppléance
qui permet de nouer ce qui ne le fut pas, le sinthome créateur à
partir du symptôme, qui répare un ratage. Il y faudrait, paraît-il,
un ego spécial, un ego délesté de ses affects, ce qui serait le cas de
Joyce, maître d’œuvre, capable de corriger – en construisant pas à
pas, mot à mot, phrase après phrase, cette œuvre écrite – l’erreur
paternelle commise à son endroit.
L’intérêt pour notre propos, c’est que Lacan va baptiser le
Nom-du-Père, sinthome. Sans le père comme élément quart, pas
28
Clinique lacanienne 16.indd 28 1/12/09 9:47:05
À CONDITION DE S’EN SERVIR ?
de nœud possible, dit-il. Mais, je cite, « il y a une autre façon de
l’appeler. C’est là que ce qu’il en est du Nom du Père, au degré où
Joyce en témoigne, je le coiffe aujourd’hui de ce qu’il convient
d’appeler le sinthome 11 ». Le sinthome sera donc un nom pour le
Nom-du-Père : il opère à la place du Nom-du-Père. Le sinthome
fait loi pour la jouissance en lui donnant forme, au plus près
des rejetons qu’elle produit, au plus près des traces non encore
effacées par le signifiant, que Joyce traite à sa manière, en créant
ses propres « contre-investissements ». Mais, remarquons-le,
ce qu’on peut dire être une « nomination dans le réel » est une
solution singulière à Joyce, pas à la portée de tout le monde.
Du Nœud Borroméen, Lacan, dans RSI, ne s’était pas privé
de déclarer que ses trois ronds, dont il faut faire nœud, sont des
Noms du Père. Cela veut-il dire que dans l’espace de chacun des
ronds, liés aux deux autres, une nomination est possible ? On
revient alors aux considérations sur la nomination imaginaire,
symbolique, et réelle. Mais il y a plus : Lacan fait plusieurs fois
allusion, reprenant à Joyce un lapsus calami qu’il ne corrige pas,
à la parenté qu’il y a entre son « Nœud Bo » et « le mont Neubo
où la loi nous fut donnée 12 ». Qu’importe l’erreur laissée telle
quelle ! Il s’agit de suggérer que le Nœud Borroméen donne la
loi, est un nouveau lieu pour la loi, en quoi, dit-il peu après, de
devoir se nouer au Corps, à l’Inconscient et au Réel, le symptôme
« rencontre ses limites ». Mais ce nœud qui fait limite, ce nœud
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
qui donne loi, Lacan nous invite à le manier avec nos mains, à le
mettre à plat, à l’écrire, à le dénouer et à le renouer, à voir où ça
pèche quand ça se défait. Le nœud, ça sert, « ça peut vous rendre
service autant que la distinction du Réel, du Symbolique et de
l’Imaginaire » dit Lacan en 1974, à Rome. Et ailleurs, en train de
pister le Réel, il clame : « Ça permet de vous familiariser avec le
refoulement originaire. » Il a rencontré le nœud, une aubaine, une
« bague au doigt ». Il ira jusqu’à soutenir, parfois, que le nœud,
c’est le refoulement originaire.
En vérité, si le symptôme est censé faire nouage singulier du
Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel, tout comme le signifiant
du Nom-du-Père, alors le recours au nœud ne serait-il pas le « à
11. J. Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, op. cit., p. 167.
12. Ibid., p. 150.
29
Clinique lacanienne 16.indd 29 1/12/09 9:47:05
LA CLINIQUE LACANIENNE N° 16
condition de s’en servir », comme le suggérait Elahé Covindas-
samy, psychanalyste, avec qui je discutais de la chose ? Si on
se sert du nœud, on le fait à partir du symptôme mis au travail,
débrouillé et transformé, que ce soit en analyse ou dans quelque
autre processus. Alors, un sujet peut « faire avec » les forces en jeu
dans le symptôme, les manipuler mais, comme nous l’avons déjà
signalé, « en prenant ses garanties, une espèce de distance » : il
distingue singulièrement et enlace singulièrement, selon la singu-
larité de son symptôme, le Réel, le Symbolique, et l’Imaginaire,
dans leur équivalence. Le nœud noué par le symptôme serait-il la
réponse lacanienne au père freudien ? Peut-on soutenir qu’avec le
maniement de ce nœud, on se passe du Nom-du-Père et on s’en
sert ? On se sert du Nom-du-Père, on s’en passe « aussi bien », en
se servant d’un symptôme devenu sinthome, qui fait nœud.
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
© Érès | Téléchargé le 23/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 46.193.66.99)
Clinique lacanienne 16.indd 30 1/12/09 9:47:05
Vous aimerez peut-être aussi
- Reich Wilhelm - La Psychologie de Masse Du FascismeDocument553 pagesReich Wilhelm - La Psychologie de Masse Du Fascismesandayu100% (2)
- La Clinique Differentielle Des PsychosesDocument27 pagesLa Clinique Differentielle Des Psychosesdorotheejambon100% (1)
- Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires: Prévenir, agir, réagirD'EverandPrévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires: Prévenir, agir, réagirPas encore d'évaluation
- Le SurréalismeDocument22 pagesLe SurréalismemarialPas encore d'évaluation
- Leph 072 0193Document23 pagesLeph 072 0193Dominique DemartiniPas encore d'évaluation
- LRL 112 0019Document3 pagesLRL 112 0019Sira B DialloPas encore d'évaluation
- Dec Walle 2009 01 0121Document22 pagesDec Walle 2009 01 0121pablo aravenaPas encore d'évaluation
- Le Tropisme de La Polémique Et La Précarité Du Débat: Spirale Spirale Érès ÉrèsDocument5 pagesLe Tropisme de La Polémique Et La Précarité Du Débat: Spirale Spirale Érès ÉrèsShaima AfandiPas encore d'évaluation
- Le Nœud Borroméen Et La Question de La Folie. Ce Qui S'apprend de JoyceDocument11 pagesLe Nœud Borroméen Et La Question de La Folie. Ce Qui S'apprend de Joycelafaucheuse307Pas encore d'évaluation
- CM 089 0007Document15 pagesCM 089 0007OumassiPas encore d'évaluation
- Herm 002 0226 PDFDocument13 pagesHerm 002 0226 PDFJeanPas encore d'évaluation
- Téléologie Universelle HusserlDocument34 pagesTéléologie Universelle Husserlmarie TellecheaPas encore d'évaluation
- Les Bébés Et Les Écrans: Spirale Spirale Érès ÉrèsDocument4 pagesLes Bébés Et Les Écrans: Spirale Spirale Érès ÉrèsShaima AfandiPas encore d'évaluation
- Cpsy 052 0005Document3 pagesCpsy 052 0005Dominique DemartiniPas encore d'évaluation
- Cadre, Jeu Et Indication Au PsychodrameDocument9 pagesCadre, Jeu Et Indication Au Psychodramejadejeanne012Pas encore d'évaluation
- Trans 148 0093Document27 pagesTrans 148 0093AimeraudePas encore d'évaluation
- Enje 006 0023Document15 pagesEnje 006 0023kexifec743Pas encore d'évaluation
- 8 - L'experience Du Vivant Sensoriel: Les Racines de L'etreDocument6 pages8 - L'experience Du Vivant Sensoriel: Les Racines de L'etrelea.delestPas encore d'évaluation
- 10 - IntroductionDocument4 pages10 - Introductionlea.delestPas encore d'évaluation
- Leph 014 0439Document15 pagesLeph 014 0439koffikonaneric299Pas encore d'évaluation
- NRP 019 0079Document15 pagesNRP 019 0079gafsiPas encore d'évaluation
- SR 023 0067Document17 pagesSR 023 0067lucngoie2017Pas encore d'évaluation
- La Sagna PH, Laurent E. Penser Avec Son Âme, Parler Avec Son Corps (2016)Document8 pagesLa Sagna PH, Laurent E. Penser Avec Son Âme, Parler Avec Son Corps (2016)Emmanuel Manolis KosadinosPas encore d'évaluation
- COMMU - Rêves de Confins. Esquisses Sur La Vie Onirique Au Temps Du Covid-19 Et Du ConfinementDocument18 pagesCOMMU - Rêves de Confins. Esquisses Sur La Vie Onirique Au Temps Du Covid-19 Et Du Confinementfeten baccarPas encore d'évaluation
- MazzerismeDocument14 pagesMazzerismeMauvePas encore d'évaluation
- Cla 017 0033Document13 pagesCla 017 0033Lorena BarajasPas encore d'évaluation
- Dia 155 0027Document15 pagesDia 155 0027moulinPas encore d'évaluation
- Introduction - La Subsitance Au QuotidienDocument29 pagesIntroduction - La Subsitance Au Quotidienelisa.domenPas encore d'évaluation
- Temoins Et TemoignagesDocument11 pagesTemoins Et TemoignagesLorena BarajasPas encore d'évaluation
- Chapitre 8 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitaireDocument18 pagesChapitre 8 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitairerazafindrakotoPas encore d'évaluation
- Jean-Christophe Bailly - "Connaissance Par Les Traces. Pour Une Ichnologie Généralisée"Document14 pagesJean-Christophe Bailly - "Connaissance Par Les Traces. Pour Une Ichnologie Généralisée"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitaireDocument18 pagesChapitre 3 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitairerazafindrakotoPas encore d'évaluation
- Chapitre 9 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitaireDocument15 pagesChapitre 9 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitairerazafindrakotoPas encore d'évaluation
- RFP 674 1263Document23 pagesRFP 674 1263elmakhloufikaoutar2Pas encore d'évaluation
- Cohe 180 0055Document5 pagesCohe 180 0055Hajer ChamsseddinePas encore d'évaluation
- Houzel Fonction ContenanDocument17 pagesHouzel Fonction ContenanjcdewittPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitaireDocument20 pagesChapitre 5 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitairerazafindrakotoPas encore d'évaluation
- Dec Hirig 2019 01 0093Document28 pagesDec Hirig 2019 01 0093jadejeanne012Pas encore d'évaluation
- Laganiere2003 - Ttachement Prématurité Et Perceptions MaternelleDocument18 pagesLaganiere2003 - Ttachement Prématurité Et Perceptions MaternelleMichael GuillienPas encore d'évaluation
- Donner L'amourDocument21 pagesDonner L'amourcomePas encore d'évaluation
- 9 - Aux Confins de L'histoire Du Corps: Un Environnement Humain Et Non HumainDocument13 pages9 - Aux Confins de L'histoire Du Corps: Un Environnement Humain Et Non Humainlea.delestPas encore d'évaluation
- Carte Scolaire Et Clubbisation Des Petites Communes Périurbaines PDFDocument29 pagesCarte Scolaire Et Clubbisation Des Petites Communes Périurbaines PDFElie BretonPas encore d'évaluation
- Alexis Pauline Gumbs, L'amour À Une Échelle... (Poème)Document3 pagesAlexis Pauline Gumbs, L'amour À Une Échelle... (Poème)Emma BigéPas encore d'évaluation
- Le Mal en Ce Jardin... Nathalène Isnard-DavezacDocument9 pagesLe Mal en Ce Jardin... Nathalène Isnard-DavezacJndPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitaireDocument19 pagesChapitre 6 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitairerazafindrakotoPas encore d'évaluation
- Dec Walle 2009 01 0005Document7 pagesDec Walle 2009 01 0005pablo aravenaPas encore d'évaluation
- Puf Citot 2022 01 0475Document9 pagesPuf Citot 2022 01 0475Stephane VinoloPas encore d'évaluation
- Descola, Humain, Trop HumainDocument18 pagesDescola, Humain, Trop HumainAsialiga MovistarPas encore d'évaluation
- Derrida VéritéDocument19 pagesDerrida VéritéEmmanuel Roche-PitardPas encore d'évaluation
- 7 - Le Paradoxe de La DetenteDocument6 pages7 - Le Paradoxe de La Detentelea.delestPas encore d'évaluation
- Parle de Totem Et TabouDocument11 pagesParle de Totem Et TabouessaidikhadijaPas encore d'évaluation
- Rdes 041 0082Document15 pagesRdes 041 0082pablo aravenaPas encore d'évaluation
- Cite 042 0127Document64 pagesCite 042 0127lantamedominiquePas encore d'évaluation
- LCN 142 0155Document25 pagesLCN 142 0155Marc JacquinetPas encore d'évaluation
- Difa 010 0181Document12 pagesDifa 010 0181moulinPas encore d'évaluation
- DSS 134 0603Document21 pagesDSS 134 0603dramah.ormeauxPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitaireDocument13 pagesChapitre 2 - Le Secours Populaire Français 1945-2000 Du Communisme À L'humanitairerazafindrakotoPas encore d'évaluation
- Se Passer Du PèreDocument19 pagesSe Passer Du PèreElisangelaPas encore d'évaluation
- Dia 155 0049Document20 pagesDia 155 0049moulinPas encore d'évaluation
- L'institution Familiale Et L'inceste: Théorie Et PratiqueDocument6 pagesL'institution Familiale Et L'inceste: Théorie Et PratiqueFlora CarrasqueiraPas encore d'évaluation
- Dio 205 0136Document17 pagesDio 205 0136collassamuel7Pas encore d'évaluation
- Autr 018 0017Document21 pagesAutr 018 0017Safaa AraibaPas encore d'évaluation
- Enfants KANAKDocument34 pagesEnfants KANAKsandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation
- LE LIVRE DU CA GEORG GRODDECK 359 Pages 1,1 Mo PDFDocument359 pagesLE LIVRE DU CA GEORG GRODDECK 359 Pages 1,1 Mo PDFGuettabyPas encore d'évaluation
- Chap1 MingantDocument17 pagesChap1 MingantetiennePas encore d'évaluation
- .EpubDocument42 pages.EpubMarcel K100% (1)
- Entretien Avec Henri Meschonnic. Propos Receuillis Par Antoine Jockey.Document15 pagesEntretien Avec Henri Meschonnic. Propos Receuillis Par Antoine Jockey.Anonymous ApuVKN8iTGPas encore d'évaluation
- BONETTI Michel TexteDocument18 pagesBONETTI Michel TexteLaura NguyenPas encore d'évaluation
- Construction Et Dynamique de La Vie PsychiqueDocument24 pagesConstruction Et Dynamique de La Vie PsychiqueAlex ScarletPas encore d'évaluation
- (Collectif) - L'insittution en Héritage - Mythes de Fondation, Transmissions, transformation-ESSAIDocument184 pages(Collectif) - L'insittution en Héritage - Mythes de Fondation, Transmissions, transformation-ESSAIm4ntr4Pas encore d'évaluation
- 023Document59 pages023Ptrc Lbr LpPas encore d'évaluation
- Reel Lacan AngrandDocument15 pagesReel Lacan Angrandfranciscoperso.bePas encore d'évaluation
- L' ÉgoDocument4 pagesL' Égoclaro legerPas encore d'évaluation
- LCRIM2103 II 1 Approche FreudienneDocument39 pagesLCRIM2103 II 1 Approche FreudienneAna MíriaPas encore d'évaluation
- InconscientDocument8 pagesInconscientmzt5z6mpdcPas encore d'évaluation
- Le Délire de La Gradiva FreudDocument20 pagesLe Délire de La Gradiva FreudSophie BELIARDPas encore d'évaluation
- T Phi Anc 925403337 PDFDocument5 pagesT Phi Anc 925403337 PDFNoémie CornPas encore d'évaluation
- LA CLINIQUE LACANIENNE JACQUES-ALAIN MILLER COURS DU 18 NOVEMBRE 1981 (Xxiii, Xxiv)Document26 pagesLA CLINIQUE LACANIENNE JACQUES-ALAIN MILLER COURS DU 18 NOVEMBRE 1981 (Xxiii, Xxiv)teofargPas encore d'évaluation
- Philosophie TL Cours ImportantDocument51 pagesPhilosophie TL Cours ImportantahmadissakhatirPas encore d'évaluation
- Car La Vie Nest Que PassagesDocument3 pagesCar La Vie Nest Que PassagesMonica MotPas encore d'évaluation
- Résistance (Psychanalyse)Document3 pagesRésistance (Psychanalyse)erutircePas encore d'évaluation
- IntroductionDocument8 pagesIntroductionhzzianiPas encore d'évaluation
- La Tyrannie Du Paraitre Faut-Il - Bonnet, Gerard..WAWACITY - Ec..Document223 pagesLa Tyrannie Du Paraitre Faut-Il - Bonnet, Gerard..WAWACITY - Ec..Kintaro OePas encore d'évaluation
- F Benslama-Saut ÉpiqueDocument4 pagesF Benslama-Saut Épiquefernando barriosPas encore d'évaluation
- Lacan Cotidiano 694Document37 pagesLacan Cotidiano 694Paz SobrinoPas encore d'évaluation
- Trois Essais Sur La Théorie SexuelleDocument8 pagesTrois Essais Sur La Théorie SexuelleNoémie La'Pas encore d'évaluation
- 08 - Cours 8Document18 pages08 - Cours 8July JamainPas encore d'évaluation
- Le Stade Du Miroir (J.lacan, 1949)Document4 pagesLe Stade Du Miroir (J.lacan, 1949)Marcio Renato Pinheiro da SilvaPas encore d'évaluation
- Introduction A La Psychologie GeneraleDocument73 pagesIntroduction A La Psychologie Generalenaturopathe100% (1)
- Hermes (I) No. 4 - Mars 1935Document40 pagesHermes (I) No. 4 - Mars 1935marceemansPas encore d'évaluation