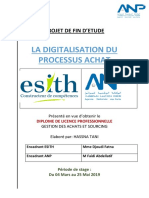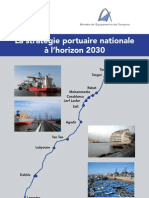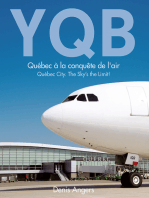Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Tableau de Bord A Marsa Maroc
Tableau de Bord A Marsa Maroc
Transféré par
Salma MkTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Tableau de Bord A Marsa Maroc
Tableau de Bord A Marsa Maroc
Transféré par
Salma MkDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Le commerce International joue un rle trs important dans la
croissance conomique. Il est considr comme llment moteur dans la
croissance, comme facteur dterminant pour sapproprier des richesses.
Depuis, une vingtaine dannes, des transformations majeures,
extrmement fortes, ont remodel le paysage conomique mondial et influ sur
le commerce international et par aussi sur le transport international. Celles-ci
sont au cur dune conomie de plus en plus mondialise.
Lobservation de ces transformations met en vidence quelques grandes
tendances en termes dvolutions quantitatives et qualitatives des flux de
transport maritime. Le dveloppement dune conomie mondiale depuis la
deuxime guerre a fait crotre les changes internationaux plus vite que la
production mondiale.
La matrise du transport maritime constitue un des lments de la
matrise de la production. De fait, les pays ont essay davoir une action sur le
transport maritime pour acqurir une certaine matrise de linsertion de leur
conomie mondiale. En particulier, la cration dune flotte nationale a
reprsent une des solutions les plus couramment prnes.
Mais ce secteur maritime est en volution trs rapide. Cest un secteur
qui a t fortement marqu ces dernires dcennies par les changements
techniques et organisationnels importants qui rendent trs rapidement une
flotte obsolte. Tout dabord la conteneurisation a fait une entre en force, et
tend couvrir de plus en plus de produits. Lapparition de rouliers, de navires
spcialiss de plus petites tailles que les vraquiers, de vraquiers gants, a
galement modifi la configuration du transport maritime.
2
Laccroissement important de la productivit du secteur des transports
et particulirement le transport maritime grce la gnration du conteneur,
rend conomiquement viables les dplacements des produits sur des grandes
distances.
Laccs certains marchs lointains, jadis difficiles, devient
aujourdhui, une opportunit nouvelle nos exportateurs. Le transport
maritime peut jouer un rle trs important ce niveau.
Aujourdhui, en raison du rle de plus en plus important du transport
maritime dans le commerce international et dans la comptitivit des firmes, de
son cot nettement plus bas et par la suite de sa prfrence, au moins pour les
cargaisons grand tonnage basse valeur , les transports maritimes
contribuent essentiellement la promotion des exportations et la russite des
entreprises dans leurs aventures ltranger. Ds lors, une opration lexport
par voie maritime doit tre ralise dans de bonnes conditions.
Encore faut-il, que lexportateur matrise les diffrentes phases du
processus dexportation de lamont laval et bien intgrer les notions de
qualit et de cot dacheminement dans sa politique commerciale. Ainsi donc,
la matrise du transport et notamment le transport par voie maritime peut
devenir un atout supplmentaire pour exporter vers lextrieur.
3
Premire partie : Prsentation gnrale
Chapitre I : Le secteur portuaire au Maroc
Le Royaume du Maroc dispose de deux faades maritimes : une faade
Mditerranenne au Nord et une faade Atlantique lOuest. Les deux faades
totalisent prs de 3500 km de ctes.
Le Maroc compte actuellement 26 ports dont 11 sont ouverts au
Commerce International.
6 ports sont situs sur la cte Mditerranenne :
RAS KEBDANA
NADOR
AL HOCEIMA
JEBHA
MDIQ
RESTINGA SMIR
20 ports sont situs sur la cte Atlantique :
TANGER
ASILAH
LARACHE
KENITRA
MEHDIA
SABLE DOR
MOHAMMEDIA
CASABLANCA
EL JADIDA
JORF LASFAR
SAFI
4
ESSAOUIRA
AGADIR
SIDI IFNI
TAN-TAN
TARFAYA
LAAYOUNE
BOUJDOUR
DAKHLA
LAGWIRA
A signaler que prs de 98% des changes du Maroc avec l'extrieur se font
par voie maritime, do lintrt que revtent les ports qui sont caractriss
juste titre comme les poumons de lconomie marocaine.
I
I
.
.
H
H
i
i
s
s
t
t
o
o
r
r
i
i
q
q
u
u
e
e
Lvolution de lorganisation portuaire au Maroc peut tre apprhende
selon trois priodes significatives. Elles se situent principalement avant 1963,
de 1963 1984 et de 1984 nos jours.
AVANT 1963 :
Le rgime des concessions confiait la responsabilit des oprations portuaires
aux socits prives installes dans les diffrents ports du commerce du
Royaume.
LEtat travers la tutelle exercre par lAdministration des Travaux
publics, prenait entirement sa charge les travaux neufs
dinfrastructures et leur entretien, lacquisition du matriel de
manutention ...,
En 1963, fut cre la Rgie dAconage du Port de Casablanca (RAPC)
qui reprit les attributions des socits concessionnaires moyennant les
conditions suivantes :
5
- Les travaux de construction et dentretien des infrastructures
restaient toujours la charge de lEtat.
- Lacquisition et lentretien du matriel de manutention
incombaient entirement la nouvelle rgie daconage.
DE 1963 A 1984 :
Dveloppement des investissements consentis par lEtat : la construction de
nouvelles infrastructures portiques (construction des nouveaux ports de
Nador, Jorf, Layoune et Agadir ...) mais aussi la ralisation des installations
portuaires spcifiques (Terminal Conteneurs de Casablanca, Terminal
Soufrier de Safi, Gares maritimes.).
Engorgement des installations au port de Casablanca amenant les
armements surtaxer le fret destination de ce port,
Conflits sociaux rptition,
Rattachement de toute lactivit portuaire la tutelle unique reprsente
par lAdministration des Travaux Publics,
La mise en place de mesures propres assainir la gestion et le
fonctionnement de la rgie daconage,
Le renforcement des attributions de la rgie daconage, particulirement
en matire des infrastructures.
Programme dactions ambitieux couvrant lensemble des volets de la gestion de
la rgie daconage (1983 1984)
Au niveau des ressources humaines,
Au niveau des infrastructures et des quipements portuaires par
ladoption dun programme durgence de remise en tat des ports,
Au niveau des structures par des actions et de contrle,
Restructuration et renforcement des units charges de la gestion
comptable et financire dans les ports.
6
DE 1984 A NOS JOURS :
Cration de lOffice DExploitation des Ports de Casablanca.
Ds lors, le port de Casablanca a connu dimportants travaux de
rhabilitation de ses infrastructures de base raliss en partie dans le cadre
du projet portuaire financ par la Banque Mondiale pour faire face aux
exigences de lvolution du trafic.
Entre 1991 et 1996
LODEP a Ralis le Terminal Conteneurs EST.
Le 15 Fvrier 1996
Lexploitation de ce Terminal a commenc.
En 2006
Rforme portuaire
I
I
I
I
.
.
L
L
a
a
r
r
f
f
o
o
r
r
m
m
e
e
p
p
o
o
r
r
t
t
u
u
a
a
i
i
r
r
e
e
:
:
Les ports jouent un rle primordial dans lconomie nationale et dans
les changes commerciaux de notre pays, dont la quasi-totalit emprunte la
voie maritime. Ils sont lun des principaux outils industriels et commerciaux
pour le dveloppement conomique et social du pays. Le secteur portuaire doit
alors sadapter, dune part , au mutation socio-conomiques caractrises par
des exigences de dveloppements internes au pays, par des engagement du
pays dans des accords de libre-change et par les nouveaux contextes de la
mondialisation et de la globalisation du commerce et, dautre part, aux
nouvelles contraintes et volutions conomiques, institutionnelles,
technologiques et environnementales et du transport maritime. Pour mieux
rpondre ces impratifs nationaux et internationaux, une refonte du mode de
7
gestion et dorganisation du secteur portuaire est ncessaire de manire
permettre une amlioration de loutil portuaire et son adaptation aux besoins
du commerce extrieur. Il est devenu essentiel de doter le secteur portuaire
dun cadre lgislatif et rglementaire adapt aux volutions futures en
harmonie avec les traites et les diffrents accords auxquels le Maroc souscrit,
mme dencourager les initiatives prives et de mettre les exploitants et
oprateurs portuaire en situation concurrentielle.
1- Contexte de La rforme portuaire
La mondialisation constitue sans aucun doute lun des vnements les
plus marquants de la fin du XXe et du dbut du XXI sicle. Elle a, en effet,
introduit des changements fondamentalement importants dans tous les
secteurs dactivit. Elle a tendu son emprise sur lensemble des pays de la
communaut internationale.
Sur le plan conomique, la mondialisation sest traduite par une
amlioration trs significative de la circulation des marchandises entre les
diffrents pays de la communaut internationale. Il y a plus de biens et de
services offerts aux consommateurs et des cots moindres suite la fois au
dmantlement tarifaire et aux effets de la comptition internationale.
- Au niveau national :
Amlioration des infrastructures de transport (Routes, autoroute, voies
ferres, arien, etc.)
Mise niveau du secteur maritime : (Libralisation, code maritime, etc.)
Mise niveau du secteur portuaire :(Rforme globale, construction du
nouveau port de transbordement Tanger Med, zone Logistique).
- Au niveau international :
Commerce des biens. Une clause volutive de lAccord prvoit la
libralisation progressive des changes agricoles sur le plan bilatral avec
8
chacun des Etats Membres de lAELE (Association europenne de libre-
change) et lamlioration du Protocole sur les produits agro-industriels au
niveau multilatral. Elle prvoit galement la libralisation du commerce des
services et le droit dtablissement.
Pour les produits industriels : Contre un accs libre pour les
produits industriels marocains, laccord prvoit un dmantlement progressif
sur 12 ans limage du schma de lUnion Europenne ;
Pour les produits agricoles : Contrairement lUE, lAELE ne
dispose pas dune Politique Agricole Commune, Aussi, des concessions ont t
changes avec chacun des pays Membres.
Les Rgles dOrigine : Le protocole B sur les rgles dorigine
annex laccord, prvoit des dispositions avantageuses en matire de rgles
dorigine notamment lextension du systme du cumul pan-europen. Les pays
de la zone Euromed concerns par lapplication de ce cumul de lorigine sont:
les pays membres de lUE (25), les 4 pays membres de lAELE, la Bulgarie, la
Roumanie, la Turquie et les 9 pays de la rive sud mditerranenne savoir le
Maroc, lAlgrie, lEgypte, la Tunisie, la Syrie, la Palestine, la Jordanie,
Isral, le Liban.
2- Le secteur portuaire avant la rforme
Dans le sous-secteur portuaire, les problmatiques dominantes se
caractrisaient par :
Linsuffisance de la structuration institutionnelle des ports ;
La Caducit du cadre juridique et rglementaire ;
Le Dcalage entre les textes en vigueur et la ralit du terrain ;
Un Vide juridique dans lorganisation des activits portuaires ;
Labsence de lien lgal et contractuel entre la main duvre dockers et les
employeurs ;
Un Vide juridique dans la dfinition des concepts ;
9
Un Vide juridique dans les modes doctroi et de contrle des autorisations
et des concessions ;
Une ouverture insuffisante des activits portuaires au secteur priv ;
Un dfaut dunicit de responsabilit dans les activits
chargement/dchargement des navires et de la manutention de la
marchandise ;
Une insuffisance de la rglementation des professions portuaires ;
Une tarification portuaire par lODEP non lie au cot rel des
prestations ;
Le Monopole de lODEP et oligopole organisationnel des socits de
manutention de bord ;
Une Dualit dans les oprations qui renchrit les cots et freine la
comptitivit, la modernisation et louverture ;
Une Forte demande de la vrit des prix ;
Une Forte protestation des oprateurs au niveau des cots et des
prestations.
Tous ces facteurs refltent ltat dune organisation dfaillante qui affecte la
productivit des intervenants du secteur ainsi que le cot du passage
portuaire et qui cre des problmes de rupture de responsabilit et
dorganisation de la main duvre, une situation tout fait alarmante et dont
les consquences demeurent tout fait incompatibles avec :
- Les exigences de louverture conomique.
- Les engagements des pouvoir publics.
- Les exigences de la mise niveau et de la comptitivit de lconomie.
- Les exigences dune ouverture du secteur de nouveaux oprateurs.
- Les exigences pour la prparation la confrontation de la concurrence
notamment celle du port de Tanger Med.
- La volont dencouragement de linvestissement priv dans la
ralisation, la gestion et lexploitation des infrastructures portuaires.
- La volont de renforcement de la concurrence.
10
3- Objectifs de la reforme
La rforme du secteur portuaire a pour objectif :
Lamlioration du niveau de comptitivit des ports marocains aux
standards internationaux ;
LActualisation et la mise niveau de larsenal juridique ;
La clarification des rles et des missions des diffrents intervenants
publics et privs ;
La clarification et la sparation des missions Rgaliennes, de Rgulation et
contrle et Commerciales ;
Lassainissement de la situation juridique des intervenants dans le
secteur ;
La mise en place dun cadre rglementaire claire et transparent pour
loctroi et lexercice de toute activit portuaire ;
La cration dun environnement propre, encourageant et attractif pour
linvestissement priv ;
Le maintien et la prennit des quilibres financiers du secteur pour
assurer son dveloppement ;
La dfinition des modes de gestion et dexploitation des ports ;
La souplesse ncessaire pour loprateur public lui permettant de se
prparer et de renforcer sa capacit concurrentielle ;
La Clarification des rles et missions ;
La Conscration de l'unicit de l'oprateur pour les oprations de
chargement et de dchargement des navires ;
La Mise en place d'un cadre juridique adquat qui clarifie les missions,
rglemente le secteur et dfinit les conditions pour exercer une activit
dans les ports ;
LOctroi de concessions de nouveaux oprateurs portuaires ;
LInstauration de la concurrence au sein et entre les ports ;
11
La Modernisation du mode de gestion de la main d'uvre ;
Ladaptation de loffre des services portuaires la demande du trafic ;
La mise la disposition des oprateurs conomiques et des entreprises
nationales des infrastructures et des quipements pour lamlioration de
leur propre comptitivit.
4- Axes de la reforme
Pour rpondre cet objectif principal de comptitivit, tout en tenant
compte des contraintes et exigences conomiques, la rforme du secteur
portuaire sarticule autour de trois principaux axes :
La sparation des fonctions rgaliennes, dautorit et commerciale
La fonction rgalienne qui incombe lEtat : concerne llaboration de
la politique portuaire, la planification des investissements en infrastructures, la
ralisation de nouvelles infrastructures et la mise en place du cadre
rglementaire pour lexercice des activits portuaires. La fonction dautorit et
de rgulation portuaire qui sera confie un tablissement public, lequel
prendra en charge les missions de police des ports, scurit, contrle du respect
de la rglementation, coordination et marketing du port, tablissement de
cahiers de charges pour loctroi de concessions et dautorisations dexercice des
activits portuaires, maintenance des infrastructures portuaires, etc.
La fonction commerciale exerce par des entits publiques et/ou
prives : services aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, etc.), services
aux marchandises (manutention, stockage, etc.) et services accessoires
(location de matriel, etc.)
Lintroduction de la concurrence
Entre ports et au sein dun mme port, ceci laisse supposer la
rgularisation de la situation de monopole de lODEP et celle doligopole
exerce par les socits de stevedoring. Ce qui conduit ipso facto encourager
la participation du secteur priv dans les activits du secteur.
12
Lunicit de la manutention
Lobjectif est de mettre fin la rupture de responsabilit juridique,
amliorer lefficacit et lefficience des oprations de chargement et de
dchargement des navires et rduire les cots de passage portuaire par une
meilleure matrise de la chane.
5- Mise en uvre de la reforme
La concrtisation du projet de rforme du secteur portuaire sest
traduite par : La dissolution de LODEP et la cration de deux entits distinctes :
LANP : "Agence Nationale des Ports" Est une Agence dautorit et de
rgulation charge de lautorit portuaire, de loctroi et du suivi des
concessions et des autorisations dexercice des activits portuaires, de la
maintenance, du dveloppement et de la modernisation des
infrastructures et des superstructures, de la gestion du domaine public
portuaire, de laccompagnement de la politique du Gouvernement en
matire de renforcement de lintroduction du secteur priv dans la
gestion portuaire.
La SODEP :"La Socit dExploitation des Ports" dont le nom depuis juin
2007 est : MARSA MAROC est une socit anonyme rgie par la loi
n17-95 sur les socits anonymes. Elle a pour objet dexercer,
concurremment avec les personnes morales de droit public ou priv
auxquelles auront t dlivre lautorisation dexploitation ou la
concession, lexploitation des activits portuaires et, le cas chant la
gestion des ports. Les deux entits ont tenu leurs conseils
d'administration et de surveillance le 1er dcembre 2006. En outre,
dans le cadre de la mise niveau des oprateurs existants et suite aux
ngociations menes entre le ministre de l'Equipement et du transport
et les socits de stevedoring, une deuxime socit est autorise
13
oprer dans les activits commerciales et de manutention au port de
Casablanca. Cette socit, issue de la fusion de Manuco, Udemac et LCE et
mene par Comanav, s'est engage recruter et garantir les acquis
sociaux de l'ensemble de la main-d'uvre dockers prsente dans le port en
contrepartie de concessions de terminaux permettant l'exercice d'une
concurrence relle. Outre la transparence dans les transactions entre
acteurs de la chane logistique portuaire, cette dmarche vise amliorer la
qualit du service portuaire.
Rcapitulatif : Reforme portuaire (Annexe 1 )
En rcapitulation, deux organisations se prsentent :
Lorganisation pr-rforme, o ltat labore et planifie la
politique portuaire et les investissements en infrastructures, lODEP ayant pour
mission de prsenter des prestations envers les navires et la marchandise et
reprsente aussi lautorit au sein du port, cependant les stevedores (oligopole)
soccupe des manutentions au bord des navires.
Cette organisation reste limite et a plusieurs contraintes, savoir la
dualit de la manutention ODEP et stevedores ce qui cre des problmes de
dtermination des responsabilits, et aussi lincompatibilit des missions o
lODEP est la fois autorit et exploitant portuaire.
Lorganisation aprs la rforme, qui a donn naissance lANP et
la SODEP en attribuant chacune ses missions et ses limites, chose qui
introduira toutefois la concurrence dans les ports nationaux.
14
Chapitre II : Prsentation de Marsa Maroc
La socit dexploitation des ports est cre par la Loi 15-02, cest une socit
anonyme Directoire et Conseil de surveillance. Elle est rgie par la loi
N17-95 sur les socits anonymes et la loi 15-02 relatives aux ports, cest un
organisme public caractre industriel et commercial. Le cadre juridique de
Marsa Maroc se caractrise par la personnalit morale autonome en matire
de gestion.
Le Dahir de cration de Marsa Maroc lui confre le droit dadministrer, de
grer ses propres ressources sous sa totale responsabilit, dexploiter les
terminaux quai et bord et dtre propritaire de ses actions et de dfendre
ses intrts en justice. Par ailleurs, Marsa Maroc assure pour le compte de
ltat et sous son contrle, les missions de police portuaire et de la pche.
Le 1er juillet 2007, la socit dexploitation des ports a rendu son nouveau
nom de marque, MARSA MAROC. Une nouvelle identit visuelle pour
exprimer sa nouvelle personnalit et sa nouvelle mission, sinscrivant ainsi
dans le changement que connat le secteur portuaire national sous lensemble.
1. La fiche signaltique
Raison
sociale
:
Socit dExploitation des Ports
Nom de
marque
:
Marsa Maroc
Date de
cration
:
1
er
Dcembre 2006 (loi 15.02)
15
Statut
juridique
:
Socit Anonyme Directoire et
Conseil de Surveillance
Capital
Social
:
733.956.000 DH
Sige social
:
175, Bd Zerktouni-20 100
Casablanca - Maroc
Prsident
du
Directoire
: Mohammed ABDELJALIL
Secteur
dactivit
:
Gestion de terminaux et quais portuaires
Chiffre
dAffaires
: 2.068.793.590,43 DH
Effectif
:
2183 collaborateurs
Trafic
global
: 35.4 millions de tonnes
Sites oprs
:
10 savoir Nador, Al Hoceima, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf
Lasfar, Safi, Agadir, Layoune, Dakhla
16
2. Organigramme
3. Statut juridique
Cre par la Loi 15-02, SODEP est une socit anonyme Directoire
et Conseil de surveillance. Elle est rgie par la loi N 17-95 sur les socits
anonymes et la loi 15-02 relatives aux ports.
La SODEP bnficie dune plus grande souplesse de gestion lui permettant une
meilleure ractivit dans un secteur qui volue rapidement.
Ladoption du statut de Socit Anonyme sest accompagne dun mode
de gouvernance novateur :
Le Conseil de Surveillance exerce le contrle permanent de la
gestion de la Socit par le Directoire et approuve les grandes
orientations stratgiques de la Socit. Le Conseil de Surveillance est
17
prsid par M. Karim GHELLAB, ministre de lEquipement et du Transport. Il
y sige galement 4 autres membres reprsentant le ministre des Finances
et de la Privatisation, le Fonds Hassan II et le ministre de lEquipement et du
Transport.
Le Directoire constitue lorgane de gestion de la Socit. A ce titre, il est
investi de larges pouvoirs pour prendre toute dcision dordre
commercial, technique, financier, ou social. Le Directoire compte 5
membres et est prsid par M. Mohammed ABDELJALIL.
4. Objet
La Socit dExploitation des Ports est un exploitant, en
concurrence avec dautres oprateurs, des terminaux et quais concds par
lAgence Nationale des Ports.
Vu la position de la SODEP au cur de la logistique du commerce, elle
sest assigne comme mission de rechercher la cration de valeur chaque
maillon de la chane logistique portuaire, travers un large ventail de
services.
5. Lidentit visuelle de la SODEP
Le 1er Juillet 2007, la SODEP a rendu public son nouveau nom de
marque, MARSA MAROC.
Marsa, le nom, a t choisi pour sa forte charge smantique et sa
consonance universelle. Associ au nom Maroc, avec lequel il a des similitudes
graphiques. Lassociation Marsa / Maroc offre loprateur priv dtre
identit comme oprateur national sans que cela soit explicitement exprim.
6. Champ dintervention de MARSA MAROC
MARSA MAROC intervient dans les principaux ports du Royaume
savoir : Nador, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir,
Laayoune et Dakhla. Il est constitue de :
Une Direction Gnrale dont le sige social est Casablanca et qui a
pour mission de :
18
Garantir la cohrence de la politique de dveloppement et des
orientations stratgiques de lensemble des ports ;
Dvelopper une politique Marketing et Commerciale commune ;
Mettre en place des procdures et modes opratoires pour une
meilleure harmonisation et optimisation des pratiques et rgles de
lexploitation portuaire ;
Dfinir les rgles communes de gestion en ce qui concerne les
fonctions de support et de soutien.
Directions de lExploitation reprsentant chacune lun des ports
susdits qui ont pour rle dassurer la reprsentation de la Direction Gnrale
au niveau du port sur lensemble de ses missions et attributions.
Figure 1: Directions de l'Exploitation des Ports
19
7. Domaine et portefeuille dactivits de MARSA
MAROC
Limplantation multi sites lui confre une expertise spcifique en tant
que Manutentionnaire (Import Export), leader notamment dans les domaines
suivants:
Vrac Solides:
Port de Safi (Soufre et Minerais).
Port de Jorf Lasfar (Coke du ptrole, engrais, aliments de btail).
Port de Nador (Charbon, Baryte).
Port de Laayoune (Sable).
Port de Casablanca (Charbon, Crales).
Vrac Liquide:
Port de Mohammedia (Hydrocarbures).
Ports de Jorf Lasfar, Safi, Agadir et Nador (Hydrocarbures, Gaz,
Soude Caustique).
Trafic Conteneur:
Ports de Casablanca, Agadir et Tanger Med.
Trafic Roulier:
Ports de Tanger, Nador et Casablanca.
MARSA MAROC Exploitant Portuaire et Intgrateur de Solutions
Logistiques, offre ses clients un large ventail de services :
Les Services aux Navires (pilotage, remorquage, lamanage et
fourniture de leau).
Les Services la Marchandise (manutention unifie, pointage,
magasinage, pesage, dpotage et empotage des conteneurs et
remorques).
Les Services Connexes lArrire (dbardage, gerbage de la
marchandise, chargement et dchargement des camions).
20
Chapitre II : Lorganisation de la Direction
DExploitation du Port Jorf Lasfar (DEPJL)
Le port de Jorf Lasfar (Annexe 2, (figure 3)) est lun des principaux pionniers
de linfrastructure portuaire du Royaume, son exploitation a commenc depuis
1982 avec un trafic de 75 000 tonnes. Ce port est venu afin de renforcer la
chane portuaire du Maroc et dcongestionner le Port de Casablanca.
Il est 17 km de la ville dEL JADIDA et 121 km au sud de
CASANBLANCA, ce qui le permet de bnficier dune situation gographique
favorable. Ainsi il est bien situ dans une rgion en plein dveloppement
conomique, social, industriel, agricole, culturel et touristique avec lexistence
dun rseau de communication et tlcommunication dvelopp.
Parmi ses principaux avantages cest quil dispose dun arrire
pays trs riche (minerais de BENGUERIR et YOUSSOUFIA), et la prsence de
fonds marins importants (-5,00 -15,60 m Hydro de tirant deau).
1- Infrastructure du port
Le port dispose de 14 quais et un terminal polyvalent qui a t inaugur par
SM le roi Med VI en 2012, chaque poste ses propres caractristiques (Annexe
3, (Tableau 1))
21
2- Organigramme de la direction de lExploitation au
port de Jorf Lasfar
3- Activits et missions des diffrentes divisions :
Division Commerciale :
Mission :
Mettre en uvre la politique promotionnelle des activits du port et
assurer linterface avec les diffrents clients de la Direction ;
Assurer la facturation des prestations et droits portuaires, en conformit
avec les rglementations en vigueur ;
22
Rgler les litiges au mieux des intrts de Marsa Maroc dans le respect
des positions juridiques de la socit et assurer la gestion du domaine
public portuaire.
Division des Ressources Humaines :
Mission :
La satisfaction moyenne et long terme des besoins en personnel du port
dans les meilleures conditions de dlais, conformment aux profils
requis par les postes et aux orientations de la Direction Gnrale ;
Assurer lapplication et le suivi de la politique dfinie par Marsa Maroc,
en matire demploi, de recrutement de formation ;
La mise en place de la politique sociale pour le personnel dans le cadre
des objectifs fixs par la Direction.
Division Technique :
Mission :
Mettre la disposition de lexploitation un parc dengins et daccessoires
de manutention en bon tat fiable et au moindre cot de revient et en
assurer la gestion technique ;
Veiller la maintenance dans des conditions dexploitation optimales de
lensemble des infrastructures, rseaux deau et dlectricit ;
Assurer la ralisation des immobilisations et des agencements.
Division dExploitation :
Mission :
Assurer dans les meilleures conditions de scurit, de cot et de dlais le
traitement des escales et le transit des marchandises par le port ;
Assurer lencadrement et la gestion des moyens humains et matriels qui
lui sont confies.
23
Division Systme dInformation
Mission :
Veiller lapplication de la politique dfinie en matire informatique,
tlcommunication, et organisationnelle, conformment aux orientations
de la Direction Gnrale.
Assurer le contrle de gestion base de tableau de bord en veillant la
fiabilit de linformation traite.
Cette Division se compose de trois entits : Informatique,
tlcommunication et Information de Gestions.
Division Financire et comptable
Mission :
Appliquer la politique dfinie par la Direction Gnrale dans les
domaines financier, comptable, budgtaire et fiscal.
Assurer le contrle du bon fonctionnement et lexactitude du systme
dinformation comptable et financier.
24
4- Prsentation du service contrle de gestion (service
daffectation)
Consciente de limpact qua le contrle de gestion sur les finances et sur le
pilotage des activits de la socit, Marsa Maroc a lanc en 2008 un projet
pour la mise en place du contrle de gestion avec pour objectifs :
Le pilotage des activits et la mesure de la performance de la Socit sur la
base de tableaux de bord de gestion pertinents ;
La revue et lamlioration du dispositif budgtaire en place, pour le faire
voluer dun dispositif de contrle des dpenses un dispositif de pilotage
budgtaire ;
La structuration de la fonction Contrle de Gestion au sein de
lentreprise, dans ses aspects humains et organisationnels.
La ncessit de cette fonction dcoule du contexte actuel o la performance
dpend essentiellement de la capacit de rcuprer la bonne information et
lutiliser au bon moment. Cest pour cela, et dans le but de garder le cap, que
Marsa Maroc doit accder des donnes financirement fiables.
Le contrle de gestion, situ entre la finance, la comptabilit et les diffrents
centres de cots, est bien plac pour donner lalerte sur les risques de drapage.
Les dirigeants comptent beaucoup sur le contrle de gestion pour une
meilleure prise dcision en sappuyant sur des informations utiles surtout dans
ce contexte de turbulence.
Donc, pour tre efficace, le service de contrle de gestion fournit une
analyse des chiffres dactivit raliss, et collabore troitement avec les autres
services pour aboutir une analyse pertinente de la situation financire de la
socit.
Cest dailleurs lanalyse des carts entre les prvisions et les rsultats qui
constitue lpine dorsale dans le travail du service de contrle de gestion.
25
Le service de comptabilit lui fournit toutes les donnes essentielles pour la
mesure des rsultats .Mais pour bien russir sa mission il doit aussi chercher
les explications de ces rsultats auprs des diffrents services.
Cette analyse lui permet de prconiser les solutions pertinentes la
direction afin de surmonter les dfaillances ventuelles. En dautres termes, son
travail consiste faciliter la prise des dcisions stratgiques. Mais son rle ne se
limite pas cela. En effet, il participe aussi la dfinition des objectifs, du
schma directeur des budgets et anticipe les rsultats. Et puis, sur la base des
informations dont il dispose, le service de contrle de gestion labore les
budgets prvisionnels en dbut dexercice.
Par ailleurs, grce aux informations comptables et financire, il conoit les
tableaux de bord de lentreprise, des outils stratgiques qui font apparaitre
lensemble des rsultats : production, stock, rentabilit des investissements, etc.
Cest donc un travail qui intgre plusieurs volets
26
Deuxime Partie : Lapproche Thorique:
Introduction Gnrale Au Tableau De Bord
Selon D. BOIX & B. FEMINIER, le Tableau de Bord est un outil destin au
responsable pour lui permettre, grce des indicateurs prsents de manire
synthtique, de contrler le fonctionnement de son systme en analysant les
carts significatifs afin de prvoir et de dcider pour agir .
Outil privilgi de contrle et de suivi, le tableau de bord permet une
visualisation des processus, du fonctionnement et des actions dun service. Il
doit tre construit en prenant en compte les objectifs poursuivis et les
exigences des utilisateurs. Les finalits sont souvent diffrentes mais
complmentaires. Elles visent optimiser les modes de production travers un
meilleur suivi des processus et des procdures, disposer dinformations
fiables pour clairer la prise de dcision.
I. Le rle et les caractristiques dun bon tableau de bord :
Le tableau de bord est un instrument de contrle et de comparaison mais
le systme dinformation quil constitue est aussi en fait un outil de dialogue, de
communication et daide la dcision. Il permet le contrle permanent des
ralisations par rapport aux objectifs fixs dans le cadre de la dmarche
budgtaire, attire lattention sur les points cls de la gestion et sur leur drive
ventuelle par rapport aux normes de fonctionnement prvues. Il permet de
diagnostiquer les points faibles et de faire apparatre les anomalies qui peuvent
influencer les rsultats de lentreprise. Il doit enfin servir doutil de dialogue
entre les diffrents niveaux hirarchiques.
27
Selon les auteurs, un bon tableau de bord obit la rgle des 3U :
- Il est avant tout UTILE, permet au responsable dvaluer une situation
dans la perspective de dcider des actions entreprendre ;
- Il est ensuite UTILISABLE, le responsable doit pouvoir facilement en
extraire une information exploitable, travers un support synthtique ;
- Il est enfin UTILISE : travers la dimension danimation, le tableau de
bord peut devenir un vritable outil au service du management dune
structure.
II. Les instruments du tableau de bord :
Le contenu du tableau de bord est variable selon les responsables concerns,
leur niveau hirarchique et les entreprises. Pourtant, dans tous les tableaux de
bord des points communs existent dans :
la conception gnrale.
les instruments utiliss.
2.1- la conception gnrale :
La maquette d'un tableau de bord type fait apparatre quatre zones :
Tableau de bord du centre
Rsultats Objectifs Ecarts
Rubrique 1
Indicateur A
Indicateur B
Rubrique 2
Zone paramtres
conomiques
Zone rsultats Zone objectifs Zone carts
28
La zone rsultats rels ces rsultats peuvent tre prsents par priode
ou/et cumuls. Ils concernent des informations relatives l'activit :
Nombre d'articles fabriqus.
Quantits de matires consommes.
Heurs machine.
Effectifs, etc.
Mais aussi des lments de nature plus qualitative :
Taux de rebuts.
Nombre de retours clients.
Taux d'invendus, etc.
A ct de ces informations sur l'activit figurent souvent des lments sur les
performances financires du centre de responsabilit :
Des marges et des contributions par produit pour les centres de chiffres
d'affaires.
Des montants de charges ou de produit pour le centre de dpenses.
Des rsultats intermdiaires (valeur ajoute, capacit d'autofinancement)
pour les centres de profit.
La zone Objectifs dans cette zone apparaissent les objectifs qui
avaient t retenus pour la priode concerne. Ils sont prsents selon les
mmes choix que ceux retenus pour les rsultats (objectif du mois seul, ou
cumul).
La zone carts ces carts sont exprims en valeur absolue ou relative
ce sont ceux du contrle budgtaire mais aussi de tout calcul prsentant un
intrt pour la gestion.
29
2.2- Les instruments utiliss :
Les instruments les plus frquents du tableau de bord sont les carts, les
ratios, les graphes et les clignotants.
A) Les carts :
Le contrle budgtaire permet le calcul d'un certain nombre d'carts. Il s'agit
alors de reprer celui (ou ceux) qui prsente (nt) un intrt pour le destinataire
du tableau de bord.
En rgle gnrale, un tableau de bord doit uniquement prsenter les
informations indispensables au niveau hirarchique auquel il est destin et
seulement celles sur lesquelles le responsable peut intervenir.
B) Les ratios :
Les ratios sont des rapports de grandeurs significatives du fonctionnement de
l'entreprise.
En rgle gnrale un ratio respect les principes suivants :
Un ratio seul n'a pas de signification : c'est son volution dans l'espace
qui significative.
Il faut dfinir le rapport de telle sorte qu'une augmentation du ratio soit
signe d'une amlioration de la situation.
La nature des ratios varie selon le destinataire et son niveau hirarchique.
C) les graphes :
Ils permettent de visualiser les volutions et de mettre en vidence les
changements de rythme ou de tendance. Leurs formes peuvent tre sous forme
de :
Histogramme.
Graphique en `'camembert''.
30
D) les clignotants :
Ce sont des seuils limites dfinis par l'entreprise et considrs comme
variables d'action. Leur dpassement oblige le responsable agir et mettre en
uvre des actions correctives.
Les formes varies que peuvent prendre les indicateurs ne doivent pas faire
oublier l'essentiel. La pertinence de l'outil tableau de bord tient d'abord aux
choix des indicateurs.
Toute la difficult rside dans leur dfinition, puisqu'il faut choisir
linformation.
III. Evolution des rles du tableau de bord :
Le tableau de bord est, dans sa conception mme, un instrument de contrle
et de comparaison. Mais le systme dinformation quil constitue en fait aussi
un outil de dialogue et de communication ainsi quune aide la dcision.
a) Le tableau de bord, instrument de contrle et de comparaison :
Le tableau de bord permet de contrler en permanence les ralisations par
rapport aux objectifs fixs dans le cadre de la dmarche budgtaire. Il attire
lattention sur les points cls de la gestion et sur leur drive ventuelle par
rapport aux normes de fonctionnement prvues.
Il doit permettre de diagnostiquer les points faibles et de faire apparatre ce
qui est anormal et qui a une rpercussion sur le rsultat de lentreprise.
La qualit de cette fonction de comparaison et de diagnostic dpend
videmment de la pertinence des indicateurs retenus.
b) Le tableau de bord, outil de dialogue et de communication :
Le tableau de bord, ds sa parution, doit permettre un dialogue entre les
diffrents niveaux hirarchiques. Pour lefficacit dune telle communication, il
31
est important que lembotement de type gigogne dcrit dans la premire
partie soit respect.
Il doit permettre au subordonn de commenter les rsultats de son action, les
faiblesses et les points forts. Il permet des demandes de moyens
supplmentaires ou des directives plus prcises.
Le suprieur hirarchique doit coordonner les actions correctives entreprises
en privilgiant la recherche dun optimum global plutt que des optimisations
partielles.
Enfin, en attirant lattention de tous les mmes paramtres, il joue un rle
intgrateur, en donnant un niveau hirarchique donn, un langage commun.
c) Le tableau de bord, aide la dcision :
Le tableau de bord donne des informations sur les points cls de la gestion et
sur ses drapages possibles mais il doit surtout tre linitiative de laction.
La connaissance des points faibles doit tre obligatoirement complte par
une analyse des causes de ces phnomnes et par la mise en uvre dactions
correctives suivies et menes leur terme. Ce nest que sous ces conditions que
le tableau de bord peut tre considr comme une aide la dcision et prendre
sa vritable place dans lensemble des moyens du suivi budgtaires.
Les limites des tableaux de bords traditionnels :
Cette volution des rles vers un outil de diagnostic, de dialogue, de
motivation, de suivi de changement ne correspond pas toujours la pratique
traditionnelle des tableaux de bord conus et utiliss seulement comme des
reporting financiers.
32
Plusieurs insuffisances apparaissent dans la ralit actuelle des entreprises :
il ny a pas de tableau de bord adapt chaque service ou niveau
hirarchique mais un tableau unique qui ne correspond pas toujours aux
spcificits de lactivit.
le tableau de bord est souvent fig pendant des annes sans souci dadaptation
de nouveaux besoins, de nouveaux objectifs ou moyens.
lobjectif du tableau de bord reste trop souvent celui du contrle sans aide au
changement ou aux amliorations.
la priodicit du tableau du bord est souvent la mme pour tous les services
alors quelle peut apparatre inadapte pour certains mtiers.
la conception des tableaux de bord est trop peu souvent laisse linitiative de
ceux qui vont les utiliss mais plutt centralise loin du terrain.
les indicateurs utiliss sont parfois dconnects de la stratgie globale et ne
permettent pas dorienter laction au bon moment.
les tableaux de bord sont souvent conus de manire interne, en fonction du
style de gestion de lentreprise sans soucis de comparaison avec des
organisations concurrentes meilleures (Benchmarking).
les tableaux de bord ne mettent pas assez en vidence les interactions entre les
indicateurs, ne favorisant pas la gestion transversale.
les indicateurs ne sont pas remis en cause et le manque de recul sur une
longue priode conduit une gestion routinire.
33
Conclusion
Les tableaux de bord sorientent de plus en plus vers une prise en
compte globale de la Performance et non plus seulement vers la mesure dune
performance financire. Leur mise En uvre ne dpend pas tant de la qualit
intrinsque des indicateurs qui les composent que de Lintgration de ces
tableaux de bord au processus de management de lentreprise. Sils sont vcus
comme lun des constituants principaux du processus de management alors il y
a fort Parier quils fonctionneront bien, mme avec des indicateurs
imparfaits.
34
Le tableau de bord est l'ensemble des donnes chiffres ncessaires et
suffisantes, mises sous formes de tableaux synthtiques permettant aux
diffrents responsables de prendre des dcisions, au regard des donnes
prvisionnelles et des objectifs fixs. Ses principales qualits sont de fournir
un nombre, trs rduit d'informations dans un temps assez court afin de
contribuer des prises de dcision immdiates. Trs utilis dans les grandes
entreprises, mais aussi dans les moyennes entreprises, le tableau de bord
permet de renforcer l'efficacit de la gestion de certains services ou
dpartements de l'entreprise.
Le tableau de bord qui est un vritable outil daide la dcision, nest plus
propre la fonction du contrle de gestion, mais la dpasse vers les autres
services et dpartements, puisque les managers en font un outil indispensable
au suivi des cours des rsultats, et une prise de dcisions, la hauteur des
situations qui simposent.
35
Accostage Manuvre d'approche finale du navire l'ouvrage (quai ou appontement)
conu pour permettre le stationnement des navires, leur amarrage et la
manutention.
Amarrage Immobilisation d'un navire au moyen d'aussires (cbles) un quai ou une
boue.
Armateur Personne qui arme un navire en lui fournissant matriel, vivres, combustible,
quipage et tout ce qui est ncessaire la navigation. Il exploite le navire en
son nom, qu'il soit ou non propritaire.
Trafic maritime
(mesure) : il s'exprime en tonnes de marchandises charges pour les
exportations d'un pays ou d'un ensemble de pays, et en tonnes de
marchandises dcharges pour les importations.
Trafic ro-ro : roll on - roll off : trafic transport par la technique du trans-
roulage, qui concerne des navires dont la cargaison est manutentionne par
roulage grce une porte passerelle avant ou arrire.
Trafic au tramping (tramp = vagabond en anglais) ou la demande : trafic
transport par un navire lou sous contrat, par opposition au navire de ligne
rgulire
Arrimage Opration qui consiste fixer solidement les marchandises bord du navire.
Affrtement
(remise de
navire)
se distingue du contrat de transport (remise de marchandises).
L'affrtement porte sur l'usage et la jouissance du navire par l'affrteur (le
frteur met le navire disposition de l'affrteur) ; le contrat de transport
porte sur la marchandise que le chargeur confie au transporteur contre
paiement du fret.
Affrteur Personne qui loue un navire ou qui exploite un navire en location, selon les
termes du contrat de location ou charte-partie daffrtement.
Mouillage
Opration consistant jeter l'ancre en laissant filer la chane de faon faire
crocher l'ancre dans le fond.
Avitaillement Fourniture des marchandises, vivres et combustibles ncessaires bord du
navire, pour le voyage en mer.
36
Transitaire
Le transitaire est un auxiliaire trs important du commerce extrieur. Il
intervient dans la chane du transport, soit comme mandataire, soit comme
commissionnaire de transport.
o En tant que mandataire, il agit soit pour le compte du chargeur
lembarquement, soit pour le compte du rceptionnaire au dbarquement. Il
a pour rle de suppler le chargeur ou le rceptionnaire, desquels il a reu
une mission bien prcise. En tant que mandataire, il est assujetti au rgime
juridique du mandat, et ce titre, sa responsabilit ne peut tre recherche
que sil a commis une faute dans lexercice de sa mission. Il a une obligation
de moyens.
o En tant que commissionnaire de transport, la mission du transitaire est
dorganiser le transport de bout en bout. Il a la matrise totale des oprations
et peut prendre ds lors les initiatives les plus larges. En tant que
commissionnaire de transport, une obligation de rsultat pse sur lui. Il en
rsulte que sa
responsabilit pourra tre recherche, mme en cas dabsence de faute de sa
part.
Stevedore
Entrepreneur de manutention portuaire. Le stevedore dispose dun
personnel permanent (notamment docker) dengins de manutention et il
loue au port les grues ou rassemble dautre moyens pour assurer la
manutention depuis bord navire jusqu et y compris terre.
Remorquage
Socit fournissant au navire des remorqueurs pour lui permettre dassurer
des manoeuvres dans les accs au Port.
Bollard Gros ft mtallique ou masse dacier tte renfle implant sur un quai pour
lamarrage des navires.
Lamanage
Opration qui consiste mettre les amarres dun navire sur des bollards ou
des ducs dAlbe et inversement.
Capitainerie
Service dpendant de lautorit portuaire et charg de coordonner les
mouvements de navires dans le port et de la police.
Cabotage Transport maritime courte distance, national ou international, qui s'exerce
le long des ctes ou entre des les (par exemple dans la cte du golfe de guine
: Nigeria Cameroun Gabon Sao tom).
37
38
Vous aimerez peut-être aussi
- Port de CasablancaDocument39 pagesPort de CasablancaWalid Saoud100% (1)
- Tableau de BordDocument77 pagesTableau de BordAbidoWhooPas encore d'évaluation
- Tableau de Bord ONCFDocument28 pagesTableau de Bord ONCFHajar Moussaoui100% (2)
- Rapport de Stage 'Marsa Maroc'Document109 pagesRapport de Stage 'Marsa Maroc'Yousra Sekkat91% (11)
- 4 Transport MaritimeDocument61 pages4 Transport MaritimeMohammed Jaija100% (5)
- Stage Marsa MarocDocument122 pagesStage Marsa MarocOuafa Elomari100% (7)
- Dynamisation Du Secteur de Transport Routier InternationalDocument217 pagesDynamisation Du Secteur de Transport Routier InternationalGadiri MarocPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage MARSA MAROCDocument32 pagesRapport de Stage MARSA MAROCyousseftaleb83% (6)
- Maison en GeomancieDocument6 pagesMaison en GeomancieAbdel Ismaila Cisse94% (16)
- Marsa MarocDocument76 pagesMarsa MarocMeryem Mouqtadi75% (8)
- Les TemperamentsDocument25 pagesLes Temperamentskoum junior100% (10)
- Projet de Fin D'études (Mesure Et Evaluation de La Performance Des Escales Portuaires TM1)Document163 pagesProjet de Fin D'études (Mesure Et Evaluation de La Performance Des Escales Portuaires TM1)Amine Bouhilal75% (4)
- Marsa MarocDocument67 pagesMarsa MarocOutmane Lakhlili100% (2)
- Pfe Anp Gas3Document100 pagesPfe Anp Gas3elbadia anas100% (1)
- Portuaire Au MarocDocument58 pagesPortuaire Au MarocZouhair Sil75% (4)
- La Conception Du Tableau de BordDocument84 pagesLa Conception Du Tableau de Bordkawtar elganaPas encore d'évaluation
- L'impact Des Ports Sur Le Commerce MaritimeDocument5 pagesL'impact Des Ports Sur Le Commerce Maritimekawtar ayPas encore d'évaluation
- 1.projet de Fin D'étude - Management International - Nabil MOUNAAMDocument156 pages1.projet de Fin D'étude - Management International - Nabil MOUNAAMzack100% (1)
- Rapport de StageDocument34 pagesRapport de StageOmayma Khorbach100% (1)
- Marsa MarocDocument65 pagesMarsa MarocLoulou Hb100% (3)
- Cours Droit Gestion PortuaireDocument34 pagesCours Droit Gestion Portuairejbiloumaroc77% (13)
- Rap Marsa MarocDocument37 pagesRap Marsa MarocfatimazahraaaPas encore d'évaluation
- Tableau de Bord Cas BDLDocument135 pagesTableau de Bord Cas BDLredouane86100% (27)
- MARSADocument40 pagesMARSAAbdelwahd Errabih50% (2)
- Rapport Final Marsa.MDocument40 pagesRapport Final Marsa.MLoulou Hb60% (5)
- TIMAR PrésentationDocument68 pagesTIMAR Présentationnoura100% (3)
- Extrait Guide Complements AlimentairesDocument22 pagesExtrait Guide Complements Alimentairestino mokrezePas encore d'évaluation
- Indicateurs de PerformanceDocument3 pagesIndicateurs de Performancenohahlm100% (1)
- BACHELOR MARKET - MARKETING OPE STRAT - Cours N°12Document41 pagesBACHELOR MARKET - MARKETING OPE STRAT - Cours N°12GODETPas encore d'évaluation
- Copie de Rapport de StageDocument43 pagesCopie de Rapport de StageOmar AfraPas encore d'évaluation
- Rapport Fatmi TMSADocument60 pagesRapport Fatmi TMSAMouna HlnPas encore d'évaluation
- Management Et Suivi de La Performance de La Chaîne Logistique Portuaire - Cas Des Ports de Tanger Et de Casablanca (Anas)Document137 pagesManagement Et Suivi de La Performance de La Chaîne Logistique Portuaire - Cas Des Ports de Tanger Et de Casablanca (Anas)tadlawi100% (1)
- Les Coûts de La LogistiqueDocument19 pagesLes Coûts de La Logistiquebourasiste100% (1)
- TimarDocument59 pagesTimarWidad Karim AllàhPas encore d'évaluation
- Troubles Cognitifs Aigus. Aphasie Amnesie Apraxie Comportement UrgenceDocument12 pagesTroubles Cognitifs Aigus. Aphasie Amnesie Apraxie Comportement UrgenceStella PapadopoulouPas encore d'évaluation
- Mémoire MasterDocument44 pagesMémoire MasterAadil El Mouden50% (2)
- Chaptr 6 TB LogistiqueDocument17 pagesChaptr 6 TB LogistiqueHACHS MAPas encore d'évaluation
- Rapport Doha Et Bouchra Marsa MarocDocument76 pagesRapport Doha Et Bouchra Marsa Marocvokin567100% (4)
- Rapport MARSA Oussama AnibaDocument38 pagesRapport MARSA Oussama AnibaReda MohPas encore d'évaluation
- StrategiePortuairewebFR PDFDocument62 pagesStrategiePortuairewebFR PDFMounir Ouadid100% (1)
- Analyse Fin MARSA MAROCDocument16 pagesAnalyse Fin MARSA MAROCilyass50% (2)
- Chapitre I. Rôle Économique Du PortDocument23 pagesChapitre I. Rôle Économique Du PortOmar DhifallahPas encore d'évaluation
- Rapport Final ANP DouniaDocument54 pagesRapport Final ANP Douniazinebnad50% (2)
- Memoire Lamiae El Mokhtar3Document99 pagesMemoire Lamiae El Mokhtar3oumPas encore d'évaluation
- Exposé DarnouniDocument51 pagesExposé DarnouniImen Kamali100% (3)
- Projet de Fin D'études OCP SA Balanced Scorecard Cas JORF LASFARDocument31 pagesProjet de Fin D'études OCP SA Balanced Scorecard Cas JORF LASFARNajat Cheikh Lahlou100% (2)
- La Politique de La Qualité de Marsa-Maoc PDFDocument10 pagesLa Politique de La Qualité de Marsa-Maoc PDFOuahid KiadePas encore d'évaluation
- The Impossible Dream Maureen Heaton 1990 356pgs POLDocument356 pagesThe Impossible Dream Maureen Heaton 1990 356pgs POLBonusje100% (1)
- Revue Thomiste 1924 CompletoDocument625 pagesRevue Thomiste 1924 CompletopasuasafcoPas encore d'évaluation
- Pfe Adib IsmailDocument131 pagesPfe Adib IsmailSIDMOU100% (1)
- Elaboration D'un Tableau de Bord Des Coûts Logistiques de DistributionDocument28 pagesElaboration D'un Tableau de Bord Des Coûts Logistiques de DistributionZakaria AbbasPas encore d'évaluation
- FTA RapportDocument5 pagesFTA RapportEl Hanafi MohamedPas encore d'évaluation
- "Traitement Des Marchandises Endommagées": Projet de Fin D'ÉtudesDocument44 pages"Traitement Des Marchandises Endommagées": Projet de Fin D'ÉtudesYassine Boughaidi0% (1)
- Rapport Loubna TOUNZIDocument66 pagesRapport Loubna TOUNZISara Lailani50% (2)
- Axe 1Document33 pagesAxe 1Majid khachniPas encore d'évaluation
- Rapport en CoursDocument68 pagesRapport en CoursIsmail AdibPas encore d'évaluation
- Tableau de Bord A Marsa MarocDocument38 pagesTableau de Bord A Marsa MarocdanadanaPas encore d'évaluation
- 13-Article Text-49-1-10-20200726Document22 pages13-Article Text-49-1-10-20200726hajar alalouPas encore d'évaluation
- Environnement Économique Portuaire ResuméDocument8 pagesEnvironnement Économique Portuaire Resumémalika amriPas encore d'évaluation
- 6519 16240 1 PBDocument18 pages6519 16240 1 PByoussefriifiPas encore d'évaluation
- Lassana Cisse CompressedDocument72 pagesLassana Cisse Compressedrkgj4zwxksPas encore d'évaluation
- 7374 17752 1 PB PDFDocument14 pages7374 17752 1 PB PDFmohamed hamza kassiPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument19 pages1 PBzineb atertaPas encore d'évaluation
- AES Transport Maritime Et PortsDocument12 pagesAES Transport Maritime Et PortszinebPas encore d'évaluation
- 1 PB1Document17 pages1 PB1El Anbari AhmedPas encore d'évaluation
- Tâche EGTDocument7 pagesTâche EGTDouae RezkiPas encore d'évaluation
- YQB - Québec à la conquête de l'air: Québec City. The Sky's the Limit!D'EverandYQB - Québec à la conquête de l'air: Québec City. The Sky's the Limit!Pas encore d'évaluation
- La Motivation Au Coeur de La Performance PDFDocument6 pagesLa Motivation Au Coeur de La Performance PDFkoum juniorPas encore d'évaluation
- Voice Leading Classique Mars 2024Document69 pagesVoice Leading Classique Mars 2024scourtney2818Pas encore d'évaluation
- L'art de Réduire Les TêtesDocument180 pagesL'art de Réduire Les TêtesBerthier LetourneauPas encore d'évaluation
- Cultures Et Organisations Sociales - CMDocument7 pagesCultures Et Organisations Sociales - CMDjidioufPas encore d'évaluation
- TD #07: Loi Des Mailles, Loi Des Noeuds, Exercices: Fin Du TD (2 Heures)Document9 pagesTD #07: Loi Des Mailles, Loi Des Noeuds, Exercices: Fin Du TD (2 Heures)Omega SigmaPas encore d'évaluation
- TP Morpho PDFDocument15 pagesTP Morpho PDFEmmanuelPas encore d'évaluation
- Les OptionsDocument21 pagesLes OptionsTakwa BenabdallahPas encore d'évaluation
- Corps HumainDocument32 pagesCorps Humaintoni mendesPas encore d'évaluation
- Controle2020 CalculformelDocument2 pagesControle2020 CalculformelDebih Hibt Elrrahmane100% (1)
- Examen Blanc BEPC Borgou 2024 - CSECDocument7 pagesExamen Blanc BEPC Borgou 2024 - CSECAdonaïPas encore d'évaluation
- Des VertueuxDocument3 pagesDes VertueuxJean-Marie SourisPas encore d'évaluation
- Cours de Recherche OperationnelleDocument68 pagesCours de Recherche Operationnelleassane2mcs100% (3)
- 360 Un Cerveau Haute PerformanceDocument62 pages360 Un Cerveau Haute PerformanceShira GognonPas encore d'évaluation
- Decrets de Delivrance de Vos FinancesDocument30 pagesDecrets de Delivrance de Vos Financescount ossiePas encore d'évaluation
- La Crainte de L'eternelDocument8 pagesLa Crainte de L'eternelEdson Gerard Julmis100% (1)
- La Société Du Malaise. Commentaires de Castel.Document9 pagesLa Société Du Malaise. Commentaires de Castel.philopolitiquePas encore d'évaluation
- LP6 Travail Et Energie CinétiqueDocument2 pagesLP6 Travail Et Energie CinétiquesergiomisosPas encore d'évaluation
- Hadji MouzaouiDocument68 pagesHadji MouzaouilouhichihichemaliPas encore d'évaluation
- Francqis Commentaire Jean Bonnet Copie FinalDocument2 pagesFrancqis Commentaire Jean Bonnet Copie FinalBen BakPas encore d'évaluation
- Taire, Mentir, Simuler, Dissimuler... Un Long Héritage, Jean-Pierre CavailléDocument2 pagesTaire, Mentir, Simuler, Dissimuler... Un Long Héritage, Jean-Pierre Cavaillévictor.beaufils76Pas encore d'évaluation
- LIslam Et Le Centre Supreme VFDocument5 pagesLIslam Et Le Centre Supreme VFMustaphaRiadhBenlamriPas encore d'évaluation