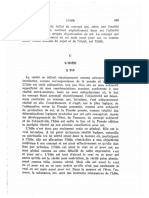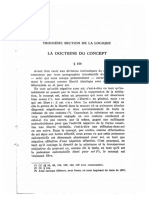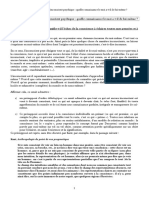Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cristal RSI PDF
Transféré par
Remus BabeuTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cristal RSI PDF
Transféré par
Remus BabeuDroits d'auteur :
Formats disponibles
RÉEL, SYMBOLIQUE, IMAGINAIRE : DU REPÈRE AU NŒUD
Vincent Clavurier
ERES | « Essaim »
2010/2 n° 25 | pages 83 à 96
ISSN 1287-258X
ISBN 9782749213163
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-essaim-2010-2-page-83.htm
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour ERES.
© ERES. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Réel, symbolique, imaginaire :
du repère au nœud
Vincent Clavurier
Le ternaire réel, symbolique, imaginaire est un paradigme sans doute
aussi important pour la psychanalyse lacanienne que les topiques freu-
diennes. On sait que Lacan, à partir de 1973, identifie ce ternaire au nœud
borroméen à trois ronds, soit chacun de ces trois termes à une des consis-
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
tances du nœud. Mais cette identification ne va pas de soi : si R, S et I sont
représentés par ou identifiés à des ronds de ficelle, pourquoi précisément
à ceux du borroméen ? Autrement dit, pour quelle raison l’articulation
entre les ronds de ficelle RSI est-elle figurable du borroméen ? Qu’est-ce
qui justifie le remplacement d’une relation non déterminée de RSI par
la relation borroméenne hyperdéterminée ? Le parcours qui suit est une
tentative pour répondre à cette question. On soutiendra d’abord l’idée
qu’une logique du repérage préside à l’apparition et à l’usage du ternaire
à partir de 1953 et qu’il s’agit selon cette logique de constituer pour la
clinique un repère à trois coordonnées. On explicitera alors les problèmes
que pose la présentation de RSI sous la forme d’un repère trivarié, dont
justement celui de l’articulation des registres. Nous isolerons ensuite les
gains théoriques offerts par le nœud borroméen comme support de RSI par
rapport à la présentation précédente. Enfin, il s’agira d’identifier certaines
difficultés propres à la présentation borroméenne à trois consistances.
Quelle articulation entre réel, symbolique et imaginaire ?
Lacan introduit ce ternaire dans le champ analytique lors de la
conférence intitulée « Le symbolique, l’imaginaire, le réel », prononcée le
8 juillet 1953 pour ouvrir les activités de la Société française de psycha-
Essaim 25.indd Sec5:83 12/11/10 11:09:40
84 • Essaim n° 25
nalyse 1. Il présente dans cette conférence « la confrontation de ces trois
registres qui sont bien les registres essentiels de la réalité humaine, registres
très distincts et qui s’appellent : le symbolisme 2, l’imaginaire et le réel ». Le
terme utilisé pour désigner S, I et R (pas encore réduits à des lettres) est
donc celui de « registre ». Le Littré le définit comme un « livre où l’on inscrit
les actes, les affaires de chaque jour » (les registres du greffe, de l’état civil
par exemple). On retrouve le mot dans différentes expressions : « Faire
registre », « tenir registre », qui désignent le fait d’enregistrer et de noter. Le
terme vient du latin de basse époque regesta 3 « registre, livre, catalogue », à
partir du participe passé de regerere « rapporter, inscrire, consigner ». On est
donc dans le domaine (le registre !) de l’écrit, de l’inscription : faire registre
(tenir les comptes) ; registrer (enregistrer, inscrire), et l’usage du mot est
ancien : « Afin que les honorables emprises […] soient notablement regis-
trées et mises en mémoire perpétuelle 4. » Avec la désignation de RSI comme
ternaire de registres, on a donc l’idée d’une notation différenciée, d’un
système de notations : il y a trois livres de notations différents, trois livres où
l’on note des choses qu’on pense appartenir à des ordres distincts.
Lors de la conférence de 1953, Lacan utilise également le terme plus
philosophique de « catégorie conceptuelle » pour désigner l’un des regis-
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
tres (l’imaginaire). Ce terme désigne classiquement ce qui vient subsumer
un certain nombre de phénomènes (extension), leur assigner une identité
commune au moyen du concept (intension, compréhension). Mais même si
l’on distingue conceptuellement ces trois registres, la relation qu’ils entre-
tiennent les uns avec les autres ne cessera d’être reprise et questionnée
par Lacan : « Présenter séparément ces trois dimensions répond à un souci
didactique. Il est cependant apparu régulièrement que l’on ne pouvait
parler d’une de ces dimensions séparément des autres et que l’opérateur
de chacun est relatif aux autres […]. De fait, il y a une nécessité à bâtir les
“jointures” des trois dimensions et c’est ce que tente à chaque fois Lacan
avec l’écriture de ses schémas (schéma L, schéma R), graphes et autres
figures, qui constituent comme les lignes de fracture du cristal RSI 5. » Sans
doute ces différentes tentatives de donner aux trois registres une articu-
lation ne satisfont pas totalement Lacan puisqu’en 1975, soit vingt-deux
ans après avoir introduit les termes et trois ans après avoir découvert le
1. Cf. version JL, site Internet de l’ELP.
2. Symbolisme et symbolique semblent utilisés indifféremment dans cette conférence.
3. O. Bloch et W. Von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, PUF, 1994
[1932].
4. J. Froissart (1360), Dictionnaire du moyen français, Larousse, 1992.
5. E. Porge, Jacques Lacan, un psychanalyste, Toulouse, érès, 2000, p. 122.
Essaim 25.indd Sec5:84 12/11/10 11:09:40
Réel, symbolique, imaginaire : du repère au nœud • 85
borroméen qui va finalement les tenir ensemble, il affirme que le lien entre
les trois registres est « énigmatique 6 ».
Cette question de l’articulation entre les registres ne surgit pas expli-
citement dans la conférence de 1953, mais Lacan en donne tout de même
à l’époque une figuration : il représente SIR sous forme d’un triangle dont
chaque registre est un sommet. Cette figuration lui sert pour illustrer une
circulation de l’analysant entre ces termes au cours de son analyse, pour
repérer le trajet du sujet dans la cure. R, S et I servent alors de balises, de
repères pour identifier les moments du trajet. En ce sens, puisqu’il s’agit de
moments de la cure, les « jonctions entre les trois dimensions ne sont pas à
concevoir seulement sur un plan spatial mais aussi temporel, en particulier
en fonction du maniement du transfert 7 ». On le voit, qu’il soit spatial ou
temporel, RSI sert d’emblée à effectuer un repérage, une façon de situer
un phénomène, d’en donner les coordonnées. RSI semble fonctionner ici
comme un repère pour la clinique.
RSI : un repère lacanien ?
L’hypothèse est la suivante : de même qu’il existe des repères carté-
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
siens à partir desquels nous pouvons lire et écrire le monde des corps et
des figures, il existe des repères lacaniens qui définissent une manière
de lire et d’écrire le monde de la clinique, et RSI est l’un d’eux. On peut
s’appuyer pour étayer cette hypothèse sur une affirmation de Lacan, qui
déclare en 1960 que la distinction entre R, S et I est méthodique, qu’elle relève
d’une méthode : « Cette force [du délire] est celle [que Freud] a désignée
sous le nom de narcissisme et qui comporte une dialectique secrète où les
psychanalystes se retrouvent mal […] (c’est pour la faire concevoir que
j’ai introduit, dans la théorie, la distinction proprement méthodique, du
symbolique, de l’imaginaire et du réel 8). » Or les deux termes promus dans
cette citation sont éminemment cartésiens : « distinction » et « méthode »
sont des éléments majeurs dans l’œuvre de Descartes 9. C’est pourquoi,
conformément à la veine cartésienne du Discours, le terme « méthodique »
me semble avoir dans cette citation de Lacan le sens de « mathématique ».
Et c’est le travail de Descartes dans le champ de la géométrie auquel on
peut faire appel, et particulièrement un des trois essais qui suit le Discours
6. Cf. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, séance du 18.11.1975, cité par E. Porge, « Du
déplacement au symptôme phobique », Littoral, n° 1, juin 1981, p. 35.
7. E. Porge, op. cit., p. 124.
8. J. Lacan, Conférence donnée à la faculté universitaire Saint-Louis, à Bruxelles, le 10 mars 1960.
Disponible sur le CD Pas-tout Lacan. Cité par M. Viltard, « L’autopunition : une solution à l’im-
passe imaginaire du transfert chez Dora », Littoral, n° 30, octobre 1990, p. 65-66.
9. Cf. par exemple la quatrième règle des Regulae, l’article 45 des Principes de la philosophie, la troi-
sième des Méditations métaphysiques et le Discours de la méthode.
Essaim 25.indd Sec5:85 12/11/10 11:09:40
86 • Essaim n° 25
et qui s’intitule La géométrie 10. On fait classiquement de cet essai un point
de bascule dans l’histoire des sciences et des mathématiques : Descartes est
censé y fonder – le point est discuté – la géométrie algébrique, en inven-
tant ce qui va devenir le système des coordonnées cartésiennes et qui va
permettre un développement important de la physique (étude du mouve-
ment, mécanique newtonienne). Le ternaire RSI est ainsi méthodique selon
la méthode de géométrie algébrique promue par Descartes : la distinction
R, S, I permet de mathématiser ce qui apparaît dans la clinique, au sens où
le phénomène clinique observé est situé selon un système de coordonnées
supporté par un jeu de lettres. Il est donc écrit en langage mathématique,
selon un processus de littéralisation (ramener un élément à une lettre) 11.
Pour illustrer ce mouvement, on peut dessiner RSI comme un repère
lacano-cartésien et y inscrire pour l’exemple une formation de l’inconscient
de Freud analysée par Lacan en 1955 : le rêve de l’injection faite à Irma.
Les coordonnées lacaniennes du rêve de l’injection faite à Irma 12
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
10. En 1637, Descartes publie un gros livre de 527 pages dont le titre complet est : Discours de la
Méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Plus la Dioptrique, les
Météores et la Géométrie, qui sont les Essais de cette méthode. À l’époque, le Discours est donc la
préface de trois traités scientifiques d’importance. Paradoxalement, on étudie aujourd’hui encore
cette préface mais plus les Essais qui la suivaient, parce qu’ils sont « dépassés, vieillis, périmés »
(cf. A. Koyré, Introduction à la lecture de Platon, suivi de Entretiens sur Descartes, Paris, Gallimard,
1991, p. 166-167).
11. Cf. J.-C. Milner, L’œuvre claire, Paris, Le Seuil, 1995, p. 92 et 94-95.
12. Cf. J. Lacan, Le Séminaire, Livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychana-
lyse, Paris, Le Seuil, 1978. Séances du 9, 16 et 30 mars 1955. Sur la constituante réelle du rêve, voir
en particulier p. 186, 196 et 209 ; sur la constituante imaginaire, voir p. 187-188 et 197-199 ; sur la
constituante symbolique, voir p. 190-192 et 200-203.
Essaim 25.indd Sec5:86 12/11/10 11:09:40
Réel, symbolique, imaginaire : du repère au nœud • 87
Mais ce système de coordonnées pose au moins quatre problèmes :
– En premier lieu, la construction de chaque coordonnée, de chaque projec-
tion de point, exige un commentaire argumentatif (cf. note 12 les séances
de séminaire où Lacan fait ce travail). Le système construit ne produit ainsi
pas de position univoque des phénomènes analysés : chaque coordonnée
reste sujette à discussion, elle n’est pas le résultat d’un calcul.
– De plus, il n’y a pas d’unité (valeur étalon) qui donnerait sa raison à la
construction de l’ordre des points sur chaque axe : écrire Rn, In, Sn signifie
que plusieurs points peuvent être isolés sur chaque axe mais sans que leur
ordre puisse être autrement constitué que par un acte plus ou moins arbi-
traire (en tout cas pas selon une règle extérieure et décisive comme peut
l’être une ligne de calcul). Il y a pour ces deux premières raisons un écart
indépassable entre l’exactitude d’un repérage physico-mathématique et ce
qui est proposé ici. On en reste à une « commodité descriptive 13 », selon les
mots de Jean-Claude Milner, et pas à une adéquation littérale du repère et
de la clinique au sens où géométrie et algèbre sont adéquats l’un à l’autre.
Puisqu’on n’est pas dans une mesure des phénomènes (une métrique) mais
dans une approche qualitative, le repère orthonormé n’est vraisemblable-
ment pas le bon synoptique.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
– Le troisième problème rejoint notre question initiale : c’est celui du point
et de la nature de la jonction entre les trois axes R, S et I. C’est ce qu’in-
dique le « ? » placé en position d’origine. Le repère orthonormé ne nous
donne pas d’élément de réponse sur cette question. Ce second problème
sera « résolu » par l’apparition du nœud borroméen et son application au
ternaire.
– Enfin, quatrième problème, doctrinal celui-là, l’hypothèse de RSI comme
repère lacanien et système de coordonnées rencontre une objection venant
de la bouche même de Lacan en 1973 : « C’est qu’il y a trois dimensions de
l’espace habité par le parlant, et que ces trois dit-mansions, telles que je
les écris, s’appellent le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel. C’est pas tout à
fait comme les coordonnées cartésiennes ; c’est pas parce qu’il y en a trois,
ne vous y trompez pas. Les coordonnées cartésiennes relèvent de la vieille
géométrie. C’est parce que […] c’est un espace, le mien, tel que je le définis
de ces trois dit-mansions, c’est un espace dont les points se déterminent
tout autrement. Et c’est ce que j’ai essayé […] c’est une géométrie dont les
points […] se déterminent du coinçage de ce dont vous vous souvenez
peut-être, que j’ai appelé “mes ronds de ficelle” 14. » Je relève deux éléments
dans cette citation :
D’abord, lorsque Lacan indique la nécessité d’écrire le terme « dit-
mansion », mansion du dit, il le fait en référence au terme anglais mansion
13. J.-C. Milner, op. cit., p. 142.
14. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XXI, Les non-dupes errent, inédit, séance du 13.11.1973.
Essaim 25.indd Sec5:87 12/11/10 11:09:40
88 • Essaim n° 25
qui signifie « château, demeure » et dont l’étymologie indique la parenté
avec le mot français « manoir ». Réel, symbolique et imaginaire constituent
le lieu d’habitation du dit, donc de l’homme qualifié de parlêtre : ils sont les
trois dimensions constitutives de l’espace habité par l’homme en tant qu’il
est un être parlant. Lacan poursuivait là à sa manière l’idée exprimée poéti-
quement par Heidegger, à la suite de Hölderlin : l’homme habite en poète,
l’homme habite le langage 15. Ceci m’amène à penser que le « manoir » RSI,
avec le passage au nœud, pourrait s’entendre et s’écrire « mano-art » : plus
que le schéma, le nœud engage le corps et particulièrement la main, il faut
le manipuler, le saisir pour l’appréhender, il fait appel à un art de la main,
un art de la mano, un mano-art.
Passons au deuxième point que je voulais souligner dans cette citation :
certes, et c’est là sans doute l’essentiel, le passage au nœud éloigne de la
« vieille géométrie » et nous fait entrer dans une autre logique, une logique
nodale où les points « se déterminent tout autrement », où ce qui est déter-
minant est le coinçage des ronds de ficelle. Mais si Lacan récuse pour cette
raison explicitement l’identification complète de RSI à des coordonnées
cartésiennes, il soutient tout de même la pertinence de ce rapprochement :
si les dit-mansions ne sont « pas tout à fait » des coordonnées cartésiennes,
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
cela signifie qu’elles le sont au moins un peu, tout du moins suffisamment
pour que la mise en relation soit légitime. Surtout, si les ronds de ficelle
continuent de se nommer RSI, c’est qu’ils participent encore de la logique
de repérage même s’ils ne s’y réduisent plus. Il y a dans le même temps
dépassement et conservation de cette logique. Voyons maintenant la façon
dont RSI fonctionne comme repère borroméen.
Le nœud borroméen
C’est un certain nouage (borroméen) qui fait tenir à partir de 1973 16
les trois registres ensemble, et le point de jonction est donc un point de
coinçage, un trou : c’est l’objet a. Il semble remplir la même fonction, mais
différemment, que le zéro dans le repère cartésien 17. On peut déjà noter,
concernant cette identification du ternaire au nœud borroméen à trois
consistances, que le mot « registre » a, par lui-même et pour deux raisons,
une parenté avec le domaine de la ficelle et du tissage. D’abord via le
latin registrum campanae venant du sens premier de regere (« tirer ») et qui
désigne la « corde de cloche » qu’on tire pour obtenir le son. Le « registre »
ici désigne la corde qu’on tire. Or ceci fait immédiatement penser à la
15. Cf. E. Porge, op. cit., p. 220.
16. Lors du séminaire Les non-dupes errent, cf. C. Conté, « Borroméens (nœuds) », dans P. Kaufmann,
L’apport freudien, Paris, Bordas, 2003, p. 78.
17. C’est une piste de recherche à développer.
Essaim 25.indd Sec5:88 12/11/10 11:09:40
Réel, symbolique, imaginaire : du repère au nœud • 89
question du « tirer la ficelle » omniprésente dans l’étude des nœuds et
évoquée par Lacan le 9 janvier 1979. Pas moyen d’étudier un nœud sans en
tirer (même mentalement) les ficelles pour en faire apparaître les points de
coinçage. Par ailleurs, le mot « registre » désigne selon la même voie latine
« la commande de chacun des jeux [règles en bois] de l’orgue », que l’orga-
niste tire pour jouer. Et c’est à partir de ce dernier sens que le mot s’est mis
à désigner également « l’étendue totale de la voix d’un chanteur 18 », proba-
blement selon un processus de déplacement métonymique (de chaque règle
en bois à l’ensemble des règles) et métaphorique (de l’orgue à la voix). Or
« l’étendue totale de la voix » se dit également « tessiture », terme qui vient
du latin tessere (tisser), via l’italien tessitura (texture, trame). L’équivalence
sémantique entre registre et tessiture crée un lien (certes ténu comme un
fil mais avéré) entre l’art de la notation et celui de la tresse. Pour ces deux
raisons liées à la fois à l’étymologie et à l’usage du mot « registre », il est
amusant de constater que le rapprochement qu’opère Lacan en 1973 entre
RSI et le champ du nœud (cordage, nouage, tissage) équivaut à faire surgir
un savoir implicite de la langue, donc un savoir pour partie déjà là en 1953
dans le seul acte de nommer « registres » les catégories du ternaire.
Si on considère maintenant RSI comme un nœud borroméen consti-
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
tuant un repère mathématique en clinique, on peut écrire sa mise à plat et
y inscrire les différentes coordonnées du rêve qu’on a isolées avec Lacan.
Un tel mouvement consiste à inscrire le rêve de l’injection faite à Irma
au centre d’un nœud borroméen dont les consistances sont quasi super-
posées (1er temps). Puis on tire sur chacune d’elles et le phénomène étudié
se diffracte en ses trois constituantes distinctes correspondant aux trois
registres (2e temps) :
1er temps : Inscription du rêve dans RSI
18. Le Robert.
Essaim 25.indd Sec5:89 12/11/10 11:09:40
90 • Essaim n° 25
2e temps : Coordonnées du rêve dans un repère borroméen (trois consistances)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Les avantages de cette présentation, donc de l’identification des trois
registres à des ronds de ficelle noués borroméennement, sont multiples et
permettent de répondre à notre question initiale : pourquoi figurer l’articu-
lation entre les registres à l’aide du borroméen ?
D’abord, cette présentation résout la question du nouage des trois
axes sans les confondre en un point (si ce n’est un point de coinçage, un
« point triple » selon Lacan), tout en faisant exister un trou, un vide central
et ambiant, donc un espace troué, non total, contrairement au système
des coordonnées cartésiennes qui, d’une certaine façon, est un espace clos
(englobant tout point possible).
D’autre part, cette présentation, contrairement aux axes, fait exister
des champs. Elle se maintient ainsi dans une logique de repérage mais
s’éloigne de la « vieille géométrie » du repère cartésien, d’autant plus
qu’avec les champs disparaît la difficulté qu’on a rencontrée tout à l’heure
pour justifier l’ordre des points sur les axes (Rn, In, Sn). Dans un champ,
on peut placer les éléments sans se soucier de leur ordre respectif.
Autre avantage : le nœud borroméen permet de tenir ensemble les
registres sans qu’il y ait de rapport duel entre eux (concaténation, traversée,
violation des trous). Or Guy Le Gaufey dit, en s’appuyant sur la séance du
15 avril 1971 du séminaire RSI, que le rapport sexuel est « supporté par
Essaim 25.indd Sec5:90 12/11/10 11:09:41
Réel, symbolique, imaginaire : du repère au nœud • 91
la concaténation simple 19 ». En ce sens, le borroméen métaphorise le non-
rapport sexuel et illustre un non-rapport qui n’est pas seulement absence
de rapport : c’est un non-rapport qui a une définition positive puisqu’il
permet le coinçage du nœud.
Autre avantage encore : avec le borroméen disparaît toute idée de
suprématie d’un registre sur les autres. Avec la parfaite substituabilité
des ronds en termes de coupure (qu’on coupe n’importe lequel et les deux
autres sont libérés), le borroméen assure une non-hiérarchie des regis-
tres, sur laquelle Lacan revient à plusieurs reprises 20. Il n’y a « aucune
préséance 21 » d’un registre sur les autres, ils ont même valeur et en même
temps il faut les distinguer.
Dernier avantage : selon Milner, cette présentation permet une mathé-
matisation plus accomplie de la psychanalyse. Le nœud « en tant que
borroméen, se révèle propre à structurer, ou plus exactement à mathé-
matiser […] le ternaire du réel, du symbolique et de l’imaginaire […].
Jusque-là, la doctrine pouvait, et de plus en plus précisément, déterminer
ce qu’elle entendait par le réel, par le symbolique et par l’imaginaire ; elle
ne pouvait cependant rien articuler de robuste sur leur mode de coexis-
tence. Désormais, le nœud borroméen se révèle, par cette sorte de bonheur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
qu’on rencontre parfois dans les lettres, offrir la solution la plus claire et la
plus féconde 22. » Il faut toutefois nuancer cette affirmation par le fait que
cette solution (ce lien entre RSI) dite « la plus claire » par Milner est toujours
qualifiée d’« énigmatique » par Lacan en 1975. Mais Milner va plus loin :
« Auparavant, les majuscules R, S et I pouvaient passer pour de simples
abréviations, sans autre règle de maniement que la commodité descriptive,
sans autre légitimité que d’être des initiales [critique qu’on a dite particu-
lièrement pertinente dans le cas de la formalisation de RSI comme repère
cartésien]. Devenues, chacune d’entre elles, le label d’un rond borroméen-
nement noué à deux autres, elles se découvrent prises dans une loi réelle
qui les contraint. » Le passage de RSI-repère à RSI-nœud ouvre des possibi-
lités de calcul à partir des ronds identifiés aux lettres, ce qui est toujours
selon Milner le propre d’une mathématisation (littéralisation et calcul),
donc d’une scientificisation de la psychanalyse. Si l’on accepte ce mouve-
19. Cf. Guy Le Gaufey, Le pas-tout de Lacan, Paris, EPEL, 2006, p. 155 et suivantes.
20. Par exemple, lors de la séance du 11.02.75 du séminaire RSI : « Homogénéiser [R, S et I], c’est
les ramener à la valeur de ce qui communément enfin est considéré comme le plus bas – on se
demande au nom de quoi – c’est leur donner une consistance pour tout dire de l’imaginaire.
C’est bien en ça qu’il y a quelque chose à redresser : la consistance de l’imaginaire est strictement
équivalente à celle du symbolique comme à celle du réel. C’est même en raison du fait qu’ils sont
noués de cette façon, c’est-à-dire d’une façon qui les met strictement l’un par rapport à l’autre,
l’un par rapport aux deux autres, dans le même rapport. »
21. Cf. Guy Le Gaufey, op. cit., p. 158.
22. J.-C. Milner, op. cit., p. 142.
Essaim 25.indd Sec5:91 12/11/10 11:09:41
92 • Essaim n° 25
ment de scientificisation par le nœud, reste la difficile tâche de trouver à
quoi correspondent en clinique les calculs faits à partir de ces ronds.
Tous les avantages de ce « support » de RSI par le nœud borroméen à
trois consistances ne vont toutefois pas sans problèmes, notamment celui
de la différenciation entre les zones de recoupements des registres. Il serait
en effet souhaitable que le support choisi pour RSI permette de distinguer
le « symboliquement imaginaire » de l’« imaginairement symbolique » par
exemple, puisque Lacan rappelle en 1955 qu’il y a une différence entre
« iS » et « sI » : « Rappelez-vous ce que, dans la conférence inaugurale de
cette société [8 juillet 1953], je vous évoquais à propos du symbolique, de
l’imaginaire et du réel. Il s’agissait d’user de ces catégories sous forme de
petites et de grandes lettres. iS – imaginer le symbole, mettre le discours
symbolique sous forme figurative, soit le rêve. sI – symboliser l’image,
faire une interprétation de rêve 23. » Or avec ce simple repère à trois consis-
tances, nous ne pouvons pas distinguer « iS » et « Si » : le seul champ de
recoupement qui apparaît participe des deux registres de façon équiva-
lente. Les éléments qui s’inscrivent dans ces zones ne sont qualifiables
que de « symbolique et imaginaire », ou « imaginaire et symbolique », pas
de « imaginairement symbolique » ou « symboliquement imaginaire ».
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Ceci est une insuffisance manifeste du borroméen à trois consistances
comme support de RSI. C’est tout de même préoccupant, d’autant que
d’autres formes que le rêve illustrent la nécessité de préciser les types de
recoupement. Je pense notamment aux anagrammes ou textes figuratifs et
également, dans le même ordre d’idées, à une calligraphie chinoise 24 que
présente Rainier Lanselle dans un article de la revue Essaim 25 (cf. dessin
n° 1 p. 95) :
« Dans [cette] calligraphie, ce signifiant graphique [l’élément qui
signifie “démon”, “esprit”] a été remplacé par la chose même […]. Dans
ce contexte de porosité entre l’objet et la représentation [correspondant à
l’origine pictographique des caractères chinois], le signifié a facilement pris
la place du signifiant : à la place de , qui veut dire “démon”, “esprit”, le
calligraphe a mis le dessin d’un démon, d’un esprit. Ce dessin se trouve, sur
la calligraphie, exactement dans la même position que le signe auquel
il s’est substitué : au bout de son pied, on reconnaît l’élément , dans la
même position que par rapport à , dans le caractère . Ce “dessin
calligraphique” réalise donc, autrement dit inscrit dans le réel, le signifiant
graphique . » Le trait remarquable de cette calligraphie est que, « les
23. J. Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, op. cit., p. 184-185.
24. D’ailleurs, selon le Dictionnaire international des termes littéraires, le chantre de l’anagramme, Apol-
linaire, était féru d’écriture chinoise.
25. Il s’agit d’une calligraphie de Ma Dezhao (XIXe siècle, conservée à la Forêt des Stèles, Xi’an),
présentée par Erik Porge lors de son séminaire en 2004 et publiée avec les explications de Rainier
Lanselle dans Essaim, n° 13.
Essaim 25.indd Sec5:92 12/11/10 11:09:41
Réel, symbolique, imaginaire : du repère au nœud • 93
yeux mis à part, ce “corps” n’est […] pas formé d’autre chose que d’un
amas de caractères d’écriture : en l’occurrence des huit caractères compo-
sant les deux formules et , caractères traités ici sous des
formes cursives ». « Cet holographe qu’est la calligraphie s’organise alors
en rébus. » Avec cette référence au rébus, on retrouve le rêve, désigné par
Lacan comme une opération iS. Le réel dont parle Rainier Lanselle est celui
de l’œuvre même, de la réalité de l’œuvre peinte. On peut opposer ce réel
au caractère imaginaire, non réalisé, du rêve. Le processus calligraphique
présenté ici pourrait donc s’écrire « rS », au sens où il réalise le symbo-
lique (Lanselle écrit : « Le dessin […] réalise le signifiant graphique ») ; et
la lecture de la calligraphie faite et permise par Lanselle s’écrirait alors
« sR », soit symboliser le réel. Toutefois, je pense que le réel ici indiqué a
affaire à l’image peinte, soit à l’imaginaire (quand bien même il se réalise
en peinture) plutôt qu’à la catégorie du réel comme impossible.
Je disais que le nœud à trois ronds ne permet pas de présenter ces
nuances entre les recoupements de registres, or ces nuances renvoient fina-
lement à la « triplicité » de chaque registre qui se décompose lui-même en
trois éléments RSI : dans le nœud borroméen à trois consistances, il y a selon
Lacan « une identité entre les trois termes du symbolique, de l’imaginaire
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
et du réel au point qu’il nous semble exigible de retrouver dans chacun
cette triplice, cette trinité du symbolique, de l’imaginaire et du réel 26 ». RSI
se retrouve ainsi en chacun de ses éléments. Je propose de figurer cette
triplicité de chaque consistance, et donc cette distinction entre des champs
laissés indistincts par le nœud à trois ronds, à l’aide d’un nœud borroméen
à neuf ronds (cf. dessin n° 2, p. 95). On peut aussi choisir une figuration
qui inclut la fonction du sinthome, soit un nœud borroméen à dix ronds
(neuf ronds « mal » noués plus le rond du sinthome qui assure le caractère
borroméen de la chaîne, voir dessin n° 3, p. 96). Ces deux figures résolvent
le problème évoqué qu’on peut nommer « problème du type de recoupe-
ment » : sur chacune d’elles, on distingue bien « sI » de « Is ».
Autre problème du support borroméen de RSI, celui de la solidité de ce
nœud, qui implique la solidité de chacune de ses consistances. Il s’agit de
savoir ce que signifie cette solidité, et donc par conséquent ce que signifie la
coupure : que peut signifier couper un rond, dès lors qu’il est identifié à un
registre ? Qu’il tienne ou qu’il cède implique qu’il ait quelque consistance.
C’est la question de la pertinence d’une « définition physique 27 » du nœud,
dès lors qu’il supporte RSI, qui est posée, avec la notion de consistance de
chaque rond-registre. Ce problème est trop vaste et complexe pour moi en
l’état pour que j’en écrive davantage. Mais il me semble être une sérieuse
piste de travail.
26. RSI, séance du 13 mars 1975, cité par Erik Porge, op. cit., p. 167.
27. Selon le mot de Guy Le Gaufey, op. cit., p. 158.
Essaim 25.indd Sec5:93 12/11/10 11:09:41
94 • Essaim n° 25
En guise de conclusion et d’invitation à poursuivre
La logique du repérage qui préside à l’apparition de RSI en 1953 est
nécessaire en clinique et elle est encore présente lorsque Lacan introduit
la logique nodale. Mais ces deux logiques sont irréductibles l’une à l’autre
et inscrire comme nous l’avons fait une formation de l’inconscient dans
un repère, si borroméen soit-il, n’est pas entrer dans la logique nodale.
Pour autant, la logique du nœud ne nie pas la logique du repérage : elle la
dépasse au sens d’une Aufhebung, elle la dépasse en la conservant :
– ce qui est conservé : les lettres RSI correspondant à des registres-
assemblages et l’existence d’un repère ;
– ce qui est dépassé : l’inscription sur une surface comme un schéma ou une
mise à plat qui aurait finalement une simple fonction illustrative (fixation
ou retour à la « vieille géométrie ») ;
– ce qui est nouveau : le tenir ensemble et ce que nous avons à trouver de
spécifiquement novateur grâce à cette question du coinçage (la question
spécifique du nœud). Dans ce cadre, les problèmes de la signification
clinique du calcul des ronds et de la consistance des registres demande-
raient bien d’autres développements.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Essaim 25.indd Sec5:94 12/11/10 11:09:41
Réel, symbolique, imaginaire : du repère au nœud • 95
Dessin n° 1
Calligraphie chinoise
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Dessin n° 2
Repère borroméen à 9 consistances
Essaim 25.indd Sec5:95 12/11/10 11:09:41
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
12/11/10 11:09:41
Repère borroméen à 10 consistances
Dessin n° 3
96 • Essaim n° 25
Essaim 25.indd Sec5:96
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Bernabeu Rémy - 217.128.117.14 - 21/07/2020 20:07 - © ERES
Vous aimerez peut-être aussi
- Ess 022 0065Document16 pagesEss 022 0065danieulaPas encore d'évaluation
- Vers Une Pensée de Lentre-Deux - 2017Document17 pagesVers Une Pensée de Lentre-Deux - 2017geraldinemariereinePas encore d'évaluation
- Le Moi-Peau Et La RéflexivitéDocument15 pagesLe Moi-Peau Et La RéflexivitéMarina ZilmiaPas encore d'évaluation
- Cardi - La Mauvaise MèreDocument12 pagesCardi - La Mauvaise MèreMrhOOdPas encore d'évaluation
- Psye 621 0079Document39 pagesPsye 621 0079Kermens SemervilPas encore d'évaluation
- Le Travail Avec Les Familles Au Csapa Monceau - Pertes Ambiguës, Liens Ambigus Et AddictionDocument16 pagesLe Travail Avec Les Familles Au Csapa Monceau - Pertes Ambiguës, Liens Ambigus Et AddictionMokihoPas encore d'évaluation
- Balz 005 0021Document19 pagesBalz 005 0021Dardo CocettaPas encore d'évaluation
- L'audition Prénatale-Granier-Deferre - BusnelDocument17 pagesL'audition Prénatale-Granier-Deferre - BusnelThomasPas encore d'évaluation
- Le Breton - SUR LE TATOUAGE CONTEMPORAINDocument8 pagesLe Breton - SUR LE TATOUAGE CONTEMPORAINDionysis PapPas encore d'évaluation
- Caph 139 0021Document18 pagesCaph 139 0021Dmt DmtPas encore d'évaluation
- Soco 108 0015Document26 pagesSoco 108 0015erferefePas encore d'évaluation
- Réflexions À Propos Du Traitement Des Psychoses Par Le PsychodrameDocument17 pagesRéflexions À Propos Du Traitement Des Psychoses Par Le PsychodramenclsfaucherPas encore d'évaluation
- Théologie Et Politiquele Débat de Davos Entre Ernst Cassirer Et Martin Heidegger Revisité - BarashDocument17 pagesThéologie Et Politiquele Débat de Davos Entre Ernst Cassirer Et Martin Heidegger Revisité - Barashenanodumbi100% (1)
- Les Pères AnalyseursDocument15 pagesLes Pères AnalyseursRosana DantasPas encore d'évaluation
- Tumu 017 0129Document19 pagesTumu 017 0129Juliano BonamigoPas encore d'évaluation
- Ok - 2019 - La Folie de La Norme - de La Norme À La CriseDocument21 pagesOk - 2019 - La Folie de La Norme - de La Norme À La CriseLuciano Alvarenga MontalvãoPas encore d'évaluation
- Eres Morea 2007 01 0007Document32 pagesEres Morea 2007 01 0007yadaPas encore d'évaluation
- Frank RenucciDocument8 pagesFrank RenucciVincent JaunasPas encore d'évaluation
- Nre 029 0167Document4 pagesNre 029 0167shushuPas encore d'évaluation
- LE TRAVAIL SOCIAL À LÉPREUVE Face Aux Défis Dynamiques Et Reconquête de Sens..Document9 pagesLE TRAVAIL SOCIAL À LÉPREUVE Face Aux Défis Dynamiques Et Reconquête de Sens..Logan Le GofficPas encore d'évaluation
- Annick Louis Critique Faire Collecte 2020Document13 pagesAnnick Louis Critique Faire Collecte 2020Caro RamalloPas encore d'évaluation
- Dionysos AntioedipeDocument19 pagesDionysos AntioedipeSouheila ChebelPas encore d'évaluation
- ZAFIROPOULOS - La Femme Contre La MèreDocument6 pagesZAFIROPOULOS - La Femme Contre La MèreBrenda R.Pas encore d'évaluation
- Francis Dupuis-Déri - La Démocratie MédiévaleDocument19 pagesFrancis Dupuis-Déri - La Démocratie MédiévaletrululupoiluPas encore d'évaluation
- Eres Nassi 2009 01 0045Document23 pagesEres Nassi 2009 01 0045Ioan PopescuPas encore d'évaluation
- 2016 - L - Illusion Du Comique Vous Emmène Quelquefois Du Côté de La VeriteDocument8 pages2016 - L - Illusion Du Comique Vous Emmène Quelquefois Du Côté de La VeriteLuciano Alvarenga MontalvãoPas encore d'évaluation
- Aricle NRE Souriau - Les Deux Cent Mille SituationsdramatiquesDocument10 pagesAricle NRE Souriau - Les Deux Cent Mille SituationsdramatiquesBorisPas encore d'évaluation
- Sujet Limite Et Limites Du SujetDocument10 pagesSujet Limite Et Limites Du SujetNadège HollardPas encore d'évaluation
- Division Subjective Et Division Dans La PsychanalyseDocument8 pagesDivision Subjective Et Division Dans La Psychanalysevince34Pas encore d'évaluation
- La Répétition Ne Se Produit Qu'une Seule FoisDocument12 pagesLa Répétition Ne Se Produit Qu'une Seule Foisvince34Pas encore d'évaluation
- Herm 026 0345Document4 pagesHerm 026 0345laajimi olfaPas encore d'évaluation
- De Corps Et de Textes. La Danse Des DramaturgesDocument14 pagesDe Corps Et de Textes. La Danse Des DramaturgesMed yahya BensalahPas encore d'évaluation
- Baisse Un Peu La JalousieDocument2 pagesBaisse Un Peu La JalousienclsfaucherPas encore d'évaluation
- L'Exces, Un Defaut - Anne-Marie SibireffDocument11 pagesL'Exces, Un Defaut - Anne-Marie SibireffwaldisiusPas encore d'évaluation
- Sabot, Philippe - Écritures Transgressives Et Pensée de La TransgressionDocument17 pagesSabot, Philippe - Écritures Transgressives Et Pensée de La TransgressionL FelipePas encore d'évaluation
- Descombes - L'équivoque Du SymboliqueDocument30 pagesDescombes - L'équivoque Du SymboliqueAelessar NabodyPas encore d'évaluation
- Autour Du Corps Souffrant: Relation Médecin-Patient-Entourage, Trio Infernal Ou Constructif ?Document22 pagesAutour Du Corps Souffrant: Relation Médecin-Patient-Entourage, Trio Infernal Ou Constructif ?MokihoPas encore d'évaluation
- Claude Landman - Mise en ContinuitéDocument5 pagesClaude Landman - Mise en ContinuitézgrounchPas encore d'évaluation
- Enje 003 0007Document19 pagesEnje 003 0007Hawraa MswPas encore d'évaluation
- Jouir Du Sens Le Symptôme À La LettreDocument8 pagesJouir Du Sens Le Symptôme À La LettreheinrothPas encore d'évaluation
- Pro 357 0079 PDFDocument6 pagesPro 357 0079 PDFLoloPas encore d'évaluation
- Cpsy 030 0027Document18 pagesCpsy 030 0027Maurizio BalsamoPas encore d'évaluation
- H. Gomez Du Stéréotype À La Relation D AideDocument23 pagesH. Gomez Du Stéréotype À La Relation D AideBassetPas encore d'évaluation
- MazzerismeDocument14 pagesMazzerismeMauvePas encore d'évaluation
- Soco 071 0117Document21 pagesSoco 071 0117Marina DuartePas encore d'évaluation
- Névrose Obsessionnelle, Névrose IdéaleDocument9 pagesNévrose Obsessionnelle, Névrose IdéalefabricePas encore d'évaluation
- Age Maconnique Et Modernite Ou LAge Du DDocument16 pagesAge Maconnique Et Modernite Ou LAge Du DWagner Da CruzPas encore d'évaluation
- Bouriche 2003Document33 pagesBouriche 2003boumedienne bourichePas encore d'évaluation
- CSL 0601 0175Document41 pagesCSL 0601 0175aguerd simohPas encore d'évaluation
- Schmutz - L'Invention Jésuite Du Sentiment D'existenceDocument18 pagesSchmutz - L'Invention Jésuite Du Sentiment D'existenceFirmin DoduPas encore d'évaluation
- Page 2 Le Corps ManuelDocument38 pagesPage 2 Le Corps ManuelelinamaliciaPas encore d'évaluation
- LA TIERCÉITÉ PIERRE DE ROSETTE DE LA SÉANCE PeranDocument16 pagesLA TIERCÉITÉ PIERRE DE ROSETTE DE LA SÉANCE PeranGratadouxPas encore d'évaluation
- Epstein - 2013 - Des Tambours Sur Les Murs La Mise en Image DDocument17 pagesEpstein - 2013 - Des Tambours Sur Les Murs La Mise en Image Danastasia.clementePas encore d'évaluation
- Edb 035 0031Document22 pagesEdb 035 0031aguerd simohPas encore d'évaluation
- All 224 0148Document12 pagesAll 224 0148Chiara BonsignorePas encore d'évaluation
- Psy 030 0089Document13 pagesPsy 030 0089erin turneerPas encore d'évaluation
- Enje 012 0039Document15 pagesEnje 012 0039Lorena BarajasPas encore d'évaluation
- Savidan La Constellation Post-Nationale Et L'avenir de L'etat LibéralDocument36 pagesSavidan La Constellation Post-Nationale Et L'avenir de L'etat LibéralZobel ClemensPas encore d'évaluation
- Cheikh Echange Sexuel Monetarisã© Au MarocDocument17 pagesCheikh Echange Sexuel Monetarisã© Au MarocRistaniPas encore d'évaluation
- 12 NidanasDocument5 pages12 NidanasRemus BabeuPas encore d'évaluation
- IdéeDocument136 pagesIdéeRemus BabeuPas encore d'évaluation
- ObjetDocument51 pagesObjetRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Jean YvesDocument9 pagesJean YveshhedfiPas encore d'évaluation
- Concept SubjectifDocument126 pagesConcept SubjectifRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Collection de Nombres, École de Pythagore, Décade Des NombresDocument4 pagesCollection de Nombres, École de Pythagore, Décade Des NombresRemus BabeuPas encore d'évaluation
- RETOUR DodécaDocument1 pageRETOUR DodécaRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Reflexion ApparenceDocument112 pagesReflexion ApparenceRemus BabeuPas encore d'évaluation
- ÊtreDocument124 pagesÊtreRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Ix. Le Triangle de L Androgyne Et Le Monosyllabe OmDocument81 pagesIx. Le Triangle de L Androgyne Et Le Monosyllabe OmMorpheus OuattPas encore d'évaluation
- VoyellesDocument1 pageVoyellesRemus BabeuPas encore d'évaluation
- CaroubierDocument11 pagesCaroubierRemus BabeuPas encore d'évaluation
- ArchangesDocument13 pagesArchangesRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Cristal RSI PDFDocument15 pagesCristal RSI PDFRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Les Cinq Esprits de Lhomme Divin Aspects PDFDocument24 pagesLes Cinq Esprits de Lhomme Divin Aspects PDFDaboPas encore d'évaluation
- ArchangesDocument13 pagesArchangesRemus BabeuPas encore d'évaluation
- On8sb 030Document6 pagesOn8sb 030Remus BabeuPas encore d'évaluation
- Chi MeresDocument16 pagesChi MeresHelia TavakoliPas encore d'évaluation
- MolayDocument5 pagesMolayRemus BabeuPas encore d'évaluation
- 12 NidanasDocument5 pages12 NidanasRemus BabeuPas encore d'évaluation
- DDBS915Document6 pagesDDBS915Remus BabeuPas encore d'évaluation
- GuerreDocument1 pageGuerreRemus BabeuPas encore d'évaluation
- MolayDocument5 pagesMolayRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Recension Critique Du Livre: La Liberté Naturelle de L'esprit, de LongchenpaDocument17 pagesRecension Critique Du Livre: La Liberté Naturelle de L'esprit, de LongchenpaRemus BabeuPas encore d'évaluation
- TantrismeDocument31 pagesTantrismeRemus BabeuPas encore d'évaluation
- De Siegfried À ParsifalDocument12 pagesDe Siegfried À ParsifalRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Recension Critique Du Livre: La Liberté Naturelle de L'esprit, de LongchenpaDocument17 pagesRecension Critique Du Livre: La Liberté Naturelle de L'esprit, de LongchenpaRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Au Commencement Est Le CoeurDocument177 pagesAu Commencement Est Le CoeurRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Agneau MystiqueDocument11 pagesAgneau MystiqueRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Girodano BrunoDocument6 pagesGirodano BrunoRemus BabeuPas encore d'évaluation
- Devoir S2 Xelka LeguilDocument8 pagesDevoir S2 Xelka LeguilXelka IuremaPas encore d'évaluation
- Demoulin OedipeDocument19 pagesDemoulin OedipeAaron Schuster SchusterPas encore d'évaluation
- Soutenance Mémoire M2RDocument4 pagesSoutenance Mémoire M2RFelipe Alfonso Díaz PeñaPas encore d'évaluation
- Le MasochismeDocument73 pagesLe MasochismeFelipe Díaz Peña100% (1)
- 15.kaës - Extension D Psychanalyse PDFDocument305 pages15.kaës - Extension D Psychanalyse PDFalbertoadalid100% (1)
- Ubv 001Document134 pagesUbv 001burfzPas encore d'évaluation
- Désirs D'enfant-2009 PDFDocument134 pagesDésirs D'enfant-2009 PDFOumayma SkhiriPas encore d'évaluation
- 08 - Cours 8Document18 pages08 - Cours 8July JamainPas encore d'évaluation
- Pour Un Sexe Post-Humain, Par Fabrice BourlezDocument23 pagesPour Un Sexe Post-Humain, Par Fabrice BourlezjuansalazarjPas encore d'évaluation
- Les Premieres Organisations Pulsionnelles Et Le Moi CorporelDocument25 pagesLes Premieres Organisations Pulsionnelles Et Le Moi CorporelFernanda DrumondPas encore d'évaluation
- Le Travail Entre Corps Et ÂmeDocument14 pagesLe Travail Entre Corps Et ÂmeGelmouPas encore d'évaluation
- Regles TypoDocument31 pagesRegles TypojnhugPas encore d'évaluation
- Flaubert y FreudDocument15 pagesFlaubert y Freudemilio laffePas encore d'évaluation
- Freud Et Jung Une Rencontre InachevéeDocument14 pagesFreud Et Jung Une Rencontre Inachevéezeugma2010Pas encore d'évaluation
- René Girard - Un Allumé Qui Se Prend Pour Un PhareDocument4 pagesRené Girard - Un Allumé Qui Se Prend Pour Un PhareJeremy WolfPas encore d'évaluation
- Lucien Seve Dans Le TexteDocument8 pagesLucien Seve Dans Le Texteaysegul222Pas encore d'évaluation
- Essai Sur Paul RicoeurDocument22 pagesEssai Sur Paul RicoeurJonnie AngaritaPas encore d'évaluation
- 000482271Document200 pages000482271ducPas encore d'évaluation
- ARMANDO VERDIGLIONE, (Semiotica) Essai CommémoratifDocument10 pagesARMANDO VERDIGLIONE, (Semiotica) Essai CommémoratifadeenameyPas encore d'évaluation
- V21PY9-cours 1Document21 pagesV21PY9-cours 1aajaPas encore d'évaluation
- Lacan, Fonction Et Champ de La ParoleDocument63 pagesLacan, Fonction Et Champ de La ParoleMiquel Figueras MoreuPas encore d'évaluation
- Colette Soler Objet ADocument9 pagesColette Soler Objet AmojepatikePas encore d'évaluation
- PHILOSOPHIE de L'histoireDocument47 pagesPHILOSOPHIE de L'histoireSARAHPas encore d'évaluation
- Les Troubles AnxieuxDocument18 pagesLes Troubles AnxieuxMohamed MalfiPas encore d'évaluation
- Inconscient - cours - Les limites de la connaissance de soi (1)Document7 pagesInconscient - cours - Les limites de la connaissance de soi (1)justine.faur26Pas encore d'évaluation
- Planification Des ApprenttissagesDocument73 pagesPlanification Des Apprenttissagesbrandao sultanPas encore d'évaluation
- Thèse BorderlineDocument138 pagesThèse BorderlineMel AniePas encore d'évaluation
- Les Théorie de La PersonnalitéDocument12 pagesLes Théorie de La PersonnalitéMadison CardietPas encore d'évaluation
- Lacan Fonction Champ Parole LangageDocument23 pagesLacan Fonction Champ Parole LangageÉric ZulianiPas encore d'évaluation
- Le Syndrome de Dysoralité SensorielleDocument84 pagesLe Syndrome de Dysoralité Sensoriellekhadidja BOUTOUILPas encore d'évaluation