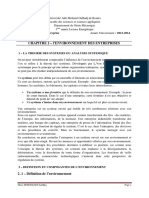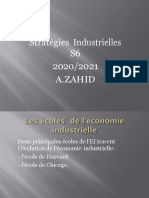Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Support 1
Support 1
Transféré par
elgorafibilal94Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Support 1
Support 1
Transféré par
elgorafibilal94Droits d'auteur :
Formats disponibles
Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Marrakech
Filière Sciences Economiques et de Gestion
Parcours : Economie – Gestion (S5)
Module : Economie Industrielle
Prof. Brahim BOUAYAD
Support : THEME 1
LES OBJECTIFS DU THEME 1:
1. Présenter, de façon synthétique, le modèle de la Concurrence Pure et Parfaite (CPP) ;
2. Définir les composantes de la trilogie de l’économie industrielle (Structures de marché, Le
comportement des agents à l’intérieur de ces structures et les performances du marché) ;
3. Utiliser le modèle concurrentiel comme référence et le comparer à ce que l’on appelle la
« Concurrence Praticable » ;
4. Définir la notion de « marché » sous ses différents aspects (fonctionnel et valeur) ;
5. Etre capable de présenter schématiquement le modèle synthétique de l’analyse de l’économie
industrielle (Conditions de base – Structures de marché – Comportement – Performances) ;
6. Déterminer la ou les relations entre chaque composante de la trilogie (S – C – P)
1. De la Concurrence Pure et Parfaite (CPP) à la Concurrence Praticable
1.1. Le modèle concurrentiel
Avant de présenter les critiques et extensions du modèle de la CPP, nous allons présenter les
bases du modèle concurrentiel
Il se base généralement sur une multitude d’acheteurs et de vendeurs et doit vérifier les cinq
hypothèses suivantes :
Atomicité des centres de décisions (agents) : plusieurs acheteurs et vendeurs
interviennent sur le marché ;
Homogénéité du produit ;
Mobilité parfaite des agents, des biens et des facteurs ;
Transparence du marché : information parfaite ;
Analyse statique des décisions des agents : simultanéité et concordance des actions et
réactions des agents ;
Le prix est une donnée exogène (fixé de l’extérieur)
Les agents économiques au sein du marché sont des « price takers » (preneurs de prix), c’est
à dire que le prix s’impose au producteur (donnée exogène), dans le sens où aucun producteur
ne peut écouler ses produits à un prix différent de celui déterminé sur le marché. De même
qu’aucun acheteur ne peut se procurer le produit à un prix différent de celui résultant de
l’interaction entre l’offre et la demande.
Prof. Brahim Bouayad Economie industrielle : Thème 1 Page 1
La demande est parfaitement élastique : horizontale et inélastique par rapport au prix
P0 Demande
La demande qui s’adresse à la firme est une droite horizontale parfaitement inélastique au prix
(ou parfaitement élastique par rapport à la quantité).
L’entreprise étant atomistique au sein du marché, sa production est très faible par rapport au
marché, elle ne peut donc influencer le prix.
Quelque soit la quantité vendue, l’entreprise obtiendra toujours ce prix de marché. S’elle
demande un prix supérieur, sa demande sera nulle.
La détermination du prix au sein du marché
La CPP fonctionne selon le principe de « commissaire-priseur » ou ce qui est communément
appelé « crieur de Walras », c’est-à-dire une centralisation des offres et des demandes qui
permettent de déterminer le prix de marché. Ce mécanisme est généralement appelé
« tâtonnement walrasien ».
L’équilibre en situation de CPP
A. Marshall (1890) distingue deux périodes : le court terme et le long terme
A titre de rappel :
P est une constante, c’est également la recette (ou revenu) marginale
La fonction d’offre est la partie de la courbe de Coût marginal qui est supérieur
au Coût moyen.
A est le seuil de rentabilité (P = Cm = CM)
B est le seuil de fermeture
Prof. Brahim Bouayad Economie industrielle : Thème 1 Page 2
1.2. Dépassement du modèle de la CPP
Il est de devenu traditionnel de critiquer le modèle de la concurrence parfaite, tant pour sa
prétention normative que pour sa valeur explicative.
Sraffa P. (1898 – 1983)
Pour lui la théorie de la concurrence n’est qu’un instrument pédagogique sans portée
opérationnelle car il y a une contradiction entre la théorie de la valeur en CPP et la réalité de
la pratique des affaires.
Il avait une vision différente des classiques et néo-classiques concernant les « rendements
d’échelle », il estimait que c’est le monopole et non la CPP qui devrait être pris en
considération
Chamberlin E. (1899 – 1967)
Il a pris ses distances avec la CPP en développant, à partir des travaux de Marshall, la théorie
de la concurrence monopolistique qui a été développée au début des années trente par
Chamberlin (USA) et Hoan Robinson (GB). Chamberlin était le premier à introduire les
phénomènes de différenciation des produits des opérations publicitaires et les coûts de
transport.
Schumpeter J. (1883 – 1950)
Schumpeter se démarque des « néo-classiques » et considère que la concurrence est
interprétée dans le cadre d’une vision dynamique de l’évolution économique.
Pour lui, la croissance repose sur l’innovation. Cette croissance est un processus permanent de
créations et de destructions des activités. Il met l’accent aussi sur la notion de concurrence–
rivalité.
Nous constatons que :
Sraffa rejette la notion d’atomicité du modèle CPP et suggère le monopole comme
modèle alternatif ;
Chamberlin remet en cause l’homogénéité des produits et propose la concurrence
monopolistique.
Schumpeter rejette celles de transparence et de libre entrée et sortie et introduit le rôle
de l’innovation.
Le modèle de la CPP et ses hypothèses paraissent donc peu réalistes, mais d’autres formes de
marché existent : la concurrence praticable ou imparfaite
Il reste que ce modèle soit toujours le point de départ utile pour une analyse des conditions
actuelles de la concurrence (concurrence praticable).
Il fournit, en effet, un repère qui permet, à travers la comparaison, de mieux déterminer les
caractéristiques de l’économie industrielle
L’économie industrielle est un domaine de la science économique qui s’intéresse au
fonctionnement du marché. Il a pour objet l’étude du comportement des firmes et des
Prof. Brahim Bouayad Economie industrielle : Thème 1 Page 3
structures de marché (CPP, monopole, oligopole). Pour Carlton et Perloff (1998), c’est
l’«Etude de la structure des entreprises et des marchés, ainsi que de leurs interactions ».
Une industrie correspond généralement à l’ensemble des firmes qui produisent des biens ou
des services proches, étroitement substituables qui se trouve en concurrence sur le même
marché.
1.3. Trilogie de l’Economie Industrielle
Pour introduire cette comparaison, on part généralement d’une classification commode qui
forme la trame des analyses en économie industrielle : les Structures, les Comportements et
les Performances du marché.
Les structures de marché sont définies comme étant un ensemble de caractéristiques
relativement stables du marché affectant le comportement des entreprises qui en font partie.
Ces caractéristiques portent essentiellement sur le nombre d’acheteurs et de vendeurs, la
nature des biens (produits ou services), le degré d’information, la mobilité plus ou moins
grande des vendeurs et des acheteurs, …
Les comportements de marché sont les diverses politiques suivies par l’entreprise
(stratégies) depuis sa politique de prix jusqu’à sa politique de recherche et développement en
passant par la politique de coordination et de collusion ;
Les performances de marché sont les résultats économiques que les entreprises réalisent. Elles
incluent les marges de profits, la croissance, le degré de capacité utilisée, la qualité des
produits, …. Ces résultats sont la conséquence des diverses combinaisons de structures et de
comportements.
1.4. Confrontation des hypothèses de la concurrence à la réalité observée
Il apparait utile de confronter à la réalité observée, les hypothèses du modèle de concurrence
ventilées selon cette classification
Structures des marchés
Une première confrontation peut-être réalisée au niveau des hypothèses qui portent sur
les structures des marchés
Contrastant avec l’hypothèse de l’atomicité des agents, il apparait que, dans la
plupart des branches de production, il existe des entreprises de grande taille qui
occupent une part importante du marché. Le phénomène de la concentration de
la production montre que le modèle concurrentiel n’est pas adapté à l’étude des
situations de petits nombres ;
L’hypothèse d’homogénéité des produits à l’intérieur d’un secteur donné doit
faire place à la différentiation poussée et à un désir de réduire la substituabilité
grâce à l’attachement personnel au bien ou au service ;
Le processus de libre entrée (mobilité parfaite) des entreprises au sein de
l’industrie, qui annule les profits de longue période est une illusion dans la
mesure où il existe d’importantes barrières à l’entrée qui sont, soit de nature
institutionnelle ou ayant un caractère technologique ou commercial ;
L’information supposée parfaite sur le marché est liée à un coût et à une
organisation des marchés. Elle n’est pas donnée à la firme qui se trouve
normalement en situation de risque ou d’incertitude ;
La nature inter-temporelle du modèle classique implique la simultanéité et la
concordance des actions et réactions. Or la concurrence est un processus
dynamique qui implique le changement continuel dans les données et dont la
Prof. Brahim Bouayad Economie industrielle : Thème 1 Page 4
signification est nécessairement détournée par une théorie qui traite ces
données comme constantes.
Objectifs et comportements de l’entreprise
L’objectif de l’entreprise est habituellement supposé être la maximisation du
profit. Cette hypothèse a été doublement contestée :
D’une part, il est admis aujourd’hui que l’entreprise ne se réduit pas à
un organisme simple ayant un objectif unique : c’est une organisation
complexe où s’affrontent plusieurs objectifs contradictoires (théories
béhavioriste, institutionnelle, agence, survie, …) ;
Pour le comportement de l’entreprise, la vision conventionnelle est
qu’elle s’adapte aux conditions de marché. C’est un comportement
statique qui prend le changement comme exogène au système où elle
opère. Ce comportement n’est valable qu’à court terme. Par contre à
long terme, l’entreprise a la possibilité d’influencer l’industrie où elle
opère, c’est-à-dire qu’elle peut agir sur les coûts et sur la demande.
Performance de l’entreprise
Dans un cadre concurrentiel traditionnel, la performance de l’entreprise se
mesure par l’allocation optimale des ressources entre les consommateurs d’une
part et les producteurs de l’autre.
Actuellement le cadre concurrentiel est dépassé dans la mesure où les
situations réelles correspondent à des situations oligopolistiques. La présence
de biens publics, d’externalités, d’informations imparfaites fait que les
marchés sont défaillants dans le sens où l’allocation n’est plus optimale.
Prof. Brahim Bouayad Economie industrielle : Thème 1 Page 5
Vous aimerez peut-être aussi
- Serie de TD 1 Et 2 Avec CorrectionsDocument15 pagesSerie de TD 1 Et 2 Avec Correctionsamani nedjadi100% (11)
- Module: Logistique Et Organisations Travail Sur Le Thème:: L'approche Structure Comportement PerformanceDocument14 pagesModule: Logistique Et Organisations Travail Sur Le Thème:: L'approche Structure Comportement PerformanceAhlam MaarafPas encore d'évaluation
- Les 5 forces de Porter: Comprendre les sources des avantages concurrentielsD'EverandLes 5 forces de Porter: Comprendre les sources des avantages concurrentielsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Ficha Número 3Document2 pagesFicha Número 3Ana Sofia Godinho90% (10)
- Economie Industrielle (Récupération Automatique)Document7 pagesEconomie Industrielle (Récupération Automatique)Zakaria El-AtiaPas encore d'évaluation
- Economie IndustrielleDocument41 pagesEconomie IndustrielleYassine El100% (1)
- Structure de Lindustrie FinaleDocument23 pagesStructure de Lindustrie FinaleOumaima EzzPas encore d'évaluation
- Support 1 - Thème 3Document4 pagesSupport 1 - Thème 3elgorafibilal94Pas encore d'évaluation
- CM Économie Industrielle 1Document66 pagesCM Économie Industrielle 1Igor MunkeniPas encore d'évaluation
- Poly 3 Politique de Concurrence Et Stratégies Des Firmes 2021Document15 pagesPoly 3 Politique de Concurrence Et Stratégies Des Firmes 2021zakaria ghanimPas encore d'évaluation
- Présentation Des Hypothèses: 1. L'atomicité Du MarchéDocument4 pagesPrésentation Des Hypothèses: 1. L'atomicité Du MarchéMohamedPas encore d'évaluation
- Economie IndustrielleDocument299 pagesEconomie IndustrielleAymen Hssaini100% (3)
- Rapport La Politique de La ConcurrenceDocument20 pagesRapport La Politique de La ConcurrenceBachir ElPas encore d'évaluation
- Economie IndustrielleDocument49 pagesEconomie IndustrielleabcdPas encore d'évaluation
- Support 2 - 2020Document3 pagesSupport 2 - 2020elgorafibilal94Pas encore d'évaluation
- Lettre BourseDocument32 pagesLettre BourseOuiame MoukitePas encore d'évaluation
- Eco. Indus Licence ProDocument37 pagesEco. Indus Licence ProKABOREPas encore d'évaluation
- Cours Deconomie Industrielle PR NACIRIDocument50 pagesCours Deconomie Industrielle PR NACIRIRH CASABELLAPas encore d'évaluation
- ConcurrenceDocument16 pagesConcurrenceAlexandre Favre100% (1)
- CoursDocument44 pagesCoursDon MohPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Economie DentrepriseDocument8 pagesChapitre 2 Economie DentrepriseLilya OuarabPas encore d'évaluation
- Synthese MicroeconomieDocument11 pagesSynthese MicroeconomieNajjari SoufianePas encore d'évaluation
- Economie-Industrielle Axe1Document7 pagesEconomie-Industrielle Axe1عزيز الجهيديPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument7 pagesIntroductionysfPas encore d'évaluation
- La Politique de La ConcurrenceDocument12 pagesLa Politique de La ConcurrenceBasalah Abderrahmane100% (1)
- Concurrence BartheDocument78 pagesConcurrence Bartheirma_j_1Pas encore d'évaluation
- Chapitre 5Document3 pagesChapitre 5hanaabdi527Pas encore d'évaluation
- Cours Eco - IndustDocument60 pagesCours Eco - IndustLachance Awounang12Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2-Economie de L'entrepriseDocument10 pagesChapitre 2-Economie de L'entrepriseREGISPas encore d'évaluation
- Economie Industrielle Chapitre 1Document80 pagesEconomie Industrielle Chapitre 1Min MedPas encore d'évaluation
- Chapitre IndroductifDocument21 pagesChapitre IndroductifSalma SaadanePas encore d'évaluation
- Cours Stratégie IndustrielleDocument12 pagesCours Stratégie IndustrielleAbdelwahab El HadiriPas encore d'évaluation
- Cours 2 Fonctionnement Economie de Marche Correction 1Document8 pagesCours 2 Fonctionnement Economie de Marche Correction 1Spinoz'ASPas encore d'évaluation
- Stratégies Industrielles Partie IIDocument14 pagesStratégies Industrielles Partie IIAmine RajawiPas encore d'évaluation
- Cours de L'economie IndustrielleDocument30 pagesCours de L'economie IndustrielleIsmail ElouargaPas encore d'évaluation
- Droit Français Et Europeen de La ConcurrenceDocument85 pagesDroit Français Et Europeen de La ConcurrenceChachahTamDao100% (1)
- Marketing Les Cinq Forces de PorterDocument4 pagesMarketing Les Cinq Forces de PorterSoufiane SegPas encore d'évaluation
- Ent Et Pouvoir de Marche 217665Document7 pagesEnt Et Pouvoir de Marche 217665uriel johnnyPas encore d'évaluation
- L'Organisation Industrielle FinalDocument43 pagesL'Organisation Industrielle Finalhamzzaa100% (1)
- TP G3 AmiDocument5 pagesTP G3 Amimanzanzatona2Pas encore d'évaluation
- Stratégie Indust Cours PR SADIQIDocument10 pagesStratégie Indust Cours PR SADIQIArrad SamirPas encore d'évaluation
- Benjamin Coriat Theories de La FirmeDocument32 pagesBenjamin Coriat Theories de La FirmeNabila Ben100% (1)
- Cours D'economie Industrielle Grade 1Document27 pagesCours D'economie Industrielle Grade 1ilunganday22Pas encore d'évaluation
- Stratégie IndustrielleDocument14 pagesStratégie IndustrielleLmehdi OzilPas encore d'évaluation
- Cours00 IntroductionDocument15 pagesCours00 IntroductionIsidore NEYAPas encore d'évaluation
- Comportement Stratégique Et Relations VerticalesDocument29 pagesComportement Stratégique Et Relations VerticalesEl MehdiPas encore d'évaluation
- Economie IndustrielleDocument45 pagesEconomie IndustrielleRachid El AlaouiPas encore d'évaluation
- Les Mécanismes Du MarchéDocument3 pagesLes Mécanismes Du MarchéOuthami BennaceurPas encore d'évaluation
- PorterDocument62 pagesPorterRif SpiritPas encore d'évaluation
- Cours 4Document59 pagesCours 4Yasser AitelhihiPas encore d'évaluation
- Cours CPP - Monopole S3Document53 pagesCours CPP - Monopole S3Taha752Pas encore d'évaluation
- 5 - Structure Des MarchésDocument27 pages5 - Structure Des MarchésEl Mekki Zekraoui100% (1)
- La Surveillance Du Jeu ConcurrentielDocument18 pagesLa Surveillance Du Jeu Concurrentielwissal-babaPas encore d'évaluation
- Diagnostic Economique de l'ESEDocument21 pagesDiagnostic Economique de l'ESELoubna LZPas encore d'évaluation
- La Concurrence Monopolistique PDFDocument22 pagesLa Concurrence Monopolistique PDFAbdlghni RahmouniPas encore d'évaluation
- Groupe 2 Expose de Marketing FinalDocument24 pagesGroupe 2 Expose de Marketing Finalachillesia12Pas encore d'évaluation
- Les Marchés ContestablesDocument23 pagesLes Marchés Contestablesgillesk100% (9)
- Axe 1Document69 pagesAxe 1HAMED JamalPas encore d'évaluation
- Eco Indus Cours IUPA PDFDocument51 pagesEco Indus Cours IUPA PDFLivia JoycePas encore d'évaluation
- E4b CMDocument13 pagesE4b CMLorenzo JyPas encore d'évaluation
- Introduction: La Firme Neo-Classique & Ses LimitesDocument6 pagesIntroduction: La Firme Neo-Classique & Ses LimitesMar WaPas encore d'évaluation
- Le MarcheDocument3 pagesLe MarcheAlihoun Moustapha TRaorePas encore d'évaluation
- Cours 5 Le Contexte en TraductionDocument2 pagesCours 5 Le Contexte en TraductionËlLina L'ionëssPas encore d'évaluation
- 2012 L1 CM1 BioEnergétiqueDocument18 pages2012 L1 CM1 BioEnergétiqueHamza Saad100% (2)
- Conception Geometrique Et Dimensionnement Structural de La Route Ouedo-ToriDocument164 pagesConception Geometrique Et Dimensionnement Structural de La Route Ouedo-ToriBilaal DjaneyePas encore d'évaluation
- Fiches de Revision de MathsDocument16 pagesFiches de Revision de MathsA.A 92100% (1)
- L'Effet de Serre SPCDocument3 pagesL'Effet de Serre SPCClarisse MbobdaPas encore d'évaluation
- M1info Lgreq td2Document2 pagesM1info Lgreq td2elmamoun1Pas encore d'évaluation
- Booking #2714128912Document2 pagesBooking #2714128912Patherson Mouckaulho ItsissaPas encore d'évaluation
- SHP 15W40Document4 pagesSHP 15W40Mouad EN-NAKORIPas encore d'évaluation
- Programme Imtiaz Et MoussanadaDocument6 pagesProgramme Imtiaz Et Moussanadarachida0% (1)
- Correction Centrale RéductionDocument8 pagesCorrection Centrale RéductionAlessandro AmalricPas encore d'évaluation
- CorrigéFiche 6Document4 pagesCorrigéFiche 6DHia Ben AichaPas encore d'évaluation
- Rapport de Projet Intelligence Artificielle: GlsidDocument35 pagesRapport de Projet Intelligence Artificielle: GlsidHajar Zarguan (Full stack developer)0% (1)
- Whirlpool Awo D 41105 (ET)Document20 pagesWhirlpool Awo D 41105 (ET)arhivarr100% (1)
- 124 Modele CV CanadienDocument4 pages124 Modele CV CanadienBillel SalazarPas encore d'évaluation
- GPS 2023Document88 pagesGPS 2023mohamed belahouelPas encore d'évaluation
- Mathématiques - Lycée de Bandjoun - Classe Troisième 2020 CamerounDocument2 pagesMathématiques - Lycée de Bandjoun - Classe Troisième 2020 CamerounEyid'a Ngangue IsaccPas encore d'évaluation
- 4 - Compr - Compressibilite Des Sols CorrectifDocument4 pages4 - Compr - Compressibilite Des Sols Correctifishaq AllalPas encore d'évaluation
- Cours Trait Eaux CH3Document80 pagesCours Trait Eaux CH3Eya B. TalebPas encore d'évaluation
- SVT SpéDocument6 pagesSVT SpéLetudiant.frPas encore d'évaluation
- Fiche Technique: Système Pré-Calculé À Doube Entrebarrage Et Notifier NFS-320Document15 pagesFiche Technique: Système Pré-Calculé À Doube Entrebarrage Et Notifier NFS-320Satish mPas encore d'évaluation
- Séparer Et Condamner:: Interrupteur Sectionneur Sectionneur Porte-Fusibles SectionneurDocument24 pagesSéparer Et Condamner:: Interrupteur Sectionneur Sectionneur Porte-Fusibles SectionneurAmel HbPas encore d'évaluation
- Rapport Cartographie NumériqueDocument13 pagesRapport Cartographie NumériquevayskaPas encore d'évaluation
- HPVDocument8 pagesHPVpropulziPas encore d'évaluation
- Charpente Mettalique Par MostafaDocument55 pagesCharpente Mettalique Par MostafamostafaPas encore d'évaluation
- Principe de Fonctionnement Et Commande de Type Pleine Onde Dun Convertisseur MMCDocument6 pagesPrincipe de Fonctionnement Et Commande de Type Pleine Onde Dun Convertisseur MMCHakim Abdelhakim NabilPas encore d'évaluation
- Chauffage Induction - Partie - 1 - Sur - 2 - 2Document251 pagesChauffage Induction - Partie - 1 - Sur - 2 - 2boboPas encore d'évaluation
- Legi 010 0050Document8 pagesLegi 010 0050p4 ifmiaPas encore d'évaluation