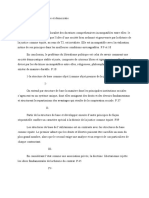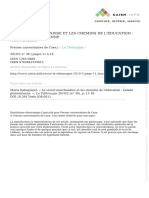Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sparfell, Autarcie Libérale Contre Autonomie Socialiste
Transféré par
julienboyer0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues7 pagesTitre original
Sparfell, autarcie libérale contre autonomie socialiste
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues7 pagesSparfell, Autarcie Libérale Contre Autonomie Socialiste
Transféré par
julienboyerDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 7
Autarcie libérale contre autonomie socialiste.
Défense d’une conception anticapitaliste de la liberté.
Par Yohann Sparfell
Portrait de Louis-Auguste Blanqui – Antoine-Joseph Wiertz
Le capitalisme a ceci de pernicieux qu’il fait passer pour des facteurs
d’accomplissement de l’être, pour des promesses de réalisation de l’individu, certains
concepts tels que la liberté ou l’autonomie, dont il modifie pourtant profondément la portée et
le sens. Alors que la liberté et l’autonomie sont, dans une communauté harmonieusement
constituée, des facteurs intégrés à l’autoréalisation et la socialisation des personnes, le sens
qu'ils prennent dans le contexte libéral en fait des buts ultimes, lointains, ne valant plus que
pour eux-mêmes, et qui consacrent l’image illusoire d’une réussite sociale basée sur
l’atomisation des individus, guidés par leurs intérêts rationnels supposés contradictoires. Sous
l’effet de fétiches modernes comme la marchandise, le travail et l’argent, les grandes nations
capitalistes ont donc vu s’élaborer des rapports sociaux historiquement spécifiques, qui
exercent sur les sujets une nécessité pour ainsi dire normative de séparation (voire de
distanciation) à l’égard de leurs congénères. Ce fétichisme engendre conséquemment une
violente frustration humaine, parce qu’il mine toute possibilité de relations directes de
coopération ou d’échanges, et ce dans la mesure où les rapports humains se trouvent être
désormais médiatisées par les fétiches en lesquels a été placé un sacro-saint pouvoir de
maintien d'une « cohésion » sociale entre les individus déracinés et massifiés.
Être « libre », sous un régime capitaliste, signifie en fait que l'on s’isole des autres, et
que l'on peut faire abstraction d’eux. Par la marchandise, le travail et l’argent, l’individu du
monde moderne libéral ne se sent plus en inter-dépendance avec ses congénères : il a l'illusion
de pouvoir vivre sans se soucier de quiconque. Mais sa liberté et son autonomie par
conséquent, ne sont plus à vrai dire qu’une forme d’autarcie, puisqu’il ne devient libre qu’en
se retranchant du groupe, en s’affranchissant de toute relation de dépendance (idéalisme
techniciste de l'homme « connecté »).
Afin d'assurer que les rapports sociaux établis sur l'échange des marchandises et sur la
force de travail puissent pérenniser le processus d'accumulation du capital, la société
capitaliste a érigé une forme de « liberté » comme d'une nécessité pour l' « accomplissement »
des individus et leur possible participation au libre cours de ces rapports. La détermination du
droit censé protéger ces libertés, dont la nature implique qu'elles doivent être perpétuellement
ajustées en fonction d'une nécessaire adaptation des individus aux conditions fluctuantes du
processus d'accumulation, est l’apanage des institutions et de l’État démocratique républicain,
qui se contentent la plupart du temps d’accompagner l’économie dans sa conquête du monde,
et le capital dans sa croissance perpétuelle. Les droits par conséquent, restent corrélativement
en phase avec les besoins historiques de la société marchande, et notamment avec
l’élaboration de rapports sociaux structurés autour de la présupposition que la « liberté » et
l'« autonomie » sont essentiellement détenues par le producteur ou le détenteur de
marchandises, force de travail incluse malgré, peut-on préciser, le caractère irréductible de
cette dernière à n'être qu'une « simple marchandise » ; ils règlent les rapports entre
producteurs et consommateurs, ainsi qu’entre capitalistes et détenteurs de la force de travail.
L’ordre légal garantit de la sorte la régulation des rapports sociaux entre sujets juridiques,
libres et égaux, en tant qu’entités économiques autonomes, ou supposées formellement telles,
et détermine la nature de ces relations qui s’opèrent par contrats. De tels rapports sont liés à
l’institutionnalisation de la propriété privée des moyens de production et des marchandises.
Cependant, même si le droit paraît situé « au-dessus » des antagonismes et des contradictions
qui structurent au jour le jour la société, il demeure en fait tributaire de la logique sociale
propre au capitalisme. Il adopte la posture de l’« universalisme abstrait », qui définit les
individus comme citoyens hors de toutes déterminations classiste et communautaire et leur
donne l’illusion de pouvoir maîtriser le cours de leur vie ; mais, ce faisant, il laisse prospérer
aussi le rationalisme le plus brutal dans la sphère de l’économique, et même, pour tout dire, le
garantit en l’institutionnalisant légalement. Le monde implacable de la production de valeur
reste dès lors peu ou prou le lieu de rapports « naturels » et sauvages de concurrence entre les
hommes (le droit du travail n'y changeant rien en réalité, malgré ses effets quelque peu
édulcorants sur ces « rapports sauvages », car il entre lui-aussi dans cette même logique, et il
faut voir sa remise en cause récente comme le fruit de la dernière restructuration du
capitalisme). C’est ce que développe Jean-Marie Vincent : « De ce point de vue, la relation de
l’étatique au juridique est capitale. L’État s’adresse à des sujets de droit auxquels il doit
garantir qu’ils pourront exercer ces droits avec un minimum de sécurité et de tranquillité. La
paix civile que doit assurer l’État, ce n’est pas seulement empêcher des affrontements
destructeurs entre groupes sociaux opposés, c’est aussi permettre des pratiques inégales de
disposition et de possession de biens et d’activités dans un cadre formel d’échanges
équivalents. L’État sanctionne l’égalité juridique des titulaires de droits pour que soit mises en
œuvre des relations dissymétriques entre ceux qui, comme représentants du Capital, captent
les activités des autres et ceux qui, d’autre part, doivent se conditionner comme prestataires de
force de travail et accepter que la majeure partie de leurs capacités d’agir leur échappe... »1
Paradoxalement, la légitimité des rapports sociaux engendrés par le mode particulier
de production et d’échange capitaliste se trouve entre autres largement favorisé par l’octroi de
droits sociaux (tant que le capital y trouve un intérêt « stratégique », du moins). Ces droits
sociaux sont censés amoindrir l’âpreté des conditions d’existence en régime de compétition
libérale. Mais ils contribuent en fait eux aussi à étendre le mode de vie libéral lui-même, dans
la mesure où ils favorisent à leur tour, au même titre que la « loi de la jungle » économique,
une séparation des individus les uns par rapport aux autres, au profit d’une sorte de
déconstruction des relations humaines traditionnelles et communautaires. Ces droits sociaux
cloisonnent en d’autres termes chacun dans un espace individuel d’autosuffisance plus ou
moins assistée, qui rend inutile le maintien de réseaux de solidarité restreints ou élargis
(comme la solidarité familiale, de voisinage, etc.). Partout, que ce soit dans le cadre de la
compétition économique ou dans l’octroi de droits sociaux, la logique libérale apparaît de ce
fait à l’œuvre pour séparer les individus, pour les maintenir en état d’autarcie.
Le régime actuel repose en cela sur un double égalitarisme, quoique de plus en plus
déséquilibré : il promeut d'une part un égalitarisme formel, juridique, qui conditionne
néanmoins des inégalités économiques réelles, et il promeut d'autre part, mais de façon
décroissante à la mesure des nouveaux impératifs de la restructuration, un égalitarisme
redistributif à travers l’octroi de droits sociaux, qui prétend rendre supportables les inégalités
économiques réelles instaurées par ce même régime. Mais, dans les deux cas et quoi qu'il en
soit, cet égalitarisme (juridique ou social) va dans le sens d’une logique libérale de fond, qui
sanctionne le règne de l’autarcie à travers la compétition générale dans la sphère productive,
et à travers la captation par l’État des pratiques et des normes plus ou moins généreuses de
solidarité, dans la sphère redistributive. Le paradigme de l’égalitarisme s’impose comme le
vecteur collectif de la croyance en la neutralité de l’État, voire en son recours lorsqu'il s'agit
de contester le libre-cours de la concurrence et ses effets, mais il déconstruit en définitive les
systèmes de relations humaines susceptibles d’être voués à la solidarité, l’entraide,
l’autonomie véritable et, surtout, à la perpétuation des communautés vivantes.
Dans ces conditions, la liberté ne peut plus effectivement être pour chacun qu’une
bulle où l’individu isolé dispose de la jouissance de ses droits ; et la rencontre conflictuelle
avec l’autre ne devient plus alors bien souvent qu’une affirmation, une défense ou une
revendication de ces droits, voire la prétention à obtenir de nouveaux droits, sans remettre en
cause les rapports sociaux qui leur sont sous-jacents. Cette praxis s’intègre tout à fait dans la
dynamique globale du capital, dont les droits concédés aux individus représentent le moyen
d’accroître son emprise sur leur vie.
Le progrès technique participe de cette dynamique, dans le sens où il rend
apparemment possible l’autarcie de chacun par rapport aux autres (même si cette autarcie
demeure en fait très largement illusoire) et ainsi favorise un mode de vie au sein duquel seule
compte la défense des intérêts individuels, et où s’étend le règne de la séparation. La liberté
capitaliste n’est en somme que le résultat d’une détermination extérieure aux individus,
sommés par le cadre juridique formel, le contexte économique réel et les dispositifs
d’assistanat public de se conformer à la logique d’autarcie du système, par le biais d’une mise
au pas technologique et technocratique de leur existence. La liberté n’est plus en ce sens
qu’un élément de la propre aliénation des individus dans la dynamique capitaliste ; liberté
pour laquelle la marchandise, le travail, l'argent et la technoscience sont devenus des points de
focalisation et de motivation sociales. Elle devient le signe d’une rupture entre la personne et
le flux social de la communauté humaine, pour ne plus laisser au sujet qu’une identité
abstraite, celle de l’« homme unidimensionnel » mu par ses seuls intérêts. Soumise au
rationalisme abstrait du sujet libéral, la liberté se fait fixation, statisme, normativité issue
d’une classification liée aux besoins impersonnels du capital.. Elle participe au
fonctionnement de la sphère de la circulation, de l’échange marchand, tout autant que de la
production, en « formatant » en quelque sorte le Sujet qui doit s'y insérer par une adaptation
psychologique et sociale à des rapports inégaux justement structurés autour de cet artefact de
« liberté ». Instrumentalisée par les institutions et la politique, gestionnaires de la croissance
du Capital, la liberté se vide de tout contenu réellement émancipateur pour les individus, et
notamment de tout contenu réellement politique, si bien que les individus n’ont plus de prise
aujourd’hui sur le sens de leur vie. Comme l’écrit Bertrand Louard : « La liberté dans les
sociétés industrielles avancées est réduite à ses aspects purement formels : liberté de circuler,
de vendre sa force de travail, de consommer des marchandises, etc... »2 On pourrait aussi
ajouter : « Liberté de voter ! », à condition de comprendre que le principe d’une liberté
formelle est qu’elle reste de pure forme, évidemment, c’est-à-dire qu’elle ne change rien aux
réalités de fond.
L’autarcie ne saurait donc se confondre avec l’autonomie. L’autarcie repose toujours
sur une illusion : celle qui consiste à croire que l'individu serait à même de pouvoir réaliser sa
vie en indépendance totale vis-à-vis des autres. Alors que l’autonomie, a contrario, implique
une relation constante avec l'autre, une relation « tensionnelle » par laquelle la personne ou la
communauté mesure en permanence sa capacité à maintenir sa singularité et son auto-
reproduction. Cette autonomie par conséquent constitue bien plus qu’un droit théorique, mais
une condition concrète de réalisation de la vie (au niveau individuel, tout comme au niveau
collectif ou communautaire). En fait, c’est même essentiellement au niveau collectif et
communautaire que la notion d’autonomie prend tout son sens, en lien avec l’idée
d’interdépendance. Bertrand Louart écrit encore : « […] Le sujet ne peut exister et avoir de
permanence que dans la mesure où il est capable de recomposer les liens particuliers grâce
auxquels il acquiert son indépendance globale. »3
La perte d’autonomie des individus est directement liée aujourd’hui à la dynamique de
développement de la société capitaliste et technologique, tant sur un plan idéologique que
pratique ; elle est notamment en lien avec le mode de production historiquement spécifique
entretenu par la croyance en la primordialité de l'individu et en sa possibilité d'auto-réalisation
égotiste. En effet, la production capitaliste et l'idéologie des « droits de l'homme » ont
conjointement séparé l'individu des conditions extérieures de réalisation de son autonomie
véritable (environnement, communautés) et l'ont enjoint à ne se référer qu'à un seul aspect,
« utile », de sa personnalité. Conséquemment, l’individu, en se spécialisant au sein des unités
de production capitalistes, a réduit ses facultés au niveau de l'adaptabilité et de l'efficience
dans un seul domaine de compétence, réduisant par là-même le sens qu'il donne à sa vie à un
impératif de survie dans la vaste machine sociale de production (bellum omnium contra
omnes) ; la gageure, terme que l'on peut appréhender ici en son sens familier, pour le système
bourgeois de production (mais n'est-ce pas un pléonasme?) fut de fournir à l’industrie la main
d'œuvre adaptée à son fonctionnement et sa croissance. Avec l'apparition de la troisième
révolution industrielle et de l'informatisation galopante des procès de production, c'est d'une
hyper-spécialisation des individus qu'il nous faut désormais parler, en lien avec une obsédante
menace d'obsolescence et une hantise de superfluité. L’être humain ainsi « chosifié », lui-
même transformé en un élément anecdotique et remplaçable de la machine qu’il sert, voit sa
dépendance s’accroître vis-à-vis du système, en même temps qu’il est vidé de toutes ses
facultés et de sa force de vie. La pauvreté sociale des travailleurs n’a d’égale que leur
dépendance existentielle totale : ils se trouvent de ce fait dans l’impossibilité de réaliser par
eux-mêmes des liens propres d’interdépendance et de construire leur autonomie.
Cette impossibilité ne se développe d'ailleurs pas dans la seule sphère de la vie
« active », mais touche également tous les aspects de l'existence individuelle en régime
libéral. L' « autonomie » devient une notion quantifiable, par conséquent inégalitairement
répartie en fonction des moyens financiers. Le fait démontrant toute l'iniquité de cette
autonomie-autarcie est la nécessité diffuse de se soumettre à des normes sociales, tant du
point de vue des comportements, de la mode, de la « santé », du paraître, visant à contraindre
l'individu à se valoriser en permanence, et à le faire d'autant plus qu'il est mieux placé dans la
hiérarchie sociale. Cette adaptation socialement contrainte mais sous-jacente, couplée à celle
opérant dans la sphère professionnelle (auto-formation), conduit les individus à une
insatisfaction permanente et une dépendance accrue aux messages médiatiques, formateurs
des esprits. La « liberté » et l' « autonomie » sont, dans la société capitaliste, conditionnelles
et dirigées et ne peuvent donc aucunement opérer dans le sens d'une réalisation de soi dans un
cadre communautaire.
Il est donc plus que jamais nécessaire de se réapproprier collectivement les moyens et
conditions de l’autonomie, dans un mouvement d’insubordination qui transite par
l’élaboration d’un paradigme post-capitaliste, ou socialiste non marxiste. Le capitalisme, au
travers de son bras armé, la technologie, ne nous apporte aucun surcroît réel d’autonomie,
mais bel et bien une autarcie solipsiste cachant mal une aliénation insidieuse vis-à-vis du
système dominant ; « système » dont, rappelons-le, les individus sont amenés par eux-mêmes
à en assurer la pérennité au-travers de leur « désir » de liberté hédoniste. Cet enfermement
dans une bulle individualiste d’égoïsmes « privés », mais néanmoins érigés en paradigme
fondant le droit public, donc la politique moderne, nous empêche d’être en prise avec le sens
de nos vies (ou avec le mouvement social du faire, comme l’explique John Holloway4). La
liberté, dans de pareilles conditions, ne peut plus avoir que le goût amer de l’impuissance.
Elle n’apporte à l’humain que résignation, angoisse et froideur d’esprit. Elle nous enserre telle
un carcan dans le calcul constant de notre meilleur intérêt.
Yohann Sparfell
1. Jean-Marie Vincent, dans sa préface à A. Artous, Marx, l’Etat et la politique, Syllepse,
Paris 1999.
2. Bertrand Louard, « ITER ou la fabrique d’Absolu », in Notes & Morceaux choisis n°8,
automne 2008.
3. Ibid.
4. John Holloway, Changer le monde sans prendre le pouvoir. Le sens de la révolution
aujourd’hui, Syllepse, Paris 2008.
Vous aimerez peut-être aussi
- Etat Post ModerneDocument9 pagesEtat Post ModerneAbderrahim HassainePas encore d'évaluation
- Correction Bac Blanc TocquevilleDocument2 pagesCorrection Bac Blanc TocquevilleMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Histoire de Lester LevensonDocument22 pagesHistoire de Lester LevensonPatricia DieghiPas encore d'évaluation
- Sequences Textuelles JMAdamDocument4 pagesSequences Textuelles JMAdamNicoleta Cristina SuciuPas encore d'évaluation
- Exposition L'aventure de La CouleurDocument19 pagesExposition L'aventure de La Couleurfrancebleuweb100% (1)
- Rosanvallon 1Document27 pagesRosanvallon 1Franck DubostPas encore d'évaluation
- Bruno Karsenti - Eléments Pour Une Généalogie Du Concept de SolidaritéDocument14 pagesBruno Karsenti - Eléments Pour Une Généalogie Du Concept de SolidaritéAndré MagnelliPas encore d'évaluation
- Cours 1Document7 pagesCours 1hfr928kvk7Pas encore d'évaluation
- Exposé Société CivileDocument8 pagesExposé Société CivileOParkerPas encore d'évaluation
- Mattei - Commons 2011Document13 pagesMattei - Commons 2011sepidehbehruzianPas encore d'évaluation
- Sociologie Fiche de RevisionDocument13 pagesSociologie Fiche de Revisionmalone GobinaPas encore d'évaluation
- Ethique L1 - Chap 2Document15 pagesEthique L1 - Chap 2PharellePas encore d'évaluation
- Société CivileDocument24 pagesSociété CivileSebastien GeorgesPas encore d'évaluation
- MONGIN PEnser Le PolitiqueDocument7 pagesMONGIN PEnser Le PolitiqueGuillermosibiliaPas encore d'évaluation
- Baschet 18022015Document5 pagesBaschet 18022015GabrielaMitidieriPas encore d'évaluation
- Associativité Rempart Au Populismes 0422Document8 pagesAssociativité Rempart Au Populismes 0422joseignacerezoPas encore d'évaluation
- Postone Ou Castoriadis Par Bernard PasobrolaDocument6 pagesPostone Ou Castoriadis Par Bernard Pasobrolacastoriad100% (1)
- Cours Droit Des Collectivités TerritorialesDocument32 pagesCours Droit Des Collectivités TerritorialesInès DeOliveiraPas encore d'évaluation
- Histoire 2008Document196 pagesHistoire 2008Stanciu Eugen VictorPas encore d'évaluation
- La PolitiqueDocument15 pagesLa Politiquelegu0307Pas encore d'évaluation
- ENCG Systeme PolitiqueDocument8 pagesENCG Systeme PolitiqueAbdelkhalek OuassiriPas encore d'évaluation
- Qu'Est-ce Que L'état - AnakalyptoDocument6 pagesQu'Est-ce Que L'état - AnakalyptoiKa LuxicePas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie-5Document7 pagesCours de Philosophie-5Benjamin ObiefunaPas encore d'évaluation
- Synthèse Chapitre 9Document3 pagesSynthèse Chapitre 9secoucamara261092Pas encore d'évaluation
- Delsol Etat SubsidiaireDocument234 pagesDelsol Etat SubsidiaireBALLA KEITAPas encore d'évaluation
- État Et LibertéDocument30 pagesÉtat Et Libertémounir57Pas encore d'évaluation
- Gabriel Tarde - Qu'Est-ce Que La SociétéDocument5 pagesGabriel Tarde - Qu'Est-ce Que La SociétéAnonymous 6HA5vdKGdPas encore d'évaluation
- 2012 13.fiche de Lecture - Le ContratDocument6 pages2012 13.fiche de Lecture - Le ContratnephegessimaPas encore d'évaluation
- HPP Vol8Document4 pagesHPP Vol8PatienPas encore d'évaluation
- EXPOSE PhilosDocument23 pagesEXPOSE Philosjephausny4Pas encore d'évaluation
- Technocratique (2)Document17 pagesTechnocratique (2)Michel FritschPas encore d'évaluation
- 1.2 AcculturationDocument6 pages1.2 Acculturationthermidorjehu2005Pas encore d'évaluation
- Support de Cours Stratification Sociale - SH06Document35 pagesSupport de Cours Stratification Sociale - SH06mauricetappaPas encore d'évaluation
- 1 La Notion DEtatDocument10 pages1 La Notion DEtatflorentbrunet4488Pas encore d'évaluation
- L'État - Tle - Cours Philosophie - KartableDocument13 pagesL'État - Tle - Cours Philosophie - Kartablendiayeousmanenabi92Pas encore d'évaluation
- La société (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLa société (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Structures Inegalites 2024Document160 pagesStructures Inegalites 2024Clément Cœugniet DaemsPas encore d'évaluation
- Cours SociologieDocument49 pagesCours SociologieYassine BenjaziaPas encore d'évaluation
- Rakovsky Russie Et Ukraine Soviétiques Leurs Relations Mutuelles Et Leurs Destinées 1920 OKDocument7 pagesRakovsky Russie Et Ukraine Soviétiques Leurs Relations Mutuelles Et Leurs Destinées 1920 OKAtaulfo RieraPas encore d'évaluation
- Murray Bookchin - Urbanisation Sans Cité (Chapitre3)Document19 pagesMurray Bookchin - Urbanisation Sans Cité (Chapitre3)Imad DahmaniPas encore d'évaluation
- La Tripartition SocialeDocument11 pagesLa Tripartition SocialepictosonicPas encore d'évaluation
- Corrigé Type Sociologie Jan 2012Document4 pagesCorrigé Type Sociologie Jan 2012Alex AtioukpePas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitRachid AmiralPas encore d'évaluation
- Corrigé l' Etat Garantit-Il Nécessairement La Liberté 3Document5 pagesCorrigé l' Etat Garantit-Il Nécessairement La Liberté 39zmtynd7scPas encore d'évaluation
- Devoir DurkheimDocument4 pagesDevoir DurkheimMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Resumé Du Cours ConstructivismeDocument5 pagesResumé Du Cours ConstructivismessfffsfPas encore d'évaluation
- Faire Collectif de La Constitution A LaDocument29 pagesFaire Collectif de La Constitution A LaetiemblePas encore d'évaluation
- Démocratie DélibérativeDocument9 pagesDémocratie Délibérativedavid tchessy nyansaPas encore d'évaluation
- Texte Pour Expose 1 Prise de ParoleDocument6 pagesTexte Pour Expose 1 Prise de ParoleMEMO GAMER 35Pas encore d'évaluation
- THEVENIN - Nicole-Edith Thevenin de L Obstacle A L Emancipation Critique D Une Certaine Idee de La CommunauteDocument15 pagesTHEVENIN - Nicole-Edith Thevenin de L Obstacle A L Emancipation Critique D Une Certaine Idee de La CommunautePedro DavoglioPas encore d'évaluation
- Société CivileDocument2 pagesSociété CiviletodsPas encore d'évaluation
- Terestchenko Michel, Philosophie PolitiqueDocument9 pagesTerestchenko Michel, Philosophie PolitiqueAdelina AlexandraPas encore d'évaluation
- (Cours) LES FONDEMENTS DU DROITDocument37 pages(Cours) LES FONDEMENTS DU DROITJean-PaulPas encore d'évaluation
- John Rarwls Justice Et DemocratieDocument3 pagesJohn Rarwls Justice Et Democratieyaya kpabouPas encore d'évaluation
- La Marchandisation Du MondeDocument23 pagesLa Marchandisation Du MondeAnne FremauxPas encore d'évaluation
- Rancière Comunidad EntrevistaDocument15 pagesRancière Comunidad EntrevistaMANUEL ALEJANDRO JORDAN ESPINOPas encore d'évaluation
- Yiqi ZHAN, M2, 11912040Document9 pagesYiqi ZHAN, M2, 11912040Erin ZhanPas encore d'évaluation
- Amartya Sen - Développement, Justice, LibertéDocument2 pagesAmartya Sen - Développement, Justice, LibertéJC. BondaPas encore d'évaluation
- Résumé Régimes Constitutionnels ComparésDocument11 pagesRésumé Régimes Constitutionnels Comparéscasa webPas encore d'évaluation
- L'ÉTATDocument3 pagesL'ÉTATLouise SolelhacPas encore d'évaluation
- Philodissert L'état Et Les IndividusDocument3 pagesPhilodissert L'état Et Les IndividusGuillaume ChênelPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 - Les Institutions de Justice Cairn - InfoDocument32 pagesChapitre 6 - Les Institutions de Justice Cairn - Infojeanbulalu0303Pas encore d'évaluation
- Sujet Et Corrigé Classes SocialesDocument7 pagesSujet Et Corrigé Classes Socialesmathleboss0Pas encore d'évaluation
- 21 - DEVENIR TERRE - Glowczewski - Trad. Idris WeberDocument61 pages21 - DEVENIR TERRE - Glowczewski - Trad. Idris WeberjulienboyerPas encore d'évaluation
- Mult 031 0181Document7 pagesMult 031 0181julienboyerPas encore d'évaluation
- LIGNES - 036 - 0143 - BookletDocument6 pagesLIGNES - 036 - 0143 - BookletjulienboyerPas encore d'évaluation
- Lignes 044 0115Document12 pagesLignes 044 0115julienboyerPas encore d'évaluation
- Lignes 036 0143Document11 pagesLignes 036 0143julienboyerPas encore d'évaluation
- Eres Morel 2004 01 0181Document14 pagesEres Morel 2004 01 0181julienboyerPas encore d'évaluation
- Kakogianni, Savoir-MarchandiseDocument9 pagesKakogianni, Savoir-MarchandisejulienboyerPas encore d'évaluation
- Puf Soler 2009 01 0205Document11 pagesPuf Soler 2009 01 0205julienboyerPas encore d'évaluation
- La Psychiatrie Biologique Une Bulle SpéculativeDocument20 pagesLa Psychiatrie Biologique Une Bulle SpéculativeDiego LondoñoPas encore d'évaluation
- 2006 SoufpsyDocument12 pages2006 SoufpsyjulienboyerPas encore d'évaluation
- BLANCHOT, La Communauté InavouableDocument91 pagesBLANCHOT, La Communauté InavouableunlecteurPas encore d'évaluation
- 2014-07-25 - Micrurus-Final Avec Couv HD (Pour Impr)Document72 pages2014-07-25 - Micrurus-Final Avec Couv HD (Pour Impr)julienboyerPas encore d'évaluation
- NRP 017 0017Document14 pagesNRP 017 0017julienboyerPas encore d'évaluation
- KpunkDocument48 pagesKpunkjulienboyerPas encore d'évaluation
- Bianchi, Retour Sur L'autonomie ItalienneDocument6 pagesBianchi, Retour Sur L'autonomie ItaliennejulienboyerPas encore d'évaluation
- Sibertin BlancDocument10 pagesSibertin BlancjulienboyerPas encore d'évaluation
- Chime 0986-6035 1989 Num 7 1 1146Document16 pagesChime 0986-6035 1989 Num 7 1 1146julienboyerPas encore d'évaluation
- Arico, Marx Et l'AM LDocument12 pagesArico, Marx Et l'AM LjulienboyerPas encore d'évaluation
- Castoriadis (Debat Av MAUSS) Politique Democratie ValeursDocument56 pagesCastoriadis (Debat Av MAUSS) Politique Democratie ValeursGhald100% (1)
- Gilles Deleuze Et Félix Guattari Cairn - InfoDocument20 pagesGilles Deleuze Et Félix Guattari Cairn - InfojulienboyerPas encore d'évaluation
- Scholz, Marie Étends Ton MlanteauDocument9 pagesScholz, Marie Étends Ton MlanteaujulienboyerPas encore d'évaluation
- Gramsci Lettres de PrisonDocument277 pagesGramsci Lettres de PrisonWonder LaurencePas encore d'évaluation
- Boccara Le Sens Du SensDocument7 pagesBoccara Le Sens Du SensjulienboyerPas encore d'évaluation
- Clastres, Introduction Au Discours de La Servitude VolontaireDocument5 pagesClastres, Introduction Au Discours de La Servitude VolontairejulienboyerPas encore d'évaluation
- TechniqueDocument24 pagesTechniquejulienboyerPas encore d'évaluation
- Labyrinthe UniversalisDocument2 pagesLabyrinthe UniversalisjulienboyerPas encore d'évaluation
- Le Mur Et La Brèche Galeano PDFDocument12 pagesLe Mur Et La Brèche Galeano PDFjulienboyerPas encore d'évaluation
- Le Mur Et La Brèche Galeano PDFDocument12 pagesLe Mur Et La Brèche Galeano PDFjulienboyerPas encore d'évaluation
- Pedagogie Des OpprimesDocument3 pagesPedagogie Des OpprimesjulienboyerPas encore d'évaluation
- TechniqueDocument24 pagesTechniquejulienboyerPas encore d'évaluation
- Grammaire Par Les Exercices 4e 2021-ExtraitDocument1 pageGrammaire Par Les Exercices 4e 2021-ExtraitMarlen LylyPas encore d'évaluation
- Determinants de La Demande Touristique (Maroc)Document13 pagesDeterminants de La Demande Touristique (Maroc)Ilassa SavadogoPas encore d'évaluation
- B04 - La Condamnation de Monseigneur WilliamsonDocument26 pagesB04 - La Condamnation de Monseigneur WilliamsondefagojiPas encore d'évaluation
- Politiques RH Et Législation Du TravailDocument6 pagesPolitiques RH Et Législation Du TravailAdil LamPas encore d'évaluation
- Bou 1026Document243 pagesBou 1026Mourad BenderradjiPas encore d'évaluation
- Faut Il Renoncer À Définir Le BeauDocument2 pagesFaut Il Renoncer À Définir Le BeauAhmed AbdiPas encore d'évaluation
- Commentaire Extrait L'Étranger - A. CamusDocument4 pagesCommentaire Extrait L'Étranger - A. CamusCé CilPas encore d'évaluation
- Iged 20-21 Unigba-1Document98 pagesIged 20-21 Unigba-1pascalmambengaPas encore d'évaluation
- Encyclopédie Berbère Volume 24Document172 pagesEncyclopédie Berbère Volume 24idlisen100% (5)
- Formation Vastu TlseDocument8 pagesFormation Vastu TlseGeetha MaPas encore d'évaluation
- Comment Rester Serein Quand Tout Seffondre - Fabrice Midal-1Document112 pagesComment Rester Serein Quand Tout Seffondre - Fabrice Midal-1gard30100% (2)
- Chapitre 1 L'époque de L'ignoranceDocument12 pagesChapitre 1 L'époque de L'ignorancearain91Pas encore d'évaluation
- Evolution Psychologique EnfantDocument37 pagesEvolution Psychologique EnfantMalak MeriemPas encore d'évaluation
- Aradia Levangile Des SorciereDocument68 pagesAradia Levangile Des Sorciereapi-27173350100% (2)
- Bellavance, G. (2002) Démocratisation Culturelle Et Actions LocalesDocument4 pagesBellavance, G. (2002) Démocratisation Culturelle Et Actions LocalesChaire Fernand-Dumont sur la culturePas encore d'évaluation
- TAF: Livret Méthodologie de RechercheDocument15 pagesTAF: Livret Méthodologie de RechercheWael MtirPas encore d'évaluation
- Evaluer Un ÉvénementDocument2 pagesEvaluer Un ÉvénementLoic TamisierPas encore d'évaluation
- Les Beaux-Arts Réduits À Un Même PrincipeDocument53 pagesLes Beaux-Arts Réduits À Un Même Principelepton100Pas encore d'évaluation
- La Loi Universelle Du SuccesDocument2 pagesLa Loi Universelle Du Succesbokajude80% (5)
- Demorgnon (2004) - Invencion de L InterculturelleDocument28 pagesDemorgnon (2004) - Invencion de L InterculturelleojoveladorPas encore d'évaluation
- Bien-Être Subjectif La Science Du BonheurDocument12 pagesBien-Être Subjectif La Science Du Bonheur'Personal development program: Personal development books, ebooks and pdfPas encore d'évaluation
- Français 1re Grammaire - Les CirconstanciellesDocument2 pagesFrançais 1re Grammaire - Les CirconstanciellesValérie DucretPas encore d'évaluation