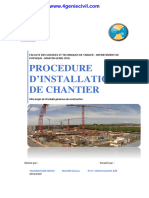Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rapport - ENSA - El Barakaz Youssef Esseddik
Rapport - ENSA - El Barakaz Youssef Esseddik
Transféré par
Amgdoul HatimTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rapport - ENSA - El Barakaz Youssef Esseddik
Rapport - ENSA - El Barakaz Youssef Esseddik
Transféré par
Amgdoul HatimDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rapport de stage technique
Intitule :
Etude et amélioration d’une
Chaudière à vapeur
Realisé par :
➢ Basry Lahcen
➢ El Barakaz Youssef Esseddik
Encadré par :
➢ EL Haouti Houssam
Année universitaire 2017/18
Remerciement :
Il nous est agréable d'exprimer en toute sincérité nos remerciements chaleureux à la
société FANTASIA, qui nous a offert l'opportunité d’effectuer notre stage
technique dans l’entreprise.
Que la direction technique de FANTASIA à DCHEIRA, trouve ici l'expression de
notre reconnaissance, pour nous avoir permis de passer ce stage dans des bonnes
conditions.
On veut tout d’abord exprimer nos profonde reconnaissance et respect à Monsieur
El Haouti Houssam notre encadrant de stage, et Monsieur Ahmed Ait Hazem qui a
fait preuve d’une grande disponibilité à notre égard, pour ses conseils, ses
constructions et ses précieuses directives, qui a permis le bon déroulement et la
mise en œuvre de notre stage.
Finalement, nous remercions aussi tous les personnes qui nous ont aidé et nous ont
encouragé à la rédaction de ce rapport de prêt ou de loin.
Rapport de stage Page 1 | 51
Table de matière
Remerciement : ............................................................................................................................................. 1
Table de matière ........................................................................................................................................... 2
Table des figures............................................................................................................................................ 5
Liste des tableaux .......................................................................................................................................... 6
Introduction générale.................................................................................................................................... 7
Chapitre I : .................................................................................................................................................... 8
1. Présentation de la société marocaine des emballages FANTASIA : .................................................. 9
1.1. Introduction : ............................................................................................................................. 9
1.2. Historique de l’entreprise :........................................................................................................ 9
1.3. Fiche technique de l’entreprise : ............................................................................................. 10
1.4. Structure organisationnelle de l’entreprise : .......................................................................... 10
1.4.1. Direction Générale : ........................................................................................................ 10
1.4.2. Direction Commerciale : ................................................................................................. 10
1.4.3. Direction du Personnel : ................................................................................................. 11
1.4.4. Direction Technique :...................................................................................................... 11
1.4.5. Direction Administrative et Financière : ........................................................................ 11
2. Processus de production : ............................................................................................................... 12
2.1. Fabrication des fonds de caisses : ........................................................................................... 12
2.1.1. Le déroulage : .................................................................................................................. 12
2.1.2. L’agrafage : ...................................................................................................................... 12
2.1.3. Le séchage : ..................................................................................................................... 12
2.1.4. Stabilisation et stockage : ............................................................................................... 12
2.2. Fabrication des têtes de caisses : ............................................................................................ 12
2.2.1. Fabrication des tasseaux en pin : ................................................................................... 12
2.2.2. Préparation des plaques de têtes : ................................................................................ 13
2.2.3. Assemblage : ................................................................................................................... 13
2.3. Fabrication des côtes : ............................................................................................................. 13
2.3.1. Le déroulage des placages : ............................................................................................ 13
2.3.2. Le séchage des placages : ............................................................................................... 13
2.3.3. L’encollage : .................................................................................................................... 13
2.3.4. Pré- pressage et pressage : ............................................................................................. 13
2.4. Montage des caisses :.............................................................................................................. 13
Rapport de stage Page 2 | 51
2.5. Montage des palettes : ............................................................................................................ 13
3. Installation électrique de l’usine : ................................................................................................... 14
Chapitre Ⅱ : ................................................................................................................................................. 18
1. Généralité : ...................................................................................................................................... 19
1.1. Introduction ............................................................................................................................. 19
1.2. Chaudière à combustion :........................................................................................................ 19
1.3. Principe de fonctionnement d’une chaudière :....................................................................... 20
2. Modélisation de la chaudière à vapeur du FANTASIA : ................................................................... 20
2.1. Chaudière à vapeur : ............................................................................................................... 20
2.2. Eléments constituant le système de la chaudière à vapeur : .................................................. 21
2.3. Description des éléments du système :................................................................................... 21
2.4. Schéma technique du système étudié : .................................................................................. 22
2.5. Vue générale sur la DN14 : ...................................................................................................... 22
2.5.1. Principe de fonctionnement : ......................................................................................... 23
2.5.2. Principe de déroulage : ................................................................................................... 24
2.6. Cahier de charge : .................................................................................................................... 24
2.6.1. GEMMA : ......................................................................................................................... 25
2.6.2. Grafcets : ......................................................................................................................... 27
2.7. Les entrés et les sorties d’automate : ..................................................................................... 28
2.7.1. Tableau des entrés : ........................................................................................................ 28
2.7.2. Tableau des sorties : ....................................................................................................... 29
2.7.3. Ladder :............................................................................................................................ 29
2.8. Schéma électrique des moteurs : ............................................................................................ 34
Chapitre Ⅲ :................................................................................................................................................ 36
1. Problématique : ............................................................................................................................... 37
2. Solution proposée : ......................................................................................................................... 38
2.1. Solution proposée : ................................................................................................................. 38
2.2. Choix d’automate : .................................................................................................................. 38
2.3. Choix de variateur : ................................................................................................................. 39
2.4. Choix de capteur de température : ......................................................................................... 40
2.4.1. Définition : ...................................................................................................................... 41
2.4.2. Principe :.......................................................................................................................... 41
2.4.3. Caractéristiques des principaux thermocouples : ......................................................... 41
2.4.4. Choix de thermocouple (sonde thermocouple de type S) :........................................... 41
Rapport de stage Page 3 | 51
2.4.5. Force électromotrice en fonction de la température de thermocouple :..................... 42
2.5. Choix des vannes de régulation :............................................................................................. 42
2.5.1. Définition: ....................................................................................................................... 42
2.5.2. Les composants de la vanne de régulation : .................................................................. 43
2.5.3. Relation de coefficient de débit : ................................................................................... 43
2.6. Choix des détecteurs : ............................................................................................................. 44
2.6.1. Définition d’un capteur : ................................................................................................ 44
2.6.2. Choix détecteur : ............................................................................................................. 44
2.6.3. Procédés de réalisation : ................................................................................................ 44
2.7. Schéma électrique de démarrage avec variateur de vitesse :................................................. 45
2.8. Fonctionnement après amélioration : ..................................................................................... 46
2.8.1. Tableau des entrés : ........................................................................................................ 46
2.8.2. Tableau des sorties : ....................................................................................................... 46
2.8.3. Grafcets améliorés : ........................................................................................................ 47
2.8.4. Ladder amélioré : ............................................................................................................ 48
Conclusion générale .................................................................................................................................... 51
Rapport de stage Page 4 | 51
Table des figures
Figure 1 : exemple d'emballage ....................................................................................................... 9
Figure 2 : logo de Fantasia................................................................................................................ 9
Figure 3 : circuit électrique du poste général ................................................................................ 14
Figure 4 : circuit électrique du poste 1........................................................................................... 15
Figure 5 : circuit électrique du poste de déroulage ....................................................................... 15
Figure 6 : circuit électrique du poste de caisse armée................................................................... 16
Figure 7 : circuit électrique du poste 1-Bis..................................................................................... 16
Figure 8 : circuit électrique du poste de contre-plaque................................................................. 17
Figure 9 : chaudière à combustion (bois) ....................................................................................... 19
Figure 10 : chaudière à vapeur du Fantasia ................................................................................... 20
Figure 11 : schéma technique du système étudié ......................................................................... 22
Figure 12 : la dérouleuse DN14 ...................................................................................................... 22
Figure 13 : billon avant déroulage.................................................................................................. 23
Figure 14 : billon après déroulage .................................................................................................. 23
Figure 15 : Grafcet de conduite...................................................................................................... 27
Figure 16 : Grafcet marche et arrêt ............................................................................................... 27
Figure 17 : Grafcet tapis roulant et vérin ....................................................................................... 27
Figure 18 : Grafcet de remplissage du condensat et citerne ......................................................... 27
Figure 19 : Grafcet de ventilation................................................................................................... 28
Figure 20 : Grafcet de sécurité ....................................................................................................... 28
Figure 21 : Grafcet d'aspiration ...................................................................................................... 28
Figure 22 : Grafcet de remplissage de la chaudière ....................................................................... 28
Figure 23 : Ladder de conduite....................................................................................................... 30
Figure 24 : Ladder de marche et arrêt ........................................................................................... 30
Figure 25 : Ladder du tapis roulant ................................................................................................ 31
Figure 26 : Ladder du ventilateur ................................................................................................... 32
Figure 27 : Ladder de remplissage de la chaudière........................................................................ 32
Figure 28 : Ladder de remplissage du condensat et citerne .......................................................... 33
Figure 29 : Ladder de l'aspirateur .................................................................................................. 33
Figure 30 : circuit de puissance ...................................................................................................... 34
Figure 31 : circuit de commande .................................................................................................... 35
Figure 32 : moteur de ventilation de la chaudière......................................................................... 37
Figure 33 : moteur d'aspiration de la chaudière ............................................................................ 37
Figure 34 : l'automate TSX 37-22 ................................................................................................... 39
Figure 35 : variateur de vitesse ATV212......................................................................................... 40
Figure 36 : rôle général d'un capteur ............................................................................................. 44
Figure 37 : montage de type proximité .......................................................................................... 44
Figure 38 : capteur photoélectrique de type proximité ................................................................. 44
Rapport de stage Page 5 | 51
Figure 39 : circuit de puissance avec variateur .............................................................................. 45
Figure 40 : circuit de commande avec variateur ............................................................................ 46
Figure 41 : Grafcet amélioré des moteurs M2 et M6 .................................................................... 47
Figure 42 : Grafcet amélioré du séchoir ......................................................................................... 47
Figure 43 : Ladder amélioré du séchoir .......................................................................................... 48
Figure 44 : Ladder amélioré des moteurs M2 et M6 (1) ............................................................... 49
Figure 45 : Ladder amélioré des moteurs M2 et M6 (2) ................................................................ 50
Liste des tableaux
Tableau 1 : fiche technique de l'entreprise ................................................................................................. 10
Tableau 2 : éléments chaudière à vapeur (capteurs, actionneurs et pré actionneurs) .............................. 26
Tableau 3 : liste des entrées automate ....................................................................................................... 29
Tableau 4 : liste des sorties automate......................................................................................................... 29
Tableau 5 : nouvelles entrées d'automate .................................................................................................. 46
Tableau 6 : nouvelles sorties d'automate ................................................................................................... 46
Rapport de stage Page 6 | 51
Introduction générale
Dans le cadre de notre formation, au sein de l’école nationale des sciences appliquées
d’Agadir, nous sommes amenés à effectuer un stage d’été afin de mettre en pratique les
connaissances acquises. Dans ce cadre, nous avons eu l’occasion d’élaborer une étude au
sein de l’entreprise FANTASIA.
Suite aux facteurs de la concurrence, l’évolution de l’activité de l’entreprise et la
mondialisation, FANTASIA, entreprise industrielle spécialisée dans la production des
caisses d’emballages et des palettes, s’est fixée l’objectif de rendre son système de
production plus efficace et plus compétitif.
Cela ne sera pas réalisé que par l’amélioration de la qualité globale de ses produits,
l’optimisation et le renforcement de ses moyens de production technique et humaine,
ainsi que la réduction du coût de production.
De ce fait les responsables ont commencé à mettre en cause l’organisation interne de
l’entreprise pour détecter et éliminer toute source de dysfonctionnement.
Ce présent rapport portera essentiellement sur un parmi les efforts mise en place par la
société, afin d’optimiser la production ; il s’agit de l’automatisation du processus de
production, plus précisément dans ce cas, la chaudière à vapeur sujet de cette étude.
Notre rapport est organisé de la manière suivante :
• Le premier chapitre concerne la présentation de l’entreprise d’accueil.
• Le second chapitre porte sur l’étude de fonctionnement de la chaudière à
vapeur
• Le troisième chapitre présente les problématiques et les solutions proposées.
Rapport de stage Page 7 | 51
Chapitre I :
Présentation de
l’entreprise d’accueil
Rapport de stage Page 8 | 51
1. Présentation de la société marocaine des emballages FANTASIA :
1.1. Introduction :
Le Maroc est considéré comme l’un des pays
exportateurs des agrumes et des primeurs, ce
secteur est très important pour l’économie
nationale. Malgré quelques difficultés rencontrer
récemment et qui sont tributaires des conditions
climatiques et concurrentielles.
A cet effet la fabrication et la commercialisation
des emballages deviennent indispensables pour
l’exportation des produits agricoles ce qui a
poussé la SME
FANTASIA de s’inscrire dans le secteur des
emballages.
Figure 1 : exemple d'emballage
1.2.Historique de l’entreprise :
L’entreprise FANTASIA a été créé en 1947 par le Français "PIERRE ANGEBAULT" et avait comme
mission la fabrication et la commercialisation des briques rouges destinées aux constructions.
En 1958, elle changea d’activité et se spécialisa dans la fabrication et la commercialisation des
emballages en bois pour les Agrumes et les Primeurs destinées exclusivement à l’exportation.
Figure 2 : logo de Fantasia
Depuis cette date, FANTASIA accompagne les exportateurs d’une manière soutenue et elle a
participé activement à l’évolution de l’emballage, depuis le billot, la caisse africaine, la floridienne,
la caisse armée, le pack, le plateau hollandais et actuellement le plateau européen avec
l’introduction du kit et le montage en station.
Ce changement radical dû à l’importance du marché des produits agricoles dans la région SOUSS
- MASSA ainsi qu’à la proximité des clients dont pourrait bénéficier FANTASIA.
Elle s’est marocanisé en 1973, et son nom devient "la Société Marocaine des Emballages
FANTASIA". Dans les années 90 FANTASIA devient une succursale du groupe
PINAULT PRINTEMPS REDOUTE, mais actuellement est devenue une succursale du groupe CFAO.
Rapport de stage Page 9 | 51
1.3. Fiche technique de l’entreprise :
Nome de la société Société marocaine d’emballages FANTASIA
Adresse BP 74 80350 INEZGANE
Capital social 40.000.000 DHS
Forme juridique Société anonyme
Nombres employés 900 personnes
Téléphone / fax 0528.27.15.71/57/74/78/80 fax :
0528.27.15.82
E- mail Sme fantasia@menara.ma
Secteur d’activité Industrie du bois
Spécialité Fabrication des emballages agrumes
et primeurs
Destination CEE/Nord Amérique / Pays
scandinaves / Afrique
Régime économique Admission Temporaire
Régime de TVA Débit
Exercice Du 1er Janvier au 31 Décembre
Tableau 1 : fiche technique de l'entreprise
1.4. Structure organisationnelle de l’entreprise :
1.4.1. Direction Générale :
C’est l’organe de décision qui applique les directrices du conseil d’administration.
1.4.2. Direction Commerciale :
Elle s’occupe de la gestion de toutes les opérations commerciales, les relations avec les clients, le
règlement des factures, la fixation des prix et l’établissement des contrats.
A - Service vente :
Ce service occupe une place primordiale au sein de la société. Dans le cadre de ses relations
extérieures, ce service entretient des relations avec la clientèle.
B - Service livraison :
Ce service s’occupe de la facturation des emballages vendus, et la gestion des bons de
commandes.
Rapport de stage Page 10 | 51
Dans la plupart des cas, la société établit des relations avec les clients en groupe. Le service exige
à ses clients une déclaration d’importation temporaire, qu’ils devraient délivrer au bureau
douanier, pour assurer que les emballages vendus seront exportés par le client.
Après la réception de la commande, le service établit un bon de livraison en six exemplaires :
• Un exemplaire sera envoyé avec la marchandise.
• Apres la réception du bon de la réception, il envoie la facture avec un autre bon de livraison.
• Un sera délivre au magasinier.
• Un au gardien.
• Deux exemplaires sont classés dans le dossier facture.
En ce qui concerne les factures, s’il s’agit d’une facture qui comporte la TVA, le service l’établit en
six exemplaires :
• Deux pour le service comptable.
• Une classée dans le service facturation.
• Trois pour les clients.
1.4.3. Direction du Personnel :
Elle veille à assurer la gestion du personnel indispensable au bon fonctionnement de la société à
savoir :
A - Recrutement :
Lorsque le besoin en mains d’œuvre est exprimé, l’augmentation de l’effectif total devient une
nécessité pour l’accomplissent de l’activité de la société. Dans ce cas, la société procède à la
méthode de recrutement.
B - La rémunération :
Puisque le contrat du travail est un contrat à titre onéreux. La direction est tenue de verser une
contrepartie du travail fournit par l’employé deux fois par mois (sauf les cadres), la première est
à considérer comme une avance.
1.4.4. Direction Technique :
Cette direction a pour but de surveiller les étapes de production ainsi que la maintenance des
machines et les moyens de transports, elle se compose de :
1- Service achat : Ce service s’occupe des relations entre la société et ses fournisseurs. Fantasia,
effectue ses achats dans les marchés nationaux et à l’étranger où il s’occupe des importations du
bois et des pièces de rechange pour les machines des ateliers.
2- Atelier Entretien : L’importance de ce service est incontestable puisqu’il assure la réparation et
la maintenance des machines.
3- Atelier Fabrication : Ce service s’occupe de la production et la fabrication des emballages de
toutes sortes.
1.4.5. Direction Administrative et Financière :
Elle a pour mission la gestion des affaires administratives de la société, ses ressources ainsi que
sa trésorerie suivant les objectifs fixés par la direction générale.
Rapport de stage Page 11 | 51
2. Processus de production :
Le processus de production peut être représenté comme le montre la figure suivante :
2.1. Fabrication des fonds de caisses :
2.1.1. Le déroulage :
C’est le copeau détaché de la masse d’un billon de bois qui constitue le produit, appelé placage
déroulé, d’une épaisseur et d’une largeur choisies en fonction du composant désiré.
2.1.2. L’agrafage :
Consiste à assembler les composants d’un fond de caisse par des agrafes en fil d’acier galvanisé.
2.1.3. Le séchage :
Evapore l’eau contenue dans le bois afin d’éviter les risques de moisissures.
2.1.4. Stabilisation et stockage :
Une période de stabilisation (environs 10H) est nécessaire. Une fois stabilisé, la pile de fonds est
cerclée et stockée.
2.2. Fabrication des têtes de caisses :
Une tête de caisse est composée de tasseaux en pin, d’une plaque imprimée en contre-plaqué ou
en panneaux de fibres.
2.2.1. Fabrication des tasseaux en pin :
La grume de pin importée est transformée dans une scierie automatique faisant appel aussi bien
aux anciens tours de mains qu’à la technologie la plus avancée, pour tirer parti au maximum du
bois.
Rapport de stage Page 12 | 51
2.2.2. Préparation des plaques de têtes :
Les panneaux découpés sont imprimés en quatre couleurs
2.2.3. Assemblage :
Appelé aussi agrafage des différents composants constituants la caisse.
2.3. Fabrication des côtes :
2.3.1. Le déroulage des placages :
Production des feuilles nécessaires à la fabrication du contre-plaqué.
2.3.2. Le séchage des placages :
Dans des séchoirs « à rouleaux », sous contrôle permanent prépare le placage du peuplier pour
le collage.
2.3.3. L’encollage :
Les placages enduits de colle sont assemblés en plis pour composer la plaque de contre-plaqué.
2.3.4. Pré- pressage et pressage :
Après un serrage à froid pour uniformiser la répartition de la colle, les panneaux sont ensuite
introduits dans des presses à chaud.
2.4. Montage des caisses :
Afin d’optimiser la logistique et l’espace de stockage, l’emballage est livré, généralement, en kit
aux stations de conditionnement qui se chargent du montage.
L’équipement est constitué d’un couple de montage avec :
➢ Une cardeuse permettant d’agrafer les côtés de la caisse aux têtes, grâce à des agrafes en
fil d’acier galvanisé.
➢ Une fonceuse reliant les fonds aux cadres précédemment constitués.
2.5. Montage des palettes :
Le montage est réalisé par des machines de clouage Son processus de fabrication est le
suivant :
Découpaeg Formation
Ecorçage Tronçonnage Assemblage
des billes des palettes
Rapport de stage Page 13 | 51
3. Installation électrique de l’usine :
La société FANTASIA compte sur son poste générale qui reçoit une tension de 22KV Triphasé en
provenance de l’Office National de l’Electricité (L’ONE), et qui alimente les différents secteurs de
la société.
Ce poste contient des sectionneurs de 22KV qui font distribuer le courant électrique aux autres
postes qui alimente les différents secteurs de l’usine (voir figure ci-après).
Figure 3 : circuit électrique du poste général
Ci-après, on donne les schémas électriques expliquant la manière de la distribution de l’électricité
dans les différents départements de l’usine.
Remarque : Dans ce circuit chaque sectionneur peut alimenter une ou plusieurs machines.
Rapport de stage Page 14 | 51
Figure 4 : circuit électrique du poste de déroulage
Figure 5 : circuit électrique du poste 1
Rapport de stage Page 15 | 51
Figure 4 : circuit électrique du poste de caisse armée
Figure 5 : circuit électrique du poste 1-Bis
Rapport de stage Page 16 | 51
Figure 6 : circuit électrique du poste de contre-plaque
Rapport de stage Page 17 | 51
Chapitre Ⅱ :
Etude de
fonctionnement de la
chaudière industrielle
Rapport de stage Page 18 | 51
1. Généralité :
1.1. Introduction
La chaudière est un système permettant de chauffer l’eau et de produire de la vapeur.
Industriellement, on utilise les chaudières pour produire la vapeur nécessaire au fonctionnement
des procèdes.
La source de chaleur peut être fournie par un combustible (gaz, fioul, charbon…) ou une résistance
électrique. De par son importance dans l’installation, la chaudière est un appareil relativement
complexe. On distingue les chaudières selon son combustible et selon sa construction.
1.2. Chaudière à combustion :
Selon le combustible en fonction des diverses sources utilisées dans les chaudières on a :
• Chaudière à combustibles liquide ou gazeux : ce type de chaudière est généralement
dote d’un bruleur qui s’occupe de la combustion
1. Chaudière à combustion gazeuse : le fonctionnement au gaz est un système à
combustion : le gaz est brulé dans une chaudière, avec un corps de chauffe. Celui-
ci (petit radiateur) chauffe de l’eau qui est ensuite diffusée dans l’habitation par
des tuyaux via une ou plusieurs pompes à eau. Ce type de chaudières est très
réponde comme utilisation domestique ou bien dans l’industrie, il présente des
avantages (prix très abordable du gaz, rendement énergétique excellent …)
comme des inconvénients (dégâts d’explosions ou d’intoxications).
2. Chaudière à combustion liquid:
De nombreuses habitations, ou usines industrielles sont équipées au fioul, les
chaudières au fioul ont réalisé de considérables progrès en termes de rendement,
d’écologie et d’hygiène.
• Chaudières à combustibles solide
Ici le combustible peut être le charbon
ou le bois.
Figure 7 : chaudière à combustion (bois)
Rapport de stage Page 19 | 51
1.3. Principe de fonctionnement d’une chaudière :
Quel que soit le modèle que vous avez, le principe de fonctionnement d’une chaudière repose
sur des éléments qui varient peu :
• Une chaudière a besoin d’un carburant, d’une source d’énergie : bois, fioul, gaz,
électricité, ou plus récemment l’air.
• Pour les chaudières à combustion, le carburant est brulé, et c’est cette action qui produit
de la chaleur.
• Pour les modèles électriques ou thermodynamiques, il n’y a pas de combustion, mais
l’utilisation d’une source d’énergie « invisible ».
• Dans tous les cas, l’énergie utilisé ou dégagée par la combustion sert à produire de la
chaleur, qui se transmet ensuite à des circuits reliés à des émetteurs de chaleur
(radiateurs, planchers chauffants).
• Les vapeurs dégagées et résidus de combustion sont évacués, sauf dans les modèles à
condensation, dans lesquels la vapeur est réutilisée en circuit interne.
2. Modélisation de la chaudière à vapeur du FANTASIA :
2.1. Chaudière à vapeur :
La chaudière est constitué d’un réservoir contenant un fluide caloporteur (eau) et muni d’un
système de chauffage (déchet de bois), son but est de produire et stocker de l’énergie thermique
de ce fluide et de l’utiliser dans les séchoirs pour assurer le traitement du bois contre les bactéries
Figure 8 : chaudière à vapeur du Fantasia
Rapport de stage Page 20 | 51
2.2. Eléments constituant le système de la chaudière à vapeur :
Une chaudière à vapeur est constituée des éléments suivants :
• Le corps de la chaudière ainsi tout équipements reliés (tuyauterie, etc.…)
• Les moteurs et les pompes
• Pressostat ou un détecteur de pression
• Sondes de niveau
• Séchoirs, condensat et citerne
2.3. Description des éléments du système :
➢ Condensat :
Stockage de l’eau et l’utiliser en cas
de besoin
➢ Pressostat :
Un pressostat est un dispositif détectant le
dépassement d'une valeur prédéterminée, de
la pression d'un fluide.
➢ Séchoirs :
C’est une structure destinée à faire sécher des
produits pouvant moisir en cas de stockage
humide
➢ Sondes de niveau :
Mesure le niveau d’eau dans la chaudière,
condensat et citerne, pour faire actionner les
moteurs et les pompes selon le besoin
Rapport de stage Page 21 | 51
2.4. Schéma technique du système étudié :
Figure 9 : schéma technique du système étudié
2.5. Vue générale sur la DN14 :
Il y a 5 dérouleuses identiques qui déroulent les billons de peuplier en placage d’une largeur allant
de 25 cm à 30 cm sur une épaisseur de 3mm, cette machine est la plus grande et la seule
dérouleuse qui possède une plus grande chaine de transfert automatisée parmi les autres qui
fournis au département les barrettes comme matière première.
Figure 10 : la dérouleuse DN14
Rapport de stage Page 22 | 51
2.5.1. Principe de fonctionnement :
Après avoir mis la machine sous tension et avoir vérifié les positions initiales de tous ces éléments
grâce au bouton INIT.
Au fonctionnement normal, on a cinq étapes qui se font parallèlement, le départ de cycle
commence par l’enclenchement du bouton automatique :
Figure 11 : billon avant déroulage
Figure 12 : billon après déroulage
Rapport de stage Page 23 | 51
2.5.2. Principe de déroulage :
Le déroulage est surtout utilisé pour la fabrication des feuilles minces qui par collage donneront
le contreplaqué. Le déroulage est donc assez exceptionnel, dans la fabrication des placages
d'ébénisterie. Tout d'abord il laisse un déchet assez important sous forme de noyau central. De
plus il donne une feuille de forme curviligne, mais on peut cependant juger intéressant.
Les effets de vinage que l'on peut obtenir.
• Bille griffée en son centre aux deux
extrémités est animée d'un mouvement
rotatif.
• Lame (ou couteau) se présentant sous
une inclinaison correspondant à la
nature du bois.
• Le couteau se rapprocha de l'axe de
rotation au fur et à mesure du
déroulage.
• Une barre de pression assure la,
régularité de la coupe.
On peut dire que le bois se développe
comme le papier qu'on déroule d'un
rouleau horizontal, ou bien, comme une
pièce de drap.
Au début de l'opération, le couteau
n'attaque le bois que par intermittence
jusqu'à ce que la bille ait une forme
cylindrique. Les premiers éléments détachés sont sans valeur (chiquettes). Ensuite on peut
obtenir une feuille continue, mais on peut aussi pratiquer une rainure suivant une génératrice
afin d'obtenir des feuilles séparées.
2.6. Cahier de charge :
Le système étudié (chaudière à vapeur) est entrainé par six moteurs asynchrones à cage triphasé
avec un démarrage étoile-triangle pour les moteurs de ventilation et d’aspiration, et un
démarrage direct pour le reste, ainsi un tapis roulant entrainé par un moteur pas à pas (avec un
sens de rotation)
Le fonctionnement du système :
➢ A l’état initial les moteurs M1, M2 et M6 démarrent en appuyant sur le bouton poussoir
Dcy.
Rapport de stage Page 24 | 51
➢ Le tapis roulant est mis en mouvement par un moteur M3, et la tige du vérin A1 sort.
➢ Après une temporisation de 10sec le moteur M3 s’arrête, et la tige du vérin A1 rentre
simultanément, 10sec après le cycle reprend.
➢ Le moteur M1 s’arrête si le niveau haut de la chaudière est atteint, ensuite le pressostat
laisse passer la vapeur d’eau vers les séchoirs puis vers le condensat.
➢ Après l’augmentation d’eau jusqu’à le niveau haut du condensat l’électrovanne s’ouvre et
l’eau passe vers la citerne.
➢ Lorsque le niveau d’eau diminue dans le condensat et augmente dans la citerne le moteur
M4 démarre pour récupérer l’eau de la citerne vers le condensat.
➢ Puis le moteur M5 démarre pour que l’eau du condensat passe vers la chaudière jusqu’il
atteint le niveau haut de cette dernière.
➢ Quand le niveau d’eau diminue dans le condensat et la citerne, et la chaudière atteint le
niveau critique (niveau bas ou Séc1), le moteur M1 démarre pour remplir la chaudière par
la source principale (RAMSA), si le niveau critique Séc2 de la chaudière est atteint alors le
système s’arrête.
2.6.1. GEMMA :
Le GEMMA, Guide d’Etude des Modes de Marches et d’arrêts est un "outil méthode" permettant
de mieux définir les Modes de Marches et d'Arrêts d'un système industriel automatisé. Dans le
cas de la chaudière à vapeur, nous avons adopté le GEMMA présenté dans la figure suivant :
Rapport de stage Page 25 | 51
Le système démarre avec un commutateur de deux positions :
✓ Marche automatique :
On appui sur le bouton poussoir Dcy, le système démarre. Lorsque les étapes sont
terminées le système revient à son point de départ pour accomplir un nouveau cycle.
✓ Marche manuelle :
Chaque moteur est commandé séparément par un commutateur de deux positions.
Capteurs Actionneurs et pré actionneurs
❖ Dcy : Bouton départ cycle ❖ M1 : moteur de la source principale
(RAMSA)
❖ Nb cond : capteur niveau bas
condensat ❖ M2 : moteur ventilation
❖ Nh cond : capteur niveau haut ❖ M3 : moteur de tapis roulant
condensat
❖ M4 : moteur de la pompe, conduit
❖ Nh chaud : capteur niveau haut de la l’eau de la citerne vers le condensat
chaudière
❖ M5 : moteur de la pompe, conduit
❖ Nb chaud : capteur niveau bas 1 de la l’eau du condensat vers la chaudière
chaudière
❖ M6 : moteur d’aspiration
❖ Séc1 : capteur niveau bas 2 de la
chaudière ❖ EVR1 : électrovanne laisse le passage
de l’eau du condensat vers la citerne
❖ Séc2 : capteur niveau bas 3 de la
chaudière (alarme) ❖ EVR2 : électrovanne de l’égaux
❖ Nb citer : capteur niveau bas de la ❖ EVR3 : électrovanne conduit vers les
citerne séchoirs
❖ Nh citer : capteur niveau haut de la ❖ V+ : sortie vérin A1
citerne
❖ V- : rentre vérin A2
❖ Pr : pressostat de pression
❖ Arrêt : bouton poussoir d’arrêt
❖ ARU : arrêt d’urgence
Tableau 2 : éléments chaudière à vapeur (capteurs, actionneurs et pré actionneurs)
Rapport de stage Page 26 | 51
2.6.2. Grafcets :
Figure 13 : Grafcet de conduite
Figure 14 : Grafcet marche
et arrêt
Figure 15 : Grafcet tapis
roulant et vérin
Figure 16 : Grafcet de remplissage du condensat et citerne
Rapport de stage Page 27 | 51
Figure 17 : Grafcet de Figure 19 : Grafcet Figure 18 : Grafcet de sécurité
ventilation d'aspiration
Figure 20 : Grafcet de remplissage de la chaudière
2.7. Les entrés et les sorties d’automate :
2.7.1. Tableau des entrés :
Désignations Mnémoniques Adresse
automate
Arrêt d’urgence ARU %I1.0
Départ cycle Dcy %I1.1
Bouton d’arrêt Arrêt %I1.2
Pressostat de pression Pr %I1.3
Sonde niveau bas1 de la chaudière Nb chaud %I1.4
Sonde niveau haut de la chaudière Nh chaud %I1.5
Sonde niveau bas2 de la chaudière Séc1 %I1.6
Flotteur de niveau bas de condensat Nb cond %I1.7
Rapport de stage Page 28 | 51
Flotteur de niveau haut de condensat Nh cond %I1.8
Flotteur de niveau bas de la citerne Nb citer %I1.9
Flotteur de niveau haut de la citerne Nh citer %I1.10
Sonde niveau bas3 de la chaudière Séc2 %I1.11
Commutateur 3 positions Auto-Man Auto %I1.14
Man %I1.15
Initialisation Init %I1.18
Tableau 3 : liste des entrées automate
2.7.2. Tableau des sorties :
Désignations Mnémoniques Adresse
automate
Système d’alarme SA %Q2.0
Contacteur moteur de pompe principale KM1 %Q2.1
RAMSA
Contacteur moteur ventilation KM2 %Q2.2
Contacteur moteur tapis KM3 %Q2.3
Contacteur moteur de pompe de retour KM4 %Q2.4
citerne => condensat
Contacteur moteur de pompe de retour KM5 %Q2.5
condensat => chaudière
Contacteur moteur d’aspiration KM6 %Q2.6
Electrovanne de passage d’eau du condensat EVR1 %Q2.7
vers la citerne
Electrovanne de passage d’eau du citerne vers EVR2 %Q2.8
l’égaux
Electrovanne de passage d’eau du chaudière EVR3 %Q2.9
vers les séchoirs
Sortie du vérin V+ %Q2.10
Entrée du vérin V- %Q2.11
Tableau 4 : liste des sorties automate
2.7.3. Ladder :
Pour l’implantation du Grafcet, il existe plusieurs logiciels pour les différents automates
disponibles sur le marché, on cite le RSlogix 500 pour Allain Bradly, le S7-PLCSIM pour le
Siemens, ainsi que PL7 pour le TSX .
Nous avons choisi ce dernier vu la facilité qu’il présente ainsi que sa disponibilité en cours de
réalisation.
Rapport de stage Page 29 | 51
Figure 21 : Ladder de conduite
Figure 22 : Ladder de marche et arrêt
Rapport de stage Page 30 | 51
Figure 23 : Ladder du tapis roulant
Rapport de stage Page 31 | 51
Figure 25 : Ladder de remplissage de la chaudière
Figure 24 : Ladder du ventilateur
Rapport de stage Page 32 | 51
Figure 26 : Ladder de remplissage du condensat et citerne
Figure 27 : Ladder de l'aspirateur
Rapport de stage Page 33 | 51
2.8. Schéma électrique des moteurs :
Figure 28 : circuit de puissance
Rapport de stage Page 34 | 51
Figure 29 : circuit de commande
Rapport de stage Page 35 | 51
Chapitre Ⅲ :
Problématique et
Solution
Rapport de stage Page 36 | 51
1. Problématique :
Après avoir étudié la chaudière, nous avons vu que l’installation de la chaudière comporte un
moteur de ventilation M2 (puissance 11Kw) et un moteur d’aspiration M6 (puissance 2.2kW), ces
deux moteurs fonctionnent avec une vitesse nominale d’une façon continue (tout le temps) quel
que soit la température et la pression dans la chaudière, ainsi que la vapeur circule dans les tous
séchoirs malgré qu’on n’a pas besoin.
Figure 30 : moteur de ventilation de la Figure 31 : moteur d'aspiration de la
chaudière chaudière
On constate alors qu’il y a des pertes d’énergie au niveau des moteurs au cas où la température
est élevée, et au niveau des séchoirs au cas où il n y’a pas des produits qui doivent être séchés (la
vapeur circule toujours dans les séchoirs).
Il faut une solution pour réduire la consommation d’énergie et d’optimiser l’utilisation des
ressources nécessaire pour le fonctionnement de la chaudière (l’eau, déchets du bois).
Rapport de stage Page 37 | 51
2. Solution proposée :
2.1. Solution proposée :
Pour résoudre cette problématique, la solution proposée est de régler les moteurs de ventilation
M2 et d’aspiration M6 en trois vitesses différentes à l’aide d’un variateur de vitesse pour chaque
moteur : (paire de pôle = 1)
✓ Petite vitesse f1 = 15 Hz V1 = 900 tr/min
✓ Vitesse moyenne f2 = 30 Hz V2 = 1800 tr/min
✓ Vitesse maximale f3 = 50 Hz V3 = 3000 tr/min
Cette régulation est effectuée à l’aide d’un capteur de température de la façon suivante :
✓ Si T1 < T < T2 : le moteur tourne avec une vitesse nominale
✓ Si T2 < T < T3 : le moteur tourne avec une vitesse moyenne
✓ Si T3 < T : le moteur tourne avec une petite vitesse
Avec T1 =0 < T2 < T3
Au niveau des séchoirs, la solution proposée est l’installation des vannes de régulation afin de
faire circuler la vapeur seulement dans les séchoirs en service, celui-ci est effectué à l’aide des
détecteurs de présence, qui indiquent si on a des produits dans les séchoirs ou non.
2.2. Choix d’automate :
Nous avons choisi dans ce travail comme automate Madicon TSX 37-22, elle appartient au gamme
d'automates de Schneider Electric conçus pour des applications nécessitant un traitement
important ou des fonctions analogiques et fonctions de comptages économiques.
Elle est composée de :
✓ Unités centrales composées d'une alimentation (24 V 19.2…30 V CC), d'un processeur
incluant une mémoire RAM de 20 Kmots.
✓ Mémoire interne Flash EEPROM de 15 Kmots attribuée à la sauvegarde du programme
d'application.
✓ Horodateur permettant de réaliser les fonctions heure, date et année.
✓ Emplacement pour 2 cartes PCMCIA (1 carte de communication et une carte d'extension
mémoire de 64 Kmots).
✓ 1 module d'entrées/sorties TOR au format standard (28 ou 64 E/S)
✓ 8 entrées analogiques intégrées et possibilité d'extensions analogiques.
✓ 2 modules demi-formats types entrées/sorties analogiques ou tout-ou-rien, ou de
comptage.
✓ Possibilité de comptage au travers des 4 premières entrées tout-ou-rien jusqu'à 500 Hz,
avec des modules de comptage jusqu'à 40 kHz.
Rapport de stage Page 38 | 51
✓ Structure du logiciel : mono-tâche (cyclique ou périodique), multitâche (tâche maître
cyclique ou périodique, tâche rapide périodique), tâche événementielle (1 à 16
événements provoqués par les entrées tout-ou-rien ou le comptage)
✓ Fonction de régulation accessible à travers le logiciel de programmation PL7.
✓ Communication possible avec un périphérique ou un autre automate par la prise
terminale ou la prise de dialogue.
✓ Communication ASCII, Uni-Telway ou Modbus esclave.
Figure 32 : l'automate TSX 37-22
2.3. Choix de variateur :
Nous avons choisi comme variateur de vitesse pour les deux moteurs M2 et M6, l’Altivar 212,
c’est un variateur de vitesse pour moteurs asynchrones triphasés de 0,75 kW à 75 kW. Il est dédié
aux applications les plus courantes de la gestion des fluides dans les bâtiments du secteur tertiaire
(HVAC “Heating Ventilation Air Conditioning”) : ventilation, chauffage et climatisation, pompage.
Sa conception est basée sur l’éco-énergie avec une réduction énergétique pouvant atteindre 70
% par rapport à un système classique de régulation.
Caractéristiques :
• Altivar 212 couvre les puissances moteur comprises entre 0,75 kW et 75 Kw.
• Gamme de vitesse : 1 , 50 Hz.
• Principaux bus de communication utilisés sur le marché du bâtiment intégré : Modbus,
METASYS N2®, APOGEE FLN P1® et BACnet®.
• Réponse aux normes et certifications internationales : UL, CSA, C-Tick et NOM
Rapport de stage Page 39 | 51
Applications :
Ventilation :
• Atténue les nuisances sonores (bruits « aérauliques », moteur...)
• Redémarrage automatique
• Permet la gestion des registres
Chauffage et Climatisation :
• Optimise la régulation dans le traitement des fluides
• Utilisation du régulateur PID (température, débit, pression...)
• Ajustement des débits pour une meilleure maîtrise de l’énergie
• Suppression des résonnances mécaniques
Pompage :
• Détection de sous-charge/surcharge, du désamorçage de pompe
• Configuration multi moteur
• Limitation du temps de marche en petite vitesse
• Fonction Sommeil/Réveil
• Suppression des coups de bélier pour prolonger la durée de vie de l’installation
Figure 33 : variateur de vitesse ATV212
2.4. Choix de capteur de température :
Les capteurs de température sont des dispositifs permettant de transformer l’effet du
réchauffement ou du refroidissement sur leurs composants en signal électrique.
Dans notre cas on a utilisé un thermocouple :
Rapport de stage Page 40 | 51
2.4.1. Définition :
Le thermocouple convertie la température en
tension, lorsque deux fils conducteurs composent
de métaux différents sont joints, une faible tension
apparait, cette tension est fonction de la
température de la jonction et du type des métaux
qui composent les fils du thermocouple. Il possède
une bonne linéarité.
2.4.2. Principe :
A la jonction de deux conducteurs A et B
différents mais à la même température, s’établit
une différence de potentiel qui ne dépend que
de la nature des conducteurs et de leur
température ө (effet Peltier)
2.4.3. Caractéristiques des principaux thermocouples :
2.4.4. Choix de thermocouple (sonde thermocouple de type S) :
On a utilisé type S car il a des
caractéristiques spéciales par
exemple :
• Température : -50 à +1760 °C
Rapport de stage Page 41 | 51
2.4.5. Force électromotrice en fonction de la température de thermocouple :
2.5. Choix des vannes de régulation :
On a choisi d’utiliser une vanne de régulation commende par l’automate TSX 3722 à travers un
pré-actionneur
2.5.1. Définition:
La vanne de régulation est un organe qui relève
de la régulation industrielle des procédés
physico-chimiques. Elle est commandée par un
actionneur dont les variations continues de la
position modifient la taille de l'orifice de passage
du fluide. De cette façon, la chute de pression
aux bornes de la vanne est modulée lors du
passage d'un fluide, avec pour conséquence la
maîtrise du débit traversant.
Rapport de stage Page 42 | 51
2.5.2. Les composants de la vanne de
régulation :
Une vanne de régulation est composée :
• un corps de vanne monté en série sur la
canalisation, contenant le clapet et son
siège ;
• un servomoteur, accouplé au clapet par
une tige ou un axe de commande, et dont
le rôle est de déplacer le clapet à partir
d'un ordre de commande pneumatique,
électrique ou hydraulique ;
• un positionneur dont le rôle est d'asservir
la position de l'obturateur, en fournissant
à l'actionneur l'énergie motrice
nécessaire pour vaincre les frottements
dus au dispositif d’étanchéité et les forces
exercées par la poussée du fluide, en
fonction d'un signal de commande issu
du système de contrôle-commande,
électrique analogique ou numérique,
voire hydraulique.
2.5.3. Relation de coefficient de débit :
Rapport de stage Page 43 | 51
2.6. Choix des détecteurs :
2.6.1. Définition d’un capteur :
Un capteur est un composant technique qui détecte un événement physique se rapportant au
fonctionnement du système (présence d'une pièce, température, etc.) et traduit cet événement
en un signal exploitable par la PC de ce système. Ce signal est généralement électrique sous
forme d'un signal basse tension. La figure suivante illustre le rôle d’un capteur :
Figure 34 : rôle général d'un capteur
L'information détectée par un capteur peut être d'une grande variété, ce qui implique une
grande variété de besoins en capteurs. On cite parmi les plus connus et fréquents, les capteurs
de position, de présence, de vitesse, de température et de niveau.
Figure 35 : montage de type proximité
2.6.2. Choix détecteur :
Nous avons choisi comme détecteur de matière dans ce
projet : des détecteurs photoélectrique, ce choix est basé
sur le fait que ces détecteurs ont une très grande
sensibilité et ils sont réglable au niveau de temporisation
ce qui permet de les configurer pour n’importe qu’elle
situation.
Un détecteur photoélectrique réalise la détection d'une
cible, qui peut être un objet ou une personne, au moyen
d'un Les détecteurs photoélectriques se composent
essentiellement d'un émetteur de lumière associé à un
récepteur photosensible. La détection est effective quand
l'objet pénètre dans le faisceau lumineux et modifie Figure 36 : capteur photoélectrique de type
suffisamment la quantité de lumière reçue par le récepteur proximité
pour provoquer un changement d'état de la sortie.
2.6.3. Procédés de réalisation :
Elle est réalisée selon deux procédés :
Rapport de stage Page 44 | 51
1. Blocage du faisceau par la cible
2. Renvoi du faisceau sur le récepteur par la cible
Avantage
• Pas de contact physique avec l’objet détecté
• Détection d'objets de toutes formes et de matériaux de toutes natures
• Détection à très grande distance
• Sortie statique pour la rapidité de réponse
Détections
• Dépend de l'opacité et de la réflexion de l'objet
• Tous objet
Le système de proximité est caractérisé par :
• L'émetteur et le récepteur sont situés dans le même boîtier ;
• La présence de la cible renvoie le faisceau lumineux vers le capteur ;
• La portée dépend de la couleur de la cible, de son pouvoir réfléchissant et de ses
dimensions. Elle augmente si l'objet est de couleur claire ou de grande dimension.
2.7. Schéma électrique de démarrage avec variateur de vitesse :
Figure 37 : circuit de puissance avec variateur
Rapport de stage Page 45 | 51
Figure 38 : circuit de commande avec variateur
2.8. Fonctionnement après amélioration :
2.8.1. Tableau des entrés :
Désignations Mnémoniques Adresse
automate
Température T %MW1
Détecteur dans séchoir 1 a %I2.1
Détecteur dans séchoir 2 b %I2.2
Tableau 5 : nouvelles entrées d'automate
2.8.2. Tableau des sorties :
Désignations Mnémoniques Adresse
automate
Petite vitesse V1 %Q2.12
Vitesse moyenne V2 %Q2.13
Vitesse nominale V3 %Q2.14
Ouverture vanne 1 Vanne1+ %Q2.15
Fermeture vanne 1 Vanne1- %Q2.16
Ouverture vanne 2 Vanne2+ %Q3.1
Fermeture vanne 2 Vanne2- %Q3.2
Tableau 6 : nouvelles sorties d'automate
Rapport de stage Page 46 | 51
2.8.3. Grafcets améliorés :
Figure 39 : Grafcet amélioré des moteurs M2 et M6
Figure 40 : Grafcet amélioré du séchoir
Rapport de stage Page 47 | 51
2.8.4. Ladder amélioré :
Figure 41 : Ladder amélioré du séchoir
Rapport de stage Page 48 | 51
Figure 42 : Ladder amélioré des moteurs M2 et M6 (1)
Rapport de stage Page 49 | 51
Figure 43 : Ladder amélioré des moteurs M2 et M6 (2)
Rapport de stage Page 50 | 51
Conclusion générale
Ce stage a été très enrichissant pour nous car il nous a permis de s'intégrer dans une équipe de
professionnels, d'approfondir nos connaissances techniques et d'appliquer des divers concepts
technologiques. Et il nous a permis de participer concrètement à ses enjeux au travers de nos
missions variées comme celle du l’étude d’une chaudière à vapeur que nous avons
particulièrement apprécié.
Ce stage nous permis de comprendre que les missions créatives n’étaient pas les plus adaptées
pour nous et nous préfère d’orienter vers les métiers de génie électrique qui nous conviennent
mieux.
L’entreprise FANTASIA qui nous accueilli pendant ce stage fait face à une période charnière un
mois et demi, et nous sommes très fier d’avoir pu contribuer, participer à cette révolution.
L’évolution des usages et l’adaptation de l’entreprise au changement de son environnement.
Enfin, nous sommes persuadés que ce stage a tout à fait sa place dans notre enseignement, et qu'il
présente des atouts au niveau technique et au niveau professionnel de notre carrière.
Rapport de stage Page 51 | 51
Vous aimerez peut-être aussi
- Manuel Francais Gt3B/C CompletDocument17 pagesManuel Francais Gt3B/C CompletBoul19081275% (4)
- Rapport de StageDocument32 pagesRapport de StageOutman Benaouiss100% (6)
- Rapport de StageDocument32 pagesRapport de StageMarwane Ch100% (1)
- Rapport PFE Etude de Conception Dun Moule en Sable de Culbuteur Dun BasculeurDocument81 pagesRapport PFE Etude de Conception Dun Moule en Sable de Culbuteur Dun BasculeurHamza Elmouhtadi100% (2)
- Rapport de Fin D'études Des AgrumesDocument61 pagesRapport de Fin D'études Des Agrumesyounes boumkissePas encore d'évaluation
- Rapport StageDocument39 pagesRapport StageSabah KabbouPas encore d'évaluation
- Stabilite D Un Barrage en RemblaiDocument57 pagesStabilite D Un Barrage en Remblaiilias2003100% (2)
- Seuil Epais Vanne de FondDocument10 pagesSeuil Epais Vanne de FondCHEL TAKPas encore d'évaluation
- 249-2 S-Direction Différentielle Tracteur Sur ChainesDocument23 pages249-2 S-Direction Différentielle Tracteur Sur Chaineswtn2013100% (5)
- Rapport de Stage 3réparéDocument34 pagesRapport de Stage 3réparéjebalimalek2004Pas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument25 pagesRapport de Stagessafouen4Pas encore d'évaluation
- Rapport IL FinalDocument78 pagesRapport IL FinalhouriaPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage PerfectionnementDocument48 pagesRapport de Stage PerfectionnementRayen AbPas encore d'évaluation
- Walid Oroginal 1Document26 pagesWalid Oroginal 1walid.haouetPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Version FinalDocument30 pagesRapport de Stage Version FinalMiled HoussemPas encore d'évaluation
- Rapport Wael 1Document63 pagesRapport Wael 1malektouati28Pas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Technique RABIH - ABID - TALBIDocument78 pagesRapport de Stage Technique RABIH - ABID - TALBIChaymae NajmiPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage AgadirDocument37 pagesRapport de Stage AgadirABDELILAH ERRAHALIPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Asment TemaraDocument39 pagesRapport de Stage Asment TemaraYassine Tamanine100% (2)
- Rapport de StageDocument44 pagesRapport de Stageayoub bentaibiPas encore d'évaluation
- Doc-20230708-Wa0003.Document36 pagesDoc-20230708-Wa0003.Soufiane TVPas encore d'évaluation
- Rapport Final11Document36 pagesRapport Final11meryemelali521Pas encore d'évaluation
- Application de La Value Stream Mapping Eclair Prym TunisieDocument87 pagesApplication de La Value Stream Mapping Eclair Prym TunisieAmel HayetPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 2emeDocument25 pagesRapport de Stage 2emeKhouloud JeridiPas encore d'évaluation
- VR FinalDocument43 pagesVR FinalKhadija Es-sousyPas encore d'évaluation
- Rapport Finale Serrure WEAKcodéeDocument47 pagesRapport Finale Serrure WEAKcodéeamine5swidPas encore d'évaluation
- Stage Yamna AkerkouchDocument38 pagesStage Yamna Akerkouchaymanezaa66Pas encore d'évaluation
- Memoire CM Zack Et KarimDocument81 pagesMemoire CM Zack Et KarimMohamed MedhioubPas encore d'évaluation
- Rapp Ort Insta Llation Du Cha Ntier - WatermarkDocument37 pagesRapp Ort Insta Llation Du Cha Ntier - Watermark45616032Pas encore d'évaluation
- Stage TechnicienDocument25 pagesStage TechnicienKhaled Ben YoussefPas encore d'évaluation
- Nouveau Rapport PMC - SOGREGA 06 - 10 - 2023Document119 pagesNouveau Rapport PMC - SOGREGA 06 - 10 - 2023copy expressPas encore d'évaluation
- Rapport PFEDocument73 pagesRapport PFERamzi Ben AmaraPas encore d'évaluation
- Rapport Stage Ben Abdallah PDFDocument46 pagesRapport Stage Ben Abdallah PDFben abdalla Abdelfattah0% (1)
- Delphi PDFDocument27 pagesDelphi PDFmarouaPas encore d'évaluation
- Rapport NEMMOU BtissameDocument31 pagesRapport NEMMOU Btissamehachm ayoubPas encore d'évaluation
- A Rapport Stage Lebest ELKBIR-CHARFAOUI - 2 Etude r+5Document72 pagesA Rapport Stage Lebest ELKBIR-CHARFAOUI - 2 Etude r+5ilias2003Pas encore d'évaluation
- Rapport de PFE ALAOUI NOHAILADocument31 pagesRapport de PFE ALAOUI NOHAILAAminePas encore d'évaluation
- Exemple de Rapport de Stage - PFE COMPLETDocument50 pagesExemple de Rapport de Stage - PFE COMPLEThamza amgharPas encore d'évaluation
- Rapport Du ProjetDocument60 pagesRapport Du ProjetLeila EladrariPas encore d'évaluation
- 0000-Rapport de Presentation CMC Agadir Et AnnexeDocument175 pages0000-Rapport de Presentation CMC Agadir Et AnnexeNourdine ElbounjimiPas encore d'évaluation
- Finale Fonda11Document44 pagesFinale Fonda11Khalil Ben MansourPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage PFEDocument70 pagesRapport de Stage PFEadbessamadsassi123Pas encore d'évaluation
- Comparateur PrixDocument64 pagesComparateur PrixMEDT NSR100% (1)
- PreludeDocument49 pagesPreludeHamza AOUANEPas encore d'évaluation
- Rapport D'onee FinaleDocument76 pagesRapport D'onee Finaleettayeb kamelPas encore d'évaluation
- Memoire de Fin D'études Soukaina HARMOUZ PDFDocument49 pagesMemoire de Fin D'études Soukaina HARMOUZ PDFtissir HARMOUZPas encore d'évaluation
- PDF 1 Rapport de Stage Yasser Idhemmou Copie - CompressDocument40 pagesPDF 1 Rapport de Stage Yasser Idhemmou Copie - CompressYOUNES KABBAJPas encore d'évaluation
- PFA FinaleDocument61 pagesPFA FinaleHana HosniPas encore d'évaluation
- Rapport de 1ère PériodeDocument48 pagesRapport de 1ère PériodeHervé Franck MBAH SA'A0% (1)
- Rapport CMDocument48 pagesRapport CMHassen BENSALEMPas encore d'évaluation
- AchrafDocument74 pagesAchrafMohà Méd SmaouiPas encore d'évaluation
- Corps Du Rapport PDFDocument50 pagesCorps Du Rapport PDFIlliyassouPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage en IRRIGATION LOCALISEEDocument53 pagesRapport de Stage en IRRIGATION LOCALISEEYasser BellahcenePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage VFDocument33 pagesRapport de Stage VFzehii ghofranPas encore d'évaluation
- Pfe Azouz2020Document136 pagesPfe Azouz2020beizig hatemPas encore d'évaluation
- NG240-GE FRDocument68 pagesNG240-GE FRchatelier stephanePas encore d'évaluation
- Rapport StageDocument54 pagesRapport StageNourdine LamzahPas encore d'évaluation
- Rapport Jaouhary JalilaDocument33 pagesRapport Jaouhary JalilaELGUERCHEPas encore d'évaluation
- Rapport Yosri IsticDocument67 pagesRapport Yosri Isticraedkhefifi5Pas encore d'évaluation
- ZERRAV - Rapport Stage 1Document63 pagesZERRAV - Rapport Stage 1ayoub zerrabiPas encore d'évaluation
- Stage de PerfectionnementDocument50 pagesStage de PerfectionnementSy RiÑe Ha MdiPas encore d'évaluation
- IMM Vip - FLUIDE-ObjetDocument1 pageIMM Vip - FLUIDE-ObjetAmgdoul HatimPas encore d'évaluation
- Metre GaineDocument4 pagesMetre GaineAmgdoul HatimPas encore d'évaluation
- RapportDocument33 pagesRapportAmgdoul HatimPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Centrale FBS Version FinaleDocument51 pagesRapport de Stage Centrale FBS Version FinaleAmgdoul Hatim100% (1)
- Electrovannes de Sécurité, Une Allure MVD, MVD/5, Mvdle/5: Technique ApplicationDocument6 pagesElectrovannes de Sécurité, Une Allure MVD, MVD/5, Mvdle/5: Technique ApplicationYoughorta TirPas encore d'évaluation
- + IUP Diplome Universitaire exercices-corrigées-de-RDMDocument9 pages+ IUP Diplome Universitaire exercices-corrigées-de-RDMAlassane BambaPas encore d'évaluation
- Polycopie RDMDocument244 pagesPolycopie RDMzakariaPas encore d'évaluation
- GS RC Wam 002 FR 00Document24 pagesGS RC Wam 002 FR 00Gil-Alain EgnakouPas encore d'évaluation
- ExamenDocument3 pagesExamenRachid AchitPas encore d'évaluation
- Corrige Interro 2 PlasticiteDocument2 pagesCorrige Interro 2 PlasticiteFlower PowerPas encore d'évaluation
- Mobile Sur Un Plateau TournantDocument3 pagesMobile Sur Un Plateau TournantIngenieur EnsaPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 2 Description D'un Gaz ActualiséDocument8 pagesCHAPITRE 2 Description D'un Gaz ActualiséBrisni MbobiPas encore d'évaluation
- TP TR Tour de Refroidissement1aDocument17 pagesTP TR Tour de Refroidissement1aAlper GüloğluPas encore d'évaluation
- TD1 2021Document2 pagesTD1 2021RAFik MobPas encore d'évaluation
- Calcul Longueur CourroieDocument4 pagesCalcul Longueur CourroieGhislainTremblayPas encore d'évaluation
- Modélisation Du Comportement Dynamique Des EngrenagesDocument5 pagesModélisation Du Comportement Dynamique Des EngrenagesNourdinr AbPas encore d'évaluation
- CS-TM1-TD Hyperstatisme Pompe Prise Camion CorrectionDocument7 pagesCS-TM1-TD Hyperstatisme Pompe Prise Camion CorrectionPierre LancelotPas encore d'évaluation
- Cours Poulie CourroieDocument14 pagesCours Poulie CourroieSara Id OalemPas encore d'évaluation
- Manuel D'atelier Groupe Moteur MD6ADocument48 pagesManuel D'atelier Groupe Moteur MD6AJoseph Martin NKOLONG DIKOLPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 3 Perte de PrécontrainteDocument17 pagesCHAPITRE 3 Perte de PrécontrainteJunior BagaPas encore d'évaluation
- QCMDocument30 pagesQCMBrahim Bakhach78% (9)
- TD CH04Document3 pagesTD CH04Jessi-James OfficielPas encore d'évaluation
- Commande Adaptative PDFDocument2 pagesCommande Adaptative PDFTina100% (2)
- Valvulas Check Tipo Bola y Resorte CepexDocument4 pagesValvulas Check Tipo Bola y Resorte CepexOliveira LugoPas encore d'évaluation
- Flexion Cisaillement Van Hoorickx PDFDocument40 pagesFlexion Cisaillement Van Hoorickx PDFabdallahPas encore d'évaluation
- 3PIVOTSDocument3 pages3PIVOTSJean François LatchoumaninchettyPas encore d'évaluation
- DT SPDocument2 pagesDT SPخالد محمد السقنيPas encore d'évaluation
- MemI BoubeMed LelDocument128 pagesMemI BoubeMed Lelsofiane redjradjPas encore d'évaluation
- New Dellorto2018Document4 pagesNew Dellorto2018stephen DRUILHEPas encore d'évaluation
- CisaillementDocument9 pagesCisaillementOumaïma El AbidiPas encore d'évaluation