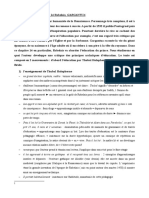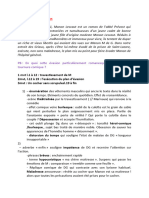Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Gargantua Plan détaillé Dissertation Fonctions Du Rire
Gargantua Plan détaillé Dissertation Fonctions Du Rire
Transféré par
missmari6776Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Gargantua Plan détaillé Dissertation Fonctions Du Rire
Gargantua Plan détaillé Dissertation Fonctions Du Rire
Transféré par
missmari6776Droits d'auteur :
Formats disponibles
1°/ Mme Vigneron
Bilan sur Gargantua
Sujet : Quelles sont les fonctions du rire dans Gargantua ?
Problématique : Pourquoi Rabelais vise-t-il à faire rire son lecteur ? Autrement dit, en quoi le rire
rabelaisien dépasse-t-il le simple divertissement ?
I Faire rire pour divertir le lecteur : FONCTION LUDIQUE
Rabelais utilise en premier lieu le rire comme moyen d’amuser et de libérer le lecteur.
1/ Rabelais invite d’emblée son lecteur à rire
Dès le début de l’œuvre, sous le déguisement d’Alcofribas Nasier, Rabelais annonce le ton de l’œuvre,
placée sous le signe de la joie et du rire ; faire rire est important pour Rabelais.
ex. 1 : poème liminaire « Avis au lecteur » : adresse directe par l’apostrophe « Amis lecteurs » = complicité,
captation benevolentiae + lui dit qu’il trouvera dans son livre « matière à rire » + Rabelais utilise aussi la
citation d’Aristote « Parce que le rire est le propre de l’homme »
ex. 2 : dans le prologue, adresse directe aussi « Buveurs très illustres, vérolés très précieux » : les thèmes de
l’œuvre sont posés = le rire, le vin, la nourriture, la bonne humeur « ébaudissez-vous et gaîment lisez »
ex. 3 : tous les passages de festin ou de beuverie = tonalité joyeuse du roman
2/ Il le fait rire en le plongeant dans un univers de farce et de démesure
Rabelais utilise les comiques de situation, de caractère et de gestes
ex. 1 : l’univers des géants : tout est surdimensionné et incroyable avec Gargantua : sa naissance par
l’oreille de Gargamelle, sa jument qui détruit toute une forêt avec sa queue, Gargantua qui vole les
cloches de Notre-Dame pour les mettre autour du cou de sa jument : c’est un univers de farce
ex. 2 : les épisodes scatologiques et l’évocation du bas-corporel : la diarrhée de Gargamelle qui a mangé
trop de tripes, la façon dont se comporte Gargantua quand il est petit « [il] « se vautrait dans les ordures […]
pissait sur ses souliers », l’épisode des « torche-culs », le déluge d’urine déversé par G. sur les habitants de
Paris
ex. 3 : la tradition du carnaval basée sur l’inversion des valeurs hiérarchies : le moine devient guerrier
« mi-diable » qui jubile du carnage qu’il réalise
3/ C’est aussi par sa créativité langagière que Rabelais fait rire son lecteur
cette écriture correspond à une esthétique de la joie, à une sorte d’euphorie verbale ; ce comique de
mots permet de créer un univers où règne la fantaisie.
ex. 1 : les mots grossiers qui évoquent les excréments : l’épisode des « torche-culs » avec le poème
ex. 2 les accumulations et les hyperboles : la liste des jeux de Gargantua
ex. 3 : les jeux de mots : « le service divin » / « le service du vin »
ex. 4 : les néologismes = invention verbale lors des propos « torcheculatifs », « rataconniculer », «
mammalement »
ex. 5 : les onomatopées aux effets sonores drôles
NB : possibilité aussi de faire une sous-partie sur le rire parodique qui nécessite la complicité du lecteur pour être
décelé.
Transition : Le rire chez Rabelais a bien pour objectif de divertir le lecteur mais il serait naïf de croire que
c’est sa seule fonction : ce rire, en apparence gratuit, est plus sérieux qu’il n’y paraît puisque qu’il permet
aussi de transmettre joyeusement une critique.
II : Faire rire pour dénoncer certains travers de l’époque : LA FONCTION CRITIQUE/SATIRIQUE
L’auteur utilise en second lieu le rire comme arme pour dénoncer l’héritage médiéval.
Le rire se met au service du sérieux et permet un regard critique sur la société : cela vise à discréditer les
ennemis de l’humanisme.
1er argument : La satire des sophistes et de l’éducation scolastique
rire du savoir, des pédants et de l’esprit de sérieux
ex. 1 : précepteurs sophistes Thubal Holoferne et Jobelin Bridé qui appartiennent à la Sorbonne cf.
onomastique :
« Thubal » = « la confusion » ! « jobelin » = « jobard » dc idiot et « bridé » = « à l’intelligence limitée »
pratique pédagogique scolastique ridicule : G. apprend son alphabet à l’endroit et à l’envers pdt plusieurs
années
ex. 2 Gargantua se met à « pleurer comme une vache » dvt Eudémon et son éloquence = éducation inutile
ex. 3 : la harangue de Janotus de Bragmardo = discours incompréhensible, pédant, latinisant
2ème argument : La critique religieuse
Rabelais critique le clergé et les moines.
ex.1 : la caricature des moines grâce à frère Jean avec « Les pauvres diables de moines » = antithèse
ironique qui a pour but de discréditer les moines de l’abbaye de Seuilly, passifs et incapables de protéger
leur abbaye.
ex.2 : Rabelais condamne sous des aspects comiques les pèlerinages et le culte des saints cf. épisode farfelu des
pèlerins mangés en salade et qui se promènent dans la bouche de Gargantua suivi par une réflexion sur la
superstition : c’est Grandgousier qui donne la morale et qui enjoint aux pèlerins de ne pas croire tout ce
qu’on essaie de leur faire croire (Rab. = évangéliste, reproche à l’Eglise d’exploiter la naïveté du peuple)
ex. 3 : L’abbaye utopique de Thélème dont la devise est « Fais ce que voudras » : cette abbaye ne respecte
pas le vœu de chasteté, de pauvreté ou d’obéissance et insulte donc la communauté religieuse, il s’agit
d’une anti-abbaye.
3ème argument : La dénonciation de la guerre
Rabelais critique la violence des guerres et l’esprit de conquête.
ex. 1 : la parodie des épopées avec l’épisode de frère Jean qui massacre les ennemis.
ex. 2 : la soif de conquêtes de Picrochole qui se fait manipuler par ses conseillers
Transition : Mais le rire n’est pas que divertissement ou critique : il est aussi porteur de la pensée
humaniste de l’auteur
III Le rire est porteur de la pensée humaniste elle-même : LA FONCTION PHILOSOPHIQUE ET
MORALE
Le rire chez Rabelais est très important car il est le reflet de sa vision humaniste. Faire rire permet de
créer une distance et de nous préparer à mieux découvrir ensuite les préceptes très sérieux de l’humanisme.
1/ Le rire a une fonction thérapeutique = le rire médecin
Rab. veut guérir ses lecteurs par le rire (il était médecin) : être bien = un objectif humaniste
ex.1 : dès le poème liminaire adressé aux lecteurs, le rire est présenté comme une consolation au chagrin et
aux difficultés de la vie : « Quand je vois la peine qui vous mine et consume, / Il vaut mieux traiter du rire que des
larmes » + « Parce que le rire est le propre de l’homme.» + « Vivez heureux »
2/ Le rire se met au service d’un idéal de sagesse, il est porteur de la pensée humaniste de
Rabelais
le rire mène à la sagesse, il est d’une grande profondeur de sens, il contribue à développer la pensée
humaniste ; il rend l’homme meilleur et élève son âme.
ex. 1 : dès le prologue, Rabelais nous dit que le rire contient un savoir précieux en utilisant la métaphore
des Silènes ou la comparaison avec Socrate : le rire n’est pas gratuit mais il contient des leçons qu’il
appartient au lecteur de découvrir : il faut découvrir le sens allégorique des œuvres joyeuses. Exemple :
l’épisode du « torche-cul » cache un message élevé et philosophique, une question profonde : comment se
débarrasser (de façon plaisante et efficace) de la merde de ce monde ? càd. de nos passions mauvaises, du
péché, du mal ?
ex. 2 : le ridicule de Picrochole est porteur d’une dimension morale puisque Rabelais amène indirectement
le lecteur à réfléchir au modèle du bon prince.
ex. 3 : le nom même de G. évoque la gorge déployée pour rire : « quel grand tu as ! ». G. = métaphore du rire,
de l’appétit du savoir
3/ Le rire mène à la construction d’un modèle de sagesse : la leçon finale de l’abbaye de Thélème,
utopie humaniste
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Livre de La ConnaissanceDocument341 pagesLe Livre de La ConnaissanceChristophe B. de Centa75% (4)
- Zikr de Astaghfiroullah Pour Avoir Ouverture Et Les Bienfaits DDocument3 pagesZikr de Astaghfiroullah Pour Avoir Ouverture Et Les Bienfaits Dricky89% (45)
- Comment Développer Vos Pouvoirs Intérieurs: Un Rapport Sur Les Pouvoirs Mentaux Et La Réalisation SpirituelleDocument23 pagesComment Développer Vos Pouvoirs Intérieurs: Un Rapport Sur Les Pouvoirs Mentaux Et La Réalisation SpirituelleMoussa100% (2)
- Survivants Des IlluminatisDocument110 pagesSurvivants Des Illuminatisjuliusevola1Pas encore d'évaluation
- Amadou Hampate Bâ PDFDocument182 pagesAmadou Hampate Bâ PDFGeorges Akbann100% (1)
- Fiqh AlmouyassarDocument526 pagesFiqh AlmouyassarAbdallah ibn ali92% (12)
- Manon 1e Rencontre EXP LINDocument6 pagesManon 1e Rencontre EXP LINIvan Morales CostaPas encore d'évaluation
- J2L3 (Corrigé) - Droit Des Libertés Fonda (Méthodo)Document6 pagesJ2L3 (Corrigé) - Droit Des Libertés Fonda (Méthodo)stef100% (1)
- LL Scène de La RencontreDocument5 pagesLL Scène de La RencontreJaziri MalekePas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud, Au Cabaret-Vert, Cinq Heures Du Soir - Commentaire ComposéDocument3 pagesArthur Rimbaud, Au Cabaret-Vert, Cinq Heures Du Soir - Commentaire ComposéAlavi AurélienPas encore d'évaluation
- Le Printemps Des Sayanim - Jacob Cohen PDFDocument1 045 pagesLe Printemps Des Sayanim - Jacob Cohen PDFAdrien Bock100% (5)
- Rimbaud Émancipations Créatrices CoursDocument9 pagesRimbaud Émancipations Créatrices Coursninjax2000proPas encore d'évaluation
- Evaluation N 3 DissertationDocument2 pagesEvaluation N 3 Dissertationjigglepeeker02Pas encore d'évaluation
- Fiche LesÉffarésDocument6 pagesFiche LesÉffarészroustangPas encore d'évaluation
- Le Crapaud, Corbière LL RédigéeDocument4 pagesLe Crapaud, Corbière LL RédigéeLaurence Silva100% (2)
- La Bruyère Les Caractères 2022 Suite 2Document5 pagesLa Bruyère Les Caractères 2022 Suite 2cheurlinPas encore d'évaluation
- Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandJacques le fataliste et son maître de Denis Diderot: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Annulation Des Voeux KarmiquesDocument3 pagesAnnulation Des Voeux KarmiquesLucía Franca100% (1)
- Investigation Sur RimbaudDocument6 pagesInvestigation Sur RimbaudYasna ShahabiPas encore d'évaluation
- Fiche Dissert Colett1Document6 pagesFiche Dissert Colett1LahnaPas encore d'évaluation
- Dissertation MolièreDocument12 pagesDissertation MolièreYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- Texte 6Document3 pagesTexte 6TitiPas encore d'évaluation
- Le Malade Imaginaire-2Document4 pagesLe Malade Imaginaire-2riezjrif fsdjkfipsdjPas encore d'évaluation
- Arthur Rimbaud, À La Musique - Plan Détaillé Pour Un Commentaire ComposéDocument2 pagesArthur Rimbaud, À La Musique - Plan Détaillé Pour Un Commentaire ComposéAlavi AurélienPas encore d'évaluation
- Bajazet de Jean Racine (Analyse de l'œuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandBajazet de Jean Racine (Analyse de l'œuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Axe de Dissertation Sur GargantuaDocument7 pagesAxe de Dissertation Sur Gargantuanour.elamrani24Pas encore d'évaluation
- Dossier n2, Francis PongeDocument5 pagesDossier n2, Francis PongeLéonard MauvernayPas encore d'évaluation
- Fiche-Bilan Le Parti Pris Des ChosesDocument12 pagesFiche-Bilan Le Parti Pris Des Chosesfrancis100% (1)
- nrpl99 Juin22 Seq1 La BruyereDocument10 pagesnrpl99 Juin22 Seq1 La BruyereGaltier JulienPas encore d'évaluation
- A. Présentation Générale Des "Cahiers de Douai" Et D'arthur RimbaudDocument3 pagesA. Présentation Générale Des "Cahiers de Douai" Et D'arthur RimbaudmasmoudirayaPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire 1 La Peau de Chagrin, Le TalismanDocument4 pagesAnalyse Linéaire 1 La Peau de Chagrin, Le Talismanrkvcn5swpv50% (2)
- Analyse n4Document4 pagesAnalyse n4Chloé ChxPas encore d'évaluation
- Al GhouslDocument2 pagesAl GhouslM Yusuf Ali R100% (1)
- Fleurs Du Mal Notamment. Rêvé Pour L'hiver, Et Ma BohêmeDocument6 pagesFleurs Du Mal Notamment. Rêvé Pour L'hiver, Et Ma BohêmeMatheo MariaPas encore d'évaluation
- Gargentua 2Document4 pagesGargentua 2riezjrif fsdjkfipsdjPas encore d'évaluation
- Parcours Spectacle Et ComédieDocument4 pagesParcours Spectacle Et ComédieYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- Paris 16Document1 pageParis 16GogoPas encore d'évaluation
- Ma BohèmeDocument3 pagesMa Bohèmemrtnbarjo100% (1)
- Les Effarés Rimbaud Analyse LinéaireDocument12 pagesLes Effarés Rimbaud Analyse Linéaireapolline.charrondierePas encore d'évaluation
- Travail Francais (Arthur Rimbaud + 4poemes)Document1 pageTravail Francais (Arthur Rimbaud + 4poemes)vuillemin.margPas encore d'évaluation
- Sujets de Dissertation Sur RabelaisDocument1 pageSujets de Dissertation Sur RabelaisClara ZILLPas encore d'évaluation
- DissertationDocument1 pageDissertationbradanetomPas encore d'évaluation
- Structure Et Résumé de GargantuaDocument2 pagesStructure Et Résumé de GargantuaElisa LefrancoisPas encore d'évaluation
- EL 15 - Manon Lescaut - Rencontre Amiens 3Document3 pagesEL 15 - Manon Lescaut - Rencontre Amiens 3Cristiano BerkanePas encore d'évaluation
- Gargantua Fiche de DissertationDocument8 pagesGargantua Fiche de Dissertationnatalia.eid100% (2)
- 5 - Analyse Lineaire 5 - Rabelais - Gargantua - PrologueDocument4 pages5 - Analyse Lineaire 5 - Rabelais - Gargantua - Prologuegaellecheron50% (2)
- CL Tableau Analyse MLDocument5 pagesCL Tableau Analyse ML07gatcha100% (1)
- Dissertation GargantuaDocument3 pagesDissertation GargantuaJuan Miguel BiancháPas encore d'évaluation
- Lernould Physique Et Theologie Lecture Du Timee de Platon Par ProclusDocument3 pagesLernould Physique Et Theologie Lecture Du Timee de Platon Par ProclusdoppiapresaPas encore d'évaluation
- Séquence Sur La Poésie 1G4 Emancipations CréatricesDocument7 pagesSéquence Sur La Poésie 1G4 Emancipations CréatricesZahra ASGARALY HASSANALYPas encore d'évaluation
- Fiche Révision - GargantuaDocument5 pagesFiche Révision - GargantuafranzettililiaPas encore d'évaluation
- Gargantua de RabelaisDocument13 pagesGargantua de Rabelaismaryamgholame938Pas encore d'évaluation
- Groupe 1Document14 pagesGroupe 1Its SousPas encore d'évaluation
- LL Chapitre 14Document2 pagesLL Chapitre 14Ibne atia Imrane100% (1)
- Fiche de Lecture F. Rabelais, GargantuaDocument1 pageFiche de Lecture F. Rabelais, GargantuaClémentine BRUGUEROLLEPas encore d'évaluation
- MOLIERE Acte IV Scene 5-6 Elements AnalyseDocument2 pagesMOLIERE Acte IV Scene 5-6 Elements AnalyseFatima LAHSSINIPas encore d'évaluation
- Soliloque de SuzanneDocument5 pagesSoliloque de SuzanneChimène SmithPas encore d'évaluation
- Colette Les Vrilles de La Vigne Resume Personnages Et AnalyseDocument7 pagesColette Les Vrilles de La Vigne Resume Personnages Et Analyseclz18420Pas encore d'évaluation
- Au Cabaret-Vert Arthur Rimbaud AnalyseDocument7 pagesAu Cabaret-Vert Arthur Rimbaud Analysemjegham2019Pas encore d'évaluation
- CorrigeÌ Du Sujet de Dissertation Gargantua HatierDocument2 pagesCorrigeÌ Du Sujet de Dissertation Gargantua Hatiersalome.szeftel50% (2)
- Tartuffe Acte I Scène 1 AnalyseDocument6 pagesTartuffe Acte I Scène 1 AnalyseÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- M.I. Lecture Linéaire I, 1Document2 pagesM.I. Lecture Linéaire I, 1spidermanflash8Pas encore d'évaluation
- Dissertation Des Grieux (Manon Lescaut)Document2 pagesDissertation Des Grieux (Manon Lescaut)ROMAIN BERTRANDPas encore d'évaluation
- Manon Lescaut L'enterrementDocument3 pagesManon Lescaut L'enterrementbenoldikillianPas encore d'évaluation
- Les Caractères de La Bruyère 80977Document7 pagesLes Caractères de La Bruyère 80977thomasthomastomaPas encore d'évaluation
- LL2 ManonDocument2 pagesLL2 Manonangelosousa68500% (1)
- Commentaire Liaisons DangereusesDocument6 pagesCommentaire Liaisons DangereusesbarbetPas encore d'évaluation
- Cours Sur La Scène 12 de L'acte III Des Fausses Confidences de MarivauxDocument3 pagesCours Sur La Scène 12 de L'acte III Des Fausses Confidences de MarivauxFrancoise GPas encore d'évaluation
- Grammaire, RABELAIS, Chap 45Document2 pagesGrammaire, RABELAIS, Chap 45lyblancPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire Histoire de Gil Blas de SantillaneDocument7 pagesLecture Linéaire Histoire de Gil Blas de Santillaneleo.vhbPas encore d'évaluation
- Madame Bovary, Partie I, Chapitre 7, Flaubert - AnalyseDocument4 pagesMadame Bovary, Partie I, Chapitre 7, Flaubert - AnalyseEL MEKKAOUIPas encore d'évaluation
- Sujets de DisserationDocument1 pageSujets de DisserationNolann CholletPas encore d'évaluation
- En Quete de L Ultime Thierry Feller - 8357980Document78 pagesEn Quete de L Ultime Thierry Feller - 8357980Romeo AwonoPas encore d'évaluation
- Debussy Et L'echelle Mystèrieuse - Yvon GéraultDocument14 pagesDebussy Et L'echelle Mystèrieuse - Yvon GéraultNawel BentaïebPas encore d'évaluation
- Candide Surinam CCDocument5 pagesCandide Surinam CCterminalestiddsinPas encore d'évaluation
- Madeleine David - Le Président de Brosses Et Les Cultes de L'ancienne EgypteDocument16 pagesMadeleine David - Le Président de Brosses Et Les Cultes de L'ancienne EgypteLeila PapyrPas encore d'évaluation
- L'art Gothique FDocument15 pagesL'art Gothique Fichrak elouadiPas encore d'évaluation
- Les Secrets Mystiques Du CoranDocument4 pagesLes Secrets Mystiques Du Coranhanrisse jacquesPas encore d'évaluation
- La Lettre de Pierre À Philippe PDFDocument3 pagesLa Lettre de Pierre À Philippe PDFJacques GiardPas encore d'évaluation
- Semaine 2 - Les Grandes Villes FrançaisesDocument4 pagesSemaine 2 - Les Grandes Villes FrançaisesGinevra MesseriniPas encore d'évaluation
- Le Sens Commun (Thomas Paine) (Z-Library)Document186 pagesLe Sens Commun (Thomas Paine) (Z-Library)Benoît T.Pas encore d'évaluation
- Clerc Des Cinq RoyaumesDocument8 pagesClerc Des Cinq RoyaumesKorutopiPas encore d'évaluation
- Les Mysteres Du RosaireDocument2 pagesLes Mysteres Du RosaireVertogradskaya CatherinePas encore d'évaluation
- Le Moyen Atlas Culture BerbereDocument8 pagesLe Moyen Atlas Culture BerbereMed Moussaoui100% (1)
- The Deception of Allah (PDFDrive) (144-286)Document143 pagesThe Deception of Allah (PDFDrive) (144-286)bahirakhadidjawaraqaPas encore d'évaluation
- 5 - Les Derniers Temps Et L'ère Du Saint EspritDocument4 pages5 - Les Derniers Temps Et L'ère Du Saint Espritjmlb0123Pas encore d'évaluation
- Dieu Nous Parle Par JérémieDocument194 pagesDieu Nous Parle Par JérémieLevoir AlainPas encore d'évaluation
- En Vue de Tirer Le Maximum Des 21 Jours Priere Et JeuneDocument2 pagesEn Vue de Tirer Le Maximum Des 21 Jours Priere Et Jeunematadifrancisca85Pas encore d'évaluation
- N'oublie Pas Le Nécessaire - Celpa - Bethel - 19-12-2021Document4 pagesN'oublie Pas Le Nécessaire - Celpa - Bethel - 19-12-2021Olivier KangoPas encore d'évaluation