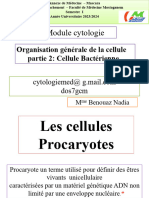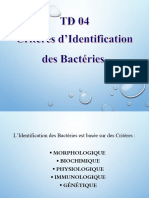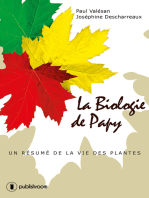Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1) Adam Roumani
1) Adam Roumani
Transféré par
Rym IdaeTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
1) Adam Roumani
1) Adam Roumani
Transféré par
Rym IdaeDroits d'auteur :
Formats disponibles
Faculté de médecine d’Alger - Bactériologie - Adam M.
Roumani
STRUCTURE BACTERIENNE
A. Introduction
Le monde vivant a été subdivisé en 3 grands règnes selon Haeckel : les animaux, les végétaux et les protistes. Ces
derniers sont subdivisés selon Chatton en protistes supérieurs (eucaryotes) et protistes inférieurs (procaryotes).
Les protistes supérieurs englobent les protozoaires, les algues microscopiques et les champignons, tandis que les
protistes inférieurs (procaryotes) englobent les cyanobactéries et les bactéries, eux-mêmes désignant les
archéobactéries et les eubactéries.
Vivant
Animaux Protistes Végétaux
Protistes Protistes
supérieurs inférieurs
Algues
Protozoaires Champignons Cyanobactéries Bactéries
microscopiques
Arhéobactéries Eubactéries
Les bactéries se différencient du reste des êtres vivants par quatre caractéristiques fondamentales :
- L’absence de membrane nucléaire.
- Un chromosome unique, sans diplosome.
- L’absence de mitochondries, de REG, d’appareil de Golgi…
- La présence d’une paroi ou peptidoglycane.
Certaines bactéries sont dépourvues de paroi bactérienne. C’est le cas
des Mycoplasma qui sont des germes à développement intracellulaire.
B. Méthodes d’étude
Afin d’étudier les bactéries, l’on a recours à l’utilisation d’un microscope. Deux types de visualisation sont possibles :
1. Examen optique à l’état frais
Il se fait entre lame et lamelle, dans un milieu semi-liquide et les bactéries sont
vivantes. Cet examen permet d’avoir un premier aperçu de la forme et surtout
de la mobilité des bactéries. Elle peut déjà être décisive pour un éventuel
diagnostic bactériologique, comme en cas de suspicion d’une infection à
Pseudomonas aeruginosa en milieu hospitalier. S’il s’agit par exemple d’un
prélèvement urinaire, l’on peut également rechercher la présence globules
blancs ainsi que leur nombre pour déterminer le type d’infection.
2. Examen optique après coloration
. Pour arriver à mieux identifier une bactérie, sa famille, sa pathogénicité, son traitement etc… il faut recourir à une
coloration spécifique basée sur la composition de la paroi : les colorations de Gram ou de Zieh-Neelsen.
Structure bactérienne Page | 1
Faculté de médecine d’Alger - Bactériologie - Adam M. Roumani
a. Coloration de Gram
Le résultat est différent selon la constitution de la paroi. L’on note deux colorations : en violet pour les parois à
Gram positif et en rose pour les parois à Gram négatif. Le procédé est le suivant :
o Première étape : coloration au violet de gentiane. Toutes les bactéries sont indifféremment colorées en
violet. L’on fixe la coloration au lugol, puis l’on rince.
o Deuxième étape : décoloration à l’alcool. Certaines bactéries notamment celles à paroi mince, perdent leur
coloration, tandis que d’autres restes colorées en violet. L’on effectue un second rinçage.
o Troisième étape : contre-coloration à la fuchsine. Les bactéries précédemment décolorées se retrouvent
roses, les autres restent inchangées.
L’on déduit donc que les bactéries violettes à Gram positif ont paroi plus épaisse que les bactéries roses à Gram
négatif. Cette coloration est à la base d’une classification très importante en bactériologie, concernant les
maladies infectieuses mais aussi la sensibilité à certains antibiotiques.
b. Coloration de Ziehl-Neelsen
Cette coloration est spécifique aux mycobactéries (bacille de Koch notamment). Elle est basée sur une
caractéristique de la paroi de ces bactéries : la présence d’acide mycolique qui lui confère une résistance
particulièrement élevée. Elle se déroule comme il suit :
o Première étape : coloration à la fuchsine. Toutes les bactéries sont indifféremment colorées en rose.
o Deuxième étape : décoloration à l’acide, puis à l’alcool. Certaines bactéries se retrouvent décolorées tandis
que d’autres restent roses.
o Troisième étape : contre-coloration au bleu de méthylène. Les bactéries précédemment décolorées
deviennent bleues, tandis que les autres restent inchangées.
Les mycobactéries sont celles qui ont résisté à la décoloration à l’acide et à l’alcool et qui donc sont restées
roses. A partir de cette expérience, les chercheurs ont qualifié les mycobactéries de bacilles acido-alcoolo-
résistantes pour les raisons évidentes. C’est le cas du bacille de Koch cité plus haut, dont le nom scientifique est
Mycobacterium tuberculosis, agent de la tuberculose.
3. Examen au microscope électronique
L’examen au microscope électronique permet de déterminer l’ultrastructure des bactéries, c'est-à-dire l’ensemble de
ses composants à l’échelle nanoscopique. Grâce à cela, l’on a pu identifier les éléments de structure obligatoires et
facultatifs des bactéries.
Structure bactérienne Page | 2
Faculté de médecine d’Alger - Bactériologie - Adam M. Roumani
a. Éléments obligatoires
o Matériel génétique.
o Cytoplasme.
o Membrane plasmique.
o Paroi bactérienne (sauf les Mycoplasma).
b. Éléments facultatifs
o Capsule ou glycocalyx.
o Flagelle et cils.
o Pilis.
o Plasmide.
o Spore.
C. Formes des bactéries
Il existe cinq formes caractéristiques de bactéries :
- Les bacilles : structure allongée, en forme de bâtonnet. Ils
peuvent être soit isolés, soit en chainettes (streptobacilles). Ex :
Escherichia coli.
- Les cocci : structure ovalaire, en forme de bille. Ils peuvent être
soit isolés, soit en chainettes (streptocoques), soit en amas
(staphylocoques). Ex : Staphylococcus aureus.
- Les spirilles : de structure filamentaire allongée, plus longue que
les bacilles. Ex : Spirillum volutans.
- Les coccobacilles : de structure intermédiaire entre le coccus et
le bacille. Ex : Brucella melitensis.
- Les vibrions : de structure incurvée, intermédiaire entre le
bacille et le spirille. Ex : Vibrio cholerae.
D. Eléments de structure obligatoires
1. Matériel génétique
Les bactéries possèdent un chromosome unique formé d’un brin d’ADN bicaténaire. Il nage directement dans le
cytoplasme et n’est donc pas délimité par une membrane nucléaire, comme c’est le cas pour les eucaryotes. Cette
caractéristique permet à la bactérie d’effectuer les phénomènes de transcription et de traduction de l’ARN de façon
simultanée, sans que ce dernier n’ait à changer de compartiment cellulaire.
L’ADN déroulé d’Escherichia coli est d’une longueur de 1.3 mm, l’on en déduit qu’il est compacté, comme chez
l’homme, pour pouvoir tenir à l’intérieur du corps de la bactérie qui ne dépasse pas les 10 µm.
Les chercheurs ont récemment découvert une sous-espèce de Vibrio cholerae qui possédait
deux chromosomes distincts et séparés. L’utilité de cette configuration est encore à l’étude.
2. Cytoplasme
Il est de composition assez basique par rapport aux eucaryotes (dépourvu de réticulum endoplasmique, d’appareil de
Golgi, de mitochondries…). Son pH est neutre, essentiel au bon fonctionnement de certaines enzymes
métaboliques. Il est riche en inclusions glucidiques ou lipidiques et contient des molécules d’ARN.
Le cytoplasme contient un composant important, le ribosome et ses deux sous-unités 50s et 30s. Ils participent à la
synthèse protéique et sont les cibles de certaines familles d’antibiotiques comme les tétracyclines.
3. Membrane plasmique
Pratiquement identique à celle des eucaryotes, comme elle fut décrite par Singer et Nicholson, c’est une bicouche de
phospholipides de 7.5 nm d’épaisseur, parsemée de protéines intrinsèques ou extrinsèques. C’est la cible des
antibiotiques de la famille des polymixines. Elle possède plusieurs fonctions :
Structure bactérienne Page | 3
Faculté de médecine d’Alger - Bactériologie - Adam M. Roumani
o Phosphorylation oxydative : même principe que la membrane interne de nos mitochondries.
o Division cellulaire : joue un rôle dans le mécanisme de scissiparité
o Création et régulation du gradient osmotique : entre le milieu extérieur et le cytoplasme.
o Régulation métabolique : par perméabilité sélective aux nutriments.
4. Paroi bactérienne
La paroi, ou peptidoglycane, est l’élément caractéristique des bactéries. Elle diffère selon qu’Il s’agisse de bactéries à
Gram positif, à Gram négatif, ou encore de mycobactéries. Ces dernières ne seront pas traitées ici.
a. Paroi Gram +
C’est la plus épaisse (entre 20 et 80 nm). Elle est constituée d’une superposition de polysaccharides, unis entre
eux par des ponts protéiques. Le tout est solidifié par des molécules d’acide teichoïque et ancré à la membrane
par l’acide lipoteichoïque. Les peptidoglycanes sont liés grâce à une enzyme, la transpeptidase, cible des
pénicillines, située dans l’espace périplasmique, entre la membrane et la paroi.
b. Paroi Gram –
Elle est plus fine et plus complexe. Elle est constituée d’une fine couche de peptidoglycane recouverte d’une
enveloppe externe trilamellaire ressemblant légèrement à la membrane plasmique. Cette dernière est formée
de trois éléments caractéristiques : les porines, les phospholipides et les lypopolysaccharides (LPS).
La paroi Gram négative est très peu perméable aux antibiotiques, du fait de l’enveloppe externe lipidique, mais
également de la présence de porines à perméabilité sélective. C’est ce qui a poussé les chercheurs à développer
de nouvelles pénicillines, comme l’ampicilline ou la ticarcilline, plus petites et donc qui peuvent traverser les
porines plus facilement.
Le lipopolysaccharide est une grosse molécule thermostable, représentant 25% de la membrane externe. Elle
est formée de trois parties :
o Un fragment protéique.
o Une fraction lipidique : le lipide A, à propriété endotoxinique et pyrogène (déclenche la fièvre et
l’inflammation lors de l’infection de l’hôte).
o Une fraction glucidique : le polyoside O à activité antigénique (déclenche la réaction immunitaire).
c. Rôle de la paroi
o Morphologie de la bactérie.
o Coloration (Gram…).
o Résistance aux variations de pression osmotique.
o Résistance aux attaques enzymatiques.
o Site de fixation de certains antibiotiques.
o Activité biologique et notamment dans la réaction immunitaire.
Structure bactérienne Page | 4
Faculté de médecine d’Alger - Bactériologie - Adam M. Roumani
Paroi Gram+ à gauche et Gram- à droite.
E. Éléments de structure facultatifs
1. Capsule
C’est une enveloppe superficielle recouvrant la paroi. Elle est le plus souvent
polysaccharidique (comme un glycocalyx), c’est le cas de Streptococcus pneumoniae
et parfois protéique comme chez Bacillus anthracis. Elle peut être mise en évidence
grâce à l’encre de Chine, après quoi elle apparaît comme une sorte de halo autour du
corps de la bactérie.
Certaines bactéries par intrication de leurs capsules forment ce que l’on appelle un biofilm. C’est une association de
bactéries ayant la capacité d’adhérer à des surfaces, biologiques ou non, et pouvant faire face aux attaques du
système immunitaire, voire à certains antibiotiques.
2. Plasmide
Il s’agit d’un ADN bicaténaire circulaire extra-chromosomique. Il est
totalement indépendant du chromosome circulaire, d’une part par sa
réplication, et d’autre part par le type de gènes qu’il contient.
En effet le plasmide possède sa propre origine de réplication (Ori C) et
peut donc se répliquer tout seul. Il est également capable de se
transmettre aux bactéries filles après scissiparité.
Le plus souvent, un plasmide contient des gènes de résistance aux
antibiotiques ou de virulence, capables de passer d’une bactérie à une
autre par transformation ou par conjugaison, ce qui fait de lui un
candidat de choix pour les tests génétiques sur les bactéries.
3. Flagelle
C’est une structure protéique fixée à la membrane plasmique et permettant la
mobilité de la bactérie. Elles sont rigides, ondulées, et formées de petites
protéines : les flagellines. Elles ont un effet antigénique (Ag H), cette
caractéristique est utiliser comme élément d’identification des Salmonella.
L’on distingue quatre types de positions de flagelle (ou ciliature) : monotriche,
lophotriche, amphitriche, et péritriche.
Type de ciliature Position du flagelle Déplacement
Monotriche Un seul, polaire Fléchant
Lophotriche Plusieurs, polaires Fléchant et oscillant
Amphitriche Un à chaque pôle Oscillant
Péritriche Tout autour Fléchant hélicoïdal
Structure bactérienne Page | 5
Faculté de médecine d’Alger - Bactériologie - Adam M. Roumani
4. Fimbriae ou pili
Ce sont de fins prolongements protéiques formés de sous-unités de piline disposés sur la surface de la bactérie. Elles
sont retrouvées sur les bactéries à Gram négatif plutôt que celles à Gram positif. Ils sont de deux types :
a. Pili communs
Ils sont petits, très nombreux, et servent de point d’adhésion et d’adsorption (oui adsorption avec un d, ça veut
dire fixation sur une surface solide dans un milieu liquide) aux muqueuse. C’est le cas par exemple de Neisseria
gonorrheae (gonocoque) qui adhère à la paroi urétrale, ou encore Escherichia coli à la paroi vésicale. Ils servent
également de facteur de virulence.
b. Pili sexuels
Ils sont plus longs, moins nombreux, et servent à faire passer une
information génétique d’une bactérie à une autre. Ils sont codés par un
gène appelé facteur F, à situation plasmidique.
Les bactéries qui expriment ce gène seront dites F+ ou « mâles », celles qui
ne l’expriment pas seront dites F- ou « femelle ». Ce sont les bactéries de
type F+ qui sont capable de transmettre leurs gènes aux bactéries F-. C’est
grâce à ce mécanisme de conjugaison que les bactéries se transmettent les
résistances aux antibiotiques.
Il arrive que le facteur soit exprimé directement au niveau du
chromosome. Dans ce cas, la bactérie n’est pas dite F+ mais HFR.
5. La spore
Certaines bactéries, et notamment à Gram positif, ont développé un mécanisme en milieu difficile : la spore. En
effet, en cas de manque de nutriments, de salinité élevée, de température élevée, de pH trop bas, la bactérie adopte
une forme à métabolisme très limité, lui permettant de se mettre « au repos » jusqu’à ce que les conditions de vie
soient de nouveau optimales. C’est un peu le principe de l’hibernation.
Le passage de la forme active à la spore est appelé sporulation, le sens inverse la germination.
F. Application clinique
Le diagnostic bactériologique se fait en quatre temps :
1- Examen cytobactériologique : c’est un examen à l’état frais du prélèvement, l’on y recherche la présence de
bactéries ou de globules blancs en tous genres. Suite à cette étape, l’on sait déjà parfois la forme de la bactérie ainsi
que son degré de mobilité.
2- Mise en culture : l’on inocule quelques gouttes du prélèvement sur un milieu de culture que l’on incube. Si le résultat
n’est pas probant, l’on effectue un isolement des souches cultivées.
3- Coloration : une fois les colonies isolées et bien cultivées, l’on en prélève quelques-unes pour effectuer une
coloration Gram et définir s’il s’agit de Gram+ ou de Gram- et (si cela n’était pas possible lors de l’examen
cytobactériologique) définir la forme et le mode de regroupement des bactéries.
4- Examens complémentaire : il existe d’autres examens afin d’identifier l’espèce exacte de la bactérie pour pouvoir
ajuster le traitement selon les antibio-résistances possibles.
Parfois l’examen cytobactériologique permet d’arriver directement à un diagnostic. Si l’on retrouve
des polynucléaires altérés chez un patient présentant une urétrite, il s’agit probablement de Neisseria
gonorrheae : diplocoque à Gram-. Ou encore si l’on retrouve une lésion caverneuse au téléthorax avec
bacilles acido-alcoolo-résistantes, il s’agit forcément de Mycobacterium tuberculosis…
Structure bactérienne Page | 6
Vous aimerez peut-être aussi
- RaherimalalaNorosoaI ESPA MAST 16Document119 pagesRaherimalalaNorosoaI ESPA MAST 16imane benssalihPas encore d'évaluation
- Procaryotes Cytologie Partie 2 - نسخةDocument71 pagesProcaryotes Cytologie Partie 2 - نسخةkaboubochraPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Partie 1-3Document9 pagesChapitre 2 Partie 1-3khaldi aminaPas encore d'évaluation
- Chap.3. Classification Des BactériesDocument56 pagesChap.3. Classification Des Bactériessoufianezenasni008Pas encore d'évaluation
- Structure Bactérienne 2022Document71 pagesStructure Bactérienne 2022Anoir anouujPas encore d'évaluation
- Généralités Bactériennes PDFDocument35 pagesGénéralités Bactériennes PDFmannyescuela291Pas encore d'évaluation
- ENS..Cours Microbiologie 2021 VFDocument89 pagesENS..Cours Microbiologie 2021 VFabdoulazisezebaPas encore d'évaluation
- Introduction À La Microbiologie OdontologiqueDocument10 pagesIntroduction À La Microbiologie OdontologiqueSafia NouriPas encore d'évaluation
- Structure Et Anatomie Des BacteriesDocument56 pagesStructure Et Anatomie Des BacteriesFernando KollaPas encore d'évaluation
- 02 Structure Et Anatomie Fonctionnelle Des Bacteries - 2010Document41 pages02 Structure Et Anatomie Fonctionnelle Des Bacteries - 2010Antonio De MatteisPas encore d'évaluation
- Microbiologie 1Document77 pagesMicrobiologie 1Yasser ShelbyPas encore d'évaluation
- Cours Bactériologie Médicale 2Document106 pagesCours Bactériologie Médicale 2Landry TengaPas encore d'évaluation
- Bacterio NabilDocument40 pagesBacterio NabilHadjab lyes100% (1)
- Microbiologie Générale VEDocument86 pagesMicrobiologie Générale VEkaoutar laaribiPas encore d'évaluation
- Partie 1 - Chapitre 4A - Le Monde Du Vivant - VOPDocument22 pagesPartie 1 - Chapitre 4A - Le Monde Du Vivant - VOPTonia TannousPas encore d'évaluation
- Microbiologiegnrale DR TOUAITIADocument36 pagesMicrobiologiegnrale DR TOUAITIAlina LaPas encore d'évaluation
- Microbiologie Générale 2024Document100 pagesMicrobiologie Générale 2024o687827Pas encore d'évaluation
- Cours Pour Les Étudiants de 2ème AnnéeDocument36 pagesCours Pour Les Étudiants de 2ème AnnéeAmina Feriel KadriPas encore d'évaluation
- Bacteriologie Chap1-2Document13 pagesBacteriologie Chap1-2hursule DohoPas encore d'évaluation
- ABM1. IntroductionDocument14 pagesABM1. IntroductionEmile Hans ObamePas encore d'évaluation
- MICROBIOChapitre 03-04Document16 pagesMICROBIOChapitre 03-04levoa eteme fabricePas encore d'évaluation
- Bacterio ParasitoDocument10 pagesBacterio ParasitoOumar TraoréPas encore d'évaluation
- Les BactériesDocument17 pagesLes Bactériesmaimounagnilanendiaye338Pas encore d'évaluation
- Cours Génie Microbiologique ETDocument223 pagesCours Génie Microbiologique ETFatima Ezzahra LaftouhiPas encore d'évaluation
- Polycop Bactériologie 2020-ConvertiDocument144 pagesPolycop Bactériologie 2020-ConvertisoufianePas encore d'évaluation
- Les Bactéries - NotesDocument8 pagesLes Bactéries - NoteszyteksPas encore d'évaluation
- Microbiologie Chapitre 0101Document9 pagesMicrobiologie Chapitre 0101djihane boussekinePas encore d'évaluation
- MICROBIOLOGIEDocument46 pagesMICROBIOLOGIEAlys ANdriaPas encore d'évaluation
- Polycop Généralités Bactériologie 2021Document65 pagesPolycop Généralités Bactériologie 2021Amine HakimiPas encore d'évaluation
- Morphologie Des BacteriesDocument26 pagesMorphologie Des Bacteriesalmnaouar100% (1)
- Chapitre 1. La Cellule BacterienneDocument12 pagesChapitre 1. La Cellule BacterienneLajlaouiPas encore d'évaluation
- Microbiologie Générale DR TOUAITIADocument35 pagesMicrobiologie Générale DR TOUAITIAعالمي الجميلPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Classification Des MicroorganismesDocument22 pagesChapitre 1 Classification Des Microorganismesdfhohfeicxh67% (3)
- CHAP I Monde Microbien PDFDocument30 pagesCHAP I Monde Microbien PDFLi NaPas encore d'évaluation
- Cours Microbiologie Générale CAG 2021-2022Document109 pagesCours Microbiologie Générale CAG 2021-2022degonbrunelPas encore d'évaluation
- TD 04 Criteres Didentification 2021Document21 pagesTD 04 Criteres Didentification 2021noutinonaPas encore d'évaluation
- 2 Cellule ProcaryoteDocument42 pages2 Cellule ProcaryoteCelia Andreu AliagaPas encore d'évaluation
- Introduction A La Bio CellDocument15 pagesIntroduction A La Bio CellLilou GrambertPas encore d'évaluation
- COURS Microbiologie Et Durabilité (Florent)Document28 pagesCOURS Microbiologie Et Durabilité (Florent)Abdel Aziz DickoPas encore d'évaluation
- Micro Biolog I eDocument25 pagesMicro Biolog I eJohanna Miller100% (1)
- Microbiologie Vétérinaire - Combinaison (s5+ s7+s7+ s8) - DZVET360-Cours-veterinairesDocument1 061 pagesMicrobiologie Vétérinaire - Combinaison (s5+ s7+s7+ s8) - DZVET360-Cours-veterinairesDZVET 360 ديزاد فات100% (2)
- Chap IIDocument19 pagesChap IIDavidsonPas encore d'évaluation
- Cours 1Document43 pagesCours 1taharPas encore d'évaluation
- Microbiologie de L'environnementDocument123 pagesMicrobiologie de L'environnementAmina Feriel KadriPas encore d'évaluation
- Chapitre II Etude de La Structure Des BactériesDocument10 pagesChapitre II Etude de La Structure Des BactériesAnthony MaryPas encore d'évaluation
- Diversite Du Monde MicrobienDocument18 pagesDiversite Du Monde Microbiensaliadissa296Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document25 pagesChapitre 1Ophelie HengyPas encore d'évaluation
- Cours 020202Document38 pagesCours 020202Hichem MedPas encore d'évaluation
- S5 - Microbiologie Générale-DZVET360-Cours-veterinairesDocument197 pagesS5 - Microbiologie Générale-DZVET360-Cours-veterinairesDZVET 360 ديزاد فات100% (3)
- COURS - 3 - Procaryote EucaryoteDocument40 pagesCOURS - 3 - Procaryote EucaryoteNESRINE NABIPas encore d'évaluation
- 2 - Le Monde MicrobienDocument9 pages2 - Le Monde Microbienchaimachaabanepph5Pas encore d'évaluation
- CF 4 Cdac 0Document7 pagesCF 4 Cdac 0Nabil holmesPas encore d'évaluation
- Microbio Chap 1Document18 pagesMicrobio Chap 1Aiicha MaigaPas encore d'évaluation
- Rappel MicrobiologieDocument21 pagesRappel Microbiologiewb5510078Pas encore d'évaluation
- Diaporama Intro A La BiotechnologieDocument23 pagesDiaporama Intro A La BiotechnologieSimier Noé100% (1)
- 03 - La Cellule ProcaryoteDocument19 pages03 - La Cellule Procaryotepatis.rdPas encore d'évaluation
- Chapitre - 1 Microbio BestDocument8 pagesChapitre - 1 Microbio BestDavid LandellePas encore d'évaluation
- 2 Amaglo Ghana Prod Feuille Moringa2006Document132 pages2 Amaglo Ghana Prod Feuille Moringa2006Younes MakPas encore d'évaluation
- Structure de La Cellule Bacterienne L3 2019 2020Document65 pagesStructure de La Cellule Bacterienne L3 2019 2020Alexandre Kpangny BéniPas encore d'évaluation
- MCRO CedDocument169 pagesMCRO CedJacques BandiombaPas encore d'évaluation
- Metabolisme Et Nutrition BacteriensDocument22 pagesMetabolisme Et Nutrition BacteriensMohamed ECHAMAIPas encore d'évaluation
- Oxydation Du Fer Bactéries ThèseDocument151 pagesOxydation Du Fer Bactéries ThèseAnonymous MKSfyYyODPPas encore d'évaluation
- Resume Fixation AzoteDocument7 pagesResume Fixation AzoteBBichon FrizePas encore d'évaluation
- Partie Ii Biotechnologie Microbienne Chap BDocument18 pagesPartie Ii Biotechnologie Microbienne Chap BAmira AmouraPas encore d'évaluation
- Wcms 846255Document34 pagesWcms 846255Emile Hans ObamePas encore d'évaluation
- Investigation Dun Resultat Bioburden Produit Non Conforme - Isabelle HOENENDocument31 pagesInvestigation Dun Resultat Bioburden Produit Non Conforme - Isabelle HOENENomar elhamdaouiPas encore d'évaluation
- ColimetrieDocument3 pagesColimetrieLaid DjokhdemPas encore d'évaluation
- Biology Paper 3 SL SpanishDocument29 pagesBiology Paper 3 SL SpanishEnric Galian FernandezPas encore d'évaluation
- Production YaourtDocument19 pagesProduction Yaourto.ameur226Pas encore d'évaluation
- TOPO TP-Microbio S3 2021-2022 Policope de TPDocument61 pagesTOPO TP-Microbio S3 2021-2022 Policope de TPsalmazligui21Pas encore d'évaluation
- Microbiologie S3Document87 pagesMicrobiologie S3api-3738916100% (9)
- BIO3721 H14 c1 PDFDocument2 pagesBIO3721 H14 c1 PDFRidaPas encore d'évaluation
- 2) Structure BactérienneDocument32 pages2) Structure BactérienneMaryam Berrada100% (1)
- 1 Cours de Microbiologie GénéraleDocument26 pages1 Cours de Microbiologie GénéraleBonaventure BabinnePas encore d'évaluation
- Eben Alexandre-La Preuve Du ParadisDocument172 pagesEben Alexandre-La Preuve Du Paradiskat kat100% (1)
- Bactéries Anaérobies À Gram NégatifDocument8 pagesBactéries Anaérobies À Gram Négatifsfendri17Pas encore d'évaluation
- Le Génie Génétique Man Ig Origine 1Document11 pagesLe Génie Génétique Man Ig Origine 1M U S I CPas encore d'évaluation
- Memotec N° 16: L'élimination Du Fer Et Du Manganèse Dans L'eau Destinée À La Consommation HumaineDocument2 pagesMemotec N° 16: L'élimination Du Fer Et Du Manganèse Dans L'eau Destinée À La Consommation HumaineNJOYA MFOKOU Abdou NasserPas encore d'évaluation
- Université Abdelhamid Ibn BadisDocument7 pagesUniversité Abdelhamid Ibn BadisIlyas BoufermaPas encore d'évaluation
- Resumé Sur Les Coccu À Gram Positif MicroDocument21 pagesResumé Sur Les Coccu À Gram Positif MicroAnou KalengaPas encore d'évaluation
- Dénombrements Bactériens TDDocument3 pagesDénombrements Bactériens TDMohamed Al100% (1)
- La Place Des Aerococcus en Clinique HumaDocument161 pagesLa Place Des Aerococcus en Clinique HumaMelissa OrdoñezPas encore d'évaluation
- ParodontologieDocument234 pagesParodontologieCatalina Fleancu67% (6)
- La Sécrétion Du Lait PDFDocument5 pagesLa Sécrétion Du Lait PDFSara KhalfaniPas encore d'évaluation
- Mémoire: Etude de L'effet de La Race Sur La Qualité Du Lait Caprin Dans La Wilaya de GhardaïaDocument51 pagesMémoire: Etude de L'effet de La Race Sur La Qualité Du Lait Caprin Dans La Wilaya de GhardaïaSanae MoufidPas encore d'évaluation
- Rapport Stage IMHE M2 Bouchali Rayan 2018 FinalDocument60 pagesRapport Stage IMHE M2 Bouchali Rayan 2018 Finalimaneabdelli1997Pas encore d'évaluation
- Mémoire CorrectionDocument99 pagesMémoire Correctionmehdib.pro11Pas encore d'évaluation
- Nutrition BactérienneDocument9 pagesNutrition BactérienneIkram El AhmerPas encore d'évaluation
- L'examen Cytobactériologique Des Urines Chez L'adulteDocument88 pagesL'examen Cytobactériologique Des Urines Chez L'adulteaya tiziPas encore d'évaluation