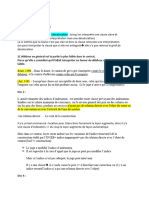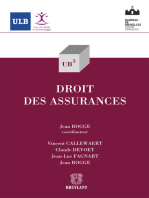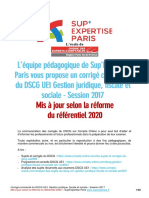Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CEJM Parcours GP Chap03
CEJM Parcours GP Chap03
Transféré par
Marleen AttalCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CEJM Parcours GP Chap03
CEJM Parcours GP Chap03
Transféré par
Marleen AttalDroits d'auteur :
Formats disponibles
3 Le contrat, un outil qui sécurise
l’entreprise
1. Sécuriser la période précontractuelle
1. Identifiez, dans le Doc 1, les parties en présence dans le projet de fusion et le degré de réalisation de ce
projet.
Les parties en présence dans ce projet de fusion sont GE (General Electric) et EDF.
Le projet en cours est un projet de rachat de la branche nucléaire de GE.
Ce dernier est encore loin d’être réalisé : les parties progressent dans leurs discussions et sont donc en
pourparlers.
2. Pourquoi ce type de contrat nécessite-t-il plusieurs mois de discussion ?
Un rachat de branche entre deux entreprises de la taille de GE et EDF, qui plus est dans un secteur observé par les
pouvoirs publics (notamment pour des questions de souveraineté énergétique et d’écologie), ne peut se faire sans
des études très approfondies et des négociations, notamment sur les aspects tarifaires.
Il est donc normal de permettre une longue phase précontractuelle sans laquelle les parties n’accepteraient jamais
de s’engager contractuellement « à l’aveugle ».
3. Expliquez pourquoi chacune des obligations conduit à une sécurisation des relations commerciales.
La bonne foi garantit la loyauté du comportement de l’autre partie
L’obligation d’information permet de réduire l’asymétrie d’information,
L’obligation de confidentialité évite la fuite d’informations obtenues lors des pourparlers :
4. Expliquez à quoi s’engage un cocontractant.
Un cocontractant s’engage à la loyauté dans la phase précontractuelle, mais non à la formation elle-même du
contrat.
Si les pourparlers échouent, cette perte de temps, d’argent et d’action fera partie des « risques du métier », mais si
cela découle d’un comportement déloyal, il convient de l’indemniser.
La différence essentielle tient à ce que le débiteur d'un pacte de préférence ne prend pas l'engagement de vendre
mais seulement de préférer un cocontractant au cas où il vendrait. Contrairement au promettant dans la promesse, le
débiteur reste donc libre de vendre ou de ne pas vendre. Cette liberté est de l'essence du pacte de préférence.
5. Précisez et expliquez la solution la plus adaptée à la situation de M. Rousseau et de Mme Gomez, entre
pacte de préférence et promesse unilatérale.
En l’espèce, ce n’est pas Mme Gomez qui n’est pas certaine d’acheter, au moins en ce moment, la seconde activité,
mais M. Rousseau qui n'est pas sûr de vendre. La promesse unilatérale n’est donc pas appropriée, puisque c’est le
bénéficiaire qui décide ou non de conclure. C’est donc un pacte de préférence qu’il convient d’établir :
M. Rousseau, si et quand il vendra son activité, ne pourra la proposer qu’à Mme Gomez.
6. Quelle serait la conséquence d’une vente par M. Rousseau de sa seconde activité à une autre personne,
M. Dumont, si ce dernier ignorait l’existence de l’accord avec Mme Gomez ?
Si M. Dumont contractait avec M. Rousseau en ignorant l’existence du pacte de préférence, Mme Gomez pourrait
se prévaloir de l’article 1123 du Code civil pour demander réparation.
7. Quelle serait la conséquence d’une vente par M. Rousseau de sa seconde activité à M. Dumont si ce
dernier connaissait l’existence de l’accord avec Mme Gomez ?
Si M. Dumont contractait avec M. Rousseau en connaissant l’existence de ce pacte de préférence, Mme Gomez
pourrait de nouveau convoquer l’art. 1123 du Code civil et demander, à son choix, l’annulation du contrat entre
MM. Rousseau et Dumont ou la substitution de sa personne dans le contrat à la place de M. Dumont.
Thème 1 – L’intégration de l’entreprise dans son environnement 1
8. Expliquez la démarche que pourrait engager M. Dumont à l’égard de Mme Gomez pour être certain
qu’il ne peut pas se porter acquéreur de la seconde activité de M. Rousseau.
Il serait dommage pour M. Dumont de ne pas acquérir la seconde activité si Mme Gomez décidait finalement de ne
pas se prévaloir de son pacte de préférence. Pour cette raison, M. Dumont peut demander à Mme Gomez, par écrit
et sous un délai raisonnable, de lui signifier si elle désire ou non actionner ce pacte.
2. La sécurisation de la période contractuelle
1. Précisez, pour chacun des cas ci-dessous, la cause d’invalidité du contrat.
a) Mme X décide, sans lui en avoir parlé, que Mme Y lui donnera son manteau et va le lui prendre.
Mme X a décidé sans même consulter Mme Y, il y a donc absence de consentement.
b) Mme X explique à sa collègue Mme Y qu’elle parlera de ses erreurs professionnelles à leur employeur
si elle ne lui offre pas un scooter.
La menace proférée pour obtenir le scooter invaliderait son éventuel don car il y a eu violence morale.
c) Mme X, assistante administrative a, sans en informer son employeur, demandé et validé un devis au
nom de son entreprise pour refaire son bureau avec de luxueux matériaux.
Le contrat est invalide car Mme X ne dispose pas de la capacité juridique pour engager contractuellement son
entreprise dans un tel contrat.
d) Mme X vend sa voiture en oubliant de préciser que, depuis deux ans, les problèmes électroniques sont
permanents malgré de multiples tentatives de réparation.
Mme X a volontairement trompé son acheteur, il y a donc manœuvre dolosive.
2. Qu’est-ce qui distingue un licenciement d’une annulation de contrat de travail ?
Un licenciement met fin à un contrat de travail valablement formé. Il porte en général sur un problème dans
l’exécution du contrat (par exemple dans les tâches réalisées), et non sur un problème de formation.
Le licenciement se distingue donc d’une annulation du contrat, puisque cette dernière porterait sur un défaut de
formation de ce contrat, par exemple une manœuvre dolosive sur les diplômes mentionnés.
3. Qu’est-ce qui distingue un divorce d’une nullité de mariage ?
Un divorce met fin à un mariage qui a réellement été contracté : les personnes étaient époux de la date du mariage
jusqu'à celle du divorce.
Une nullité signifie que le mariage n’a jamais eu lieu : n’ayant pas été valablement formé, il n’a pas existé.
4. Expliquez l’intérêt pour une entreprise d’insérer une telle clause dans ses conditions générales de
vente.
Grace à cette clause, l’entreprise pourra récupérer ses marchandises si elles ne sont finalement pas payées.
5. Précisez, pour chacun des exemples ci-dessous, pourquoi la situation décrite n’est pas licite.
a) Un vendeur de structure métallique a passé un contrat sur deux ans avec un client. Au bout de
quelques mois, il mentionne « une logique tacite et évidente » qui permet d’augmenter ses prix sur le
contrat en cours pour tenir compte des cours du marché.
Cette situation n’est pas licite puisque la clause d’indexation doit être explicitement intégrée au contrat (ou
proposée ensuite dans un avenant). Elle ne peut donc pas être tacite, même sous la « fausse logique » de son
prétendu caractère évident qui ne l’est pas en l’espèce.
b) Ce même vendeur précise dans son contrat qu’en cas d’effondrement d’une passerelle posée sur ses
structures, une indemnité de 100 euros sera versée.
Cette situation n’est pas licite puisque cette indemnité est dérisoire.
6. Indiquez si, dans un contrat, les différentes clauses ci-dessous seraient licites.
a) Le gestionnaire du parc de stationnement ne remboursera pas le ticket d’entrée à un automobiliste
qui, n’ayant trouvé aucune place, devrait ressortir sans avoir pu se stationner.
Cette clause ne serait pas licite au regard de l’actuel article 1170 du Code civil, puisqu’elle porte sur la substance
de l’obligation d’une société de parking : permettre de stationner son véhicule.
2 Chapitre 3 – Le contrat, un outil qui sécurise l’entreprise
b) Dans un contrat de société, M. James s’engage à percevoir tous les bénéfices de l’activité et M. Luigi à
en rembourser toutes les dettes.
Cette clause ne serait pas licite au regard de l’actuel article 1171 du Code civil, puisqu’elle génère un déséquilibre
« significatif » entre les droits et obligations des deux parties. Cette clause est donc « non écrite ».
3. Remplir les obligations de son contrat
1. Expliquez le principe de force obligatoire du contrat et son intérêt.
La force obligatoire impose à un contractant de respecter l’obligation qu’il s’est librement créée. En effet, puisque
j’ai été libre de me créer cette règle, il est normal que je réalise ce à quoi je me suis librement obligé.
2. Montrez que la démission d’un salarié est une rupture unilatérale, mais qu’elle ne s’oppose cependant
pas à l’article 1103 du Code civil.
La démission est bien une rupture unilatérale puisqu’elle permet au salarié de rompre le contrat de travail sans
l’accord de son employeur : il n’y a donc pas de consentement mutuel des parties. Néanmoins, la démission est
bien conforme à l’article 1103 du Code civil puisque ce dernier prévoit l’absence de consentement mutuel pour une
cause prévue par la loi, ce qui est bien le cas de la démission.
3. Précisez pour chaque contrat les obligations de chacune des parties, puis qualifiez-les (obligation de
donner, de faire ou de ne pas faire).
Contrat de travail d’Hector :
obligation de faire pour le salarié ;
obligation de rémunérer la personne pour l’employeur.
Contrat de construction :
obligation d’effectuer les travaux pour l’entreprise Judris ;
obligation de payer la facture pour le particulier qui achète de la piscine.
4. Quelles sont les conséquences de cette qualification sur l’exécution du contrat pour l’entreprise
Judris ?
S’il y a mauvaise exécution, l’exécution forcée en nature sera de droit pour l’obligation de donner, alors que, pour
l’obligation de faire, cela se traduira par des dommages et intérêts.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la distinction est presque abandonnée, car le principe sera désormais
l’exécution en nature, sauf quand cela sera impossible (article 1221 du Code civil).
5. Expliquez l’intérêt du principe évoqué dans l’article 1199 du Code civil.
Le contrat est une obligation que des parties se créent à elles-mêmes. S’il est normal que la volonté d’une personne
l’engage, il est tout aussi compréhensible que la volonté d’une personne ne puisse engager autrui si cette dernière
est extérieure à la manifestation de volonté. On imagine bien l’absurdité que serait une règle de droit qui
permettrait que la volonté d’une personne créée une obligation à une autre (par exemple : M. X et M. Y
conviennent que M. Z doit leur donner 100 euros).
6. Expliquez l’intérêt de l’exception posée à ce principe par l’article 1224-1 du Code du travail.
Lorsqu’une personne est embauchée, son contrat de travail existe entre elle et l’entreprise X. Imaginons que
l’entreprise Z rachète l’entreprise X qui disparait juridiquement : il y aurait alors un contrat entre le salarié et une
personne disparue, créant ainsi la fin de son contrat de travail. Pour éviter cette situation, le principe de l’ayant-
droit à titre particulier vient imposer au repreneur de l’entreprise X de poursuivre les engagements issus du contrat
de travail, même s’il n'était pas lui-même cocontractant lors de la formation de ce dernier.
7. Comment le principe juridique de groupe de contrats peut-il protéger l’entreprise contre des débiteurs
négligents ?
La notion de groupe de contrats regroupe à la fois des ensembles contractuels et des chaînes de contrats. L'avantage
majeur de cette notion est que ces contrats sont interdépendants les uns des autres, donc le sort des uns est lié au
sort des autres, ce qui signifie que l’entreprise a la possibilité de récupérer sa créance directement si son débiteur a
été négligent.
Thème 1 – L’intégration de l’entreprise dans son environnement 3
4. Les règles applicables en cas de problème d’exécution du contrat
1. Expliquez la possibilité offerte à une partie de ne pas respecter ses obligations dans un contrat selon
l’article 1219 du Code civil.
L’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors que celle-ci est
exigible si l’autre n’exécute pas la sienne : il serait en effet paradoxal de poursuivre ses obligations alors que l'on
sait ne pas en percevoir les contreparties.
2. Expliquez pourquoi l’exécution forcée est une conséquence logique de la force obligatoire d’un
contrat.
La force obligatoire m’imposait d’exécuter ce à quoi je m’étais obligé. La conséquence logique en est que, si je ne
respecte pas l’obligation à laquelle je me suis obligé, il est possible de me contraindre à m’exécuter.
3. Quels sont les différents moyens de mettre fin au contrat ?
Pour mettre fin au contrat, il faut soit l’annuler, soit le faire disparaître en droit : on parle alors de nullité, de
résolution ou de résiliation.
4. Quelle différence y a-t-il entre une obligation de moyen et une obligation de résultat ?
Dans une obligation de moyen, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour exécuter leur obligation. Elles
seront en défaut si elles manquent à la mise en œuvre de ces moyens.
Dans une obligation de résultat, les parties s’engagent à exécuter leur obligation. Elles seront en défaut si, en
dehors des causes d’exonération (question suivante), l’obligation n’est pas exécutée.
5. Donnez des exemples pour chaque cause d’exonération.
Exemples de force majeure : inondation, tempête, tsunami…
Exemples de fait d’un tiers : une personne pousse une autre personne qui tombe sur une voiture.
Exemples de faute de la victime : suicide, oubli de donner des informations (provoquant une allergie)…
6. Expliquez l’intérêt de pouvoir qualifier d’abusive une clause.
Le fait d’annuler la clause permet de réduire le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, ce dernier
étant la partie la plus vulnérable. Cela permet également d’appliquer le droit français des contrats.
ENTRAÎNEMENT : LES DIFFICULTÉS JURIDIQUES DE
L'ENTREPRISE MICROX
1. Précisez si l’entreprise MicroX peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété rédigée dans ses
conditions générales de vente.
Si, dans les faits, le matériel informatique a été livré par l’entreprise MicroX le 8 janvier à son client, qui avait, en
signant le bon de commande, approuvé les conditions générales de vente, lesquelles incluaient une clause de
réserve de propriété ; et si, selon la règle de droit (article 2367 du Code civil), une clause de réserve de propriété
peut licitement prévoir de suspendre le transfert de propriété d’un bien en en attendant le paiement, alors la
société MicroX peut légitimement se prévaloir de cette clause à l’encontre de son client.
2. Appréciez la licéité du comportement de l’entreprise Web@tor.
Si, dans les faits, l’entreprise MicroX est en pourparlers avec l’entreprise Web@tor et qu’elle a pour cela consacré
du temps et des ressources financières à payer des experts ; si, dans le même temps, la société Web@tor a conduit
ses pourparlers sans réelle volonté de contracter, mais pour utiliser l’entreprise MicroX comme argument de
négociation avec un autre acquéreur potentiel envers qui elle était déjà engagée ; et si, selon la règle de droit, des
pourparlers peuvent être librement rompus, sauf, selon l’arrêt « Manoukian » de la chambre commerciale de la
Cour de cassation, à constituer un abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la
confiance du partenaire, alors la société Web@tor semble bien, en l’espèce, avoir commis un abus de droit.
L’entreprise MicroX est donc fondée à demander réparation pour cette rupture fautive des pourparlers. Elle peut
ainsi notamment obtenir l’indemnisation du temps qu’elle a consacré à mener ces négociations et les frais d’experts
que ces dernières lui ont généré.
4 Chapitre 3 – Le contrat, un outil qui sécurise l’entreprise
Vous aimerez peut-être aussi
- Chapitre 3Document7 pagesChapitre 3sam minimiaou100% (2)
- Cejm CH2P1Document3 pagesCejm CH2P1Elif OzPas encore d'évaluation
- Comment Les Contrats Sécurisent-Ils Les Relations Entre L'Entreprise Et Ses Partenaires ?Document13 pagesComment Les Contrats Sécurisent-Ils Les Relations Entre L'Entreprise Et Ses Partenaires ?Ines elPas encore d'évaluation
- Cas Pratique ValensDocument5 pagesCas Pratique ValensGILLES Manon100% (1)
- Précontractuelle PDFDocument42 pagesPrécontractuelle PDFAbdel MonaimPas encore d'évaluation
- Chap 2 CEJM BTS NDRC 1Document5 pagesChap 2 CEJM BTS NDRC 1Lucas PhoeungPas encore d'évaluation
- Activités Chap 3Document2 pagesActivités Chap 3GoumanPas encore d'évaluation
- Chap 2 La Formation Et Le Contenu Du ContratDocument6 pagesChap 2 La Formation Et Le Contenu Du Contratnathanaeladefiranye68Pas encore d'évaluation
- Chap 3Document5 pagesChap 36dcjzwq2ptPas encore d'évaluation
- Droit Des Contrats BisDocument6 pagesDroit Des Contrats BisLalia ZeroualiPas encore d'évaluation
- CEJM Synthèse CONTRATSDocument6 pagesCEJM Synthèse CONTRATSwechingerPas encore d'évaluation
- Chap 1 Droit T STMG EleveDocument3 pagesChap 1 Droit T STMG EleveTiphanie VileyPas encore d'évaluation
- Cours CEJM - Chapitre 2 CEJMDocument5 pagesCours CEJM - Chapitre 2 CEJMMaxime MourguetPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document5 pagesChapitre 2Irénaëlle PromitorPas encore d'évaluation
- Tome 3 DobDocument24 pagesTome 3 DobSara_KePas encore d'évaluation
- Documents Et Cas DroitDocument8 pagesDocuments Et Cas DroitMyriam BecheikhPas encore d'évaluation
- Thème 1 Chap3 CEJM BTSDocument5 pagesThème 1 Chap3 CEJM BTSmichailou.helenePas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Droit ContratsDocument4 pagesChapitre 3 Droit Contratsevmesquita13Pas encore d'évaluation
- Thème 8 - L'équilibre Économique Du Contrat (La Lésion)Document9 pagesThème 8 - L'équilibre Économique Du Contrat (La Lésion)Eric NguyenPas encore d'évaluation
- Thème 1-Chap 1 - La Formation Du Contrat 2Document5 pagesThème 1-Chap 1 - La Formation Du Contrat 2fatna.cPas encore d'évaluation
- Fiche de TD Theorie Generale Des ObligationsDocument6 pagesFiche de TD Theorie Generale Des ObligationsJojo OdgPas encore d'évaluation
- Le Droit Des Contrats InformatiquesDocument17 pagesLe Droit Des Contrats InformatiquesDalal HalPas encore d'évaluation
- Quelle Est La Différence Entre Un Contrat Nommé Et Un Contrat InnomméDocument2 pagesQuelle Est La Différence Entre Un Contrat Nommé Et Un Contrat InnomméorachimaPas encore d'évaluation
- Quelle Est La Différence Entre Un Contrat Nommé Et Un Contrat InnomméDocument2 pagesQuelle Est La Différence Entre Un Contrat Nommé Et Un Contrat InnomméorachimaPas encore d'évaluation
- INEXECUTIONDocument14 pagesINEXECUTIONousmaiga84Pas encore d'évaluation
- Thème 5Document5 pagesThème 5barakaPas encore d'évaluation
- 2019-2020 Sujet Droit Des Obligations Corrections CopieDocument6 pages2019-2020 Sujet Droit Des Obligations Corrections CopieMartin MinnePas encore d'évaluation
- Fiche Droit 4Document7 pagesFiche Droit 4exxan.chretienPas encore d'évaluation
- CEJM T1C2 SyntheseDocument4 pagesCEJM T1C2 SyntheseRIYAD TERMOUL100% (1)
- Droit Des Obligations - Partie BDocument4 pagesDroit Des Obligations - Partie Bsalut11Pas encore d'évaluation
- CHAPITRE 2 Condition de Validite de ContratDocument2 pagesCHAPITRE 2 Condition de Validite de ContratAbdou Med MehdiPas encore d'évaluation
- Chap 2 Droit Cours Prof La Formation Du ContratDocument4 pagesChap 2 Droit Cours Prof La Formation Du ContratNils CHRISTANVAL100% (1)
- Rupture ContratDocument5 pagesRupture Contratabdouconsulting2022Pas encore d'évaluation
- CH3 Les ContratsDocument4 pagesCH3 Les ContratsMohamed ElyousfiPas encore d'évaluation
- Cours Civil L2 Second Semestre Jusqu'a Moitié NovembreDocument32 pagesCours Civil L2 Second Semestre Jusqu'a Moitié NovembreLuciano IrigoyenPas encore d'évaluation
- Partie 2Document24 pagesPartie 2jussyPas encore d'évaluation
- 1 Bonne Foi Et LoyauteDocument9 pages1 Bonne Foi Et Loyaute158PRXYPas encore d'évaluation
- Des Pourparlers Au Contrat 2ème PartieDocument29 pagesDes Pourparlers Au Contrat 2ème PartieTitouan BltPas encore d'évaluation
- PV Live de La Cour de Cassation - La Caducité Et L'interdépendance Des ContratsDocument9 pagesPV Live de La Cour de Cassation - La Caducité Et L'interdépendance Des Contratslouisj789gourguesPas encore d'évaluation
- CH3 La Formation Des Contrats - DDocument6 pagesCH3 La Formation Des Contrats - DCoralie RbnPas encore d'évaluation
- Synthèse ch3 Des Pourparlers Au ContratDocument9 pagesSynthèse ch3 Des Pourparlers Au ContratMeyssanPas encore d'évaluation
- Le Contrat D EntrepriseDocument4 pagesLe Contrat D EntrepriseppdPas encore d'évaluation
- Synthèse CH 3 La Formation Du ContratDocument6 pagesSynthèse CH 3 La Formation Du ContratMeyssanPas encore d'évaluation
- Theme 1: L'Intégration de L'Entreprise Dans Son EnvironnementDocument5 pagesTheme 1: L'Intégration de L'Entreprise Dans Son EnvironnementDHTR TRDPas encore d'évaluation
- Chapitre 6-La Formation Et L'éxécution Du ContratDocument2 pagesChapitre 6-La Formation Et L'éxécution Du Contratwilsonhru820Pas encore d'évaluation
- Exception D InexecutionDocument2 pagesException D InexecutionHassnaa FaroukPas encore d'évaluation
- L'essentiel de Thã Me 1 de Droit Le ContratDocument4 pagesL'essentiel de Thã Me 1 de Droit Le Contratronicevaz824Pas encore d'évaluation
- Droit: Synonyme de Négociation: Pour Parler // Période Précontractuelle Bonne Foi Responsabilité Des Deux PartisDocument3 pagesDroit: Synonyme de Négociation: Pour Parler // Période Précontractuelle Bonne Foi Responsabilité Des Deux PartisspeezfraPas encore d'évaluation
- Contrats CommerciauxDocument6 pagesContrats CommerciauxLouisa Delamart100% (1)
- Applications Chap1 2Document4 pagesApplications Chap1 29cqgqbbrqtPas encore d'évaluation
- Clinique Du DroitDocument5 pagesClinique Du Droitamandtrottier01Pas encore d'évaluation
- Fiches ExposésDocument18 pagesFiches Exposéssonia.ankerlPas encore d'évaluation
- 4-Les Contrats D'entreprise Et Les Contrats de ConstructionDocument50 pages4-Les Contrats D'entreprise Et Les Contrats de ConstructionSènami TOÏTOPas encore d'évaluation
- Cejm - Chapitre 3 - Bts 1Document4 pagesCejm - Chapitre 3 - Bts 1bscheffmann56Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document14 pagesChapitre 2Hermes Fadil SoroPas encore d'évaluation
- Synthese CH 3Document7 pagesSynthese CH 3meissa83120Pas encore d'évaluation
- WEB-CONF N2 - v.21.11.2021Document80 pagesWEB-CONF N2 - v.21.11.2021armel sidibePas encore d'évaluation
- Droit Des Contrats SpéciauxDocument37 pagesDroit Des Contrats SpéciauxVictoria GrosuPas encore d'évaluation
- R2.06 - Rel Contract Cours1Document20 pagesR2.06 - Rel Contract Cours1Mayély ClairvoyantPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Responsabilité Civile-ConvertiDocument28 pagesChapitre 2 - Responsabilité Civile-ConvertiIlham LaaroussiPas encore d'évaluation
- Synthese Chapitre 1Document4 pagesSynthese Chapitre 1Sara LopedPas encore d'évaluation
- L'Analyse Juridique Des Clauses Des Contrats D'affairesDocument30 pagesL'Analyse Juridique Des Clauses Des Contrats D'affairesf9zg2kdmnzPas encore d'évaluation
- 15 Contrat CorealisationDocument16 pages15 Contrat Corealisationlouis.giraudeau.proPas encore d'évaluation
- Techniques ContractuellesDocument8 pagesTechniques ContractuelleslegaldesignmadaPas encore d'évaluation
- Droit de Commerce International 6Document50 pagesDroit de Commerce International 6jamal eddine raoufPas encore d'évaluation
- Cejm - Chapitre 3 - Bts 1Document4 pagesCejm - Chapitre 3 - Bts 1bscheffmann56Pas encore d'évaluation
- Cours de Technique Contractuelle - New1-1Document45 pagesCours de Technique Contractuelle - New1-1Audia CheryldePas encore d'évaluation
- Cours de Droit Des Obligations Senegal C PDFDocument105 pagesCours de Droit Des Obligations Senegal C PDFAnta SAKHOPas encore d'évaluation
- Le Droit Des Contrats en Cartes Mentales... Wawacity - RedDocument157 pagesLe Droit Des Contrats en Cartes Mentales... Wawacity - RedDenis LEBRUN100% (1)
- Contrats CommerciauxDocument6 pagesContrats CommerciauxLouisa Delamart100% (1)
- Titre I: La Formation Du ContratDocument12 pagesTitre I: La Formation Du ContratGuyPas encore d'évaluation
- Fiches TDDocument28 pagesFiches TDsalo75100% (2)
- TD2 - Formation Du Contrat I-Conclusion Du ContratDocument15 pagesTD2 - Formation Du Contrat I-Conclusion Du ContratYasmine KhedhiriPas encore d'évaluation
- Droit Des Obligations S3Document36 pagesDroit Des Obligations S3zkrmahmoudiPas encore d'évaluation
- DSCG Ue1 2017 Corrige Supexpertiseparis VFDocument30 pagesDSCG Ue1 2017 Corrige Supexpertiseparis VFAZALMAD DanielPas encore d'évaluation
- Exemple DissertationDocument12 pagesExemple DissertationLuke Wilson100% (1)
- Techniques Contractuelles ApprofondiesDocument17 pagesTechniques Contractuelles Approfondiesght.entreprisePas encore d'évaluation
- Cours Droit CivilDocument30 pagesCours Droit Civildnr38Pas encore d'évaluation
- Synthèse CH 3 La Formation Du ContratDocument6 pagesSynthèse CH 3 La Formation Du ContratMeyssanPas encore d'évaluation
- CEJM Révisions - L'intégration de L'entreprise Dans Son EnvironnementDocument4 pagesCEJM Révisions - L'intégration de L'entreprise Dans Son EnvironnementAurélie DupuichPas encore d'évaluation
- L2 20droit 20des 20obligations 20 1Document99 pagesL2 20droit 20des 20obligations 20 1Julie DorizonPas encore d'évaluation
- CEJM1 - C3 - EA ÉlèvesDocument7 pagesCEJM1 - C3 - EA Élèvesmariepaquin00Pas encore d'évaluation
- Document 20200414 010403Document68 pagesDocument 20200414 010403Rihab RezguiPas encore d'évaluation
- Fiche D'arrêts: Rupture Des Pourparlers, Offre, Pacte de Préférence, Promesse UnilatéraleDocument7 pagesFiche D'arrêts: Rupture Des Pourparlers, Offre, Pacte de Préférence, Promesse UnilatéralemariePas encore d'évaluation
- Cours Droit Des ContratsDocument35 pagesCours Droit Des Contratszoé poyéPas encore d'évaluation
- Séances 1 - ContratDocument10 pagesSéances 1 - ContratBebey LynaPas encore d'évaluation
- Cas Verger Thau Corrigé Cejm - NC - 2020 - CorrectionDocument6 pagesCas Verger Thau Corrigé Cejm - NC - 2020 - Correctiondylan.thierriotPas encore d'évaluation
- Droit Des ObligationsDocument46 pagesDroit Des ObligationsAmbrine Soussi ZbatPas encore d'évaluation
- Responsabilité PrécontractuelleDocument30 pagesResponsabilité PrécontractuelleWalid AmraniPas encore d'évaluation