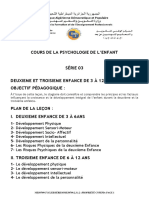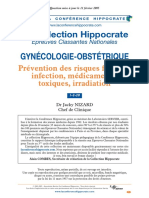Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
2-Psychologie de L'enfant
Transféré par
Mikael IshakTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
2-Psychologie de L'enfant
Transféré par
Mikael IshakDroits d'auteur :
Formats disponibles
COURS DE LA PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT
SÉRIE 01
LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET LA PHASE PRENATALE
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :
À l’issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de définir le développement de
l’enfant ainsi que ses différents facteurs en s’appuyant sur la phase prénatale.
PLAN DE LA LEÇON :
INTRODUCTION
I- DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT
II- LES FACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
III- PHASE PRÉNATALE
IV- DÉVELOPPEMENT PRÉNATAL
V- LES RISQUES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES DE LA PÉRIODE
PRÉNATALE
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 1
INTRODUCTION :
La psychologie de l'enfant est une discipline de la psychologie qui a pour objet d'étude les
processus de pensée et des comportements de l'enfant humain, son développement psychique
et ses problèmes éventuels. Elle prend en compte son environnement.
Et puisque L'enfance est une période d'intenses changements, des changements affectent le
développement physique (et les habiletés motrices), le cerveau, la cognition (mémoire,
raisonnement, compréhension du monde...), le langage et la capacité à communiquer,
les apprentissages (lecture, mathématiques...), les émotions et leur gestion, les relations
sociales, la sante en général, La meilleure façon d’ appréhender l’enfance est de l’inscrire
dans une perspective temporelle, faite de croissance et de changements qui débutent dès la
conception et continuent pendant le développement prénatal, l’enfance, l’adolescence et, à
certains égards, pendant l’âge adulte et la vieillesse.
Durant toute cette évolution, l’enfant-individu participera au développement de son corps,
de son cerveau et de son système nerveux, acquérant progressivement la capacité de
déployer différentes fonctions et aptitudes qui lui permettront de s’adapter et de survivre
dans des environnements très variés.
I. DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT :
La psychologie de l'enfant (ou de l'enfance) est voisine de la psychologie du développement
qui s'attache à comprendre le comment et pourquoi du développement humain (de sa
conception à sa mort) et construit des modèles théoriques qui permettent de comprendre et
prédire les changements et les périodes de stabilité au cours de la vie humaine. Les deux
disciplines ont les mêmes racines historiques et les mêmes fondements théoriques.
Le développement est l’ensemble des phénomènes participant à la transformation
progressive de l’être humain depuis la conception jusqu’à l’âge adulte, c’est aussi
l’acquisition de l’habileté résultant de la grande complexité des structures de l’organisme,
particulièrement le système nerveux central.
Le développement intéresse donc, les changements dans les différentes fonctions de
différentes fonctions de l’organisme, incluant celles qui sont influencées par l’interaction
avec l’environnement, aboutissant à des modifications tant structurelles, émotionnelles que
sociales.
1- Principes du développement :
Le développement se fait en général selon des principes bien défini :
- Le développement est un processus continu ;
- Le développement suit la même séquence chez tous les enfants ;
- Le développement est intimement lié à la maturation du système nerveux ;
- Une activité globale est remplacée par des réponses individuelles spécifiques ;
- Le développement se fait dans le sens céphalo-caudal ;
- Certains réflexes primitifs doivent disparaître.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 2
2- Étapes du développement :
Une étape est déterminée/limitée dans le temps, elle a un début et une fin, chaque étape a
ses propres caractéristiques, tandis-que les étapes de développement sont les stades
successifs que subit un organisme au cours du temps, depuis un état initial vers un état final.
L’enfance est la période de la vie qui s’étale de la phase prénatale à la puberté, elle est
divisée en trois grandes étapes :
1ère enfance : de la phase prénatale a 3 ans.
2ème enfance : de 3 à 6 ans.
3ème enfance : de 6 à 12/13 ans.
II. LES FACTEURS DU DEVELOPPEMENT :
La croissance de l'enfant consiste en une augmentation en taille, mais aussi en poids, en
surface et en volume des diverses régions du corps, des organes, des tissus. Elle est précédée
de la croissance in utero, pendant la vie embryonnaire puis fœtale. Autre versant du
développement de l'enfant, la maturation consiste en un perfectionnement progressif du
fonctionnement des organes.
Il existe divers facteurs intervenant dans la croissance en poids et en taille :
Les facteurs héréditaires ou génétiques : justifient que la taille d'un enfant soit toujours
évaluée, pour juger de sa normalité, en fonction de la taille des parents.
Les facteurs alimentaires : expliquent les besoins en substances incorporées aux nouveaux
tissus, par exemple en protéines pour la synthèse de l'os ou du muscle.
Les facteurs hormonaux : sont représentés surtout par l'hormone de croissance sécrétée par
l'hypophyse, glande endocrine située à la base du cerveau. Les hormones de la glande
thyroïde et les hormones sexuelles interviennent aussi dans la croissance, ainsi que dans la
maturation.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 3
III. PHASE PRENATALE :
1- Définition :
La période périnatale ou périnatalité désigne la période qui précède la naissance du bébé.
Cette période est comprise entre le 154e jour de gestation (environ 28 semaines) et s'achève
8 jours après l'accouchement. Elle est suivie de la période néonatale qui termine à la fin de la
deuxième année de vie de l'enfant.
Les principaux thèmes relatifs à la périnatalité sont la grossesse, l'accouchement,
l'allaitement, la préparation des parents et la création des liens avec le nouveau-né.
Dans la phase prénatale on distingue deux déférentes périodes : Période embryonnaire et
période fœtale.
Quelques heures après la fécondation, la cellule-œuf se divise et donne un embryon. Tout en
se divisant, l'embryon progresse à l'intérieur de la trompe grâce aux cils vibratiles de celle-ci.
Le sixième jour, l'embryon atteint l'utérus dans lequel il s’implante : c'est la nidation.
La période embryonnaire :
On parle d'embryon pendant les 10 premières semaines. Celui-ci n'a pas une forme humaine.
Le 21ème jour, le cœur bat.
La période embryonnaire est une période très importante pendant laquelle les organes
génitaux se mettent en place. C'est pendant cette période que les risques de malformation
sont les plus importants. À la fin de cette période, l'embryon mesure 5 cm et pèse 30g.
La période fœtale :
Elle s'étend de la 11ème semaine jusqu'à la fin du 9ème mois en général. C'est
essentiellement une période de croissance. Le fœtus a toujours une forme humaine.
Un fœtus ne peut être viable qu'à partir du 7ème mois car auparavant les poumons n'ont pas
finis leur développement.
À la fin de la grossesse, il pèse 3kg et mesure 55 cm.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 4
IV. DÉVELOPPEMENT PRÉNATAL :
Le développement prénatal (ou développement anténatal) est le processus durant lequel
l'individu se développe, allant de la fécondation jusqu'à la naissance.
Classiquement, la période de développement allant de la conception à la naissance est
appelée embryogenèse.
Elle est décomposée en trois grandes étapes :
Le stade pré-embryonnaire ou germinal : 0 à 10 jours (fécondation de l'ovule par
le spermatozoïde et création d'une cellule œuf par mitose) ;
Le stade embryonnaire : 10 jours à 8 semaines ;
Le stade fœtal : entre 9 semaines à la naissance
Dès le début de la deuxième semaine de vie, commence la période embryonnaire. L’élément
essentiel de cette période est la neurulation, qui correspond à la construction de l'axe
cérébro-spinal, siège du système nerveux central. Outre la neurulation, la période
embryonnaire est marquée, à partir de la cinquième semaine, par une accélération du
développement morphologique qui conduit, vers huit semaines, à un embryon de 3 cm
présentant l'ébauche de la plupart des membres du corps humain. En effet la tête est
distincte du corps, le nez, les yeux et la bouche sont identifiables, les doigts, les orteils sont
séparés. L'embryon possède ainsi sous forme rudimentaire les principales caractéristiques
anatomiques de l'Homme. Ces phénomènes marquent le passage su stade embryonnaire au
stade fœtal.
On peut noter que l'on parle généralement de fœtus à partir du 3e mois après la fécondation.
L'évolution fœtale, dernière étape avant la naissance, présente deux aspects essentiels : la
poursuite de la croissance et la différentiation du système nerveux central d'une part, et
l'émergence des premières réactions à l'environnement d'autre part. Ces comportements
prénatals sont essentiels dans la mesure où ils constituent les prémices du fonctionnement du
nouveau-né. Pendant très longtemps les psychologues n'ont pas soupçonné que le fœtus avait
de nombreuses interactions avec son environnement.
Il a fallu attendre des progrès technologiques comme l’échographie, et aussi l'évolution des
mentalités concernant la vie fœtale et les nouveaux nés pour qu'on s’intéresse de près au
développement sensoriel et moteur du fœtus.
1- Les étapes du développement du fœtus :
Le fœtus est constamment en mouvement. Certains de ces mouvements, manuels,
notamment, auront d'ailleurs un effet sur les activités motrices ultérieures (après la
naissance), quand celles-ci auront passé sous un contrôle cortical.
1.1- Le cerveau et le développement du fœtus :
L’activité fœtale présente une alternance de périodes intenses et moins intenses. Ainsi
l'activité spontanée du fœtus diminue assez significativement vers la 16e semaine, sans doute
sous l'effet d'une maturation nerveuse très importante qui est marquée par l'apparition des
hémisphères cérébraux et des circonvolutions cérébrale. Cette diminution d'activité sans
doute due au fait qu'une partie des mouvements, jusqu'alors incontrôlés, passent sous le
contrôle cérébral. Une telle période d'inhibition de l'activité se poursuit jusque vers le 6e
mois, moment où un regain d'activité est observé.
Vers la 27e semaine, les cellules nerveuses sont considérées comme matures. Cependant,
deux phénomènes importants, la synaptogénèse et la myélinisation, sont encore nécessaires
afin que le cerveau atteigne un fonctionnement comparable à celui d'un adulte.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 5
Définition de « La synaptogénèse » : élaboration des connexions qui s'établissent entre les
synapses des cellules nerveuses. Ces connexions créent des circuits de plus en plus complexes
conduisant à une augmentation des coordinations des comportements.
Définition de « La myélinisation » : recouvrement des axones des cellules par une gaine de
protection appelée myéline. La myélinisation progressive des champs du cerveau commence
vers le 6e mois après la conception, sous l'influence du fonctionnement des organes. Les aires
primaires sont myélinisées en premier lieu, puis les aires associatives. Ce processus se
poursuit plusieurs années après la naissance.
1.2- Développement des systèmes sensoriels :
Tous les systèmes sensoriels atteignent leur maturité fonctionnelle avant la naissance, à
l'exception de la vision peut être. Leur ordre de développement est commun à l'ensemble des
vertébrés, à savoir : toucher-sens de l'équilibre-olfaction gustation-audition-vision.
En ce qui concerne par exemple le toucher, le fœtus a de très nombreuses occasions
d'interactions tactiles suscitées par les déplacements maternels, et par ses propres
déplacements. Ces contacts, avec les parois utéro-placentaires, et entre les différentes
parties de son corps, déclenchent des réflexes d'orientation buccale. Ainsi, à la 15 e semaine,
l'échographie montre des fœtus suçant leur pouce (Hepper et al, 1991).
Le toucher :
Les réactions à des stimulations tactiles sont extrêmement précoces. Ainsi, à 8 semaines, une
stimulation très légère de la joue d'un fœtus donne lieu à des mouvements de protection
(Hooker, 1952). Toutes les parties du corps vont devenir progressivement réactives aux
stimulations tactiles. Cette grande sensibilité du toucher a été également mise en évidence à
partir d'attouchements avec un stylet sur des fœtus en état de survie provisoire. Des
réactions apparaissent suite à des stimulations faciales, en particulier dans la région de la
bouche, ou après une stimulation des mains et des pieds (De Vries et al, 1985). Ces derniers
auteurs ont aussi observé à l'aide de l’échographie que les fœtus entre la 8e et la 9e semaine
restent rarement plus de 13 minutes sans bouger.
Le sens de l’équilibre :
Le fœtus qui baigne dans le liquide amniotique est soumis à des changements constants de
position. L'intégration des changements de position de la tête et du corps par rapport à la
force de gravité, est réalisée par les canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Ceux-ci se
développent dès la 8e semaine. Ils sont sensibles aux accélérations et
aux décélérations angulaires et contribuent au maintien de l'équilibre. Il faut observer que les
stimulations du sens de l’équilibre jouent un rôle important pour le développement
fœtal, notamment dans le maintien et dans les changements d'état d’excitation. Ainsi quand
la mère bouge beaucoup au cours de la grossesse, le fœtus reçoit un grand nombre de
stimulations vestibulaires. En revanche, quand la mère est au repos, par exemple la nuit, il
n'est pas rare que le fœtus recevant peu de stimulations vestibulaires se mette à bouger. Il
est facile de vérifier le rôle de ces stimulations, après la naissance, en berçant l'enfant pour
le calmer.
L’odorat et le sens gustatif :
Les structures nerveuses responsables de l'odorat et du goût sont disponibles dès la 14e
semaine. Odeurs et saveurs liées à l'alimentation maternelle, via le système sanguin de la
mère, passent ensuite dans le liquide amniotique et dans le sang du fœtus. Schaal et al (1995)
ont trouvé près de 120 composés olfactifs différents dans le liquide amniotique. Ceux-ci sont
traités dans trois sites différents : le nez, la bouche et le système sanguin. Par exemple, les
narines du fœtus sont à 4 mois, débarrassées des tissus qui les bouchaient.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 6
Le fœtus peut à la fois inhaler et avaler le liquide amniotique. Il expérimente donc souvent
les odeurs et les saveurs. Des préférences pour certaines substances apparaissent. Ainsi, il
semblerait que les fœtus, comme les nouveaux nés, préfèrent les substances sucrées aux
substances salées. S'il n'est pas exclu que les capacités de détection et la préférence pour
certaines saveurs soient génétiquement déterminées, d'autres préférences peuvent
s'apprendre au cours de la vie fœtale.
Ainsi la consommation d'alcool par la mère peut conduire à une augmentation de son
absorption par le fœtus et éventuellement une préférence pour l'alcool plus tard dans la vie
(Molina et al, 1995). La discrimination par les nouveaux nés de l'odeur du lait maternel repose
sans doute sur les mêmes mécanismes d'apprentissage précoce, qui ont lieu au cours de la vie
prénatale.
L’audition :
Un autre exemple représentatif de l'activité du fœtus est celui de l'audition. Si l'oreille
est complètement fonctionnelle vers la 24e semaine, des réactions à des bruits extérieurs
sont déjà possibles dès la 27e semaine ; par exemple, la discrimination entre deux sons purs
de 250 et 500 Hz (Shahidullah et Hepper, 1994).
La réactivité du fœtus à des sons concerne également les stimuli langagiers. Ainsi, à partir
d'un enregistrement des changements dans le rythme cardiaque, Lecanuet et al (1987) ont pu
montrer que le fœtus discrimine des séquences sonores telles que "babiʺ par rapport à "biba".
Cette précocité indique que le traitement des signaux auditifs se réalise d'abord par la peau
et par le système osseux avant d'être perçus par le système vestibulaire et par la cochlée
(tube osseux en forme de spirale situé dans l'oreille interne). Il est difficile de se faire une
représentation exacte de la façon dont le fœtus traite les sons, car il entend des sonorités qui
traversent le liquide amniotique.
Le fœtus vit dans un environnement auditif tout à fait particulier, appelé bruit de fond intra-
utérin. Ce milieu est constitué : des bruits endogènes tels que les bruits cardio-vasculaires
maternels et fœtaux, ainsi que les borborygmes digestifs ; des bruits externes, telles la voix
humaine et la musique, qui, malgré une atténuation notable, atteignent le fœtus (Lecanuet
et al, 1987).
Les réactions auditives de ce dernier sont attestées par de nombreux indices : le rythme
cardiaque, les réponses motrices ou les mouvements réflexes comme le "sursaut" et les
réponses électro physiologiques, mesurées à l'aide de la technique des potentiels évoqués.
Ainsi l'utérus est un milieu très bruyant. Son niveau sonore, d'environ 75 décibels, correspond
au niveau sonore mesuré à l'intérieur d'une voiture en déplacement. Ce fond sonore est
renforcé fréquemment par le bruit que fait le passage de l'air dans l'estomac de la mère et,
chaque seconde environ, par le bruit encore plus intense des battements de cœur de la
mère.
Les bruits extérieurs sont fortement atténués par le corps de la mère et le liquide
amniotique. Seuls certains types de sonorités peuvent être discriminés parmi le bruit de fond
utérin. Ainsi certaines mères rapportent que des changements d'activité de leur fœtus se
produisent lorsqu'elles écoutent de la musique, ou bien à la suite d'un bruit ponctuel comme
le claquement d'une porte.
De plus, des études minutieuses ont révélé que le fœtus réagit à certains types de bruits
provenant du milieu extérieur. Dans une de ces expériences, un générateur de sons a été
placé sous l'abdomen de la mère. Celle-ci portait un casque dans lequel était diffusé
constamment le même son, afin de l'empêcher d'entendre les stimulations sonores au fœtus.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 7
Le résultat de cette expérience a montré une augmentation de l'activité fœtale quelques
secondes après que le bruit a été expérimentalement produit. Ces capacités prénatales de
détection de stimulations auditives ont incité des chercheurs à étudier l'existence possible
d'un apprentissage prénatal de nature auditive.
La vision :
Les études anatomiques montrent que le système visuel est la dernière modalité sensorielle à
se développer. C'est seulement vers 6 mois que les muscles qui actionnent les globes oculaires
sont en place. Quelques semaines plus tard, le fœtus peut réaliser les premiers mouvements
des yeux. Peu d'informations, concernant l'expérience visuelle du fœtus, sont disponibles. Les
prématurés de 7 mois présentent des changements dans la réactivité de leur cortex visuel,
lorsqu'ils sont stimulés par des flashs lumineux, et s'ils sont en mesure de suivre visuellement
un objet en mouvement. Certains chercheurs ont montré que vers la fin de la période fœtale,
entre 36 et 40 semaines, le fœtus pouvait détecter une source lumineuse intense qui
passerait la barrière constituée par la paroi stomacale de la mère (Kiuchi et al, 2000). Cette
sensation visuelle prénatale pourrait être comparable à la lueur perçue à travers la paume
lorsque la main recouvre une lampe de poche allumée. Enfin, Eswaran et al (2000) ont utilisé
avec succès les méthodes contemporaines d'imagerie cérébrale pour établir la réactivité du
cerveau de fœtus (36e semaine de gestation) à des stimulations lumineuses émises à la
surface de l'abdomen de la mère.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 8
V. LES RISQUES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES DE LA PÉRIODE
PRÉNATALE :
1- Les facteurs préconceptionnels :
Les causes préconceptionnelles de trouble du développement sont principalement liées à des
troubles génétiques ou à des syndromes malformatifs.
La plupart du temps, les troubles génétiques sont responsables d’un retard intellectuel ou
d’autres troubles et incluent les troubles monogéniques, les troubles multifactoriels et
polygéniques ainsi que les anomalies chromosomiques.
Les troubles génétiques associés à un retard du développement comprennent les aneuploïdies
et les erreurs innées du métabolisme. La consanguinité accroît la prévalence de troubles
génétiques rares et augmente de manière significative le retard intellectuel et les graves
anomalies congénitales, notamment chez les enfants de cousins du premier degré.
Certaines communautés ethniques (p. ex., Juifs ashkenazes) ont une prévalence plus élevée
de mutations génétiques rares et d’anomalies congénitales qui ont une incidence sur le
développement.
Les causes de retard intellectuel sont réparties dans les catégories suivantes, suivies de leur
prévalence :
1.3- Anomalies chromosomiques (30 %) ;
1.4- Malformations du système nerveux central (10 % à 15 %) ;
1.5- Syndromes d’anomalies congénitales multiples (4 % à 5 %) ;
1.6- Problème métabolique (3 % à 5 %) ;
1.7- Problème acquis (15 % à 20 %) ;
1.8- Cause inconnue (25 % à 38 %).
2- Les infections prénatales :
Lorsqu’ils prennent les antécédents médicaux d’un enfant qui manifeste des signes de trouble
du développement, les dispensateurs de soins doivent envisager les infections et procéder aux
tests de dépistage nécessaires.
Les femmes enceintes doivent subir des tests de dépistage du VIH, de la syphilis et de la
rubéole. Les résultats des tests doivent être transmis au dispensateur de soins du nourrisson.
2.1-Le VIH
Les enfants de moins de 14 ans subissent rarement le test de dépistage du VIH, même si leur
mère était atteinte d’une infection diagnostiquée. L’infection par le VIH de la mère accroît le
risque de prématurité et de petite taille par rapport à l’âge gestationnel. Ces deux effets
s’associent à une augmentation du risque de mortalité et de retard du développement.
Le VIH pénètre dans le système nerveux central de quelques jours à quelques semaines après
l’exposition primaire. Le virus provoque des lésions neuronales et la mort des cellules, qui
sont responsables d’une encéphalopathie progressive accompagnée d’une incapacité motrice,
d’une microcéphalie et d’une atrophie cérébrale ainsi que de troubles cognitifs et du
langage.
On ne connaît pas tout à fait les effets de l’exposition au VIH in utero qui ne provoque pas
d’infection ou de l’exposition à un traitement antirétroviral périnatal.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 9
Des études préliminaires menées aux États-Unis et en Europe sont encourageantes, mais
d’après d’autres études menées en Afrique subsaharienne et en Asie, une forte proportion des
enfants exposés présente des indices de développement global inférieurs à ceux de la
moyenne de la population en matière de langage et de comportement.
Cependant, la santé sous-optimale de la mère, la malnutrition, une maladie concomitante et
des charges virales élevées peuvent également nuire au potentiel développemental de
l’enfant.
2.2-Le cytomégalovirus
Dans les pays industrialisés, le cytomégalovirus (CMV) est la principale infection virale
congénitale, sa prévalence globale s’élevant à 0,6 % de toutes les naissances vivantes.
Ainsi, 10 % des nourrissons atteints présentent des signes d’infection dès la naissance et
courent un risque important de séquelles neurologiques, telles qu’une surdité
neurosensorielle (SNS), un retard intellectuel, une microcéphalie, des troubles convulsifs et
une paralysie cérébrale. Le CMV est la principale cause non héréditaire de SNS, qui peut être
évolutive, absente à la naissance, unilatérale ou bilatérale. La perte d’audition et les
troubles visuels peuvent s’observer chez un nourrisson qui n’a pas d’autres symptômes.
Le CMV est un herpès virus transmis par des contacts interpersonnels étroits avec la salive, le
sang, les sécrétions génitales, l’urine ou le lait maternel. Une nouvelle infection ou une
infection réactivée chez la mère peut entraîner une transmission maternofœtale en tout
temps pendant la grossesse, mais le taux est plus élevé après une infection primaire.
Les souches du virus varient selon l’emplacement géographique. Ainsi, les taux de prévalence
de l’infection sont plus élevés dans les populations d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie, et
plus faibles dans celles d’Europe occidentale et des États-Unis. Le CMV est plus courant chez
les personnes qui ne sont pas de race blanche et chez celles qui vivent dans la pauvreté.
2.3-La toxoplasmose
La toxoplasmose congénitale, présente à un taux de 1,5 cas sur 1 000 naissances vivantes, est
responsable de déficits neurocognitifs comme le retard intellectuel, les convulsions et
l’atteinte visuelle causée par la choriorétinite.
Le Toxoplasme gondi est un parasite et un pathogène d’origine alimentaire. L’infection
humaine découle de l’ingestion ou de la manipulation de viande crue ou mal cuite qui
renferme des kystes, du contact direct avec des chats infectés ou de la consommation
d’aliments ou d’eau contaminés par des ovocytes (gamètes) provenant des excréments de
chats infectés.
Les taux d’infection sont plus élevés en Amérique du Sud, en Méditerranée orientale et dans
certaines parties de l’Afrique.
2.4-La rubéole
On estime que 110 000 cas de rubéole congénitale se déclarent chaque année dans le monde.
La mère infectée pendant la grossesse transmet le virus de la rubéole au fœtus, ce qui peut
entraîner la surdité, des cataractes congénitales, une microcéphalie, les convulsions et un
retard intellectuel.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 10
Pour éviter le syndrome de rubéole congénitale, il faut s’assurer que les femmes subissent un
test de dépistage de la rubéole et se font vacciner avant de devenir enceintes.
Même si, à la fin de 2012, le vaccin contre la rubéole était administré systématiquement dans
le cadre de programmes de vaccination de 134 pays, seuls 44 % de la cohorte de naissances
étaient couverts, sans compter l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.
En 2008, on estimait que plus de 1,3 million de femmes enceintes avaient contracté la
syphilis dans le monde et qu’une grande partie n’était pas traitée ou était traitée de manière
inadéquate. La plupart des pays disposent de tests de dépistage anténatals de la syphilis,
mais les taux de mise en œuvre sont extrêmement variables. En effet, on estime que 30 % des
femmes enceintes d’Afrique subsaharienne subissent le test et sont traitées, par rapport à
70 % des femmes d’Europe.
À l’instar de toutes les infections transmises sexuellement (ITS) qui sont évitables, la syphilis
est liée au travail prématuré, à un petit poids à la naissance et au décès. La syphilis
congénitale peut provoquer la surdité, la microcéphalie, un retard intellectuel et une
atteinte visuelle attribuable à une kératite interstitielle.
3- Les toxines prénatales :
3.1-Le tabagisme :
Le tabagisme de la mère pendant la grossesse accroît le risque de placenta prævia, de
décollement placentaire et d’accouchement prématuré. Il est également néfaste pour la
croissance du fœtus.
3.2-La consommation d’alcool :
L’exposition à l’alcool in utero est la principale cause tératogène de troubles du
développement, y compris la microcéphalie, les troubles cognitifs, les troubles
d’apprentissage, le trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et les problèmes de
comportement.
Dans le monde entier, le syndrome d’alcoolisation fœtale touche environ 1,9 nourrisson sur
1 000 naissances vivantes. L’alcool est responsable de l’interruption de la production
neuronale et d’une destruction secondaire, la migration défaillante des neurones entraînant
une microcéphalie.
3.3-La consommation d’autres drogues ou de médicaments :
L’exposition de la mère à d’autres toxines, y compris les drogues récréatives et certains
médicaments (par exemple. acide valproïque, phénytoïne sodique, isotrétinoïne
[AccutaneMC]), peut également être responsable de troubles du développement.
3.4-La phénylcétonurie :
La phénylalanine, un acide aminé, est une neurotoxine pour le cerveau du fœtus en
développement. Non traitée, la phénylcétonurie provoque un retard intellectuel, qu’elle se
déclare chez la femme enceinte ou chez le nourrisson.
3.5-Les toxines dans l’environnement :
L’exposition au plomb, au mercure et à des produits chimiques comme les diphényles
polychlorés (BPC) et l’alcool sont responsables de 4 % à 5 % des retards intellectuels.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 11
La dose et le moment de l’exposition sont des variables qui contribuent à en prédire les
résultats neurotoxiques.
Le plomb peut traverser le placenta dès 12 semaines de grossesse et s’accumuler dans les
tissus du fœtus. Les femmes enceintes et les enfants absorbent jusqu’à 70 % du plomb qu’ils
ingèrent, comparativement à 20 % dans la population générale.
L’exposition naturelle provient du sol, mais la pollution, l’essence avec plomb, les produits
pour la peinture, les pesticides et l’activité industrielle peuvent accroître les taux de plomb
dans l’air, le sol et l’eau.
Dans les pays en développement, les mesures de contrôle contre la pollution sont moins
rigoureuses, et l’utilisation de vieille porcelaine et de certains médicaments traditionnels
accroissent également l’exposition à des toxines comme le plomb.
Toutes les formes de mercure peuvent traverser le placenta et être transmises dans le sang
du fœtus. Pendant la grossesse, la consommation d’espèces de poissons et de fruits de mer
qui contiennent des quantités élevées de mercure est la principale cause d’empoisonnement
par le mercure. D’autres expositions sont possibles dans les pays en développement (et les
pays industrialisés) : l’exploitation des mines (particulièrement l’or), certains processus
industriels, les usines de charbon et l’utilisation de produits qui contiennent du mercure.
De grandes quantités d’arsenic sont présentes naturellement dans les eaux souterraines, qui
peuvent contaminer l’eau utilisée pour la consommation, la préparation des aliments et
l’irrigation des cultures. L’arsenic est également présent dans le sol.
L’exposition prénatale s’associe à ces deux sources et peut provoquer un retard intellectuel
et un retard du développement.
L’économie des pays en développement est lourdement tributaire de l’agriculture.
L’utilisation et l’élimination de fertilisants et de pesticides sont de graves problèmes
environnementaux. L’exposition chronique aux pesticides en milieu de travail, notamment
dans les populations rurales pauvres, pose problème chez tous les travailleurs, mais est
particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et les enfants qui travaillent et
vivent près des régions où ces produits chimiques sont utilisés.
L’exposition prénatale au pesticide connu sous le nom de DDT s’associe à des retards du
neural développement pendant la petite enfance. Le DDT reste dans l’environnement
pendant des années et s’accumule dans la chaîne alimentaire et les tissus adipeux des
humains. En Afrique subsaharienne, où le contrôle du paludisme constitue un grave problème,
le DDT est toujours utilisé.
4- Les maladies chroniques de la mère :
Des maladies comme le diabète, l’hypertension, les maladies rénales et les troubles auto-
immuns s’associent à des complications de la grossesse qui peuvent avoir des effets
indésirables sur le fœtus ou le nouveau-né.
Le diabète de la mère accroît le risque d’anomalies fœtales, de macrosomie (poids de
naissance de plus de 4 000 grammes), de traumatismes obstétricaux et d’hypoglycémie à la
naissance, qui peuvent tous nuire au développement clinique du nourrisson. L’hypertension,
seule ou en association avec un trouble rénal ou auto-immun, peut provoquer une insuffisance
placentaire et une insuffisance de la croissance fœtale.
L’allo-immunisation fœto-maternelle non diagnostiquée ou non traitée s’associe à de
l’anémie et à une grave hyper bilirubinémie. Elle peut entraîner des convulsions, la surdité,
des retards cognitifs et une paralysie cérébrale chez les nourrissons qui survivent.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 12
5- Les carences nutritionnelles de la mère :
Figure1 : Plus de la moitié des bébés de petit poids à la naissance habitent dans dix pays.
Nombre de nourrissons de moins de 2 500 grammes à la naissance (en milliers).1
Les anomalies congénitales du système nerveux central associées à la malnutrition sont plus
fréquentes dans les populations et les pays pauvres en ressources. On estime que 94 % des
graves anomalies congénitales se manifestent dans les pays à revenu moyen ou faible, où les
mères sont plus vulnérables à la malnutrition de macronutriments et de micronutriments. Ce
facteur de risque de trouble du développement peut également s’associer à une exposition
accrue aux toxines prénatales.
La carence en acide folique s’associe à des anomalies du tube neural.
La carence en iode est considérée par l’OMS comme la cause principale, et la plus
facile à éviter, de lésions cérébrales dans le monde. L’iode, qui est associé aux
hormones thyroïdiennes, est essentiel pour le développement du cerveau,
particulièrement entre le deuxième trimestre de la grossesse et la troisième année de
vie. Une grave carence s’associe à un retard intellectuel, à un retard de croissance et
au crétinisme. Une étude britannique a déterminé que les enfants de huit ans étaient
plus susceptibles d’obtenir des résultats plus faibles en matière de QI verbal, de niveau
de lecture et de compréhension de la lecture que leurs camarades lorsque leur mère
avait présenté une carence en iode légère à modérée, tout au plus, pendant le premier
trimestre de leur grossesse. La carence en iode est un phénomène écologique dans
certaines partie des pays en développement où l’érosion du sol, la perte de végétation
causée par la production agricole, le surpâturage du bétail et la surcoupe d’arbres ont
épuisé les sources naturelles de cet élément. Cependant, on peut observer la carence
en iode partout dans le monde.
La malnutrition de la mère, avant et pendant la grossesse, peut nuire au poids du
nourrisson à la naissance et à son développement. Quelque 20 millions de nourrissons
de petit poids à la naissance (moins de 2 500 grammes) naissent chaque année, ce qui
représente environ 23,8 % de toutes les naissances et qui peut atteindre 30 % dans bien
des pays en développement. Un poids inférieur à 1 500 grammes à la naissance triple le
risque de trouble du développement.
1
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF, 2014, d’après le MICS, le DHS et d’autres sondages représentatifs sur la scène
nationale, 2008─2012, à l’exception de l’Inde.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 13
6- Les complications liées à la grossesse :
Dans les pays où il est difficile d’avoir accès à des soins prénatals et obstétricaux, les
maladies chroniques de la mère et les complications liées à la grossesse passent souvent
inaperçues. Si elles ne sont pas traitées, les affections qui peuvent contribué à la prématurité
ou à un retard du développement s’établissent comme suit :
Le diabète gestationnel s’associe à une macrosomie et à un risque de traumatisme à
l’accouchement, à une hypoglycémie du nourrisson et à une mort naissance.
- Les troubles hypertensifs (par exemple, pré éclampsie et éclampsie), qui peuvent
être responsables de graves incapacités à long terme, ont une incidence plus élevée
dans les pays en développement. Le pré éclampsie et l’éclampsie s’associent à une
insuffisance placentaire et à une prématurité ;
- Les grossesses multiples entraînent plus de complications obstétricales pendant la
grossesse et au moment de l’accouchement ;
- Les traumatismes à l’accouchement s’associent à une macrosomie, à l’obésité de la
mère, à une présentation par le siège, à un accouchement vaginal avec intervention,
à une petite taille de la mère et à des anomalies du bassin de la mère. Les graves
traumatismes à l’accouchement (par exemple, hémorragie intracrânienne) sont peu
courants, mais peuvent causer des troubles du développement. La plupart des lésions
neurologiques aux nerfs périphériques (par exemple, des lésions du plexus brachial),
mais pas toutes, se résorbent au fil du temps ;
7- La prématurité :
Tableau 1. Les dix pays qui possèdent les taux les plus élevés de naissances prématurées, 20102
Inde 3 519 100
Chine 1 172 300
Nigeria 773 600
Pakistan 748 100
Indonésie 675 700
États-Unis d’Amérique 517 400
Bangladesh 424 100
Philippines 348 900
République démocratique du Congo 341 400
Brésil 279 300
La prématurité (moins de 37 semaines de grossesse) est un problème mondial. Les facteurs de
risque de prématurité sont les grossesses multiples, les anomalies utérines, les saignements
placentaires, l’exposition aux drogues pendant la période prénatale, une maladie chronique
2
Sources : OMS. Les naissances prématurées. Aide-mémoire no 363.www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/fr. Blencowe H,
Cousens S, Oestergaard MZ et coll. National, regional and worldwide estimates of preterm birth. The Lancet ; 379(9832) : 2162-72.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 14
de la mère, les troubles hypertensifs, la chorioamnionite, une rupture prolongée des
membranes et une vaginose bactérienne.
L’absence de soins prénatals, la sous-vaccination et le traitement inadéquat des infections ou
d’autres problèmes médicaux de la mère, y compris les infections transmises sexuellement
(ITS), sont tous des facteurs qui peuvent contribuer aux troubles du développement d’un
nourrisson prématuré.
On estime que 15 millions de nourrissons naissent prématurément chaque année, soit environ
une naissance sur dix. Plus de 60 % de ces naissances prématurées ont lieu en Afrique et en
Asie du Sud (tableau 1). Au sein même des pays, les familles les plus pauvres sont les plus
vulnérables.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 15
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
1. Rudolph C, Rudolph A, Lister GE et coll., éd. Rudolph's Pediatrics, 22e éd. New York,
NY: McGraw-Hill Professional, 2011.
2. American Academy of Pediatrics, comité sur les enfants ayant des incapacités, 2001.
Role of the pediatrician in family-centered early intervention services. Pediatrics 2011 ;
107(5) :1155-7.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Developmental disabilities increasing in
US.http://www.cdc.gov/features/dsdev_disabilities
4. OMS, 2012. Anomalies congénitales. Aide-mémoire
no 370. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/fr
5. Le Doaré K, Bland R, Newell ML. Neurodevelopment in children born to HIV-infected
mothers by infection treatment status. Pediatrics 2012 ; 130(5) :e1326-44.
6. Swanson EC, Schleiss MR. Congenital cytomegalovirus infection: New prospects for
prevention and therapy. Pediatr Clin N Am 2013 ; 60(2) :335-49.
7. Torgerson PR, Mastroiacovo P. The global burden of congenital toxoplasmosis: A
systematic review. Bull World Health Organ 2013 ; 91(7) :501-8.
8. OMS, 2013. Rubella and congenital rubella syndrome
(CRS) :http://www.who.int/immunization_monitoring/diseases/rubella/en
9. OMS, 2013. Over a million pregnant women infected with syphilis
worldwide.http://www.who.int/entity/reproductivehealth/topics/rtis/syphilis/pregnan
cy
10. OMS, 2013. Infections sexuellement transmissibles (IST). Aide-mémoire
no 110.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/fr/, consulté en octobre
2013
11. Abel EL, Sokol RJ. Incidence of fetal alcohol syndrome and economic impact of FAS-
related anomalies. Drug Alcohol Depend 1987 ; 19(1):1951-70.
12. Liu Y, McDermott S, Lawson A et coll. The relationship between mental retardation and
developmental delays in children and the levels of arsenic, mercury and lead in soil
samples taken near their mother’s residence during pregnancy. Int J Hyg Environ Health
2010 ; 13(2) :116-23.
13. OMS. Toxic hazards. http://www.who.int/heli/risks/toxics/chemicals/en
14. Eskenazi B, Marks AR, Bradman A et coll. In utero exposure to
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) and
neurodevelopment among young Mexican American children. Pediatrics 2006 ;
118(1):233-41.
15. OMS, UNICEF, ICCIDD. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their
elimination: A guide for programme managers, 3e éd. Genève : OMS,
2008 :http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/iodine_deficiency/97
89241595827/en
16. Bath SC, Steer C, Golding J et coll. Effect of inadequate iodine intake status in UK
pregnant women on cognitive outcomes in their children: Results from the Avon
longitudinal study of parents and children (ALSPAC). Lancet 2013 ; 382(9889) :331-7.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 16
17. OMS. Feto-maternal nutrition and low birth
weight. http://www.who.int/nutrition/topics/feto_maternal/en
18. Dagnew AF, Cunnington MC, Dube Q et coll. Variation in reported group B streptococcal
disease incidence in developing countries. Clin Infect Dis 2012 ; 55(1) :91-102.
19. Centers for Disease Control and Prevention. ABCs Report: Group B Streptococcus,
2012. http://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/gbs12.html
20. Latin American Center for Perinatology, Women and Reproductive Health. Perinatal
infections transmitted by the mother to her infant: Educational material for health
personnel. Scientific Publication-CLAP/SMR 1567.02 décembre 2008.
21. OMS, 2012. Les naissances prématurées. Aide-mémoire
no 363. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/fr
22. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard M.et coll. National, regional and worldwide
estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for
selected countries: A systematic analysis and implications. The Lancet 2012 ;
379(9832) : 2162-72.
MES0709/CYCLEII/SÉRIE01MES0709.2.1.2.2 «PROPRIÉTÉ CNFEPD» PAGE 17
Vous aimerez peut-être aussi
- Bilan neuropsychologique de l'enfant: Guide pratique pour le clinicienD'EverandBilan neuropsychologique de l'enfant: Guide pratique pour le clinicienPas encore d'évaluation
- Expose Sur L'enfanceDocument8 pagesExpose Sur L'enfanceLeNantais Sonderangebote100% (2)
- Psychologie de L'enfant Et de L'adolescentDocument13 pagesPsychologie de L'enfant Et de L'adolescentclement MascletPas encore d'évaluation
- 5 Le - Devellopement - Psychomoteur - 5 - de - L'individuDocument3 pages5 Le - Devellopement - Psychomoteur - 5 - de - L'individuSid Ali HouachriaPas encore d'évaluation
- Développement de La PersonnalitéDocument13 pagesDéveloppement de La Personnalitésaidaggoun100% (1)
- Psychologie Du Developpement de La Naissance A L AdolescenceDocument37 pagesPsychologie Du Developpement de La Naissance A L Adolescencefmogonea7084Pas encore d'évaluation
- L'évaluation du comportement chez le jeune enfant: Un ouvrage de psychologie pour praticiensD'EverandL'évaluation du comportement chez le jeune enfant: Un ouvrage de psychologie pour praticiensPas encore d'évaluation
- Bilan neuropsychologique de l'enfant: Un guide pour analyser les difficultés cognitives des enfantsD'EverandBilan neuropsychologique de l'enfant: Un guide pour analyser les difficultés cognitives des enfantsPas encore d'évaluation
- La motivation: Voyage au cœur des comportements motivés, de l'étude des processus internes aux théories neuropsychologiques les plus récentesD'EverandLa motivation: Voyage au cœur des comportements motivés, de l'étude des processus internes aux théories neuropsychologiques les plus récentesPas encore d'évaluation
- Développement Psychologique de L'adolescentDocument15 pagesDéveloppement Psychologique de L'adolescentJae Oh l100% (2)
- Developpement EnfantDocument11 pagesDeveloppement EnfantBonjour Aymeric100% (1)
- Psychologie EnfantDocument30 pagesPsychologie EnfantSalihi Nada100% (1)
- La Psy Du Developpement Selon Piaget (E. Bonjour)Document35 pagesLa Psy Du Developpement Selon Piaget (E. Bonjour)Fiona DeprezPas encore d'évaluation
- Le Développement de L'enfant (Freud, Piaget, Wallon, Vygotsky) (Extrait)Document4 pagesLe Développement de L'enfant (Freud, Piaget, Wallon, Vygotsky) (Extrait)CéliaCarpaye100% (1)
- CHAP 4. Le Modèle D'henri WallonDocument6 pagesCHAP 4. Le Modèle D'henri WallonWojciechowski100% (1)
- Psychologie de L'adolescentDocument11 pagesPsychologie de L'adolescentYoussef Las100% (1)
- Jean Piaget - Les Différents Stades de L'évolution IndividuelleDocument3 pagesJean Piaget - Les Différents Stades de L'évolution IndividuellegestanitPas encore d'évaluation
- Psychologie de L'enfant Et de L'adolescentDocument31 pagesPsychologie de L'enfant Et de L'adolescentRonald IntegrePas encore d'évaluation
- Psy 112 Psychologie de L'enfantDocument37 pagesPsy 112 Psychologie de L'enfantSouaïbou Baba57% (7)
- Concepts Théoriques en Psychologie (Mode de Compatibilité) PDFDocument85 pagesConcepts Théoriques en Psychologie (Mode de Compatibilité) PDFVirgile TAHOPas encore d'évaluation
- DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DEL'ENFANT 4eme AnneeDocument61 pagesDEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DEL'ENFANT 4eme Anneejuste ben johnsonPas encore d'évaluation
- Psychologie Du Developpement 2Document20 pagesPsychologie Du Developpement 2lebonelPas encore d'évaluation
- Psychopedagogie, La Psychologie CognitiveDocument5 pagesPsychopedagogie, La Psychologie CognitiveFarouq MedaniPas encore d'évaluation
- Psychopédagogie Doc-Final M2 AMEUR-AzzeddineDocument18 pagesPsychopédagogie Doc-Final M2 AMEUR-AzzeddinehafidPas encore d'évaluation
- DEVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF CopieDocument69 pagesDEVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF Copiemabchour100% (1)
- Les Stades Selon Piaget Cours 2Document42 pagesLes Stades Selon Piaget Cours 2Med HassanPas encore d'évaluation
- Cours PsychpédagogieDocument59 pagesCours PsychpédagogiehoussaynPas encore d'évaluation
- PsycologieDocument9 pagesPsycologieTALEB AHMED AbdelhakPas encore d'évaluation
- CM Educateur 2022 Psychologie de Lenfant Prof. Koudou OpadouDocument14 pagesCM Educateur 2022 Psychologie de Lenfant Prof. Koudou OpadouAboubakar KansePas encore d'évaluation
- Developpement Enfant DossierDocument86 pagesDeveloppement Enfant DossierSébastien Lebreton100% (1)
- Module 09 - FD - Psychomotricite Et Education PhysiqueDocument25 pagesModule 09 - FD - Psychomotricite Et Education PhysiqueMeryem Jara100% (1)
- 3 - Psychologie de L EnfantDocument38 pages3 - Psychologie de L EnfantIkram ChamixoPas encore d'évaluation
- Développement Psychologique de L'enfantDocument26 pagesDéveloppement Psychologique de L'enfantSoizic PiettePas encore d'évaluation
- Elements de Psychologie SocialeDocument25 pagesElements de Psychologie SocialeMoustapha SarrPas encore d'évaluation
- Développement Affectif Du NourrissonDocument8 pagesDéveloppement Affectif Du NourrissonEmmanuelle JallageasPas encore d'évaluation
- 1-Psychologie de L'enfantDocument32 pages1-Psychologie de L'enfantMikael IshakPas encore d'évaluation
- Développement, Motricité, Perception Et Communication Non Verbale (C. Brechet)Document14 pagesDéveloppement, Motricité, Perception Et Communication Non Verbale (C. Brechet)La Rabia del PuebloPas encore d'évaluation
- 4 - Structure Et Développement de La PersonnalitéDocument43 pages4 - Structure Et Développement de La Personnalitémo salahPas encore d'évaluation
- Psychomotricité Du BébéDocument253 pagesPsychomotricité Du Bébéuda tznPas encore d'évaluation
- Le MaturationismeDocument8 pagesLe MaturationismePhil Penda100% (1)
- Introduction À La Psychologie GéneraleDocument9 pagesIntroduction À La Psychologie Géneralesami87100% (1)
- Stades Du Développement Chez L'enfant - Comparaison Entre Freud, Piaget Et WallonDocument6 pagesStades Du Développement Chez L'enfant - Comparaison Entre Freud, Piaget Et Wallonidrile100% (6)
- Developpement Psychoaffectif de L'enfantDocument21 pagesDeveloppement Psychoaffectif de L'enfantAbed Frigui0% (1)
- Développement Social de L'enfantDocument61 pagesDéveloppement Social de L'enfantIkram BardaguiPas encore d'évaluation
- Principes, Methodes Et Techniques Des Examens Psycho DiagnosticDocument82 pagesPrincipes, Methodes Et Techniques Des Examens Psycho Diagnostickibayisire100% (14)
- Psychopedagogie Et Methodologie GeneraleDocument189 pagesPsychopedagogie Et Methodologie GeneraleIssam Boulksibat100% (2)
- Relation Mère-Bébé PDFDocument17 pagesRelation Mère-Bébé PDFEmmanuelle JallageasPas encore d'évaluation
- Tableau Dev. Psychomoteur de L'enfantDocument2 pagesTableau Dev. Psychomoteur de L'enfantBrand Mindset100% (3)
- CM 2 Ip Cafop Methodes Et Techniques en Apprentissage Prof. Koudou OpadouDocument10 pagesCM 2 Ip Cafop Methodes Et Techniques en Apprentissage Prof. Koudou Opadouolousola jacobPas encore d'évaluation
- Psychologie de L'adolescentDocument22 pagesPsychologie de L'adolescentYoussef LasPas encore d'évaluation
- Psychologie SocialeDocument71 pagesPsychologie Socialesohayeb100% (3)
- Développement Affectif de L - AdolescentDocument22 pagesDéveloppement Affectif de L - Adolescenthoussein zmerliPas encore d'évaluation
- Guide - Résoudre Comportement EnfantDocument124 pagesGuide - Résoudre Comportement EnfantDodji Kekeli Eben-EzerPas encore d'évaluation
- Troubles D-Apprentissage PDFDocument44 pagesTroubles D-Apprentissage PDFpoupette64100% (1)
- Cours Psycho Enfant 2016 Unifie PDFDocument42 pagesCours Psycho Enfant 2016 Unifie PDFVital BossoukpePas encore d'évaluation
- Théories de L'apprentissageDocument68 pagesThéories de L'apprentissageIsmail Aabil100% (1)
- Developpement Affectif de L'enfant PDFDocument2 pagesDeveloppement Affectif de L'enfant PDFEffort BenefPas encore d'évaluation
- DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DR CHTIOUI FinalDocument61 pagesDEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DR CHTIOUI FinalSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- 5-Animation Et Évaluation Des ActivitésDocument38 pages5-Animation Et Évaluation Des ActivitésMikael IshakPas encore d'évaluation
- 1-Psychologie de L'enfantDocument32 pages1-Psychologie de L'enfantMikael IshakPas encore d'évaluation
- 4-Préparation de L'enfant À La Vie Scolaire (Réparé)Document27 pages4-Préparation de L'enfant À La Vie Scolaire (Réparé)Mikael IshakPas encore d'évaluation
- 3-Application Des Démarches PédagogiqueDocument38 pages3-Application Des Démarches PédagogiqueMikael Ishak100% (1)
- 5-Animation Et Évaluation Des ActivitésDocument19 pages5-Animation Et Évaluation Des ActivitésMikael IshakPas encore d'évaluation
- 4 - Préparation L'enfant À La Vie ScolaireDocument31 pages4 - Préparation L'enfant À La Vie ScolaireMikael IshakPas encore d'évaluation
- 2-Organisation Des Activites QuotidienneDocument14 pages2-Organisation Des Activites QuotidienneMikael IshakPas encore d'évaluation
- 3-Application Des Démarches PédagogiquesDocument27 pages3-Application Des Démarches PédagogiquesMikael Ishak100% (1)
- 4-Préparation de L'enfant À La Vie Scolaire (Enregistré Automatiquement) VuDocument23 pages4-Préparation de L'enfant À La Vie Scolaire (Enregistré Automatiquement) VuMikael IshakPas encore d'évaluation
- 1 - Psychologie de L'enfantDocument20 pages1 - Psychologie de L'enfantMikael IshakPas encore d'évaluation
- 2-Organisation Des Activites QuotidienneDocument21 pages2-Organisation Des Activites QuotidienneMikael IshakPas encore d'évaluation
- 3-Application Des Démarches PédaDocument14 pages3-Application Des Démarches PédaMikael Ishak100% (2)
- 2-Organisation Des Activites Quotidienne VUDocument24 pages2-Organisation Des Activites Quotidienne VUMikael IshakPas encore d'évaluation
- 1 - Psychologie de L'enfantDocument19 pages1 - Psychologie de L'enfantMikael Ishak100% (1)
- 5-Préparation de L'enfants À Vie ScolaireDocument23 pages5-Préparation de L'enfants À Vie ScolaireMikael IshakPas encore d'évaluation
- 4 - Application Des Démarches Pédagogiques VuDocument9 pages4 - Application Des Démarches Pédagogiques VuMikael Ishak100% (1)
- 5-Préparation de L'enfants À Vie ScolaireDocument23 pages5-Préparation de L'enfants À Vie ScolaireMikael IshakPas encore d'évaluation
- 6-Droit Du TravailDocument16 pages6-Droit Du TravailMikael IshakPas encore d'évaluation
- 3-Organisation Des Activtés QuotidiènneDocument14 pages3-Organisation Des Activtés QuotidiènneMikael IshakPas encore d'évaluation
- 1-Initiation À La PsychologieDocument12 pages1-Initiation À La PsychologieMikael IshakPas encore d'évaluation
- Texte 1 (Introduction Theì Orique) - Une Pathologie Eì Claireì e Par La Geì Nomique (Pour La Science, Juin 22)Document8 pagesTexte 1 (Introduction Theì Orique) - Une Pathologie Eì Claireì e Par La Geì Nomique (Pour La Science, Juin 22)mavrinissue4Pas encore d'évaluation
- FC Mali Manuel Du Participant en Prevention de Fistule Et SOUDocument221 pagesFC Mali Manuel Du Participant en Prevention de Fistule Et SOUFrère Paul Angelo MahanPas encore d'évaluation
- Anatomie: Gynéco by CADEMDocument24 pagesAnatomie: Gynéco by CADEMJamila SajidPas encore d'évaluation
- Embryologie Corrige s1 1128412705144Document11 pagesEmbryologie Corrige s1 1128412705144Uziel CHIMI100% (2)
- Allo-Immunisation Foetomaternelle ErythrocytaireDocument44 pagesAllo-Immunisation Foetomaternelle ErythrocytaireAghilas KingPas encore d'évaluation
- Evaluation Certificative - CEB - 2013 - Consignes de Passation Et de Correction (Ressource 12065) PDFDocument51 pagesEvaluation Certificative - CEB - 2013 - Consignes de Passation Et de Correction (Ressource 12065) PDFRauldiaz777Pas encore d'évaluation
- 7 La Premiã Re Semaine Du Dã©veloppement Embryonnaire PPTDocument13 pages7 La Premiã Re Semaine Du Dã©veloppement Embryonnaire PPThamihenbasmaPas encore d'évaluation
- Embryologie S1 2014 2015 1Document27 pagesEmbryologie S1 2014 2015 1L'enfant SucréPas encore d'évaluation
- R03 Proped Genitale Femelle 2016Document32 pagesR03 Proped Genitale Femelle 2016yassin elharrarPas encore d'évaluation
- CHAPITRE V Les Mutations ChromosomiquesDocument12 pagesCHAPITRE V Les Mutations ChromosomiquesChah Inez L-AbPas encore d'évaluation
- Le Nouveau-Né PrematuréDocument2 pagesLe Nouveau-Né PrematuréBoubacar KoumarePas encore d'évaluation
- VCATHSF19 Les Bases Des Soins DavortementDocument48 pagesVCATHSF19 Les Bases Des Soins DavortementRenaud DibyPas encore d'évaluation
- Gafbgrr HistreDocument33 pagesGafbgrr HistreakonderishiPas encore d'évaluation
- Syndrome de Gayet-Wernicke Par Carence Vitaminique Sur Vomissements Gravidiques Incoercibles Avec HyperthyroidieDocument4 pagesSyndrome de Gayet-Wernicke Par Carence Vitaminique Sur Vomissements Gravidiques Incoercibles Avec HyperthyroidieIJAR JOURNALPas encore d'évaluation
- La GlécimeDocument30 pagesLa GlécimechaymatebaibiaPas encore d'évaluation
- Protocole IMG 2021Document7 pagesProtocole IMG 2021CristinaCaprosPas encore d'évaluation
- Arret Cardiorespiratoire Chez L'adulte Et Particularitéschez LaDocument9 pagesArret Cardiorespiratoire Chez L'adulte Et Particularitéschez LaparamedicalesetsagefemmePas encore d'évaluation
- CM 2Document3 pagesCM 2souennoughPas encore d'évaluation
- UAA 8 Vivre Une Sexualité ResponsableDocument30 pagesUAA 8 Vivre Une Sexualité Responsablezappa1276Pas encore d'évaluation
- Endometre R1 Pr. FarahDocument22 pagesEndometre R1 Pr. FarahMSDPas encore d'évaluation
- Comment Calculer Votre Date DovulationDocument3 pagesComment Calculer Votre Date DovulationModeste OuèdraogoPas encore d'évaluation
- Série D'exercices: Reproduction Chez La FemmeDocument6 pagesSérie D'exercices: Reproduction Chez La FemmeLemrabott sidimahmoud50% (2)
- La Supplémentation Au Cours de La Grossesse: L'indispensable Et L'inutileDocument4 pagesLa Supplémentation Au Cours de La Grossesse: L'indispensable Et L'inutileamanina29Pas encore d'évaluation
- Revision N°2Document3 pagesRevision N°2kissaobilPas encore d'évaluation
- La Collection Hippocrate: Gynécologie-ObstétriqueDocument22 pagesLa Collection Hippocrate: Gynécologie-ObstétriqueAlberto GeorgePas encore d'évaluation
- Manuel Des Cours SVT s2 2A.C PR - naciRI Issame-1 (WWW - Pc1.ma)Document24 pagesManuel Des Cours SVT s2 2A.C PR - naciRI Issame-1 (WWW - Pc1.ma)jaouadPas encore d'évaluation
- StelDocument5 pagesStelYoussef LhsainiPas encore d'évaluation
- Ebook Un Bebe Maintenant - Aurelie RAESDocument48 pagesEbook Un Bebe Maintenant - Aurelie RAESMama LouifiPas encore d'évaluation
- Cancer de LovaireDocument93 pagesCancer de LovaireBek GhizlanePas encore d'évaluation
- La Criminalisation Du Viol Et Aprè1Document2 pagesLa Criminalisation Du Viol Et Aprè1Samba KeitaPas encore d'évaluation