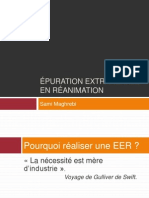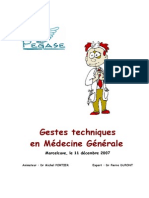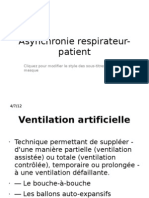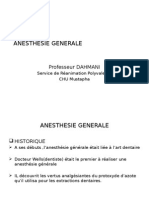Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Revue Du Praticien-Douleur, Soins Palliatifs
La Revue Du Praticien-Douleur, Soins Palliatifs
Transféré par
drbadisTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Revue Du Praticien-Douleur, Soins Palliatifs
La Revue Du Praticien-Douleur, Soins Palliatifs
Transféré par
drbadisDroits d'auteur :
Formats disponibles
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
539
PARTIE I / MODULE 6
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Q 67
Anesthsie locale,
locorgionale et gnrale
P
r
Jean-Jacques Lehot
1
, P
r
Marc Freysz
2
1. Service danesthsie ranimation, hpital cardiovasculaire et pneumologique Louis Pradel, 69394 Lyon Cedex 03
2. Dpartement danesthsie ranimation, Hpital gnral CHU de Dijon, 21033 Dijon Cedex
jean-jacques.lehot@chu-lyon.fr
ANESTHSIE LOCALE
La pharmacologie des anesthsiques locaux (AL) et leur toxi-
cit sont dveloppes plus loin. Lanesthsie topique consiste
bloquer les terminaisons nerveuses sensitives en appliquant
lAL sur la peau et les muqueuses. Lors de lanesthsie par infil-
tration, lAL est introduit dans le tissu sous-cutan et les plans
plus profonds, sur une surface limite au lieu de lintervention.
ANESTHSIE LOCALE TOPIQUE
Lanesthsie topique a de nombreux avantages : elle diminue
la douleur lie laiguille, la crainte quelle peut engendrer,
le risque de piqre septique, la dformation des berges dune
plaie qui peut tre gnante pour une suture. Les anesthsiques
locaux peuvent tre appliqus sur les muqueuses, la peau et
les plaies.
1. Anesthsie topique des muqueuses
Ses indications sont lanesthsie locale :
de contact avant explorations instrumentales stomatolo-
giques, laryngoscopiques, fibroscopie sophagienne ou gastrique;
de surface avant anesthsie dinfiltration ou gestes
douloureux ;
de muqueuse nasale avant geste invasif ;
avant exploration en urologie ;
des muqueuses gnitales de ladulte avant infiltration laiguille.
Un effet indsirable de lanesthsie topique du nez, de la bou-
che et du pharynx, est la suppression du rflexe de protection
des voies ariennes suprieures qui, associe la difficult pour
avaler, peuvent conduire une inhalation bronchique.
Le strict respect des posologies recommandes est indispen-
sable pour viter un accident toxique, en particulier au niveau
des voies ariennes suprieures.
2. Anesthsie topique de la peau
Un mlange de lidocane (2,5 %) et de prilocane (2,5 %)
appel Emla est disponible. Cette crme existe sous 2 formes :
Emla et EmlaPatch. Elle doit tre applique sous un pansement
iOBJECTIFSi
Argumenter les indications, les contre-indications et les risques
dune anesthsie locale, locorgionale ou gnrale.
Prciser les obligations rglementaires respecter avant
une anesthsie.
POINTS FORTS
> Les anesthsies locales peuvent tre pratiques par tout
mdecin.
> Les anesthsies locorgionales les plus pratiques sont
les blocs centraux (ou neuro-axiaux) (rachianesthsie,
anesthsie pridurale) et les blocs priphriques
(plexiques, tronculaires). La toxicit des anesthsiques
locaux est essentiellement neurologique et
cardiovasculaire.
> Lanesthsie gnrale ncessite souvent lassociation
dhypnotiques (intraveineux ou inhals), danalgsiques
(morphiniques) et de myorelaxants (curares). Elle
demande le contrle des voies ariennes par intubation
trachale ou masque laryng et le plus souvent une
ventilation mcanique. Les accidents anesthsiques sont
en diminution grce lapplication des textes rglementaires
et lutilisation de matriels et de mdicaments plus srs.
comprendre
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 539
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
540
occlusif, maintenu en place au moins une heure (pas plus de
20 minutes au contact des muqueuses ou dune plaie).
Les indications sont lanesthsie :
de la peau saine avant ponctions ou abords vasculaires,
ponction lombaires ou anesthsie locorgionale (ALR) ;
avant chirurgie cutane superficielle ;
avant dtersion mcanique des ulcres veineux.
Les posologies maximales sont de 30 g habituellement chez
ladulte, mais seulement 10 g en cas de contact avec les muqueu-
ses et de 0,15 g kg
1
chez lenfant.
3. Examen dun il douloureux en urgence
Linstillation dune ou deux gouttes dune solution dAL, loxy-
buprocane (Novsine) permet de raliser ce geste sans douleur.
ANESTHSIE PAR INFILTRATION
Elle est utilise dans la majorit des procdures chirurgicales
mineures. Les AL administrer sont la lidocane et la mpiva-
cane. En labsence de contre-indication, lutilisation dune solu-
tion adrnaline est recommande pour diminuer la dose dAL
injecte. Chez ladulte, dans cette indication, la posologie maxi-
male est de 200 mg pour la lidocane et pour la mpivacane.
La technique dadministration utilise doit diminuer la dou-
leur lors de linjection, prvenir la propagation infectieuse, et
viter linjection intravasculaire. Pour diminuer la douleur de lin-
jection, les solutions suivantes sont proposes : aiguilles de petit
calibre, solutions rchauffes, injection intradermique rgulire
et lente dans les berges de la plaie et de proche en proche. Pour
prvenir le risque septique, en cas de plaie manifestement
contamine, linfiltration doit tre ralise en peau saine.
CHOIX DE LA TECHNIQUE
Une surface opratoire tendue doit faire prfrer une tech-
nique dALR, car les doses efficaces atteignent les limites des
doses maximales dAL et font donc courir le risque de toxicit
systmique en rapport avec les concentrations plasmatiques
leves alors observes. Le risque de distorsion des berges
dune plaie complexe fait prfrer une anesthsie topique ou
une ALR.
ANESTHSIE LOCORGIONALE ET GNRALE
PRISE EN CHARGE ANESTHSIQUE
La dmarche anesthsique (dcret du 5 dcembre 1994)
rend obligatoires, en dehors de lurgence, la consultation et
la visite pranesthsiques, ainsi que le passage en salle de sur-
veillance post-interventionnelle (SSPI) ou en ranimation aprs
lanesthsie (fig. 1).
1. Consultation pranesthsique
Cette consultation doit tre ralise plusieurs jours avant
lanesthsie par un mdecin anesthsiste-ranimateur, soit dans
des locaux de consultation externe pour les tablissements
hospitaliers, soit au cabinet du mdecin anesthsiste-ranimateur
ou dans les locaux des tablissements pour les tablissements
de sant privs. Les rsultats sont consigns dans un document
crit, incluant les rsultats des examens complmentaires et des
ventuelles consultations spcialises ; il est insr dans le dos-
sier mdical du patient. Cette consultation a pour but dappr-
cier et de diminuer les risques lis lanesthsie ainsi que den
informer le patient et les mdecins correspondants. Cela
explique quelle doit tre pratique dautant plus longtemps
avant lanesthsie que le risque est important.
Les antcdents pathologiques doivent tre recherchs, en
particulier les antcdents cardiovasculaires, respiratoires, uro-
nphrologiques, osto-articulaires, oto-rhino-laryngologiques
(accs aux voies ariennes), stomatologiques (intubation tra-
chale), hmatologiques (y compris les transfusions sanguines),
digestifs, endocrinologiques et neuro-psychiatriques.
Linterrogatoire porte particulirement sur :
les antcdents anesthsiques et obsttricaux (possibilit
dapparition danticorps irrguliers) ;
les antcdents immunologiques avec la recherche daller-
gies mais aussi le degr dimmunodpression;
la prsence de maladies transmissibles (en particulier virus
de lhpatite et VIH) et les risques de portage de bactries multi-
rsistantes.
Linterrogatoire recherche la prsence de signes fonction-
nels, apprcie le mode de vie et en particulier la capacit deffort
(le rveil post-anesthsique correspond un effort physique),
les prfrences pour une anesthsie gnrale ou locorgionale,
ainsi que les traitements en cours. Linterrogatoire porte gale-
ment sur les habitudes toxiques (alcool, tabac, drogue).
Lexamen clinique est la fois classique et doit porter sur des
points particuliers. Les donnes anthropomtriques sont consignes
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Anesthsie locale, locorgionale et gnrale
Consultation pranesthsique
(plusieurs heures avant
lanesthsie)
Urgences
Visite pranesthsique
(dans les heures prcdent
lanesthsie)
Anesthsie
Ranimation
Soins intensifs
Salle de surveillance
post-interventionnelle
Service hospitalisation
Domicile
(anesthsie ambulatoire)
Prise en charge anesthsique.
Figure 1
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 540
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
541
afin dadapter les posologies des agents anesthsiques et de
connatre le poids initial avant un ventuel sjour en ranimation
postopratoire.
Lexamen cardiovasculaire comprend une auscultation car-
diaque et vasculaire (en particulier les vaisseaux de la base du
cou), la frquence cardiaque et la pression artrielle, ltat vei-
neux (risque de thrombophlbite et possibilit dinsertion des
cathters veineux).
Lexamen respiratoire recherche une dyspne, une cyanose,
une dsaturation en oxygne (saturomtre de pouls) et com-
porte une auscultation pulmonaire.
Lexamen du rachis est un temps important si lon envisage
une anesthsie neuraxiale. Lexamen du rachis cervical et de
la cavit buccale ainsi que de la dentition permet dapprcier les
risques et les difficults de lintubation trachale. Lexamen
cutan permet de prvoir la ralisation des diffrentes ponc-
tions. Enfin, un examen neurologique et un examen psycholo-
gique sommaire sont indispensables, en particulier pour pren-
dre en charge lanxit.
Prescription dexamens complmentaires. Les deux objectifs
principaux de ces examens sont la modification ventuelle
de la technique anesthsique et la prvision des complications
postopratoires. Il nexiste aucune obligation lgale en cette
matire. La prescription de ces examens dpend de ltat cli-
nique du patient et de lintervention envisage.
Les examens biologiques peuvent tre raliss au dcours de
la consultation pranesthsique mais la recherche danticorps
irrguliers, obligatoire avant une transfusion sanguine, a une
validit infrieure 5 jours et doit tre ralise le moins long-
temps possible avant lanesthsie. Tests dhmostase, iono-
gramme sanguin et hmogramme sont de ralisation courante.
Si une transfusion sanguine est envisage, on ralise un grou-
page ABO Rhsus, la recherche danticorps irrguliers et des
srologies virales (hpatite, VIH aprs consentement du
patient). Le bilan hpatique et la cratininmie sont souvent
prescrits en dehors des patients ASA I (tableau 1). Dautres exa-
mens sont plus rarement raliss, tels que la gazomtrie art-
rielle, les demandes de tests allergologiques ou la recherche
dun ventuel portage de bactries multirsistantes .
ECG 12 drivations, radiographie thoracique, exploration
fonctionnelle respiratoire ou radiographie du rachis sont pres-
crits sur justification particulire. Chez les patients ayant des
facteurs de risques cardiovasculaire ou une suspicion de throm-
bophlbite, un examen doppler vasculaire peut tre pratiqu.
Chez le patient cardiaque non suivi par un cardiologue, cer-
tains examens peuvent tre utiles la prise en charge. Lcho-
cardiographie-doppler transthoracique de repos examine les
structures cardiaques la recherche dune dilatation des cavi-
ts, dune hypertrophie paritale, dune dysfonction systolique
ou diastolique. Cet examen est loccasion dun avis cardiolo-
gique. En prsence de signes fonctionnels compatibles avec une
angine de poitrine ou une dyspne, une coronaropathie peut
tre recherche en ralisant une preuve de stress (ECG def-
fort, scintigraphie, chocardiographie la dobutamine).
Lorsquune ischmie myocardique tendue est diagnosti-
que, une coronaro-ventriculographie puis un geste de revascu-
larisation peuvent tre discuts en dehors de lurgence, princi-
palement pour la chirurgie aortique.
Prescriptions mdicamenteuses. Certains mdicaments doi-
vent tre arrts avant lanesthsie cause de leur interfrence
possible avec cette dernire, ou sils font courir un risque hmor-
ragique pour lintervention chirurgicale. Parmi les premiers, il
sagit essentiellement des antidpresseurs IMAO non spci-
fiques qui doivent tre arrts deux semaines avant lanesth-
sie, ainsi que des anti-hypertenseurs rserpiniques. Les anti-
arythmiques de classe Ic seront galement arrts 3 4 jours
avant lanesthsie. Il en est de mme des inhibiteurs de lenzyme
de conversion et des antagonistes de langiotensine chez lhyper
tendu 24 heures avant lanesthsie. Ces derniers peuvent tre
remplacs par des dihydropyridines. linverse, les -bloquants
diminuent lincidence des complications ischmiques myocar-
diques et seront poursuivis. Avant anesthsie pour cardiover-
sion, la digoxine est arrte une semaine et lon sassure que
lINR est suprieur 2.
Concernant le risque hmorragique, laspirine est arrte
gnralement 4 jours avant une intervention risque, la ticlopi-
dine et le clopidogrel une semaine avant ce type dintervention.
Les antivitamine K sont relayes par une hparine 3 4 jours
avant lintervention en prvoyant la recherche dune thrombo-
pnie lie lhparine.
La ncessit du jene pranesthsique est explique (2 heu-
res pour les liquides clairs tels que eau, jus de fruit sans pulpe,
boissons gazeuses, th et caf, et 6 heures pour un repas lger :
toasts et liquides clairs). Les aliments gras ou frits ou la viande
allongent le temps de vidange gastrique. La non-prise en
compte de ces consignes peut entraner une inhalation bron-
chique du contenu gastrique.
Des avis complmentaires peuvent tre demands au
mdecin traitant, loprateur (chirurgien ou non) ou un autre
spcialiste.
Synthse. lissue de la consultation, le patient est class en
fonction des stades ASA (tableau 1) qui quantifient le risque li
lanesthsie. Le type danesthsie est choisi en fonction du ter-
rain, de lintervention, de la prfrence du patient, ainsi que de
Classication de ltat clinique du
patient selon lAmerican Society of
Anesthesiologists (ASA)
Tableau 1
ASA 1
ASA 2
ASA 3
ASA 4
ASA 5
Patient normal ou en bonne sant
Patient atteint dune affection systmique lgre
Patient atteint dune affection systmique grave,
qui limite son activit sans entraner dincapacit
Patient atteint dune affection systmique invalidante
et mettant constamment la vie en danger
Patient moribond dont lesprance de vie est infrieure
24h, avec ou sans intervention
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 541
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
542
celle de lanesthsiste et du chirurgien. Le patient doit en tre
clairement inform, ainsi que des possibilits de transfusion
sanguine et dautotransfusion. Si besoin, le passage en soins
intensifs postopratoires est prvu. La discussion bn-
fice/risque de lintervention et de lanesthsie est rsume dans
le dossier anesthsique.
2. Visite pranesthsique
Cette visite est effectue dans les heures prcdant lanes-
thsie. Au cours de celle-ci, le mdecin reprend le compte rendu
de la consultation pranesthsique, interroge et examine
le patient la recherche de modifications depuis la consultation.
Les rsultats des examens complmentaires sont pris en
compte. Le type danesthsie et danalgsie post-intervention-
nelle est arrt en accord avec le patient et loprateur. Linfir-
mier anesthsiste est alors inform du protocole danesthsie.
Enfin, la prmdication et ventuellement le patch danes-
thsique local sont prescrits. La prmdication, gnralement
administre par voie orale, vise rduire lanxit laide dune
benzodiazpine et dhydroxyzine. Ladministration datropine
nest plus systmatique, mais est faite lors de lanesthsie en cas
de bradycardie. Ladministration de morphiniques est de rgle
chez les patients souffrant dune douleur aigu.
3. Anesthsie conventionnelle
Avant de procder une anesthsie gnrale ou une ALR,
un certain nombre de fonctions doivent tre surveilles ou vri-
fies : rythme cardiaque et trac ECG, pression artrielle non
invasive ou invasive, arrive des fluides mdicaux et aspiration
par le vide, administration de gaz et de vapeurs anesthsiques,
intubation trachale et ventilation artificielle. Des contrles
continus doivent tre assurs : dbit de loxygne et teneur en
oxygne du mlange gazeux inhal, saturation du sang en oxy-
gne, pression et dbit ventilatoire, ainsi que la concentration en
gaz carbonique expir lorsque le patient est intub.
Le mdecin qui pratique lanesthsie doit sassurer avant
linduction que les dispositifs utiliss sont en tat de marche et
contresigner un registre qui en fait mention. Par ailleurs, les
matriels et dispositifs mdicaux doivent tre contrls lors de
leur premire utilisation et lors de toute remise en service, et
leur maintenance organise. De plus, des procdures doivent
pallier les dfaillances de lalimentation normale en gaz usage
mdical et en nergie.
Il en est de mme pour le matriel utilis en SSPI qui doit, en
outre, tre quip des moyens ncessaires au retour un quili-
bre thermique normal, dun dfibrillateur cardiaque, et dun
moniteur de curarisation. Cette salle comporte un minimum de
4 lits, et doit tre situe proximit du site o sont pratiques
les anesthsies. Les patients admis dans cette salle sont sur-
veills par un infirmier form, si possible infirmier anesthsiste.
Lanesthsie et la surveillance post-interventionnelle sont pla-
ces sous la responsabilit dun mdecin anesthsiste-ranima-
teur qui doit pouvoir intervenir sans dlai. La priode post-anes-
thsique peut aussi se drouler dans un service de ranimation
ou de soins intensifs. Sous rserve que les patients puissent
bnficier des mmes conditions de surveillance, la salle de tra-
vail en cas danesthsie gnrale ou locorgionale pour des
accouchements par voie basse, ou la salle o sont pratiques
des activits de sismothrapie peut galement tre utilise.
4. Anesthsie ambulatoire
Lanesthsie ambulatoire est pratique habituellement en
dehors de toute urgence par un mdecin anesthsiste-ranima-
teur sur un patient qui doit bnficier soit dun acte chirurgical,
soit dune endoscopie, soit dun acte mdical ncessitant une
anesthsie, et qui va rester moins de 12 heures dans la structure
de soins avant de retourner son domicile. En France, 27 % des
anesthsies sont pratiques en ambulatoire, et 55 % de ces
anesthsies le sont loccasion dactes chirurgicaux. La slec-
tion des patients par loprateur et lanesthsiste lors de
la consultation est primordiale. Quel que soit le type danesth-
sie utilis, la seule obligation est de permettre une rcupration
rapide des principales fonctions vitales avec un minimum def-
fets secondaires. Lanalgsie post-interventionnelle doit gale-
ment tre prvue. La surveillance post-interventionnelle,
dabord en SSPI, puis en salle de repos, doit tre attentive.
La sortie nest autorise quaprs accord de loprateur et (ou) de
lanesthsiste. En cas de problme, le patient et son entourage
doivent pouvoir contacter 24 h/24 un praticien du centre et
le patient doit pouvoir revenir dans le centre en moins dune heure.
ANESTHSIES LOCORGIONALES
LALR correspond actuellement environ 20 % de lensemble
des anesthsies pratiques.
1
Les AL bloquent, de manire
rversible, les canaux sodiques qui transmettent linflux
nerveux. Lintensit, ltendue et la dure de ce bloc dpen-
dent, dune part du site dinjection, et dautre part du type, de
la concentration et de la quantit dAL utilis.
1. Anesthsiques locaux et adjuvants
Pharmacologie des anesthsiques locaux. Les AL actuellement
utiliss sont des molcules comportant un noyau aromatique
(ple lipophile) et un driv amin de lacide actique ou de
lalcool thylique (ple hydrophile, ionisable), relis par une
chane intermdiaire dont la liaison avec le ple lipophile est de
type amide. Ces molcules sont des bases faibles, existant sous
forme ionise ou non ionise (forme diffusible). Elles sont com-
mercialiss sous deux formes : adrnalines au 1/200 000
contenant un conservateur, et non adrnalines, ne contenant ni
conservateur ni antioxydant. Les AL de puissance faible (lido-
cane, prilocane et mpivacane) ont un dlai daction court (5
10 min selon le site) et une dure daction de 1 h 30 2 h. Les AL
les plus puissants (ropivacane et bupivacane) ont un dlai dac-
tion plus long (10 20 min) et une dure daction de 2 h 30 3 h 30.
La liaison protique de tous les amides est importante. Les
facteurs la diminuant (acidose, hypoventilation, ges extrmes
de la vie) augmentent la toxicit des AL. Linjection rapide dun
AL augmente la fraction libre, ce qui accrot le risque toxique.
Le mtabolisme des AL de type amide est hpatique, par
le cytochrome P450 et dpend du dbit sanguin hpatique. Aussi,
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Anesthsie locale, locorgionale et gnrale
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 542
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
543
toute baisse du dbit cardiaque peut conduire un ventuel
surdosage en lidocane. La ropivacane et la bupivacane voient
leurs concentrations libres augmenter en cas dadministration
chez un patient ayant une insuffisance hpatocellulaire grave.
Les solutions adrnalines sont associes un ralentisse-
ment de labsorption systmique. Elles augmentent habituelle-
ment la dure du bloc.
La vitesse dapparition de lanesthsique local dans le sang
est fonction du site dinjection. Lapparition de lAL dans le sang
est plus rapide dans les zones cphaliques bien vascularises,
quau niveau des membres infrieurs. Il convient dtre prudent
lors des rinjections, mme espaces, en raison du risque
toxique des doses cumules. Lenfant de moins dun an a des
caractristiques physiologiques qui imposent un usage particu-
lier de lanesthsie locale.
Toxicit des anesthsiques locaux
Toxicit locale
Les AL, et plus particulirement la lidocane, sont toxiques pour
le nerf. Cependant, cette toxicit ne se manifeste que lors des
rachianesthsies ou lors dune injection intraneurale accidentelle.
Toxicit systmique
La concentration dAL susceptible de provoquer des acci-
dents systmiques est inversement proportionnelle la puis-
sance de lagent utilis. Pour un agent donn, la toxicit est fonc-
tion de sa concentration plasmatique du fait :
lsoit dune injection accidentelle dans un vaisseau ;
lsoit dune dose unique trop leve ;
lsoit de doses cumules trop importantes.
Toxicit nerveuse centrale
Tous les agents sont capables dinduire des accidents convul-
sifs. Le rapport des toxicits neurologiques de la bupivacane, de
la ropivacane et de la lidocane est denviron 4/3/1. La toxicit
neurologique se traduit par des prodromes, puis par des convul-
sions, enfin au stade ultime, par un coma avec dpression cardio-
respiratoire (tableau 2). Le traitement doit tre rapide : arrt de
linjection, oxygnation et contrle des voies ariennes, voire
administration parentrale danticonvulsivants.
Toxicit cardiaque
Laccident cardiotoxique peut survenir avant lapparition des
prodromes neurologiques avec la bupivacane (ralentissement
majeur des vitesses de conduction intraventriculaire lorigine
de blocs fonctionnels de conduction, facilitant la survenue de
tachycardies ventriculaires par rentre). La ropivacane peut
induire les mmes manifestations.
Plus que lusage de la dose-test adrnaline, linjection lente,
fractionne avec maintien du contact verbal reprsente
la meilleure prvention. La ropivacane, rpute moins cardio-
toxique que la bupivacane, du moins dose gale, est une alter-
native intressante la bupivacane.
Allergies
Lallergie aux AL de type amide est tout fait exceptionnelle.
Dans les rares cas avrs, le conservateur utilis dans les solu-
tions adrnalines est plus souvent en cause que lAL lui-mme.
Mthmoglobinmie
Chez le nouveau-n et le nourrisson, une mthmoglobin-
mie peut se dvelopper jusqu 3 h suivant ladministration de
prilocane ou exceptionnellement de lidocane.
Les contre-indications lusage des AL sont rares. Les con-
tre-indications absolues sont lallergie avre un agent de
la classe correspondante (ou un excipient), la porphyrie pour
la lidocane et la ropivacane. Les solutions adrnalines ont
peu de contre-indications. Les contre-indications absolues sont
les traitements par IMAO de premire gnration, les blocs
dans les rgions dont la circulation est terminale (pnis, face,
doigts et orteils). Les contre-indications relatives sont les cardio-
pathies ischmiques mal compenses et la thyrotoxicose.
Autres agents. En dehors de ladrnaline, souvent associe aux
AL, la clonidine (Catapressan) et surtout la morphine, et ses dri-
vs, sont utiliss en anesthsie locorgionale.
lLa clonidine, par son action sur les rcepteurs neuronaux a2
adrnergiques de la corne postrieure de la moelle renforce
le bloc anesthsique et entrane une analgsie de longue
dure avec une frquence acceptable deffets secondaires.
lLa morphine et ses drivs agissent sur les rcepteurs mdul-
laires aux opiacs aprs administration par voie pridurale ou
directe dans le liquide cphalo-rachidien (LCR). La morphine,
hydrosoluble, persiste longtemps dans le LCR et procure une
analgsie longue (12 24 h). linverse, les opiacs liposolu-
bles (fentanyl, sufentanil) ont une dure daction plus courte et
sont administrs en continu. Si ladministration par voie pri-
durale ou intrathcale peut entraner des nauses, des vomis-
sements, un prurit ou une rtention durines, le principal risque
est la dpression respiratoire, qui peut tre de survenue retar-
de. Aussi, des mesures de surveillance stricte de ltat de
conscience et de la ventilation du patient sont indispensables.
2. Techniques anesthsiques
Les techniques, indications et contre-indications seront
successivement abordes.
Description des techniques. On distingue schmatiquement
les blocs centraux (ou anesthsie neuraxiale) et les blocs
priphriques.
Signes cliniques de toxicit
systmique des anesthsiques locaux
Tableau 2
SIGNES
MAJEURS
SIGNES
MINEURS
Confusion, attaques de panique
Convulsions
Coma
Apne
Tachycardie ventriculaire, torsade de pointe ou
bradycardie extrme pouvant aboutir larrt
circulatoire
Paresthsie des extrmits
Cphales en casque ou frontales
Got mtallique dans la bouche
Malaise gnral avec angoisse
Sensation brieuse, vertiges, logorrhe
Hallucinations visuelles ou auditives
Bourdonnement doreilles
PRODROMES
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 543
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
544
Blocs centraux
La rachianesthsie est induite par linjection dAL dans
le LCR, habituellement au-dessus de la terminaison mdullaire
(L2) au niveau lombaire, en utilisant une trs faible quantit dAL
ou dopiacs. Lorsquil ny a pas de perforation de la dure-mre
au moment de linjection, on parle danesthsie pridurale ; les
mmes agents sont injects, mais en plus grande quantit, par
lintermdiaire ou non dun cathter pouvant permettre des
injections rptes ou continues. Les deux techniques doivent
tre ralises dans des conditions dasepsie strictes. Elles provo-
quent une vasoplgie par bloc sympathique (avec pour cons-
quence une hypotension associe une bradycardie traiter,
le cas chant, par injection intraveineuse de vasopresseurs).
Ces techniques procurent un bloc sensitif (et aussi trs sou-
vent moteur) bilatral qui concerne les membres infrieurs et
remonte plus ou moins haut sur labdomen et le thorax.
Les patients bnficiant dune anesthsie pridurale ou
dune rachianesthsie doivent avoir le mme environnement et
une surveillance aussi attentive que celle pratique lors dune
anesthsie gnrale.
Blocs priphriques
Ils sont surtout utiliss pour la chirurgie des membres. En
fonction du territoire anesthsier, il est possible de bloquer
lensemble des nerfs par un ou des blocs plexiques ou de bloquer
slectivement un nerf priphrique (anesthsie tronculaire).
La pratique des blocs priphriques a t facilite par lutilisa-
tion des stimulateurs de nerfs qui permettent de reprer les
nerfs avant injection de lAL (ladministration dun courant lec-
trique de faible intensit permet de reprer le nerf par
la contraction des muscles quil innerve). Ces blocs priph-
riques peuvent, comme les blocs centraux, voir leur dure
daction prolonge par lutilisation dune injection continue ou
rpte par lintermdiaire dun cathter.
Parmi les nombreuses techniques disponibles, citons lanes-
thsie pribulbaire trs utilise pour la chirurgie ophtalmolo-
gique et les blocs cervicaux pour la chirurgie carotidienne.
Anesthsie locorgionale intraveineuse
Ladministration intraveineuse dAL se pratique surtout au
membre suprieur, aprs pose dun garrot artriel, mais elle est
actuellement de moins en moins utilise.
Indications. Les lments amenant choisir lALR plutt que
lanesthsie gnrale figurent dans le tableau 2.
Il est souvent considr (mais tort) que lALR est prfrable
lanesthsie gnrale chez les patients fragiles. En fait, les pro-
grs dans la ralisation de lanesthsie gnrale, la morbidit
spcifiquement lie lALR et la grande variabilit du terrain des
patients anesthsis expliquent probablement quaucun travail
na pu dmontrer de diffrence en termes de morbidit ou de
mortalit.
Du fait de son efficacit pour prendre en charge la douleur de
la femme enceinte lors de laccouchement, le nombre dactes
danalgsie pridurale a t multipli par 35 en 15 ans, pour
concerner actuellement plus de 50 % des accouchements raliss.
1
Chez lenfant, lALR et lanesthsie gnrale viennent en com-
plment lune de lautre pour assurer une prise en charge optimale
du stress chirurgical tant en termes de rponse physiologique
lagression tissulaire, quen termes de rponse psychologique
une situation anxiogne.
3
En dehors de lurgence, les consignes de
jene propratoire habituelles sappliquent lALR.
Contre-indications. En dehors des contre-indications des AL et
de leurs adjuvants, en particulier des solutions adrnalines,
elles tiennent aux risques de la ponction : troubles significatifs
de lhmostase et traitement anticoagulant. En effet, la surve-
nue dun hmatome primdullaire est une ventualit rare
mais dramatique. Linfection cutane au voisinage du point de
ponction est aussi une contre-indication. Lorsque lALR est
a priori refuse par le patient, qui prfre tre endormi com-
pltement , et que la balance bnfice/risque est largement en
faveur de lALR, les bnfices et les risques des deux techniques
doivent tre expliqus en dtail au patient.
ANESTHSIE GNRALE
1. Pharmacologie
Lanesthsie gnrale doit assurer une perte de conscience
(obtenue par les agents hypnotiques), une analgsie (assure
par les agents morphiniques) et limmobilit (utilisation si besoin
dagents myorelaxants ou curares).
Les posologies sont fonction du poids du patient (en tenant
compte dune ventuelle obsit), de lge (le grand ge
demande habituellement une rduction de la posologie), de
facteurs toxiques (alcool, drogues), de facteurs gntiques, de
la pathologie du patient (insuffisance cardiaque, respiratoire,
rnale ou hpatique, sepsis, myasthnie), de lintensit des
stimulus douloureux (provoqus par lintubation trachale ou
le geste chirurgical) et de la potentialisation par les agents de
la prmdication et les autres agents utiliss pour lanesthsie.
Ces agents sont liposolubles, ce qui leur permet datteindre
le systme nerveux central ( lexception des curares) et leur
limination est rnale, hpatique ou plasmatique (dans ce
dernier cas par les estrases qui entranent alors une limina-
tion rapide).
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Anesthsie locale, locorgionale et gnrale
Pourquoi prfrer une anesthsie
locorgionale une anesthsie
gnrale ? (daprs rf. 2)
Tableau 3
Du fait de
la localisation
anatomique de
lintervention :
chirurgie des membres ou du prine
chirurgie ophtalmologique
chirurgie de la carotide
cure de hernie inguinale
geste chirurgical priphrique ou superficiel
(chirurgie de la main)
Pour assurer une analgsie notamment postopratoire efficace
(chirurgie thoracique, chirurgie du genou ou de la hanche), facilitant
la rducation
Pour des indications spcifiques en fonction du geste chirurgical :
surveillance neurologique pendant une chirurgie carotidienne
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 544
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
545
Agents hypnotiques.
Agents intraveineux
Ltomidate est trs utilis pour linduction anesthsique et
cela malgr quelques effets indsirables (myoclonies, douleurs
linjection). Il en est de mme du propofol, y compris en anesth-
sie ambulatoire, du fait de son limination rapide. Il est utilis
souvent grce un dispositif objectif de concentration qui per-
met dobtenir des concentrations sriques entre 2 et 4 mg/L.
Ses effets vasodilatateurs peuvent entraner une hypotension
artrielle (il est contre-indiqu en prsence dun choc).
La ktamine entrane une libration de noradrnaline et
tend augmenter la pression artrielle et la frquence car-
diaque. Utilise seule, elle provoque une anesthsie qui peut
tre suivie dagitation et de dlire. Elle produit une analgsie,
une bronchodilatation et une hyperscrtion salivaire et bron-
chique. Elle peut tre utilise chez le sujet allergique. La kta-
mine est administre en association avec une benzodiazpine
pour rduire lincidence des effets psychiques et pour poten-
tialiser les agents analgsiques. Son usage itratif peut induire
une tachyphylaxie. Elle peut tre indique dans les tats
de choc et chez le brl. Elle est contre-indique en cas
dhypertension intracrnienne, dangor instable ou dun tat
psychique fragilis.
Les benzodiazpines (midazolam) sont utilises seules en
sdation ou pour potentialiser les autres agents en anesthsie.
La posologie du midazolam doit tre rduite chez le sujet g. Les
benzodiazpines ont des proprits anticonvulsives et amn-
siantes, sont contre-indiques en cas de myasthnie et sont anta-
gonises par ladministration intraveineuse de flumaznil.
Agents gazeux et volatils
Le protoxyde dazote (N2O) est un gaz anesthsique qui
possde aussi des proprits analgsiques. Sa faible puissance
daction oblige lutiliser concentration leve (minimum
50 % du mlange gazeux inspir). Il est aussi livr en bouteille,
mlang 50 % doxygne pour lanalgsie en aide mdicale
urgente, et pour les actes douloureux et de courte dure raliss
en dehors de la prsence dun anesthsiste. Le protoxyde
dazote est contre-indiqu en cas dhypoxmie et dpanche-
ment gazeux (pneumothorax, occlusion intestinale).
Les hypnotiques volatils, reprsents par les halogns, se
prsentent sous forme liquide et un vaporateur est nces-
saire. Une fraction des gaz envoys par la machine danesth-
sie vers le patient est constitue par la vapeur halogne.
Lvaporateur est plac entre la source de gaz et le ballon, quel
que soit le type de circuit (fig. 2). La ventilation mcanique est
gnralement ralise avec un respirateur permettant une
rinhalation (circuit ferm . Ainsi, les gaz expirs (oxygne
et gaz anesthsique) sont rinhals par le patient et ainsi co-
nomiss. Le CO2 expir est absorb par un dispositif compor-
tant de la chaux sode. Les halogns passent par le comparti-
ment sanguin pour tre distribus lorganisme (fig. 3). Leur
solubilit dans ce compartiment est llment dterminant de
leur cintique : moins ils sont solubles dans ce compartiment,
plus rapidement ils le saturent et atteignent leur effet maximal
au niveau crbral. Ainsi, si lon va du produit ayant le coefficient
de solubilit le plus faible (0,45) celui ayant le coefficient
le plus lev (2,5), on trouve successivement le desflurane,
le svoflurane, lisoflurane et lhalothane. Le monitorage de
la concentration tl-expiratoire permet dvaluer la concen-
tration crbrale.
Leur puissance est value par leur concentration alvolaire
minimale (CAM) qui permet de prvenir les mouvements lors de
lincision chirurgicale chez 50 % des patients. Elle diminue avec
lge, et bien sr avec ladministration dautres agents anesth-
siques. Les agents halogns sont trs utiliss, en particulier
pour linduction au masque. Ainsi, lorsquon ne dispose pas de
voie veineuse, on peut raliser linduction anesthsique par de
lhalothane ou du svoflurane (cas frquent chez le petit enfant).
Ces agents sont galement trs utiliss pour lentretien de
lanesthsie. Lisoflurane, le svoflurane et le desflurane sont
bien tolrs sur le plan hmodynamique, ninduisant quune
vasodilatation modre. Par contre, lhalothane peut provoquer
une dpression myocardique ou des troubles du rythme. Les
halogns sont contre-indiqus en cas dhypertension intracr-
nienne et peuvent dclencher une hyperthermie maligne chez
un patient ayant une susceptibilit gntique.
Les halogns arrivent au niveau pulmonaire avant
dtre distribus vers les diffrents compartiments.
Figure 3
Extraction CO2
chaux sode
patient Ballon
Le ballon est comprim 12 fois/min
Le volume envoy au patient est 7-10 mL/Kg (volume courant)
Une partie des gaz expirs est rcupre
CIRCUIT D'ANESTHSIE FERM
(avec rinhalation)
N2O (protoxyde d'azote) :
35-50 %
O2 : 35-50 %
Source de gaz frais
Tissus richement
vasculariss-cerveau
compartiment sanguin
Muscles
Halogn Poumons
Graisses
PHARMACOCINTIQUE DES HALOGNES
Figure 2
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 545
Analgsiques. Les agents analgsiques sont reprsents par
les drivs de la morphine. Les agonistes morphiniques sont peu
histamino-librateurs, ne sont pas dpresseurs myocardiques, ont
peu deffet sur le tonus vasculaire, mais ralentissent la frquence
cardiaque. Leurs effets secondaires principaux sont une dpres-
sion respiratoire, une rigidit thoracique et la possibilit de nau-
ses et vomissements. En salle de surveillance post-intervention-
nelle, la survenue dune dpression respiratoire accompagne de
myosis suggre un surdosage en morphinique et, outre les mesu-
res symptomatiques, impose lutilisation de naloxone. Les produits
utiliss pour linduction et lentretien de lanesthsie ont une demi-
vie dlimination allant de 3,7 h 9 min dans lordre suivant : fen-
tanyl, sufentanil, alfentanil et rmifentanil. Utiliss en administra-
tion continue, leur dlai dlimination aprs larrt de la perfusion
se raccourcit dans lordre suivant : fentanyl, alfentanil, sufentanil et
rmifentanil. Ce dernier a une dure daction trs brve et offre
une scurit demploi optimale.
Les morphiniques et les hypnotiques sont souvent associs,
permettant de rduire leurs posologies respectives. La morphine
est essentiellement utilise en analgsie postopratoire par voie
sous-cutane, ou intraveineuse par bolus de 1 2 mg chez ladulte,
complte ventuellement par un dispositif danalgsie contrle
par le patient (PCA). Des chelles permettent de quantifier la dou-
leur et de moduler lanalgsie (chelle visuelle analogique, EVA).
Curares. Les curares sont indispensables dans certaines
chirurgies (chirurgie abdominale) et facilitent lintubation tra-
chale. Les curares non dpolarisants sont les plus utiliss. Les
strodes les plus utiliss sont, par dure daction dcroissante :
le pancuronium, le vcuronium et le rocuronium. Les benzyliso-
quinolines sont, dans le mme ordre : latracurium, le cisatra-
curium et le mivacurium. Leur groupement ammonium quater-
naire peut dclencher des ractions anaphylactiques. Par
ailleurs, leur effet doit tre contrl par un moniteur de curari-
sation, en particulier en SSPI. Leur action peut tre antagonise
par la nostigmine laquelle on associe de latropine pour viter
bradycardie et hyperscrtion.
2. Ralisation de lanesthsie
Le contrle de la ventilation est plus souvent ralis par
lintubation trachale ncessitant une laryngoscopie. Celle-ci
provoque un stimulus nociceptif. Aussi, pour certaines interven-
tions peu invasives, le masque laryng autorise une ventilation
en pression positive et protge en partie les voies ariennes
dune ventuelle rgurgitation. La ventilation au masque nest
le plus souvent utilise que lors de la priode dinduction ou
pour des anesthsies courtes. Le monitorage de la profondeur
de lanesthsie est essentiellement clinique avec lobservation
du patient et des paramtres hmodynamiques. Cependant, ces
derniers peuvent tre trompeurs chez un patient en tat de choc
ou recevant des mdicaments diminuant la frquence cardiaque
ou la pression artrielle. Aussi, llectro-encphalogramme
bispectral (BIS) est-il actuellement propos pour surveiller
la profondeur de lanesthsie.
RISQUES ANESTHSIQUES
Le risque peranesthsique est major au moment de linduc-
tion, tant en anesthsie gnrale quen ALR, en particulier lors
de lanesthsie neuraxiale. Le risque post-anesthsique est
majeur puisque 42 % des complications surviennent pendant
la priode de rveil et entranent le dcs dans 37 % des cas,
contre 16 % en salle dopration (v. Pour approfondir).
Les causes respiratoires et cardiaques peuvent entraner
le dcs ou des dommages crbraux. Lanalyse des poursuites
judiciaires aux tats-Unis durant les 30 dernires annes mon-
tre une rgression des dcs et des dommages crbraux (fig. 4).
Cela est rapprocher de lutilisation systmatique de loxymtre
de pouls et de la capnographie en anesthsie gnrale.
Les vnements les plus frquents concernant les causes
respiratoires
4
sont une ventilation inadquate, une intubation
sophagienne et une intubation trachale difficile. Les autres
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
546
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Anesthsie locale, locorgionale et gnrale
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
41 %*
32 %
12 %
16 %
22 %*
9 %*
18 %*
15 %* 15 %
Dcs
Lsion crbrale
Lsion nerveuse priphrique
1970-79
n = 674
1980-89
n = 2904
1990-94
n = 783
N = 4 459 plaintes
% des plaintes totales durant la priode donne
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
56 %
49 %*
19 %
6 %
38 %*
25 %*
9 %*
13 %
7 %
Accidents respiratoires
Accidents vasculaires
Problmes d'quipements
1970-79
n = 674
1980-89
n = 2904
1990-94
n = 783
N = 4 459 plaintes
volution des causes de dcs et lsions crbrales
Incidence des dcs, dommages crbraux et lsions
nerveuses priphriques en pourcentage des plaintes totales
aux USA. On assiste un rduction des plaintes pour dcs
et dommages crbraux entre 1970 1979 et 1990 1994
(*P 0,01, Z test) (daprs rf. 4).
Figure 4
Incidence des accidents respiratoires, cardiovasculaires
et lis aux quipements en pourcentage des plaintes totales
pour dcs et dommages crbraux aux USA (*P 0,05, Z test)
(comparaison avec 1970-1979) (daprs rf. 4).
Figure 5
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 546
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
causes sont le bronchospasme et linhalation du contenu
gastrique.
Alors que les causes respiratoires sont en diminution, les causes
cardiovasculaires semblent en augmentation (fig. 5). Cette
tendance peut reflter plus de prcisions dans le diagnostic de
lvnement initial permis par le monitorage, les caractris-
tiques du patient ou dautres facteurs. Chez le coronarien, ces
vnements sont surtout reprsents par les infarctus myocar-
diques dont la gravit est majore par rapport aux infarctus non
anesthsiques. Ils surviennent le plus souvent dans les 3 pre-
miers jours post-anesthsiques. Leur prvention passe par
la stabilisation de la frquence cardiaque et de la pression art-
rielle en phase pri-anesthsique et par la dtection et le traite-
ment prcoces des pisodes ischmiques myocardiques. Daut-
res cardiopathies peuvent tre responsables dincidents
pri-anesthsiques : insuffisance cardiaque, valvulopathie, cardio-
myopathie hypertrophique, troubles de la conduction.
Les accidents neurologiques centraux peuvent tre la cons-
quence dune anoxie. Des cphales peuvent survenir aprs
rachianesthsie, notamment chez les sujets jeunes. Les acci-
dents vasculaires crbraux surviennent gnralement sur un
terrain athromateux. Les accidents neurologiques priph-
riques aprs anesthsie gnrale peuvent tre lis un problme
de posture ventuellement favoris par des lsions osto-articu-
laires prexistantes. Aprs ALR, les lsions nerveuses peuvent
tre lies des accidents de ponction ou des lsions mdul-
laires type dhmatome intrarachidien, ventuellement favori-
ses par une hypocoagulabilit. La plupart des atteintes du nerf
cubital et du plexus brachial semblent survenir malgr un posi-
tionnement et une protection adquats, ce qui suggre que leur
mcanisme demeure insuffisamment connu, et peut expliquer
labsence de diminution des plaintes pour ces lsions (fig. 4).
Lhypothermie peranesthsique non intentionnelle peut
favoriser certaines complications cardiaques, hmorragiques et
infectieuses. Lhyperthermie maligne est beaucoup plus rare
mais grave (v. Pour approfondir).
Les accidents mdicamenteux sont reprsents par les
allergies, en particulier aux curares, latex et antibiotiques.
Un choc anaphylactique, un dme de Quincke, un bron-
chospasme ou un rythme en sont les manifestations les plus
frquentes. La toxicit directe des mdicaments peut se rencon-
trer lors de surdosage, derreur de site dinjection ou de seringue,
et plus rarement lors des hpatites lies lhalothane. Les acci-
dents dentaires sont les plus frquents. Les accidents de catht-
risme peuvent survenir lors de ponction artrielle ou veineuse. B
POUR EN SAVOIR PLUS
Complications des abords veineux
Level C, Bernardy A, Pillet O, Favarel-Garrigues JC
Rev Prat 1998 ; 48 : 919-23
Aspects juridiques et contentieux de lanesthsie
Lienhart A
Rev Prat 2001 ; 51 : 836-40
Prise en charge de la douleur postopratoire chez ladulte
et lenfant.
Confrence de consensus.
Anaes 1997 (http://www.anaes.fr)
Recommandations concernant la pratique de lanalgsie
obsttricale.
SFAR 1992 (http://www.sfar.org)
Recommandations pour la pratique clinique. Les blocs
priphriques des membres chez ladulte.
SFAR 2002 (http://www.sfar.org)
Confrence dexperts. Pratique des anesthsies locales et
locorgionales par des mdecins non spcialiss en anesthsie
ranimation dans le cadre des urgences.
SFAR, SAMU de France
SFMU 2002 (http://www.sfar.org)
547
Pour approfondir
Lhyperthermie maligne
Elle est lie une intolrance dorigine
gntique certains agents anesthsiques
(halogns, succinylcholine). Sa survenue
demande un traitement urgent par
dantrolne (prsence obligatoire dans
tous les sites anesthsiques) et une
enqute familiale avecbiopsie musculaire et
test la cafine.
pidmiologie des accidents
anesthsiques
En France, daprs les rapports dactivit
du groupement des assureurs mdicaux,
304 dossiers danesthsie-ranimation
ont t traits, ayant donn lieu
condamnation, indemnisation ou trans-
action dans 93 cas dont 78 hors tribunal
de 1996 1998. Si lon considre les
indemni-sations verses par lAssistance
publique-Hpitaux de Paris entre 1977 et
1994, on ne retrouve que 7 affaires en
rapport avec lanesthsie contre 136
affaires en rapport avec la chirurgie.
Par contre, les affaires en rapport avec
lanesthsie entranent des indemnisations
significativement plus importantes en
comparaison avec la chirurgie. Enfin,
lenqute mortalit ralise par
la Socit franaise danesthsie et
de ranimation en 2002 confirme
la diminution du nombre daccidents
lis lanesthsie (probablement en
relation avec les textes rglementaires
parus en 1994 et 1995 qui ont
notablement amlior les conditions
de prise en charge des patients soumis
une anesthsie gnrale ou locorgionale).
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 547
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
548
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
A / VRAI OU FAUX ?
Lanesthsie gnrale est rgie en
France par un dcret de 1994.
Lanesthsie locorgionale est rgie
en France par un dcret de 1994.
Lanesthsie locale est rgie en
France par un dcret de 1994.
B / VRAI OU FAUX ?
La dose des agents anesthsiques
doit tre adapte lge.
1
3
2
1
Lanesthsie ambulatoire est rgie
par des impratifs particuliers.
Les anesthsistes-ranimateurs
doivent connatre la mdecine
priopratoire.
C / QCM
Parmi les monitorages suivants,
lesquels sont obligatoires pour une
anesthsie gnrale ?
Capnographie.
1
3
2
Saturomtre de pouls.
LECG continu.
Un appareil de mesure de pression
artrielle non invasive.
Un analyseur de concentration en
oxygne.
5
4
3
2
M I N I T E S T D E L E C T U R E
R p o n s e s : A : V , V , F / B : V , V , V / C : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 .
DEJ PARU DANS LA REVUE
Anesthsie
Monographie
(Rev Prat 2001 ; 51 [8] : 827-70)
POINTS FORTS
> Les anesthsies locales et locorgionales amnent les
anesthsiques locaux au contact des structures
nerveuses (moelle et nerfs priphriques), inhibent les
canaux sodiques et la conduction nerveuse. Il sensuit
un bloc sensitif, moteur et ventuellement sympathique.
> Lors dune anesthsie gnrale, les agents hypnotiques
et analgsiques se potentialisent. Leur posologie doit
tre adapte ltat physiologique du patient.
Lutilisation des myorelaxants nest pas systmatique
en raison du risque allergique.
> Pour les anesthsies locorgionales et gnrales,
un monitorage minimal est ncessaire, ainsi que
la surveillance en salle de soins post-interventionnelle
par un personnel form.
retenir
Anesthsie locale, locorgionale et gnrale
1. Organisation et techniques
de lanesthsie.
Laxenaire MC, Auroy Y, Clergue F,
Pquinot F, Jougla E, Lienhart A
Ann Fr Anesth Reanim 1998 ;
17 : 1317-23
2. Anesthsie locorgionale
Bonnet F, De Montblanc J,
Houhou A
Rev Prat 2001 ; 51 : 846-50
3. Anesthsie locorgionale
chez lenfant
Confrence dexperts
Ann Fr Anesth Reanim 1997; 16 : 2-7.
4. What have we learned, how
has it affected practice, and
how will it affect practice in
the future?
Cheney GW
Anesthesiology 1999 ; 91 : 552-6
R F R E N C E S
A / VRAI OU FAUX ?
Les cancers sont la premire cause
de mortalit, avant 65 ans, chez les
hommes comme chez les femmes.
Une enqute pidmiologique de
bonne qualit permet de dmontrer
quune exposition un facteur (par
exemple une pollution chimique) est
la cause dune augmentation dinci-
dence dun cancer donn.
Les facteurs de risque exognes
actuellement identifis sont beaucoup
plus lis des styles de vie qu
la pollution de notre environnement.
3
2
1
B / VRAI OU FAUX ?
Chez les hommes, en France, la plus
grande proportion de cancers est
attribuable lalimentation.
Il est possible de prvenir les can-
cers du sein.
Le dpistage des cancers de
la prostate nest pas efficace.
C / QCM
Parmi les actions prventives suivantes,
quelles sont celles dont lefficacit est
dmontre* pour la rduction de la mor-
talit par cancer.
3
2
1
Arrter de fumer.
Rduire son poids.
Prendre une supplmentation en
b-carotne.
Supprimer les expositions lamiante.
Dpister les cancers du col de lutrus.
Manger des fruits et des lgumes.
Rduire les gaz des voitures.
Supprimer les centrales nuclaires.
8
7
6
5
4
3
2
1
M I N I T E S T D E L E C T U R E
R
p
o
n
s
e
s
:
A
:
V
,
F
,
V
/
B
:
F
,
F
,
V
/
C
:
1
,
2
,
4
,
5
,
6
.
* (ou fortement probable)
QUESTION 139 (v. p. 549)
ref05/04_LeHot_539 25/03/04 13:34 Page 548
Neurologie
Partie I Module 6 Q 65
VOIES ET CENTRES NERVEUX
DE LA NOCICEPTION
Les systmes sensitifs et sensoriels ont pour rle din-
former les centres nerveux de ltat de lenvironnement
extrieur et du milieu intrieur. Ainsi, la sensibilit
douloureuse ou nociception met en jeu des structures
anatomiques permettant de dtecter, percevoir et ragir
des stimulations potentiellement nocives. Ces dernires
crent un message nociceptif qui est transmis des
rcepteurs priphriques aux centres nerveux suprieurs
sous la forme dun influx nerveux franchissant plusieurs
relais. Des systmes de rgulation inhibiteurs et facilita-
teurs modulent ce message nociceptif en permanence.
La notion de douleur comporte 3 composantes sensori-
discriminative, affective et cognitive lies larrive
du message nociceptif dans le cortex somesthesique,
prfrontal et limbique.
Voies anatomiques
Elles sont dcrites successivement de la priphrie
jusquaux centres suprieurs.
1. Nocicepteurs
Ils sont retrouvs aux niveaux cutan, musculaire,
articulaire et viscral.
Ce sont des terminaisons libres de fibres nerveuses
sensibles une stimulation nociceptive, cest--dire de
forte intensit. Les nocicepteurs sont de 2 types :
les mcano-nocicepteurs sont des terminaisons qui
rpondent des stimulations mcaniques intenses;
les nocicepteurs polymodaux sont des terminaisons
qui rpondent des stimulus mcaniques intenses,
thermiques (< 18 C, > 45 C) et (ou) chimiques (de
substances algognes ).
Ils assurent la transduction qui est la transformation du
message nociceptif en influx nerveux.
2. Fibres priphriques
Linflux nerveux nociceptif emprunte dans les nerfs
sensitifs 2 types de fibres.
Les fibres mylinises A, de faible calibre, assurent
une conduction nerveuse de 4 30 m/s responsable
dune douleur rapide, prcise valeur localisatrice.
I
l existe 2 types de douleur : la douleur aigu ou
douleur-symptme, qui est une alerte devant une
agression et qui constitue un guide pour le diagnostic
tiologique ; la douleur chronique ou douleur-maladie
qui, en puisant le patient, devient une vritable maladie
en elle-mme.
Bases neuro-physiologiques
et valuation dune douleur
aigu et chronique
Les fibres nerveuses A transmettent
une douleur rapide, prcise, valeur localisatrice
tandis que les fibres nerveuses C transmettent
une douleur retarde, sourde et moins localise.
Le message douloureux est soumis constamment
des modulations, principalement au niveau
de la corne dorsale de la moelle.
Les voies cordonales dorsales et lemniscales
exercent un contrle inhibiteur sur les voies
extralemniscales spino-rticulothalamiques.
Les voies descendantes bulbo-spinales
inhibitrices de la transmission nociceptive
sont neurotransmission noradrnergique
et srotoninergique.
Lanatomophysiologie classe les douleurs
en douleurs par excs de nociception
et douleurs neuropathiques, ces dernires
tant secondaires des lsions
des voies nerveuses.
Une douleur entretenue entrane un cercle
vicieux physiologique et neurochimique
pouvant la rendre chronique do la ncessit
dun traitement prcoce de la douleur.
Points Forts comprendre
Dr Joseph MAARRAWI,
Dr Patrick MERTENS, Pr Marc SINDOU
L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 3 , 5 3
453
Service de neurochirurgie A
Hpital Pierre-Wertheimer
69394 Lyon Cedex 03
josephmaarrawi@aol.com
ref_sindou 10/02/03 10:07 Page 453
Les fibres C, non mylinises, assurent une conduction
nerveuse infrieure 2 m/s responsable dune douleur
retarde, sourde et moins localise.
3. Corne dorsale spinale
Linflux nerveux nociceptif transite par les cellules
bipolaires du ganglion rachidien (protoneurone), situ
au niveau de la racine dorsale du nerf spinal qui se
connecte dans la corne dorsale de la moelle avec le deu-
toneurone (neurone situ dans les couches I V de
Rexed). Au niveau de la zone dentre de la racine
dorsale dans la moelle (DREZ pour dorsal root entry zone),
il existe une organisation spatiale des fibres sensitives :
les fibres fines nociceptives se placent dans la rgion
ventro-latrale de cette zone pour se rendre travers le
tractus de Lissauer aux couches superficielles de la
corne dorsale. Les fibres destine cordonale dorsale se
disposent dans la rgion dorso-mdiane.
Il existe des collatrales des protoneurones qui entrent
en contact avec la colonne vgtative de la moelle et la
corne antrieure, responsables des ractions vgtatives
et motrices la douleur.
4. Voies ascendantes
Les axones des neurones nociceptifs de la corne dorsale
croisent la ligne mdiane (dcussation) et se dirigent
vers le cordon ventrolatral controlatral de la moelle
pour former le faisceau spino-rticulo-thalamique. Ce
dernier se divise en 2 contingents.
Dans le contingent superficiel et latral, le faisceau
nospinothalamique conduction rapide, paucisynaptique
(peu de synapses) et organisation somatotopique se projette
sur le noyau somesthsique ventro-latral du thalamus.
Dans le contingent profond et mdial, le faisceau
palospino-rticulothalamique, conduction lente, avec
de nombreux relais synaptiques et sans organisation
somatotopique se projette largement et bilatralement
au niveau de la rticule du tronc crbral.
Dautres voies transmettant le message nociceptif en
dehors du faisceau spino-rticulo-thalamique ont t
mises en vidence mais seulement chez lanimal : faisceau
spino-cervico-thalamique, conduction post-synaptique
du cordon dorsal, faisceau spino-hypothalamique
5. Centres suprieurs
Au niveau du thalamus, le faisceau nospinothalamique
se projette dans le noyau ventro-postro-latral, rejoignant
la voie lemniscale. Le faisceau palospino-rticulo-
thalamique se projette dans les noyaux mdians intra-
laminaires qui constituent un prolongement de la substance
rticule.
Les projections crbrales sont les suivantes :
les projections de la voie no-spinothalamique se font
dans le cortex sensitif du gyrus parital post-central
assurant la composante sensori-discriminative de la
douleur. Il a t suggr rcemment, daprs des
tudes dimagerie fonctionnelle et denregistrements
intracrbraux, quun cortex somesthsique recevant
des informations nociceptives se situe au niveau de la
partie postro-suprieure de linsula ;
le contingent palo-spino-rticulo-thalamique se pro-
jette au niveau de la rticule de faon diffuse gn-
rant une raction dveil. ce niveau, se font des
synapses avec les noyaux des nerfs crniens et les
centres vgtatifs du tronc. Par la suite, les projections
se font vers les noyaux mdians du thalamus pour
gagner ensuite : lhypothalamus une voie directe
spino-hypothalamique est envisage (raction vgta-
tive de la douleur) ; le striatum (ractions motrices
automatiques et semi-automatiques la douleur) ; le
cortex prfrontal (sensation de souffrance soutenant la
composante affective) ; le cortex limbique (mmorisation
et gense de comportements de protection assurant la
composante cognitivo-comportementale).
ltage encphalique, il y a une interaction entre les
projections nociceptives et les autres fonctions corticales
et sous-corticales : lanticipation (attention dirige vers
la douleur) de la douleur ou lanxit majorent le vcu
douloureux alors que la distraction (attention dirige
ailleurs) a un effet inverse. Le stress induit une analgsie
probablement par mdiation endorphinique. Des observations
cliniques en pathologie humaine ont permis dobserver
la recrudescence de douleurs anciennes (ractivation
cognitive) dans certaines atteintes neurologiques centrales.
Mcanismes de contrle
Le message nociceptif est constamment modul, de telle
faon quun mme stimulus nociceptif est peru diff-
remment chez le mme sujet en fonction de ltat de
modulation un moment donn. Ces systmes de
contrle et de rgulation sont, dans ltat actuel des
connaissances, les suivants.
Dans le systme de porte (gate control) spinal, les
fibres mylinises de gros calibre A exercent une
action inhibitrice sur les informations nociceptives par
lintermdiaire de collatrales nes aussitt aprs leur
entre dans la moelle et destines la corne dorsale.
Le systme endorphinique spinal est constitu par de
petits interneurones endorphiniques dont la mise en jeu
provoque une inhibition puissante de la nociception
dans la corne dorsale.
Des voies descendantes inhibitrices prennent naissance
essentiellement dans la partie rostroventrale du bulbe et
descendent en direction de la corne dorsale o elles
exercent leurs actions inhibitrices par lintermdiaire
dune libration de srotonine ou de noradrnaline dans
la corne dorsale.
Dans le systme inhibiteur thalamique, le noyau reti-
cularis thalamique semble inhiber les voies nociceptives.
Le systme de contrles inhibiteurs diffus a pour but
de mettre en relief un message nociceptif en augmentant
le rapport stimulus sur bruit de fond par inhibition de
tous les autres messages.
Face cette conception de 2 grands systmes anatomiques,
lun vhiculant les influx douloureux, lautre charg de leur
contrle, il est facile de comprendre quil existe 2 princi-
paux types de douleur : douleurs par excs de nociception
par hyperstimulation du systme nociceptif et douleurs
neuropathiques par atteinte des voies nerveuses.
B AS E S NE URO- P HYS I OL OGI QUE S E T VAL UAT I ON D UNE DOUL E UR AI GU E T CHRONI QUE
L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 3 , 5 3
454
ref_sindou 10/02/03 10:07 Page 454
diffusant linformation douloureuse aux mtamres voisins.
La corne dorsale est le sige dune modulation importante
du message nociceptif illustre par la thorie du portillon
qui a t initialement dcrite par Melzack et Wall (fig. 1).
Les voies lemniscales (cordonales dorsales) exercent un
contrle inhibiteur sur les voies extralemniscales spino-
thalamiques. Ainsi, les fibres A envoient des collatrales
inhibitrices vers les neurones convergents de la voie spino-
thalamique. Cette inhibition est, semble-t-il, mdie par
des interneurones GABA-ergiques et glycinergiques.
Selon la prdominance des influx excitateurs ou inhibiteurs,
la porte est ouverte ou ferme et le message nociceptif
franchit ou non ce portillon. La neurostimulation trans-
cutane ou mdullaire haute frquence et faible intensit
dans le traitement de certains types de douleur a ainsi
pour but de fermer la porte de la corne dorsale.
Au niveau de la corne dorsale, existe une convergence de
projection des fibres affrentes primaires en provenance
de la peau, des muscles, des articulations et des viscres
sur le mme neurone (fig. 2). Comme le cerveau possde
une meilleure reprsentation somatotopique pour la
peau que pour les tissus et organes situs en profondeur,
ce phnomne de convergence aboutit une sensation de
MCANISMES NEUROPHYSIOLOGIQUES
ET NEUROCHIMIQUES DE LA NOCICEPTION
Naissance du message douloureux
La transduction est la transformation dun stimulus
caractre nociceptif en influx nerveux par les noci-
cepteurs priphriques dont lactivation se fait de 2 faons :
directe par le stimulus et indirecte par des facteurs chimiques
appels aussi substances algognes. Ces dernires consti-
tuent la soupe priphrique . Elles sont de 3 types :
excitatrices (srotonine, histamine, interleukines, K+) ;
sensibilisatrices rendant les nocicepteurs plus excitables
(substance P, prostaglandine, leucotrines) ; mixtes
(bradykinine). Leur origine est multiple : tissus pri-
phriques, plasma et fibres nerveuses. Ces substances
constituent la cible pharmacologique de certains antalgiques
dutilisation courante comme les anti-inflammatoires
non strodiens dont laction serait dinhiber la synthse
des prostaglandines. Leur multiplicit rend compte de la
difficult trouver un seul mdicament qui soit capable
de bloquer compltement la transduction.
Ces nocicepteurs possdent plusieurs proprits : seuil
dactivation lev, dcharge (production dinflux nerveux)
proportionnelle lintensit du stimulus et phnomne
de sensibilisation. Ce dernier phnomne, rsultant de
laction de la soupe priphrique sur les nocicepteurs,
aboutit une diminution de leur seuil, une augmentation
de la frquence de leur dcharge et une apparition de
dcharges spontanes (sans stimulus). Des nocicepteurs
silencieux peuvent tre activs par une stimulation noci-
ceptive prolonge. Donc, une douleur entretenue aboutit
une modification ds la priphrie de la transmission
nociceptive dans le sens dune facilitation et dune exa-
gration, do lintrt pratique dun traitement prcoce
de la douleur pour viter ces phnomnes.
La stimulation rpte des fibres nerveuses provoque au
niveau de leurs collatrales une libration rtrograde (en
priphrie) de neurotransmetteurs comme la substance P
et des substances algognes. Ce rflexe classiquement
dit daxone (en fait de dendrite), traduit par une vaso-
dilatation locale, induit une inflammation neurogne
participant ainsi au cercle vicieux damplification du
message douloureux en tache dhuile .
Modulation au niveau de la corne
dorsale de la moelle
Le 1
er
relais des voies nociceptives seffectue au niveau
de la corne dorsale, l o le message douloureux subit
une modulation importante. Ainsi, les axones des fibres
affrentes primaires (FAP) nociceptives font relais soit
avec des neurones nociceptifs spcifiques (principalement
couche I) qui ne dchargent qu partir dun certain
seuil, soit avec des neurones nociceptifs non spcifiques
(principalement couches V ou VI) qui accroissent leurs
dcharges en fonction de lintensit du stimulus.
Les fibres affrentes primaires nociceptives envoient des
collatrales aux tages sus- et sous-jacents (1 2 niveaux
de chaque ct) formant ainsi le tractus de Lissauer et
Neurologie
L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 3 , 5 3
455
Contrles centraux
+
+
Neurone
convergent
Fibres A
Fibres A et C
V
o
i
e
s
p
i
n
o
-
r
t
i
c
u
l
o
t
h
a
l
a
m
i
q
u
e
+
+ +
Thorie de la porte.
1
Convergence des fibres affrentes primaires au niveau de
la corne dorsale.
2
Peau
Muscle
Vaisseau
ref_sindou 10/02/03 10:07 Page 455
douleur dans le territoire cutan du neurone convergent,
innervant un viscre malade et expliquant les douleurs
rfres: douleur ressentie au territoire C8 de linfarctus
du myocarde, douleur lpaule droite de la cholcystite,
douleur au point de McBurney de lappendicite, dorsalgies
de la pancratite
Quant aux mcanismes neurochimiques (fig. 3), la
substance P a t longtemps considre comme tant
le neurotransmetteur de la douleur. En ralit, la neuro-
transmission nociceptive de la corne dorsale fait intervenir
bien dautres mdiateurs, en particulier les acides amins
excitateurs : le glutamate et laspartate qui agissent sur
les rcepteurs post-synaptiques AMPA (-amino-
3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate acid) et
N-mthyl-D-aspartate. La substance P agit sur son
rcepteur NK1. La neurotransmission ce niveau est
soumise un phnomne de sensibilisation qui facilite
et amplifie le message nociceptif aboutissant une
hyperalgsie secondaire. Il existe une coopration entre
les divers neurotransmetteurs, par interaction entre leurs
rcepteurs en particulier entre le rcepteur NK1 et le
rcepteur AMPA dune part et le rcepteur N-mthyl-D-
aspartate dautre part. Des stimulations rptes induisent
un cercle vicieux faisant intervenir les prostaglandines
et le monoxyde dazote qui renforcent la libration
dacides amins excitateurs. Un intrt pratique de cette
neurochimie de la corne dorsale est la dcouverte dun
antagoniste du rcepteur N-mthyl-D-aspartate, la
ktamine, qui est un produit antalgique puissant utilis
en anesthsie.
Au niveau de la corne dorsale comme en priphrie, une
stimulation nociceptive continue induit un cercle vicieux
avec une baisse du seuil de dcharge des neurones noci-
ceptifs et une augmentation de leurs champs rcepteurs
priphriques, do lintrt dun traitement prcoce
pour viter lhyperalgsie (excs de perception doulou-
reuse) secondaire.
Dans la corne dorsale, les interneurones endorphiniques
agissent sur les rcepteurs morphiniques , et qui
sont retrouvs aux niveaux pr- et post-synaptique des
fibres affrentes primaires nociceptives. Leur effet est
une inhibition puissante de la transmission du message
nociceptif par diminution du calcium (Ca++) intra-
cellulaire prsynaptique bloquant ainsi la libration de
neuromdiateurs et par inhibition des canaux sodiques et
stimulation des canaux potassiques en post-synaptique
induisant ainsi une hyperpolarisation inhibant la trans-
mission nociceptive. Ladministration intrathcale de
morphine travers un cathter reli une pompe constitue
une modalit thrapeutique dans certains types de douleurs
chroniques surtout cancreuses.
Contrle thalamique
Au niveau du relais thalamique, une modulation du message
douloureux se fait par le biais du noyau reticularis situ
en priphrie latrale du thalamus. Ainsi, il a t dcrit
une boucle comportant une voie thalamo-corticale, puis
une voie de rtrocontrle cortico-thalamique vers le
noyau reticularis qui exerce un effet inhibiteur sur la
voie nociceptive ascendante par le biais dinterneurones
GABA-ergiques. Leffet antalgique de la neurostimulation
corticale, utilise dans le traitement de certaines douleurs,
peut tre d en partie cette voie inhibitrice.
B AS E S NE URO- P HYS I OL OGI QUE S E T VAL UAT I ON D UNE DOUL E UR AI GU E T CHRONI QUE
L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 3 , 5 3
456
Mcanismes neurochimiques de la douleur.
3
STIMULUS NOCICEPTIFS
(mcaniques, thermiques,
chimiques)
LSIONS TISSULAIRES
Stimulation des nocicepteurs
(terminaisons libres)
Abaissement du seuil
des terminaisons libres et adjacentes
Libration du K+ intracellulaire
}
Libration de prostaglandines E
Libration damines (histamine, srotonine)
Formation de bradykinines (sous laction
de protases et d
2
globulines plasmatiques)
SENSITIZATION
INFLAMMATION
ref_sindou 10/02/03 10:07 Page 456
MCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES
DES DOULEURS CHRONIQUES
Si lon carte les douleurs psychognes qui sont le plus
souvent une sommation entre une pine irritative
organique (souvent peu grave) et des phnomnes dam-
plification psychologique, les douleurs chroniques
comportent les douleurs par excs de nociception et les
douleurs neuropathiques.
Douleurs par excs de nociception
Lhyperalgsie primaire correspond une ampli-
fication priphrique du message nociceptif qui est due
une augmentation de dcharges des nocicepteurs
(amplification de leurs rponses aux stimulus doulou-
reux), un abaissement de leurs seuils de dclenche-
ment et un cercle vicieux de la neurochimie priph-
rique qui provoque une libration accrue de mdiateurs
avec leurs effets excitateurs et sensibilisateurs (sur les
nocicepteurs).
Le rflexe de dendrite (dit daxone ), dclench
par la stimulation rpte des fibres affrentes primaires
nociceptives, induit une inflammation neurogne
priphrique due aux substances scrtes en priphrie
par les fibres nerveuses nociceptives de faon rtro-
grade : substance P (SP), CGRP (calcitonine gene related
peptide) Ces substances renforcent le cercle vicieux
priphrique.
Le systme nerveux sympathique peut participer
lentretien de certains types de douleurs par le biais de la
scrtion de noradrnaline. En effet, il a t dmontr
que la stimulation rpte des fibres affrentes primaires
nociceptives provoque leur niveau une augmentation
des rcepteurs la noradrnaline, ce qui les rend plus
sensibles cette dernire. Deux entits ont t dcrites
pour lesquelles le systme nerveux sympathique joue un
rle physiopathologique : les complex regional pain
syndrome de types I et II. Le type I correspond lalgo-
dystrophie et le type II la causalgie. Ce sont des
syndromes o la douleur, de type brlure, saccompagne
de troubles vasomoteurs ainsi que de troubles de la
sudation et de troubles trophiques.
La contraction motrice rflexe la douleur aggrave
les phnomnes douloureux. Larc rflexe se fait entre les
collatrales des fibres affrentes primaires nociceptives
et la corne ventrale de la moelle.
Lhyperalgsie centrale est lie la douleur chronique
qui entrane une augmentation de la dcharge des neurones
convergents spinaux, un abaissement de leurs seuils de
rponse et une augmentation de leurs champs rcepteurs.
Ces phnomnes sont surtout dus au cercle vicieux de la
neurochimie de la corne dorsale faisant intervenir les
rcepteurs N-mthyl-D-aspartate (NMDA). De mme,
laugmentation post-synaptique dions calcium aboutit
des changements gniques crant ainsi une modification
durable des neurones convergents.
Contrle descendant inhibiteur (fig. 4)
Ce sont les voies bulbospinales prenant naissance au
niveau de la partie rostro-ventrale du bulbe et sous le
contrle de la substance grise pri-aqueducale. Ainsi
cette dernire, neurotransmission opiodergique, stimule
les noyaux de la partie rostro-ventrale du bulbe qui
leur tour inhibent la transmission nociceptive de la corne
dorsale par des projections bulbo-spinales dont la neuro-
transmission est essentiellement noradrnergique et
srotoninergique. Les noyaux de la partie rostro-ventrale
du bulbe qui sont impliqus sont : le noyau raph magnus,
les noyaux gigantocellulaire et para-gigantocellulaire, le
locus cruleus et le locus sub-cruleus. Cette voie des-
cendante inhibitrice reprsente une cible thrapeutique
dans certains types de douleurs neuropathiques : ainsi,
les antidpresseurs (tricycliques) inhibiteurs de la recapture
de la srotonine et de la noradrnaline exercent leurs effets
antalgiques par le biais du renforcement de cette voie.
Contrles inhibiteurs diffus
Cest un systme dont la finalit est dextraire le message
nociceptif des autres stimulus permettant de le mettre en
relief. Le principe est celui dune augmentation du rapport
stimulus sur bruit de fond en inhibant les autres messages.
Ainsi, une douleur en teint une autre et la plus intense
est la mieux perue. Celle de moindre intensit est perue
lorsque la 1
re
est contrle. Ce systme est sous la dpen-
dance du noyau subreticularis dorsalis du bulbe. La morphine
inhibe ce systme, par consquent son effet antalgique
supprime le phnomne de mise en relief de la douleur.
Neurologie
L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 3 , 5 3
457
Contrle descendant inhibiteur de la nociception.
4
NDR
NRM
NGC
PS RT
A-C
A
TDL
LC
?
+
+
+
+
Sites opiacs
endomorphines
Pdoncule
Pont
Bulbe
ref_sindou 10/02/03 10:07 Page 457
Douleurs neuropathiques
Ces douleurs sont conscutives une lsion du systme
nerveux soit priphrique, soit central. Plusieurs mca-
nismes physiopathologiques ont t incrimins.
Les dcharges ectopiques sont des influx nerveux qui
prennent naissance au niveau des fibres nerveuses
lses, par prolifration anormale des canaux ioniques
rendant ainsi la dpolarisation de ces neurones plus
facile et mme spontane sans stimulus priphrique.
La prolifration anormale des rcepteurs adrner-
giques (type 1) au niveau des fibres affrentes primaires
nociceptives les rend plus sensibles la noradrnaline
expliquant les douleurs mdies par le systme sympa-
thique.
Latteinte des grosses fibres A qui normalement
ferment la porte au niveau de la corne dorsale (gate
control) aboutit une porte ouverte qui par cons-
quent facilite la transmission nociceptive, expliquant
ainsi certains types de douleurs neuropathiques.
Les phapses sont des nosynapses, cest--dire des
connexions aberrantes entre fibres au niveau des zones
lses du systme nerveux. Cela explique certains types
dallodynie qui correspondent la perception comme
douloureuse dune stimulation priphrique normale-
ment non douloureuse.
La neurochimie de la corne dorsale joue un rle. La
stimulation des rcepteurs N-mthyl-D-aspartate, ainsi
que la scrtion anormale de prostaglandines et de
monoxyde dazote entretiennent un cercle vicieux de
transmission nociceptive exagre.
Au niveau crbral, les mcanismes damplification
nociceptive, devant tre galement prsents, sont
actuellement moins bien connus.
VALUATION DE LA DOULEUR
Dfinie de faon simplifie dans le dictionnaire Robert
comme tant une sensation pnible en un point ou une
rgion du corps , la douleur , selon la dfinition de lIASP
(International Association for the Study of Pain) est
lexpression dune exprience sensorielle et motionnelle
dsagrable lie une pathologie tissulaire existante ou
potentielle ou dcrite en termes de telles lsions .
La prise en charge de la douleur ncessite une valuation
rigoureuse. La douleur aigu, protectrice, est le reflet
dune pathologie sous-jacente : les modalits sensorielles,
la topographie et lintensit orientent vers une lsion
tissulaire permettant ainsi un diagnostic et un traitement
tiologiques. La douleur chronique, quant elle, prsente
un caractre polymorphe : elle a des mcanismes gn-
rateurs qui peuvent tre diffrents, nest perue qu travers
la subjectivit dun patient qui souffre, est influence
par des facteurs environnementaux et ne peut tre exprime
que par un comportement verbal ou moteur.
La douleur possde 3 composantes : une composante
physique sensori-discriminative caractrise par le sige,
lirradiation, lintensit, la nature et la dure ; une com-
posante affective et psychologique caractrise par une
perception dsagrable engendrant des modifications
psychologiques transitoires en douleur aigu, beaucoup
plus durables en douleur chronique ; une composante
cognitivo-comportementale caractrise par une mmo-
risation au niveau central et qui induit des comportements
dvitement et de fuites physiologiques en douleur
aigu, mais des comportements pathologiques en douleur
chronique toxicomanie, repli sur soi, modification de
la vie socio-familiale
Lvaluation du malade douloureux comprend un
interrogatoire et un examen clinique.
Interrogatoire
Il prcise les antcdents mdicaux, chirurgicaux et
psychiatriques du patient. Il faut noter la prsence
dexpriences douloureuses antrieures et les comporte-
ments vis--vis de ces dernires.
1. Histoire de la douleur
Il faut prciser la date et le mode de dbut, avec les
circonstances et les vnements de vie concomitants. De
mme, il faut noter les modalits de prise en charge
initiale avec le diagnostic initial et son impact sur le
malade. Le malade est amen prciser les diffrents
examens effectus et les mdecins consults. Lvolution
de la douleur ainsi que les diffrents traitements entrepris
et leur efficacit constituent des lments essentiels, la
rponse aux grandes classes pharmacologiques des
antalgiques doit tre bien prcise : anti-inflammatoires
non strodiens, paractamol, opiacs mineurs (dextro-
propoxyphne, codine et tramadol), opiacs majeurs
(morphine et drivs) et co-analgsiques (antidpresseurs,
antipileptiques).
2. Douleur actuelle
Chronologie : la dure des pisodes douloureux ainsi
que le caractre permanent ou intermittent de la douleur
doivent tre prciss. Les variations nycthmrale, men-
suelle ou annuelle sont galement notes.
Topographie : le sige de la douleur ainsi que ses
irradiations doivent tre bien prciss. La topographie
douloureuse doit tre dessine sur un schma du corps et
intgre dans le dossier mdical. Il faut savoir reconnatre
les douleurs projetes qui sont ressenties distance de la
zone malade, dans le territoire cutan innerv par le
mme mtamre que celui dont dpend lorgane malade.
Il existe 2 types de douleurs projetes : douleur rapporte
lorsque la douleur est ressentie dans le territoire innerv
par un nerf comprim (compression du nerf sciatique par
une hernie discale ou au bassin sexprimant dans le terri-
toire du membre infrieur, compression du nerf fmoro-
cutan par le port dun jeans trop serr sexprimant au
niveau de la face externe de la cuisse) ; douleur rfre
qui est trompeuse pour un clinicien non averti.
Intensit : pour pouvoir quantifier la douleur, plusieurs
chelles sont utilises : chelle visuelle analogique
(EVA) o lon demande au patient de montrer sur une
B AS E S NE URO- P HYS I OL OGI QUE S E T VAL UAT I ON D UNE DOUL E UR AI GU E T CHRONI QUE
L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 3 , 5 3
458
ref_sindou 10/02/03 10:07 Page 458
reux ; une hyperpathie, retrouve surtout dans les dou-
leurs de type neuropathique central, qui se caractrise
par une exagration de la perception douloureuse
lorsque le stimulus est rptitif (sommation temporelle)
ou tendu (sommation spatiale). La rponse douloureuse
augmente en devenant intolrable et persiste aprs larrt
de la stimulation.
Latonie psychomotrice est une expression de la douleur
qui nest pas rare. Elle est particulire lenfant et le
risque est de mconnatre la souffrance cet ge : lenfant
est passif, triste, confin au lit avec une gesticulation
trs pauvre et une hostilit sourde.
Les douleurs neuropathiques associent souvent 2 types
de composantes douloureuses.
Les douleurs spontanes sont de 2 types souvent associs
douleur de fond type de brlure, darrachement ou de
dysesthsie et les accs paroxystiques de douleurs fulgu-
rantes type dlancements ou de dcharges lectriques.
Les douleurs provoques sont type dallodynie et
dhyperalgsie.
rglette sa douleur sur une ligne droite entre labsence
de douleur gauche et la douleur maximale imaginable
droite. Lexaminateur peut alors lire sur le verso de
cette rglette un chiffre allant de 0 10 (que le malade
ne voit pas) ; chelle numrique simple (ENS) qui
consiste demander au malade de coter sa douleur par
un chiffre allant de 0 (absence de douleur) 10 (douleur
maximale imaginable). Ces chelles, certes subjectives,
permettent au clinicien davoir une ide de lintensit de
la souffrance du malade et de suivre lvolution de cette
dernire en fonction du temps et des thrapeutiques
essayes.
Description qualitative : la douleur tant perue
travers une subjectivit et un impact sensoriel et mo-
tionnel, plusieurs chelles ont t conues pour couvrir
ces aspects de la douleur : chelle de description verbale
de la douleur ressentie avec des items sensoriels et mo-
tionnels (questionnaire de St-Antoine), chelles de
qualit de vie avec impact de la douleur sur celle-ci.
Circonstances de dclenchement et facteurs modi-
fiant la douleur dans les deux sens : stress, anxit,
dpression, dtente
Rpercussions comportementales : les prises mdica-
menteuses sont prcises ainsi quun ventuel compor-
tement daddictif. Les rpercussions de la douleur sur
les activits, le travail, les loisirs, le sommeil ainsi que le
comportement du malade vis--vis de la douleur sont
notes. Il faut rechercher une symptomatologie anxieuse
et (ou) dpressive.
Contextes familial et social : la vie conjugale, familiale,
de relation ainsi que le contexte socio-professionnel et
les ventuels conflits juridiques sont des lments
importants dans lvaluation dun malade douloureux.
La notion de bnfice secondaire la douleur est
prendre en compte.
Contexte psychologique : il est valu si ncessaire
par un psychologue ou un psychiatre. De mme, les
interprtations personnelles du malade vis--vis de sa
douleur sont prises en compte.
Examen clinique
Il dbute par une observation du patient avec ses
mimiques, sa mobilit spontane, sa faon de se lever,
de sasseoir, de se mouvoir, ses attitudes antalgiques, ses
soupirs et ses plaintes.
Lexamen clinique comporte linspection de la zone
douloureuse avec laspect de la peau, sa couleur et
lventuelle prsence de troubles vasomoteurs. Les
attitudes antalgiques et les contractures musculaires sont
notes. Cet examen est complt par un examen neuro-
logique comportant en particulier lapprciation de la
motricit et de la sensibilit la recherche dune anesthsie
ou dune hypoesthsie soit globale soit dissocie, de
type thermo-algique. On peut retrouver une hyperalgsie
qui est une rponse augmente un stimulus normalement
douloureux ; une allodynie qui se caractrise par une
sensation douloureuse secondaire des stimulus qui
normalement ne doivent pas tre perus comme doulou-
Neurologie
L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 3 , 5 3
459
Cliniquement, il existe 2 grands types
de douleur : douleur aigu ou douleur-symptme
et douleur chronique ou douleur-maladie.
La douleur comporte 3 composantes :
sensori-discriminative, affective et cognitivo-
comportementale.
Les douleurs projetes peuvent tre trompeuses
pour un clinicien non averti.
Dans la prise en charge optimale de la douleur
chronique, on commence par couter la plainte
du patient pour se rendre compte de la ralit
du vcu douloureux subjectif, comprendre les
mcanismes physiopathologiques prdominants
chez un malade donn afin dorienter dventuels
examens paracliniques et de choisir la prise
en charge adquate qui peut ncessiter
parfois laide dun psychothrapeute
ou dun psychiatre. Il faut toujours se rappeler
que la douleur est vcue travers une subjectivit
qui, malgr le fait quelle soit contre-courant
de la rationalit scientifique, doit tre prise
en compte par le mdecin.
Points Forts retenir
Albe-Fessard D. La douleur, ses mcanismes et les bases de ses
traitements. Paris : Masson, 1996 : 201 pp.
ANAES (Agence nationale daccrditation et dvaluation de la
sant). valuation et suivi de la douleur chronique chez ladulte en
mdecine ambulatoire. Service des recommandations et rfrences
professionnelles, fvrier 1999. www.anaes.fr
Sindou M, Mertens P, Keravel Y. Neurochirurgie de la douleur (I).
Encycl Med Chir (Elsevier, Paris), Neurologie, 17-700-B-10, 1996, 5p.
POUR EN SAVOIR PLUS
ref_sindou 10/02/03 10:07 Page 459
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
91 1
PARTIE I / MODULE 6
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Q 70
Deuil normal et pathologique
D
r
Laure Angladette, P
r
Silla M. Consoli
Service de psychologie clinique et psychiatrie de liaison, Hpital europen Georges Pompidou, 75908 Paris Cedex 15
silla.consoli@hop.egp.ap-hop-paris.fr
L
e terme de deuil dsigne
la fois la perte lie au
dcs dun tre cher,
la priode de souffrance qui suit
cet vnement douloureux, les
rituels associs au dcs, et
le processus psychologique
volutif conscutif la perte ou
travail de deuil . Par extension, ce terme dsigne les remanie-
ments psychiques accompagnant dautres types de perte (spara-
tion, mais aussi checs sur le plan social et professionnel).
Nous nenvisagerons ici que ce qui concerne les ractions
psychologiques lies au dcs dun tre cher.
DEUIL NORMAL
DROULEMENT CLINIQUE DU DEUIL
Le deuil normal se droule selon un processus comportant
plusieurs phases, communes tous les individus. Chaque deuil
reste cependant singulier, puisquil dpend de la personnalit de
chacun et de la relation entretenue avec le dfunt. Les diffren-
ces individuelles apparaissent dans les manifestations du deuil
et dans le rythme dvolution de ce processus.
On distingue gnralement trois tapes dans le droulement
clinique dun deuil : le dbut, marqu par un tat de choc ; ltape
centrale qui regroupe les symptmes caractristiques dun tat
dpressif ; et la phase de rtablissement.
1. tat de choc
La priode suivant immdiatement le dcs dun tre cher
est marque par un tat de choc, la fois psychique et physique,
qui est dautant plus intense que la perte est brutale. Cette
priode se divise en deux phases.
Phase de sidration. lannonce de la mort dun tre cher,
la toute premire raction est le refus de la douloureuse ralit.
La stupfaction et le refus saccompagnent dun tat de sidra-
tion mentale, qui ralise un blocage de toutes les fonctions psy-
chiques, avec une anesthsie des affects et un moussement
des perceptions. La personne endeuille agit de manire auto-
matique, dans une sorte dengourdissement qui la rend imper-
mable lenvironnement. Elle aura par la suite peu de souve-
nirs de cette priode. La stupfaction et lengourdissement
peuvent durer de quelques heures quelques jours, parfois
quelques semaines.
Le vcu somatique se traduit par des manifestations de tous
les grands tats motionnels : tachycardie, hypotension, oppres-
sion thoracique, gne respiratoire, crampes pharynges, dou-
leurs pigastriques, tendances lipothymiques pouvant aller jus-
qu la syncope. Sy ajoutent la perte presque complte de
lapptit, du sommeil et la sensation dune intense fatigue.
Phase de dcharge motionnelle et de recherche de la personne
disparue. Ltat de sidration se dissipe aprs un dlai variable,
pour laisser place lexpression des motions. Surviennent alors
iOBJECTIFSi
Distinguer un deuil normal
dun deuil pathologique et
argumenter les principes
daccompagnement.
POINTS FORTS
> Le droulement du deuil normal est marqu par trois grandes tapes : le choc, la phase
dpressive et la priode de rtablissement.
> Le travail de deuil qui conduit lacceptation de la perte et au dsinvestissement du
dfunt est ncessaire linvestissement de nouvelles relations dobjet.
> Parmi les deuils ne se droulant pas selon un processus normal, on distingue les deuils
compliqus, qui ne conduisent pas un trouble psychiatrique caractris, et les deuils
pathologiques, qui ralisent un tableau de maladie psychiatrique ou somatique.
> Un traitement est souhaitable dans les deuils compliqus, et simpose dans le cas
des deuils pathologiques.
comprendre
Ref08/04_Consoli_911 13/05/04 15:04 Page 911
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
91 2
les pleurs, les sanglots et les lamentations, ces manifestations
du chagrin tant plus ou moins bruyantes selon les individus.
Cette priode de forte dcharge motionnelle saccompagne
dune recherche de la personne aime et disparue. Le comporte-
ment peut alors alterner entre des moments dabattement et de
prostration et des moments dagitation anxieuse.
Diffrentes manifestations tmoignent de la recherche de
la personne disparue.
Orientation des comportements vers la personne disparue.
Le sujet en deuil prouve le besoin de parler du dfunt, de
sentourer de ses objets, de son cadre familier et des personnes
qui lont connu et aim.
Existence dillusions perceptives
Il sagit le plus souvent dimages visuelles, mais aussi de per-
ceptions auditives, olfactives ou tactiles. Ces impressions sur-
viennent spontanment ou loccasion de perceptions diverses
de la ralit ambiante, que le sujet ressent comme des indices de
la prsence du dfunt. Le sujet en deuil croit voir le visage ou
la silhouette de la personne disparue, entendre sa voix ou sentir
sa prsence ses cts, alors mme quil sait quelle est morte.
Il sagit dillusions de prsence et non dhallucinations, dans
la mesure o le sujet na pas la conviction que cette prsence est
relle. Ces manifestations sont banales et ne prjugent en aucun
cas dun pronostic dfavorable.
Sur le plan somatique, linsomnie et lanorexie persistent,
ainsi quune asthnie majeure.
2. Phase dpressive
Cette tape centrale constitue par une phase dpressive
sinstalle plus ou moins rapidement aprs la survenue du dcs,
et va durer en gnral plusieurs mois (entre quelques semaines
et un an). La symptomatologie dpressive ne peut apparatre
quaprs la priode du choc.
Le tableau clinique est constitu du trpied smiologique de
la dpression (humeur dpressive, ralentissement psychomo-
teur, et symptmes somatiques), auquel sajoutent des penses
et des attitudes lgard du disparu.
Symptmes affectifs. Ils comportent :
ltristesse, douleur morale, idation suicidaire ;
lanhdonie (perte du plaisir avoir des loisirs, participer aux
vnements sociaux et familiaux, ainsi qu toutes les activi-
ts auxquelles participait le disparu, sentiment que plus rien
nest agrable sans lui) ;
lsentiment de solitude, mme en prsence des autres.
Ralentissement psychomoteur. Gnralement modr, il com-
porte :
lbradypsychie, troubles de la concentration et de lattention,
troubles mnsiques ;
lhypokinsie, hypomimie, apathie, aboulie, repli sur soi.
Troubles somatiques. Ils sexpriment sous forme danorexie,
dinsomnie, dasthnie, de plaintes fonctionnelles (douleurs,
inconfort digestif, symptmes neurovgtatifs, etc.).
Penses et attitudes lgard du disparu. Elles sont diverses :
lintrusion rptitive de souvenirs tristes, mais aussi heureux,
relatifs au disparu;
lidalisation : tendance ignorer les dfauts du disparu et
exagrer ses caractristiques positives ;
lambivalence : coexistence de sentiments positifs et ngatifs
envers la personne disparue ;
lculpabilit : auto-accusation et blme concernant certains
vnements (par exemple, se reprocher de ne pas avoir su
viter la mort du disparu), regrets lis au comportement
pass lgard du disparu (par exemple, navoir pas su laimer
ou le protger) ; en revanche, dans le deuil normal, il ny a pas
de sentiment de culpabilit ou dauto-dprciation relatif
des thmes autres que ceux qui concernent le disparu;
lillusions perceptives concernant le disparu;
lidentification au dfunt : proccupations de sant, sympt-
mes somatiques mimant la maladie du dfunt, imitation tem-
poraire de ses manires et de ses habitudes ;
lides de mort, sexprimant gnralement par la pense quil
aurait mieux valu mourir avant le disparu, en mme temps
que lui ou encore sa place.
Cet tat dpressif a un retentissement sur le niveau de fonc-
tionnement global de lindividu : relations interpersonnelles
(familiales, amicales, sociales), et fonctions professionnelles.
Toute lattention, toute lnergie se concentrent sur lobjet perdu ;
tous les autres intrts semblent laisss de ct.
Il est frquent galement dobserver une augmentation de
la consommation dalcool (principalement chez les hommes), de
psychotropes (principalement chez les femmes), et de tabac
(dans les deux sexes).
3. Rtablissement
La dernire tape du deuil est celle du rtablissement. Durant
cette priode, le sujet retrouve progressivement ses intrts
antrieurs et se montre capable peu peu de se tourner vers
lavenir, dinvestir de nouvelles relations, de ressentir de nou-
veaux dsirs et de les exprimer. Ce retour vers le monde ext-
rieur dbute habituellement dans les rves (rves de rencontre,
dacquisition, etc.).
Ltat dpressif se dissipe, la douleur sapaise. Le sujet
prouve dabord du soulagement, puis retrouve une sensation
de bien-tre, de lnergie et du got vivre.
Des modifications du cadre de vie tmoignent galement de
ce processus de gurison : changement de lieu de vie ou modifi-
cation de lamnagement, sparation des objets personnels du
dfunt, en gardant seulement ceux que le sujet endeuill consi-
dre comme particulirement vocateurs et significatifs.
Les reprsentations associes au disparu sont moins nom-
breuses et moins frquentes, mais elles persistent, mme aprs
la fin du deuil : elles sont seulement devenues moins poignantes
et moins douloureuses. Peu peu, ces souvenirs tristes et
nostalgiques sestompent, pour resurgir priodiquement dans
certaines circonstances. Mme aprs un deuil normal, il existe
une reviviscence de souvenirs accompagne de tristesse au
moment de la date anniversaire de la perte. Ces ractions
danniversaire sont particulirement vives dans les deuils
compliqus et pathologiques.
Si le deuil est une exprience douloureuse, il peut tre
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Deuil normal et pathologique
Ref08/04_Consoli_911 13/05/04 15:04 Page 912
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
91 3
galement, dans la mesure o il a t rsolu, loccasion dune
maturation affective et dun dveloppement personnel.
TRAVAIL DE DEUIL
La succession des manifestations cliniques du deuil est lexpres-
sion du droulement dun processus psychique, le travail de deuil.
Les fonctions du travail de deuil sont lacceptation de
la ralit, le dsinvestissement de lobjet perdu et le rinvestis-
sement de nouveaux objets.
Aprs la perte dun tre cher, un travail de dsinvestissement
doit ncessairement soprer. Cest un travail de dtachement
progressif. Chacun des souvenirs doit tre remmor, puis
confront lide de disparition afin dtre dsinvesti, ce qui
entrane chaque fois douleur et nostalgie. Ce travail se fait au
travers du vcu dpressif.
Laccomplissement de ce travail est indispensable pour accder,
par la suite, un rinvestissement de qualit vers de nouveaux objets.
DURE DU DEUIL NORMAL
Il est souvent admis quun travail de deuil normal dure entre
10 et 12 mois.
En fait, le processus peut tre attnu et durer beaucoup
moins longtemps, mais il peut galement durer plus longtemps,
sans pour autant devoir tre considr comme un deuil patho-
logique . Il faut ajouter que la dure et lexpression du deuil
normal varient considrablement selon les groupes culturels.
DEUILS COMPLIQUS ET DEUILS
PATHOLOGIQUES
Il nexiste actuellement aucune dfinition consensuelle ta-
blissant les critres dun deuil pathologique.
On distingue classiquement les deuils compliqus des deuils
pathologiques.
Dans les deuils compliqus, le droulement habituel du tra-
vail de deuil est entrav, sans toutefois conduire une patho-
logie psychiatrique caractrise. Nanmoins, la suspension de
laccomplissement du deuil a des consquences dltres sur
le fonctionnement psychique et social.
Les deuils pathologiques constituent dauthentiques maladies,
psychiatriques mais aussi somatiques, survenant au dcours
dun deuil, chez des sujets nayant gnralement aucun antc-
dent psychiatrique ou mdical. Le deuil est galement un
facteur de perturbation au cours de lvolution de maladies
mentales prexistantes et peut, sur un tel terrain, prendre plus
facilement une forme pathologique.
FACTEURS DE RISQUE DE DEUIL COMPLIQU
OU PATHOLOGIQUE
Ils comportent :
type de liens avec le disparu : dcs dun enfant, dun
conjoint, dun pre ou dune mre (surtout dans lenfance ou
ladolescence) ; relation conflictuelle ou ambivalente ;
circonstances du dcs : dcs brutal et inattendu ; dcs
par suicide ; dcs par homicide ; dcs lors dune catastrophe
naturelle ou dun attentat (dcs multiples) ; dcs dont on a t
le tmoin (pathologie aigu, accident, etc.) ;
annonce du dcs : absence de prparation au dcs ;
absence de tact dans lannonce ;
caractristiques de lendeuill : ge (les sujets jeunes
souffrent plus de culpabilit et de symptmes anxieux, dpres-
sifs et somatiques, que les sujets plus gs) ; sexe (le risque de
deuil compliqu ou pathologique est plus important dans le cas
du veuvage chez les hommes gs, par comparaison aux veu-
ves du mme ge) ; personnalit borderline ou tat limite
(trouble de la personnalit caractris par une incompltude
narcissique, o la relation lautre est domine par une forte
angoisse de perte ou dabandon) ; antcdents psychiatriques,
en particulier dpression ou tentatives de suicide ; deuils rp-
ts ; dsinsertion professionnelle ou autres difficults de vie ;
tat de sant prcaire : favorise le risque de complications
somatiques ;
environnement social et affectif : absence de rites commu-
nautaires ; environnement familial peu tayant.
DEUILS COMPLIQUS
1. Deuil diffr
Le sujet en deuil est maintenu dans une position de dni de
la ralit, ce qui diffre la survenue des affects dpressifs. En
conservant les affaires du dfunt la mme place, en perp-
tuant les gestes qui lui taient destins et les habitudes du quoti-
dien, lendeuill prolonge la prsence de celui-ci, comme si rien
navait chang.
Une ritualisation de la vie permet de maintenir ce dni (par
exemple une mre prparant les affaires de son fils mort tous les
matins ou la chambre dun enfant mort constituant un sanctu-
aire dans lequel aucun objet ne doit tre dplac).
La raction dpressive est ici retarde. Elle surviendra
loccasion dun vnement ractivant la perte ou partir dune
laboration personnelle permettant laccs au travail de deuil.
2. Deuil inhib
Comme dans le deuil diffr, les manifestations normales
du deuil ne sont pas apparentes. Le sujet endeuill a intgr
la ralit de la perte, mais il refuse les motions et la douleur
qui y sont lies. Les affects, non exprims pendant un temps
plus ou moins long, rapparaissent le plus souvent subite-
ment et parfois de manire difficilement comprhensible,
loccasion dun rappel conscient ou inconscient de la dispari-
tion de ltre aim. Ce sont eux qui dclenchent alors le proces-
sus de deuil.
3. Deuil prolong ou deuil chronique
On parle dun deuil prolong lorsque la symptomatologie
dpressive persiste avec la mme intensit, mme aprs plus
dun an dvolution.
Le deuil est considr galement comme prolong si,
plusieurs annes aprs le dcs, lvocation du dfunt provoque
une tristesse intense ou quun comportement de recherche de
Ref08/04_Consoli_911 13/05/04 15:04 Page 913
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
91 4
la personne disparue persiste ou que les priodes danniversaire
provoquent des ractions particulirement douloureuses, ou
encore si le sujet endeuill na pas pu rinvestir des relations
affectives ou des activits professionnelles.
DEUILS PATHOLOGIQUES
Les deuils pathologiques peuvent revtir toutes les formes
de la pathologie mentale. Dans lensemble, leurs expressions cli-
niques sont comparables celles de la pathologie habituelle,
mme si ce contexte particulier du deuil leur imprime cependant
quelques caractres spcifiques.
On distingue classiquement les deuils marqus par un syn-
drome psychiatrique et les deuis caractriss par la dcompen-
sation dune personnalit nvrotique (plus rcemment, des
auteurs amricains ont propos une nouvelle catgorie nosolo-
gique, le deuil traumatique).
1. Syndromes psychiatriques
tats anxieux. La pathologie anxieuse, souvent mconnue,
est nanmoins frquente dans la priode du deuil. Elle se mani-
feste par une anxit gnralise ou des attaques de panique.
Elle peut encore raliser un tat de stress post-traumatique
(syndrome de rptition, vitement des situations qui rappel-
lent lvnement traumatique, sentiment de dtachement dau-
trui et restriction des affects, sentiment dun avenir vain, rduc-
tion des intrts, hypervigilance ou tat de qui-vive ,
troubles du sommeil, de la mmoire et de la concentration, irri-
tabilit, qui survient le plus souvent lorsque le sujet assiste au
dcs dun ou plusieurs proches, dans une situation trauma-
tique (accident, guerre, attentat, etc.). Le syndrome de stress
post-traumatique est distinguer du deuil traumatique que nous
dcrirons plus loin.
Accs mlancolique. Il est difficile de faire la distinction, dans
le deuil, entre une phase dpressive normale du deuil et une
raction aggrave constituant au maximum un deuil mlanco-
lique . Dans le deuil mlancolique, la symptomatologie dpres-
sive se dtache en quelque sorte de la cause originelle et devient
autonome dans lexprience du patient.
On considre habituellement quun ralentissement psycho-
moteur important, une baisse importante de lestime de soi,
lintensit excessive des sentiments de culpabilit, des ides
dindignit, la prsence dides suicidaires, et a fortiori dune
symptomatologie dlirante ou dides de damnation, sont en
faveur dun tat mlancolique.
Selon la classification amricaine des maladies mentales,
le DSM-IV, un certain nombre dindividus prsentent, comme
raction la mort dun tre cher, des symptmes caractris-
tiques dun pisode dpressif majeur, qui seront identifis
comme lexpression dun deuil normal . En revanche, on par-
lera dpisode dpressif majeur et non de deuil normal :
si les symptmes dpressifs durent plus de 2 mois ;
ou si les symptmes suivants sont prsents : culpabilit
propos de choses autres que les actes entrepris ou non entrepris
par le survivant avant le dcs de ltre cher, ides de mort
autres que le sentiment, pour le survivant, quil aurait d mourir
avec la personne dcde, sentiment morbide de dvalorisation,
ralentissement psychomoteur marqu, altration profonde et
prolonge du fonctionnement, hallucinations proprement dites
et non simple impression dentendre la voix du dfunt ou de voir
transitoirement son image.
Hormis la question de la dure, qui nest pas prise en compte
pour caractriser le deuil mlancolique, la dfinition dpisode
dpressif majeur propose par le DSM-IV dans le cadre du
deuil recouvre en grande partie la notion de deuil mlancolique
des auteurs franais.
pisode maniaque. Le tableau clinique de la manie de deuil ne
diffre pas fondamentalement de celui dun accs maniaque
aigu typique, mais il prsente quelques particularits.
Tout dabord, il existe souvent un temps de latence, de dure
variable, entre le dcs et la raction maniaque. Pendant ce
temps, lendeuill parat faire face la situation. Ltat maniaque,
lorsquil apparat, est marqu par limportance du dni de la
mort et par lintensit des sentiments de triomphe et de puis-
sance. Le dni peut porter sur la ralit de la mort, avec un dlire
dans lequel le disparu est donn pour vivant, dlire auquel
le sujet adhre plus ou moins. Mais dune manire gnrale, le
dni porte bien plus sur la signification de la perte. Dans la manie
de deuil, la perte semble ne pas avoir dimportance.
Troubles psychotiques. En dehors des deuils mlancoliques et
des deuils maniaques, dans lesquels des caractristiques
psychotiques peuvent tre prsentes, les deuils psychotiques
peuvent revtir des formes aigus ou des formes chroniques,
dinstallation insidieuse.
Les tats aigus sont habituellement accompagns dune note
confusionnelle.
Dans le cadre des dlires chroniques (schizophrnies, para-
noa, etc.), la situation de deuil peut inaugurer la maladie ou
rvler un tat mental qui voluait dj depuis quelque temps.
2. Dcompensation dun trouble nvrotique
de la personnalit
Deuil hystrique. Les ractions dans les premiers jours sont
trs variables. Dans la majorit des cas, lindividu en deuil
exprime trs rapidement sa souffrance, avec des manifestations
bruyantes. Le plus souvent, il sagit dune violente crise motion-
nelle avec dcharge motrice, parfois passages lacte auto-
agressifs. Lendeuill peut galement dvelopper des symptmes
de conversion aigu. Mais le deuil peut aussi sembler se drouler
normalement dans un premier temps, masquant parfois un dni
intense et prolong.
Par la suite, le tableau du deuil hystrique se caractrise par
la prsence de 4 types de symptmes :
comportements autodestructeurs : les tentatives de sui-
cide sont trs frquentes, avec le dsir exprim de retrouver
la personne aime dans la mort. Lautodestruction se manifeste
galement dans des comportements dincurie, ces sujets ngli-
geant leurs besoins vitaux (alimentation, sommeil, etc.) et leur
sant physique et psychique ;
refus de quitter le dfunt : la personne endeuille reconnat
la mort du dfunt, mais se comporte dans le quotidien comme
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Deuil normal et pathologique
Ref08/04_Consoli_911 13/05/04 15:04 Page 914
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
91 5
sil tait toujours prsent, en entretenant avec lui une relation
intrieure. Il pense constamment lui, lui parle pendant des heu-
res, lui crit, etc. ;
identification au dfunt : ce processus didentification est
prsent au cours du deuil normal, mais prend un caractre parti-
culirement intense au cours du deuil hystrique. Lendeuill
sidentifie tout dabord au disparu en tant que mort, avec des
mouvements dautodestruction. Il exprime ensuite des sympt-
mes identiques ceux du dfunt, sidentifiant ainsi celui-ci lors-
quil tait malade. Ces symptmes se dveloppent de manire
inconsciente, selon le mme mcanisme quune conversion hys-
trique. Lidentification porte enfin sur des caractristiques du
dfunt lorsquil tait en vie, lendeuill adoptant des traits de sa
personnalit ou de son apparence physique ;
chronicit de ltat dpressif : dans le deuil hystrique,
ltat dpressif est particulirement prolong, stendant sou-
vent sur plusieurs annes.
Deuil obsessionnel. Dans les premiers moments, lendeuill ne
manifeste pas ou peu son chagrin, gardant sa souffrance en lui.
Il tient soccuper des problmes matriels : organisation des obs-
ques, gestion de la situation administrative et financire du dfunt.
Ds les premiers jours apparat la culpabilit, qui va marquer
lvolution de tout le deuil obsessionnel.
Lorsque les premiers moments sont passs, la dpression
apparat. Ltat dpressif se manifeste habituellement par de
labattement, de la lassitude, une anhdonie et une asthnie
intense. La culpabilit est au premier plan, avec des reproches
que lendeuill sadresse lui-mme et par lesquels il ne cesse de
se torturer. Des squences prcises de mots : il sest suicid, on
la tu, il ma abandonn(e) ou des images de mort simposent
peu peu de manire compulsive et obsdante. Un geste suici-
daire nest pas rare.
Ce blocage obsessionnel inhibe le travail de deuil. Il sagit dun
blocage des affects destin se protger contre les motions
douloureuses et agressives suscites par le dcs.
Une dpression grave prolonge donc le temps du deuil par
rapport la normale. Le sujet risque dvoluer vers un tat din-
hibition qui touche tous les domaines de sa vie : affectif, intellec-
tuel, social et professionnel.
Ce phnomne peut aussi spuiser au bout de quelque
temps et permettre ainsi la reprise du travail de deuil.
3. Deuil traumatique
Certains auteurs ont propos cette catgorie diagnostique
pour faciliter lidentification et encourager le traitement des
ractions de deuil pouvant tre considres comme patholo-
giques, sans entrer dans la catgorie dun trouble dpressif ou
anxieux.
Selon ces auteurs, le deuil raliserait un type particulier de
traumatisme : le traumatisme de la sparation. Ils soulignent
dailleurs lexistence dun certain nombre de symptmes com-
muns au deuil et ltat de stress post-traumatique (dtache-
ment dautrui, sentiment dun avenir vain, perte des senti-
ments de scurit, de confiance et de contrle, colre,
irritabilit).
Le deuil traumatique est donc dfini par la prsence de
2 catgories de symptmes : dune part les symptmes refltant
la difficult de la sparation, dautre part les symptmes indi-
quant limpact traumatique du dcs (v. tableau).
4. Pathologie somatique du deuil
Aprs un deuil, on constate une augmentation des
manifestations coronariennes chez les deux sexes.
Contrairement une ide trs rpandue, il ny a pas
daugmentation dincidence des cancers aprs un deuil
(sauf peut-tre pour des cancers lis la modification du
mode de vie, comme le cancer du poumon, d laugmenta-
tion du tabagisme).
Critres diagnostiques du deuil traumatique
Daprs Prigerson HG, Jacobs SC. JAMA 2001 ; 286 : 1369-73
Tableau
Critre A (difficults de sparation)
Critre B (impact traumatique du dcs)
Critre C
Critre D
Prsence dau moins 3 des 4 symptmes suivants :
intrusions rptitives de penses concernant le disparu
sentiment que le disparu manque
comportement de recherche du disparu
sentiment excessif de solitude
Prsence dau moins 4 des 8 symptmes suivants :
sentiment dun avenir sans but ou vain
sentiment de dtachement ou restriction des affects
difficult reconnatre la mort (incrdulit)
sentiment dune vie vide ou dpourvue de sens
sentiment davoir perdu une partie de soi
bouleversement de la vision du monde (perte des sentiments de scurit, de confiance et de contrle)
appropriation de symptmes ou de comportements du disparu
irritabilit, amertume ou colre vis--vis du dcs
Les symptmes (critres A et B) voluent depuis au moins 6 mois
Les symptmes induisent une altration cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel
ou dans dautres domaines importants
Ref08/04_Consoli_911 13/05/04 15:04 Page 915
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
91 6
PRINCIPES DE PRVENTION
ET DACCOMPAGNEMENT
Laccompagnement du deuil est ncessaire pour tout deuil
pathologique, souhaitable pour un deuil compliqu et peut sa-
vrer utile dans certains deuils normaux, dans la mesure o le
deuil est toujours source dune grande souffrance. La finalit
dun tel accompagnement nest cependant pas de faire lcono-
mie de la tristesse et de linconfort majeur quimplique tout tra-
vail de deuil.
En amont, cest--dire avant le dcs ou immdiatement au
dcours de celui-ci, il sagit galement de prvenir un deuil
pathologique dans lentourage du dfunt.
PRVENTION DU DEUIL PATHOLOGIQUE
Auprs dun malade en fin de vie, il conviendra de :
favoriser la prsence des proches et les changes entre
eux (verbaux ou non verbaux) ;
faire participer le plus possible les proches aux soins, leur
expliquer les gestes mdicaux et les traitements ;
favoriser les soins de confort pour le patient, tre attentifs
aux demandes des proches ce sujet ;
prparer les proches au dcs de leur malade ;
reprer les sujets et les situations risque et proposer un
soutien psychologique.
Aprs le dcs, on veillera :
annoncer le dcs avec tact ;
dcrire, sil y a lieu, lentourage les circonstances du
dcs, rapporter les paroles et les gestes du mourant ;
savoir, en tant que mdecin, prsenter ses condolances et
exprimer de lempathie ;
encourager annoncer le dcs tout lentourage (y com-
pris les personnes supposes fragiles, comme les enfants et les
personnes ges) et assister aux funrailles, tout en respec-
tant les choix et les stratgies dfensives individuelles ;
donner des informations aux sujets en deuil sur les affects
quils peuvent ressentir et les aides qui peuvent leur tre proposes;
prvoir une consultation dvaluation : il sagit de rencontrer
les proches (particulirement les sujets risque) au moins une fois
dans les semaines qui suivent le dcs, afin dvaluer leur tat
psychologique, mais aussi pour rpondre leurs questions concer-
nant la maladie du dfunt, les soins de fin de vie, le deuil, etc.
DEUIL PATHOLOGIQUE
La prise en charge du deuil pathologique associe traitement
mdicamenteux et traitement psychothrapique.
1. Traitement mdicamenteux
Le type de traitement est fonction de la symptomatologie
psychiatrique :
antidpresseur (inhibiteur de la recapture de la srotonine
ou tricyclique) dans le deuil mlancolique, le deuil hystrique et
le deuil obsessionnel ;
anxiolytique dans les troubles anxieux ;
thymorgulateur et (ou) neuroleptique dans le deuil maniaque ;
neuroleptique dans le deuil psychotique.
2. Psychothrapies
Psychothrapies individuelles
lPsychothrapie de soutien : il sagit dassurer un accompa-
gnement au cours duquel le sujet endeuill peut parler des
circonstances du dcs, de la nature de ses relations avec le
disparu, tant dans ses aspects positifs que dans ses aspects
ngatifs, ainsi que des difficults concrtes auxquelles il a
faire face. Ce cadre doit lui donner la possibilit dexprimer les
motions, souvent intenses, quil ressent. La psychothrapie
de soutien peut tre utilise dans tous les types de deuil
pathologique.
lPsychothrapie dinspiration analytique : elle permet au
sujet de prendre conscience de phnomnes psychiques qui
taient jusqualors inconscients et qui entravaient le droule-
ment normal du travail de deuil : sentiments hostiles ou agres-
sifs vis--vis du disparu, ractivation de deuils antrieurs, etc.
Ce type de psychothrapie nest gnralement pas indiqu
demble si une symptomatologie psychiatrique svre
(dpressive, maniaque ou dlirante) est au premier plan. Elle
peut tre propose dans un second temps, lorsque ltat cli-
nique a t amlior par un traitement associant chimioth-
rapie et psychothrapie de soutien.
lThrapies cognitivo-comportementales : la thrapie cogni-
tive a pour objectif didentifier les penses irrationnelles
ou errones , et de les modifier. Elle permet dagir en
particulier sur les symptmes anxieux, dpressifs, obses-
sionnels, ainsi que dans les tats de stress post-traumatique.
Les thrapies comportementales, aprs une valuation de
limpact fonctionnel du deuil sur la vie du patient, proposent
plusieurs types dintervention : relaxation, dsensibilisation
(qui consiste associer un tat de dtente, des souvenirs ou
des situations pnibles), renforcement social.
Psychothrapies de groupe
lGroupe dentraide : le groupe dentraide est fond sur lide
que des personnes peuvent sapporter aide et soutien mutuel,
dans la mesure o elles vivent la mme exprience. Il permet
lexpression et le partage des motions et des difficults ren-
contres par chacun, la recherche de solutions et la restaura-
tion dun lien social. Les groupes dentraide sont souvent ani-
ms par une personne qui a dj vcu un deuil et qui partage
sa propre exprience avec le groupe (groupes de parents
ayant perdu un enfant, groupe de conjoints endeuills, etc.).
Dautres groupes sont mens par des professionnels (psycho-
logues ou psychiatres) ou par des bnvoles forms.
Ce type de groupe a t particulirement dvelopp dans
le cadre de mouvements associatifs.
lPsychothrapie de groupe dinspiration psychanalytique :
elle applique les principes thoriques psychanalytiques
lanalyse de la dynamique du groupe, et en particulier des
mouvements transfrentiels qui se produisent dans ce cadre.
lPsychothrapie de groupe cognitivo-comportementale :
elle sappuie sur les principes des thrapies cognitives et
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Deuil normal et pathologique
Ref08/04_Consoli_911 13/05/04 15:04 Page 916
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
91 7
comportementales, tout en proposant un partage des
expriences entre les participants et un tayage apport par
le groupe.
DEUIL COMPLIQU
Le deuil chronique peut bnficier dun traitement anti-
dpresseur associ une psychothrapie, individuelle ou collective.
En revanche, un traitement mdicamenteux ne se justifie
pas dans le cas de deuil retard et inhib, qui relve uniquement dun
travail de psychothrapie, plutt dinspiration psychanalytique.
DEUIL NORMAL
Dans le cadre dun deuil normal, il ny a gnralement pas
dindication un traitement.
Toutefois, limportance de la dtresse peut conduire propo-
ser un soutien psychologique, sous forme dentretiens indivi-
duels avec un psychologue ou un psychiatre ou sous forme de
groupes. Une aide mdicamenteuse peut galement tre appor-
te, de manire ponctuelle, afin de soulager une anxit trop
importante ou des troubles du sommeil. B
POINTS FORTS
> La perte dun tre cher constitue un des vnements les
plus douloureux de lexistence. Laccs un mieux-tre
nest possible qu lissue dun long travail psychique
passant par lacceptation de la perte, le
dsinvestissement progressif de la personne disparue,
puis le rinvestissement de nouveaux objets.
> Le travail de deuil ne peut se drouler sans que le sujet
ne traverse des moments dintense souffrance, et en
particulier une phase dpressive, quil importe de
respecter et de ne pas mdicaliser de manire excessive.
> Les traitements (en particulier mdicamenteux) ne
doivent en aucun cas tre systmatiques lors dun deuil
normal. En revanche, le deuil pathologique, qui constitue
en quelque sorte un obstacle au droulement du travail
de deuil, doit conduire proposer des mesures
thrapeutiques.
> Il faut souligner limportance du travail de prvention qui
peut permettre dviter la survenue dun certain nombre
de deuils pathologiques.
retenir
A / VRAI OU FAUX ?
Le droulement dun deuil normal
est caractris par la succession de
trois phases : le choc, la phase
dpressive, la priode de rtablissement.
Un tat de prostration suivant
immdiatement lannonce du dcs
dun tre cher est une manifestation
de la phase dpressive du deuil normal.
Au cours dun deuil normal, la phase
dpressive dure moins dun mois.
Trois mois aprs le dcs dun tre
cher, un tableau associant une
douleur morale, une anhdonie, un
ralentissement psycho-moteur et
des troubles du sommeil doit
ncessairement conduire
la prescription dun traitement
antidpresseur.
4
3
2
1
B / VRAI OU FAUX ?
Au cours de la phase dpressive
dun deuil, la prsence dun ralentis-
sement psychomoteur marqu et
dune culpabilit majeure oriente
vers le diagnostic de deuil mlanco-
lique.
Lidentification massive au dfunt
est une des caractristiques du deuil
obsessionnel.
Les tentatives de suicide sont fr-
quentes au cours des deuils hyst-
riques.
La survenue dun deuil augmente
le risque de pathologie coronarienne.
4
3
2
1
C / QCM
Au cours du droulement dun deuil
normal, on peut constater les symptmes
suivants :
Idations suicidaires
Ides de damnation
Symptmes somatiques mimant
la maladie du dfunt
Illusions perceptives concernant
le dfunt
4
3
2
1
M I N I T E S T D E L E C T U R E
R p o n s e s : A : V , F , F , F / B : V , F , V , V / C : 1 , 3 , 4 .
POUR EN SAVOIR PLUS
Deuil. Clinique et pathologie
Bourgeois M, Verdoux H
EMC (Paris-France), Psychiatrie,
37-395-A-20, 1994, 8 p
Deuil normal et deuil pathologique
Bourgeois M
Paris : Doin, 2000
Le deuil
Hanus M, Bacqu MF
Paris : PUF, 2001
Les deuils dans la vie. Deuils
et sparations chez ladulte et lenfant
Hanus M
Paris : Maloine, 1998
Ref08/04_Consoli_911 13/05/04 15:04 Page 917
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
563
PARTIE I / MODULE 6
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENTS
Q 68
Douleur chez lenfant :
sdation et traitements antalgiques
D
r
Laurence Teisseyre, D
r
Chantal Wood-Pillette
Unit douleur, hpital Robert Debr 75019 Paris
chantal.wood@rdb.ap-hop-paris.fr
DVELOPPEMENT COGNITIF DE LENFANT
Il volue naturellement au fur et mesure de la croissance de
lenfant et est marqu par de trs nombreux facteurs, tant cultu-
rels que psycho-socio-familiaux, ainsi que par le vcu ou non
dexpriences douloureuses.
Le psychologue suisse Jean Piaget a dcrit diffrents stades
en fonction de lge.
De 0 2 ans : cest le stade des rflexes, des premires habitu-
des motrices, de lintelligence sensori-motrice. Le bb na
aucune notion du temps, ni du soulagement, et la douleur lenva-
hit trs rapidement. La peur des situations douloureuses appa-
rat progressivement entre 6 et 18 mois.
De 2 7 ans : cest le stade propratoire. La pense est go-
centrique, lenfant a du mal diffrencier ses propres penses
de celles des autres, et croit donc que lautre sait ce quil res-
sent. Cest lge des penses finalistes : tout a une raison dtre.
La survenue dune maladie peut tre comprise selon 2 mca-
nismes : le phnomnisme : lenfant croit quelle est due un
vnement extrieur concomitant. Il peut sagir sinon dune
contagion, la maladie tant alors due des objets ou des per-
sonnes proches, mais qui ne le touchent pas. Lenfant ne fait pas
la distinction entre la cause et les consquences de la maladie ;
il ne fait pas non plus le lien entre traitement et soulagement de
sa douleur. Parfois, il peut tenir lautre , ventuellement
le soignant, pour responsable de sa douleur ; parfois la douleur
est au contraire vcue comme une punition pour des penses
ou des actes layant prcde. Toutes ces explications sont
importantes connatre pour mieux comprendre, et selon les
cas, renforcer ou dmentir, expliquer, ventuellement exploiter
les croyances en la magie, guider la pense ou le raisonnement
de lenfant.
De 7 11 ans : cest le stade opratoire concret ; lenfant peut
penser que la maladie survient par contamination ; les plus
iOBJECTIFSi
Reprer, prvenir et traiter les manifestations douloureuses
pouvant accompagner les pathologies de lenfant.
Prciser les mdicaments utilisables chez lenfant selon lge,
avec les modes dadministration, indications et contre-indications.
POINTS FORTS
> Lenfant diffre de ladulte dans son corps, mais aussi
dans son esprit ; dans un contexte de douleur, son
niveau de dveloppement cognitif conditionne le vcu et
lexpression de celle-ci, et il importe de le prendre en
compte en abordant lenfant.
> Les manifestations de la douleur sont biphasiques :
la phase aigu, elles sont bruyantes, mais si la douleur
se prolonge ou se rpte, elles font place, parfois
rapidement, un tableau dinertie psychomotrice.
> Lvaluation de la douleur est la premire tape de
sa prise en charge ; elle fait appel des outils qui
permettent de limiter la subjectivit du soignant et de
fournir un score utile au suivi. Chez les plus petits, seule
une htro-valuation est possible, base sur des
chelles comportementales, choisir en fonction de
lge de lenfant mais aussi du contexte. partir de
5 voire 3 ans, une auto-valuation est souhaitable.
> Les principes du traitement sont proches de ceux de
ladulte, mais de nombreuses spcialits nont pas
lautorisation de mise sur le march (AMM) en pdiatrie.
comprendre
ref05/04_Wood_563 25/03/04 13:43 Page 563
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
564
grands ont la notion dintriorisation : la maladie, bien que de
cause extrieure, est localise dans le corps. Il existe une grande
confusion sur le rle des organes ; en revanche, lenfant peut
localiser la douleur certaines parties du corps ; par ailleurs, il
fait la distinction entre lui-mme et les autres, entre son tat
interne et son tat externe, entre les causes et les consquences
de sa maladie. noter quil a souvent peur dune atteinte de
lintgrit de son corps ou de la mort.
Aprs 11 ans : cest le stade opratoire formel, dbut dune pen-
se abstraite ; lenfant est capable de dcrire sa maladie comme
une succession dvnements et dadmettre des explications
physiologiques, la cause pouvant tre alors un mauvais ou un
non-fonctionnement dun organe, voire des explications psycho-
physiologiques, chez les plus grands, faisant un lien entre psy-
chisme et sant.
SIGNES DE LA DOULEUR
Il est possible de les regrouper en trois ordres de signes.
MANIFESTATIONS MOTIONNELLES
Elles sont peu spcifiques de douleur car galement lies au
stress, ni proportionnelles lintensit de la douleur. On observe:
des ractions comportementales : en partie rflexes, en partie
sous le contrle de lenfant :
lpleurs, cris : leur tonalit permet parfois aux parents et (ou)
aux soignants de faire la distinction entre cris et pleurs de
douleur ou dune autre cause ;
lagitation, mouvements de flexion et extension des membres ;
lagrippement ;
ldes modifications du visage, signe le plus spcifique de cette
catgorie ; trs utilis par les grilles dvaluation. On note un
froncement des sourcils, des yeux ferms trs serrs, une
accentuation du sillon nasolabial, une bouche ouverte en
rectangle .
des manifestations neurovgtatives : ces dernires sont totale-
ment rflexes :
llvation de la pression artrielle et de la frquence
cardiaque ;
lvariation de la frquence respiratoire, baisse de la saturation
en oxygne ;
ldes sueurs ;
lune hyperglycmie et une augmentation du catabolisme
protidique.
SIGNES DADAPTATION DU CORPS
LA DOULEUR
Ils correspondent une protection rflexe du corps, et sont
beaucoup plus spcifiques de douleurs. On recherche :
lune position antalgique au repos ;
lune attitude antalgique dans le mouvement ;
lla protection spontane dune zone douloureuse ;
lune contracture ;
lune entrave la mobilisation passive.
ALTRATIONS PSYCHOMOTRICES
Elles apparaissent lorsque la douleur se prolonge ou se
rpte ; et ce, dautant plus rapidement que lenfant est petit,
parfois en quelques heures. La symptomatologie se modifie : de
bruyante, elle devient discrte, aboutissant un aspect denfant
trop calme et un tableau dinertie psychomotrice :
le visage est fig, inexpressif, impassible ;
les mouvements sont rares, limits aux extrmits, lents,
monotones, dnus daffect ;
on observe une baisse de lintrt, pour les choses et les
personnes ;
une baisse du plaisir fonctionner: jouer, parler, manger;
une altration de la relation lautre, voire une hostilit ;
une baisse de linitiative ;
une diminution des rponses aux stimulations, en intensit
et en dure.
ABORD DE LENFANT DOULOUREUX
Plusieurs aspects sont importants.
Il faut instaurer une relation de qualit avec lenfant et ses
parents ; le soignant doit faire preuve dcoute, de confiance,
dempathie. La notion de confiance est la clef de vote de la prise
en charge pour que lenfant exprime ce quil ressent, puis, rci-
proquement, coute le soignant et adhre ses explications et
au traitement.
Le rle des parents est primordial ; bien souvent, ils savent inter-
prter les modifications de comportement de leur enfant et gui-
der le soignant dans lvaluation de la douleur. Ils connaissent
par ailleurs les stratgies de coping (pour faire face ) de leur
enfant, et peuvent laider attnuer la perception de sa douleur.
linverse, il faut savoir dceler certains dysfonctionnements
familiaux avec des parents qui transmettent leurs angoisses
leurs enfants, par exemple, ou reportent leur propre vcu sur
eux, majorant, voire induisant les douleurs.
Llimination pralable des autres facteurs de stress est
indispensable ; faim, froid, soif, inconfort sont trompeurs dans
lvaluation.
Linterrogatoire cherche faire prciser les caractristiques de
la douleur : anciennet, circonstances de survenue, localisation,
ventuelles irradiations, influences de divers facteurs ou des trai-
tements entrepris, horaires, caractres smiologiques; selon son
ge, lenfant dispose ou non dun vocabulaire lui permettant de
dcrire sa douleur, peut la dessiner sur le schma du corps humain
ou remplir un questionnaire de mots. Cette implication renforce la
relation de confiance et augmente la fiabilit de lvaluation.
Lexamen clinique est particulirement doux. Il commence par
un certain temps de dialogue et dobservation : quand lenfant
arrive, au repos, quand il se dshabille ou est dshabill par ses
parents ; le bb peut tre examin dans les bras de sa maman.
Lentre en matire peut se faire sur un mode ludique, par
lintermdiaire dun jouet ou dun objet transitionnel. Lexamen
dbute par les zones indemnes pour finir par celles douloureuses.
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENTS
Douleur chez lenfant : sdation et traitements antalgiques
ref05/04_Wood_563 25/03/04 13:43 Page 564
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
565
PRINCIPES DE LVALUATION
DE LA DOULEUR
Lvaluation a pour but de dpister la douleur en cas de doute
ou de dni de lenfant, de ses proches ou des soignants et de la
quantifier : pour choisir le traitement de faon pertinente, puis
suivre lvolution de manire fine et prcise et apprcier leffica-
cit de ce traitement, voire le rajuster.
Les outils utiliss (chelles, grilles) permettent de limiter
la subjectivit et garantissent le mme langage tous les intervenants.
Beaucoup dchelles suggrent un seuil dintervention thrapeu-
tique au-del duquel la douleur est considre comme trop intense;
il faut alors instaurer un traitement ou majorer celui en place.
Tous les enfants en situation potentiellement algogne sont
valus, quils se plaignent ou pas, de manire systmatique,
ainsi que tout enfant prsentant une modification du comporte-
ment non explique.Des chelles valides, adaptes la fois
lge de lenfant et au contexte sont utilises : douleur aigu,
postopra-toire, prolonge. On peut se rfrer aux recomman-
dations de lAnaes, publies en 2000, consultables sur le site
Internet www.anaes.org.
Lobtention dun score ne suffit pas : la plupart des outils
nvaluent que lintensit de la douleur. Il importe tout autant
dvaluer son retentissement global sur la vie de lenfant, aux
plans familiaux, sociaux, psychologiques, ventuellement scolaires.
VALUATION EN FONCTION DE LGE DE LENFANT
DE 0 3 ANS
Lenfant ne peut exprimer verbalement sa douleur ; on fait
donc une htro-valuation, base sur lobservation de son
comportement, de son visage ; les chelles utilises, dites com-
portementales, sont nombreuses.
La grille EDIN
De 0 3 mois : chelle de Douleur et dInconfort du Nouveau-
n (EDIN) [tableau1] value la douleur prolonge du nouveau-n,
terme ou prmatur ; le score obtenu varie de 0 (pas de dou-
leur) un maximum de 15. Le seuil dintervention thrapeutique
est 5/15 (tableau 1).
La NFCS (Neonatal Facial Coding System). Elle recherche quatre
modifications du visage lors dune douleur aigu, chez le nour-
risson de moins de 18 mois : froncement des sourcils, ouverture
de la bouche, accentuation du sillon nasolabial et fermeture des
yeux. Chacune est cote, 0 si absente ou 1 si prsente ; le score
total varie donc de 0 : absence de douleur, 4 : douleur maxi-
male, avec un seuil 1.
La douleur postopratoire. Elle est tudie par plusieurs chelles
dhtro-valuation :
lCHEOPS : (Childrens Hospital of East Ontario Pain Scale) :
de 1 6 ans, score de 4 13, seuil 9.
lAmiel-Tison inverse : de 1 mois 3 ans, score de 0 20 ;
lOPS (Objective Pain Scale), partir de 2 mois ; score de 0
10, seuil 3/10 (tableau 2).
La douleur provoque. Lors de soins ou gestes, elle peut tre
value par diffrentes chelles ; la DAN (douleur aigu du nou-
veau-n), utilisable jusqu 3 mois, dont le score varie de 0 10,
tudie les rponses faciales, les mouvements de membres, et
lexpression vocale de la douleur.
La DEGR (Douleur enfant Gustave Roussy) value la douleur prolonge.
Chez lenfant de 2 6 ans le score varie de 0 40, avec un seuil
10. Chacun des 10 items est cot de 0 4, selon quil est absent,
douteux, discret, vident ou massif. Ils correspondent des
signes directs de douleur (1, 3, 5, 7, 9), dexpression volontaire de
la douleur (4, 8), ou refltent une inertie psychomotrice (2, 6, 10) :
position antalgique au repos ;
manque dexpressivit ;
protection spontane des zones douloureuses ;
plaintes somatiques ;
attitude antalgique dans le mouvement ;
dsintrt pour le monde extrieur ;
contrle exerc quand on le mobilise ;
localisation des zones douloureuses ;
raction lexamen des zones douloureuses ;
lenteur et raret des mouvements.
chelle de douleur et dincofort
du nouveau-n
Tableau 1
VISAGE
CORPS
SOMMEIL
RELATION
RECONFORT
Visage dtendu
Grimaces passagres : froncement des sourcils,
lvres pinces, plissement du menton,
tremblement du menton
Grimaces frquentes, marques ou prolonges
Crispation permanente ou visage prostr, fig
ou visage violac
Dtendu
Agitation transitoire, assez souvent calme
Agitation frquente mais retour au calme
possible
Agitation permanente, crispation des extrmi-
ts, raideur des membres
ou motricit trs pauvre et limite, avec corps
fig
Sendort facilement, sommeil prolong, calme
Sendort difficilement
Se rveille spontanment en dehors des soins
et frquemment, sommeil agit
Pas de sommeil
Sourire aux anges, sourire-rponse, attentif
lcoute
Apprhension passagre au moment du
contact
Contact difficile, cris la moindre stimulation
Refuse le contact, aucune relation possible.
Hurlement ou gmissement sans la moindre
stimulation
Na pas besoin de rconfort
Se calme rapidement lors des caresses, au son
de la voix ou la succion
Se calme difficilement
Inconsolable. Succion dsespre
ref05/04_Wood_563 25/03/04 13:43 Page 565
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
566
Chez lenfant polyhandicap, lchelle de San Salvador a t
labore. Une premire grille, tablie par un de ses proches,
dcrit de manire dtaille le comportement habituel de len-
fant ; la grille dvaluation de la douleur recherche des modifi-
cations de comportement pouvant tre de trois ordres : signes
directs de douleur, de composante anxieuse ou de manifesta-
tions psychiques motrices. Chacun des 10 items est cot de 0
4, donnant un score de 0 40 ; la douleur est suspecte 2/40,
certaine 6/40.
ENTRE 3 ET 5 ANS.
Une auto-valuation peut tre tente ; si la comprhension
est incertaine, il faut se contenter dune htro-valuation.
VALUATION CHEZ LENFANT DE PLUS DE 5 ANS
Le niveau de dveloppement cognitif permet lenfant
danalyser sa douleur, den percevoir plus finement lintensit,
de disposer de vocabulaire pour la dcrire ; on pratique donc
une auto-valuation, en fournissant lenfant un outil pour
quil svalue lui-mme. Il est primordial de sassurer de la
bonne comprhension par lenfant ; on peut par exemple lui
faire utiliser deux chelles diffrentes et vrifier la concor-
dance des rsultats, ou faire coter une douleur ancienne.
De nombreuses chelles existent ; les critres de choix seront
la bonne matrise et la prfrence de lenfant.
Lchelle visuelle analogique (VA). Habituellement prsen-
te verticalement aux enfants, elle a lavantage dtre simple
et souvent dj connue deux mais elle ne convient pas tous.
L encore, un seuil dintervention thrapeutique a t dfini
3/10.
Les chelles numriques : de 0 10 ou de 0 100, ncessitent
une bonne matrise des chiffres ; la rptition des valuations
est particulirement aise.
Les chelles de visages sont plus accessibles et bien accep-
tes, surtout chez les plus petits et ceux parlant mal le fran-
ais. Elles ne doivent contenir ni larmes ni rires. La FPS-r pro-
pose 6 visages, permettant une cotation de 0 10 ; seuil
4/10 (figure).
Le schma du corps humain : on demande lenfant de dessiner
sa douleur, en employant ventuellement plusieurs couleurs en
fonction de lintensit ; ce procd est trs performant, sil nest
pas utilis comme un jeu, et valorise lenfant.
Poker Chip Tool est un ensemble de 4 jetons ; lenfant en choisit
de 0 quatre selon lintensit de sa douleur.
Algocube est compos de 6 cubes embotables ; lenfant
choisit celui dont la taille correspond limportance de sa
douleur.
Les chelles de vocabulaire peuvent tre faciles dutilisation
comme : douleur absente, lgre, intense, trs intense ;
le QDSA, nettement plus riche et complexe, est utilisable partir
de 10 ans seulement ; mais il offre une description qualitative de
la douleur, ainsi quune apprciation de son retentissement
psychologique.
PRINCIPES DU TRAITEMENT
Les objectifs sont prcis et ralistes : soulager la nuit, le jour
au repos, lors de la mobilisation passive ou active.
Pour les atteindre, ladhsion de lenfant et de ses proches est
indispensable.
Sur le plan pharmacologique, la voie orale est prfre
la voie injectable ; on utilise un antalgique de palier I pour les
douleurs lgres modres, II pour les douleurs modres
intenses, et III pour celles intenses ou trs intenses.
La prescription des antalgiques tient compte de la dure dac-
tion du produit et ceux-ci ne sont pas utiliss la demande .
Une prescription de recours en cas defficacit insuffisante
doit tre prvue sur lordonnance et des co-antalgiques peuvent
tre utiles : myorelaxants, anti-inflammatoires, antispasmo-
diques, anxiolytiques, sans ngliger les moyens non mdica-
menteux, selon les cas : thrapies physiques, thermothrapie,
rducation, contre-stimulation, ou psychologiques : relaxation,
distraction, hypnose.
Une rvaluation aprs deux trois prises mdicamenteuses
est ncessaire, puis rgulirement.
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENTS
Douleur chez lenfant : sdation et traitements antalgiques
Grille OPS (Objective Pain Scale)
Tableau 2
Pleurs
Mouvements
Comportement
Expression verbale ou corporelle
Absents
Prsents mais enfant consolable
Prsents et enfant inconsolable
Enfant veill et calme ou endormi
Agitation modre, ne tient pas en place, change de position
sans cesse
Agitation dsordonne et intense, risque de se faire mal
Enfant veill et calme ou endormi
Contract, voix tremblante, mais accessible aux questions et
aux tentatives de rconfort
Non accessible aux tentatives de rconfort, yeux carquills,
accroch aux bras de ses parents ou dun soignant
Enfant veill et calme ou endormi, sans position antalgique
Se plaint dune douleur faible, inconfort global, ou position
jambes flchies sur le tronc, bras croiss sur le corps
Douleur moyenne, localise verbalement ou dsigne de la main,
ou position jambes flchies sur le tronc, poings serrs, et porte
la main vers une zone douloureuse, ou cherche la protger
Variation de la pression artrielle systolique
par rapport la valeur pr-opratoire
Augmentation de moins de 10%
Augmentation de 10 20%
Augmentation de plus de 20%
Traduction Pediadol 2000
ref05/04_Wood_563 25/03/04 13:43 Page 566
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
567
TRAITEMENTS MDICAMENTEUX
Les contre-indications, prcautions demploi, interactions
mdicamenteuses et effets indsirables sont dans lensemble
superposables ceux de ladulte ; ne seront donc prcises ici
que les AMM, posologies et particularits ventuelles lies
lutilisation en pdiatrie.
PALIER I
Leurs indications sont les douleurs faibles modres ou en
association des antalgiques des paliers II ou III.
Le paractamol dispose de lAMM ds la naissance ; la posolo-
gie par voie orale et injectable (en IVL de 15 minutes) est de
60 mg/kg/j avec des prises espaces de 4 6 heures. La voie
rectale est viter, car labsorption est alatoire (posologie
90 mg/kg/j).
Les anti-inflammatoires non strodiens : Libuprofne (Nureflex,
Advil), le plus utilis, a lAMM 3 mois et est prsent en solution
buvable ; posologie : 10 mg/kg/8 heures.Le ktoprofne est
donn par voie orale ds 6 mois (Toprec) 0,5 mg/kg/6 8 h, ou
intraveineuse (IV) [Profnid] partir de 15 ans, Lacide niflu-
mique (Nifluril) : AMM 6 mois, 10 mg/kg/8 h ; lacide tiapro-
fnique (Surgam) : AMM 4 ans, 10 mg/kg/j ; le naproxne
(Apranax, Naprosyne) : AMM partir de 25 kg, 10 mg/kg/j.
Laspirine est de moins en moins utilise comme antalgique, en
raison de lallongement du temps de saignement induit et du
risque de survenue de syndrome de Reye. La posologie est de
25 50 mg/kg/j, les prises tant espaces de 4 heures au moins.
PALIER II
Leurs indications sont les douleurs modres intenses.
La codine a lAMM partir de 1 an. Elle est prsente seule
dans le sirop Codenfan, ou souvent associe du paractamol
(Dafalgan codine, Codoliprane, Efferalgan codine). La posolo-
gie est de 0,6 1 mg/kg/prise de codine-base, avec des prises
espaces de 4 6 heures, sans dpasser 6 mg/kg/j. Le seuil
toxique est 2 mg/kg en une prise, avec un risque vital
5 mg/kg en une prise. Les effets secondaires sont : la constipa-
tion ( prvenir si lutilisation est prolonge), parfois des nau-
ses, vertiges, somnolence, vomissements. Les contre-indica-
tions sont : lhypersensibilit la codine, linsuffisance
respiratoire svre non contrle, lassociation des agonistes-
antagonistes morphiniques.
Le dextropropoxyphne na lAMM qu partir de 15 ans.
Le tramadol (Topalgic, Contramal) voit son utilisation sten-
dre. Son AMM est actuellement partir de 12 ans. La posologie
est de 1 2 mg/kg/prise, 3 4 fois par jour, sans dpasser
8 mg/kg/j ; les effets secondaires sont : vertiges, somnolence,
nauses, scheresse buccale, sudation.
PALIER III
Leurs indications sont les douleurs intenses trs intenses.
1. Morphine orale :
Elle na lAMM qu partir de 6 mois ; chez le plus petit, un
dbut de traitement peut tre instaur lhpital.
Comme chez ladulte, la posologie est strictement individuelle,
Ces visages montrent combien on
peut avoir mal. Ce visage (montrer
celui de gauche) montre quelquun qui
na pas mal du tout.
Ces visages (les montrer un un de
gauche droite) montrent quelquun
qui a de plus en plus mal, jusqu
celui-ci (montrer celui de droite),
qui reprsente quelquun qui a trs
trs mal.
Montre-moi le visage qui montre
combien tu as mal en ce moment.
Les scores sont, de gauche droite :
0, 2, 4, 6, 8, 10. 0 correspond donc
pas mal du tout et 10 correspond
trs trs mal .
Remarques :
Exprimez clairement les limites
extrmes :
pas mal du tout et trs trs mal .
Nutilisez pas les mots triste ou
heureux .
Prcisez bien quil sagit de la sensation
intrieure, pas de laspect affich de
leur visage. Montre-moi comment tu
te sens lintrieur de toi .
Faces Pain Scale Revised (FPS-R)*
Figure
Hicks, C.L., von Baeyer, C.L., Spafford, P., van Korlaar, I., & Goodenough, B. The Faces Pain Scale Revised : Toward a common metric in
pediatric pain measurement. Pain 2001 ; 93:173-183. Scale adapted from : Bieri, D, Reeve, R, Champion, G, Addicoat, L and Ziegler, J. The Faces.
Pain Scale for the self-assessment of the severity of pain experienced by children : Development, initial validation and preliminary
investigation for ratio scale properties. Pain 1990 ; 41 : 139-150. Version : June 2001
*Pain Research Unit, Sydney Childrens Hospital, Randwick NSW 2031, Australia. Ce matriel peut tre photocopi pour une utilisation
clinique. Pour tout autre demande, sadresser au Pain Research Unit, contact : piirat@sesahs.nsw.gov.au
ref05/04_Wood_563 25/03/04 13:43 Page 567
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
mais doit tre dbute avec des quantits diminues de moiti
chez les moins de 3 mois. Il nexiste pas de posologie maximale,
tant que les effets secondaires sont contrls.
La titration se fait idalement avec de la morphine daction
rapide et brve : 0,3 0,5 mg/kg en dose de charge, puis
0,2 mg/kg toutes les 4 heures ; lefficacit est rvalue aprs
2 prises. Si elle est insuffisante, les doses sont augmentes par
paliers de 30 50 %.
Quand la posologie journalire est trouve, on peut la remplacer
par de la morphine daction retarde et prolonge (LP), en 2 prises
quotidiennes, en mnageant toujours la possibilit dinterdoses de
forme rapide en cas de pic douloureux, mais aussi prventivement,
45 minutes avant les gestes douloureux, chaque interdose quivalant
au 1/6 de la dose journalire.
La constipation est prvenue systmatiquement ; les autres
effets secondaires : nauses, vomissements, prurit, au cas par
cas ; la sdation cde le plus souvent en quelques jours.
Prsentations de morphine orale daction brve
lchlorhydrate de morphine en solution buvable : Morphine
Cooper 0,1 ou 0,2 %, en ampoules de 10 et 20 mg ; son got
amer doit faire prparer un sirop sucr froid pour permet-
tre son acceptation.
lsulfate de morphine : Svrdol en comprims de 10 et 20 mg,
Actisknan en glules de 5, 10, 20 et 30 mg qui peuvent tre
ouvertes, et les microgranules quelles contiennent, mlan-
gs un aliment semi-liquide, ou introduits dans une sonde
de nutrition entrale dun diamtre maximal de 16 gauges,
rince ensuite.
Prsentations de morphine orale daction prolonge (sulfate de
morphine) :
lMoscontin en comprims et Sknan en glules contenant
des microgranules, utilisables comme ceux de lActisknan ;
ils sont doss 10, 30, 60, 100 et 200 mg ;
lLe Kapanol en 1 prise par jour, 20, 50 et 100 mg, na lAMM
que chez ladulte.
2. Morphine injectable (chlorhydrate
de morphine) :
Elle a lAMM ds la naissance ; elle est indique quand la voie
orale est impossible ou quand une douleur excessivement
intense ncessite une action trs rapide.
Linjection sous-cutane est douloureuse, donc gnrale-
ment vite chez lenfant (1 mg de morphine SC quivaut 2 mg
de morphine orale).
Elle est donc le plus souvent injecte en intraveineux, le dlai
daction est de 10 20 minutes ; 1 mg de morphine IV quivaut
2 3 mg de morphine orale ; pour ces 2 voies, la dure daction
est de 4 heures.
La titration se fait en injectant 0,1 mg/kg en IVD en dose
de charge, suivie de rinjections de 0,025 mg/kg espaces
de 10 minutes, en surveillant la fois lvolution de lintensit
douloureuse et lapparition dventuels effets secondaires, jus-
qu lobtention dune analgsie satisfaisante ; la dose totale
injecte correspond approximativement la dose ncessaire
pour les 4 heures suivantes.
La poursuite du traitement peut se faire ds lge de 6 ans,
par des pompes danalgsie autocontrle ou PCA, avec
des bolus que lenfant sadministre lui-mme, le plus souvent de
0,02 0,04 mg/kg, espacs dune priode rfractaire de 6
10 minutes ; il est primordial dexpliquer en dtail le fonctionne-
ment de la pompe, den vrifier la comprhension et lutilisation.
Un dbit continu peut tre associ, dans les douleurs trs
intenses ou chez les enfants puiss, de lordre de 0,01
0,04 mg/kg/h en gnral, voire plus.
Chez les plus petits, ou ds lors que lon nest pas sr de
la bonne matrise de lappareil par lenfant, on se limitera un
dbit continu, en mnageant la possibilit de bolus infirmiers, en
cas de douleur survenant malgr le traitement, et en prvision
des gestes douloureux, 10 minutes avant eux : soins, toilette,
mobilisation, par exemple.
La surveillance dun traitement par morphine intraveineuse com-
prend: lvaluation de son efficacit sur la douleur et des effets ind-
sirables: somnolence et frquence respiratoire, tout en sachant que
la somnolence prcde toujours la dpression respiratoire.
3. Autres analgsiques des paliers III
La nalbuphine (Nubain) : Cest un agoniste-antagoniste de
la morphine, avec un effet plafond atteint pour des doses de
0,3 mg/kg toutes les 4 heures ; il entrane moins deffets secondai-
res que la morphine et est donn, soit en discontinu, 0,2 mg/kg
toutes les 4 heures, en IVL pour viter un effet flash , soit, plus
efficace, en continu 1,2 mg/kg/j la suite dune dose de charge
de 0,2 mg/kg. Il peut galement tre utilis, faibles doses
(0,1 mg/kg/j) pour diminuer les effets indsirables de la morphine.
La buprnorphine : (Temgsic) est un agoniste-antagoniste,
avec un effet plafond. Il est autoris en comprims sublinguaux
de 0,2 mg partir de 7 ans, la posologie de 6 g/kg/j.
Lhydromorphone : (Sophidone), glules de 4, 8, 16 et 24 mg est
un agoniste pur autoris partir de 7 ans ; utilis dans le cadre
de la rotation des opiodes, il est donn en 2 prises quotidiennes ;
4 mg correspondent 30 mg de morphine per os.
DOULEUR SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENTS
POINTS FORTS
> La douleur est vcue diffremment par lenfant.
La connaissance des niveaux de dveloppement cognitifs
en fonction de lge aide le soignant mieux le comprendre
et communiquer avec lui.
> Elle sexprime diffremment : ses manifestations,
bruyantes la phase initiale, cdent le pas un tableau
dinertie psychomotrice, avec un enfant prostr et
inexpressif si elle se prolonge.
> Lvaluation est rendue plus fiable par lutilisation
doutils, chacun tant valid pour un contexte et une
tranche dge donns.
> Les principes du traitement sont superposables ceux
de ladulte, avec malheureusement de frquents usages
hors AMM.
retenir
568
Douleur chez lenfant : sdation et traitements antalgiques
ref05/04_Wood_563 25/03/04 13:43 Page 568
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 4 : 5 4
569
Le fentanyl percutan : (Durogsic), na pas encore lAMM chez
lenfant. La dure daction des patchs est de 72 heures ; le plus faible
dosage est de 25 g par heure ; il existe aussi des dosages 50,
75 et 100 g/h, avec une table de correspondance des doses avec
la morphine orale.
DOULEUR PROVOQUE
Elle est dautant plus combattre quelle est prvisible et
particulirement redoute des enfants.
Le MEOPA (mlange quimolaire doxygne et de protoxyde
dazote) a des proprits antalgiques faibles, anxiolytiques,
euphorisantes et amnsiantes, facilitant grandement la ralisa-
tion des gestes douloureux ; il doit tre inhal par lenfant de
faon continue, au moins trois minutes avant le dbut du geste
et pendant toute sa dure. Ses contre-indications sont rares :
troubles de la conscience, insuffisance respiratoire aigu,
squestration gazeuse, traumatisme facial empchant lapplica-
tion du masque ; il entrane peu deffets secondaires et est li-
min rapidement. Si la douleur prvisible est intense, il faut asso-
cier un antalgique adapt.
LEMLA permet, ds la naissance et mme chez le prmatur,
danesthsier la peau sur une profondeur de 3 mm en 1 heure,
5 mm en 2 heures (si le geste est plus profond, il faut associer
une anesthsie locale). Leffet disparat en 2 4 heures aprs
son ablation. Il est identique pour tous les gestes avec effraction
cutane, ponctions veineuses, lombaires, chirurgie cutane
superficielle (ablation de molluscum contagiosum) et contre-
indiqu en cas de porphyries, mthmoglobinmies congnita-
les ; associations dconseilles : mdicaments mthmoglobi-
nmiants.
Le saccharose : chez le nouveau-n terme et le prmatur,
la douleur lie aux gestes peut tre diminue par labsorption,
2 minutes avant le geste, dune solution sucredonne dans une
seringue, comme du saccharose 25 %(0,3 ml/kg pour les
moins de 2 kg, 2 ml chez les nouveau-ns terme), suivie de
la succion dune ttine non nutritive prolonge pendant toute
la dure du geste sans dpasser 6 absorbtions par jour.
DOULEURS NEUROGNES
Ces douleurs sont traites essentiellement par :
des anti-pileptiques, pour les douleurs paroxystiques ; le clo-
nazpam (Rivotril), la carbamazpine (Tgrtol), la gabapentine
(Neurontin) sont les plus utiliss, tous hors AMM, dose progres-
sivement croissante jusqu trouver la dose minimale efficace ;
les antidpresseurs, pour leur composante continue et
paroxystisque ; la clomipramine (Anafranil) et lamitriptyline
(Laroxyl, plus sdatif) sont ceux ayant le plus fait preuve de leur
efficacit.
Les posologies sont, l encore, trs variables, de 0,1 1 mg/kg/j.
Peu dtudes concluantes existent sur les inhibiteurs de
la recapture de la srotonine. B
A / VRAI OU FAUX ?
valuation de la douleur :
Chez un enfant de 4 ans la douleur
peut tre value avec certaines
chelles dauto-valuation.
Lchelle des visages peut tre
utilise chez un petit de 2 ans.
Les chelles de douleur postopra-
toires sont encore valides J5 chez
un enfant de 5 ans.
Chez un pradolescent lVA est simple,
en gnral bien accepte et fiable.
B / VRAI OU FAUX ?
La thrapeutique :
La codine est utilisable chez
le nouveau-n.
1
4
3
2
1
Il peut tre intressant dassocier
un anti-inflammatoire avec un
mdicament du palier II de lOMS.
La morphine orale admet une
posologie maximale de 1,5 mg/kg/jour.
La morphine en PCA intraveineuse
peut tre utilise partir de 6 ans.
Chez lenfant, les douleurs neuropa-
thiques ou neurognes sont traites
prfrentiellement par les antalgiques
des diffrents paliers de lOMS.
C / QCM
Chez le nouveau-n sont fortement
vocateurs de douleurs prolonges :
Des pleurs.
Un visage inexpressif.
2
1
4
4
3
2
Une agitation.
Des cris.
Une immobilit.
5
4
3
M I N I T E S T D E L E C T U R E
R p o n s e s : A : V , F , F , V / B : F , V , F , V , F / C : 2 , 5 .
DEJ PARU DANS LA REVUE
Mdicaments de lurgence en pdiatrie
Chron G, Bocquet N, Timsit S, Cojocaru B
(Rev Prat 2001 ; 51 [17] : 1914-8)
POUR EN SAVOIR PLUS
Prise en charge de la douleur chez
lenfant : une approche multidisciplinaire
Twycross A, Moriarty A, Betts T.
Masson d 2002
Site internet www.anaes.org
ref05/04_Wood_563 25/03/04 13:43 Page 569
Cancrologie
Partie I Module 6 Q 69
2279 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
une coute et un soutien psychologique, social et spi-
rituel du patient et de son entourage ainsi quun
soutien des soignants ;
un travail interdisciplinaire ;
une collaboration avec les bnvoles daccompagne-
ment ;
une connaissance des aspects rglementaires donto-
logiques et juridiques relatifs aux soins palliatifs en y
intgrant une rflexion thique propre aux situations
de fin de vie ;
des modalits organisationnelles originales (EMSP,
USP, quipe de soins palliatifs domicile, rseau de
soins palliatifs).
CONCEPT ET DOMAINE DAPPLICATION
DES SOINS PALLIATIFS
Les patients qui requirent des soins palliatifs (le plus sou-
vent, mais non exclusivement, des patients cancreux) ne
sont pas toujours faciles identifier pour le clinicien car la
frontire nest pas toujours nette entre phase curative et
phase palliative de la maladie : des soins curatifs et pallia-
tifs peuvent tre ncessaires alternativement voire en
mme temps chez un mme patient. Aujourdhui, dans
lvolution actuelle du mouvement des soins palliatifs en
France et dans le monde, on peut dire que :
la phase curative est une priode dans lvolution
naturelle dune maladie potentiellement mortelle pen-
dant laquelle la gurison, ou du moins une rmission
complte et durable, est une attente raliste ; le
pronostic vital nest pas en jeu;
la phase palliative est celle o le pronostic vital est
engag de faon irrmdiable et lincurabilit certaine.
La maladie est volutive. Deux phases palliatives peuvent
tre distinctes, lune o des soins spcifiques ont une
place pour obtenir un ralentissement de lvolution de
la maladie, lautre, la phase terminale proprement
dite, o plus aucun traitement spcifique na dintrt.
Longtemps, les soins palliatifs ont t assimils
cette phase terminale des maladies.
La fig. 1 rsume lintrication des approches palliatives
et curatives. Certaines quipes prfrent parler de soins
continus . En cancrologie, les soins palliatifs correspon-
L
es soins palliatifs offrent une prise en charge
globale et multidisciplinaire des situations de fin de
vie par :
une valuation et un traitement de la douleur et des
autres symptmes prsents par le patient ;
Soins palliatifs pluridisciplinaires
chez un malade en fin de vie
Accompagnement dun mourant et de son entourage
Les soins palliatifs et laccompagnement
cherchent viter les investigations
et les traitements draisonnables et se refusent
provoquer la mort ; ils sefforcent
de prserver la meilleure qualit de vie possible
jusquau dcs
Ils offrent une prise en charge globale
et pluridisciplinaire des besoins physiques,
psychologiques, sociaux et spirituels du malade,
ainsi quun soutien de ses proches avant
et aprs le dcs.
Ils concernent tous les patients atteints
de maladie grave volutive ou terminale,
quels que soient la pathologie concerne
et lge du patient.
Leurs aspects lgislatifs et organisationnels
ont beaucoup volu, reconnaissant ainsi
le droit toute personne malade dont ltat
le requiert daccder des soins palliatifs
et un accompagnement .
Les quipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)
et les units dhospitalisation de soins palliatifs
(USP) sont cres pour permettre la prise
en charge des cas les plus difficiles,
former les professionnels de sant et dvelopper
la recherche en soins palliatifs.
Points Forts comprendre
Unit de recherche et de soutien en soins palliatifs
CHU de Grenoble
BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09
glaval@chu-grenoble.fr
Dr Guillemette LAVAL, Dr Marie-Laure VILLARD
Priodes curatives et palliatives dune maladie grave volutive.
1
dent en partie aux soins supportifs (ou soins de sup-
port) destins au maintien de la qualit de vie des patients
depuis lannonce du cancer jusqu leur gurison ou leur
dcs.
LAPPROCHE GLOBALE : UNE NCESSIT
EN SOINS PALLIATIFS
Le patient, par la maladie et les expriences de sparation
auxquelles elle le confronte, peut vivre une souffrance
physique, psychique, sociale et spirituelle. Cest la douleur,
les diffrents symptmes prsents, les craintes, les
incomprhensions, les pertes diverses (rle familial, rle
professionnel, perte de lautonomie, de limage de soi),
voire la souffrance de lentourage qui peuvent gnrer une
souffrance globale. Saunders nomme cette souffrance,
chez le patient cancreux en phase terminale, la douleur
totale . De ce fait, une quipe pluridisciplinaire associant
professionnels, bnvoles, et reprsentant du culte est
indispensable permettant soins et thrapeutiques adapts
ainsi quune aide matrielle, psychologique et spirituelle.
VALUATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR
ET DES AUTRES SYMPTMES
En phase terminale, le malade prsente en moyenne 3 4
symptmes, qui doivent faire lobjet dune valuation
quantitative initiale et rpte au cours du suivi laide
dchelles appropries [chelle visuelle analogique
(EVA), chelle verbale simple (EVS)]. Il faut traiter la
cause du symptme chaque fois que possible (tableau I).
Lensemble des recommandations et traitements proposs
ci-dessous sont adapter en fonction de lge, de la fonc-
tion rnale et de la fonction hpatique.
Douleur
La douleur est frquente en soins palliatifs (tableau II).
Son valuation et son traitement sont dcrits dans les
articles n
os
Q65 ( paratre), Q66 ( paratre), Q68 (
paratre).
On rappelle que la morphine na aucune contre-
indication chez un patient en phase terminale avec des
douleurs nociceptives intenses. La posologie de dpart est
de 1 mg/kg/j, sauf chez linsuffisant rnal et la
personne ge (0,25 0,5 mg/kg/j). Laugmentation pro-
gressive des doses se fait en moyenne par palier de 30
50%/j. La diversit des morphiniques forts, maintenant
disponibles en France pour la douleur (morphine, hydro-
morphone, oxycodone, fentanyl) et la multiplicit des
formes galniques disponibles (comprim, glule, solu-
tion buvable, solution injectable, patch
transdermique,btonnet transmuqueux) offrent des possi-
bilits thrapeutiques importantes.
Autres symptmes rencontrs
Leur frquence varie selon les tudes (tableau II).
Lasthnie, lanorexie, la constipation et les troubles neu-
ropsychiques sont les plus frquents.
1. Constipation
Elle est trs frquente et gnante. En mdecine palliative,
elle est souvent multifactorielle, organique (cancer) et
(ou) surtout fonctionnelle (tableau III), en grande partie
explique par la grabatisation et par les mdicaments.
Quand la constipation sinstalle malgr de bonnes
mesures hygino-dittiques (hydratation, fibres, activit
physique) un traitement laxatif devient ncessaire. Il est
systmatiquement prescrit chez un patient qui reoit de la
morphine.
Une association classique est le lactulose (Duphalac,
S OI NS PAL L I AT I F S P L UR I DI S CI P L I NAI R E S CHE Z UN MAL ADE E N F I N DE V I E
2280 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
Traiter la cause du symptme chaque fois que possible
Prvenir le symptme de faon continue (prise heures
rgulires des antalgiques, des anti-mtiques)
Soulager le symptme compltement et en liminer
le souvenir (valuer lintensit du symptme et raliser
un suivi clinique avec rvaluation)
Garder le patient le plus valide possible (viter chaque
fois que possible des traitements assujettissants :
sondes, perfusions)
Prserver les facults intellectuelles (viter chaque fois
que possible des traitements sdatifs)
Privilgier la voie orale le plus longtemps possible
Soulager est toujours une urgence
Daprs B. Mount.
Principes de traitement de la douleur
et des autres symptmes en soins palliatifs
TABLEAU I
Traitements
spcifiques
Priode curative
Soins supportifs
Soins palliatifs
Soins
terminaux
Priode palliative
Traitements
non spcifiques
Espoir
de gurison
Diagnostic
du cancer
Espoir
de rmission
Diagnostic
dvolution
locale incurable
ou de premires
mtastases
Phase
terminale
Diagnostic
dentre
en phase
terminale
Dcs
continu). Les strons (Zophren, Kytril, Navoban,
Anzemet), indiqus dans les vomissements radio- ou
chimio-induits, peuvent tre essays dans les vomisse-
ments rebelles par syndrome occlusif.
3. Occlusion intestinale
Locclusion intestinale maligne chez les patients en phase
terminale est rarement rscable (cachexie, stnose ta-
ge, adhrences). La mise en place dune endoprothse
digestive reste rare mais possible dans locclusion stno-
se unique, en particulier haute, pyloro-duodnale. La pose
dune sonde nasogastrique, presque toujours ncessaire
la mise en place du traitement mdical, doit rester une
mesure temporaire, car elle est intrusive. En cas dchec
des traitements mdicaux bien conduits, elle doit tre rem-
place, sauf impossibilit, par une gastrostomie de dchar-
ge (fig. 2).
Le traitement mdical associe un corticode (rduction de
1 2 sachets 3/j) ou le macrogol (Forlax, 1 2 sachets,
1 2 fois/j) avec le docusate sodique (Jamylne 1
2 comprims, 3 fois/j). Les laxatifs irritants base de sn
sont parfois ncessaires.
2. Nauses et vomissements
Ils sont souvent multifactoriels. Lanalyse des causes et
des mcanismes mis en jeu permet de guider le choix des
thrapeutiques. Par exemple, les vomissements par hyper-
calcmie ou par hypertension intracrnienne sont particu-
lirement rebelles aux antimtiques, de mme que ceux
par occlusion intestinale haute, rappelant combien la
dmarche tiologique est primordiale. Souvent, plusieurs
antimtiques associs sont ncessaires, les plus utiliss
tant le mtoclopramide (Primpran, 30 90 mg/24 h en 3
prises per os ou par voie sous-cutane en discontinu ou
continu) et lhalopridol (Haldol, 3 15 mg en 1 3 prises
per os, SC ou IV, demi-dose/voie orale en discontinu ou
Cancrologie
2281 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
Revue EMSP
de la littrature CHU de Grenoble
2000 2001, n = 185
Douleur physique, 11 88 70
tous mcanismes
confondus
Asthnie 12 81 98
Anorexie 6 87 81
Constipation 6 46 61
Nauses seules 13 44 32
Vomissements seuls 10 27 26
Occlusion intestinale / 12
Dyspne 21 64 30
Toux / 26
Encombrement
laryng, bronchique
ou rles agoniques / 35
Troubles
confusionnels avec
ou sans agitation 3 47 27
Anxit ou angoisse 14 69 45
Dpression nerveuse 18 39 28
Prvalence de quelques symptmes
rencontrs chez les patients
en soins palliatifs (%)
TABLEAU II
Causes organiques : obstruction colique
Tumeur, stnose
intrinsque ou extrinsque avec ou sans carcinose
pritonale
Adhrence
par brides post-chirurgicales, ou par fibrose
post-radiothrapie
Affection proctologique
Fissure, fistule, abcs, prolapsus
Causes fonctionnelles : par troubles
de la progression colique ou par dyschsie
(absence de sensation de besoin)
Mdicaments
opiacs
anticholinergiques dont la scopolamine
antidpresseurs tricycliques
phnothiazines/antihistaminiques
Perturbations mtaboliques
hyperkalimie, hypercalcmie, dshydratation
Perturbations neuro-vgtatives
tumeur crbrale, diabte, Parkinson, paraplgie
Causes lies l'tat gnral
ge avanc, alitement, rgime pauvre en rsidu,
insuffisance dapport hydrique
Principales causes
de la constipation chez les patients
en soins palliatifs
TABLEAU III
ldme pritumoral et possible leve dobstacle), un
anticholinergique (antispasmodique et antiscrtoire) ou,
si besoin, un analogue de la somatostatine, un antim-
tique, et un antalgique. Les soins de bouche sont impor-
tants et rpts. Lhydratation parentrale est mise en
place, sauf chez certains patients qui parfois peuvent
continuer de boire ou mme de salimenter a minima
(occlusion basse).
4. Dyspne
S OI NS PAL L I AT I F S P L UR I DI S CI P L I NAI R E S CHE Z UN MAL ADE E N F I N DE V I E
2282 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
Traitement symptomatique de locclusion intestinale
maligne non rscable.
2
Sonde naso-gastrique*
Rhydratation parentrale
Antimtique* :
Haldol (halopridol)
ou Largactil (chlorpromazine)
ou quivalent
Antiscrtoire antispasmodique :
Scopolamine (hyoscine hyobromide)
ou Scoburen ou Buscopan (Butylbromure de Scopolamine)
moins deffets indsirables centraux que la Scopolamine
Corticodes :
Solumdrol (mthylprdnisolone)
ou quivalent
Antalgiques* :
1
er
, 2
e
ou 3
e
palier de lOMS
* : introduits et (ou) maintenus selon les symptmes.
Diminution,
puis arrt
des corticodes
et des antiscrtoires
Arrt corticodes
et antiscrtoires
Introduction Sandostatine
(Octrotide)
Aprs 5 jours de traitement
Non leve de locclusion Leve de locclusion
Recherche
de la posologie
minimale
efficace
Indication
de gastrostomie
chirurgicale
ou endoscopique
Aprs 3 jours de traitement
Poursuite des vomissements Arrt des vomissements
Cest une sensation subjective dinconfort respiratoire
avec une impression de soif dair . Comme pour la dou-
leur, le patient peut en valuer lintensit.
Les causes de la dyspne sont essentiellement tumorales,
cardiaques, infectieuses, ou mtaboliques. Lorsque le trai-
tement spcifique de la pathologie en cause nest plus pos-
sible, des traitements tiologiques (diurtiques, antibio-
tiques, anticoagulants, corticodes, bronchodilatateurs
autres, oxygnothrapie, physiothrapie) ou symptoma-
tiques peuvent tre proposs.
Les 2 traitements symptomatiques essentiels sont la mor-
phine et les benzodiazpines.
La morphine amliore la dyspne par diminution de la
sensibilit des rcepteurs aux variations de PaCO
2
et de la
PaO
2
ce qui ralentit le rythme respiratoire avec diminution
de lespace mort. Les doses sont progressives avec, au
dpart, 0,5 mg/kg soit environ 2,5 mg toutes les 4 h par
voie orale (demie-dose en SC ou 1/3 dose en IV). Chez un
patient dj sous morphine, on peut augmenter de 30% la
posologie reue par 24 h. En pratique, comme pour la dou-
leur, il est prfrable de donner des supplments la
demande et de radapter en consquence la dose de fond.
Les benzodiazpines amliorent la dyspne par leur effet
anxiolytique et, plus accessoirement, myorelaxant. Les
plus utiliss sont le diazpam (Valium), 2 5 mg 1 2
fois/j per os si possible (3 gouttes 1 % = 1 mg) ou par
voie rectale. Lorsque la voie orale nest pas possible, le
midazolam (Hypnovel) par voie SC ou IV, est utilis
dose progressive partir de 0,5 1 mg/h en continu en res-
pectant les recommandations abordes plus loin dans les
situations durgence (non disponible en ville).
Dans tous les cas, des moyens simples de confort sont
mettre en place (prsence rassurante, paroles dexplication,
courant dair frais, position semi-assise). Loxygne
nest maintenir que sil amliore la dyspne.
5. Toux, encombrement et rles de lagonie
En labsence de traitement tiologique de la toux et de
lencombrement, on utilise des fluidifiants, lhumidifica-
tion et la kinsithrapie respiratoire associe une ven-
tuelle aspiration. Chez le patient en mauvais tat gnral
ou en phase terminale, nayant plus la force dexpectorer,
les mesures prcites sont abandonnes au profit dun
asschant des scrtions, la scopolamine injectable (0,25
0,5 mg en SC ou IV toutes les 4 ou 8 h ou en continu) ou
en patch (Scopoderm, 1 4 patchs toutes les 72 h). Cest le
traitement de rfrence des rles de lagonie. En cas de
toux non productive, les antitussifs sont ncessaires. La
codine et, si besoin, la morphine peuvent tre efficaces.
6. Nutrition, hydratation
Il sagit l dune question trs importante en soins
palliatifs. Il est important de comprendre que, selon ltat
du patient, le stade volutif de la maladie et le bilan nutri-
tionnel, la stratgie est diffrente, allant des simples
conseils dittiques une nutrition entrale ou parentrale.
Dans tous les cas, lalimentation orale est privilgie. Sauf
contre-indication, lapptit peut tre stimul par une corti-
cothrapie en cure courte de 10 jours de 0,25 0,5
psychologique.
Les tats confusionnels doivent toujours faire rechercher
une cause somatique (lsions crbrales), mtabolique
(hypercalcmie), iatrognique (opiacs forts). En labsence
de traitement tiologique possible, seule lagitation psycho-
motrice fait prescrire un neuroleptique plus ou moins
sdatif (Haldol, Largactil ou Nozinan).
8. Autres symptmes
Lasthnie (ou limpression gnrale de fatigue), en lab-
sence de traitement tiologique (douleur, psychasthnie,
dnutrition, anmie), peut tre amliore par une corti-
cothrapie en cure courte.
Les troubles trophiques sont domins par les escarres dont
la prvention est primordiale (positionnement, effleurage
des zones dappui, matelas anti-escarres). Selon le stade
volutif du patient, les soins sont curatifs ou palliatifs. On
veillera ladaptation du traitement de la douleur. tous
les stades, les hydrocollodes (Duoderm, Comfeel) peu-
vent tre utiliss. Dans le cas des mauvaises odeurs, un
anti-anarobie peut tre associ par voie locale (Flagyl).
En cas de situations durgence (agitation terminale,
hmorragie massive, accs de dyspne aigu, souffrance
existentielle majeure), une sdation peut tre propose.
Elle fait aujourdhui lobjet de recommandations. Le
mdicament de choix est le midazolam (Hypnovel) du fait
de sa demi-vie courte et de son effet sdatif dpendant de
la dose. Chez ladulte, il est utilis en IV raison de 0,5
mg/2 3 min jusqu lobtention de la sdation complte.
Pour entretenir la sdation jusquau moment prvu du
rveil, il faut prescrire une dose horaire gale 50 % de la
dose utile linduction, en perfusion intraveineuse conti-
nue. Par voie sous-cutane, linjection de dpart est de
0,05 0,1 mg/kg.
COUTE ET SOUTIENPSYCHOLOGIQUE,
SOCIAL ET SPIRITUEL DU PATIENT
ET DE SONENTOURAGE SOUTIENDES SOIGNANTS
Le malade
Le malade en soins palliatifs vit une crise existentielle dif-
ficile, avec des deuils faire pour accder une perspecti-
ve diffrente de ce quil imaginait et attendait de la vie.
Lespoir reste toujours prsent, mais les ambitions peuvent
diminuer jusqu parvenir parfois lacceptation dune fin
inluctable. On saccorde pour dire quil faut maintenir
lespoir dans les limites du raisonnable, cest--dire de ne
pas entretenir de faux espoirs ni dcourager le malade. Le
code de dontologie mdicale, article 35, stipule que le
mdecin doit la personne quil examine, quil soigne ou
quil conseille, une information lgale, claire et approprie
sur son tat un pronostic fatal ne doit tre rvl
quavec circonspection.
Les sentiments et attitudes vcus par les patients peu-
vent fluctuer selon les moments. Le patient va vivre :
refus, dngation, dni, rvolte, colre, agressivit, matri-
se (rationalisation), repli sur soi, tristesse, rgression
mg/kg/j. Il est important de toujours vrifier ltat buccal
et traiter, si besoin, une lsion ce niveau.
Lhydratation des patients en phase terminale a fait lobjet
de nombreuses discussions. Le consensus actuel est dhy-
drater pour prvenir confusion et agitation. Dans tous les
cas, les soins de bouche sont importants et contribuent
labsence de sensation de soif. En cas de fausse route,
leau glifie est utile. Lorsque la voie orale nest plus
possible et la voie intraveineuse difficile, la voie sous-
cutane peut tre utilise pour une hydratation de 500 mL
1 L/24 h de solution sale isotonique, sans addition
dlectrolytes, ou de glucos 2,5 % additionn de 4 g
NaCl (un apport trop important peut aggraver lencombre-
ment bronchique terminal). Les principaux mdicaments
utilisables par voie sous-cutane sont rsums dans le
tableau IV.
7. Troubles neuropsychiques
Lanxit, la tristesse, la dpression font appel, plus
quaux mdicaments, laccompagnement ou au soutien
Cancrologie
2283 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
Type
de traitement
Continu
possible
Discontinu
uniquement
Anti-
inflammatoires
non strodiens
Diphosphonates
Antimtiques
Antiscrtoires
(digestif,
respiratoire)
Antibiotiques
Antiulcreux
Constipation
Diurtiques
Corticodes
Sdation
Primpran
Haldol
Largactil
Zophren
Scopolamine
Buscopan
(Scoburen)
Raniplex
Azantac
Lasilix
Hypnovel
Nozinan
Profnid
Clastoban
Atropine
Pnicilline
Rocphine*
Amiklin
Prostigmine
Solumdrol
Soludcadron
Principales thrapeutiques
utilisables par voie sous-cutane
TABLEAU IV
* : 2 g dans 5 mL de Xylocane 1 % en SC directe.
Dilution des produits :
avec un solut isotonique NaCl 9 ou du glucos 5 %. Sauf Primpran,
uniquement avec NaCl 9 .
Certains produits peuvent tre administrs dans la mme seringue :
morphine avec tout autre produit (sauf corticodes) ;
morphine + Haldol + Scopolamine (ou Buscopan ou Scoburen ou atropine).
mais aussi combativit et acceptation ou sublimation.
Le climat de confiance tabli par le mdecin, les soi-
gnants et les autres partenaires de la sant permet coute
et soutien. Le psychologue aide le patient exprimer
son vcu et laborer autour de ses difficults, reprer
ses mouvements dfensifs, ramnager ses liens rela-
tionnels
La souffrance sociale correspond la peine prouve
par le malade vis--vis de ses proches, et de ceux-ci vis-
-vis de lui. Elle correspond aussi aux difficults
sociales quil va vivre (activit professionnelle, ques-
tions financires, maintien au domicile). Les soignants,
psychologue, assistante sociale, bnvoles vont interve-
nir selon les besoins.
La souffrance spirituelle rside dans le questionnement
douloureux que se pose le patient sur le sens de sa vie et
de la vie, en gnral. Il sagit de louverture de la per-
sonne un au-del de lui-mme, une ralit qui dpas-
se lindividu. La religion, la philosophie et lart sont des
moyens de vivre cette dimension spirituelle de ltre.
Loriginalit des soins palliatifs est de faire du soutien
spirituel lun des rles des soignants et des mdecins. Il
est donc important de savoir reprer cette souffrance, se
situer en attitude dcoute et si le malade y consent, faire
appel la collaboration des bnvoles ou dun reprsen-
tant du culte.
Les familles
Elles sont prouves par la souffrance de leur proche,
par les ramnagements ncessaires aux changements
imposs par la maladie et par la prise de conscience de
la sparation venir. Elles sont, elles aussi, confrontes
la perte et lpuisement (aussi bien psychologique
que physique), particulirement lorsque le patient reste
au domicile. Les possibles dcalages entre ce que sait le
patient et ce que sait la famille, ce que vit le patient ou
ce que vit la famille, crent autant de difficults suppl-
mentaires. Le soutien des familles, apport par les
quipes mdicales et soignantes, lassistante sociale et
le psychologue, trouve toute sa place. Il sagit damener
aussi bien des solutions concrtes, quun espace dcou-
te. Cette coute peut tre poursuivie aprs le dcs du
patient, accompagnant ainsi le ncessaire travail de
deuil.
Les soignants
Tous les professionnels de la sant engags autour des
patients et de leurs proches sont, eux aussi, confronts
leurs propres questionnements et difficults. La
conscience de ne plus pouvoir gurir et de voir souffrir
peut tre la source de dsarroi, de culpabilit et
dangoisse. Pour cela, le soignant doit aussi pouvoir
sexprimer et tre soutenu, do limportance des
runions dquipe au sein des services de soins ou entre
professionnels libraux. Il est aussi possible de mettre
en place des groupes de parole anims par un psycho-
logue gnralement extrieur au service et ouverts
tous les professionnels.
TRAVAIL EN QUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
ET PLACE DES BNVOLES
Lquipe pluridisciplinaire associe diffrents professionnels
(mdecins, psychologue, infirmire, aide-soignante, masseur-
kinsithrapeute, assistante sociale, secrtaire mdicale).
Leur partenariat dpasse la simple juxtaposition de comp-
tences complmentaires. Linterdisciplinarit qui rsulte
de ces interrelations ncessite un investissement en runions
et temps de rflexion communs, indispensables llabora-
tion des problmes rencontrs. Chaque professionnel est
responsable dans sa fonction spcifique. La dimension
hirarchique reste pour autant ncessaire au fonctionnement
de lquipe et sa reprsentation intra- et extrahospitalire.
Linterdisciplinarit peut cependant prsenter des difficults,
voire des risques, dont celui du chevauchement des rles
o finalement on ne sait plus qui fait quoi. Il sagit donc
dun processus qui nest jamais acquis une fois pour toutes.
Il peut aussi dvoiler des fragilits mises en exergue par
langoisse de mort favorise par les problmatiques ren-
contres en soins palliatifs. Enfin, linterdisciplinarit
reprsente aussi la possibilit dapaiser le stress li la
confrontation au processus du mourir.
Les bnvoles forms laccompagnement de la fin de vie
vont apporter leur concours lquipe de soins en parti-
cipant lultime accompagnement du malade et en
confortant lenvironnement psychologique et social du
malade et de son entourage (loi 99-477 du 9 juin 1999).
Leur intervention, particulirement en institution,
permet de moins mdicaliser la mort. Ils reprsentent la
communaut sociale lhpital. La prsence de bnvoles
et leur mode de collaboration avec les quipes restent
ingaux dun lieu lautre. Dans tous les cas, ils appar-
tiennent des associations qui se dotent dune charte et qui
organisent leur intervention dans des tablissements de
sant (convention), ou domicile.
ASPECTS RGLEMENTAIRES,
DONTOLOGIQUES, JURIDIQUES ET THIQUES
DES SOINS PALLIATIFS
Lois et circulaires Code de dontologie
Depuis la loi du 3 juillet 1991, les soins palliatifs font par-
tie des missions du service public hospitalier au mme
titre que les soins prventifs et curatifs. La loi
n
o
99-477 du 9 juin 1999 (v. Pour approfondir) est venue
garantir le droit du malade laccs aux soins palliatifs.
Parmi les avances considrables quelle amne, citons la
reconnaissance du droit de la personne malade de soppo-
ser toute investigation ou thrapeutique, droit prcis de
nouveau dans la loi n
o
2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et la qualit du systme de sant.
Lorsque le patient nest plus en mesure de donner son
consentement clair, la famille doit tre concerte (art.
36, art. 42 du code de dontologie) mais elle ne doit pas
porter le poids de la dcision qui reste une dcision mdi-
cale . Citons aussi le droit un cong daccompagnement
S OI NS PAL L I AT I F S P L UR I DI S CI P L I NAI R E S CHE Z UN MAL ADE E N F I N DE V I E
2284 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
Le principe dautonomie : chaque personne a le droit
de prendre les dcisions qui la concernent, et dabord celle
daccepter ou de refuser le traitement qui lui est propos.
De ce principe dcoule le devoir dinformer le patient et
de recueillir son consentement.
Le principe de proportion : une thrapeutique nest
justifie que si sa mise en route et ses effets sont
proportionns au bien quen tirera le patient.
Le principe de futilit : une thrapeutique est sans
objet quand elle napporte aucun bnfice au patient ; il est
alors justifi de larrter.
Leuthanasie, en tant que mort dlibrment provoque
dans le but de mettre un terme la souffrance du malade,
nest pas un acte de soins. Les soins palliatifs, par le soula-
gement et laccompagnement quils apportent tentent de
rduire les situations de souffrance extrme o peut surgir
cette question.
MODALITS ORGANISATIONNELLES DES SOINS
PALLIATIFS EN FRANCE
Les principes de lorganisation des soins palliatifs et lac-
compagnement en tablissement et domicile sont claire-
ment poss dans la circulaire 2002/98 permettant un dve-
loppement des soins palliatifs avec laide des Agences
rgionales dhospitalisation et des Unions rgionales des
Caisses dassurance-maladie.
Les diffrents types de structures existants, dont les
2 principales sont les USP et EMSP, sont amens sins-
crire progressivement dans un fonctionnement en rseau
afin dassurer lindispensable continuit de la prise en
charge du patient entre le domicile et les tablissements de
sant (tableau V).
Remerciements Mme Francesca Comandini (psychologue de lquipe).
(temps plein, temps partiel ou fractionn) dune personne
en fin de vie, dune dure maximale de 3 mois, mais non
rmunr.
Les professionnels de sant sont dans lobligation de se
former en soins palliatifs. Pour la profession mdicale,
larrt du 4 mars 1997 rend obligatoire lenseignement
des soins palliatifs au cours du 2
e
cycle. Le code de don-
tologie rappelle les devoirs des mdecins en matire din-
formation et dassistance au patient : selon larticle 37, en
toute circonstance le mdecin doit sefforcer de soulager
les souffrances de son malade, lassister moralement et
viter toute obstination draisonnable dans les investiga-
tions ou les thrapeutiques et selon larticle 38, Le
mdecin doit accompagner le mourant jusqu ses derniers
moments, assurer par des soins et des mesures appropries
la qualit dune vie qui prend fin, sauvegarder la dignit
du malade et rconforter son entourage. Il
na pas le droit de provoquer dlibrment la mort. .
Ce dernier point est clairement prcis dans les articles 295
et suivants du Code pnal.
thique et fin de vie
De nombreuses situations de fin de vie posent des
questions thiques, comme celle de lobstination thrapeu-
tique draisonnable (ou acharnement thrapeutique), de
leuthanasie, de linformation du patient et de son consen-
tement aux soins. En pratique, il sagit de tout faire pour
soulager et soulager vite (principe de bienfaisance), et de
savoir choisir entre que faire et que ne pas faire
pour ne pas nuire (principe de non-nuisance). La rflexion
et les dcisions que de telles questions soulvent et qui
engagent la responsabilit du mdecin, devraient sap-
puyer sur les principes thiques suivants proposs par
lOrganisation mondiale de la sant et lAssociation euro-
penne pour les soins palliatifs.
Cancrologie
2285 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
Structures Dfinition tablissement Domicile
Unit dhospitalisation Units ddies la pratique des soins palliatifs et laccompagnement. X
de soins palliatifs (USP) Rserves aux situations les plus difficiles
quipe mobile de soins quipe mobile pluridisciplinaire se dplaant au lit du patient ou recevant X X
palliatifs (EMSP) en consultation. Rle dvaluation, de conseils et de soutien.
Lits identifis Lits accueillant des patients en soins palliatifs en dehors dune USP. X
Permettent la reconnaissance dune activit de soins palliatifs pour un service,
un tablissement, et pouvant donner lieu une dotation de moyens adapte
Rseau de soins Le rseau a pour objectif de mobiliser et de mettre en lien des ressources sanitaires X X
palliatifs et sociales sur un territoire donn autours des besoins des personnes
Soins domicile Assurs par un service dhospitalisation domicile, un centre de soins ou une quipe X
librale. Peuvent bnficier du soutien dun rseau et (ou) dune EMSP.
Modalits organisationnelles des soins palliatifs en France selon la circulaire 2002/98
TABLEAUV
S OI NS PAL L I AT I F S P L UR I DI S CI P L I NAI R E S CHE Z UN MAL ADE E N F I N DE V I E
2286 L A R E V UE DU P R AT I CI E N 2 0 0 2 , 5 2
Toute personne malade dont ltat le requiert,
a le droit daccder des soins palliatifs
et daccompagnement (loi du 9 juin 1999).
La transition progressive des soins curatifs
vers les soins palliatifs est une dmarche
pluridisciplinaire qui demande une radaptation
permanente du projet vitant toute rupture
et tout sentiment dabandon.
Les soins palliatifs sefforcent de traiter
la douleur et les symptmes pnibles,
par une dmarche clinique et thrapeutique
rigoureuse. Ils offrent un soutien au patient
et son entourage. Ils reconnaissent
aussi la souffrance des quipes soignantes
et encouragent linterdisciplinarit
et au soutien des professionnels .
Les nombreuses questions thiques rencontres
en fin de vie imposent au clinicien rflexion
et concertation, indispensables une dcision
mdicale respectueuse du patient, de lthique
et de la dontologie.
Points Forts retenir
Manuel de soins palliatifs. Ouvrage coordonn par Dominique
Jaquemin. Paris : Dunod, 2001 : 776 p.
Sang B, Laval G. Les principales thrapeutiques mdicamenteuses
en soins palliatifs. Paris : Sauramp Mdical, 2001 : 162 p.
Groupe de travail Sdation en fin de vie coordonn par
V. Blanchet : La sdation pour dtresse respiratoire en phase
terminale. Recommandations de la Socit franaise daccompa-
gnement et de soins palliatifs. 8
e
congrs national de la SFAP,
Lille, 27, 28, 29 juin 2002.
Monographie. Fin de vie : Soins palliatifs et accompagnement.
Rev Prat 1999 ; 49 : 1041-88.
Saunders C, Baines M. La vie aidant la mort. Traduction Michle
Salamagne. Niort : Medsi, 1986 : 102 p.
Programme national de dveloppement des soins palliatifs 2002-
2005. Ministre de lEmploi et de la solidarit, ministre dlgu
la Sant, fvrier 2002 : 48 p.
www.sante.gourv.fr
Ruzniewski M. Face la maladie grave, patients, familles, soignants.
Privat : Dunod, 1995 ; 15-58 : 157-94.
POUR EN SAVOIR PLUS
Synthse de la loi du 9 juin 1999
(programme national de dveloppement
des soins palliatifs 2002-2005)
La loi du 9 juin 1999 assure aux soins palliatifs une assise lgale et un
dveloppement prenne.
Elle comporte :
ltablissement du droit daccder aux soins palliatifs et un accom-
pagnement pour toute personne dont ltat le requiert ;
la dfinition des soins palliatifs et de leurs lieux de pratique ;
la reconnaissance du droit de la personne malade de sopposer
toute investigation ou thrapeutique ;
la ncessit de linscription des soins palliatifs dans les schmas
rgionaux dorganisation sanitaire ;
lobligation faite tous les tablissements publics et privs de dvelopper
une rponse en matire de soins palliatifs et de lutte contre la douleur ;
les centres hospitalo-universitaires ont en outre assurer une mission
denseignement, en liaison avec les autres tablissements de sant,
et une mission de recherche ;
linsertion de la thmatique des soins palliatifs dans le programme
de mdicalisation du systme dinformation ;
lannonce de conditions particulires de rmunration en faveur des
professionnels libraux ou salaris des centres de sant pratiquant
des soins palliatifs domicile ;
la reconnaissance du rle des bnvoles daccompagnement, forms
et appartenant des associations invites signer une convention
avec les tablissements de sant, publics ou privs, ou les tablissements
sociaux et mdico-sociaux ;
le droit donn aux proches de bnficier dun cong ou dune rduction
dactivit pour laccompagnement dune personne en fin de vie.
POUR APPROFONDIR
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 81 9
PARTIE 1 / MODULE 6
DOULEUR - SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Q 66
P
r
Bernard Bannwarth
Service de rhumatologie, groupe hospitalier Pellegrin & laboratoire de thrapeutique, Universit Victor Segalen, Bordeaux
Bernard.Bannwarth@thera.u-bordeaux2.fr
MDICAMENTS ANTALGIQUES
Ils regroupent lensemble des mdicaments symptomatiques
capables de soulager les douleurs par excs de nociception,
quelle quen soit lorigine, sans induire danesthsie, ni altrer la
conscience du malade. On les scinde en 2 catgories, selon quils
agissent ou non par le biais des rcepteurs opiodes.
ANTALGIQUES NON OPIODES
Cette classe comprend le paractamol, les anti-inflammatoi-
res non strodiens (AINS), la floctafnine, le mtamizole (nora-
midopyrine, selon la dnomination franaise) et le nfopam.
Mais ces 3 derniers produits ont un rle accessoire :
lla floctafnine (Idarac) expose des accidents allergiques
(urticaire, bronchospasme, dme de Quincke, choc), favoriss
par les prises itratives qui sont ds lors dconseilles ;
lle mtamizole (qui entre dans la composition de lOptalidon
ou de la Viscralgine Forte) est rserv aux checs dautres
antalgiques moins nocifs, vu ses complications, rares, mais
gravissimes (agranulocytose, choc anaphylactique) ;
lle nfopam (Acupan) nest disponible quen solution injecta-
ble. Sa tolrance est en outre mdiocre, cause de ses pro-
prits anticholinergiques notamment.
1. Paractamol
Le paractamol (Dafalgan, Doliprane) est lantalgique-antipy-
rtique le plus consomm dans le monde, dautant quil peut tre
dlivr sans ordonnance.
iOBJECTIFSi
Argumenter la stratgie de prise en charge globale dune douleur
aigu ou chronique chez ladulte.
Prescrire les thrapeutiques antalgiques mdicamenteuses (P)
et non mdicamenteuses.
valuer lefficacit dun traitement antalgique.
POINTS FORTS
> Le traitement des douleurs est toujours symptomatique
et, si possible, tiologique (infections, fractures et
pathologies tumorales surtout).
>La stratgie thrapeutique doit tre personnalise en
fonction :
- des caractristiques de la douleur, cest--dire de ses
mcanismes gnrateurs (excs de nociception, origine
neurogne, composante psychique), de son intensit et
de son retentissement, fonctionnel et motionnel ;
- du syndrome ou de laffection en cause, susceptible
de rclamer des mesures pharmacologiques ou non
mdicamenteuses propres ;
- du terrain physiopathologique du malade (antcdents,
comorbidits, mdicaments en cours).
>Si chaque syndrome ou affection ncessite une prise en
charge globale particulire, il existe toutefois des moyens
et des principes thrapeutiques communs tous les tats
douloureux.
comprendre
Thrapeutiques antalgiques,
mdicamenteuses
et non mdicamenteuses
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1819
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 820
Le paractamol se prsente sous diverses formulations gal-
niques orales (comprims simples ou effervescents, glules,
lyocs) qui permettent une absorption complte et rapide
jeun. La rsorption des suppositoires est plus lente et plus irr-
gulire. Il existe enfin une solution pour perfusion intraveineuse
(Perfalgan). Le paractamol est limin dans les urines aprs un
mtabolisme hpatique qui consiste en une glucuro-conjugai-
son et, dans une moindre mesure, en une sulfo-conjugaison aux
doses thrapeutiques. Au-del, une voie oxydative prend de lim-
portance, qui aboutit la libration dun driv ractif cyto-
toxique, neutralis par le glutathion. Mais ce systme de dtoxi-
cation est dbord aprs une ingestion massive de paractamol
(10 g habituellement) : pour viter lvolution vers une hpa-
tite aigu cytolytique, il faut administrer dans les 8 10 heures
suivant lintoxication, de la N-actylcystine qui pallie le manque
de glutathion endogne.
Aux posologies usuelles, le paractamol induit parfois une
dyspepsie et des douleurs abdominales ; mais il ne provoque pas
dulcre gastroduodnal. Les hpatites sont exceptionnelles,
gnralement favorises par le terrain du patient (alcoolisme
chronique, dnutrition). Les manifestations allergiques (urtica-
ire, thrombopnie) sont rares, et le risque dintolrance croise
avec laspirine et autres AINS, est faible. Bien que le paractamol
ninterfre pas avec lhmostase et quil soit peu susceptible
dinteragir avec les anticoagulants, un contrle de lINR (Interna-
tional Normalized Ratio) se justifie 3 ou 4 jours aprs son intro-
duction ou son arrt chez les sujets sous antivitamine K.
Lemploi du paractamol est interdit dans linsuffisance hpa-
tique et lhypersensibilit connue au produit. Il est en revanche
autoris pendant lallaitement et au cours de la grossesse, en
labsence deffet tratogne avr chez lhomme.
La dose unitaire optimale est de 1 g chez ladulte ; elle peut
tre renouvele au bout dun minimum de 4 heures, sans dpas-
ser 4 g/j. Dans linsuffisance rnale svre (clairance de la cra-
tinine 10 mL/min), il faut respecter un intervalle de 8 heures au
moins entre deux prises (3 g/j).
2. Anti-inflammatoires non strodiens (AINS)
Tous les AINS sont antipyrtiques et antalgiques et tous inhi-
bent la composante vasculaire de la raction inflammatoire,
responsable de la classique ttrade : dme, douleur, rougeur,
chaleur. Mais leurs indications thrapeutiques varient dune sp-
cialit lautre selon:
lle rapport bnfice/risque de chacune ;
lles essais cliniques entrepris et leurs rsultats lors de la
demande dAMM (Autorisation de mise sur le march).
En pratique, il convient de consulter le dictionnaire Vidal pour
connatre le libell exact des indications reconnues chaque
produit mme si, schmatiquement, lventail des indications
slargit depuis les AINS de la liste I (affections rhumatologiques
douloureuses et invalidantes) aux AINS de la liste II (indications
rhumatologiques et extra-rhumatologiques) et, finalement, aux
AINS commercialiss comme antalgiques-antipyrtiques (dvo-
lus aux douleurs lgres modres dorigine diverse et aux
tats fbriles). Ces derniers se caractrisent par la limitation de
leur dose unitaire ou quotidienne (tableau 1). Ils ont ainsi lavan-
tage dentraner peu de complications dose-dpendantes, en
particulier digestives ou rnales. Ils partagent nanmoins les
prcautions demploi et les contre-indications de leur classe
ainsi que les risques potentiels de tout AINS.
ANTALGIQUES OPIODES
Leur polymorphisme pharmacologique rsulte de :
lla pluralit fonctionnelle des rcepteurs opiodes, dont on
dcrit 3 grands types : mu(), kappa () et delta () ;
lla diversit des interactions ligand-rcepteur, amenant
considrer des agonistes purs, des agonistes mixtes ou ago-
nistes-antagonistes et des antagonistes purs. La buprnor-
phine (Temgsic) se singularise par son effet agoniste par-
tiel qui limite son activit antalgique ( effet plafond ).
Rappelons quadministr seul, un antagoniste pur na pas
daction ; il soppose en revanche celle dun agoniste pris
concomitamment de sorte quil sert dantidote lors dun sur-
dosage morphinique.
On peut galement classer ces mdicaments en fonction de
leur pouvoir analgsique ; ainsi, lOrganisation mondiale de la
sant (OMS) distingue :
lles opiodes pour les douleurs faibles modres, qui sont
DOULEUR - SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Thrapeutiques antalgiques, mdicamenteuses et non mdicamenteuses
Principaux AINS galement commercialiss comme antalgiques-antipyrtiques
Tableau 1
Dnomination com-
mune
internationale
acide
actylsalicylique
ibuprofne
ktoprofne
naproxne sodique
Dnomination
commerciale
Aspgic
Brufen
Profnid
Apranax
Dose
quotidienne
maximale
3 6 g
2 400 mg
300 mg
1 100 mg
Dnomination
commerciale
Aspirine
du Rhne
Advil
Toprec
Aleve
Dose unitaire
500 mg
200 mg
25 mg
220 mg
Dose
quotidienne
maximale
3 g
(sujet g : 2 g)
1200 mg
75 mg
660 mg
Liste
nant
II
II
II
Liste
nant
nant
nant
II
* spcialit commercialise comme AINS dans les indications rhumatologiques et extra-rhumatologiques.
AI NS ANTALGI QUES ANTI PYRTI QUES AI NS*
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1820
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 821
communment appels opiodes faibles , tels que la
codine, la dihydrocodine, le dextropropoxyphne et le tra-
madol (tableau 2) ;
lles opiodes pour les douleurs modres svres ou
opiodes forts , comme la morphine, loxycodone et
lhydromorphone. Ils sont inscrits la liste des substances
vnneuses en tant que stupfiants : leur prescription,
sur une ordonnance scurise, ne peut excder 28 jours.
1. Effets pharmacodynamiques
Ils sont la fois dose-dpendants, avec nanmoins dimpor-
tantes variations individuelles pour une posologie donne, et
sujets un phnomne de tolrance ou daccoutumance, consti-
pation et myosis mis part. La morphine nous sert de rfrence.
Action antalgique : la morphine diminue la perception de la
douleur en inhibant la transmission et lintgration du message
nociceptif grce un triple impact, spinal, supra-mdullaire, et,
dans une moindre mesure, priphrique. Elle inhibe en outre les
ractions vgtatives et motionnelles la douleur. La mor-
phine est particulirement efficace sur les douleurs par excs de
nociception, surtout si elles sont sourdes et continues, alors que
les douleurs neuropathiques sont moins sensibles son action.
Effets neuropsychiques : ils sont domins par la sdation (ralen-
tissement idatoire, somnolence, baisse de la vigilance). On note
aussi des manifestations psychodysleptiques qui se traduisent
gnralement par une indiffrence aux sensations dsagra-
bles (y compris la douleur), un tat de bien-tre ou deuphorie,
et parfois par une dysphorie (anxit, frayeurs, cauchemars).
Vertiges, confusion et troubles cognitifs sont galement rappor-
ts. Des myoclonies peuvent survenir aux fortes doses.
Dpression respiratoire : prcde par la somnolence, vritable
signe dalerte, la dpression respiratoire (inaugure par une bra-
dypne) est la marque dun surdosage. Elle ne sobserve pas
quand la posologie de morphine est adapte au terrain du
patient et lintensit du syndrome algique, les influx nociceptifs
jouant un rle protecteur en stimulant la ventilation. Bien quelle
soit indpendante de leffet dpresseur respiratoire, mention-
nons laction antitussive, gnante en cas de bronchopneumopa-
thie chronique.
Effets digestifs : la morphine induit des nauses ou des vomis-
sements par son action sur la chemoreceptor trigger zone et les
fibres musculaires lisses. Elle renforce les contractions segmen-
taires provoquant une hypertonie du pylore, qui retarde la
vidange gastrique, et du sphincter dOddi, gnralement asymp-
tomatique. Elle dprime, en revanche, les ondes intestinales pro-
pulsives, do une constipation opinitre, laquelle contribuent
la rduction des scrtions digestives et linhibition du rflexe
de dfcation.
Effet sur lappareil urinaire : lhypertonie du sphincter externe
de la vessie est lorigine dpisodes de rtention urinaire chez
des sujets prdisposs (adnome de la prostate).
Effets cutano-muqueux : il sagit surtout de xrostomie, prurit
et, parfois, de sueurs profuses.
Tolrance et dpendance : la tolrance aux proprits antal-
giques de la morphine, les seules intressantes en clinique, se
dveloppe bien plus lentement qu la plupart de ses autres
effets (constipation et myosis excepts). Il sensuit que les mani-
festations indsirables samendent habituellement en 5 10
jours lors dun traitement continu posologie constante, cepen-
dant que lanalgsie se maintient. Lemploi de morphine au-del
de 10 20 jours saccompagne dune dpendance physique,
cest--dire du risque dun syndrome de sevrage larrt brutal
du mdicament ou ladministration dun antagoniste (naloxone,
Narcan). Pour lviter, il est ncessaire et suffisant de rduire
progressivement les doses. Quant la dpendance psychique ou
assutude ( addiction ), elle correspond une envie irrpres-
sible de se procurer une substance pour en ressentir les effets
psychiques ; elle ne se rencontre pas quand la morphine est utili-
se dans la douleur cancreuse.
2. Caractristiques des principaux
antalgiques opiodes
Les antalgiques opiodes les plus communment utiliss en
pratique sont des agonistes , do la similitude de leur profil
Principaux opiodes faibles destins ladulte (voie orale)
Tableau 2
* uniquement disponible en association un autre antalgique.
DCI
Codine *
Dextropropoxyphne*
(D-propoxyphne)
Dihydrocodine
Tramadol
SPCI ALI T
( EXEMPLES)
Dafalgan-Codine
Lindilane
Codoliprane
Di-Antalvic
Propofan
Dicodin LP
Topalgic
Zamudol LP
DOSES UNI TAI RES
paractamol 500 mg + codine 30 mg
paractamol 400 mg + codine 25 mg
paractamol 400 mg + codine 20 mg
paractamol 400 mg + D-propoxyphne 30 mg
paractamol 400 mg + D-propoxyphne 27 mg
+ cafine 30 mg
60 mg
50 mg
50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg
DURE
DACTI ON MOYENNE
4 6 heures
4 6 heures
4 6 heures
4 6 heures
4 6 heures
12 heures
4 6 heures
12 heures
POSOLOGI E
QUOTI DI ENNE MAXI MALE
6 comprims
6 comprims
6 comprims
6 glules
6 comprims
2 comprims
8 glules
400 mg
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1821
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 822
pharmacodynamique. Aux doses qui-analgsiques, ces mdi-
caments entranent des effets secondaires grossirement com-
parables en intensit et en frquence lchelle dune popula-
tion. Mais, individuellement, il existe des diffrences de
sensibilit une molcule donne. Cette notion fonde le concept
de rotation des opiodes . En dautres termes, il est lgitime
dessayer un autre opiode fort quand la morphine est inefficace
ou mal supporte par un malade.
Codine ou mthylmorphine : opiode faible de rfrence pour
lOMS, son action antalgique est attribue sa transformation
en morphine. Environ 10 % des sujets de race blanche ne poss-
dent pas lenzyme assurant cette conversion mtabolique et,
partant, ne rpondent pas ce mdicament. Ils sont en revanche
susceptibles dtre soulags par la dihydrocodine (Dicodin LP
60 mg) qui produit le mme effet que 60 mg de codine. En
tant quanalgsique, la codine est uniquement commercialise
en association avec dautres antalgiques, le paractamol sur-
tout, les doses unitaires de ces 2 principes actifs tant trs varia-
bles dune spcialit lautre. Il semble que les combinaisons 25-
30 mg de codine pour 500 mg de paractamol ralisent le
meilleur rapport bnfice/risque. Aux posologies quotidiennes
maximales de codine (180 mg, quivalents environ 20-30 mg
de morphine per os), des effets indsirables opiodergiques
(constipation, nauses, vomissements, vertiges, somnolence)
sont relativement frquents.
Dextropropoxyphne: il est systmatiquement associ au para-
ctamol. Sa posologie quotidienne est limite 180 mg. ces
doses, il est peu efficace, mais en contrepartie, il induit peu def-
fets secondaires opiodergiques. Une spcialit renferme en
outre de la cafine (Propofan), cense renforcer lactivit antal-
gique, ce qui est controvers. Le dextropropoxyphne expose
des complications particulires : hypoglycmie chez la personne
ge ou linsuffisant rnal, et hpatite cholestatique.
Tramadol : Son effet antalgique rsulte de son activit agoniste
et dune inhibition de la recapture de mono-amines (noradr-
naline, srotonine) dans la moelle, dprimant ainsi la transmis-
sion des impulsions nociceptives. Cest le plus efficace des opio-
des faibles : per os, sa puissance est de lordre de 1/6 1/4 de celle
de la morphine per os ; ainsi, 100 mg de tramadol sont qui-anal-
gsiques 15-25 mg de morphine environ. Les formes orales de
tramadol sont libration immdiate (Topalgic 50 mg), efficaces
pendant 4 6 heures, ou prolonge, requrant 2 prises journa-
lires, dont la gamme la plus tendue est propose par le Zamu-
dol LP (50 mg, 100 mg, 150 mg et 200 mg). Il existe une solution
pour la voie intraveineuse (Topalgic 100 mg/2 mL), surtout desti-
ne aux douleurs postopratoires.
Corollaire de son efficacit, cest aussi lopiode faible qui pro-
voque le plus deffets secondaires morphiniques aux posologies
usuelles (400 mg/j), en particulier vertiges, nauses, consti-
pation, somnolence. Il est galement susceptible dentraner des
palpitations, une hypotension orthostatique, voire un collapsus.
Morphine: un effet de premier passage hpatique limite sa bio-
disponibilit par voie orale (20 30 % en moyenne). Mais si on
opte pour la voie orale aprs quelques jours de traitement par
voie parentrale, il suffit gnralement de doubler la posologie
en raison de lapparition de mtabolites actifs. Les deux drivs
commercialiss en France sont :
lle chlorhydrate de morphine, solution qui sadministre per os
ou en injection sous-cutane, voire intraveineuse toutes les 4
heures ;
lle sulfate de morphine, vendu en glules ou en comprims
libration immdiate (Actiskenan, Sevredol), actifs pendant 4
heures, ou libration prolonge, actifs pendant 12 heures
(Skenan LP, Moscontin) ou 24 heures (Kapanol LP), en
moyenne.
Hydromorphone (Sophidone LP) et oxycodone (Oxycontin LP) : ce
sont deux opiodes forts rservs la douleur cancreuse. Ces
spcialits libration prolonge sadministrent toutes les 12
heures. Elles sont surtout employes dans le cadre de la rota-
tion des opiodes chez les malades rsistants ou intolrants
la morphine dont elles partagent lensemble des caractris-
tiques pharmacologiques. Le rapport des doses qui-analg-
siques entre morphine dune part, hydromorphone et oxyco-
done dautre part, est l encore trs variable dun sujet lautre :
on conseille de diviser la posologie journalire de morphine
orale par 7 ou 2, quand on lui substitue la sophidone ou loxyco-
done, respectivement.
3. Interactions mdicamenteuses
Lassociation dun opiode tout autre mdicament dpres-
seur du systme nerveux central (benzodiazpines, neurolep-
tiques, barbituriques, certains antidpresseurs et antihistami-
niques H1) ou lalcool risque de majorer leur effet sdatif et la
dpression respiratoire.
On se garde de coprescrire diffrents opiacs, antitussifs y
compris. On vite ainsi des associations aberrantes entre ago-
nistes purs et mixtes.
Des syndromes srotoninergiques ont t rapports en cas
de prise concomitante dun IMAO et de certains opiodes. Ce
risque existe notamment avec le tramadol, qui favorise en outre
les convulsions sous antidpresseurs et antipsychotiques, en
abaissant le seuil pileptogne.
4. Contre-indications et prcautions demploi
Lallergie au principe actif ou un excipient, linsuffisance
hpatique svre et lallaitement constituent les principales
contre-indications communes aux divers opiodes. Certains
tats pathologiques (insuffisance respiratoire, dysurie urtro-
prostatique, pilepsie, hypertension intracranienne) et asso-
ciations mdicamenteuses (v. supra) rclament une vigilance
particulire. Rappelons aussi que tous les drivs morphiniques
peuvent induire une raction positive lors dun contrle antido-
page chez le sportif.
5. Prescription des opiodes forts
La morphine est lopiode fort de rfrence. Autant que pos-
sible, on utilise la voie orale, la plus commode et la plus confor-
table. La dose initiale est de lordre de 0,5 1 mg/kg/j, soit en
pratique de 10 mg de morphine libration immdiate en relais
dun opiode faible, ou 5 mg dans le cas contraire, renouveler
DOULEUR - SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Thrapeutiques antalgiques, mdicamenteuses et non mdicamenteuses
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1822
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 823
toutes les 4 heures. Ces doses sont rduites de moiti chez les
patients fragiles (personnes ges, insuffisants rnaux ou
hpatiques) en raison de leur grande sensibilit aux effets
centraux et digestifs des opiodes. Deux attitudes sont ensuite
envisageables :
lclassiquement, on fait le point au bout de 24 heures : si le sou-
lagement est insuffisant, on majore la posologie quotidienne
de 50 % (sauf si les effets secondaires incitent une augmen-
tation plus prudente) jusqu atteindre la posologie efficace ;
lon prvoit demble des interdoses ou doses de secours,
gales 1/10 1/6 de la dose quotidienne programme, en les
espaant galement de 4 heures. Ces interdoses compltent
au besoin le traitement prvu. Les doses unitaires du lende-
main seront ajustes en fonction de la dose totale reue la
veille, jusqu obtention de lanalgsie.
Quand la douleur est matrise, la morphine libration
immdiate est remplace par une forme LP, laquelle on ajoute
de la morphine libration immdiate pour les ventuels accs
douloureux ( douleurs incidentes ). noter que certains
emploient les formes LP ds le dpart, en commenant par une
posologie journalire identique. Cela se conoit notamment
dans les douleurs chroniques cancreuses sauf chez les
malades fragiles chez qui il est prfrable de dmarrer avec
la morphine libration immdiate dont la maniabilit facilite
lajustement posologique (titration).
En cas dchec d une morphino-rsistance , une perte
defficacit ou des effets indsirables svres incontrlables, on
essaie un autre opiode fort. Il est ncessaire de lutter contre la
constipation tout au long du traitement : en plus des conseils dit-
tiques (hydratation importante, rgime riche en lgumes et fruits),
on prescrit un laxatif osmotique (lactulose, Duphalac) associ, au
besoin, un laxatif pristaltique (cascara, Pristaltine). La sur-
veillance du transit reste nanmoins indispensable : labsence de
selles depuis 3 jours doit faire rechercher un fcalome. Les nau-
ses et les vomissements tant plus inconstants, leur prvention
systmatique nest pas imprative ; le cas chant, on administre
un neuroleptique anti-mtique comme le mtoclopramide (Prim-
pran) ou lhalopridol (Haldol Faible). La somnolence oblige par-
fois diminuer les doses de lopiode ; en toute hypothse, on
attend sa disparition avant daugmenter la posologie. Ces manifes-
tations ne sont pas toujours secondaires la prise de lantalgique:
il faut donc voquer une autre origine surtout si, constipation mise
part, elles ne cdent pas en 5 10 jours.
THRAPEUTIQUES NON MDICAMENTEUSES
Les traitements non pharmacologiques visent complter,
renforcer ou relayer laction des mdicaments. De trs nom-
breuses techniques sont proposes, au rle parfois controvers
(acupuncture) ou limit des situations particulires (manipula-
tions vertbrales, radiothrapie, chirurgie curative ou palliative,
thrapies comportementales ou psychiques telles que hypnose
et relaxation). Nous nenvisagerons ici que les modalits les plus
couramment utilises.
PHYSIOTHRAPIE
Elle regroupe lensemble des traitements par agents phy-
siques dlivrant de lnergie vise antalgique ou anti-inflam-
matoire.
1. Thermothrapie, hydrothrapie et cryothrapie
La chaleur, surtout si elle est apporte par leau (hydrothra-
pie) exerce une action dcontracturante et sdative, notamment
sur les douleurs dorigine musculaire. La balnothrapie conju-
gue cette action leffet portant de limmersion qui favorise
la rducation chez le patient douloureux. La balnothrapie est
par ailleurs lune des composantes de la cure thermale.
La thermothrapie consiste appliquer de la chaleur sur la zone
douloureuse laide de bains, denveloppements ou de paraffine.
Le recouvrement par un film de paraffine chaude est propos
pour soulager les articulations des mains et faciliter leur mobili-
sation au cours de la polyarthrite rhumatode.
La cryothrapie par application locale (compresses, vessie de
glace, sprays rfrigrants) ou en massage (cubes de glace) entrane
une analgsie rapide, notamment lors des atteintes inflammatoires
aigus et post-traumatiques (contusion, entorse, fracture).
2. Rayonnements
Ultrasons, ondes courtes (appeles lectromagntiques )
et laser sont largement employs en kinsithrapie o ils ont
supplant les infrarouges dont leffet thermique sexerce uni-
quement en surface. Mais les preuves manquent pour entriner
leur usage. Certains travaux tendent nanmoins accrditer
lintrt des ultrasons dans les tendinopathies et les squelles
dentorse, et de lmission pulse dondes courtes dans lar-
throse symptomatique.
3. lectrothrapie
En labsence de lsions cutanes, diffrents courants lec-
triques sont employables. Ce sont :
le courant continu ou galvanique : ce courant unidirectionnel
sert aux ionisations parce quil permettrait de faire pntrer
des mdicaments ionisables (AINS surtout) travers la peau.
Destin aux douleurs articulaires et pri-articulaires superficiel-
les, son bnfice nest pas avr ;
les courants discontinus de basse frquence (100 Hz), utiliss
dans le cadre de la stimulation nerveuse transcutane. Celle-ci
se fonde sur la thorie de la porte mdullaire (gate control). Elle
consiste stimuler prfrentiellement les grosses fibres myli-
nises du tact (A et A) pour entraner une inhibition de la
transmission des influx nociceptifs par les fibres de petit calibre
(A et C) au niveau des relais spinaux dans la corne postrieure.
La neurostimulation transcutane sadresse principalement aux
douleurs de dsaffrentation sigeant dans un territoire dfini,
radiculaire ou tronculaire. Elle a pour avantage son innocuit,
mais son efficacit tend spuiser au fil du temps. Elle est inter-
dite chez les patients ayant un pacemaker ;
les courants discontinus moyenne (800-10 000 Hz) et haute (
100000 Hz) frquence, qui par leur action thermique ont des pro-
prits dcontracturantes, trs phmres.
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1823
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 824
KINSITHRAPIE ET RDUCATION
FONCTIONNELLE
On a naturellement tendance ne pas solliciter une rgion
douloureuse. Or linactivit prolonge aboutit un dcondi-
tionnement physique qui, par lui-mme ou par son retentisse-
ment psychique, va entretenir ltat douloureux. La prise en
charge physique et fonctionnelle vise rompre ce cercle
vicieux en :
lcalmant la douleur, laide des massages, des mobilisations
passives (tirements), voire des orthses et, nous lavons vu,
de la physiothrapie ;
lmettant en uvre des exercices adapts pour rcuprer la
mobilit ou la stabilit articulaire, renforcer la musculature
dficiente et surmonter, ou du moins compenser, un handi-
cap. Des programmes de reconditionnement leffort desti-
ns amliorer la condition physique gnrale sont parfois
justifis (lombalgies chroniques invalidantes, par exemple).
PRINCIPES DU TRAITEMENT
STRATGIE THRAPEUTIQUE PERSONNALISE
Quil sagisse dune douleur aigu ou chronique, le traite-
ment a pour objectifs non seulement de la soulager de
manire efficace et sre, mais aussi de prvenir sa rcidive ou
dempcher sa persistance. Or, loin dobir un schma st-
rotyp, la stratgie thrapeutique adapte un malade
donn dpend de 3 facteurs principaux : les caractristiques
de la douleur, laffection ou le syndrome responsable et le ter-
rain du patient.
1. Caractristiques de la douleur
Il convient dabord de prciser le mcanisme physiopatholo-
gique en cause (excs de nociception, origine neuropathique ou
neurogne, composante psychique) tout en sachant que leur
intrication est possible, notamment lors des tats douloureux
chroniques, cancreux surtout. Contrairement aux douleurs par
excs de nociception, les douleurs neuropathiques sont gnra-
lement rfractaires aux antalgiques non opiodes et elles sont
moins sensibles aux morphiniques. Elles rpondent en revanche
des psychotropes, en particulier des antidpresseurs tricy-
cliques ou imipraminiques et des anti-pileptiques. Le tableau
3 runit les principales spcialits ayant une indication recon-
nue en ce domaine en France. Tous ces produits comportent un
grand nombre deffets indsirables et dinteractions mdica-
menteuses, et leur tolrance est volontiers mdiocre aux poso-
logies efficaces quil faut atteindre progressivement en dbu-
tant par une faible dose. Certaines douleurs neuropathiques
peuvent aussi bnficier de la stimulation nerveuse transcuta-
ne (v. supra). Par ailleurs, des psychotropes (anxiolytiques, hyp-
notiques, antidpresseurs) et des thrapies comportementa-
les sont mme dagir sur la composante anxio-dpressive qui
sous-tend ou entretient certains syndromes algiques.
Lintensit de la douleur et les rsultats des traitements dj
entrepris interviennent aussi dans le choix. Cela est bien illustr
par les recommandations de lOMS concernant le traitement des
douleurs nociceptives lies au cancer, qui prconisent dabord
un antalgique non opiode, paractamol ou AINS (niveau 1) ; sil
ne suffit pas, on lui adjoint un opiode faible ; si cette association
(niveau 2) choue, on emploie un opiode fort (niveau 3), auquel un
antalgique non opiode peut tre ajout. Il importe de souligner
DOULEUR - SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Thrapeutiques antalgiques, mdicamenteuses et non mdicamenteuses
Principaux mdicaments indiqus dans les douleurs neuropathiques de ladulte
daprs leur AMM (Dictionnaire Vidal 2003)
Tableau 3
DCI
Amitriptyline
Carbamazpine
Clomipramine
Dsipramine
Gabapentine
Imipramine
Phnytone
SPCI ALI T( EXEMPLE)
Laroxyl
Tgrtol
Anafranil
Pertofran
Neurontin
Tofranil
Di-Hydan
CLASSE
AD tricyclique
anti-pileptique
AD tricyclique
AD tricyclique
anti-pileptique
AD tricyclique
anti-pileptique
I NDI CATI ON
algies rebelles
douleurs neuropathiques
nvralgie du trijumeau
et du glosso-pharyngien
douleurs neuropathiques
douleurs neuropathiques
douleurs post-zostriennes
douleurs neuropathiques
algies rebelles
nvralgie du trijumeau
POSOLOGI E
I NI TI ALE USUELLE*
10-25 mg/j 75-150 mg/j
200-400 mg/j
10-25 mg/j 150 mg/j
25 mg/j 75-100 mg/j
300 mg/j 1,2-3,6 g/j
10-25 mg/j 25-75 mg/j
75-150 mg/j
2-6 mg/kg/j
* dose quotidienne habituellement efficace ; AD : antidpresseur.
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1824
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 825
que cette stratgie en 3 paliers ne sapplique pas lensemble
des douleurs par excs de nociception (v. infra).
Enfin, il y a lieu de considrer le retentissement psychique et
fonctionnel du syndrome algique, pour dcider des mesures
appropries, pharmacologiques et autres.
2. Affection causale
Elle influe sur le choix des mdicaments et leur squence du-
tilisation. Ainsi, dans larthrose symptomatique, le rapport bn-
fice/risque du paractamol limpose comme antalgique de pre-
mire intention, devant les AINS. Ces derniers sont en revanche
privilgis dans la colique nphrtique ou les spondylarthropa-
thies inflammatoires. Ils occupent aussi une place prminente
au cours de la polyarthrite rhumatode o leur chec amne
gnralement proposer une corticothrapie systmique fai-
ble dose, solution retenue demble dans la pseudopolyarthrite
rhizomlique. Outre les corticodes, par ailleurs utiles sous la
forme dinfiltrations locales dans des syndromes canalaires, des
tendinopathies, des arthrites inflammatoires ou larthrose,
notamment lors des pousses congestives, dautres molcules
exercent une activit antalgique dans certaines circonstances
pathologiques o elles apparaissent comme des alternatives
intressantes aux mdicaments antalgiques ; citons la colchicine
dans les accs goutteux et les alcalodes de lergot de seigle ou
les agonistes slectifs des rcepteurs 5HT1 (triptans) dans la
migraine. Enfin, il savre parfois ncessaire de recourir une
substance spcifique de la maladie causale, comme la trini-
trine dans langine de poitrine ou un antiscrtoire gastrique
dans lulcre. Laffection responsable de la douleur peut de sur-
crot rclamer un traitement tiologique ou un traitement de
fond et des thrapeutiques non mdicamenteuses propres,
destins empcher sa rcidive, inflchir son volution jusqu
la mettre en rmission, voire obtenir sa gurison.
3. Terrain du patient
Le terrain du patient (antcdents, comorbidits) et les mdi-
caments en cours sont susceptibles de contre-indiquer lemploi
de tel ou tel antalgique. Ailleurs, ils prdisposent certaines
complications ( sujets risque ) obligeant envisager des
mesures prophylactiques et renforcer la surveillance, clinique
ou biologique.
En dfinitive, cette stratgie thrapeutique globale et person-
nalise implique habituellement une prise en charge multidisci-
plinaire des douleurs chroniques, et parfois des douleurs aigus.
RGLES DUTILISATION DES ANTALGIQUES
Rappelons en prambule que la prfrence doit toujours tre
donne lantalgique ou lassociation dantalgiques qui offre le
meilleur rapport bnfice/risques dans laffection considre.
La posologie initiale dpend de la svrit de la douleur et du
terrain physiopathologique du malade.
1. Rythme dadministration
Ladministration des antalgiques doit tre rgulire, selon un
rythme dcoulant de leur cintique daction afin de matriser la
douleur de faon continue en anticipant sa rsurgence. Mais les
doses unitaires ne sont pas forcment quivalentes : elles peu-
vent varier en fonction de la chronologie de la douleur au cours
du nycthmre. De plus, il y a lieu de prvoir des doses compl-
mentaires ou un antalgique de secours pour dventuelles
douleurs incidentes.
2. Association dantalgiques
Lassociation dantalgiques permet de rduire la posologie de
chacun des principes actifs sans nuire lefficacit globale, ce
qui est surtout utile pour les molcules aux effets indsirables
dose-dpendants (AINS, opiodes), ou combattre plus efficace-
ment une douleur intense. Elle fait appel des mdicaments au
mode ou au site daction distincts, tels quun AINS et du parac-
tamol, ou un opiode et un antalgique non morphinique.
VALUATION RGULIRE DU TRAITEMENT
Il faut rgulirement valuer la tolrance et lefficacit du
traitement. Celle-ci est apprcie sur lvolution de lintensit
douloureuse (en comparant les valeurs dtermines par le
patient entre 2 consultations sur une chelle visuelle analo-
gique de 100 mm) ou sur le degr de soulagement (exprim en
pourcentages ou cot entre 0 et 100 mm sur une chelle
visuelle analogique). Des indices algofonctionnels sont par
ailleurs utiles au suivi de certaines pathologies (lombalgies
chroniques, arthrose du genou ou de la hanche). Les chelles
dauto-valuation multidimensionnelles et les indices de qualit
de vie sont surtout indiqus dans des tats douloureux chro-
niques complexes. Ces outils sont indispensables ladaptation
permanente du traitement qui, selon le cas, devra tre modifi
(intolrance), renforc (soulagement insuffisant) ou allg,
voire suspendu (rmission). Devant tout chec inexpliqu ,
il faut vrifier la bonne observance du traitement, sinon rviser
le diagnostic. B
POINTS FORTS
> Les antalgiques sont gnralement indispensables,
mais insuffisants pour soulager les douleurs de manire
efficace, sre et durable.
>Leur emploi doit sinscrire dans une stratgie globale,
adapte aux caractristiques du syndrome algique et
ltat physiopathologique du malade, ce qui implique
habituellement une prise en charge plurimodale et
multidisciplinaire.
>La thrapeutique doit tre rgulirement value et, au
besoin, modifie en fonction de la rponse clinique ou en
raison de la survenue deffets indsirables.
retenir
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1825
L A R E V U E D U P R AT I C I E N / 2 0 0 3 : 5 3
1 826
DOULEUR - SOINS PALLIATIFS
ACCOMPAGNEMENT
Thrapeutiques antalgiques, mdicamenteuses et non mdicamenteuses
A / VRAI OU FAUX ?
Les mdicaments antalgiques
sont capables de soulager toutes
les douleurs, quels quen soient
le mcanisme physiopathologique
et lorigine.
Lutilisation des mdicaments
antalgiques dans les douleurs par
excs de nociception doit toujours
se conformer la stratgie
thrapeutique en 3 paliers de
lOrganisation mondiale de la sant.
Les anti-inflammatoires non strodiens
sont efficaces uniquement dans
les douleurs par excs de nociception
comportant une composante
inflammatoire.
B / VRAI OU FAUX ?
Lassociation dun opiode un anti-
1
3
2
1
inflammatoire non strodien est
pharmacologiquement rationnelle.
La morphine, loxycodone et lhydro-
morphone sont des opiodes forts
inscrits sur la liste des stupfiants .
Le paractamol est contre-indiqu
durant la grossesse.
C / QCM
Parmi les caractristiques de la mor-
phine, on trouve :
Il sagit dun agoniste partiel des
rcepteurs opiodes .
Les nauses et vomissements induits
par la morphine sont sujets un phno-
mne de tolrance ou accoutumance.
Lantidote de la morphine conseill
en cas de surdosage est la buprnorphine.
3
2
1
3
2
M I N I T E S T D E L E C T U R E
VOIR AUSSI
Bannwarth B
Analgsiques non morphiniques.
Principes et rgles dutilisation
(Rev Prat 1996 ; 46 : 1025-30)
Bannwarth B
Analgsiques morphiniques.
Principes et rgles dutilisation
(Rev Prat 1996 ; 46 : 1393-8)
DJ PARUS DANS LA REVUE
Douleur cancreuse : un opiode
peut-tre plus efficace quun autre
Triol I, Dume L, Lassaunire JM
(Rev Prat Med Gen 1999 ; 14 [499] :
925-7)
La douleur chez les personnes
ges en fin de vie
Sebag-Lano R, Lefebvre-Chapiro S(Rev
Prat Med Gen 1999 ; 13 [462] : 985-8)
Son efficacit et ses principaux effets
indsirables sont dose-dpendants.
Un phnomne de dpendance
physique se dveloppe lors de son
emploi prolong.
5
4
R
p
o
n
s
e
s
:
A
:
F
,
F
,
F
/
B
:
V
,
V
,
F
/
C
:
2
,
4
,
5
.
Retrouvez les annonces
carrires sant
de La Revue du Praticien
sur son site Internet
www.33docpro.com
ref16_Bannwarth_1819 30/10/03 15:20 Page 1826
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide Pratique Périanesthésique Pour Les IADESDocument612 pagesGuide Pratique Périanesthésique Pour Les IADESzack labPas encore d'évaluation
- Physiopathologie Table Des MatièresDocument11 pagesPhysiopathologie Table Des MatièresSteph AnnyPas encore d'évaluation
- Échographie Thyroïdienne Et Parathyroïdienne2021Document241 pagesÉchographie Thyroïdienne Et Parathyroïdienne2021Bech EmilienPas encore d'évaluation
- Traite D Anesthesie Et de Reanimation 4e PDFDocument1 314 pagesTraite D Anesthesie Et de Reanimation 4e PDFPopescu VioricaPas encore d'évaluation
- Oeil Et Maladies SystémiquesDocument564 pagesOeil Et Maladies SystémiquesEl Farouk100% (1)
- Carabook - Guide de L'externe 2010Document192 pagesCarabook - Guide de L'externe 2010amar94290100% (2)
- Guide - Iade Sophie LamyDocument612 pagesGuide - Iade Sophie LamyCharlie HAHN100% (5)
- Gynecologie-CNGOF 2016Document730 pagesGynecologie-CNGOF 2016nadji ptichoouPas encore d'évaluation
- Imagerie de La Thyroide Et Des ParathyroidesDocument293 pagesImagerie de La Thyroide Et Des ParathyroidesBech Emilien100% (1)
- Le Manuel Du Vétérinaire - Volume 01Document199 pagesLe Manuel Du Vétérinaire - Volume 01Idris Sadoun100% (1)
- Intoxications Aigues PDFDocument364 pagesIntoxications Aigues PDFMohammed Mankour100% (1)
- Polycopie PhlebologieDocument188 pagesPolycopie PhlebologieFiras Tabka100% (1)
- Anesthésie Et MyasthénieDocument9 pagesAnesthésie Et Myasthéniekajol14100% (2)
- La Revue Du Praticien-Immunopathologie, Réaction InflammatoireDocument134 pagesLa Revue Du Praticien-Immunopathologie, Réaction Inflammatoiredrbadis100% (1)
- Précis d'anesthésie et de réanimation - Abrégé de la cinquième éditionD'EverandPrécis d'anesthésie et de réanimation - Abrégé de la cinquième éditionPas encore d'évaluation
- Sutures Chirurgicales: Un Manuel Pratique sur les Nœuds Chirurgicaux et les Techniques de Suture Utilisées dans les Premiers Secours, la Chirurgie et la Médecine GénéraleD'EverandSutures Chirurgicales: Un Manuel Pratique sur les Nœuds Chirurgicaux et les Techniques de Suture Utilisées dans les Premiers Secours, la Chirurgie et la Médecine GénéraleÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Mésothérapie: Les dessous de la peauD'EverandMésothérapie: Les dessous de la peauÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Mon livre sur le diabète et ses complications: Expérience et spécificité au service d'un artD'EverandMon livre sur le diabète et ses complications: Expérience et spécificité au service d'un artPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-DermatologieDocument144 pagesLa Revue Du Praticien-Dermatologiedrbadis100% (1)
- Traiteacute D39anestheacutesie Et de Reacuteanimation 4edpdf PDFDocument1 314 pagesTraiteacute D39anestheacutesie Et de Reacuteanimation 4edpdf PDFCristina Trofimov100% (1)
- 1 9782818314654 PDFDocument30 pages1 9782818314654 PDFChahira Ghezali100% (1)
- Protocoles UrologieDocument401 pagesProtocoles UrologieFAMER AngeliquePas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien Orientation DiagnostiqueDocument380 pagesLa Revue Du Praticien Orientation DiagnostiqueSylvainRnlt100% (2)
- Epuration Extrarénale en RéanimationDocument57 pagesEpuration Extrarénale en RéanimationSami MaghrebiPas encore d'évaluation
- Echographie Pulmonaire en ReanimationDocument21 pagesEchographie Pulmonaire en Reanimationentredosmundos0% (1)
- La Revue Du Praticien-Cancérologie, OncoHématologieDocument238 pagesLa Revue Du Praticien-Cancérologie, OncoHématologiedrbadis100% (1)
- Guide de Prescription Des Antalgiques en Urgence PDFDocument100 pagesGuide de Prescription Des Antalgiques en Urgence PDFJakob Laloui100% (2)
- Anesthesie Du Nourrisson Et de L Enfant PDFDocument18 pagesAnesthesie Du Nourrisson Et de L Enfant PDFnirvadinePas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-HépatoGastroEntérologieDocument175 pagesLa Revue Du Praticien-HépatoGastroEntérologiedrbadis100% (3)
- Manuel Infirmier AnesthDocument165 pagesManuel Infirmier Anesthazvanesthesie100% (1)
- La Revue Du Praticien-Cardiologie Pathologie - VasculaireDocument193 pagesLa Revue Du Praticien-Cardiologie Pathologie - Vasculairedrbadis100% (1)
- La Revue Du Praticien-Maladies InfectieusesDocument133 pagesLa Revue Du Praticien-Maladies InfectieusesdrbadisPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-Athérosclérose, Hypertension, ThromboseDocument95 pagesLa Revue Du Praticien-Athérosclérose, Hypertension, ThrombosedrbadisPas encore d'évaluation
- AnesthesieDocument12 pagesAnesthesieThalés KingPas encore d'évaluation
- Cours Des Anesthesiques (Locaux Et Généraux) 2022-2023Document15 pagesCours Des Anesthesiques (Locaux Et Généraux) 2022-2023Aissa Aymen BnPas encore d'évaluation
- Ol..Lection: .Jonati-Ian TaiesDocument171 pagesOl..Lection: .Jonati-Ian Taiesamédée junior wawaPas encore d'évaluation
- Anesthésie Du Nourrisson Et de L'enfantDocument30 pagesAnesthésie Du Nourrisson Et de L'enfantkajol14Pas encore d'évaluation
- PUFR ECNReaWebBRDocument512 pagesPUFR ECNReaWebBRMaksym Demianchuk100% (1)
- Hyponatrémies en RéanimationDocument18 pagesHyponatrémies en RéanimationCerastes CerastesPas encore d'évaluation
- Rapport Les Avancees en Contactologie PDFDocument222 pagesRapport Les Avancees en Contactologie PDFIrénée KalisaPas encore d'évaluation
- Le Maillon Faible - Radiologie, Echographie de L'Appareil LocomoteurDocument109 pagesLe Maillon Faible - Radiologie, Echographie de L'Appareil LocomoteurAthanassios CharitosPas encore d'évaluation
- Douleur, Soins Palliatifs Et Accompagnement 5e ÉdDocument436 pagesDouleur, Soins Palliatifs Et Accompagnement 5e ÉdAurélien100% (2)
- Désordres Métaboliques Et RéanimationDocument501 pagesDésordres Métaboliques Et RéanimationHanane AzurePas encore d'évaluation
- Urgences Chirurgicales NéonatalesDocument18 pagesUrgences Chirurgicales Néonataleskajol14100% (3)
- Obstetrique 4 Ed Collection Le Livre de L Interne SommaireDocument20 pagesObstetrique 4 Ed Collection Le Livre de L Interne SommaireChristian Ntakobajira100% (1)
- Anesthésie de L'enfant BrûléDocument11 pagesAnesthésie de L'enfant Brûlékajol14Pas encore d'évaluation
- Orthopédie - Les Dossiers Du DCEM - Ellipses - Text PDFDocument192 pagesOrthopédie - Les Dossiers Du DCEM - Ellipses - Text PDFLeap Heng0% (1)
- Livre Precis EpurationDocument66 pagesLivre Precis EpurationbigwebPas encore d'évaluation
- Vasopresseurs Pour Césarienne Urgente Et ProgramméeDocument12 pagesVasopresseurs Pour Césarienne Urgente Et ProgramméeTrésor de MédecinePas encore d'évaluation
- Anomalies Des Paupières Et Problèmes SystémiquesDocument4 pagesAnomalies Des Paupières Et Problèmes SystémiquesPhilip McNelsonPas encore d'évaluation
- Cours de Neurologie 4eme Anné e - 4Document12 pagesCours de Neurologie 4eme Anné e - 4MarMar TsiePas encore d'évaluation
- L'essentiel en Pédiatrie - Tome 3Document594 pagesL'essentiel en Pédiatrie - Tome 3Atou SidibéPas encore d'évaluation
- Examen Neurologique Facile 2021 PDFDocument242 pagesExamen Neurologique Facile 2021 PDFBadr AinPas encore d'évaluation
- Anesthesie Du Polytraumatisé DalensDocument18 pagesAnesthesie Du Polytraumatisé DalensOussama SSOUNIPas encore d'évaluation
- QUESTIONNAIREDocument1 pageQUESTIONNAIREibrahim abdelaliPas encore d'évaluation
- Gestes Techniques en MG PDFDocument39 pagesGestes Techniques en MG PDFJean PatatePas encore d'évaluation
- 263 Poly MyasthenieDocument8 pages263 Poly MyasthenieMatthew LeoPas encore d'évaluation
- 6-4 Prise en Charge Plaies de L Amain en Med GenDocument44 pages6-4 Prise en Charge Plaies de L Amain en Med GenProfesseur Christian DumontierPas encore d'évaluation
- 2 - Le Manuel Du Généraliste - PsychiatrieDocument177 pages2 - Le Manuel Du Généraliste - PsychiatrieYacouba DembelePas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-Néphrologie UrologieDocument140 pagesLa Revue Du Praticien-Néphrologie Urologiedrbadis100% (2)
- M Péd4Document92 pagesM Péd4Saleh Moussa SalehPas encore d'évaluation
- Le Manuel Du Généraliste Urgences Circonstancielles Et Toxicologie 2017Document279 pagesLe Manuel Du Généraliste Urgences Circonstancielles Et Toxicologie 2017Sauveur CristiniPas encore d'évaluation
- Asynchronie Patient-RespirateurDocument34 pagesAsynchronie Patient-Respirateurchergui100% (1)
- Ecg - Ecg DR DjellaoudjiDocument167 pagesEcg - Ecg DR DjellaoudjidrbadisPas encore d'évaluation
- Les Urgences Du Medecin Généraliste by DR DidouDocument733 pagesLes Urgences Du Medecin Généraliste by DR DidouDocteur Didou88% (8)
- Guide - Massage - Femme Enceinte Et Allaittante 2014Document45 pagesGuide - Massage - Femme Enceinte Et Allaittante 2014drbadisPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien - Synthése Clinique Et ThérapeutiqueDocument377 pagesLa Revue Du Praticien - Synthése Clinique Et ThérapeutiqueSylvainRnlt100% (2)
- La Revue Du Praticien-PédiatrieDocument179 pagesLa Revue Du Praticien-Pédiatriedrbadis100% (3)
- La Revue Du Praticien-Maturation Et VulnérabilitéDocument176 pagesLa Revue Du Praticien-Maturation Et VulnérabilitédrbadisPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien Orientation DiagnostiqueDocument380 pagesLa Revue Du Praticien Orientation DiagnostiqueSylvainRnlt100% (2)
- La Revue Du Praticien-Vieillissement, GériatrieDocument97 pagesLa Revue Du Praticien-Vieillissement, Gériatriedrbadis100% (1)
- La Revue Du Praticien-Maladies InfectieusesDocument133 pagesLa Revue Du Praticien-Maladies InfectieusesdrbadisPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-Maladies TransmissiblesDocument280 pagesLa Revue Du Praticien-Maladies TransmissiblesdrbadisPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-HépatoGastroEntérologieDocument175 pagesLa Revue Du Praticien-HépatoGastroEntérologiedrbadis100% (3)
- La Revue Du Praticien-OphtalmologieDocument82 pagesLa Revue Du Praticien-Ophtalmologiedrbadis50% (2)
- La Revue Du Praticien-Néphrologie UrologieDocument140 pagesLa Revue Du Praticien-Néphrologie Urologiedrbadis100% (2)
- La Revue Du Praticien-HématologieDocument134 pagesLa Revue Du Praticien-Hématologiedrbadis100% (1)
- La Revue Du Praticien-Douleur, Soins PalliatifsDocument50 pagesLa Revue Du Praticien-Douleur, Soins Palliatifsdrbadis100% (2)
- La Revue Du Praticien-NeurologieDocument178 pagesLa Revue Du Praticien-Neurologiedrbadis67% (3)
- La Revue Du Praticien-Endocrinologie NutritionDocument121 pagesLa Revue Du Praticien-Endocrinologie Nutritiondrbadis100% (2)
- La Revue Du Praticien-Endocrinologie NutritionDocument121 pagesLa Revue Du Praticien-Endocrinologie Nutritiondrbadis100% (2)
- La Revue Du Praticien-Athérosclérose, Hypertension, ThromboseDocument95 pagesLa Revue Du Praticien-Athérosclérose, Hypertension, ThrombosedrbadisPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-Gynécologie ObstétriqueDocument179 pagesLa Revue Du Praticien-Gynécologie Obstétriquedrbadis100% (3)
- La Revue Du Praticien-Cardiologie Pathologie - VasculaireDocument193 pagesLa Revue Du Praticien-Cardiologie Pathologie - Vasculairedrbadis100% (1)
- La Revue Du Praticien-DiversDocument76 pagesLa Revue Du Praticien-DiversdrbadisPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-Cancérologie, OncoHématologieDocument238 pagesLa Revue Du Praticien-Cancérologie, OncoHématologiedrbadis100% (1)
- La Revue Du Praticien-DermatologieDocument144 pagesLa Revue Du Praticien-Dermatologiedrbadis100% (1)
- TD Cas CliniqueDocument138 pagesTD Cas Cliniquedrbadis100% (1)
- Nouara + Aissa 2Document71 pagesNouara + Aissa 2elhara bentPas encore d'évaluation
- Anesthésie-Réanimation en Stomatologie Et Chirurgie Maxillofaciale (36-615-C-10)Document16 pagesAnesthésie-Réanimation en Stomatologie Et Chirurgie Maxillofaciale (36-615-C-10)MariusOnicelPas encore d'évaluation
- Cancer de La ThyroideDocument29 pagesCancer de La ThyroideMehdia MegateliPas encore d'évaluation
- 10 Anesthesiques3Document45 pages10 Anesthesiques3Ro FaidaPas encore d'évaluation
- Guide Pratique Danesthésie Du Chien Et Du Chat 2015Document431 pagesGuide Pratique Danesthésie Du Chien Et Du Chat 2015Fedy K'hila100% (2)
- Objectifs Pedagogiques Bases Generales Anesthesie-ReaDocument268 pagesObjectifs Pedagogiques Bases Generales Anesthesie-ReaSilvie Din0% (1)
- L'Anesthesie A L'Hopital de District: Michael B. DobsonDocument146 pagesL'Anesthesie A L'Hopital de District: Michael B. DobsonmechackPas encore d'évaluation
- EVCP Anesth ReaDocument27 pagesEVCP Anesth ReaAmirPas encore d'évaluation
- AnesthesiqueDocument15 pagesAnesthesiquekhm56505Pas encore d'évaluation
- Anesthesiques Cours Sur Les AnesthesiquesDocument7 pagesAnesthesiques Cours Sur Les AnesthesiquesAntonPurpurovPas encore d'évaluation
- Item 133 - Anesthesie - v3Document4 pagesItem 133 - Anesthesie - v3nicoPas encore d'évaluation
- Anesthesie Generaleen Odonto StomatologieDocument10 pagesAnesthesie Generaleen Odonto StomatologieDjaa MilaaPas encore d'évaluation
- Anesthesie Pour Chirurgie Du RachisDocument31 pagesAnesthesie Pour Chirurgie Du Rachislun pourlautrePas encore d'évaluation
- Chirurgie Oculaire Sous Les Climats Chauds 04Document21 pagesChirurgie Oculaire Sous Les Climats Chauds 04Wady Ben JalelPas encore d'évaluation
- Cas Cliniques Progressifs PDFDocument96 pagesCas Cliniques Progressifs PDFJulien CoguicPas encore d'évaluation
- 03 C Objectifs de StageDocument62 pages03 C Objectifs de Stagezchekireb97Pas encore d'évaluation
- Memoire Fin D'etude Ratard de RéveilDocument67 pagesMemoire Fin D'etude Ratard de RéveilBessmaPas encore d'évaluation
- 823 01 002 Chirurgie 1 Jour Avant Et Apres PDFDocument19 pages823 01 002 Chirurgie 1 Jour Avant Et Apres PDFbevhir.becirPas encore d'évaluation
- QCM Anesthésie PDFDocument3 pagesQCM Anesthésie PDFScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Anesthésiques Généraux Et Médicaments Utilisés en Anesthésie Les Points EssentielsDocument8 pagesAnesthésiques Généraux Et Médicaments Utilisés en Anesthésie Les Points EssentielsGeoffray AgardPas encore d'évaluation
- INSENSIBILISATION en OCEDocument7 pagesINSENSIBILISATION en OCErima dentairePas encore d'évaluation
- Questionnaire D'anesthésiologie/ D2 MédecineDocument26 pagesQuestionnaire D'anesthésiologie/ D2 MédecinePierre KalalaPas encore d'évaluation
- Anesthésie Locale Et Régionale en Oto-Rhino-Laryngologie PDFDocument15 pagesAnesthésie Locale Et Régionale en Oto-Rhino-Laryngologie PDFAlina TashnicPas encore d'évaluation
- Monitorage Profondeur Anesthesie BISDocument57 pagesMonitorage Profondeur Anesthesie BISMario FernandezPas encore d'évaluation
- Le Manuel Du Généraliste - Chirurgie Et AnestesieDocument83 pagesLe Manuel Du Généraliste - Chirurgie Et AnestesieMf Pil100% (1)
- Anesthesie LiproDocument15 pagesAnesthesie LiproKouekam Gustave TientcheuPas encore d'évaluation
- Objectifs de Stage 2 Emme Annee AnesthesieDocument4 pagesObjectifs de Stage 2 Emme Annee AnesthesiesaifPas encore d'évaluation