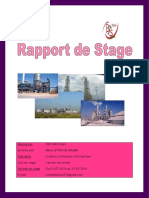Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rapport de Stage Rachid Ofppt
Rapport de Stage Rachid Ofppt
Transféré par
Laara Abde El AtiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rapport de Stage Rachid Ofppt
Rapport de Stage Rachid Ofppt
Transféré par
Laara Abde El AtiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Royaume du Maroc
Ministre de lEducation Nationale, de lEnseignement Suprieur,
Centre Pdagogique Rgional
De la formation des cadres Et de la recherche scientifique
de Technologie Settat
Acadmie Rgionale de
lEducation
Et de la formation de la rgion de Chaouia Ouardigha
Dlgation Provinciale de Settat
BREVET DE TECHNITIEN
SUPERIEUR
OPTION : Electromcanique et
Systmes Automatiss
RAPPORT
DE STAGE
OFFICE
CHERIFIEN DES
PHOSPHATES
BENI-IDIR
KHORIBGHA
Priode du stage :
au15/06/2010
du 17/5/2010
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Ralis par ltudiant :
NACHIT
Mustapha
Tuteur de stage
lentreprise : Mr SABKI
Sommaire
1-Introduction gnrale
..
2- Remerciement :
4
3-Ddicace :
4-Gnralits sur le groupe OCP :
..
a) Historique :
6
b) Organigramme du groupe OCP :
7
c) Statut juridique :
..7
d) Filiales du groupe OCP :
..8
5-Description de lunit BENIIDIR :..............................................................9
a)-Enrichissement sec :
9
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
b)-Station de chargement :
..9
c)-Calcination;
.10
d)-Schage :
.10
PARIE I : DESCRIPTION DU FOUR
SECHEUR11
I-1-les principaux lments du four scheur :
.12
I-2 principe de fonctionnement dun four
scheur :17
PARTIE II : ETUDE DE CHAINE DE
REGULATION.19
I-1 Chaine debit fuel pilot par luimme : 20
I-2 Chaine combustion:
..21
I-3 Chaine produit :
....23
I-4 chaine tirage:
..25
I-5 Chaine de prchauffage de fuel :
..27
I-6Les instrument dans les chaine de
rgulation :.28
Conclusion :
36
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
INTRODUCTION
GENERALE
Le stage joue un rle primordial dans la formation des
tudiants. Il contribue au contact direct de chaque tudiant
quant aux exigences du monde de travail. Il permet galement
de valider les connaissances thoriques acquises lors de la
formation, dapprendre de nouvelles mthodes de travail et de
stimuler le sens de la responsabilit chez ls tudiants.
Mon stage a t effectu au sein de lOffice Chrifien des
Phosphates, unit traitement Beni-Idir PMK/TB/MR service
Rgulation.
Dans ce service j tait charg de:
Faire la description du four scheur (Dfinir ses
lments et son principe de fonctionnement).
Faire ltude des chaines de rgulation.
Dfinir les instruments existants dans les chaines
de rgulation.
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
REMERCIMENT
Avant daborder ce rapport rsumant le
stage, nous tenons tout dabord.
Plus prcisment remercier notre encadrant de
stage Mr. SABKI pour son Soutien qui nous a t
prcieux tout au long de notre Stage pour
accomplir nos tches, afin de russir dans cette
priode de stage.
De mme, nous osons prsenter nos respects,
nos reconnaissances et nos profondes gratitudes
tout le personnel de service pour leur aide
prcieux, leur soutient moral, pour leur esprit de
collaboration et leurs sacrifices pour que je puisse
passer ce stage dans des bonnes conditions en
acqurant
certaines
connaissances
et
expriences professionnelles.
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
DEDICACE
Je ddie ce modeste travail :
Ma chre mre, en signe damour de respect de
reconnaissance pour tout ce quelle a consentis pour mon
ducation et mon bien tre. Que Dieu puisse la protger et
la procure une longue vie pleine de joie et de bonne sant.
Mes frres et mes surs.
Tous mes professeurs et corps enseignants et tous ceux
qui ont contribu de prs ou de loin llaboration de ce
travail.
Toute ma famille, mes amis, que nos relations restent
indfectibles, bases sur le respect, la solidarit et lamour.
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
4-Gnralits sur le groupe
OCP
a) Historique :
Le groupe Office Chrifien des Phosphates (O.C.P) est un
oprateur international dans le domaine de lindustrie du
phosphate et des produits drivs. Le phosphate brut extrait du
sous-sol marocain est export tel quel ou livr aux industries
chimiques du groupe SAFI ou JORF LASFAR pour tre
transform en produits drivs commercialisables : acide
phosphorique de base, acide phosphorique purifi, engrais
solides. Le groupe O.C.P livre aux cinq continents de la plante ;
Ses exportations reprsentent 25 30% du commerce
international du phosphate et ses drivs, En effet cest le
premier exportateur est troisime producteur mondial aprs les
Etats-Unis et lex-URSS.
Cest en fvrier 1912 quon a dcouvert les premiers
gisements dans la zone de KHOURIBGA et plus prcisment
dans la rgion de OULED ABDOUNE. Mais lexploitation effective
na commenc quen fvrier 1921 dans la rgion de OUED ZEM.
Ce nest quen 30 juin 1921 que le premier train sur voie large
de 1.60 m a t charg est dirig vers le port de CASABLANCA.
Un mois aprs lexploitation a commenc par voie maritime.
En 1930 un nouveau centre de production de
phosphate est ouvert Youssoufia connu sous le nom de
Louis Gentil (1931).
7
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
La mthode dextraction en dcouverte KHOURIBGA
nest mise en uvre quen 1952 suivi de la cration dun centre
de formation professionnel en 1958, en renforcement des
efforts mens, depuis des dcennies sur ce plan ; Puis cration
par la suite dautres units de formation / perfectionnement :
Ecole de matrise de BOUJNIBA (1965).
Vers lanne 1975 lO.C.P sest organis en
groupe qui comporte lO.C.P et les filiales.
Depuis lors, les besoins mondiaux en phosphates ont fait
de lO.C.P une entreprise qui jusqu nos jours na cess de
grandir et pour se maintenir face la concurrence des autres
pays producteurs des phosphates et drivs, il se modernise, se
dveloppe continuellement et saffirme comme le leader du
march mondial des phosphates.
Ce groupe est gr par plusieurs directions coiffes par une
direction gnrale dont le sige social a CASABLANCA.
b) Organigramme du groupe OCP :
RAPPORT DE STAGE 2010
c)
NACHIT Mustapha
Statut juridique :
Le dahir du 27 janvier 1920 a attribu ltat marocain la
participation aux recherches et lexploitation du phosphate dans
tout le royaume.
Le dahir du 7 aot 1920 dcrta la fondation de loffice
chrifien des phosphates comme filiale qui sera gr dans des
conditions lgales, techniques et psychologiques identiques
un tablissement industriel et commercial.
d) Filiales du groupe OCP :
Le groupe O.C.P regroupe en plus de l'O.C.P plusieurs filiales,
il s'agit de :
CERPHOS
FERTIMA: Socit Marocaine des Fertilisants.
IPSE: Institut de Promotion socio-ducative.
MAROC PHOSPHORE : direction industrielle chimique.
MARPHOCEAN
(maritime).
transfert
des
actions
de
lOCP
PHOSBOUCRAA.
SMESI: Socit
Industrielles.
Marocaine
d'Etudes
SOTREG: Socit des Transports Rgionaux.
STAR.
9
Spciales
et
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
5-Description de lunit
BENI-IDIR :
Lunit de BENI-IDIR a dmarr en 1965 dans le but de
traiter le phosphate fourni par les units dextraction (DAOUI,
PARC EL WAFI ).
Elle est constitue de trois usines de traitement et une station
de chargement :
Usine denrichissement;
Station de chargement ;
Usine de calcination ;
Usine de schage.
a)-Enrichissement sec :
On note plusieurs qualits de phosphate, en fonction de la
teneur en phosphate, au niveau de cette usine savoir :
10
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Le K00 : sa teneur en phosphate est de 62% 56%,
provenant du DAOUI et la ZONE CENTRAL. Sa qualit est
pauvre, elle est argileuse.
K10 : la teneur en phosphate est de 69%, il provient du
DAOUI et MERAH LAHRACH.
K20 : sa teneur en phosphate est de 71% provenant du
DAOUI, MERAH LAHARACH et LA ZONE CENTRAL.
K40 : sa teneur en phosphate est de 74% 80%, il
provient de LA RECETTE.
Lenrichissement consiste amliorer la teneur
phosphates 70% en passant par les tapes suivantes :
des
Schage ;
Elimination des particules fines infrieures 40 microns ;
Criblage 3 mm ;
Broyage 1 mm pour clater les engluements mixtes
(phosphate Gange) ;
Elimination des refus de 360 microns.
b)- Station de chargement :
Grce une station de chargement qui est intgre dans
linfrastructure de lunit, le phosphate sera changer et
transporter par des trains aux diffrentes destinations.
Le phosphate trait se met dans des stocks selon la qualit
et se transporte par des convoyeurs vers les silos. Ces derniers
sont commands selon le dbit souhaitable et chargent 4
wagons en mme temps.
c)-Calcination :
Dfinition :
Calciner signifie brler ou carboniser, cest la procdure par
laquelle, on ne laisse plus les rsidus calcaires.
Objectif :
La calcination a pour but lenrichissement du phosphate en
portant sa temprature 900C pour diminuer le taux de CO 2
11
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
(de 7% 1%) selon la demande du client, avec llimination de
certains lments tels que :
Leau dhumidit.
Leau de cristallisation.
Leau de constitution.
Matires organiques.
d)-Schage :
Le schage est une opration industrielle qui consiste
liminer ou diminuer le taux dhumidit du phosphate.
Il a pour but dliminer compltement ou partiellement
lexcs dhumidit que contient le phosphate par vaporation, il
ncessite une source de chaleur trs leve (950 oC) produite
par un gnrateur de gaz (fuel), le contacte gaz produit est
ralis dans un scheur cylindrique rotatif quip des augets et
palettes pour faciliter le malaxage et lavancement du
phosphate. Pour faire schage on besoin des fours scheurs.
12
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
PARIE
I
DESCRIPTION DU
FOUR SECHEUR
13
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
I-1-les principaux lments du four scheur :
Schma synoptique du four scheur :
Figure I
Le cur du schage est compos de 4 parties principales :
Le foyer ou chambre de combustion.
La virole ou tube scheur.
La chambre poussire ou chambre de dtente.
Les ventilateurs de tirage.
La buse
1. foyer ou chambre de combustion :
Cest une enveloppe cylindrique en tle dacier, revtue
intrieurement de briques isolantes afin de limiter la diffusion
de chaleur vers lextrieur et protger les tles dacier contre la
fonte.
Elle joue le rle du gnrateur de gaz chaud. Le fuel est
pulvris en fines gouttelettes par ladjonction dun jet de fluide
auxiliaire de vapeur deau. Lair primaire, inject par un
14
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
ventilateur, donne naissance loxygne ncessaire la
combustion. La quantit de chaleur, produite dans la chambre
de combustion, est vhicule par la dpression cre par les
ventilateurs de tirage dispose en tte du tube scheur.
Schma suivant reprsente
les diffrents lments
qui
constituent le foyer.
Figure 1
2.
La buse :
15
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Cest un lment de gomtrie spciale permettent la
combinaison entre le foyer et la virole, et le premier lment qui
reoit le produit de la trmie.
Figure 2
3. La virole :
Cest un tube scheur tournant, de 25 m de longueur et de
1.70
m de diamtre, entran une vitesse constante
(8tr/min), quip des augets et des palettes disposes le long
de sa paroi interne, facilitant lchange thermique entre la
masse gazeuse et le phosphate, ainsi que le dplacement de
ce dernier vers la chambre sont assure par des augets qui
permettent de brasser continuellement les grains du produit
avec la rotation de la virole 8 tr/min une vitesse constante
puis les laissent tomber en pluie dans le courant des gaz
chauds, augmentant ainsi considrablement la surface
dchange thermique. Ainsi lacheminement du produit vers la
sortie est assur par les palettes qui permettent avec la
rotation de la virole un mouvement hlicodal du produit, et
dautre part le courant des gaz assur par la dpression cre en
tte du tube.
16
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Figure 3
4. La chambre poussire :
Cest le lieu o se rassemble le phosphate sec aprs avoir
pass dans le tube scheur, elle se compose de 2 parties :
Chambre de dtente : cest une enceinte qui est situe
juste la sortie de la virole, sa longueur est plus grande
que le diamtre de la virole. Le gaz charg baisse
brusquement, les particules relativement grosses perdent
de laptitude et tombent, les fines schappent et
continuent le chemin vers les tubix.
chambre tubix : cest la partie de rcupration des
particules extra fines. On appelle tubix un ensemble de
cyclones disposs dune faon bien dtermine (8
batteries de cyclones, chaque batterie est compose de
quatre ranges de12 cyclones) soient 384 cyclones dans
le four.
17
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Figure 5
5. ventilateurs de tirage :
Crent une dpression le long du four scheur ?elles
ont pour rle laspiration de la quantit gazeuse chaude
existante dans le foyer, et participent aussi lvacuation Du
phosphate vers la chambre poussire et vers la chemine.
18
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Figure 6
6. La chemine :
Sert vacuer les gaz de combustion du fuel et du coke,
la vapeur deau
due au schage et les fines particules qui
russi dchapper du dernier cyclone ; la poussire.
19
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
I-2 principe de fonctionnement dun four scheur :
But de schage :
On sche le phosphate dans le but daugmenter sa teneur
par limination de leau en vue de minimiser le cot de
transport et faciliter son exploitation .le taux dhumidit du
produit dentre environ 13% qui augmente 15% du fait de
lavage et en fonction du qualit du parc humide du fait de
schage en sort entre 1% 3% suivant les clients et la qualit
demande .Le schage se fait grce un four dit four scheur
que lusine de BENI-IDIR en contient 11, 8 sont utiliss et les
autres sont rservs pour le rechange.
Principe de fonctionnement:
aprs raliser le triangle de combustion, le produit humide
et les gazes chauds sont introduits dans le tube scheur au
niveau de la jonction virole .la quantit de chaleur produites est
vhicul le long du tube scheur ,l ou lchange thermique
entre la masse gazeuse et le phosphate seffectue par
dplacement le long de la virole laide des lments installs
dans cette dernire appels les palettes et les augets .aprs
passage dans le tube scheur il yaura un dplacement des
gros grains vers la chambre dtente et des fines grains vers
la chambre tubix ensuite un criblage pour faire passer
seulement les grains riches en phosphate envoys ensuite vers
le stock .
20
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Le systme de scurit install au niveau du four scheur :
Pour des raisons de scurit les valeurs qui suivantes doivent
tre respectes :
Temprature chambre poussire: 62c <Tc< 84c.
(Dpendante de lhumidit)
Temprature de la buse : 100c<Tb<1200c.
Temprature de brique : 0c<Tbr<350c.
Temprature de tle : 0c<Tt<120c.
Dbit du fuel : 600l/h<Df<3000l/h.
Dbit du coke : 0kg/h<DC<3000l/h.
Dbit du produit : 18 cm/casque. (Cest une ouverture
qui rgle le dbit du produit).
Dpression : -3 ou -4 mbar.
Lhumidit : ses valeurs dpendantes des besoins de
client, cest pour cela il faut contacter les laboratoires et
les services concerns.
H2O dentre : 10 17%.
H2Ode sortie : 2,2 2,5%.
H2O pour la fabrication du semi sch : 3 3,5%.....
21
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Lafficheur de fonctionnement
PARTIE
II
22
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
ETUDE DES CHAINES
DE REGULATION
I-1 Chaine debit fuel pilot par lui-mme :
But : maintenir un dbit constant de fuel dans le four scheur.
Schma fonctionnelle :
API
Consigne
dbit
fuel
Ouverture ou
fermeture de la
vanne fuel
PI
D
Indicateur
Vanne
rgulatrice
Figure I-20
Principe de fonctionnement :
23
Compteur
volumtrique
Dbit
fuel
indiqu
(Rgl)
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Le compteur volumtrique permet de donner des impulsions de
frquence F a partir du dbit fuel entrant dans le four, alors il envoie ces
impulsions a un transmetteur qui les converti en une intensit (4-20 mA)
envoy lAPI qui joue le rle dun comparateur plus un rgulateur, et
suivant une consigne donn il envoie un signale la vanne rgulatrice qui
maintient le dbit dsir suivant cette consigne.
Schma synoptique :
Figure I-21
I-2 Chaine combustion:
24
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
But : pour avoir une humidit de sortie comprise entre 2% 3% il
faut assurer une temprature de chambre entre 60C 85C, do
lintrt dune telle chaine.
Schma fonctionnelle :
API
Indicateur
Consigne
Foyer + Buse
V.V+
KE
PI
D
SELECTIONN
-EUR
T buse
V.R
.FUEL
V.V
PT100
Plat
eaux
Foyer + Buse
PT100
Bu Foyer + Buse
PT100
Figure I-22
Principe de fonctionnement :
Suivant la temprature existant dans la chambre le PT100 donne son
image en une Resistance convertie via un transmetteur en une intensit
de 4-20 mA puis envoy lAPI qui va agir suivant la consigne soit :
Sur le dbit du produit par lintermdiaire dun variateur de vitesse
qui commande les moteurs de lextracteur KF.
Sur le dbit fuel a laide dune vanne rgulatrice
Sur le dbit de coke laide des variateurs de vitesse qui
commandent les plateaux du doseur.
Schma synoptique :
25
Indiqu
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Figure I-23
I-3
Chaine produit :
But : linjection du produit et la dpression cre par les ventilateurs de tirage aspirent
la masse gazeuse gnrer par le foyer et par consquent la temprature buse varie, do
lintrt dune telle chaine de rgulation pour la maintenir TB=950C.
Schma fonctionnelle :
26
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Figure I-24
Principe de fonctionnement :
Le thermocouple permet de donner une tension qui est limage de la
temprature buse et a laide dun transmetteur cette valeur est convertie
en une intensit puis envoye a lAPI qui va agir suivant la consigne soit :
Sur le dbit de produit par lintermdiaire dun variateur de vitesse
qui commande la vitesse des moteurs de lextracteur KF.
Sur le dbit de coke en agissant sur les variateurs de vitesse qui
commandent les moteurs des plateaux du doseur.
Sur le dbit de fuel en agissant sur la vanne rgulatrice.
Schma synoptique :
27
RAPPORT DE STAGE 2010
Figure I-25
I-4 chaine tirage:
Schma fonctionnelle :
28
NACHIT Mustapha
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
API
Consigne
dpression
Indicateur
PI
D
V.V+V.T
Buse+vrole
Canne
Chambre
DEP
P
I I
Dpression
Figure I-26
Indiqu ; rgl
But : obtenir un produit avec une faible humidit, aspirer lair
secondaire vers la chambre de faon limiter le retour de la flamme vers
lextrieur, et la participation lavancement du phosphate vers la
chambre poussire et vers la chemine.
Principe de fonctionnement :
A laide dune conduite qui a la forme dun tube li la buse on obtient
une valeur sous forme de pression ,convertie par un transmetteur en une
intensit envoy ensuite a lAPI qui agit aprs correction sur un variateur
de vitesse qui commande a son tour les ventilateurs de tirage.
Des expriences sur les fours scheurs ont montr que si la
dpression >3.7mbar, le fuel sort sans quil fini sa combustion totale et
aussi le phosphate sort avec humidit trs lev et si la dpression <3.7
mbar on observe le phnomne du retour flamme.
29
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Schma synoptique :
Figure I-27
I-5 Chaine de prchauffage de fuel :
But : pour que le fuel soit prs la combustion il faut quil atteint une
temprature de 110C do lintrt dune installation de prchauffage.
Principe de fonctionnement :
Une fois le fuel arrive dans le conduit de prchauffage, une sonde
la sortie du conduit, agit sur un liquide glycrine (suivant la consigne
dsir) ayant un coefficient de dilatation proportionnelle la temprature
mesur la sortie du conduit, alors que la dilatation du liquide agit sur un
cerveau moteur agit ensuite sur une vanne rgulatrice pour augmenter ou
diminuer la quantit de vapeur deau.
Schma synoptique :
30
RAPPORT DE STAGE 2010
Entr
vapeur
VVV
Entr
fuel
NACHIT Mustapha
Sortie
vapeur
Sonde de
tempratur
e
Sortie
fuel
Cerveau
moteur
Consigne
110C
Figure I-28
Rglage de la
consigne
I-6Les instrument dans les chaine de rgulation :
1.DEFINITION:
La rgulation
consiste maintenir automatiquement une
grandeur physique la valeur dsire quelles que soient les
perturbations qui peuvent subvenir.
La rgulation dune grandeur couramment appele rgulation
de procd.
Exemples de rgulation de procd :
Rgulation du niveau dun rservoir
Rgulation de la temprature dun four
Rgulation de la vitesse dun moteur
Rgulation du dbit dans une canalisation
31
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
2. LES CAPTEURS
2.1 Dfinition d'un capteur
C'est un dispositif qui transforme une grandeur
physique en une grandeur exploitable, souvent de nature
lectrique. Le choix de l'nergie lectrique vient du fait qu'un
signal lectrique se prte facilement de nombreuses
transformations difficiles raliser avec d'autres types de
signaux.
2.2 Constitution d'un capteur
Corps d'preuve : lment mcanique qui ragit slectivement
la grandeur mesurer. Il transforme la grandeur mesurer en
une autre grandeur physique dite mesurable.
Transducteur : il traduit les ractions du corps d'preuve en une
grandeur lectrique constituant le signal de sortie.
Transmetteur : mise en forme, amplification, filtrage, mise
niveau du signal de sortie pour sa transmission distance. Il
peut tre incorpor ou non au capteur proprement dit.
2.3 Transmission du signal de mesure
Selon le type de capteur, le signal lectrique de
mesure peut tre de diffrentes natures : analogique,
numrique ou logique.
32
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Signal de mesure analogique : il est li au mesura de par une loi
continue, parfois linaire, qui caractrise l'volution des
phnomnes physiques mesurs. Il peut tre de toute nature:
courant 0 - 20 mA , 4 - 20 mA
tension 0 - 10 V , 0 - 5 V
Signal de mesure numrique : il se prsente sous la forme
d'impulsions lectriques gnres simultanment (mode
parallle, sur plusieurs fils) ou successivement (mode srie, sur
un seul fil). Cette transmission est compatible avec les
systmes informatiques de traitement.
Signal de mesure logique : il ne compte que deux valeurs
possibles, c'est un signal tout ou rien.
2.4 Les thermocouples:
Ce capteur est utilis pour mesurer la temprature, il est
constitu de deux conducteurs de nature diffrentes, souds
une extrmit (soudure chaude), Lautre extrmit appel
soudure froide ou sengendre une force lectromotrice en mV
continu de 0 50 mV qui est transmis travers un cble de
compensation un transmetteur tentions / courant.
Lorsque la partie chaude est chauffe, une tension
proportionnelle la diffrence de temprature entre la soudure
chaude est la soudure froide est gnre. Les tensions
disponibles la sortie du thermocouple sont de lordre de
millivolt 0 50 mV
Thorie :
Pour mieux comprendre la mesure par thermocouple, il
convient de comprendre pralablement le fonctionnement de ce
dernier. La premire partie de cette section dveloppe la thorie
fondamentale des thermocouples, tandis que la suite dcrit
comment connecter le thermocouple un instrument et
comment effectuer une mesure de temprature.
Pour mesurer la tension de Seebeck sur un thermocouple, il ne
suffit pas de connecter le thermocouple un voltmtre ou un
autre systme de mesure car le fait de connecter les fils du
thermocouple au systme de mesure cre des circuits
thermolectriques supplmentaires.
33
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Figure n1. Thermocouple de type J
Prenons l'exemple du circuit illustr par la Figure n1, dans
lequel le thermocouple de type J se trouve dans la flamme
d'une bougie dont nous souhaitons mesurer la temprature. Les
deux fils du thermocouple sont connects aux fils de cuivre
d'une carte d'acquisition de donnes. Vous remarquerez que le
circuit comporte trois jonctions mtalliques dissemblables : J1,
J2 et J3. J1, la jonction du thermocouple, gnre la tension de
Seebeck proportionnelle la temprature de la flamme de la
bougie. J2 et J3 ont chacun leur propre coefficient de Seebeck et
gnrent leur propre tension
thermolectrique
proportionnelle la temprature au niveau des terminaux
d'acquisition de donnes. Afin de dterminer la contribution en
tension de J1, il faut connatre les tempratures des jonctions J2
et J3, ainsi que les rapports tension/temprature pour ces
jonctions. Vous pouvez alors soustraire les contributions en
tension des jonctions parasites en J2 et J3 de la tension mesure
au niveau de jonctionJ1.
Les thermocouples ont besoin d'une rfrence de
temprature pour compenser l'effet de ces soudures "froides"
parasites indsirables. La mthode la plus courante consiste
mesurer la temprature la jonction de rfrence avec un
capteur de temprature mesure directe, puis de soustraire les
contributions en tension des jonctions parasites. Ce processus
est appel compensation de soudure froide. Il est possible de
34
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
simplifier le calcul de la compensation de soudure froide en
tirant parti de certaines caractristiques du thermocouple.
En ayant recours la loi des mtaux intermdiaires et en
posant quelques hypothses simples, vous constaterez que la
tension mesure par un systme d'acquisition de donnes
dpend uniquement du type et de la tension du thermocouple,
ainsi que de la temprature de la soudure froide. La tension
mesure est indpendante de la composition des fils de mesure
et des soudures froides, J2 and J3.
D'aprs la loi des mtaux intermdiaires, illustre Figure n2,
l'insertion de n'importe quel type de fil dans un circuit de
thermocouple n'a aucun effet sur la sortie tant que les deux
extrmits de ce fil sont la mme temprature, c'est--dire
isothermes.
Figure n2. Lois des mtaux intermdiaires
Avantage:
* aucune source extrieure ncessaire.
* simple utiliser.
* robuste et peu coteux.
* bon temps de rponse.
*grande de mesure de temprature.
Inconvnient:
* non linire.
* basse de tension de sortie.
* peu stable.
* peu sensible.
* jonction de rfrence ncessaire
35
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
2.5 PT100
Sous laction de la chaleur la
rsistance tels le cuivre .le platine
et le nickel varie de sorte que lon
peut avoir une indication de la
valeur de la temprature en,
mesurant cette rsistance.
la valeur de la rsistance
quivalente du PT100 peut tre
calcule approximativement laide de la formule :R=R0+a.T .
R :la valeur de temprature T donne
R0 :la valeur de rfrence du PT100 0 0C
a : la valeur du coefficient de temprature du matriau
(ohm/0C).
PT100 en platine 100 Ohm normalis est devenu une norme en
instrumentation. Celui-ci offre une rsistance de 100 Ohm pour
une temprature de 0C et il peut, mesurer des tempratures
allant de
(-180 C jusqu +650 C a valeur de la rsistance quivalente
du PT100 peut tre calcule approximativement laide de la
formule suivante.
La thermistance PT100 dont la rsistance varie en fonction
de la temprature, elle est place dans la chambre poussire,
la variation sera traite par un transmetteur qui la convertit
un courant proportionnel la rsistance, et par consquent la
temprature.
Ce courant est indiqu sur un indicateur galvanique et un
indicateur numrique, qui nous donne la valeur de la
temprature, puis un enregistreur et vers le rgulateur qui
selon la mesure nous donne un cart E qui agit sur le
positionneur qui nest quun convertisseur lectropneumatique
avec recopie, qui selon E nous donne une pression qui ouvre ou
36
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
ferme proportionnellement les deux vannes du fuel et de la
vapeur deau, et par consquent, respectivement
laugmentation ou chute la temprature chambre.
constitution : Cest une sonde thermo-rsistive en platine.
caractristiques : La rsistance dune sonde pt100 est de 100
ohms 0C et la variation est de 0,4 ohm par degr .l
Critiques :
gamme de temprature leve.
.mise en uvre simple
.prix lev
.variation linaire
.stable dans le temps
.prcise
3. LES CONVERTISSEURS ET LES TRANSMETTEURS :
3.2.CONVERTISSEUR
3.2.1 Dfinition
Dfinition du mot CONVERTISSEUR, Dsigne la technologie
qui convertit des informations numriques en quantits
physiques, et inversement. Dsigne galement tout programme
de conversion
3.2.2 Principe de Fonctionnement :
Lair passe des lalimentation de linstrument travers une
restriction, jusqu la chambre de pilotage et le capillaire de
contre-pression.
La bobine est solidaire dun bras articul et quilibr et se
trouve de dans de la chambre magntique dun aimant
37
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
permanent. Lorsque un courant lectrique parcoure la bobine,
le chambre magntique
Engendr soppose au champ magntique de laiment
permanent, tout en approchant la plaquette au capillaire on
augmente la restriction du passage et, par consquence, on
augmente la pression jusqu produit lquilibre de forces sur le
bras. Une diminution de lintensit du courant lectrique,
partir dune position dquilibre dtermine, produit les effets
contraires et, ce qui arrive, cest une diminution de la pression
de sortie du module qui va piloter le positionneur.
3.3 LE TRANSETEUR
3.3.1 Dfinition
Le transmetteur est un appareil qui
permet de convertir une grandeur
physique en une autre grandeur physique
de mme nature.
Les transmetteurs qui sont utiliss dans
les chanes de rgulation du four scheur
sont de type SCALAIRE.
3.3.2 Transmetteur TT20
Le transmetteur lectrique de temprature TT 20 est un
appareil permettant dans dentre, en tension continue, un
standard de sortie en courant continue proportionnel choisi
lavance.
Le standard dentre dtermine par la F. E. M (forces
lectromotrices) mis par un dtecteur de temprature
thermocouple.
Ltendue de mesure doit tre comprise entre 0 -50 mV le
standard de sortie les valeurs minimales et maximales du
courant de sortie peuvent tre rgles indpendamment de 0
20 mA.
38
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
3.3.3 Caractristique gnrale.
* Alimentation du secteur : 127/220 V, 50/ 60 Hz
* Consommateur : 5 V. A
* Domaine dutilisation en temprature : 0 50 C
4. LES ACTIONNEURS
4.1 Dfinition
Dans une machine ou un systme de commande distance,
semi automatique ou automatique, un actionneur est l'organe
de la partie oprative qui, recevant un ordre de la partie
commande via un ventuel pr-actionneur,
convertit l'nergie qui lui est fournie en un travail utile
l'excution de tches, ventuellement programmes d'un
systme automatis.
En d'autres termes : un actionneur est l'organe fournissant la
force ncessaire l'excution d'un travail ordonn par une unit
de commande distante.
4.2 Vanne rgulatrice
Cest une vanne dont la marge douverture varie de 0 100%,
cette variation dpend de la pression applique sur une
membrane qui fait dplacer une tige ouvrant ou fermant la
conduite selon le sens daction de la vanne.
39
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
CONCLUSION
Je suis trs satisfait de ce stage qui ma permet de
concrtiser les connaissances thoriques acquises lcole
avec la ralit du travail, et de confronter le monde
professionnel, un monde qui demande non seulement des
comptences dans le domaine du savoir mais aussi un savoirfaire, et un savoir tre et avoir des bonnes relations humaines.
Ce stage tait pour moi une prcieuse occasion pour
sintgrer dans le monde professionnel et pour dcouvrir les
avantages du travail en groupe.
Ensuite, mme si la priode dun mois de stage nest pas
suffisante, tait trs important touts les niveaux savoir :
Connatre le milieu du travail, subir lhoraire de travail
inhabituel,et Conqurir des nouvelles connaissances thoriques
et pratiques dans plusieurs domaines lOCP.
Ctait le cas pour moi durant ce stage, PMK/TB/MR,
qui ma permis de se familiariser aussi bien avec les
installations de traitement OCP quavec un personnel qualifi et
comptent.
40
RAPPORT DE STAGE 2010
NACHIT Mustapha
Sur le bon relationnel, lintgration aux siens du service
rgulation a t trs facile vu ces personnels agrables et
sympathiques.
Enfin, je tiens remercier pour la deuxime fois tous le
Personnel de lOCP, pour laide quil ma prodigu.
41
Vous aimerez peut-être aussi
- Memoire Conception Mise en Place Modele Controle GestionDocument80 pagesMemoire Conception Mise en Place Modele Controle GestionNadia Ns71% (7)
- SerieDocument10 pagesSerieSERGIOPas encore d'évaluation
- DrissRapport de Stage - OCPDocument63 pagesDrissRapport de Stage - OCPKarim JikPas encore d'évaluation
- Audit Fiscal Et Gestion Du Risque FiscalDocument49 pagesAudit Fiscal Et Gestion Du Risque FiscalOussama Salih94% (49)
- Tableau de Bord Cas BDLDocument135 pagesTableau de Bord Cas BDLredouane86100% (27)
- Business PlanDocument44 pagesBusiness PlanGhizlane Ait El Mousse100% (1)
- Controle de Gestion BanqueDocument60 pagesControle de Gestion BanqueB.I97% (33)
- Rapportade StageDocument55 pagesRapportade Stagemochakiss100% (1)
- Rapportade StageDocument55 pagesRapportade Stagemochakiss100% (1)
- Houda SabilDocument27 pagesHouda Sabilrajaa chebbakiPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument49 pagesRapport de StageYassine ZaharPas encore d'évaluation
- RapportDocument66 pagesRapportAbdelilah El Gabari100% (1)
- 1Document28 pages1boumostachPas encore d'évaluation
- Rhaiti BouchraDocument27 pagesRhaiti Bouchrahjhihvj100% (2)
- OCP Rapport2003Document46 pagesOCP Rapport2003Lune Celeste100% (2)
- Asmaa PfeDocument31 pagesAsmaa PfeSoukaina soukainaPas encore d'évaluation
- Rapport Ocp de KhouribgaDocument32 pagesRapport Ocp de KhouribgaanassPas encore d'évaluation
- Salamedine AyouchiDocument45 pagesSalamedine AyouchivuweriPas encore d'évaluation
- Rapport Ocp - Etude Critique Des Performances Du Parc MaterielDocument49 pagesRapport Ocp - Etude Critique Des Performances Du Parc MaterielAnass BePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage OcpdocxDocument29 pagesRapport de Stage OcpdocxNabil FaresPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 1Document30 pagesRapport de Stage 1fatima ezzzhra BaalasPas encore d'évaluation
- DciDocument39 pagesDciTaha BenammounePas encore d'évaluation
- Probléme Des Arrêt Des Chaînes - OCP - NABILDocument50 pagesProbléme Des Arrêt Des Chaînes - OCP - NABILH-raf MouihPas encore d'évaluation
- Le Rapport de Stage OCP 2013Document41 pagesLe Rapport de Stage OCP 2013SouadElPas encore d'évaluation
- Salwa SadikiDocument35 pagesSalwa SadikiAnas ElhardaPas encore d'évaluation
- Phosphate 2 - CopieDocument25 pagesPhosphate 2 - CopieDafali HasnaPas encore d'évaluation
- AichaDocument32 pagesAichaAbderrahim BelmJouJPas encore d'évaluation
- Rapport SalimiDocument80 pagesRapport SalimiHind HachPas encore d'évaluation
- Adil Raport7Document65 pagesAdil Raport7Azz-eddine ZizoPas encore d'évaluation
- Production D'acide Phosphorique Au Niveau de La Nouvelle Installation (Jfc3) de Jorf LasferDocument25 pagesProduction D'acide Phosphorique Au Niveau de La Nouvelle Installation (Jfc3) de Jorf Lasferkhadijaaelidrissi7Pas encore d'évaluation
- JADID-HAJAR-OCP (Réparé)Document34 pagesJADID-HAJAR-OCP (Réparé)Hajar HajarPas encore d'évaluation
- Etude Graphique de La Capacité D'absorption Par Les Colonnes À Charbon Actif - ZAIITAR SabahDocument33 pagesEtude Graphique de La Capacité D'absorption Par Les Colonnes À Charbon Actif - ZAIITAR Sabahmohamed creatorPas encore d'évaluation
- Validation de La Méthode D'analyse Du Phosphate Tricalcique Par L'auto-Analyseur Selon La Norme NF T90-210 - Najoua BenzaidaneDocument66 pagesValidation de La Méthode D'analyse Du Phosphate Tricalcique Par L'auto-Analyseur Selon La Norme NF T90-210 - Najoua BenzaidaneJIHAD EL MAKAOUIPas encore d'évaluation
- Rapport-Descriptif-De - IMACID PETROL-Jorf-LasfarVrDocument44 pagesRapport-Descriptif-De - IMACID PETROL-Jorf-LasfarVrSoufiane El AoumariePas encore d'évaluation
- JADID HAJAR OCP Repare PDFDocument34 pagesJADID HAJAR OCP Repare PDFAnaibar TarikPas encore d'évaluation
- Dyal WaldDocument29 pagesDyal Waldnadia benmehdiaPas encore d'évaluation
- Etude Du Phénomène D'encrassement D'un Échangeur de Chaleur À BlocsDocument48 pagesEtude Du Phénomène D'encrassement D'un Échangeur de Chaleur À BlocsYousra El MeriniPas encore d'évaluation
- Ben Hamou & Othman32: Réalisé Par: Etablissement: Option: Encadré Par: Période de Stage: Lieu de StageDocument41 pagesBen Hamou & Othman32: Réalisé Par: Etablissement: Option: Encadré Par: Période de Stage: Lieu de Stagelopir120Pas encore d'évaluation
- PRSTDocument56 pagesPRSTUYYPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage - OCP - Amsaguine Fatima EzzahraDocument37 pagesRapport de Stage - OCP - Amsaguine Fatima EzzahraYassine El HadakPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Ocp - CompressDocument34 pagesRapport de Stage Ocp - CompressGhita BouzoubaaPas encore d'évaluation
- Tiznit Ocp 2Document42 pagesTiznit Ocp 2NeoXana01Pas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Sanaa BouhlalDocument42 pagesRapport de Stage Sanaa BouhlalmojgfdPas encore d'évaluation
- Groupe Ocp S.A Pôle Mines Direction Phosboucraâ. Réalisé Par - Responsable de StageDocument34 pagesGroupe Ocp S.A Pôle Mines Direction Phosboucraâ. Réalisé Par - Responsable de StageMy WorkPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage (Momen Nawal)Document49 pagesRapport de Stage (Momen Nawal)Hamid AllaliPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument38 pagesIntroductionRawand MiadiPas encore d'évaluation
- Moussaoui OCP COZDocument46 pagesMoussaoui OCP COZhourialaaPas encore d'évaluation
- Rapport Stage OCPDocument50 pagesRapport Stage OCPFATIMAZAHRA BENABDELLAHPas encore d'évaluation
- R.stage (Naoumia Aymen)Document27 pagesR.stage (Naoumia Aymen)ImmamHadramyPas encore d'évaluation
- Réseau Que de PHOUSBOUCRAADocument42 pagesRéseau Que de PHOUSBOUCRAAradouane100% (3)
- Rapport El Mouaddine KaoutarDocument45 pagesRapport El Mouaddine KaoutarAmine OuafiPas encore d'évaluation
- Rachid Rapport PhoDocument22 pagesRachid Rapport PhoAbderrahim BelmJouJPas encore d'évaluation
- Rapport OcpDocument42 pagesRapport OcpFatine Essakhi100% (1)
- Oc P RDocument44 pagesOc P Rayoub0% (1)
- Rapport ElkortobiDocument33 pagesRapport ElkortobiSaid ElkhouPas encore d'évaluation
- Rapport Bouafoud OtmaneDocument49 pagesRapport Bouafoud OtmaneSaad GhoummidPas encore d'évaluation
- Raport de StageDocument47 pagesRaport de StageIMAPas encore d'évaluation
- Pfe Oco SafiDocument103 pagesPfe Oco SafiZakaria Regragui100% (1)
- Rapport de Stage FinaleDocument67 pagesRapport de Stage FinaleElMostafa Elboudali100% (1)
- Rapport Stage Ocp 9Document49 pagesRapport Stage Ocp 9Le ModestePas encore d'évaluation
- Rapport FinalDocument71 pagesRapport FinalAbderrahim BelmJouJPas encore d'évaluation
- Les Phosphates de Khouribga - KEMMOUNE Zineb - 3179Document51 pagesLes Phosphates de Khouribga - KEMMOUNE Zineb - 3179yassinoPas encore d'évaluation
- Minimisation Des Pertes en P O Dans Les Rejets Liquides: Mémoire de Projet de Fin D'etudesDocument55 pagesMinimisation Des Pertes en P O Dans Les Rejets Liquides: Mémoire de Projet de Fin D'etudesAnas Kella BennaniPas encore d'évaluation
- Laaniber Elkrouni 2016 ConvertiDocument71 pagesLaaniber Elkrouni 2016 ConvertiAmine Abouelouafa100% (1)
- Rapport de Stage IlhamDocument29 pagesRapport de Stage IlhamYassine El HadakPas encore d'évaluation
- RAPPORTDESTAGEGESTORDocument45 pagesRAPPORTDESTAGEGESTORAzeddine Bennehari50% (2)
- Rapport de Stage OcpDocument18 pagesRapport de Stage OcpZouhire Ben Harbit AlamiPas encore d'évaluation
- Finance offshore et paradis fiscaux: Légal ou illégal?D'EverandFinance offshore et paradis fiscaux: Légal ou illégal?Pas encore d'évaluation
- BancassuranceDocument23 pagesBancassuranceOussama Salih75% (4)
- Rapport Du Stage Smb2Document37 pagesRapport Du Stage Smb2Anwar FalakiPas encore d'évaluation
- Groupe N°09 - Gestion de La LogistiqueDocument16 pagesGroupe N°09 - Gestion de La LogistiqueOverDoc100% (2)
- Tableau de Bord Controle GestionDocument53 pagesTableau de Bord Controle GestionmochakissPas encore d'évaluation
- Gestion de Stock ExposéDocument36 pagesGestion de Stock ExposéOussama Salih83% (18)
- Memoir D'emballageDocument42 pagesMemoir D'emballageSonny Reglisse67% (3)
- La Mise en Place Du Tableau de Bord Au Sein de La Société IngelecDocument55 pagesLa Mise en Place Du Tableau de Bord Au Sein de La Société IngelecBelbayane MajdaPas encore d'évaluation
- Fiscalite Secteur TouristiqueDocument38 pagesFiscalite Secteur TouristiquemochakissPas encore d'évaluation
- Rapport D eDocument24 pagesRapport D emochakissPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 01-03-2011 Au 31-0-32011 (2003)Document55 pagesRapport de Stage 01-03-2011 Au 31-0-32011 (2003)mochakiss100% (1)
- Rapport de Adil SoudeurDocument7 pagesRapport de Adil SoudeurmochakissPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument28 pagesRapport de Stagemochakiss100% (1)
- Rapport de StageDocument17 pagesRapport de StagemochakissPas encore d'évaluation
- RapportDocument10 pagesRapportmochakissPas encore d'évaluation
- RapportDocument37 pagesRapportmochakiss100% (1)
- Rapport de Stage OcpDocument18 pagesRapport de Stage Ocpmochakiss85% (20)
- Rapport de Stage Koudri El-MehdiDocument28 pagesRapport de Stage Koudri El-Mehdimochakiss67% (6)
- Rapport Final Complet. 3versions SanaaDocument122 pagesRapport Final Complet. 3versions Sanaamochakiss100% (2)
- Rapport de Stage 01-03-2011 Au 31-0-32011 (2003)Document55 pagesRapport de Stage 01-03-2011 Au 31-0-32011 (2003)mochakiss100% (1)
- Rapport Final Complet. 3versions SanaaDocument122 pagesRapport Final Complet. 3versions Sanaamochakiss100% (2)
- Rapport de Stage NASSIK RadouaneDocument17 pagesRapport de Stage NASSIK RadouanemochakissPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 2002 2003 Cma CGMDocument25 pagesRapport de Stage 2002 2003 Cma CGMmochakissPas encore d'évaluation
- Rapport de Adil SoudeurDocument7 pagesRapport de Adil SoudeurmochakissPas encore d'évaluation
- 1-Système FerroviaireDocument82 pages1-Système FerroviaireSara MarouchePas encore d'évaluation
- Abies Bornmuelleriana Mattf. Syn. Abies Equi-Trojani (Asch. & Sint. Ex Boiss.) Mattf. Sapin de Bornmüller, Sapin de La Mer NoireDocument6 pagesAbies Bornmuelleriana Mattf. Syn. Abies Equi-Trojani (Asch. & Sint. Ex Boiss.) Mattf. Sapin de Bornmüller, Sapin de La Mer NoireIsembockPas encore d'évaluation
- Cavil LotDocument70 pagesCavil LotDjihane BoussoufPas encore d'évaluation
- Politique de La ConcurenceDocument3 pagesPolitique de La ConcurenceJames Zoa zibiPas encore d'évaluation
- Fiche Synthétique Action Éducative ESEFODocument7 pagesFiche Synthétique Action Éducative ESEFOHICHAM LABRAHMIPas encore d'évaluation
- Presentation Du Barrage Beni Azimane 2024Document30 pagesPresentation Du Barrage Beni Azimane 2024hamza.bouramadanPas encore d'évaluation
- Bruit de L'environment PDFDocument69 pagesBruit de L'environment PDFAbderrahmaneAdanePas encore d'évaluation
- Word Débutant ValideDocument69 pagesWord Débutant ValidekimoudonnyPas encore d'évaluation
- Objectif Niveau B1 PDFDocument5 pagesObjectif Niveau B1 PDFKatze CzajkwoskiPas encore d'évaluation
- Comparateur Logique (Arabe)Document2 pagesComparateur Logique (Arabe)sliPas encore d'évaluation
- ZIN Brochure-Duplexfr 02 PDFDocument8 pagesZIN Brochure-Duplexfr 02 PDFMohammed MAAROUFPas encore d'évaluation
- UM Guide Cliclclac 1 FrancesDocument27 pagesUM Guide Cliclclac 1 FrancesSara Fernandez100% (1)
- Bas-Fonds Et Riziculture en AfriqueDocument33 pagesBas-Fonds Et Riziculture en AfriqueMayé SYLLAPas encore d'évaluation
- DownloadfileDocument3 pagesDownloadfilenkolaaxelPas encore d'évaluation
- N°2 Maître Puntila Et Son Valet Matti Bacfrancaisldh2016Document1 pageN°2 Maître Puntila Et Son Valet Matti Bacfrancaisldh2016Alexandre MandinaPas encore d'évaluation
- Fiche Toolbox 0Document25 pagesFiche Toolbox 0ouaouich saidPas encore d'évaluation
- +programme Santé USAID SENEGAL Composante SMNI/PF PaludismeDocument31 pages+programme Santé USAID SENEGAL Composante SMNI/PF Paludismetotalweb2Pas encore d'évaluation
- Ham PH MétreDocument12 pagesHam PH Métreولي الدين حموPas encore d'évaluation
- Étapes de La Recherche ScientifiqueDocument18 pagesÉtapes de La Recherche ScientifiqueJoe DaltonPas encore d'évaluation
- 15 Villes Et TerritoiresDocument5 pages15 Villes Et TerritoirestaharPas encore d'évaluation
- VOLET ADMISSION Passat 3CDocument1 pageVOLET ADMISSION Passat 3CMimid SbihiPas encore d'évaluation
- These Physique QuantiqueDocument16 pagesThese Physique QuantiqueSakina LaidiPas encore d'évaluation
- Nouveau Présentation Microsoft PowerPointDocument71 pagesNouveau Présentation Microsoft PowerPointMostafa RassamyPas encore d'évaluation
- Kyocera Ds Taskalfa 2554ciDocument2 pagesKyocera Ds Taskalfa 2554ciJessy VINDEXPas encore d'évaluation
- Benaissa1999 PDFDocument10 pagesBenaissa1999 PDFAbdelhak GuettiPas encore d'évaluation
- DTU 23.5 - Planchers À Poutrelles en Béton - P2 - Mai 2019Document9 pagesDTU 23.5 - Planchers À Poutrelles en Béton - P2 - Mai 2019sautier_thomasPas encore d'évaluation
- Catalogue Cariboni-Lite 2009Document326 pagesCatalogue Cariboni-Lite 2009ABELWALIDPas encore d'évaluation
- Activité 1 La Stratégie MarketingDocument2 pagesActivité 1 La Stratégie MarketingAyoub SadikiPas encore d'évaluation
- Bonne Gouvernance Au Niveau Local TunisieDocument56 pagesBonne Gouvernance Au Niveau Local TunisieHakim Ben BelgacemPas encore d'évaluation