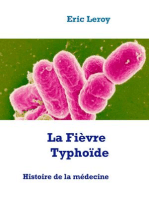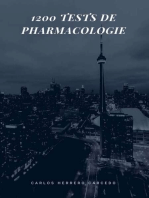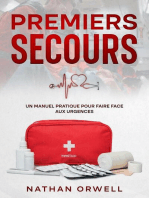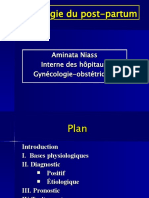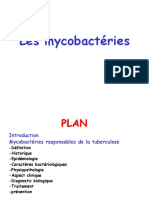Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
51 Bilharzioses
51 Bilharzioses
Transféré par
Pape FayeTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
51 Bilharzioses
51 Bilharzioses
Transféré par
Pape FayeDroits d'auteur :
Formats disponibles
51- BILHARZIOSES
I- INTRODUCTION
I.1- Définition:
Anthropozoonoses parasitaires dues à des trématodes hématophages du genre
Schistosoma, transmises à l’homme par voie transcutanée par l’intermédiaire des
mollusques d’eau douce
5 espèces sont pathogènes pour l’homme
Schistosoma haematobium → bilharziose uro-génitale
Schistosoma mansoni → bilharziose intestinale et hépatosplénique
Schistosoma intercalatum → bilharziose rectale
Schistosoma japonicum et Schistosoma mekongi → bilharziose hépatosplénique
I.2- Intérêt
Affections fréquentes, 2ème endémie parasitaire après le paludisme
Gravité liée aux complications à long terme: séquelles urogénitales et hépatospléniques
Socio-économique: affections liées à l’eau, favorisée par les projets hydro-agricoles
(barrages et irrigation)
Thérapeutique: problème de chimiorésistance au praziquantel, programmes de lutte
II- SIGNES
II.1- TDD: bilharziose vésicale à Schistosoma haematobium
II.1.1- Phase initiale ou phase de pénétration cutanée ou primo-infection
Dermatite cercarienne: quelques macules érythémateuses, prurigineuses, de 1 mm de
diamètre devenant papuleuse vers la 10ème heure
Souvent discrète voire inapparente
Apparait 2 heures après le bain infestant et dure 1 à 2 jours
II.1.2- Phase d’invasion ou toxémique ou de dissémination larvaire
Elle survient au bout de 45 jours à 3 mois après le bain
Clinique:
Etat infectieux avec fièvre (fièvre de Safari), sueurs et céphalées
Phénomènes allergiques: arthralgies, myalgies et urticaire
Hépatosplénomégalie parfois
Biologie:
La recherche d’œufs dans les urines est négative
MEDECINE INTERNAT IBRAHIMA DIALLO
NFS: hyperleucocytose avec éosinophilie à 80%
II.1.3- Phase d’état ou phase de focalisation viscérale
Clinique:
Dysurie avec pollakiurie précoce, diurne et nocturne
Douleurs sous pubiennes exacerbées par la miction obligeant le patient à se
courber en deux et donnant l’impression d’urines chaudes
Hématurie constante mais capricieuse typiquement terminale, d’abondance
variable, parfois provoquée par l’effort physique
Paraclinique
Biologie
o NFS: hyperéosinophilie à 40-50%
o Compte d’Addis: hématurie (ou BU: hématurie, protéinurie, leucocyturie)
Parasitologie
o Directe: met en évidence des œufs de S. haematobium dans les urines ou
biopsie rectale
o Indirecte: recherche d’antigènes et d’anticorps: IFI, HA
Imagerie médicale
o ASP: calcifications vésicales épousant le contour de la vessie ou donnant
l’aspect de « vessie porcelaine »
o Echographie abdomino-pelvienne: supplante la cystoscopie, montre
Épaississement et irrégularités de la paroi vésicale
Les bilharziomes
Retentissement sur le haut appareil urinaire
o Cystoscopie: apprécie les 3 stades évolutifs de la bilharziose vésicale:
Primaire (I): semis de grains de sucre de semoule fait de fines
granulations réfringentes
Secondaires (II): grains d’acnés ou nodules ± ulcérés
Tertiaire (III): tumeur framboisée ou bilharziome
o Tomodensitométrie, UIV: retentissement sur le haut appareil urinaire
II.1.4- Evolution
II.1.4.1- Eléments de surveillance
Cliniques: hématurie, dysurie, autres signes
Paracliniques: échographie, parasitologie
II.1.4.2- Modalités évolutives
En l’absence de traitement ou si traitement tardif
L’évolution spontanée vers la guérison est possible
Cependant l’évolution peut se faire vers la chronicité au fur et à mesure des
réinfestations massives et répétées, exposant à des complications:
MEDECINE INTERNAT IBRAHIMA DIALLO
o Cystite suppurée, pyélonéphrite
o Néphrite interstitielle d’origine bactérienne
o Lithiase, rétrécissement urétral, urétérohydronéphrose, insuffisance rénale
o Cancérisation de la vessie: épithélioma épidermoïde spino-cellulaire
Sous traitement précoce: l’évolution se fait vers la guérison sans séquelle
II.2- Formes cliniques
II.2.1- Formes étiologiques
II.2.1.1- Autres bilharzioses uro-génitales à Schistosoma haematobium (Sh)
Urétérale: généralement latente; UIV montre
Sténose urétérale unique ou multiples, dilatation
Urétéro-hydronéphrose secondaire à une sténose
Rénale: hydronéphrose en amont de l’obstacle et néphrite interstitielle par infection →
IR terminale
Urétrale: écoulements riches en œufs, urétrorragies, rétrécissement urétral, fistules
périnéales
Génitale
Chez l’homme: épididymite chronique indolente, fistulisation fréquente,
hémospermie
Chez la femme: vaginite ou cervicite chronique, annexite responsables de stérilité,
grossesses ectopiques, d’accouchements prématurés
Autres localisations: rectale, appendiculaire, péritonéale (tuberculose), hépatique,
splénique (splénomégalie chronique)
II.2.1.2- Bilharziose intestinale à S. mansoni (Sm)
Phase de pénétration et phase d’invasion (fièvre de Safari) bruyantes
Phase d’état 3 mois après le bain: diarrhée faite de selles liquides ou dysentériques
Paraclinique:
Recherche d’œufs dans les selles
Rectosigmoïdoscopie: granulations (images de pastille ou en taches de bougies),
polypes (biopsies)
Evolution:
Généralement favorable même sans traitement en quelques mois
Des complications peuvent survenir:
o Etat sub-occlusif, hémorragies
o Risque majeur: atteinte hépatique → HSMG avec HTP
o Atteintes cardio-pulmonaires et du système nerveux: par embolisation des
œufs
II.2.1.3- Bilharziose rectale à S. intercalatum (Si)
MEDECINE INTERNAT IBRAHIMA DIALLO
Les deux premières phases sont en général silencieuses
Phase d’état: Rectite avec diarrhée glairo-sanglante, ténesme et prolapsus
II.2.1.4- Bilharziose hépatosplénique à S. japonicum (Sj) et mekongi (Sk)
Phase de pénétration et phase toxémique bruyantes (syndrome de Katayama)
Phase d’état:
Forme grave: dominée par une atteinte hépato-splénique redoutable; AEG rapide
avec fièvre, amaigrissement et anémie: le pronostic est réservé, la survie ne
dépasse guère quelques années
Formes bénignes: sans hépatomégalie, pronostic est meilleur sous traitement
II.2.2- Formes topographiques: autres localisations
Cardio-pulmonaire surtout fréquente avec Sm, Sj et Sk
Nerveuses: exceptionnel tableau de compression médullaire
Cutanées: éruptions papulo-nodulaires (région péri-ombilicale, enfants surtout)
Ano-génitale: tumeurs bilharziennes de l’anus et du col
II.2.3- Formes associées
Bilharziose + salmonellose: les vers adultes favorisent le portage chronique des
salmonelles
Bilharziose + autres parasitoses: paludismes, helminthiases…
III- DIAGNOSTIC
III.1- Diagnostic positif
Arguments épidémiologiques:
Notion de séjours en zone d’endémie
Baignade dans les eaux douces
Arguments cliniques: devant l’existence de signes évocateurs
Arguments paracliniques
Présomptifs
o Hyperéosinophilie surtout à la phase d’invasion
o Echographie: fibrose péri-portale, dilatation des voies urinaires supérieures,
calcifications
o Radiographie sans préparation: calcifications vésicales
Certitude: diagnostic parasitologique
o Diagnostic direct: mise en évidence du parasite
Examen direct entre lame et lamelle: urines, selles
Biopsie: étude histologique montre des œufs centrés par un granulome
MEDECINE INTERNAT IBRAHIMA DIALLO
o Diagnostic indirect: réactions immunologiques: réaction péricercarienne de
Vogel et Minning, réaction de fixation de complément, hémagglutination
passive, IFI, ELISA, recherche d’antigènes solubles…
III.2- Diagnostic différentiel
Phase de pénétration: eczéma, gale, autres réactions allergiques (alimentaire…)
Phase d’invasion: accès palustre, allergie médicamenteuse, autres causes de
bronchopathies dyspnéisantes
Phase d’état:
Autres causes d’hématurie: lithiasique, tumorale, tuberculeuse
Autres causes de dysenterie: amibiase, shigellose, tuberculose intestinale, tumeur
rectale bénigne ou maligne, RCH, Crohn
Autres causes d’HTP: cancer du foie, cirrhose hépatique
III.3- Diagnostic étiologique
Agents pathogènes:
Famille: Schistosomatidae
Genre: Schistosoma
Complexes d’espèces: 5 pathogènes pour l’homme
Réservoir de parasites
S. haematobium: parasite strictement humain
Autres espèces sont des zoonoses
o S. mansoni infecte différents mammifères (primates, bétail, rongeurs)
o S. mekongi: chiens, porcs
o S. japonicum: buffles
Transmission: facteurs favorisants
Les eaux: contamination due à l’absence d’hygiène fécale et urinaire, contact eaux
mollusques hommes: pêcheurs, riziculteurs, femmes, enfants, adolescents
Création de point d’eau: mise en valeur des terres (construction de barrages,
développement de l’irrigation permanente)
Terrain: groupes à risque: enfants d’âge scolaire, les femmes (travaux domestiques), les
travailleurs agricoles
IV- TRAITEMENT
IV.1- Traitement curatif
IV.1.1- Buts
Eliminer le parasite de l’organisme malade
MEDECINE INTERNAT IBRAHIMA DIALLO
Eviter ou traiter les complications
IV.1.2- Moyens
Moyens étiologiques: Antibilharziens actuels
Praziquantel (Biltricide®) +++ comprimés sécables de 600 mg
o Actif sur les vers adultes de toutes les espèces
o Posologie: 40-60 mg/kg en 1 à 2 prises orales
o Effets secondaires: céphalées, vertiges, douleurs abdominales
Oxamniquine (Vansil®, Mansil®): actif sur Sm: 50 mg/kg en prise unique
Métronifonate (Bilarcil®): actif sur Sh: 2 PO de 7,5-10 mg/kg à 15 jours
d’intervalle
Dérivés de l’artémisinine: artémether et Artésunate: actif sur les schistosomules de
7 à 21 jours
Adjuvants
Médicaux: antihistaminiques, antipyrétiques, corticoïdes, antibiotiques,
anticonvulsivants, diurétiques, béta-bloquants, sang et dérivés
Instrumentaux: traitement endoscopique: ligature, sclérothérapie,
électrocoagulation
Chirurgicaux: chirurgie plastique, anastomose porto-cave, chirurgie d’exérèse
IV.1.3- Indications
Bilharziose à S. haematobium
Praziquantel + contrôle des urines dans 3 mois
Si échec: association Praziquantel-Artésunate
Bilharziose à S. mansoni: Oxamniquine ou Praziquantel
Bilharziose à S. japonicum et mekongi: Praziquantel
Formes compliquées: Praziquantel + adjuvants
NB: le contrôle de l’efficacité du traitement individuel (élimination d’œufs) doit
s’effectuer à 3 mois, 6 mois et 12 mois après le traitement
IV.2- Traitement préventif
Buts: Interrompre la chaine épidémiologique
Prophylaxie individuelle
Hygiène fécale et urinaire: éviter de se baigner dans eaux stagnantes, conseiller le
port de bottes et gants dans les rizières
Des essais vaccinaux contre la bilharziose urinaire sont en cours: vaccin Bilhvax
en phase 3
Prophylaxie générale
Lutte contre les mollusques
o Chimiques: dérivés du cuivre, de l’étain, du plomb… (très onéreux et
toxiques pour les poissons)
MEDECINE INTERNAT IBRAHIMA DIALLO
o Biologiques: assèchement périodiques des canaux d’irrigation et des rizières,
destruction des végétaux
Chimiothérapie de masse: avec Oxamniquine et praziquantel
IEC
V- CONCLUSION
Bilharzioses: parasitoses tropicales cosmopolites, posant un problème majeur de santé
Elles sont faciles à diagnostiquer
Le retard au traitement est responsable de morbidité grave pouvant engager le PV
En attendant la venue d’un vaccin, la meilleure prévention est le traitement de masse
dans les zones d’endémie et l’IEC
Bibliographie
Cours DCEM2 Infectieuse: Pr SA. Diop NYAFOUNA: Schistosomiases 2010
Cours DCEM4 Thérapeutique: Dr NM DIA Badiane: Traitement bilharziose 2012
Cours personnels d’internes: Dr D. A. DIOP, Dr F.B SALL/Dr H.DEME
MEDECINE INTERNAT IBRAHIMA DIALLO
Vous aimerez peut-être aussi
- Microbiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainD'EverandMicrobiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cat Devant Un PriapismeDocument31 pagesCat Devant Un PriapismeLubin Miyaba100% (1)
- Algies Pelviennes ChroniquesDocument45 pagesAlgies Pelviennes ChroniquesSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Soins Infirmiers Dans Les Maladies Infectieuses Et Parasitaires - CopierDocument10 pagesSoins Infirmiers Dans Les Maladies Infectieuses Et Parasitaires - CopierOsman Aden89% (9)
- 53-Amibiase HepatiqueDocument5 pages53-Amibiase HepatiqueSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- 33-Glomerulonephrites AiguesDocument6 pages33-Glomerulonephrites AiguesSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- 52-Dysenterie AmibienneDocument6 pages52-Dysenterie AmibienneSerigne Sohibou Gaye75% (4)
- CAT Sur Vomissements de L'enfantDocument28 pagesCAT Sur Vomissements de L'enfantSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Stenose Hypertrophique Du PyloreDocument41 pagesStenose Hypertrophique Du PyloreSidi MansourPas encore d'évaluation
- Plan de Discussion Nephro-1Document11 pagesPlan de Discussion Nephro-1de100% (4)
- Fievre Typhoïde de L'enfantDocument46 pagesFievre Typhoïde de L'enfantIdiAmadou100% (1)
- Abcès Sous-Phrénique DEMSDocument14 pagesAbcès Sous-Phrénique DEMShamza benPas encore d'évaluation
- Bilharzioses L3 DjohanDocument48 pagesBilharzioses L3 DjohanSahouin Claude MedardPas encore d'évaluation
- Anémies Du Nouveau-NéDocument6 pagesAnémies Du Nouveau-NézerfaouiPas encore d'évaluation
- Infections Des MéningesDocument60 pagesInfections Des MéningesChrist michel Essimba100% (1)
- SPLENOMEGALIES Ndiassé Thiapato Dembélé AminataDocument9 pagesSPLENOMEGALIES Ndiassé Thiapato Dembélé AminataSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Palu GravDocument47 pagesPalu GravSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- 31 MycetomesDocument6 pages31 MycetomesSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Les Purpuras de L - EnfantDocument52 pagesLes Purpuras de L - EnfantHatem NasriPas encore d'évaluation
- Conduite À Tenir Devant Un Abdomen AiguDocument80 pagesConduite À Tenir Devant Un Abdomen AiguMina Dahel100% (1)
- Serie de Cas D'ictere Chez Les EnfantsDocument132 pagesSerie de Cas D'ictere Chez Les Enfantsamédée junior wawaPas encore d'évaluation
- 4 - Choc Septique 1Document32 pages4 - Choc Septique 1abdo217Pas encore d'évaluation
- 26-Grossesse Extra-UterineDocument7 pages26-Grossesse Extra-UterineSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- 11-Osteomyelite AigueDocument7 pages11-Osteomyelite AigueAbdou BorsaliPas encore d'évaluation
- Grossesse Extra UtérineDocument1 pageGrossesse Extra UtérineSabrina HammadiPas encore d'évaluation
- Appendicite Aigue Et Ses ComplicationsDocument3 pagesAppendicite Aigue Et Ses ComplicationsbrahimPas encore d'évaluation
- Solutés de RemplissageDocument20 pagesSolutés de RemplissageDIS MUSTAPHAPas encore d'évaluation
- PALU GRAVE KajDocument55 pagesPALU GRAVE KajOusmane Sambou0% (1)
- Appendicite AiguëDocument22 pagesAppendicite AiguëBMA-medecine100% (6)
- TRANSFUSION SANGUINE Et ACCIDENTDocument13 pagesTRANSFUSION SANGUINE Et ACCIDENTAna ManaPas encore d'évaluation
- Sténose Hypertrophique Du PyloreDocument30 pagesSténose Hypertrophique Du Pyloremac_eden100% (1)
- PaludismeDocument3 pagesPaludismeAlaa SobhiPas encore d'évaluation
- Complications Infectieuses Du Post-PartumDocument10 pagesComplications Infectieuses Du Post-PartumYi Fong100% (1)
- 221 - Grossesse Extra-UtérineDocument8 pages221 - Grossesse Extra-UtérineMahefa Serge RakotozafyPas encore d'évaluation
- Staphylococcie Pleuropulmonaire de L'enfantDocument36 pagesStaphylococcie Pleuropulmonaire de L'enfantAwana DimitriPas encore d'évaluation
- DéshydratationDocument14 pagesDéshydratationmessi000013Pas encore d'évaluation
- Infections Neonatales em - 2Document17 pagesInfections Neonatales em - 2IdiAmadouPas encore d'évaluation
- Néphropathies Glomérulaires: DR Jebali Hela Service de Néphrologie-La RabtaDocument33 pagesNéphropathies Glomérulaires: DR Jebali Hela Service de Néphrologie-La Rabtahela bergaouiPas encore d'évaluation
- 20-Ulceres Gastro-DuodenauxDocument7 pages20-Ulceres Gastro-DuodenauxSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- Kyste Hydatique Du FoieDocument42 pagesKyste Hydatique Du FoieKhallil OuahlimaPas encore d'évaluation
- 4 - Ictère FébrileDocument50 pages4 - Ictère FébrileSara SouPas encore d'évaluation
- 30-Complications Des AvortementsDocument4 pages30-Complications Des AvortementsSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Arthrite Juvénile IdiopathiqueDocument80 pagesArthrite Juvénile Idiopathiqueblk fatima100% (1)
- Deshydratation Aigue de L'enfantDocument21 pagesDeshydratation Aigue de L'enfantanis anisPas encore d'évaluation
- 13) Ischemie Aigue Des MembresDocument10 pages13) Ischemie Aigue Des MembresDany AbdouPas encore d'évaluation
- 1-Brulures Etendues RecentesDocument6 pages1-Brulures Etendues RecentesSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Diagnostic Du DiabèteDocument55 pagesDiagnostic Du DiabèteJolie Coeur SakePas encore d'évaluation
- TD CAT Devant Une LeucorrhéeDocument20 pagesTD CAT Devant Une LeucorrhéeRoza SaraPas encore d'évaluation
- Conduite À Tenir Devant Une Fièvre AigueDocument22 pagesConduite À Tenir Devant Une Fièvre AigueSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- 57 Peritonite Aigue 01 PDFDocument24 pages57 Peritonite Aigue 01 PDFRim Ben SalemPas encore d'évaluation
- 34-Pseudokyste Du PancrèasDocument17 pages34-Pseudokyste Du PancrèasChemsou MedPas encore d'évaluation
- Ictères InfectieuxDocument36 pagesIctères InfectieuxYacine FerniniPas encore d'évaluation
- Appendicite AigueDocument22 pagesAppendicite AigueFlorina PopaPas encore d'évaluation
- EMBRYOFOETOPATHIESDocument14 pagesEMBRYOFOETOPATHIESSamira Moussa100% (2)
- Fievre TyphoideDocument3 pagesFievre TyphoideBouzi FáyçålPas encore d'évaluation
- Anesthésie RéanimationDocument6 pagesAnesthésie RéanimationSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- Cat Devant Une Diarrhée Glairo-SanglanteDocument28 pagesCat Devant Une Diarrhée Glairo-SanglanteRawaa RawaaPas encore d'évaluation
- Premiers Secours: un manuel pratique pour faire face aux urgencesD'EverandPremiers Secours: un manuel pratique pour faire face aux urgencesPas encore d'évaluation
- Mélanges d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. ChirurgieD'EverandMélanges d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. ChirurgiePas encore d'évaluation
- Mon livre sur le diabète et ses complications: Expérience et spécificité au service d'un artD'EverandMon livre sur le diabète et ses complications: Expérience et spécificité au service d'un artPas encore d'évaluation
- Asthme DII 2016 N - 2Document72 pagesAsthme DII 2016 N - 2Serigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Collapsus Et Choc CVDocument59 pagesCollapsus Et Choc CVSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- Troubles Fonctionnels IntestinauxDocument54 pagesTroubles Fonctionnels IntestinauxSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Asthme Aigu Grave 2017 PDFDocument46 pagesAsthme Aigu Grave 2017 PDFSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- CAT Envenimation Serpent PDFDocument39 pagesCAT Envenimation Serpent PDFSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Appendicite Aigue 2016-2017Document6 pagesAppendicite Aigue 2016-2017Serigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Anesthésie RéanimationDocument6 pagesAnesthésie RéanimationSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- CAT Envenimation Serpent PDFDocument39 pagesCAT Envenimation Serpent PDFSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Urgence6an Prise en Charge Medicale Des Brulures-Graves PDFDocument103 pagesUrgence6an Prise en Charge Medicale Des Brulures-Graves PDFSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Examen Clinique Du Nné - Soins en Salle de NceDocument40 pagesExamen Clinique Du Nné - Soins en Salle de NceSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Appendicite Aiguë - CopieDocument30 pagesAppendicite Aiguë - CopieSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- AnémiesDocument47 pagesAnémiesSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Les Thrombophlebites 2017Document63 pagesLes Thrombophlebites 2017Serigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Physiopath3an-Acidocetose Diabetique PDFDocument20 pagesPhysiopath3an-Acidocetose Diabetique PDFSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Semio3an-Appendicite Aigue PDFDocument3 pagesSemio3an-Appendicite Aigue PDFSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- Examen Clinique en Gynu00e9cologieDocument10 pagesExamen Clinique en Gynu00e9cologieSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- Pec PaluDocument56 pagesPec PaluSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- CAT HTA Chez L'enfantDocument48 pagesCAT HTA Chez L'enfantSerigne Sohibou Gaye0% (1)
- ExposépartoDocument21 pagesExposépartoSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Solutes de RemplissageDocument44 pagesSolutes de RemplissageSerigne Sohibou Gaye67% (3)
- DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DR CHTIOUI FinalDocument61 pagesDEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DR CHTIOUI FinalSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Conduite À Tenir Devant Une Fièvre AigueDocument22 pagesConduite À Tenir Devant Une Fièvre AigueSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- CAT Crise DrépanocytaireDocument21 pagesCAT Crise DrépanocytaireSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Deshydratation Dcem3Document37 pagesDeshydratation Dcem3Serigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Coma de L'enfantDocument64 pagesComa de L'enfantSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- AnémieDocument19 pagesAnémieSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- CAT Convulsions YKDocument38 pagesCAT Convulsions YKSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Prévention de L'hémorragie Du Post-Partum Par La PriseDocument31 pagesPrévention de L'hémorragie Du Post-Partum Par La PriseSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Thrombose Veineuse Profonde2Document67 pagesThrombose Veineuse Profonde2Serigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- 4 Coop MSPS Unicef Sécurité Sanitaire Des ESSP Formation 2022 Hygiène Des MainsDocument40 pages4 Coop MSPS Unicef Sécurité Sanitaire Des ESSP Formation 2022 Hygiène Des MainsMoon CefPas encore d'évaluation
- Fiche Synthetique VHC 2023 09 21Document7 pagesFiche Synthetique VHC 2023 09 21Archange N'ZAOUPas encore d'évaluation
- Diagnostic Biologique Des Fièvres Typhoïde Et ParatyphoïdesDocument4 pagesDiagnostic Biologique Des Fièvres Typhoïde Et Paratyphoïdessh7wdg7gxbPas encore d'évaluation
- Prev Contre InfecDocument471 pagesPrev Contre InfecPicincu Irina GeorgianaPas encore d'évaluation
- HEMOCULTUREtsl 3Document17 pagesHEMOCULTUREtsl 3J-Paul DétoPas encore d'évaluation
- Proposition Hygiène IDE-1Document3 pagesProposition Hygiène IDE-1aurelien choupoPas encore d'évaluation
- Poe Covid 19 FRDocument41 pagesPoe Covid 19 FRLahouifi HosniPas encore d'évaluation
- Fièvre Aiguë Chez L'enfantDocument18 pagesFièvre Aiguë Chez L'enfantZahoud MPas encore d'évaluation
- Le 17 Octobre 1961Document5 pagesLe 17 Octobre 1961Nouvelle ViePas encore d'évaluation
- spf00004256Document42 pagesspf00004256CaillieretPas encore d'évaluation
- Prise en Charge À Chaque Séance Du Patient en Hémodialyse ChroniqueDocument2 pagesPrise en Charge À Chaque Séance Du Patient en Hémodialyse Chroniquemechergui100% (1)
- Ulcère Génitaux2Document37 pagesUlcère Génitaux2Natacha Vida MartinsPas encore d'évaluation
- ParasitologieDocument31 pagesParasitologiealmnaouarPas encore d'évaluation
- Maladies: Renseignez-Vous Davantage Au Sujet D'Une MaladieDocument3 pagesMaladies: Renseignez-Vous Davantage Au Sujet D'Une MaladieHuguette LamegniPas encore d'évaluation
- MycobactériesDocument41 pagesMycobactériesBRAHIM MOUFARRAJ100% (1)
- Resultat Web Bio24Document2 pagesResultat Web Bio24fatou corka kanePas encore d'évaluation
- Session Formation Formateurs ObservateursDocument116 pagesSession Formation Formateurs ObservateursVăru Igor bitîiPas encore d'évaluation
- Memoire Nembot Lele Ronel WilfriedDocument93 pagesMemoire Nembot Lele Ronel WilfriedWilfried NembotPas encore d'évaluation
- 7 - Virus Hepatites 2024Document60 pages7 - Virus Hepatites 2024myrafandyPas encore d'évaluation
- Vaccination Contre L'hépatite BDocument14 pagesVaccination Contre L'hépatite BApavaloaie CristiPas encore d'évaluation
- Les Microbes Exercices SVT 3AC 1Document2 pagesLes Microbes Exercices SVT 3AC 1ilyas benadissaPas encore d'évaluation
- La Gastroentérite Gastro: Prévention Des Maladies TransmissiblesDocument2 pagesLa Gastroentérite Gastro: Prévention Des Maladies TransmissiblesgaelPas encore d'évaluation
- JJGGDocument2 pagesJJGGNehemie SawadogoPas encore d'évaluation
- MycobactériesDocument1 pageMycobactériesAKOURKSPas encore d'évaluation
- Correction BacterioDocument14 pagesCorrection BacterioGhislain AssogbaPas encore d'évaluation
- Fiche de Révision Brevet S.V.T.Document4 pagesFiche de Révision Brevet S.V.T.b0% (1)
- Laboratoire de Biologie Medicale DR N.Boudissa: BacteriologieDocument2 pagesLaboratoire de Biologie Medicale DR N.Boudissa: BacteriologieGhania FerganiPas encore d'évaluation
- SVTDocument3 pagesSVTcarlotagonztapPas encore d'évaluation
- Ram Mars 2023Document41 pagesRam Mars 2023imenehaddad93Pas encore d'évaluation