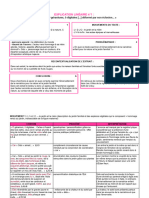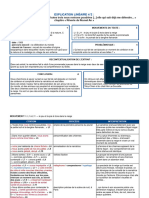Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Linéaire TEXTE 1 STMG Le Capitaine
Transféré par
lyblancCopyright
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Linéaire TEXTE 1 STMG Le Capitaine
Transféré par
lyblancDroits d'auteur :
COLETTE, Sido (1930)
Séquence : roman. Texte 1 : le capitaine
(p. 89 éd. A. Compagnon ou p.91 éd. Livre de poche « bac »)
Table des matières
Introduction ............................................................................................................................................... 1
Situation de l’extrait dans l’œuvre ........................................................................................................ 1
Brouillon : premiers relevés ...................................................................................................................... 1
Analyse linéaire ......................................................................................................................................... 3
1er mouvement (lignes 1 – 12) : tendre évocation du père .................................................................... 3
Installation progressive du portrait & poétisation du père ................................................................ 3
Evocation pathétique......................................................................................................................... 3
2e mouvement (l. 13-36) : remémoration élogieuse du mari et militaire............................................... 3
(l. 13-25) l’éloge du père .................................................................................................................. 3
(l. 26-36) : héroïsation du « capitaine » ............................................................................................ 3
Conclusion ................................................................................................................................................. 4
Bilan ...................................................................................................................................................... 4
Ouverture .............................................................................................................................................. 4
(Suite de l’intro)
Introduction
Situation de l’extrait dans l’œuvre
Le père est le chapitre intermédiaire entre la mère (« Sido ») et la fratrie (« les sauvages »)
Hommage rendu père mutilé de guerre : à la fois héroïsme du vétéran & la faiblesse de
l’amputé (handicap) => défi d’écriture
Portrait ambivalent, bancal (à l’image du père qui boite)
Brouillon : premiers relevés
Lecture ciblée de l’extrait : portrait élogieux ou pathétique du père ?
Gloire du père, héros Mélancolie ; humain
Éloge Hommage
Genêts jaunes pléonasme Amèrement adverbe forme longue (4 syllabes) =
intensifier la symbolique de la fleur aspect laborieux de son existence
fleur rustique, increvable, adaptative = rappel du adverbe revient (3 occurrences) = rumination du
père père qui ressasse son destin raté.
queue de paon : symbole de la prestance et de
l’orgueil
Cumul des sens visuel (« jaunes ») et du son Banni des éléments ; mutilé ; les amputés, étayé
« fredon » => portrait vivant des béquilles
4 participes passés passifs = affaiblissement du
père
Heureux : adjectif mélioratif Une demi-douzaine de points de suspension et de
très heureux : (hyperbole) : superlatif phrases laissées en suspens « Enfin... » « rêvait
amèrement... » = aposiopèse = malaise
Un homme … « mon allègre père nourrissait la tristesse
Mon père … propulsé en début de phrase profonde [...] » dissonance des contraires dans la
même phrase (antithèse)
avec un primat donné à la joie avec un mot de
niveau de langue plus soutenu (« allègre » =
« joyeux »)
Mon brillant, mon allègre père : adjectifs Spectre de la mort dans les redondances sonores :
mélioratifs « il meurt – il mûrit » effet de paronymie pour
gradation : 2 puis 3 syllabes (bril-lant, al-lè-gre) montrer que la mort est rentrée (par la blessure)
dans la vie du père et dans le texte
Gradation (dilatation) des groupes nominaux Mise en valeur du membre manquant qui est la
successifs : l’homme qui datait d’avant elle / le cause du traumatisme : la jambe arrive en fin de
Saint-Cyrien beau danseur/ le lieutenant solide phrase (effet de chute) : « … qu’il lui manquât,
comme un bois-debout coupée en haut de la
nombreuses périphrases = il suscite de cuisse, une jambe. »
nombreuses qualifications
Nombreuses références au domaine militaire : Tout l’héroïsme est rejeté dans l’antériorité du
Saint-Cyrien, grand chancelier de la Légion passé (tellement loin que ça en devient irréel) :
d’honneur, rosette, ruban sauver, chevaux = « avait connu », « avait pu courir » : plus-que-
Colette lui rend, en l’évoquant, sa carrière parfait
militaire.
Malgré l’accumulation des indices physiques Le jeu des paragraphes peine à installer
(« jambe », « cuisse », « amputé », « buste », « ce durablement la figure paternelle (le père est censé
mutilé ») => fil conducteur discret, de part et pourtant être l’objet de ce chapitre et servir de
d’autre, qui est spirituel et qui dure : « rêvait » base au portrait) ; cela prouve que Sido (qui ouvre
(imparfait duratif) des paragraphes « elle », ou les conclut) prend
beaucoup de place mais aussi que ce père a du mal
à exister dans sa vie comme dans le texte.
L’identité du père reste instable :
- « mon père »
- « mon brillant, mon allègre père »
- « le saint-Cyrien beau danseur, le
lieutenant solide … »
- « l’homme qui datait d’avant elle »
- « mon père »
- « homme », « humain »
Gradation-dégradation dans les substituts, les
périphrases qui désignent ce père :
Dimension affective (mon père) => héroïsme
militaire (« saint-cyrien, lieutenant) => catégorie
générale (homme)
Analyse linéaire
1er mouvement (lignes 1 – 12) : tendre évocation du père
Considérations rétrospectives nostalgiques de la narratrice
Installation progressive du portrait & poétisation du père
• Genêts jaunes pléonasme
Intensifier la symbolique de la fleur
Fleur rustique, increvable, adaptative = rappel du père
• Queue de paon : symbole de la prestance et de l’orgueil
• Cumul des sens visuel (« jaunes ») et du son « fredon » => portrait vivant
Evocation pathétique
• Amèrement adverbe forme longue (4 syllabes) = aspect laborieux de son existence.
L’adverbe revient (3 occurrences) = rumination du père qui ressasse son destin raté.
• Spectre de la mort dans les redondances sonores : « il meurt – il mûrit » effet de
paronymie pour montrer que la mort est rentrée (par la blessure) dans la vie du père et
dans le texte
• Une demi-douzaine de points de suspension et de phrases laissées en suspens « Enfin... »
« rêvait amèrement... » = aposiopèse = malaise
• « mon allègre père nourrissait la tristesse profonde [...] » dissonance des contraires dans
la même phrase (antithèse) pour traduire la difficulté à exister du Capitaine.
• Mise en valeur du membre manquant qui est la cause du traumatisme : la jambe arrive en
fin de phrase (effet de chute) : « … qu’il lui manquât, coupée en haut de la cuisse, une
jambe. »
2e mouvement (l. 13-36) : remémoration élogieuse du mari et militaire
Père vu dans les yeux de l’épouse aimante (qui fut la grande amoureuse du père) : regard aimant
et valorisant.
Le portrait du père est aussi un biais, pour Colette, pour revenir sur ce couple fascinant et attester
de l’amour que se sont portés les deux.
(l. 13-25) l’éloge du père
• Gradation (dilatation) des groupes nominaux successifs : l’homme qui datait d’avant elle
/ le Saint-Cyrien beau danseur/ le lieutenant solide comme un bois-debout
nombreuses périphrases = il suscite de nombreuses qualifications
• Nombreuses références au domaine militaire : Saint-Cyrien, grand chancelier de la
Légion d’honneur, rosette, ruban sauver, chevaux = Colette lui rend, en l’évoquant, sa
carrière militaire.
• Malgré l’accumulation des indices physiques (« jambe », « cuisse », « amputé »,
« buste », « ce mutilé ») => fil conducteur discret, de part et d’autre, qui est spirituel et
qui dure : « rêvait » (imparfait duratif) = surinvestissement de l’esprit qui compense les
défaillances du corps.
(l. 26-36) : héroïsation du « capitaine »
• Hommage rendu en évoquant la vie militaire du père et sa dignité d’homme de combat
Tout l’héroïsme est rejeté dans l’antériorité du passé (tellement loin que ça en devient irréel) :
« avait connu », « avait pu courir » : plus-que-parfait pour faire revivre, dans le texte, la grande
époque militaire du père.
• Extension de la figure du père : qui sort de sa qualité strictement familiale pour acquérir
une stature universelle
- « mon père »
- « mon brillant, mon allègre père »
- « le saint-Cyrien beau danseur, le lieutenant solide … »
- « l’homme qui datait d’avant elle »
- « mon père »
- « Homme », « humain »
On constate la gradation-dégradation dans les substituts, les périphrases qui désignent ce père :
C’est-à-dire que l’on passe de la dimension affective (mon père) => héroïsme militaire (« saint-
cyrien », « lieutenant ») => catégorie générale (homme).
Les trois phases du texte réhabilitent le père dans toutes ses dimensions, avec un élan graduel
qui lui rend peu à peu ce à quoi il tenait le plus (sa gloire militaire) = texte en forme d’hommage.
Conclusion
Bilan
Portrait doux-amer, nostalgique et aimant
A l’image de ce père, tout à la fois diminué (car amputé, dans la vraie vie) et grandi (par l’écriture)
Ouverture
Evocation du père (partagée en pathos et héroïsation, déjà) par un des modèles de COLETTE,
F.-René de CHATEAUBRIAND, Dans son autobiographie-somme, Les mémoires d’outre-tombe,
vol.1 :
Alors mon père donna la première marque du caractère décidé que je lui ai connu. Il
avait environ quinze ans : s'étant aperçu des inquiétudes de sa mère, il approcha du lit
où elle était couchée et lui dit : « Je ne veux plus être un fardeau pour vous. » Sur ce,
ma grand−mère se prit à pleurer (j'ai vingt fois entendu mon père raconter cette scène).
« René, » répondit-elle, « que veux−tu faire ? Laboure ton champ. − Il ne peut pas nous
nourrir ; laissez−moi partir. − Eh bien, » dit la mère, « va donc où Dieu veut que tu
ailles. » Elle embrassa l'enfant en sanglotant. Le soir même mon père quitta la ferme
maternelle, arriva à Dinan, où une de nos parentes lui donna une lettre de
recommandation pour un habitant de Saint−Malo. L'aventurier orphelin fut embarqué,
comme volontaire, sur une goélette armée, qui mit à la voile quelques jours après.
La petite république malouine soutenait seule alors sur la mer l'honneur du pavillon
français. La goélette rejoignit la flotte que le cardinal de Fleury envoyait au secours de
Stanislas, assiégé dans Dantzick par les Russes. Mon père mit pied à terre et se trouva
au mémorable combat que quinze cents Français, commandés par le brave Breton, de
Bréhan comte de Plélo, livrèrent le 29 mai 1734, à quarante mille Moscovites,
commandés par Munich. De Bréhan, diplomate, guerrier et poète, fut tué et mon père
blessé deux fois. Il revint en France et se rembarqua. Naufragé sur les côtes de l'Espagne
des voleurs l'attaquèrent et le dépouillèrent dans les Galices ; il prit passage à Bayonne
sur un vaisseau et surgit encore au toit paternel. Son courage et son esprit d'ordre
l'avaient fait connaître. Il passa aux Iles ; il s'enrichit dans la colonie et jeta les
fondements de la nouvelle fortune de sa famille.
Vous aimerez peut-être aussi
- Explication LinéaireDocument6 pagesExplication Linéairejohayna9545babilPas encore d'évaluation
- Colette - Étude TEXTE 3Document9 pagesColette - Étude TEXTE 3lyblanc100% (1)
- Extrait 1 Alternatif STMG Colette - Le CapitaineDocument1 pageExtrait 1 Alternatif STMG Colette - Le Capitainelyblanc100% (1)
- COLETTE Textes de La Séquence - Voie Générale - 2023-24Document5 pagesCOLETTE Textes de La Séquence - Voie Générale - 2023-24lyblancPas encore d'évaluation
- Transversale Sur ColetteDocument12 pagesTransversale Sur Colettelyblanc100% (1)
- Bajazet de Jean Racine (Analyse de l'œuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandBajazet de Jean Racine (Analyse de l'œuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Balzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude LinéaireDocument10 pagesBalzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude Linéairelyblanc100% (1)
- COLETTEDocument6 pagesCOLETTELahnaPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire ColetteDocument2 pagesAnalyse Linéaire ColetteDarknathBox100% (1)
- Fiche Texte 1Document4 pagesFiche Texte 1alicetrubert07Pas encore d'évaluation
- La Panthère Des Neiges - Sylvain TessonDocument2 pagesLa Panthère Des Neiges - Sylvain TessonSébastien PrêtrePas encore d'évaluation
- Eléments Pour Lanalyse Linéaire de Nuit BlancheDocument4 pagesEléments Pour Lanalyse Linéaire de Nuit Blanchebehohi6595100% (2)
- Texte 12 La Peau de ChagrinDocument3 pagesTexte 12 La Peau de Chagrinsheckyna86100% (1)
- Colette Sequence ComplèteDocument23 pagesColette Sequence ComplèteniombePas encore d'évaluation
- Le Mariage de Figaro de Beaumarchais (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLe Mariage de Figaro de Beaumarchais (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Cours Classe AntoineDocument2 pagesCours Classe AntoinelyblancPas encore d'évaluation
- Fables, La Cour Du LionDocument3 pagesFables, La Cour Du LionEthan PlenkPas encore d'évaluation
- Maitres Et Valets Dans La Comédie Du XVIIIe Siècle - Rapports, Renversement Des Roles, Fonctions Du Masque, ComiqueDocument50 pagesMaitres Et Valets Dans La Comédie Du XVIIIe Siècle - Rapports, Renversement Des Roles, Fonctions Du Masque, ComiqueTamara Taska ZajicPas encore d'évaluation
- La MetriqueDocument7 pagesLa MetriquegezzkeyPas encore d'évaluation
- Débuter Le Commentaire - Rentabiliser Sa Lecture Et Construire Le BrouillonDocument2 pagesDébuter Le Commentaire - Rentabiliser Sa Lecture Et Construire Le BrouillonlyblancPas encore d'évaluation
- Fiche Texte 2Document4 pagesFiche Texte 2alicetrubert07100% (1)
- Séance Sur Poème de Ronsard, Mignonne Allons Voir Si La RoseDocument2 pagesSéance Sur Poème de Ronsard, Mignonne Allons Voir Si La RoseEmelyne BRASSARTPas encore d'évaluation
- Manon Lescaut L'enterrementDocument3 pagesManon Lescaut L'enterrementbenoldikillianPas encore d'évaluation
- Analyse LinéaireDocument6 pagesAnalyse LinéaireEMMANUEL LOUMANAPas encore d'évaluation
- Extrait de Texte de COLETTE. "Les Vrilles de La Vigne" Part3Document4 pagesExtrait de Texte de COLETTE. "Les Vrilles de La Vigne" Part3isdhydPas encore d'évaluation
- Texte 2 Vrilles de La Vigne Jour Gris Lecture LinéaireDocument3 pagesTexte 2 Vrilles de La Vigne Jour Gris Lecture Linéairechiaraguzzo20Pas encore d'évaluation
- Sido Texte 5Document2 pagesSido Texte 5wennamanyPas encore d'évaluation
- TEXTE BAC N°2 Extrait Acte II Scène 8 Le M.I (Molière)Document6 pagesTEXTE BAC N°2 Extrait Acte II Scène 8 Le M.I (Molière)Raiii.78Pas encore d'évaluation
- EL 16 - Manon Lescaut - V.réduite Lettre de ManonDocument3 pagesEL 16 - Manon Lescaut - V.réduite Lettre de Manonluke100% (1)
- Analyse Linéaire Giton Et PhédonDocument6 pagesAnalyse Linéaire Giton Et Phédonmyriambengamra0110Pas encore d'évaluation
- Épreuve Orale Anticipée de Français: Liste Des Œuvres SESSION 2023Document24 pagesÉpreuve Orale Anticipée de Français: Liste Des Œuvres SESSION 2023Jules TerpantPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire N°3 Peau de ChagrinDocument2 pagesAnalyse Linéaire N°3 Peau de ChagrinGabin SerfatiPas encore d'évaluation
- Devoir Sur Les Incipit Et CorrigéDocument6 pagesDevoir Sur Les Incipit Et CorrigéHuythjkPas encore d'évaluation
- Guide Hatier Enseignant de La Pièce de Marivaux Les Fausses ConfidencesDocument21 pagesGuide Hatier Enseignant de La Pièce de Marivaux Les Fausses ConfidencesFrancoise GPas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation Colette 2023Document5 pagesCorrigé Dissertation Colette 2023lyblancPas encore d'évaluation
- Autour de Ronsard Le Poete Des Amours Multiples À Forme FixeDocument8 pagesAutour de Ronsard Le Poete Des Amours Multiples À Forme Fixebeebac2009Pas encore d'évaluation
- La Celebration Du MondeDocument2 pagesLa Celebration Du Mondesiyeon9242Pas encore d'évaluation
- Les Figures de Style - ExercicesDocument3 pagesLes Figures de Style - Exerciceshabib hassinePas encore d'évaluation
- La mort n'oublie personne: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLa mort n'oublie personne: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- COMMENTAIRE - INTRODUIRE - ExercicesDocument4 pagesCOMMENTAIRE - INTRODUIRE - ExercicesElia DjamadarPas encore d'évaluation
- La Personnalité de Colette Préparation Au Bac - OdtDocument2 pagesLa Personnalité de Colette Préparation Au Bac - OdtMister SPas encore d'évaluation
- Etude Linéaire 2: Le Merle, SidoDocument1 pageEtude Linéaire 2: Le Merle, SidoSzleperPas encore d'évaluation
- A La Musique Rimbaud AnalyseDocument7 pagesA La Musique Rimbaud Analysemjegham2019Pas encore d'évaluation
- Volpone FrancaisDocument606 pagesVolpone FrancaislidiavianuPas encore d'évaluation
- Corrige Positionnement Francais 3e A 1315137Document10 pagesCorrige Positionnement Francais 3e A 1315137douzi nourPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire N°2 (L'évasion)Document4 pagesLecture Linéaire N°2 (L'évasion)lillyta2007Pas encore d'évaluation
- Britannicus de Racine Acte 2 Scène 6Document2 pagesBritannicus de Racine Acte 2 Scène 6MakachPas encore d'évaluation
- Fiche Bac RimbaudDocument2 pagesFiche Bac RimbaudElise ArteroPas encore d'évaluation
- LLn2 CorrectionDocument3 pagesLLn2 CorrectionRayane Mohamed FilaliPas encore d'évaluation
- Explication Linéaire Du Texte 11 - Portrait de L'antiquaireDocument3 pagesExplication Linéaire Du Texte 11 - Portrait de L'antiquaireClo05Pas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire Texte 7Document4 pagesAnalyse Linéaire Texte 7blauzac2020100% (1)
- 5 Explication Linéaire LhuitreDocument2 pages5 Explication Linéaire LhuitreMaxence DuboisPas encore d'évaluation
- Commentaire Promenade de Picasso PrévertDocument3 pagesCommentaire Promenade de Picasso PrévertMoisson100% (1)
- Moliere LL 14Document6 pagesMoliere LL 14G BPas encore d'évaluation
- Commentaire - La Roque - Séquence Poésie - 2nde PDFDocument1 pageCommentaire - La Roque - Séquence Poésie - 2nde PDFlyblancPas encore d'évaluation
- Annales 2012 Séries technologiques "Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours" (Bac de français): Réussir le bac de françaisD'EverandAnnales 2012 Séries technologiques "Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours" (Bac de français): Réussir le bac de françaisPas encore d'évaluation
- Sujets DM 2023-24 en PremièreDocument1 pageSujets DM 2023-24 en PremièrelyblancPas encore d'évaluation
- Grasse Matinée Tableau Outils CompleteDocument6 pagesGrasse Matinée Tableau Outils CompleteShivangi MaheshwariPas encore d'évaluation
- Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand: Questionnaire de lectureD'EverandCyrano de Bergerac d'Edmond Rostand: Questionnaire de lecturePas encore d'évaluation
- Corrigé Du DS de Fin de SéquenceDocument8 pagesCorrigé Du DS de Fin de SéquencelyblancPas encore d'évaluation
- Extrait 3 - TANGUY VIEL Texte - NotaireDocument1 pageExtrait 3 - TANGUY VIEL Texte - NotairelyblancPas encore d'évaluation
- Cours Classe - Mouvements - Chap 38Document7 pagesCours Classe - Mouvements - Chap 38lyblancPas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation RabelaisDocument3 pagesCorrigé Dissertation RabelaislyblancPas encore d'évaluation
- Extrait MiroirDocument1 pageExtrait MiroirlyblancPas encore d'évaluation
- Entraînement À La Dissertation - Sujet 1 - CorrigéDocument5 pagesEntraînement À La Dissertation - Sujet 1 - Corrigélyblanc100% (1)
- Cours 1 - BéréniceDocument1 pageCours 1 - BérénicelyblancPas encore d'évaluation
- Corrigé - Question de Réflexion Louise Labé - 215Document6 pagesCorrigé - Question de Réflexion Louise Labé - 215lyblanc100% (1)
- Transversale Sur ColetteDocument12 pagesTransversale Sur Colettelyblanc100% (1)
- Corrigé de Dissertation - H DorionDocument5 pagesCorrigé de Dissertation - H Dorionlyblanc100% (2)
- Balzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude LinéaireDocument10 pagesBalzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude Linéairelyblanc100% (1)
- Hélène Dorion - Étude Linéaire - Texte 1Document15 pagesHélène Dorion - Étude Linéaire - Texte 1lyblanc100% (2)
- Hélène DORION - Mes Forêts - Étude Inédite - Version DraftDocument88 pagesHélène DORION - Mes Forêts - Étude Inédite - Version DraftlyblancPas encore d'évaluation
- Maquette Séquence Bérénice - SecondeDocument1 pageMaquette Séquence Bérénice - SecondelyblancPas encore d'évaluation
- Textes BéréniceDocument10 pagesTextes BérénicelyblancPas encore d'évaluation
- Hélène Dorion, Mes Forêts - Présentation GénéraleDocument20 pagesHélène Dorion, Mes Forêts - Présentation GénéralelyblancPas encore d'évaluation
- Présentation de La Seconde en FrançaisDocument8 pagesPrésentation de La Seconde en FrançaislyblancPas encore d'évaluation
- Sujet La Poésie Séquence DORIONDocument1 pageSujet La Poésie Séquence DORIONlyblancPas encore d'évaluation
- Réf. Documentaires - Grand OralDocument10 pagesRéf. Documentaires - Grand OrallyblancPas encore d'évaluation
- Simone WEIL - Cours - Classe Du 05 04 2023Document4 pagesSimone WEIL - Cours - Classe Du 05 04 2023lyblancPas encore d'évaluation
- Prépa Oral Seconde Partie ("Salina")Document2 pagesPrépa Oral Seconde Partie ("Salina")lyblanc50% (2)
- Ra23 Lycee GT 1 Francais Dorion EntretienDocument5 pagesRa23 Lycee GT 1 Francais Dorion EntretienlyblancPas encore d'évaluation
- L'Année de PremièreDocument7 pagesL'Année de PremièrelyblancPas encore d'évaluation
- Discours Contre La Misère - ClasseDocument1 pageDiscours Contre La Misère - ClasselyblancPas encore d'évaluation
- Le Grand OralDocument9 pagesLe Grand OrallyblancPas encore d'évaluation
- Francais Premiere 2023 Amerique Nord Sujet OfficielDocument4 pagesFrancais Premiere 2023 Amerique Nord Sujet OfficiellyblancPas encore d'évaluation
- Récapitulatif EAF 1STMG2 DRAFTDocument5 pagesRécapitulatif EAF 1STMG2 DRAFTlyblancPas encore d'évaluation
- Exercice de Contraction À Partir de Didier FASSINDocument1 pageExercice de Contraction À Partir de Didier FASSINlyblancPas encore d'évaluation
- La Famille (Familia)Document2 pagesLa Famille (Familia)Maria-Lucia NINUPas encore d'évaluation
- Verbes de MouvementDocument28 pagesVerbes de MouvementVictoria MascaliucPas encore d'évaluation
- Proust - Hors-Série N 2Document15 pagesProust - Hors-Série N 2Antonio Trullen100% (1)
- Crimes (2E) - Manuel de L'enquêteurDocument498 pagesCrimes (2E) - Manuel de L'enquêteurJeremie Pingret100% (3)
- Comment Seduire La Femme Belier (3 Pages - 75 Ko)Document3 pagesComment Seduire La Femme Belier (3 Pages - 75 Ko)N'goran koffi honorePas encore d'évaluation
- اختبار فرنسية 2023Document2 pagesاختبار فرنسية 2023رحيق الأزهارPas encore d'évaluation
- Le Voreux PDFDocument1 pageLe Voreux PDFlyblancPas encore d'évaluation
- Jour 1Document2 pagesJour 1Lola HermannPas encore d'évaluation
- Qui Sont Les Chiens Et Les Porcs Selon Le ChristianismeDocument8 pagesQui Sont Les Chiens Et Les Porcs Selon Le ChristianismeSeyfou IslamPas encore d'évaluation
- Final Fantasy X Introduction Et SoluceDocument89 pagesFinal Fantasy X Introduction Et SoluceDall'Angelo Céline100% (4)
- Le Goût Du Néant, Prise de Notes Analyse Linéaire: Antithèse - Métaphore Filée NihilismeDocument3 pagesLe Goût Du Néant, Prise de Notes Analyse Linéaire: Antithèse - Métaphore Filée NihilismeLouis BoulayPas encore d'évaluation
- 2020 2al Théa cp3Document5 pages2020 2al Théa cp3Papeterie Boussta100% (1)
- Ethymologie MorandDocument390 pagesEthymologie MorandMircea CristianPas encore d'évaluation
- BrassensDocument204 pagesBrassensgeronim ougi bPas encore d'évaluation
- Guide Pratique Du Mémoire M2 Professionnel - Paris 3 Sorbonne NouvelleDocument6 pagesGuide Pratique Du Mémoire M2 Professionnel - Paris 3 Sorbonne NouvellearielnjilaPas encore d'évaluation
- DDFC Fiche DissertationDocument8 pagesDDFC Fiche Dissertationtheoxyder100% (3)
- 2022 SECU - M2 BoulangeraDocument291 pages2022 SECU - M2 BoulangeraazertyPas encore d'évaluation
- Extrait de MerDocument8 pagesExtrait de MerDorina MohenjoPas encore d'évaluation
- Esthétique de La RéceptionDocument3 pagesEsthétique de La RéceptionSùcr Ęttę100% (2)
- La Science FictionDocument3 pagesLa Science FictionPatchari DECOCKPas encore d'évaluation
- Labriolle - Sources de Histoire Du Montanisme PDFDocument430 pagesLabriolle - Sources de Histoire Du Montanisme PDFpasuasafcoPas encore d'évaluation
- Clairefontaine - C01 PDFDocument156 pagesClairefontaine - C01 PDFMollan&filsPas encore d'évaluation
- XIX SiecleDocument22 pagesXIX SiecleTanja AdamovicPas encore d'évaluation
- Guibert Et Al. - 2023 - Ce Que Le Genre Fait Au Tourisme (Et Inversement) .Document10 pagesGuibert Et Al. - 2023 - Ce Que Le Genre Fait Au Tourisme (Et Inversement) .Léna GruasPas encore d'évaluation
- LIVRE-REVUE-LITTÉRATURE-nº 52-Georges BatailleDocument137 pagesLIVRE-REVUE-LITTÉRATURE-nº 52-Georges Bataillesdoreau001Pas encore d'évaluation
- Confucius PenseesDocument3 pagesConfucius PenseesgirliePas encore d'évaluation
- Dragon Age JdR-Aide de JeuDocument75 pagesDragon Age JdR-Aide de JeuhugoPas encore d'évaluation
- Cahier #87: FuentesDocument6 pagesCahier #87: FuentesHerne EditionsPas encore d'évaluation
- DPcomicsDocument30 pagesDPcomicsNtumba NtumbaPas encore d'évaluation
- Alchimie de La DouleurDocument4 pagesAlchimie de La DouleuryasminaPas encore d'évaluation